PROCÈS-VERBAUX DES AUDITIONS
EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
D'ENQUÊTE
Audition de M. Sébastian
ROCHÉ,
sociologue
(6 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Sebastian Roché, sociologue, chargé de recherches au CNRS et enseignant à Grenoble, Paris et Lyon.
Vous êtes, en outre, Monsieur Roché, l'auteur d'un ouvrage intitulé : La délinquance des jeunes : les 13-19 ans racontent leurs délits .
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole.
M. Sebastian Roché - Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de récapituler ce qu'est la délinquance des mineurs et d'essayer de décrire quelles sont les explications du phénomène.
Ce qui me frappe, tout d'abord, c'est le fait que ce phénomène et son augmentation ont été négligés depuis un certain nombre d'années au motif que les comportements des jeunes n'étaient pas aussi nombreux ni aussi graves que cela.
Or, nous savons que cette délinquance augmente depuis les années soixante-dix. Je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que ce développement de la délinquance des mineurs dure maintenant depuis longtemps et qu'il faut sans doute rechercher les moyens de mieux comprendre et de mieux agir contre cette délinquance. C'est le premier élément.
Deuxième élément liminaire : j'ai souhaité faire une sorte d'équilibre entre le fait de ne pas dramatiser la situation et celui de souligner les tendances réelles à l'aggravation de cette délinquance. A chaque fois, j'ai essayé de le faire à partir d'éléments qui ne soient pas mon opinion, mais qui soient appuyés sur des travaux empiriques à caractère universitaire.
En ce qui concerne la réalité de la délinquance et ses caractéristiques, la première chose qui me vient à l'esprit est que les jeunes auteurs de délits sont d'abord des jeunes victimes de délits. Par conséquent, la répression des auteurs ne saurait suffire ; il faut également se tourner simultanément vers la protection des jeunes qui seront leurs victimes.
Structurellement, la délinquance des jeunes a toujours existé. Ce qui a varié, c'est le volume et la gravité des actes. Dès lors, comment peut-on enregistrer cette augmentation du volume et de la gravité des actes ?
Depuis 1972, nous pouvons le faire à travers les mises en cause auxquelles procèdent la police et la gendarmerie. Ces mises en cause de mineurs depuis 1972 montrent en fait deux grandes tendances : la période 1972-1993 au cours de laquelle il y a une augmentation substantielle mais légère des délits, et la période 1993-2001 où cette fois l'accroissement du nombre de mises en cause est extrêmement sensible. Ainsi, l'on passe de 93 000 mises en cause en 1993 à 175 000 autour de l'an 2000.
Nous assistons donc à un phénomène d'accélération qui, à mon avis, n'est pas anodin puisqu'il fait suite à une trentaine d'années d'augmentation des comportements de vol. Je note d'ailleurs que cette grande facilité de réalisation des vols a sans doute fini par porter ses fruits en termes de passage à la vitesse supérieure, y compris à des comportements violents qui font l'objet de mises en cause.
A travers cette évolution, nous constatons - c'est une banalité, mais il n'est pas inutile de le rappeler - que la délinquance des jeunes n'est pas quelque chose d'unifié, de palpable, mais qu'il y a au contraire une diversité d'actes et de motifs.
Pour ce qui est de la diversité des actes, viennent en premier lieu les dégradations qui sont les actes les plus fréquemment commis par les jeunes en quantité ; puis les actes de vols motivés par le profit ou par l'économie. Ensuite, viennent les actes d'une intensité supérieure, je veux parler des agressions physiques. Or, évidemment, les causes qui valent pour certains actes ne valent pas nécessairement pour les autres.
Il existe toute une série de comportements, je pense, notamment, au commerce d'objets volés ou au commerce de cannabis essentiellement - beaucoup plus rarement au commerce de drogues dures qui intéresse surtout les jeunes majeurs. Il ne faut pas oublier non plus les comportements anti-institutionnels tels que les incendies de postes de police, éventuellement de gendarmeries, voire d'établissements scolaires, par exemple.
Tous ces actes existaient déjà dans les années soixante et nous les retrouvons aujourd'hui dans toute leur diversité. Simplement, aujourd'hui ils sont plus nombreux et plus violents dans leur manifestation.
En ce qui concerne les explications que l'on peut essayer de développer, je voudrais d'abord faire une différence entre expliquer quelque chose, le comprendre et agir. Cela vous paraîtra peut-être un peu trivial, mais il me semble important de le dire.
En tant que sociologue, je peux procéder à une explication, mais il n'est pas du tout certain qu'une fois que l'on aura isolé les facteurs qui alimentent un phénomène, l'on soit en mesure d'agir. Cela est dû bien souvent au fait que certains des facteurs sont des facteurs qui ont eu lieu dans le passé et qui continuent à agir. Or, puisqu'on ne peut retourner dans le passé, on ne peut pas agir sur les facteurs qui sont à l'oeuvre au temps « t ».
Imaginons, par exemple, l'évolution de société que représente la multiplication des familles monoparentales, évolution contre laquelle on ne peut pas agir au sens où l'on pourrait forcer les gens à vivre ensemble. De la même façon, en ce qui concerne les effets du divorce qui, d'ailleurs, sont moins marqués que les effets des familles monoparentales sur la délinquance des enfants, on ne peut faire diminuer le taux du divorce, on ne peut forcer les gens à rester ensemble. Le pourrait-on que les conditions de vie à l'intérieur des familles et les relations entre parents ou entre parents et enfants ne seraient pas meilleures.
Nous avons donc affaire à des causes sur lesquelles nous n'avons pas de prise directe. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, l'analyse des facteurs qui permettent de limiter la délinquance doit être différente de l'analyse qui porte sur les causes. En d'autres termes, savoir ce qui motive un phénomène est une chose, savoir ce qui permet de le freiner en est une autre.
Je vais maintenant essayer de décrire quelques caractéristiques de la délinquance sur un modèle d'explication relativement concentré. Je le ferai à partir d'une enquête que j'ai dirigée et qui portait sur 2300 jeunes dans les deux agglomérations de Saint-Etienne et de Grenoble, donc des villes-centres contenant à leur périphérie des villes importantes ainsi qu'une trentaine de petites communes qui se situent en fait en zone gendarmerie. Il s'agit donc d'un échantillon qui représente bien, à mon avis, la situation des grandes villes et des villes moyennes en France, à l'exception de Paris intra muros qui est une ville tout à fait unique et spécifique, y compris en matière de délinquance.
Avant de passer en revue les éléments que fait ressortir cette enquête, je voudrais signaler l'importance de tenir des discours qui soient documentés empiriquement, c'est-à-dire qui ne soient pas seulement fondés sur des impressions.
En premier lieu, on trouve une très forte concentration de la délinquance sur un petit ensemble de personnes : c'est ce que l'on appelle la théorie des 5 %. En effet, d'après les jeunes auteurs de délits eux-mêmes, il y a bien 5 % qui « pèsent » 60 % à 85 % du total des actes -60 % des actes tels que le vol, mais 85 % des actes de trafic. Ces 5 % de jeunes sont motivés par une activité de délinquance qui n'est pas seulement démonstrative, mais qui est ancrée dans la production de richesses- par des moyens illégaux, certes, mais il s'agit tout de même de production de richesses.
Or il est évident qu'il existe ici deux sortes de délinquants : ceux qui volent par occasion et qu'il suffit d'intimider et ceux qui tirent des revenus substantiels de la revente du cannabis essentiellement ou, secondairement, d'objets volés. Il est clair que ces deux populations ne répondront pas aux mêmes politiques de prévention et de répression.
Cela m'amène à développer un deuxième élément important, je veux parler du rajeunissement des délinquants. D'après les déclarations des jeunes auteurs de délits eux-mêmes, on note une augmentation du nombre de ceux qui réalisent des délits avant 13 ans. Lorsqu'il y a augmentation du niveau de violence des jeunes, cela suppose qu'ils sont entrés plus tôt dans la délinquance. Par conséquent, le rajeunissement et l'augmentation du niveau de violence des actes sont un seul et même phénomène, selon moi. C'est un peu comme au tennis : pour être un champion, il faut commencer à s'entraîner jeune.
Dès lors, la délinquance étant une activité comme une autre, elle nécessite l'acquisition d'un savoir-faire, la levée de toute une série d'inhibitions, l'expérience du frisson du cambriolage. Quant à l'utilisation d'armes -12 % des jeunes reconnaissent en avoir une occasionnellement- elle correspond à un outil de productivité : il est plus simple de convaincre quelqu'un vite si l'on a un couteau à la main que si l'on n'en a pas !
C'est donc l'entrée précoce dans la délinquance qui permet d'atteindre à l'âge de 16 ans, par exemple, la possibilité de réaliser un certain nombre de comportements relativement offensifs, voire très offensifs vis-à-vis des cibles qu'ils se sont données.
J'ai également pointé tout à l'heure, mais je voudrais y revenir, l'importance du trafic qui doit également être liée, me semble-t-il, à l'augmentation de la violence des actes. En effet, lorsqu'il y a une motivation économique à être violent, il y a beaucoup plus de chances de passer réellement à l'acte. Autrement dit, une fois qu'il est entré dans le trafic, le jeune délinquant va devoir se faire respecter des autres trafiquants, des autres caïds, comme il va devoir se faire respecter de la population et de la police. Or, dans ce contexte, la violence est un moyen utile, je dirai presque indispensable.
J'essaie ici simplement de montrer les liens qui existent entre le rajeunissement, la violence et le commerce à un moment où le chômage a tout de même considérablement diminué et où, parallèlement, il y a une explosion des mises en cause des jeunes pour des actes de plus en plus graves. Il faut bien trouver une explication à ce phénomène.
Je ne m'étendrai pas sur d'autres caractéristiques qui sont bien connues : ainsi le fait, par exemple, que la délinquance touche les jeunes garçons et non pas les jeunes filles ou le fait qu'à 13 ans la délinquance soit essentiellement une délinquance de dégradation que j'appelle démonstrative et qui ne rapporte rien à ses auteurs : on se fait voir et on ne gagne rien !
Plus l'on s'approche de l'âge de 19 ans, plus ces dégradations s'effondrent en quantité au profit des actes qui rapportent, c'est-à-dire les vols et les trafics. Il y a donc ici ce que l'on appelle rationalisation de l'activité délinquante. En même temps que les jeunes apprennent à compter à l'école, ils transfèrent ce savoir-faire dans la rue. Il s'agit là d'un élément important car la délinquance à 13 ans n'est pas la même qu'à 19 ans, de même que la prévention et la répression ne sont pas les mêmes à 19 ans et à 13 ans.
En ce qui concerne la consommation de cannabis, elle est liée avant tout au plaisir et cette recherche est souvent présente chez les jeunes délinquants. Mais, dans ce domaine, les comportements varient en intensité de violence et peuvent aller du simple trafic à des comportements violents physiquement lorsque le jeune délinquant est précisément sous l'emprise de psychotropes légaux ou illégaux, c'est-à-dire surtout l'alcool et le cannabis, et plus l'on s'approche de la majorité, plus ce phénomène est fréquent.
J'en viens aux causes de tous ces phénomènes, causes qui interviennent avant le délit, au moment du délit et après le délit.
Tout d'abord, les sociologues, en tout cas ceux qui s'appuient sur des données empiriques, ne peuvent aujourd'hui parler de détermination. Par exemple, les jeunes qui habitent dans les banlieues, c'est-à-dire dans l'habitat social hors centre ville, ne sont pas tous auteurs de délits graves et la plupart de ces jeunes se retiennent de passer à l'acte en matière de délinquance violente. Inversement, dans les milieux urbains, une partie non négligeable des jeunes passe à l'acte, je pense, notamment, au trafic de cannabis. Par conséquent, en aucun cas on ne peut dire que le milieu social détermine les comportements au sens où une catégorie donnerait 100 % de délinquants dans cette catégorie.
Quelles sont donc les motivations internes qui préparent à la réalisation des actes ?
J'évoquerai en premier lieu l'échec scolaire. En effet, lorsqu'un enfant est « mauvais » à l'école, eh bien, il est mauvais obligatoirement jusqu'à 16 ans, six heures par jour ! Cette situation est vécue par les jeunes comme une sorte d'humiliation, une confrontation à une institution qui leur renvoie une image négative d'eux-mêmes. Cet échec sur le plan scolaire est l'un des premiers prédicteurs du comportement délinquant.
De la même façon, dans les milieux favorisés, les jeunes qui ne sont pas à la hauteur des espérances mises en eux par leurs parents - et Dieu sait si ces espérances sont grandes ! - se tournent vers une autre réalisation qu'à l'école, dans la rue.
En deuxième lieu, je mentionnerai les blocages à l'intérieur de la famille. Au cours de l'enquête sur la délinquance que j'ai dirigée se trouve une liaison entre famille monoparentale et délinquance violente. Dans cette optique, les principaux facteurs qui jouent sont au nombre de deux : il s'agit, d'une part, du climat de la famille plus que de la structure familiale, qui paraît prépondérant, et, d'autre part, plus encore que du climat familial, il s'agit de la supervision des parents par rapport aux enfants concernant notamment leur emploi du temps.
Ainsi, la scolarisation de masse et l'entrée tardive sur le marché du travail constituent deux éléments essentiels de la plus grande latitude laissée aux jeunes.
En milieu urbain, il est relativement compliqué pour les parents de surveiller leurs enfants s'ils ne leur ont pas fait accepter les règles. Or ces règles sont simples et pourraient s'énoncer ainsi : « Avec qui tu sors ? Où tu vas ? A quelle heure tu rentres ? » Eh bien, des choses aussi simples sont des excellents prédicteurs de la délinquance des jeunes.
Si les parents ne sont pas dans la position de faire naître ces exigences à l'intérieur de l'enfant, celui-ci naturellement échappera à leur contrôle et ira se réaliser ailleurs, dans la rue. La contrainte doit donc être apprise et intériorisée. A cet égard, le pire est sans doute un père qui a des bouffées de colère et qui s'emporte parfois jusqu'à frapper son enfant. Cette attitude ne marche pas en termes de prévention de la délinquance ; ce qui marche, c'est la continuité de la veille éducative, la continuité de la supervision.
Enfin, il est un dernier élément sur lequel je serai bref : les groupes de pairs qui sont des facteurs de motivation. En d'autres termes, quand les copains disent à un jeune : « Tu seras le meilleur si tu parviens à caillasser le car de police ou le bus qui passe », la motivation est très forte car le jeune trouve une estime de soi auprès des copains. C'est là un moteur plus fort que la sanction. En effet, ce qui est pris en compte par les plus jeunes des jeunes, les 13-15 ans, ce ne sont pas tellement les sanctions qui arrivent après les actes, mais la réussite des actes eux-mêmes et l'encouragement à la réussite par les groupes de pairs.
Evidemment, il ne faut pas oublier l'origine socio-économique des enfants, mais je serai également bref sur ce point.
Entre 1970 et aujourd'hui - ou même depuis la fin de la Seconde guerre mondiale - on a remplacé une population de personnes âgées pauvres par une population de jeunes pauvres qui sont sortis du système scolaire et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. En fait, la pauvreté a été massivement réduite dans notre pays mais ce qui a surtout changé, c'est la structure démographique de la pauvreté, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des personnes âgées pauvres, on a des jeunes pauvres, ce qui, en matière de délinquance, est tout à fait différent.
En revanche, je voudrais insister sur un autre élément extrêmement important quand il s'agit du passage à l'acte : c'est le fait d'anticiper le succès de son comportement. Je ne parle pas là de l'impunité par rapport aux réactions et je dissocie la réalisation des actes des conséquences de celui-ci. Ce qui est frappant, c'est que les jeunes ne s'engagent que dans des actes dont ils ont la certitude de les réussir.
Je prendrai un exemple : avant 13 ans, les jeunes délinquants s'attaquent essentiellement à des lieux publics qui ne sont surveillés par personne. A cet âge, les délinquants entrent par les portes ouvertes. Ils ne font pas preuve d'une très grande inventivité.
C'est la même chose pour ce qui concerne les vols : avant 13 ans, les jeunes délinquants volent en supermarché ou en hypermarché, c'est-à-dire dans des lieux où le système de distribution est tel que les produits sont à portée de la main. Ce genre de vol est extrêmement simple à réaliser car il n'y a pas de résistance au sens propre.
Ce n'est que lorsqu'il aura acquis les réflexes nécessaires que le jeune passera à la vitesse supérieure, c'est-à-dire lorsqu'il sera sûr de réussir compte tenu de la résistance de sa cible. C'est la raison pour laquelle les jeunes s'attaquent d'abord à d'autres jeunes, ceux-ci étant moins résistants que les adultes et aussi parce qu'ils portent beaucoup moins souvent plainte que les adultes. En ce sens, les jeunes sont particulièrement vulnérables car, en s'attaquant à un jeune de 16 ans, le racketteur sait très bien que le jeune n'ira pas porter plainte ; c'est un problème sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs.
Succès et anticipation sont donc des éléments fondamentaux et l'on ne pourrait pas comprendre l'explosion des vols si l'on ne comprenait pas la mise en place de la grande distribution et le fait que des villes anonymes ne cessent de grandir. C'est aussi simple que cela, il ne s'agit pas de déplorer cette évolution mais d'en tenir compte. De ce point de vue, le meilleur prédicteur statistique de la délinquance, ce sont les conditions d'urbanisation dans tous les pays du monde et également en France.
Voyons maintenant ce qui se passe après l'acte. Cette fois, le jeune va se trouver face à la double réaction de la justice et de la société civile. Or il est à noter la faiblesse de cette double réaction. Ainsi, lorsqu'on demande à un jeune qui réalise un délit : « Est-ce que vous avez été vu ? », pour la plupart d'entre eux ils ont effectivement été vus par un public passif, ce qui leur donne évidemment un sentiment de puissance.
Pour ce qui est des sanctions proprement dites, il convient de séparer les délits peu graves des délits graves. Pour les délits peu graves, environ 10 % des auteurs ont été confrontés à un policier à la suite de la réalisation d'un délit et 2 % ont été présentés à un magistrat. Concernant les vols avec violence, le pourcentage augmente puisqu'il est de 15 % dans le premier cas et de 5 % dans le second. Il reste donc entre 80 % et 85 % des jeunes qui jamais, au cours de leur vie, n'ont été confrontés à l'autorité du système pénal.
Ce dont je parle ici, c'est de la prise de risque d'être sanctionné par le délinquant, prise de risque qui est extrêmement limitée. Cela est encore plus vrai en matière de drogues où le taux est inférieur à 2 %. Le trafic ne fait pas de victimes ; il se fait entre personnes consentantes. Par conséquent, il est peu ou pas signalé aux autorités. C'est la raison pour laquelle le principal acte de délinquance en milieu scolaire est lié au trafic. Cet acte ne fait pas de bruit, pas de vague, il n'est repéré par personne. Il n'y a donc aucune contradiction entre le sentiment de surcharge des magistrats qui condamnent les mineurs lorsque ceux-ci leur sont présentés et la faiblesse des risques courus par les délinquants.
Enfin, je voudrais insister sur la difficulté qu'il y a à prononcer des peines qui sont à la fois éducatives et proportionnées aux actes. En général, la justice garde les peines pour plus tard. Le système pénal étant surchargé, il se réserve de traiter les actes les plus graves qui se produisent vers l'âge de 17, 18 ou 19 ans. Alors, le système pénal fonctionne mais son énergie est dépensée à sanctionner des actes quand il est trop tard, d'une certaine façon, trop tard en tout cas pour faire de la prévention.
M. le président - La commission d'enquête vous remercie de cet exposé très intéressant, monsieur Roché.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je voudrais revenir sur les motivations de l'acte et sur la certitude pour le mineur qui commet cet acte de réussir. Vous avez parlé de l'anonymat des espaces publics ainsi que du manque de sanctions pénales. Dès lors, que peut-on faire pour essayer de contrecarrer cette situation ?
M. Sebastian Roché - Mon sentiment est qu'il n'y a structurellement pas grand-chose à faire pour aller contre l'anonymat des villes tant il est vrai que la nature même des villes est de faire circuler des flux. Aujourd'hui, les lieux de travail sont dissociés des lieux de résidence qui, eux-mêmes, sont dissociés des lieux de loisirs, etc. La ville est donc en permanence un système de flux dans lesquels il ne peut y avoir de surveillance ou de veille mutuelle.
Cette situation est intéressante du point de vue de la délinquance des jeunes car ceux-ci sont les meilleurs connaisseurs des espaces autour de leur domicile alors que, pour les adultes, ce ne sont finalement que des espaces traversés. Il y a donc une socialisation territoriale des jeunes qui est en complet décalage avec la socialisation territoriale des adultes.
Cela étant dit, il me semble que l'on pourrait développer une logique de « garant des lieux », autrement dit de garant des espaces, à l'instar des correspondants de nuit dans certaines villes. Par exemple, pourquoi, dans les établissements scolaires, les agressions ont-elles lieu dans la cour ? Parce que, dans la cour, il n'y a pas de surveillants et c'est la même chose dans les transports, dans la rue, etc. Le garant des lieux serait ainsi une personne chargée de veiller à la qualité des espaces et à ce qui se passe dans ces espaces. Il est, selon moi, possible d'aller dans cette direction.
De plus, je suis évidemment partisan d'une réaction plus rapide lorsque les délits sont commis par de très jeunes personnes.
Mais il est très difficile de savoir « qui fait quoi ? » et de distinguer un jeune de moins de treize ans qui commet un vol pour la première et peut-être pour la dernière fois d'un autre jeune du même âge pour qui ce sera le premier d'une longue série. Les Canadiens travaillent sur ce sujet ; je ne suis pas très au fait des études de criminologie appliquée mais il y a sans doute des pistes à creuser dans cette direction, pour mieux identifier le profil de l'auteur et pour apporter la réponse adéquate.
Dans la mesure où l'on décide qu'une réponse pénale doit être apportée, je vous ai indiqué ma préférence : définir des peines de substitution à l'emprisonnement ou à l'amende -car celles-ci ne font pas sens pour les jeunes mineurs- permettant une réaction non pas plus dure, mais plus systématique et un petit peu moins erratique qu'aujourd'hui. En effet, actuellement, la peine n'est pas respectée : elle est tellement rarement prononcée que les jeunes délinquants ne lui accordent aucun crédit. C'est un peu comme une loterie : on se dit « pourquoi moi ? », « pourquoi serais-je pris ? ». La peine est considérée comme illégitime parce qu'elle est devenue trop rare. Il serait donc intéressant de la rendre un tout petit peu plus systématique et de développer notamment la collaboration avec les collectivités territoriales pour l'exécution des travaux d'intérêt général.
M. le rapporteur - D'après vos chiffres, moins de 5 % des mineurs qui commettent un délit sont connus des services de justice ; il me semble même que le taux est de 2 % pour les délits peu graves. D'où cela vient-il ? Les moyens sont-ils insuffisants ou inadaptés ? Que peut-on faire ?
M. Sebastian Roché - En fait, plusieurs éléments contribuent à expliquer ce phénomène.
L'anonymat est évidemment un premier élément : à partir du moment où aucune victime ne constate l'infraction et n'en reconnaît l'auteur, les services de police et de gendarmerie sont souvent dans l'incapacité d'identifier celui-ci.
Le deuxième élément, également bien connu et extrêmement préoccupant, est le faible niveau du taux d'élucidation des vols qui est de l'ordre de 10 %. Il est d'ailleurs surestimé puisque les statistiques officielles de la police et de la gendarmerie considèrent un acte comme élucidé si au moins un des auteurs a été trouvé. Si un « coup » est réalisé par trois personnes, mais qu'un seul est identifié, cet acte est considéré comme élucidé.
On se trouve donc devant une difficulté structurelle qui repose en partie sur l'anonymat bien sûr, mais aussi sur la faiblesse des moyens d'identification des auteurs des délits. Plusieurs points importants sont à souligner à cet égard.
Premièrement, le travail de police judiciaire est très loin d'être fait systématiquement, ne serait-ce que pour les cambriolages. Les empreintes ne sont pas toujours relevées et ne peuvent donc pas être informatisées dans un fichier départemental : les policiers sont alors incapables de faire la liaison entre certaines affaires.
Deuxièmement -mais vous le savez très bien- les effectifs de la police et de la justice les plus importants se trouvent dans les départements ruraux dans lesquels moins de délits sont commis. En fait, l'Etat n'a pas su se moderniser ; pour être un peu caricatural, je dirais qu'il a « creusé sa propre tombe », en ne modernisant ni son administration ni son implantation territoriale. Pourtant, il a su ouvrir des écoles là où des villes se construisaient et fermer des casernes militaires suivant l'évolution des réalités géopolitiques mondiales. Il a également su fermer -et Dieu sait si les élus locaux n'ont pas apprécié !- un certain nombre de cliniques qui n'étaient plus aux normes. Mais il n'a su adapter ni les effectifs de la police, ni ceux de la gendarmerie, ni ceux encore -ce qui est peut-être moins connu- de la justice pénale au développement de la France urbaine.
Troisièmement, il faut noter un déficit en matière d'exécution des peines : une très grande partie des peines prononcées n'est en effet pas appliquée. En ce qui concerne les travaux d'intérêt général, nous ne disposons pas de chiffres précis. Les statistiques officielles de 1990 indiquent un taux de l'ordre de 60 % pour les travaux d'intérêt général exécutés au premier jour. Mais elles ne précisent pas le taux des travaux d'intérêt général intégralement exécutés. Les syndicats de magistrats de leur côté n'avancent qu'un pourcentage de 25 % d'exécution des travaux d'intérêt général pour ces dernières années.
C'est donc toute la chaîne pénale qui est très faible, qu'il s'agisse des taux d'élucidation, de la mauvaise implantation des effectifs ou de la non-exécution des peines.
M. le rapporteur - Je vais maintenant évoquer une question centrale que tout le monde se pose : le cadre législatif qui régit la délinquance des mineurs est-il bien adapté ? Que faudrait-il faire pour restaurer l'autorité, que ce soit celle de la famille ou celle de l'école ?
M. Sebastian Roché - J'ai essayé de souligner l'ampleur des dysfonctionnements des administrations publiques et leur inadaptation aux réalités de la France du début du XXème siècle. Mais je ne pense pas que la solution soit dans l'élaboration de nouveaux textes de loi.
Vous pouvez disposer du meilleur texte du monde sans être garanti de son efficacité Si vous ne placez pas les policiers et les gendarmes là où se commettent les délits, vous aurez très peu de chances d'arriver à faire fonctionner la chaîne pénale.
Prenons l'exemple de la Protection judiciaire de la jeunesse : c'est une administration extrêmement féminisée. Face à des délinquants qui sont particulièrement endurcis, c'est un élément de dysfonctionnements qui rend impossible l'application de textes si durs, si intelligents ou si novateurs soient-ils.
Une grande partie du problème de l'insécurité tient donc à l'inadaptation de l'Etat.
Pour autant, il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de fonctionnaires : ceux-ci sont simplement mal répartis sur le territoire, entre les communes riches et les communes pauvres. Il y a une inégalité de distribution qui ne correspond pas à la réalité de la délinquance, celle-ci étant d'autant plus grande que les problèmes sociaux sont plus intenses.
Comment restaurer l'autorité de l'Etat ? C'est une question très vaste. On peut certes agir sur les trois grands groupes de facteurs que j'ai déjà développés. Mais il faudrait aussi insister sur la socialisation de l'enfant qui doit se faire à la fois et à l'école et dans la famille.
A cet égard, je ne suis pas très partisan de la suppression des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Je ne crois pas tellement à l'efficacité de la mesure. En effet, les parents qui ont perdu toute autorité sur leurs enfants ne la regagneront pas, même si l'Etat exerce sur eux cette pression supplémentaire, car il s'agit d'une autorité morale : il ne s'agit pas dès lors de contraindre physiquement l'enfant, il aurait fallu lui inculquer auparavant des règles qu'il aurait pu intérioriser et faire siennes. A posteriori, la contrainte n'est pas suffisante. En revanche, je ne dis pas qu'il ne faille pas prévoir des mesures pénales spécifiques à l'encontre des familles qui organisent la délinquance de leurs enfants ; mais il s'agit d'un autre cas de figure.
Sur le plan scolaire, l'augmentation du niveau général a entraîné un effet non désiré : lorsque 80 % des jeunes vont jusqu'au baccalauréat, 20 % restent « sur le carreau ». L'idée d'emmener tout le monde à un niveau très haut pose problème et engendre fatalement ce genre de mécanisme contre-productif. Il serait intéressant de creuser la piste de la revalorisation des enseignements moins généralistes, dotés de bons enseignants, enseignants qui auraient un intérêt, y compris économique, à enseigner dans ce secteur.
S'agissant de la facilité de réalisation des délits, les organismes de logement, de transport et de distribution ont également, à leur niveau, des responsabilités. L'une des logiques à respecter serait d'intégrer la notion de sécurité dans la prestation du service, que ce soit dans le domaine du logement, des transports, etc. Il faudrait concevoir la sécurité en amont comme une activité ordinaire et rompre ainsi avec la conception de la sécurité comme mission régalienne, ce qui ne permet pas de l'inclure dans la prestation d'un service de qualité.
M. le président - En tant que rapporteur du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, j'avais proposé, non pas de supprimer les allocations familiales versées aux parents de mineurs délinquants, mais de prévoir des possibilités d'élargissement de mise sous tutelle de ces allocations. Votre réserve sur ce sujet demeure-t-elle dans ce cas là ?
M. Sebastian Roché - J'ai quelques réticences à me prononcer plus complètement sur ce sujet, parce qu'il faudrait auparavant mener une consultation. Je souhaite qu'une étude soit menée en collaboration avec la Caisse nationale d'allocations familiales. Effectivement, certains départements prononcent ces mesures beaucoup plus fréquemment que d'autres, cela dépend des choix politiques. Une étude permettrait alors de constater, d'un point de vue statistique, l'effet et l'apport de telles mesures.
Je préférerais me prononcer, non pas à partir d'une conviction, mais de faits constatés, ce qui n'est pas possible actuellement. Bref, pour l'instant, ma réserve est la même, mais elle pourrait être levée si les faits constatés pouvaient nous permettre vraiment d'orienter la politique.
C'est d'ailleurs une remarque que l'on peut faire plus généralement : s'il était possible en France de travailler à l'évaluation des effets plutôt que de se lancer dans des discussions sur ce qui est théoriquement vrai ou faux, ce serait extrêmement utile. Certains pays prévoient ainsi, dans les textes législatifs, donc au moment de la conception des mesures, des articles qui rendent obligatoire leur évaluation en la « budgétant ». C'est un exemple à suivre.
De la même manière, s'agissant des homicides commis par les mineurs, qui sont tout de même relativement peu fréquents -environ 6 %, à comparer aux 48 % que connaissent les Etats-Unis- il serait intéressant de disposer d'une rétrospective à l'échelle d'une grande ville de France, Lyon par exemple, qui permette de retracer l'évolution de ce type de délits. Il est en effet techniquement tout à fait possible d'avoir des données fiables sur la « contribution » -si j'ose dire- des jeunes à la criminalité violente.
M. Bernard Plasait - Vous avez dit que le risque d'être sanctionné pour les jeunes délinquants était très faible et que, dans leur « carrière » de jeune délinquant, 85 % d'entre eux ne rencontraient ni policier ni magistrat. Est-ce bien cela ?
M. Sebastian Roché - Absolument.
M. Bernard Plasait - Par conséquent, je commets sans doute une erreur lorsque, dans la « chaîne de production » de sécurité, je considère la justice comme le maillon le plus faible, dans la mesure où celle-ci est embouteillée et ne réussit pas à traiter les affaires avec la célérité nécessaire et où elle ne dispose pas des possibilités de prononcer des sanctions appropriées - je pense à cet égard au problème des places de prison.
Autrement dit, j'avais le sentiment que la police était sans doute plus efficace que la justice, mais qu'elle « butait » contre la justice. Ainsi, la police arrête le délinquant, le présente à la justice, qui manque de moyens. On a alors le sentiment que la justice est « laxiste ». En réalité, elle n'a sans doute pas les moyens de prononcer les sanctions qu'elle voudrait voir appliquer.
Cela signifie-t-il que la difficulté de traiter la délinquance est aussi liée au fait que la police n'est pas suffisamment présente sur le terrain ou n'est pas suffisamment efficace pour « entrer en contact » avec les jeunes délinquants dans 85 % des cas ?
M. Sebastian Roché - En fait, toute la chaîne pénale est en cause : il ne faut donc pas se polariser sur l'un des maillons. En effet, améliorer un seul des maillons et ne pas renforcer les autres ne renforce pas la solidité de l'ensemble de la chaîne. Actuellement, l'ensemble des maillons fonctionne relativement mal ; mais il faut bien admettre qu'élucider les délits n'est pas chose facile !
J'en reviens à nouveau à l'anonymat. La délinquance sort des villes et se déplace vers leurs périphéries. Or, dans ces périphéries, on vit désormais comme dans des villes et non plus du tout comme dans des villages : l'anonymat y est le même, les couples d'actifs partent le matin travailler, laissent leur maison pleine de biens pendant la journée, et reviennent le soir. Ces espaces sont de plus en plus difficiles à surveiller et sont donc des cibles accessibles et faciles pour les mineurs délinquants.
Dans les faits, la police de proximité, annoncée dans un certain dispositif législatif -je pense à la loi « Pasqua »- est très peu présente ou n'existe même pas. Les difficultés que connaissent la police et la justice ne sont donc pas seulement dues à un manque de moyens.
Les moyens de la justice sont également mal répartis et mal utilisés. Un certain nombre de magistrats ne croient pas à la sanction et continuent à considérer les actes des mineurs comme des « symptômes ». A l'intérieur même de la justice des mineurs, certains magistrats ne croient pas à l'utilité de la réaction rapide de la justice. Ainsi trouvez-vous en marge de certains dossiers des mentions comme « laisser prescrire », ce qui permet de « laisser courir » les délais et de ne pas donner aux délits de suite pénale.
Par ailleurs, les risques pris par les mineurs délinquants sont faibles. Il est intéressant de s'apercevoir que l'estimation des risques par les délinquants eux-mêmes ne joue pas directement sur leurs décisions de passer à l'acte, mais a un effet sur leur perception de la gravité de cet acte : autrement dit, les jeunes qui pensent qu'un acte n'est pas risqué pensent en fait qu'il n'est pas grave. Dans leur esprit, si rien n'est fait pour empêcher l'acte, c'est qu'il n'est pas si grave. La perception de la gravité par les jeunes est un excellent indicateur de leur passage à l'acte : s'ils pensent qu'agresser physiquement n'est pas grave, alors ils vont le faire.
M. Jacques Mahéas - Monsieur le président, je voudrais faire une proposition : pourrait-on avoir le livre de M. Roché ? A moins qu'il ne soit épuisé !
M. Sebastian Roché - Malheureusement non ! Mon éditeur était content mais il n'est pas épuisé quand même !
M. Jacques Mahéas - Ce qu'il nous a dit est fort intéressant. Nous pourrons certainement « puiser » des compléments dans cet ouvrage.
Monsieur Roché, j'ai noté dans vos propos un très grand pessimisme. Selon vous, la répression d'un mineur délinquant est extrêmement difficile car la police et la justice sont mal adaptées ; je le crois aussi et je recherche donc dans l'éducation et dans la vie antérieure de ce jeune les causes que vous avez définies et dont le traitement me semble effectivement prioritaire. En revanche, vous n'avez pas évoqué un certain nombre de causes sur lesquelles je voudrais vous interroger.
Vous avez évoqué l'échec scolaire. Il y a d'autres causes : notre société ne maîtrise rien dans l'éducation télévisuelle, dans les jeux vidéos extrêmement agressifs. Elle ne maîtrise pas grand chose non plus dans le marché parallèle ou dans le domaine de l'urbanisme et des grands ensembles urbains qui continuent à se construire.
Il faut également parler de l'échec des bonnes volontés. Ainsi, j'ai formé dans ma ville quarante employés communaux pour encadrer les jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général. Or il n'y a pratiquement pas de condamnation à ces travaux d'intérêt général. Hier encore, j'ai eu connaissance d'un jugement concernant des enfants qui avaient mis le feu à une voiture, ce qui devient commun maintenant. Ils ont été pris et ont reconnu les faits. Mais alors que les faits se sont passés en 1998, le jugement n'est intervenu que récemment ! Nous avions demandé 30 000 francs de dommages-intérêts. Ils n'ont reçu qu'une simple admonestation et n'ont été condamnés qu'à un franc de dommages-intérêts.
Ne pourrions nous pas, nous législateur, mieux adapter les lois aux mineurs ? Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mettre en place, pour la répression de certains litiges, certaines mesures qui seraient pourtant assez faciles à appliquer. Il faudrait certes une présence policière extraordinaire pour réprimer tous les actes de délinquance. Mais les faits constatés sont souvent des faits qui seraient faciles à réprimer. Par exemple, la prise d'un mineur en possession de cannabis constitue un fait constaté et un fait résolu : c'est extraordinaire pour la police ! Si on enlevait des statistiques ce type de délits, qui sont en grand nombre, on verrait que les phénomènes de dégradation sont encore pires que ce que l'on croit.
Ma réflexion va dans votre sens. Mais que peut-on faire pour « rééduquer » la société ? Pour être un peu moins pessimiste, je pense que l'on pourrait définir des règles établissant des limites dans les phénomènes de violence, parce que ces jeunes finissent par concevoir la violence comme une valeur.
M. Sebastian Roché - Je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit à propos des faits qui sont constatés et élucidés. Ainsi, la consommation de cannabis est, en réalité, quasiment dépénalisée en France et ne fait l'objet d'une procédure pénale que si elle est liée à d'autres délits.
S'agissant des vols, leur nombre est tellement important -plus de 2,5 millions- que la connaissance, même imparfaite, des taux d'élucidation donne une bonne idée de la difficulté d'action de la police et de la justice.
Sans être pessimiste, il faut être conscient du fait que la délinquance augmente en France depuis 1960 ; il faut bien donner une explication à un phénomène qui s'étale sur quarante ans. Les causes en sont lourdes et multiples. J'ai essayé de vous présenter celles qui me paraissent essentielles. En fait, parce que les meurtres n'ont pas augmenté, la gravité de la délinquance a été sous-estimée. Effectivement, il n' y a pas substantiellement plus d'homicides, mais le problème est ailleurs : c'est celui de l'augmentation des comportements violents, à caractère sexuel ou non, et des vols avec violence.
En ce qui concerne la réaction de la justice, il y a une vraie difficulté ; vous l'avez illustrée par votre exemple, monsieur le sénateur. Le problème ne vient pas seulement de dysfonctionnements de la police ou de la gendarmerie. A l'évidence, il y a également des dysfonctionnements et des lourdeurs du côté de la justice : cela a déjà été souligné cinquante fois. Même si les procédures ont été accélérées, la lenteur des traitements est flagrante. Même lorsque les auteurs sont identifiés, une grande partie des affaires est classée -le taux est de 45 % environ pour la décennie quatre-vingt dix. Une grande partie des actes n'est même pas traitée.
Quant aux travaux d'intérêt général, ce sont parfois les élus locaux qui ne sont pas très « chauds », mais, en outre, les magistrats ne sont souvent pas prêts encore aujourd'hui à prononcer ce type de peines. Les magistrats n'étaient pas non plus très « chauds » pour le développement des maisons de justice et du droit. On en dénombre actuellement à peine 70, ce qui, pour un pays de 60 millions d'habitants, est relativement faible.
De ce point de vue, la modernisation de la justice est donc très insuffisante. Les choses peuvent évoluer : il est possible de modifier les relations entre les collectivités locales et la justice, afin de faciliter la passation de conventions entre elles et d'offrir ainsi la possibilité de prononcer certaines peines de substitution. Un certain nombre de conventions existent déjà au niveau local. Au demeurant, si les collectivités territoriales ne créent pas les services nécessaires pour accueillir les jeunes qui auront été condamnés, les peines prononcées ne seront pas exécutées. Peut-être y a-t-il une impulsion à donner au niveau national à ces conventions ?
Par ailleurs, je suis un peu réservé par rapport aux arguments développés dans certains ouvrages -j'en ai parlé récemment avec une collègue psychosociologue qui connaît bien le sujet- qui tendent à montrer que l'exposition aux médias a un effet sur la délinquance des mineurs, notamment en raison de l'identification de ceux-ci à des acteurs de séries télévisées. Mais la consommation des médias est liée à la manière dont les parents contrôlent ou non l'accès au poste de télévision et apprennent à l'enfant à regarder et à interpréter ce qu'il voit. Ce n'est pas un effet à isoler : il se combine avec la manière dont la socialisation de l'enfant s'effectue au niveau de la famille. Je voulais développer à ce sujet un programme de recherches en France, afin de disposer d'éléments empiriques très concrets ; j'ai cherché des financements auprès de fondations privées mais je n'ai pas réussi à en trouver.
L'urbanisme n'est pas non plus maîtrisé, toutefois pas moins en France que dans les autres pays. La concentration de population dans les grands ensembles pose évidemment un problème d'ordre public. Mais un nouveau défi apparaît, celui de la surveillance d'étendues extrêmement larges. Du fait que la délinquance se « ruralise », le problème s'inverse : il faut désormais savoir gérer l'espace.
En tout état de cause, des défis nouveaux sont à relever ; je n'ai pas du tout de « clés » en la matière.
Mme Nicole Borvo - Vous avez beaucoup insisté sur les cadres que constituent la famille et l'école tout en élargissant un peu sur la responsabilité collective.
On ne peut quand même pas complètement séparer la délinquance des mineurs de celle des majeurs sous toutes ses formes. Au cours de la période 1970-2000, cette dernière n'a fait que croître, en raison notamment de l'idée de l'argent facile.
Il est bien évident que les médias ont un impact lié à l'éducation des enfants et à la façon dont ils sont livrés à eux-mêmes. Ce serait intéressant justement de mener des études concrètes sur ce sujet. Je me garderai de faire les amalgames qu'on entend souvent à ce sujet, mais force est de constater que la profusion de violence liée à l'argent facile, que l'on trouve dans bien des séries télévisées, particulièrement dans celles qui nous viennent des Etats-Unis, ne peut qu'avoir un effet amplificateur sur la délinquance des mineurs.
S'agissant des diverses formes de prévention, il est intéressant de vous entendre dire que la solution aux problèmes n'est pas tant dans l'augmentation en nombre des moyens que dans leur adaptation, leur modernisation et leur répartition géographique en fonction du développement de la société.
Pour ce qui relève de la prévention, vous avez évoqué l'exemple des correspondants de nuit, mais vous n'avez pas du tout parlé des différentes formes de protection de la jeunesse qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou de diverses formes d'éducation de rue.
Or les gens qui travaillent dans ce domaine disent souffrir d'un manque de moyens considérable. Lorsqu'ils peuvent faire un travail ciblé de prévention auprès de primo-délinquants -il ne s'agit pas bien sûr d'actions générales pour la jeunesse- ils disent en revanche avoir des résultats et des taux de réussite très importants. Mais ils estiment que les moyens dont ils disposent sont absolument dérisoires. J'aimerais avoir votre avis sur ce point.
Ne pensez-vous pas finalement qu'on aurait tout intérêt à être beaucoup plus attentif à ce qui fonctionne, à ce qui produit des résultats réels, plutôt que de se laisser distraire par un discours fait d'amalgames d'idées plus ou moins maîtrisées sur ce qu'il faudrait faire ?
M. Sebastian Roché - En vous présentant les divers facteurs qui contribuent à la délinquance des mineurs - que ce soit la pauvreté des jeunes, la facilité de réalisation des délits ou la faiblesse de la réaction -, j'ai voulu insister sur le caractère plurifactoriel de cette délinquance. C'est un phénomène complexe, varié dans ses manifestations. Aussi, le traitement de la délinquance sera très difficile à mettre en oeuvre s'il ne prend pas en compte ces différents éléments.
D'une manière plus générale, on peut représenter la délinquance comme un escalier dont il faut absolument éviter de monter la première marche qui est déterminante. Or il est extrêmement difficile de convaincre un jeune que le vol est illégal, cela lui semble tellement facile au supermarché, même si les jeunes âgés de moins de treize ans manifestent une opposition morale au fait de voler. En effet, d'après les résultats des échelles d'attitude auxquelles on les soumet, on constate que c'est à cet âge que l'on croit le plus aux normes. Ensuite, jusqu'à dix-neuf ans, la croyance en des normes décline.
C'est pour cela que j'ai insisté sur les causes qui favorisent le passage à l'acte jeune, ce qui rend ensuite très difficile le travail de prévention.
A ce sujet, je serai aussi sévère pour les éducateurs que je l'ai été pour le fonctionnement du système pénal ; finalement, ils tiennent le même discours : « donnez nous plus de moyens ». Je ne suis pas persuadé que les éducateurs de rue, par exemple, fassent véritablement un travail sur les groupes. Or, les rétributions symboliques des actes commis par le délinquant sont données dans le groupe. Si le groupe pousse le jeune à agir, s'il lui reconnaît un statut parce qu'il agit, alors celui-ci va passer à l'acte. Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais il y a actuellement chez les éducateurs une « dérive » vers le traitement individuel, au détriment du traitement collectif, parce que c'est plus facile et que cela correspond aux modèles qu'ils apprennent lors de leur formation. Le problème n'est donc pas non plus ici uniquement lié à un manque de moyens ; il est également lié à la façon dont les éducateurs se représentent leur travail et sur ce qu'ils sont prêts à faire.
Autre problème : je ne connais pas de corporation plus opposée à l'idée de résultat ; ils ont une « sainte horreur », encore plus que la justice, et ce n'est pas peu dire ! des chiffres et de l'évaluation externe. Ils auraient pourtant intérêt à essayer de montrer qu'ils obtiennent des résultats. Cela leur servirait à légitimer certaines de leurs actions, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
En fait, les travailleurs sociaux sont « désarticulés ». Une étude concrète a été réalisée par Gilbert Berlioz, dans un des quartiers de Lyon, sur la connaissance mutuelle des différentes structures de prévention. Les travailleurs sociaux devaient chiffrer eux-mêmes la part de la population sur laquelle ils travaillaient seuls, celle sur laquelle ils travaillaient en commun avec d'autres structures et décrire les procédures communes à plusieurs structures sur un même territoire. Il en ressort que les structures de prévention s'ignorent toutes mutuellement et qu'elles ne connaissent pas les objectifs poursuivis par les autres structures. Après quoi les travailleurs sociaux viennent nous parler de coordination ! Or, comment peut-on se coordonner avec des partenaires dont on ignore à la fois le mode d'action et les priorités ?
Au-delà des moyens, les méthodes de travail posent également problème : une sérieuse réflexion est donc à mener en direction des méthodes utilisées pour atteindre les objectifs.
M. le président - Merci infiniment de toutes ces explications. Pourriez-vous nous transmettre cette étude ?
M. Sebastian Roché - Bien sûr.
Audition de Mme Sophie BODY-GENDROT, politologue,
et de Mme Nicole LE
GUENNEC, sociologue
(6 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Jacques HYEST, vice-président
M. Jean-Jacques Hyest, président - Nous allons à présent entendre Mme Sophie Body-Gendrot et Mme Nicole Le Guennec. Madame Body-Gendrot, vous êtes professeur des universités à la Sorbonne, chercheur au CNRS. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les politiques urbaines et notamment sur la violence dans les villes. Madame Le Guennec, vous êtes sociologue et professeur des universités. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, en particulier sur les violences urbaines.
En 1998, vous avez été chargées, ensemble, d'une mission sur les violences urbaines et c'est à ce titre que nous avons souhaité vous entendre, notamment pour connaître votre sentiment sur l'évolution de cette question depuis que votre mission s'est achevée.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole.
Mme Sophie Body-Gendrot - Ce serait une banalité de dire que, actuellement en France, la délinquance des mineurs est un enjeu central dans le débat public. Aussi bien dans le discours des médias que dans le discours politique, elle est souvent présentée comme un phénomène nouveau dans ses formes, connaissant une aggravation continue dans son intensité : les mineurs délinquants seraient de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Elle est présentée comme étroitement corrélée à des espaces urbains spécifiques, relégués, dépréciés, qu'on appelle par euphémisme « quartiers sensibles », lesquels regroupent souvent des grands ensembles de logement social en marge des villes, et qui accueillent des populations jeunes, d'origine étrangère, qui se situent aux plus bas échelons du marché du travail.
Or, pour nous chercheurs, ce tableau est à « déconstruire » et tous les termes que je viens de citer sont suspects et sont à reprendre.
Déjà, l'utilisation abusive des statistiques officielles émises par la police chaque année, en particulier au mois de janvier, permet aux médias, au discours politique et aux porte-parole « auto-proclamés » de l'opinion de tirer avantage de l'anxiété diffuse de la population pour la concentrer sur des faits précis, tandis que, dans le même temps, des problèmes difficiles et presque ingérables politiquement, sont occultés. Or ces problèmes pourraient expliquer cette anxiété de l'opinion, qu'il s'agisse de la ségrégation, de la xénophobie, d'un sentiment d'exclusion par rapport au reste de la société, du non-partage ou des dysfonctionnements des services de l'Etat. Toutes ces questions sont éludées au profit d'une concentration sur les fauteurs de troubles que seraient les « jeunes des cités ».
Il est donc facile, en suivant cette logique, d'associer à la ville -espace géographique, fait social, mais aussi promesse de vivre ensemble- tout le malaise existant au tournant de ce siècle.
Ce malaise presque existentiel trouve pourtant son origine dans d'autres facteurs : macro-mutations, émergence de risques, indétermination éprouvée par les parents à l'égard de l'avenir qu'ils vont donner à leurs enfants, indétermination également des individus qui sont sur le marché du travail. Je le répète, la logique actuelle veut que l'on recentre cette anxiété sur certains sujets présentés comme exogènes au corps social majoritaire, à savoir les jeunes de banlieues, sous-entendu « issus de l'immigration », qui troubleraient la tranquillité du corps social.
J'ai contribué à créer un réseau de chercheurs sur les dynamiques de violence dans les pays européens : dix-huit pays se sont joints à cette recherche et le sous-groupe que je dirige en particulier concerne les jeunes et la violence.
Je suis très frappée par le fait que chaque pays a ses critères propres pour désigner l'Autre -avec un A- comme une source de danger et de mal-vivre. Ainsi, en Italie du Nord, les Albanais sont la source de tous les maux ; en Scandinavie et en Allemagne, ce sont les groupes néo-nazis, les hooligans ; et en Angleterre, les demandeurs d'asile.
En France, c'est le « péril jeune », avec encore une fois toute sorte de sous-entendus derrière ce terme. Depuis les années quatre-vingt, la manière d'en parler a évolué. A l'époque des troubles des Minguettes et ses fameux « rodéos », il s'agissait d'un problème lié à l'immigration, à des populations qui co-existaient mal dans les grands ensembles. Puis, cela a évolué pour devenir vite un problème lié aux jeunes. Les journalistes, qui étaient d'ailleurs de moins en moins sur le terrain, en ont fait, petit à petit, la cause de la rupture du pacte républicain et de la difficulté, dans des sociétés modernes individualistes, à s'accepter les uns les autres.
Or, pourquoi les médias choisissent-ils cette vision pour traduire notre malaise et non les accidents de la route, qui font 8 000 morts, ou bien les conflits de paysans ou d'ouvriers qui « cassent » tout autant dans la ville ? Pourquoi les médias choisissent-ils aussi de toujours mettre l'accent sur l'absence de sens dans les actions de ces jeunes, comme si l'on était dans le nihilisme ?
Il est vrai qu'il y a différents types de violence juvénile. Certaines transgressions liées à l'adolescence sont presque « banales ». La délinquance des mineurs peut être la conséquence de troubles psychologiques ou mentaux ; on peut y ajouter aussi les problèmes de drogue ; mais il y a également ce que Denis Salas appelle la « délinquance d'exclusion », qui serait la conséquence d'une socialisation mal faite à un moment donné et qui ferait en sorte que certains de ces jeunes se sentent exclus et ont l'impression que personne n'a de projet pour eux : ils sont donc livrés à eux-mêmes et retrouvent dans le groupe, plus ou moins précaire d'ailleurs, qui les entoure, une espérance et en tout cas une raison d'agir.
Je suis frappée de constater que c'est un phénomène français et qu'en Allemagne, par exemple, où il y a également des quartiers difficiles, des quartiers d'habitat social, le débat public ne se concentre pas sur cette grande interrogation à propos du « péril jeune ».
Est-ce dû au fait qu'en France l'Etat a été longtemps un Etat protecteur, et que les choses ont changé au cours des vingt dernières années ? Dominique Duprez et moi-même avons retracé l'évolution des mesures de prévention contre la délinquance depuis les années soixante-dix, lorsque les internats ont fermé et que le traitement de la délinquance a été confié à l'éducation spécialisée qui est « descendue » dans la rue pour se concentrer géographiquement sur certains espaces, en direction de jeunes potentiellement fauteurs de troubles.
Au cours de cette période, il est bien évident qu'elle a empêché une « municipalisation » des mesures de prévention : les élus n'ont pas eu la capacité de s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité.
La situation a bien sûr évolué au début des années quatre-vingt, non sans quelques contradictions d'ailleurs. Le secteur de prévention sociale et d'éducation spécialisée était autonome et novateur : il était plus attirant bien sûr que les internats d'autrefois pour les jeunes à risque. Mais il avait également ses faiblesses : c'était un secteur anomique, peu évalué et offrant peu de travail en équipes.
La nouvelle politique de prévention sociale constituait donc une sorte de réaction aux insuffisances de la prévention spécifique et du travail social en général.
Je ne retracerai pas l'évolution de la prévention sociale de la délinquance. Elle est bien connue. Elle s'est construite par étapes, au fur et à mesure que les émeutes obligeaient les autorités à réagir. L'innovation était souvent le fait de petits noyaux de professionnels issus de différents ministères. Ils montaient des opérations, les étés chauds par exemple, relayées par une forte couverture médiatique.
Cette politique fut présentée, à l'époque, comme un modèle pour d'autres pays qui avaient choisi la prévention en situationnel, c'est-à-dire l'entrave des desseins des délinquants par des techniques de surveillance et de répression.
Toutefois, cette politique très générale, insuffisamment ciblée, inflationniste, peu visible, ne convainquait pas les habitants qu'on essayait vraiment de les aider. Le sentiment d'insécurité se nourrissait d'actes divers, que l'on désigne du terme fourre-tout d' « incivilités » dans lequel on met tout et n'importe quoi. Les gens avaient l'impression que l'on ne traitait pas vraiment l'insécurité et que la politique mise en place servait tout au plus à contenir les conflits.
Certains ont dit que l'on mettait en oeuvre une politique de sparadrap pour lutter contre un traumatisme majeur -la crise économique- dans des quartiers fordistes qui n'avaient pas été conçus pour l'économie postindustrielle.
Ces quartiers sont occupés par trois types de population en grand malaise, exclusion faite des personnes qui utilisent les quartiers comme dortoirs.
Il s'agit d'abord des habitants de longue date qui ont eu l'impression d'être abandonnés par un Etat en retrait par rapport à son rôle protecteur. Ils ont pris comme symbole de leur malaise les jeunes qui s'agglutinaient dans les halls d'entrée des immeubles, qui crachaient et faisaient trop de bruit. Ils se sont sentis pénalisés par rapport aux autres Français.
Il s'agit ensuite des agents publics qui travaillaient au contact des habitants. Ils souffraient souvent d'un sentiment de déclassement alors que leurs entreprises se transfiguraient. La moindre altercation avec un jeune était la goutte d'eau qui faisait déborder un vase de frustrations déjà trop rempli.
Il s'agit enfin des jeunes eux-mêmes. Selon moi, ils continuent d'être l'objet d'une double fracture : la pauvreté dans une société qui met l'accent sur la consommation ; la pénalisation pour délit de faciès.
Des jeunes vivant dans la banlieue parisienne me parlaient, la semaine dernière, de leurs rapports difficiles avec la police. Il est bien évident que, dans notre pays, la guerre d'Algérie pèse durablement sur les rapports entre les jeunes et les institutions. Cette question n'a jamais vraiment été résolue. Les jeunes issus de l'immigration font très souvent allusion à leurs parents. Ils doutent beaucoup de leurs droits, des promesses de la République et de la justice. Ils se réfugient alors dans un contremonde, dans un territoire situé au fondement de leur identité.
A l'inverse des phénomènes que l'on observe aux Etats-Unis, pays que je connais assez bien, les bandes ne regroupent pas des jeunes issus d'une seule ethnie. On peut y trouver des blondinets aux yeux bleus. Elles sont intégrées dans une culture de quartier qui sert de ciment de solidarité. Leur comportement violent est une manière d'établir une forme de respect. C'est une sorte de protection contre les attaques d'autres jeunes ou d'autres bandes. C'est aussi une façon de se valoriser. En effet, ces jeunes sont bien conscients, dans une société de compétition, d'avoir été recalés dans bien des domaines.
Je nuance immédiatement mon propos. Nous parlons en fait d'une minorité de jeunes. En matière de délinquance juvénile, il n'y a que 10 % de multirécidivistes dont personne d'ailleurs ne veut se charger. C'est en effet le sale boulot par excellence. Sait-on bien ce que l'on fait lorsqu'on demande à des jeunes femmes de vingt-deux ans qui sortent de l'école de prendre en charge des caïds qui ont presque le même âge qu'elles ?
Je rappelle que 80 % des jeunes qui passent pour la première fois devant le juge ne récidivent pas et, surtout, que 80 % de la délinquance vient des adultes. Nous sommes confrontés à une véritable inflation.
Par ailleurs, et j'insiste sur ce point, il s'agit d'une histoire de garçons. Les filles d'origine étrangère qui suivent mes cours, à la Sorbonne ou à Science po, bénéficient du modèle républicain et de la non-reconnaissance des différences. Elles progressent silencieusement, tirent le meilleur parti de l'école républicaine pour se fondre petit à petit dans la société. La délinquance concerne donc les jeunes qui enragent de ne pas être dans la société gagnante, qu'ils voient touts les jours à la télévision, et qui ont l'impression que tout se fait sans eux.
J'apporterai une autre nuance. Des chercheurs du CNRS viennent d'achever une enquête de victimation sur la région parisienne. Ils ont obtenu la confirmation que 7 % des Franciliens ont, dans les six derniers mois, été victimes d'un délit grave. On constate d'ailleurs les mêmes pourcentages aux Etats-Unis. Les délits graves qui entraînent un arrêt de travail et un séjour à l'hôpital sont assez rares.
Les chercheurs sont confrontés à un phénomène très enflé par les médias et politiquement exploité. On ne peut pas prétendre pour autant que l'on est dans le fantasme. La violence remplit des fonctions instrumentales. J'ai passé une journée, dans la prison de Saint-Maur, avec des détenus condamnés à perpétuité. Je n'oublierai pas les propos de l'un d'eux. Il déclarait en substance : nous avons le pouvoir, dans une vie sans pouvoir, de priver les autres d'un bien précieux, à savoir la tranquillité sociale.
Certains jeunes ont l'impression d'être invisibles. Ils se servent alors de la violence pour entrer en contact avec des adultes, pour attirer l'attention sur eux. Des maires se sont plaints que les voitures brûlaient toujours avant l'été parce que des jeunes voulaient négocier des séjours de vacances. Mme Le Guennec et moi-même avons étudié ce phénomène à Strasbourg. Il s'agit parfois de ritualisation, parfois de trafic de voitures volées. N'oublions pas que les adultes brûlent également des voitures. Il faut cesser de tout mettre sur le dos des jeunes. Il s'agit d'un phénomène complexe que l'on présente de manière simpliste. Il ne faut pas être dupe.
Le dernier point important que j'évoquerai tient aux ratés de la République. Des jeunes me disent : « Moi, je me sens français mais, pour les autres, je sais très bien que je ne suis pas français. Il y a un délit de faciès, je n'ai pas les mêmes chances ».
M. Dominique Duprez, dans l'enquête qu'il a conduite sur l'université de Lille Sud, a constaté que parmi les 10 % des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage, 59 % étaient d'origine maghrébine. Qu'on ne me dise pas qu'ils avaient tous un problème ! On doit envisager la plausibilité du refus d'embauche.
C'est dès le départ, dès l'école et ses filières, où l'on sépare les garçons maghrébins des filles gauloises, que certains sentiments se créent. Les services publics français, contrairement à ceux d'autres pays, ont mis beaucoup de temps à donner à ces jeunes une impression d' inclusion. L'école Polytechnique compte moins d'élèves d'origine ouvrière aujourd'hui que dans les années cinquante. A aucun moment on ne dit à ces jeunes : les prix Nobel sont chez vous, on ne peut pas vivre sans vous. Aux Etats-Unis, des membres des fondations Falk ou Rockfeller, disent aux jeunes qui vivent dans le Bronx : « On ne peut pas vivre sans vous, vous êtes indispensables et l'hybridation est l'avenir de l'Amérique. » Il n'y a pas l'équivalent chez nous.
Si des solutions existent, elles ne peuvent qu'être très complexes. En tout état de cause, leur mise en oeuvre signifierait que la société est prête à payer le prix de la paix sociale, à payer le sale boulot, c'est-à-dire à envoyer sur le terrain des professionnels aguerris, expérimentés, correctement rémunérés, pour prendre en charge les jeunes des quartiers difficiles au lieu de confier cette mission aux fameux adjoints locaux de sécurité ou à des personnes titulaires d'un emploi-jeune.
Aujourd'hui, on se demande pourquoi on ne parvient pas à recruter de gardiens d'immeubles sociaux. Un éducateur me disait récemment : croyez-vous que je vais, pour un salaire de 7.000 francs par mois, sortir le soir et prendre le risque de recevoir des coups de barre de fer ?
Il faut savoir ce que l'on veut. L'opinion peut être éduquée. On peut lui expliquer qu'il est onéreux de remettre à niveau des quartiers dont les habitants ont l'impression d'être marginalisés.
Par ailleurs, il faut encourager les initiatives issues de la société civile. Il n'est pas question que les institutions fassent tout. Je connais suffisamment d'exemples pour pouvoir vous affirmer que la situation s'améliore avec l'ouverture de la société locale, avec la création de forums dans lesquels les habitants peuvent parler ensemble des problèmes communs, avec l'instauration de passerelles. J'étais à Onex voilà une semaine. J'ai rencontré des gens qui avaient la démocratie participative chevillée au corps, la citoyenneté toujours en tête. Cela fait vraiment plaisir. Parlons des expériences qui réussissent, des personnes qui se battent tous les jours pour donner un avenir à des quartiers. Je pourrais vous citer de nombreuses expériences, riches d'imagination, dans lesquelles des gens prennent des risques pour améliorer la vie d'un quartier.
Je l'ai déjà dit à certains élus, je le répète aujourd'hui devant vous, il faut, dans ce pays, parler des expériences positives et agir avec pragmatisme. La responsabilité individuelle est souvent fondée sur le contrat, sur le donnant-donnant. Ici, les groupements locaux de traitement de la délinquance, les GLTD, ont obtenu de très bons résultats. Ailleurs, les institutions ont fait front et proposé des contrats aux délinquants. Et cela a marché : les délits très graves ont cessé et, surtout, les institutions ont démontré qu'elles pouvaient mettre de côté leur rituel de méfiance. Dans certains quartiers, des éducateurs sont montés dans les voitures des policiers pour s'assurer qu'il n'y avait pas de business le soir. Ils ont ainsi appris à s'estimer.
Il faut ouvrir des voies d'expression aux jeunes. Tous se plaignent de ne pas être reconnus. Les commissions aux droits de certains quartiers font des propositions, invitent des élus, mais ces derniers ne viennent pas. Les jeunes pensent que les adultes ne se déplacent qu'au moment des élections. Tout cela est assez décourageant pour eux. Or, c'est seulement en les responsabilisant que l'on parviendra à leur donner la dignité à laquelle ils aspirent.
Il faut trouver un moyen terme, sanctionner les actes illégaux, comme nous le faisons pour nos propres enfants mais, dans le même temps, leur apporter une sorte d'encouragement. Il faut leur donner le sentiment qu'ils sont partie intégrante de la société en précisant qu'on ne laissera pas passer les atteintes aux victimes. Parler des victimes n'est le privilège d'aucun parti politique. Nous devons tous être solidaires des victimes et, parallèlement, poursuivre la prévention sociale de la délinquance qui avait, au moins dans sa démarche, donné des résultats au début des années quatre-vingt.
M. le président - Je vous remercie, madame. La parole est à Mme Le Guennec.
Mme Nicole Le Guennec - Je ne peux que confirmer les propos de Mme Body-Gendrot. Je vais m'efforcer de vous apporter quelques éléments supplémentaires.
Tout d'abord, la plupart des services de police et de justice constatent la progression continue de la délinquance des mineurs et la permanence des émeutes. Ces dernières fonctionnaient auparavant par épidémies : 1981, 1983, 1989, 1990. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'une émeute éclate dans un quartier.
Votre commission entendra sans doute des représentants des services de police. Il n'est donc pas utile que je détaille les données chiffrées. La vision de ce phénomène est toutefois quelque peu brouillée puisque les chiffres émanent de plusieurs sources : les services judiciaires, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale de l'administration, la police. Néanmoins, ces données font apparaître que 143 000 mineurs étaient mis en cause en 1996, soit 20 000 de plus par rapport à 1992, alors qu'ils n'étaient que 72 000 en 1972. Le nombre de mineurs mis en cause a donc été multiplié par deux durant les vingt dernières années, avec une augmentation très forte depuis 1993.
Le nombre des délinquants est une chose, la qualité des délits commis en est une autre. Alors que, dans les années soixante-dix, les mineurs volaient des bicyclettes, aujourd'hui, ils sont impliqués dans des vols avec violence, des rackets, des razzias dans les supermarchés, des attaques de voitures de police.
Comme le constate la Direction centrale des renseignements généraux, la DCRG, la délinquance a changé de forme, elle est devenue collective, urbaine. Il existe bien évidemment des délits individuels, mais, d'une certaine manière, la délinquance s'exerce en groupe.
Naguère, sévissaient des blousons noirs, Pierrot le Fou ; aujourd'hui, des bandes n'hésitent pas à attaquer des commissariats de police avec des voitures béliers. Ces actions sont plutôt inquiétantes.
Selon la direction centrale de la sécurité publique, la DCSP, 48 000 mineurs étaient impliqués dans des actes violents en 1986, contre 98 000 en 2000. La part des mineurs par rapport au nombre total des délinquants est passée de 17 % à 23,3 %. La DCRG fait état du climat délétère qui règne dans les banlieues et de la progression du nombre des attaques, en particulier contre les institutions policières. Les quartiers touchés sont eux aussi de plus en plus nombreux.
La Direction centrale des renseignements généraux constate également la rurbanisation des violences urbaines. En d'autres termes, avec l'effondrement de certaines catégories de la population dans les petits villages ou dans les villes moyennes, le phénomène n'est plus limité aux grandes villes, il touche la France entière. En 1991, on comptait 78 quartiers touchés par les émeutes contre 485 en 1993 et 818 en 2000.
Par ailleurs, les formes d'attaques évoluent, deviennent plus impressionnantes. Il ne s'agit plus d'arracher un sac en roulant sur un scooter. Désormais, on tend des embuscades et des guets-apens pour attaquer des voitures de police ou de pompiers. Ces actions, beaucoup plus graves, relèvent d'une sorte d'organisation, certes limitée -ces gangs ne sont pas capables d'attaquer une banque- mais à laquelle il convient néanmoins de prêter attention.
Les populations, elles, ont le sentiment de ne plus être protégées. Quant à la police, elle pense que son rôle consiste désormais à déminer les conflits et à éviter les ratonnades, c'est-à-dire à ne pas s'en prendre à l'ensemble d'une catégorie de population, maghrébine par exemple, ce qui n'est pas aisé, car il est difficile d'identifier les auteurs des violences.
On constate également une montée du caïdat et une augmentation du nombre des conflits entre les bandes. Les jeunes gens entrent dans la délinquance de plus en plus tôt. Une étude que j'ai menée auprès de l'inspecteur d'académie de Seine-saint-Denis fait apparaître que les jeunes deviennent membres d'une bande dès la fin du cours moyen deuxième année, c'est-à-dire avant l'entrée au collège, parce qu'ils ont le sentiment que seule la bande peut les protéger.
Il convient de s'interroger sur ces pratiques. Si les institutions donnent à ces jeunes gens le sentiment de les menacer et non plus de les protéger, c'est grave.
Les nouvelles formes de délinquance résultent aussi du bricolage d'une identité morcelée, fondée sur la violence, la débrouille, la capacité de faire peur, l'angoisse, une espèce de souffrance à blanc et l'impression d'être les premières victimes de la crise, d'être sans cesse importuné, d'être l'objet d'injustices. La façon dont certains jeunes parlent de la police -crevards, violents, bâtards, racistes, fils de pute- ou des juges -sans scrupules, trop sévères, vengeance, prisons, tapés, racistes- est assez impressionnante.
Selon le sociologue Anthony Giddens, conseiller de Tony Blair, les sentiments à l'égard du voisin ont changé. Naguère, le voisin était quelqu'un avec qui on labourait la terre, faisait la moisson, avec qui on allait à l'usine, bref, que l'on connaissait bien. Il se créait ainsi une espèce de pouvoir de police. Le voisin venait vous dire : ton fils a volé mon vélo, il faut qu'il me le rende. Avec l'évolution du monde du travail et l'effondrement du syndicalisme, cette relation a disparu. La défiance s'est installée. Les jeunes gens ne sont plus dirigés. Il en résulte des phénomènes qui me paraissent très sévères.
Les jeunes ne font plus confiance au voisin. Ils font confiance uniquement à ceux qui ont été à l'école primaire avec eux, qui habitent le même escalier, le même quartier. Les bandes qui se forment sont parfois très petites.
Par ailleurs, ils ne croient pas que les institutions veuillent les protéger. On assiste, selon Anthony Giddens, à une « délégitimation » de l'Etat. Ces jeunes estiment que l'Etat est injuste à leur égard, que l'école ne leur apprend rien de ce qui pourrait leur être utile dans la vie. Parfois même, des policiers les tuent. Ils ne supportent absolument pas cette situation.
En outre, leur famille vit souvent avec 2 000 ou 3 000 francs par mois et a du mal à s'en sortir. Je travaille dans un quartier de Grigny. Des femmes m'ont expliqué qu'elles vivaient seules avec leurs enfants, sans téléphone ni carnet de chèque. Elles ne disposent que d'un peu d'argent liquide qu'elles gardent dans leur poche. Lorsqu'elles n'en ont plus, pour pouvoir donner le biberon à leur bébé, elles vont voir l'assistante sociale, puis elles se rendent de l'autre côté de l'autoroute A 6, avec leur famille, pour obtenir un bon d'alimentation.
Une d'elles m'a raconté que son enfant de sept ans avait été pris d'une crise d'asthme au milieu de la nuit. Elle avait dû réveiller ses deux autres enfants, âgés de deux et cinq ans, pour aller à l'hôpital, situé à cinq ou six kilomètres, parce qu'elle n'avait pas le téléphone et qu'elle ne pouvait faire appel à personne. De telles situations me semblent limites dans un pays riche. Elles peuvent expliquer pourquoi les jeunes gens concernés se sentent aussi mal à l'aise.
L'origine de cette situation réside en partie dans la fin d'un espoir social, dans la faillite des grands équipements qui avaient fait la gloire de la France. L'Etat providence, en France, ne se réduisait pas aux syndicats et aux conventions collectives. Il avait construit des équipements de progrès : les maisons des jeunes et de la culture, les centres sociaux.
Aujourd'hui, tous ces lieux sont fermés. Il n'y a plus de personnels. D'une certaine façon, les jeunes gens demandent le rétablissement de ces équipements de progrès. Il s'agit non pas de les restaurer dans leur forme républicaine traditionnelle -c'est trop tard, tout a été détruit- mais de trouver des solutions différentes, la gestion associative par exemple. Ils brûlent les établissements sportifs, car ils leur paraissent ne plus être à leur portée.
Le remède réside, me semble-t-il, dans la reconstruction d'un Etat plus actif, en particulier dans les formes nouvelles de l'Etat républicain. Jusqu'à présent, on a eu tendance à minimiser les actes de violence tant des jeunes que des adultes. N'oublions pas que les jeunes ne sont pas seuls en cause. Certains adultes prennent également des positions très dangereuses. On a minimisé ces faits avant de les diaboliser. Il existe peut-être un discours intermédiaire qui permettrait de pacifier les quartiers et d'y rétablir la paix sociale.
Plutôt que de répondre dans l'urgence aux situations difficiles en distribuant, comme le rappelait Mme Body-Gendrot, des séjours de vacances, recherchons des solutions susceptibles de stabiliser un peu ces populations afin qu'elles s'inscrivent dans le progrès, comme chacun le souhaite.
M. le président - Madame Body-Gendrot, je pense que vous faisiez allusion à l'étude de victimation qui a été conduite sur l'initiative de la région d'Ile-de-France et dont la presse nationale s'est fait l'écho.
Mme Body-Gendrot - Tout à fait !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Madame Body-Gendrot, vous nous avez dit, en termes assez forts, que la France se considérait confrontée à un péril jeune, ce qui ne semble pas d'être le cas d'autres pays européens. Cela m'inspire deux questions. La mesure des violences urbaines est-elle pertinente ? Quelle est la situation dans les autres pays par rapport à notre échelle de mesure ?
Mme Sophie Body-Gendrot - La notion de violences urbaines recouvre des actions collectives. Des jeunes issus de quartiers dits sensibles s'en prennent à des symboles ou à des agents de l'Etat.
A Milan, on ne caillasse pas les autobus, on n'attaque pas les pompiers. Une des mes étudiantes travaille pour le SAMU social. Elle me disait que, lors de leurs interventions, les personnels prennent un luxe de précautions pour entrer dans les cités, car ils ont toujours peur de se faire attaquer.
Les chercheurs étrangers sont ébahis lorsque je leur décris la situation de notre pays. Eux ont affaire à des groupes néo-nazis qui s'en prennent essentiellement aux immigrés et aux demandeurs d'asile. C'est le cas en Norvège, en Suède, en Italie ou en Allemagne. Je me suis rendue à Berlin pour participer à une conférence. Mon homologue allemand a évoqué les attaques xénophobes qui se produisent dans le Brandebourg.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous n'avons pas géré la question coloniale. Ce ne sont pas les Chinois du XIII e arrondissement qui posent des problèmes. Ce sont les enfants issus de l'immigration postcoloniale. Et ils en parlent. Un jeune qui avait eu affaire à la police m'a dit : « Ah, la façon dont ils ont parlé de mes parents. » Je suis frappée de constater que cet aspect reste présent à l'état larvaire dans les rapports sociaux.
Mme Nicole Le Guennec - Permettez-moi d'ajouter que ce sont les Anglais qui ont, si je puis dire, « inventé » l'émeute. La première émeute a eu lieu en 1981 à Brighton. Les troubles durèrent huit jours et provoquèrent de nombreux incendies. Trois cents maisons furent détruites. Dix ans plus tard, la ville connaîtra une nouvelle émeute.
A la frontière nord des Pays-Bas, vers Groningen, dans la nuit de la saint Sylvestre, des jeunes gens ont cambriolé les maisons des notables qui réveillonnaient. Ils se sont ensuite retranchés derrière des troncs d'arbres auxquels ils avaient mis le feu pour éviter l'approche des voitures de police. Des phénomènes identiques se produisent dans d'autres pays européens, même si on ne les qualifie pas de la même manière ou si l'on y prête moins attention.
Mme Sophie Body-Gendrot - Le nord de la Grande-Bretagne a connu cet été des journées d'émeutes provoquées par un sentiment fort de ségrégation, par une absence de perspective, et l'extrême droite a jeté de l'huile sur le feu.
M. le rapporteur - Madame Body-Gendrot, vous vous êtes demandé si la société était prête à payer le prix de la paix sociale. Par ailleurs, dans votre rapport, vous dénoncez les « tentatives d'acheter la paix sociale en donnant du RMI, en embauchant des agents d'ambiance, en cooptant des grands frères mais sans traiter les causes de la violence. » Pensez-vous que ces politiques ont échoué et, dans l'affirmative, quelles stratégies alternatives peut-on mettre en oeuvre ?
Mme Sophie Body-Gendrot - Je ne pense pas qu'elles aient échoué. Comme le souligne à juste titre M. Belorgey, on ne sera jamais en mesure de dire si la situation aurait été pire sans ces politiques. Je prétends en revanche qu'elles ont servi à contenir la dégradation. On a posé un sparadrap sur un traumatisme majeur. Il s'agit de ce que j'appelle une « politique de troisième type », riche en rhétorique, se référant beaucoup à la politique de la ville. Mais la cause profonde de la violence, c'est-à-dire la volonté de se sentir inclus, d'avoir un avenir, de vivre comme les autres, n'a pas vraiment été traitée.
En fait, nous avons péché par arrogance. J'ai participé, cet été, aux entretiens de Pétrarque. Pendant une semaine, nous avons réfléchi à la fracture sociale par rapport à la République. Nous avons été un peu arrogants en pensant que des populations originaires de plusieurs pays comprendraient, du seul fait de leur présence, des siècles de civilisations dans les villes. Non, pour réussir, il faut de bons alchimistes, il faut expliquer, apprendre aux gens à se faire confiance. Je n'ai pas l'impression que la situation s'améliore depuis le 11 septembre.
Mme Nicole Le Guennec - Dans les années soixante-dix, l'Etat a mené une politique ambitieuse, construit de nombreux équipements et favorisé l'émergence des professions sociales, notamment avec la loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Depuis le début des années quatre-vingt, nous avons assisté à la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs. Or, un dispositif n'a pas de murs, n'emploie pas de professionnels. D'une certaine façon, n'importe qui peut tenir la maison.
Puis la crise s'est approfondie, amenant avec elle de nouvelles difficultés. Nous n'avons pas été en mesure - peut-être ne l'a-t-on pas souhaité - de construire quelque chose à la hauteur de ce qui avait été fait dans les années soixante-dix. Tout le monde en est conscient. Les dispositifs qui ont été élaborés sont très fragiles. Comme le souligne Sophie Body-Gendrot, personne ne connaît bien leurs résultats. Les ZEP ont sans doute été utiles...
M. le président - Il paraît que oui. ( Sourires )
Mme Nicole Le Guennec - Elles auraient permis d'atténuer certains effets !
M. Jacques Mahéas - Vous avez lu les articles.
Mme Nicole Le Guennec - Oui. En tout état de cause, leurs résultats ne sont pas manifestes et restent difficiles à cerner.
M. Jacques Mahéas - A Neuilly-sur-Marne, dont je suis élu depuis 1993, les évaluations sont très positives. Les résultats de certains collèges ont soit atteint soit dépassé la moyenne nationale. Des moyens supplémentaires ont été alloués à ces établissements. En outre ...
M. le président - Monsieur Mahéas, vous pourrez vous exprimer plus tard. Pour l'instant, je vous invite à poser votre question.
M. Jacques Mahéas - Madame Body-Gendrot a, en évoquant les milieux postcoloniaux, parlé de ségrégation, de xénophobie, de marginalité et de délit de faciès. Ces phénomènes ne valent pas pour les filles.
Mme Sophie Body-Gendrot - C'est ce que j'ai dit.
M. Jacques Mahéas - Le délit de faciès ne peut s'appliquer aux seuls garçons et épargner les filles.
M. le président - Mais si !
M. Jacques Mahéas - N'y a-t-il pas une culture qui, dans certains cas, rend l'intégration beaucoup plus difficile ?
Mme Sophie Body-Gendrot - La vérité est certainement entre les deux. Il ne s'agit pas de nier que les mères peuvent élever leurs garçons et leurs filles d'une manière différente. A l'inverse, les employeurs préfèrent embaucher une jeune femme d'origine étrangère qui a les compétences nécessaires plutôt qu'un garçon. Ils pensent qu'ils rencontreront moins de difficultés. Il y a certaines adresses qu'il vaut peut-être mieux ne pas donner dans les agences d'intérim.
M. le rapporteur - Vous avez indiqué, Madame Body-Gendrot, que personne ne veut prendre en charge les multirécidivistes. Ils vivent souvent grâce à une économie souterraine qui limite l'implosion des quartiers. Quelles sont les mesures de nature à éviter cette implosion, d'une part, et la multiplication des actes délictueux, d'autre part ?
Mme Sophie Body-Gendrot - Il est très difficile de répondre à cette question. Peut-être avons-nous la chance, en France, de ne pas croire à la prison. Les prisons, telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle, accroissent plus qu'elles ne les réduisent les dispositions des jeunes à la délinquance. Ce n'est pas en prison que les jeunes vont trouver les meilleurs moyens de se discipliner, de se doter d'un moral d'acier.
M. le président - Sauf si on conçoit la prison autrement.
Mme Sophie Body-Gendrot - Tout à fait ! A New York, je me suis rendue dans la grande prison de Rock Island. Des associations, souvent gérées par d'anciens détenus, y font un travail magnifique. J'ai fait le même constat dans une prison de San Francisco. Les jeunes ont la certitude, dès le jour de leur sortie, et pour une durée de trois ou quatre mois, d'avoir un travail, de toucher leur chèque à six heures du soir et de disposer d'un logement.
On ne parle jamais des expériences réussies. Ce serait sans doute souhaitable. La prison, oui, parce qu'il faut une sanction, mais on ne vous laisse pas tomber.
M. le président - Je vous remercie .
Audition de M. Alain BAUER,
Président de AB Associates (audits de
sécurité)
et M. Xavier RAUFER, enseignant et
journaliste
(13 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Jacques HYEST, vice-Président
M. Jean-Jacques Hyest, président - Mes chers collègues, nous allons entendre M. Alain Bauer et M. Xavier Raufer.
Monsieur Bauer, vous êtes président d'AB Associates, société de conseil en sécurité urbaine.
M. Christian de Bongain -je suis obligé de donner votre vrai nom même si vous êtes plus connu sous le nom de Xavier Raufer- vous êtes chargé de cours à l'Institut de criminologie de Paris.
Vous avez l'un et l'autre écrit plusieurs ouvrages sur les violences et les différentes formes de criminalité et, notamment ensemble, un ouvrage intitulé Violence et insécurité urbaines .
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur Bauer, vous avez la parole.
M. Alain Bauer - Monsieur le président, je vous remercie de votre invitation. Je pensais, en écoutant le serment que vous venez de nous faire prêter, que le reproche qui nous était fait en général était davantage d'en dire trop que pas assez. Nous avons donc prêté serment avec bonne volonté.
En termes d'analyses, que celles-ci soient universitaires, scientifiques ou qu'elles émanent du terrain, la France est un pays merveilleux où l'on parle de violence et d'insécurité alors qu'on ne les connaît pas. Aujourd'hui, malheureusement, deux intégrismes à caractère scientifique ou pseudo-scientifique coexistent. Le premier vise à expliquer qu'il n'y a ni délinquance ni délinquants dans ce pays. Il n'y a que des victimes sociales -elles existent, certes -mais que des victimes sociales, qui ont une sorte de droit naturel à la victimation des autres parce que la société serait coupable à leur égard. Il ne s'agit donc pas de s'occuper de la délinquance et des délinquants, mais de faire la révolution pour régler le problème.
L'autre intégrisme, qui se satisfait d'ailleurs très bien de l'existence du premier, est celui de la répression aveugle. On ne recherche pas les motifs du passage à l'acte. Qui vole un oeuf vole un boeuf. Miradors, mitrailleuses, élimination sociale et, grosso modo , on sera ainsi débarrassé de la délinquance.
Aucun de ces deux intégrismes ne s'occupe d'ailleurs des victimes. Le problème est que, dans notre pays, le dispositif statistique visant à permettre de mesurer l'insécurité a été élaboré pour donner tout sauf cela. Il vise en effet d'abord à masquer les faits quantitativement et ensuite à ne pas les gérer qualitativement. Depuis de très nombreuses années, ce dispositif est manipulé, instrumentalisé et modifié, pour des raisons qui ont peu à voir avec la statistique au sens scientifique du terme.
On peut en fait considérer que le système est partiel, parcellaire et partial. Il ne donne en effet qu'une faible idée de la réalité. Les contraventions, notamment les délits qui sont dépénalisés et contraventionnalisés depuis 1972, n'apparaissent pas dans les statistiques. Seuls sont pris en compte les délits qui sont connus, déclarés ou constatés. Une très grande partie de la victimation, notamment la vraie victimation sociale que constituent les violences domestiques, n'apparaît pas dans les statistiques.
Enfin, depuis qu'il existe, le dispositif statistique est manipulé par les services de l'Etat, que ce soit au niveau local ou national, et ce dans des conditions assez intéressantes, qui traduisent même des volontés curieuses : lorsque les chiffres sont trop bons dans un commissariat, celui-ci perd des effectifs ; lorsqu'au contraire ils sont trop mauvais, les policiers sont vivement mis en cause. La gestion du tas de sable annuel n'est pas inintéressante.
De même, lorsque les statistiques d'un mois de décembre sont difficiles pour un gouvernement en période électorale -quel que soit le gouvernement et quelle que soit la période électorale -, celles-ci sont systématiquement reportées sur le mois de janvier. Le bug de l'an 2000 ou encore la tempête de 1999 ont également permis de gérer intelligemment une année de onze mois et ainsi de stabiliser une hausse des statistiques. Annuellement, la statistique ne nous dit donc rien d'intéressant.
Toutefois, puisqu'elle est manipulée et instrumentalisée dans les mêmes conditions depuis près de cinquante ans, elle nous dit des choses extrêmement intéressantes en tendance. Elle nous montre d'abord une double mutation, qui est récente mais non historique, notamment en matière de délinquance des mineurs. Il faut traiter de deux phénomènes pour bien comprendre cette délinquance.
Dans un premier temps, il ne s'est rien passé en France de 1950 à 1964. On dénombrait alors cinq cent mille crimes et délits. Il n'y a pas eu de phénomène de dépénalisation ou de décriminalisation durant cette période. La situation est demeurée stable. Puis, de 1964 à 1994, on a assisté à une forte progression liée à une délinquance contre les biens. C'était la délinquance de la prospérité. On avait envie des produits de toutes natures qui étaient alors offerts. Naturellement, la délinquance contre les biens a progressé jusqu'à atteindre environ 3,9 millions de faits en 1993-1994.
Entre 1994 et 2001, un phénomène de yo-yo s'est produit, qui a entraîné une augmentation et une baisse du nombre de crimes et de délits. Il est à noter d'ailleurs qu'une augmentation intervient en général lorsque le chômage diminue et qu'une baisse se produit quand le chômage augmente, c'est-à-dire que le lien entre le social et le sécuritaire est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Il faut donc faire attention aux simplifications mécaniques.
Une vraie mutation de la délinquance française est intervenue en 1994. Ce fut alors le retour de la violence contre les personnes. Jusque là, on était spectateur d'un acte délictuel. C'était désagréable, mais l'on n'avait subi qu'un vol de voiture ou qu'un cambriolage. Cette mutation a d'abord été voulue par le monde des assurances, moins préoccupé de sécurité publique que par une relation comptable entre la prime et le dommage. En effet, les compagnies en avaient assez de dédommager les victimes de centaines de milliers de vols de voitures et de cambriolages. En France, les biens sont donc mieux protégés que les personnes. Naturellement, le petit délinquant occasionnel est passé du cambriolage et du vol de voitures à la délinquance de voie publique, sur laquelle sont apparus de nouveaux sujets d'intérêt : les distributeurs automatiques de billets et les téléphones portables. Il leur faut donc désormais s'en prendre aux personnes. Les spectateurs sont alors devenus des acteurs de leur propre victimation. Ils subissent une violence qui génère un stress post-traumatique. La demande de sécurité est donc devenue ce qu'elle est aujourd'hui.
La statistique fait d'ailleurs apparaître un net décrochage. Les victimes ne sont pas inventées. On ne peut faire comme si elles n'existaient pas, ces agressions donnant lieu en effet à des arrêts de travail temporaires et à des admissions dans les services des urgences. La statistique est relativement stable dans ce domaine. Elle sous-évalue, mais ne surévalue jamais.
L'apparition des mineurs dans cette affaire est une nouveauté relative. Avant 1980, le nombre de mineurs délinquants était très élevé. Puis ce chiffre a commencé à diminuer tendanciellement, en proportion. En 1979, les mineurs représentaient 15,4 % du nombre total de personnes mises en cause. Ce chiffre est tombé à 11,2 % en 1985. Il se situe aujourd'hui aux alentours de 21 %. Il s'agit donc d'un phénomène en « U », qui est d'ailleurs traditionnel. Il est lié à la fois aux mécanismes de poursuite des mineurs et à un changement de la nature des interventions de ces derniers.
En effet, le mode d'intervention des mineurs a évolué. Ceux-ci sont passés des petits vols aux agressions, y compris aux agressions en bande. Le vrai problème des mineurs n'est pas leur violence. Ils ont toujours été très violents. En 1900, il y avait les Apaches, de jeunes mineurs délinquants des faubourgs. Ils sont ensuite devenus les Blousons noirs, puis les Loubards. Plus récemment, M. Chevènement leur a donné le joli nom de « sauvageons ». Ils sont en train de devenir des Etourneaux. Je ne sais pas si c'est là une progression.
Les mineurs interviennent plus jeunes qu'auparavant, c'est-à-dire qu'avant 1970. Les phénomènes de violences physiques ne sont pas nouveaux. Au XVème siècle, en France, il y avait 100 à 150 homicides pour 100.000 habitants. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à deux. Ce n'est pas la ville qui créé le crime. La ville a civilisé le crime, notamment les violences physiques, mais il y a cependant des évolutions, des mutations et des retours en arrière.
Nous vivons en effet depuis 1994 un grand retour en arrière en matière de délinquance. Les délinquants sont plus jeunes, ils agissent en réunion et ils sont plus violents. Soit la justice les condamne très peu parce qu'elle ne sait pas gérer les primo-délinquants, soit au contraire elle les condamne sévèrement parce qu'elle ne sait gérer les délinquants que lors de leur trentième ou quarantième méfait, et ce par des mesures extrêmement dures. La prévention en France n'a pas échoué. Pour échouer, encore faudrait-il qu'elle existe ! Pour 170.000 mineurs délinquants et 150 000 mineurs en danger, les services sociaux -les conseils généraux, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats- ne disposent que d'un peu plus de 1.100 places, et encore n'en est-on pas sûr !
De même, la sanction n'existe pas non plus. La France est le grand pays de l'impunité où le taux réel d'intervention, le taux d'élucidation de la police comme le taux de poursuite par les parquets, est infinitésimal. Cela pose un vrai problème de gestion, et donc de réponse au problème de la délinquance.
Enfin, pour terminer, j'évoquerai l'Education nationale. Elle ne connaît rien à l'absentéisme scolaire, qu'elle ne veut pas quantifier. Elle ne se préoccupe pas particulièrement de gérer les mineurs en déshérence. Personne n'a jamais fait le lien entre mineur en danger et mineur auteur parce que l'on ne souhaite pas mettre à mal un pseudo anonymat. La France est le seul pays où l'on ne peut dire ce que tous les autres savent : un mineur auteur est souvent un mineur victime. Or, l'on traite davantage des conséquences que des causes, et ce dans une sorte d'indifférence générale, notamment scientifique. C'est un vrai problème. La France est le pays de l'impunité. Il n'y a ni prévention, ni sanction, ni réponse publique à la problématique de la délinquance en général, des violences en particulier, notamment de celles des mineurs, qui est la plus visible.
Je crois qu'il faudrait enfin commencer par faire ce que l'on n'a pas voulu essayer, à savoir établir un diagnostic, ce qui nous permettrait de dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, en général, lorsque l'on montre le soleil et que l'on dit qu'il se lève à l'est, une partie de l'intelligentsia nationale explique que c'est peut-être le soleil, mais que l'on n'est pas sûr qu'il s'agisse de l'est ! Cela permet de mettre immédiatement fin à la discussion. Nier la vérité sur les questions d'insécurité et de délinquance pave la voie à ceux qui n'ont de réponse qu'extrémiste, xénophobe, antisémite et raciste. En la matière, les deux intégrismes vont très bien ensemble.
J'espère que nous ferons entendre, au cours de cette séance, que les choses méritent d'être étudiées de manière plus importante.
Quand un médecin vous reçoit et vous prescrit une thérapeutique sans vous ausculter, il faut rapidement en changer.
M. le président - La parole est à M. Raufer.
M. Xavier Raufer - Monsieur le président, je voudrais insister sur les autres conséquences de la délinquance des mineurs pour la vie française.
Après avoir fait un long diagnostic et rencontré de nombreuses personnes sur le terrain, dans les hautes sphères, à droite comme à gauche, il nous semble que ce qui explique à la fois notre présence à tous ici aujourd'hui et de multiples phénomènes qui affectent la société française depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est que la France vit une très grave crise de l'autorité de l'Etat. Je ne parle pas d'instaurer une dictature, mais simplement d'appliquer les mesures que la Constitution et le code pénal mettent à la disposition des représentants du peuple.
Cette crise de l'autorité de l'Etat est à l'origine de l'aggravation de la délinquance des mineurs mais également de ce qui se passe en Corse, tout comme elle est à l'origine de l'explosion du grand banditisme et du nombre des attaques à main armée sur le territoire français et, de façon spectaculaire et extrêmement récente, de cette invraisemblable affaire de narco-trafiquants qui sont venus attaquer une gendarmerie afin de récupérer les 330 kilos de cocaïne qui leur avait été « indûment » dérobés !
L'Etat français a fini par ne plus faire peur à personne parce que l'on fait souvent preuve à sa tête -toutes sensibilités politiques confondues- d'une grande arrogance qui révèle en réalité une grande faiblesse et parfois une grande lâcheté. Faire preuve d'une attitude arrogante ne signifie pas pour autant avoir de l'autorité.
S'agissant des problèmes qui nous concernent aujourd'hui et du grand banditisme, nul n'a mis en place dans ce pays depuis vingt ans de véritable politique criminelle. Alain Bauer l'a dit d'une autre manière, mais cela revient à poser le même diagnostic. Le travail d'un gouvernement, quel qu'il soit, est de mettre au point des politiques puis de les appliquer en fonction d'un environnement juridique et judiciaire, d'une Constitution et de la volonté du peuple. Or, au lieu de mettre en place une politique criminelle, on a utilisé toutes sortes de produits de substitution ou de médicaments de confort. On a fait du social, mais le social n'est pas une politique. Il accompagne une politique mais il n'en est pas une. On a fait de la communication, mais la communication n'est pas une politique. Elle est un adjuvant à la politique. Enfin, et pire que tout, on a fait du lacrymal-moralisme, à savoir que l'on a plaint, que l'on a gémi et que l'on a abordé les problèmes de façon moralisatrice. Naturellement, le moralisme n'est pas la morale. Il en est une exagération, un dépassement et une caricature. Cela n'a pas donné lieu à la mise au point et à l'application concrète d'une politique criminelle.
En Corse -le problème corse est un problème criminel qui n'a rien à voir avec le nationalisme-, dans le midi de la France avec le développement et l'agitation de plus en plus grave du grand banditisme et dans les banlieues françaises, nous avons affaire aux diverses facettes de cette crise de l'autorité de l'Etat.
Quand un patient a une maladie, quand une voiture cesse de bien fonctionner, quel que soit le type de dysfonctionnement, cela se traduit toujours par des symptômes. Le symptôme clair et évident de cette crise de l'autorité de l'Etat, c'est la dévaluation sémantique. Les autorités françaises ne savent plus appeler les choses par leur nom. J'ai été ainsi frappé de voir que la commission d'enquête du Sénat s'intéressait à la délinquance des mineurs, alors que, naturellement, le problème crucial en France aujourd'hui n'est pas un problème de délinquance mais de criminalité.
Lorsqu'à Béziers un mineur tire sur un car de police avec un lance-roquettes, lorsque de jeunes mineurs assassinent un père de famille à coups de pieds et à coups de briques, comme cela s'est produit hier à Evreux, ce ne sont pas des délinquants mais des criminels. Ce qui rend la vie des Français impossible aujourd'hui, ce n'est pas le fait que des gamins un peu joueurs tirent des sonnettes puis s'en aillent en courant, ce ne sont pas les délits mais les crimes.
Je rougis d'avoir à le rappeler, mais je le fais quand même : entre la moitié, au minimum, et les deux tiers des 125.000 agressions violentes qui ont été commises en 2001, ce que l'on appelle les vols avec violence -ces chiffres peuvent être vérifiés au cas par cas puisque chacune de ces agressions a fait l'objet d'un procès-verbal- et qui sont portés à la connaissance des instances de répression, sont ce que le code pénal qualifie de vol en réunion avec usage d'une arme. Or, le vol en réunion avec l'usage d'une arme est un crime passible de la cour d'assises et punissable, pour un majeur, de trente ans de prison, la peine encourue étant naturellement adaptée pour les mineurs.
Il me semble donc qu'il n'est pas innocent que la France vive aujourd'hui une grave crise criminelle et que l'on s'acharne à ne parler que de délinquance. Que cela soit conscient ou non, ce n'est pas innocent. Permettez-moi une brève incursion dans le domaine de la philosophie : ne pas être capable d'évaluer les choses, c'est se condamner à les dévaluer. On en arrive ainsi à la situation actuelle où, par dévaluation, les crimes deviennent des délits, les délits des contraventions et les contraventions des incivilités. C'est envoyer un signal terrible aux jeunes malfaiteurs, c'est leur dire « tu peux y aller ». Les conséquences seront soit médiocres, soit nulles.
En France, aujourd'hui, nous avons affaire à des bandes de jeunes malfaiteurs. La fraction la plus idéologique de la sociologie nous prédisait que de telles bandes n'existeraient jamais et que la France était miraculeusement à l'abri de ce qui s'était passé partout dans le monde où l'on avait laissé une sorte d'impunité s'instaurer. Tout comme le nuage de Tchernobyl s'était arrêté sur le Rhin, nous n'aurions pas de bandes juvéniles en France. Or, ces bandes, nous les avons. Elles commencent à hériter de l'armement lourd, de l'armement de guerre en provenance des Balkans.
Je rappelle qu'en France, en 2001, près de 60 fusils d'assaut, des Kalachnikov 56 précisément, et -selon les sources- entre 25 et 27 lance-roquettes anti-chars, tel celui qui a été utilisé à Béziers, ont été récupérés par les services de police. C'est suffisant pour mettre la France à feu et à sang pendant un semestre. Toutefois, à l'heure actuelle, les jeunes malfaiteurs des banlieues ne savent pas encore se servir de ces armes. La preuve en est que récemment une grenade défensive extrêmement meurtrière a été jetée sur le commissariat de Vitry, dans le Val-de-Marne. Mal dégoupillée, cette grenade n'a pas explosé, mais vous le savez peut-être, les sources de nature policière le confirment, le nombre de jeunes gens qui sont allés combattre en Afghanistan avec les troupes d'Oussama ben Laden s'élève à une centaine. Quelques uns d'entre eux sont morts. Certains ont été arrêtés. D'autres sont en fuite à l'étranger. Toutefois, un certain nombre de ces jeunes gens sont revenus en France. Ils ont appris à se servir des armes que leurs collègues ne savaient pas utiliser. Il n'y a qu'à attendre pour qu'un drame se produise.
A Béziers, pendant l'été 2001, on n'a déploré aucun mort dans la police uniquement parce que le jeune malfaiteur ne savait pas se servir du lance-roquettes, de même qu'à Vitry il ne savait pas se servir de la grenade.
Il est regrettable d'avoir à en tirer la conclusion que, une fois de plus, en France, il faudra attendre qu'un drame se produise, qu'un car de police brûle avec dix policiers à l'intérieur, pour que l'on prenne la mesure de la gravité du phénomène. Il s'agit là d'une crise criminelle et non à une crise de délinquance. Comme toujours en pareil cas, si l'on n'y prend garde, les choses ne pourront que s'aggraver.
Ce qui me frappe, notamment à la lecture des programmes des partis politiques à l'occasion de la campagne électorale, c'est que l'on parle beaucoup de sécurité mais en des termes étranges. Les réponses que proposent aujourd'hui les principaux candidats ne sont pas adaptées à la criminalité telle que nous la connaissons en 2002, mais à ce qu'elle était en 1992-1993. Il a sans doute fallu un temps de latence assez long pour que les faits sur la délinquance et la criminalité parviennent jusqu'aux principaux dirigeants politiques, tout en haut, dans les sphères où ils se trouvent !
Il serait naturellement extrêmement utile que vos travaux -c'est en tout cas le voeu que je forme- s'intéressent, à partir du terrain, à la criminalité telle qu'elle est aujourd'hui, en 2002, dans les milieux juvéniles les plus atteints et qu'ils permettent aux pouvoirs publics de la prendre en compte.
Je vous remercie.
M. le président - La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie, messieurs, de vos exposés particulièrement clairs. Notre souci est bien de nous intéresser à ce qui se passe sur le terrain et à la réalité puis d'essayer d'en dresser un bilan afin d'apporter des ébauches de solutions. J'ai plusieurs questions à vous poser. Selon vous, l'âge des délinquants a-t-il baissé ? La gravité des actes commis a-t-elle augmenté ?
M. Alain Bauer - S'agissant de l'âge, il faut distinguer les délinquants âgés de moins de treize ans de ceux de plus de treize ans. En dessous de treize ans, il est très difficile de savoir si l'âge a baissé à huit, neuf, dix, onze ou douze ans. En revanche, on constate une féminisation accélérée de la délinquance. On connaît en effet le nombre de jeunes filles qui sont mises en cause, c'est-à-dire identifiées et donc interpellées. Ces jeunes filles, notamment celles qui sont mises en cause pour des activités en bandes, sont plus jeunes qu'elles ne l'ont jamais été.
Le taux d'élucidation en France est aujourd'hui de 42 %, comme en 1965. En fait, à statistiques comparables, il est de 25 %. Vous voyez que l'on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres ! Nous ne parlons en fait que du quart de ce que nous pourrions connaître. Dans ce quart, les mineurs représentent un dixième. Tout ce que je vais vous dire porte donc sur un dixième de la réalité.
Il suffirait que le taux d'élucidation passe de 10 à 20 % pour que tout ce que je suis en train de vous dire devienne totalement faux. En effet, si l'on doublait la surface de la connaissance, si le taux d'élucidation des mineurs était égal à celui des majeurs, on se rendrait peut-être compte que l'âge des mineurs délinquants n'a pas baissé.
Si l'on se base sur ce dixième de la réalité, on constate un net rajeunissement des jeunes qui sont mis en cause dans les phénomènes de délinquance, particulièrement dans les cas de violence sur la voie publique. Ce concept est d'ailleurs une création assez intéressante. On ne sait pas exactement qui a créé cet agrégat -qui date de 1994, me dit Xavier Raufer, qui y est fermement opposé- qui n'existe qu'en France et qui n'a aucun sens. J'y suis moi-même opposé parce que la délinquance de voie publique prend en compte des choses assez étonnantes, comme par exemple les cambriolages, parce que les cambrioleurs viennent de l'extérieur nous a expliqué le ministère de l'intérieur !
M. Xavier Raufer - Les livreurs de pizzas aussi !
M. Alain Bauer - Il s'agit là d'un argument puissant qui mérite que l'on s'y arrête. Les jeunes qui sont interpellés et mis en cause pour violences sur la voie publique sont plus jeunes. On constate également une féminisation. En proportion, les treize/dix-huit ans représentent une très large majorité des délinquants, mais on constate toutefois une poussée des huit/douze ans, ce que démontrent d'ailleurs les enquêtes d'auto-incrimination. Je vous invite à en discuter avec Sébastian Roché, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou avec Hugues Lagrange, qui vous montrent l'un et l'autre ce que sont ces évolutions. Il ne s'agit que de tendances parce que nous ne nous basons que sur de petits chiffres. Selon les indications des renseignements généraux, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et de la police, les délinquants sont donc plus jeunes, ils agissent davantage en réunion et ils sont bien plus violents qu'au cours des dix dernières années.
M. Xavier Raufer - Il y a une autre manière de percevoir ce qui se passe dans les milieux de la délinquance juvénile, c'est d'interroger les travailleurs sociaux. Les étudiants de l'Institut de criminologie exercent dans les milieux du travail social. De façon parfaitement empirique, voilà ce que l'on tire de leurs connaissances lorsque l'on discute avec eux. L'âge moyen d'entrée dans les bandes -on ne parle pas de groupes de copains allant ensemble au cinéma le samedi mais de bandes qui se constituent de manière durable dans le but de commettre des délits- a tendance à baisser environ tous les trois ans.
M. Alain Bauer - Ce sont des organisations tribales.
M. Xavier Raufer - Voilà. Il y a à peu près six ans, cet âge se situait vers douze ans, cette moyenne cachant les disparités les plus grandes. Il y a trois ans, cet âge est passé à dix ans. Aujourd'hui, il est plus près des huit ans. Les travailleurs sociaux constatent aujourd'hui que de tout jeunes enfants de cinq ou six ans se rendent à l'école avec des couteaux parce qu'ils doivent se défendre contre une autre bande dont fait partie le grand frère. Dans ces secteurs du territoire français où vivent la plupart de ces jeunes malfaiteurs, la réalité n'est pas la même que devant la porte du Sénat ou dans la société française en général, il s'agit d'une réalité clanique.
Lorsque dans notre centre de Paris II, en tant qu'enseignants, nous rencontrons des étudiants ou des professionnels, qu'il s'agisse de policiers ou de gens de l'armée, qui doivent intervenir sur des théâtres extérieurs, nous avons un travail préliminaire très important à faire. Nous devons leur expliquer ce qu'est la vie dans une société tribale ou clanique, ce que tout le monde ignore. Le seul endroit sur le territoire français où l'on a encore vaguement une idée de ce que c'est, c'est en Corse.
Adhérer à un parti politique ou à une association, entrer dans les ordres ou se marier, sont des actes que l'on accomplit seul, en fonction d'un jugement ou d'une volonté personnelle. Tel n'est absolument pas le cas dans une société tribale ou clanique. Pour prendre un exemple proche de la France, quand, dans le sud du Liban, on doit se déterminer pour savoir si on entre dans la milice Amal ou au Hezbollah, c'est tout un clan, toute une famille, tout un village ou toute une tribu qui adhère. L'adhésion n'est en rien un acte personnel. Dans les écoles, les petits frères sont comptables des bagarres des grands frères ou du clan. La guerre, on y est nolens volens .
Naturellement, cette attitude entraîne un rajeunissement permanent des gens en cause parce que, lorsque vous êtes petit, vous pouvez subir des représailles parce que votre frère a frappé quelqu'un dans la cour de récréation, dans la ville d'à côté ou à cause d'une bagarre dans un centre commercial.
Il y a donc un rajeunissement, que l'on observe de manière empirique parce que -Alain Bauer a insisté sur ce sujet- nous ne disposons pas de l'appareil de connaissance et des statistiques qui nous permettraient de l'établir d'une façon formelle. Toutefois, le peu de choses que l'on sait, qu'elles émanent des instances de répression ou qu'elles soient le fruit d'observations sur le terrain, révèlent un rajeunissement. Ce rajeunissement est mécanique, si l'on peut dire, puisqu'il affecte des individus dont la mentalité est encore, le plus souvent du fait de la provenance de leurs parents, à dominante clanique ou tribale.
M. Alain Bauer - Il existe en revanche des éléments statistiques stables ; ce sont la forte progression du nombre de mineurs en prison, le rajeunissement de l'âge auquel ils sont incarcérés et l'augmentation massive des peines auxquelles ils sont condamnés. Ces indicateurs sont stables. Le nombre de mineurs qui sont incarcérés a presque quadruplé en une vingtaine d'années. Les mineurs sont aujourd'hui condamnés plus jeunes à des peines plus longues.
M. le rapporteur - Vous nous dites qu'il y a un rajeunissement des mineurs délinquants puisque leur âge moyen est passé de douze ans il y a six ans à huit ans aujourd'hui, âge auquel ils entrent dans les bandes. Vous nous avez également dit qu'il n'y avait ni prévention ni sanction en France, qui est le pays de l'impunité, où l'Education nationale a une part de responsabilité en ne traitant pas, notamment, le problème de l'absentéisme. Selon vous, la sanction pénale n'est-elle pas insuffisamment adaptée au problème de la délinquance ou, pour reprendre votre terme, au problème, dans certains cas, de criminalité, comme à Evreux ?
M. Alain Bauer - Je me base sur le dispositif pénal et civil tel qu'il existe en France. Je suis toujours stupéfait du débat en France sur l'ordonnance de 1945. On ne doit pas lire la même ordonnance. L'ordonnance du 2 février 1945 et celle du 23 décembre 1958 permettent de répondre à presque tous les problèmes.
Quelques propositions du Sénat lors de la discussion du projet de loi sur la sécurité quotidienne me plaisaient, notamment celle visant à instituer des poursuites pour incitation à la criminalité des mineurs, ce qui n'existe pas dans le dispositif actuel. Je pense que cette disposition irait bien avec l'incitation à la débauche, par exemple. Cette proposition partait d'un sentiment compréhensible. Il est en effet difficile de trouver la vraie intentionnalité, notamment dans les organisations criminelles et dans les groupes criminels.
Sur le fond, les débats sur le code pénal, sur le code civil, sur l'ordonnance de 1945 et sur celle de 1958 -qui vont ensemble- sans oublier sur la convention de Pékin, qui a été signée en 1984, est un débat entre incantations, imprécations et lamentations, assorti de quelques claquements de pupitres parce que cela fait partie de l'animation parlementaire.
Le vrai problème en France n'est pas l'inexistence de la loi mais sa non-application. Je vous invite à vous pencher sur les conditions du débat au sein de la Chancellerie en 1972. Ce débat était public et il a fait l'objet d'une longue étude dans les Cahiers de la sécurité intérieure il y a une dizaine d'année. En 1972, le débat était simple : il y avait plus de douze millions de crimes et de délits, dont de nombreuses émissions de chèques sans provision, et beaucoup de délinquance automobile.
Le problème qui a alors été posé par la Chancellerie en 1972 portait sur la manière de résoudre la question. Il y en avait deux : la première consistait à créer des postes de magistrats et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, des institutions pour mineurs, des places de prison, d'ouvrir de nouveaux palais de justice et de répondre ainsi à la crise quantitative à l'aide d'un appareil judiciaire disposant d'un peu plus de fonctionnaires qu'en 1867. En effet, le nombre de magistrats en France vient seulement de dépasser celui de 1867 ! Le seconde manière consistait à décriminaliser, à dépénaliser, à contraventionnaliser et, accessoirement, à classer sans suite. C'est ce choix que l'exécutif et le Parlement de l'époque -tout le monde y a mis de la bonne volonté- ont fait au grand jour en 1972.
Ce système perdure aujourd'hui imperturbablement. La plupart des délits sont tombés en déshérence, mais n'ont pas disparu du code. On a décidé aujourd'hui de ne pas appliquer la loi. Le code pénal comme le code civil, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale, permettent de répondre à presque tous les problèmes. Je pense que l'on a davantage de parents licenciés que de parents démissionnaires.
Il y a tout ce qu'il faut dans l'arsenal juridique français. La vraie difficulté est qu'une partie des magistrats et du parquet -des décisions d'opportunité existent- ont décidé de classer sans suite 82 % des plaintes, celles-ci ne correspondant qu'aux quatre cinquièmes de celles qui sont déposées dans les commissariats. En effet, un million de plaintes de victimes ne sont pas comptabilisés grâce à l'invention merveilleuse qu'est la main courante. M. Haenel a d'ailleurs rédigé pour le Sénat un rapport exceptionnel sur cette question. Les cinq millions en question coïncident d'ailleurs de manière lointaine avec les 16,7 millions d'actes de victimation dont fait état la seule et unique enquête qui a été effectuée avec beaucoup de courage et de lucidité en 1999. Cette enquête n'a pas été effectuée en 2000, ce qui nous aurait permis de savoir ce qui se passait.
J'ai été auditionné à l'Assemblée nationale par la commission de Christophe Caresche et de Robert Pandraud. Nous étions, je le crois, d'accord en général. Les conclusions de cette commission sont vraies : nous ne voulons pas connaître la vérité. Si l'on étudie ce que l'on connaît déjà, à savoir notre taux d'inexécution absolu, qu'il s'agisse du taux d'élucidation, c'est-à-dire d'identification des auteurs, ou du taux de poursuite, c'est-à-dire le nombre de passages devant un tribunal ou devant une quelconque institution -si je comprends qu'il y ait des dispositifs alternatifs aux peines, je suis en revanche toujours surpris qu'il y ait des dispositifs alternatifs aux poursuites ; un tel concept me pose, sur le principe, un problème juridique- on s'aperçoit qu'aujourd'hui le taux de productivité du système judiciaire français est de 1 %. Tel est le pourcentage de peines qui sont prononcées et exécutées en France par rapport au nombre d'actes recensés. Cela pose un problème pratique. Je parle des peines qui sont exécutées et non de celles qui sont prononcées. L'Union syndicale des magistrats a réalisé une étude sur l'inexécution des peines en France. La Chancellerie en a contesté les résultats tout en disant qu'elle ne pouvait fournir de statistiques parce qu'elle n'en avait pas !
M. Xavier Raufer - Je souhaite revenir sur la crise de l'autorité de l'Etat. Le bon sens populaire dit que les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Or, il ne manque pas un bouton de guêtre aux instruments judiciaires. La fameuse ordonnance de 1945 est une boite à outils qui a permis la création de maisons de correction rigoureuses. Si l'on a demain la volonté politique d'en créer d'autres, même sous un autre nom, pour être politiquement correct, elles fonctionneront aussi bien.
On parle beaucoup chaque été des couvre-feux pour les mineurs. Cette mesure, comme la réforme de l'ordonnance de 1945, est un pur et simple gadget électoral dont on parle à la télévision au journal de vingt heures lorsque l'on ne sait pas quoi dire. L'article 227-17 du code pénal dispose que « le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. » J'ai demandé aux magistrats qui publient leurs travaux dans la collection que je dirige s'il était déjà arrivé qu'une seule personne soit condamnée dans leur ressort à un franc d'amende au titre de l'article 227-17. Jamais personne !
L'article 227-21 dispose que « le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. » Cet article met immédiatement fin aux affaires de grands frères dans les cités. Les jeunes malfaiteurs sont en effet sensibles à la vertu de l'exemple. Si plusieurs d'entre eux étaient punis de trois ans de prison pour avoir incité un gamin à faire le « chouffe » à l'angle d'une cité pour annoncer l'arrivée de la police lorsqu'ils trafiquent du haschich, les autres arrêteraient immédiatement.
Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le code pénal est récent. Il est moderne. De plus, il est « bipartisan » puisqu'il a été commencé sous Pierre Bérégovoy puis terminé sous Edouard Balladur, qui l'un et l'autre ne sont pas Gengis Khan. Voilà un texte modéré. Le code pénal n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister.
Les professeurs de droit avec qui je discute à la faculté de droit disent que la machine fonctionne et qu'il ne reste plus qu'à s'en servir, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Avant de créer de nouveaux articles, d'en modifier certains, la sagesse impose de faire fonctionner cette machine puis seulement ensuite de réformer ce qui ne marche pas.
M. Bernard Plasait - Il est clair qu'en France nous sommes loin de réaliser le voeu formulé par Montesquieu de se garder de la fureur de légiférer, car nous passons notre temps à faire des lois, alors même que nous ne nous sommes pas donné les moyens d'appliquer celles qui ont été votées.
S'agissant de l'ordonnance de 1945, M. Raufer a estimé qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à ce dispositif. Pouvez-vous me confirmer qu'il est suffisant tel qu'il est, sans qu'il soit besoin de le modifier, pour traiter de façon convenable et efficace la délinquance des mineurs de moins de treize ans et pour compléter la palette des outils qui sont à la disposition des magistrats, en particulier en matière d'établissement adapté ?
M. Alain Bauer - Je confirme tout à fait les propos tenus par M. Raufer.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a probablement des améliorations à apporter au traitement de la responsabilité en matière d'incitation d'un mineur à produire des actes délinquants.
A cet égard, le Sénat avait proposé une série d'amendements parmi lesquels j'ai salué la disposition visant la poursuite pour mise en danger d'un mineur en le forçant à la délinquance. Cette mesure constituerait non pas une révolution, mais un aménagement permettant de compléter le dispositif existant.
L'ordonnance de 1945 a été réformée vingt-cinq fois, et je n'ai pas eu le sentiment que la République s'était effondrée pour autant. Je suis persuadé que des petites corrections sont à apporter ici ou là. Les violences des moins de treize ans commises en réunion et à main armée devraient peut-être faire l'objet d'une attention particulière. Ce cas est d'ailleurs prévu implicitement par les textes.
En revanche, s'agissant de la prédominance de l'éducatif sur le répressif, de l'existence de juridictions spécialisées et de la minoration de peines pour les mineurs, il me paraît hors de question d'y changer quoi que ce soit.
Si l'évolution de la société démontre la nécessité de compléter les textes existants sur quelques points, dès lors que le besoin en est exprimé, je ne pense pas que de telles modifications suscitent un drame entre les républicains dans l'hémicycle, toutes couleurs politiques confondues.
Je crois donc que tous les textes nécessaires sont effectivement disponibles.
Au-delà de cet aspect, je souligne quelques chiffres : 170.000 mineurs mis en cause, 140.000 mineurs en danger et 1.100 places ! Moi je veux bien que l'on traite d'un cent soixante-dixième du problème en posant la question suivante : la prévention a-t-elle échoué en France ?
Il faut savoir comment cela se passe lorsqu'un vendredi soir un magistrat pour les mineurs supplie à genoux un centre surchargé de récupérer un gamin en fugue ayant commis un certain nombre de violences ou d'agressions, de le garder pour le week-end, tout en sachant que le gamin sera libéré le lundi, s'il ne s'est pas enfui de nouveau entre-temps, le centre n'ayant pas les moyens de le surveiller !
Pour appliquer la loi, encore faudrait-il avoir la volonté et les moyens de le faire !
Pour ma part, je suis vivement intéressé par l'analyse de la relation entre le mineur auteur et le mineur victime. Une telle approche nous donnerait des indications importantes sur le moment où il convient d'agir.
Je me souviens des grands éclats de rire qui accueillaient le récit des expériences canadiennes et plus particulièrement l'expérience québécoise sur les tout petits enfants qui se montraient très violents à l'encontre tant de leurs camarades que des puéricultrices ou des institutrices de l'école maternelle. Tout le monde s'esclaffait. Des délinquants en maternelle !
Après vingt ans de travail -ils se sont donné les moyens et le temps de la réflexion-les Canadiens affirment que les enfants très violents ont eux-mêmes subi des violences et qu'ils effectueront six fois plus de séjours en prison que les autres délinquants.
Si nous traitions des causes et non pas seulement des conséquences, nous nous épargnerions des débats quelque peu compliqués et, surtout, nous toucherions à l'élément central que l'on connaît le moins, celui des violences domestiques, où l'auteur et la victime vivent ensemble, où les enfants sont victimes de leurs parents ou inversement, ou de la fratrie.
Pour des raisons qui restent mystérieuses, notre pays accuse un grand retard dans ce domaine, y compris sur l'Espagne, la Grèce et l'Italie, pourtant connues pour avoir des ressorts plutôt machistes en termes d'organisation sociale, qui ont su surmonter, avec l'opinion, la difficulté de traiter de ces questions.
La France se penche beaucoup aujourd'hui sur le problème des enfants victimes de violences sexuelles. C'est très bien. Des moyens considérables ont été mis en oeuvre. Il y a eu la volonté de rechercher la vérité, si pénible soit-elle. Des affaires de ce type surgissent continuellement, non pas parce qu'elles sont plus nombreuses qu'auparavant, mais simplement parce qu'elles deviennent plus visibles.
Il en a été de même pour les femmes violées. Le temps est révolu où le policier accueillait la jeune femme dans un état difficile avec ces mots : « Ma brave dame, vous avez été violée ; racontez-moi donc cela ! ». Il existe maintenant un accueil spécialisé, isolé, par des policières et des policiers ayant reçu une formation spécifique.
Lorsque nous abordons la délinquance des mineurs, nous ne faisons pas l'effort de savoir et de comprendre. Nous essayons seulement de réprimer, alors que nous devrions instaurer un équilibre entre la prévention, la dissuasion et la sanction.
En matière de sanction, il existe toute une panoplie, qui passe notamment par le retour à l'école, mais aussi par l'emprisonnement. La sanction est fonction du mode de passage à l'acte.
Le mode de passage à l'acte diffère selon qu'il est motivé par le besoin, l'envie ou le plaisir. Je vole du pain pour manger parce que je réponds à une violence plus grande encore, grosso modo la violence sociale qui a, elle, une légitimité historique -cf. Jean Valjean. Je vole une voiture parce que je ne possède qu'un vélo, parce que le système des transports publics est compliqué. Il peut y avoir des circonstances atténuantes ou aggravantes. Je viole n'importe qui parce que j'obéis à une pulsion irrésistible. Le violeur n'est pas un militant de la cause sociale ou de la révolution. Danger public, menace pour tous, il est nécessaire de le réprimer.
Aujourd'hui, on fait semblant de croire que les auteurs de tels actes sont simplement des militants sociaux qui agissent ainsi pour changer la société. Et l'on découvre subitement que ceux qui volent des voitures peuvent aussi bien brûler des synagogues, ou des églises.
On me dit qu'ils ont changé. Non, ils n'ont pas changé. Ils ont simplement élargi leur champ d'activité. Au surplus, ils ont un bonus puisqu'ils brandissent maintenant une idéologie pour masquer la voyoucratie. C'est un prétexte complémentaire. On vole les voitures et, en plus, on brûle la synagogue. L'un ne remplace pas l'autre. Si tel était le cas, on pourrait parler de mutation de la délinquance française vers une forme d'antisémitisme. Il n'en est rien.
Derrière nos débats, se pose aussi un problème de redéfinition. L'incendie volontaire d'un véhicule ou d'une poubelle n'est pas une dégradation de biens. S'il est commis en réunion, c'est un crime. S'il n'est pas commis en réunion, c'est un délit particulièrement grave. Aujourd'hui, il est considéré comme étant une dégradation de biens.
Quant aux incivilités, demandez à Sebastian Roché de vous dire comment on a manipulé ce concept pour passer de l'infrapénal au pénal que l'on ne poursuit plus. Heureusement qu'en 1994 on a supprimé le seul sujet vraiment intéressant du code pénal qui s'appelait la forfaiture ! Cela doit être un hasard !
M. Xavier Raufer - Quand on a affaire à des bandes, la délinquance des mineurs est un faux problème.
Ceux qui se préoccupent uniquement du phénomène de la délinquance des mineurs ignorent totalement ce qu'est une bande de délinquants. Il ne s'agit pas de gamins de huit ans qui se réunissent pour former une bande.
La bande se constitue un peu comme on fait de la mayonnaise. On la « touille » et on ajoute une goutte de temps en temps. Une bande comprend d'abord des meneurs, généralement appelés grand frères. Eux ont vingt-cinq ans et sont bel et bien intégrés dans le processus d'une carrière criminelle lucide et consciente. En dessous des meneurs, il y a le gros de la bande, dont les membres sont âgés entre quinze et dix-huit ans. Puis, de temps en temps, un petit entre dans la bande et y fait ses classes.
En France à l'heure actuelle, la décision n'a pas été prise d'identifier les éléments des bandes. Vous évoquiez à l'instant le diagnostic. Tout comme dans le domaine médical, la phase de diagnostic est essentielle en matière de lutte contre le crime. Ce n'est pas un mot utilisé à la légère, pour faire joli ou savant. Si le chirurgien ne dispose pas de radios ou de scanners, il se réserve des surprises lors de l'intervention. De même, dans le domaine qui nous occupe, la phase de diagnostic doit permettre de distinguer les éléments simplement un peu turbulents des vraies bandes criminelles afin de les démanteler.
Les noyaux durs des bandes criminelles ne sont pas les gamins de huit ans. Ce sont les éléments âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Si jamais vous démantelez les noyaux durs, les gamins de huit ans n'ont plus de bande vers laquelle aller. La constitution de bandes criminelles graves suit partout le même schéma. Mais vous savez que les Français vivent sur une île. Pour eux, rien n'existe en dehors de la France. Nous avons publié un livre intitulé « Les bandes criminelles » dans la collection des Presses universitaires de France, à partir de l'expérience des bandes criminelles en Californie. On le voit très bien, le mécanisme est connu. Si l'on devait ne retenir qu'un seul constat en matière de sociologie criminelle, c'est que les malfaiteurs procèdent toujours et partout de la même manière.
La raison en est que la vie criminelle est une des modalités d'évolution de l'être humain dans un milieu hostile.
Le cosmonaute évolue dans un milieu hostile. Il n'y a pas une manière soviétique ou américaine d'être cosmonaute. Tous les cosmonautes ont un scaphandre. De même, en matière de plongée sous-marine, il n'y a pas une manière de droite ou de gauche de faire de la plongée. Tous les plongeurs agissent de même pour ne pas se noyer. Pour l'alpiniste, c'est la même chose. Et ainsi de suite.
Les malfaiteurs évoluent dans un milieu hostile. Par conséquent, qu'ils sévissent au Chili, aux Etats-Unis ou en France, ils tendent tous à faire la même chose et la manière dont les bandes s'agrègent et se constituent est à peu près toujours la même.
On constate que deux ou trois gamins de huit ou neuf ans rejoignent chaque année une bande constituée. Ils sont chargés de « choufer » (regarder) à l'angle de la rue pour voir si les « flics » arrivent et de porter les « barrettes » (de drogue) parce que, comme ils sont petits, ils ne risquent pas de se faire arrêter.
S'il n'existe plus de bandes de quasi-adultes auxquelles se raccrocher, les gamins de huit ans ne s'y agrègent pas. A partir de ce moment-là, pourvu que la justice et la police s'avisent de faire leur travail, l'ordonnance de 1945 devient résiduelle et même quasiment inutile.
Commençons donc par faire ce qu'on sait faire. Nous disposons en France de l'article 227-17 du code pénal sur la responsabilité parentale. Or les autorités de ce pays ont l'attitude absolument incroyable de se demander ce qu'il faut faire, maintenant qu'il y a des familles monoparentales.
Monsieur le ministre, commençons par régler les problèmes que l'on peut régler. Lorsque vous en aurez réglé 40 % ou 50 %, vous vous féliciterez de voir baisser d'autant vos statistiques criminelles. La première impulsion aura été donnée et vous serez en mesure de constituer le petit instrument qui permet d'être efficace. Compte tenu de l'effet de rendement décroissant, il sera plus difficile de traiter plus de 50 % des cas. Peut-être faudra-t-il envisager la nécessité de concevoir un instrument spécifique pour passer de 50 % à 70 %.
Les codes existent. Nos interlocuteurs sur le terrain et ceux que nous avons consultés sont unanimes pour dire que nous possédons les instruments permettant de régler le problème à 70 %. La seule chose qui manque, c'est l'autorité de l'Etat, la volonté politique d'utiliser ces moyens. C'est tout. Le reste, c'est de la poésie.
M. le président - Vous avez dit tout à l'heure que la prévention n'existait pas.
M. Alain Bauer - Un jour, il nous a été demandé d'évaluer la prévention. J'ai répondu que nous le ferions quand il y en aurait. Traiter un cent soixante-dixième du problème peut donner des résultats ou non. Mais il demeure 169.000 mineurs délinquants mis en cause et 150.000 mineurs en danger.
Il faut bien comprendre que le dispositif actuel est conçu pour traiter de la même manière les huit-douze ans et les quinze-dix-huit ans, par une même association pilotée par le Conseil général, selon la politique du « guichet » local, qui ne correspond d'ailleurs pas toujours avec celle de la ville principale, la couleur politique du maire et du président du conseil général ne coïncidant pas totalement. J'ai vécu la situation dans le cadre de nombreux contrats locaux de sécurité.
Mon propos ici n'est pas de mise en cause, mais j'ai pu constater comment l'agrégation entre HLM, réseaux de transports urbains, ville, police, justice, Education nationale et conseil général échappait à la règle habituelle des trois tiers. Sur le sujet, je partage la vision que vous avez exposée dans le rapport Hyest-Carraz !
M. le président - Oui.
M. Alain Bauer - Il faut tout de même dire les choses !
M. le président - Cela n'a aucune importance aujourd'hui, vous le savez bien.
M. Alain Bauer - Oui, mais il restera votre rapport, ceux des sénateurs Gélard et Haenel. Ils ont constitué des bases de références qui nous sont utiles et qui nous serviront toujours.
L'acceptation de la réalité est toujours compliquée en France. Elle est progressive. En attendant, il n'y a pas de réponse. Les dispositifs de prévention ne peuvent pas avoir échoué puisqu'ils ne sont pas opérationnels. Lorsqu'ils seront mis en place, il sera possible de déterminer s'ils sont efficaces ou non.
Pour l'instant, la prévention se résume à une sorte de course à l'échalote pour obtenir la seule place qui reste dans le centre. Ce dernier, surchargé, ne peut pas répondre aux questions. Il fonctionne de huit heures à dix-huit heures du lundi au vendredi et accueille dans la même salle les jeunes de huit à treize ans et ceux de quatorze à dix-huit ans, comme si le problème était le même et se traitait de la même manière.
Lorsque vous découvrez cela, vous comprenez que la politique du guichet n'est pas une politique de projet, que la subvention n'est pas une réponse systématique au problème, même si le soulagement est grand d'avoir trouvé une association qui fera à votre place, sans observer ni évaluer ni contrôler, ce que vous avez décidé que vous ne pouviez ni ne vouliez faire, a fortiori tout seul.
Je pense que l'investissement sur la prévention est la première réponse au problème, l'objectif étant d'instaurer un équilibre naturel entre la prévention, la dissuasion et la sanction. Le mode de passage à l'acte est l'élément d'aiguillage.
Au chapitre de la sanction, il convient de considérer toutes les échelles de peine, y compris l'incarcération. La prison est toujours un échec, mais parfois cet échec est nécessaire. C'est le mode de passage à l'acte qui nous oriente vers l'utilisation éventuelle de l'incarcération. Aujourd'hui, l'incarcération est devenue le mode opératoire par défaut.
M. Jacques Mahéas - Je dois reconnaître que ces deux interventions m'ont quelque peu étonné et même « douché ». Je ne m'y retrouve pas, alors même que je vis en Seine-Saint-Denis, dans un milieu extrêmement difficile.
J'avais même l'intention, peut-être d'une façon un peu provocatrice, de vous demander en première question si vous étiez pour le rétablissement de la peine de mort. Je gomme cette question. Mais vous voyez combien vos interventions m'ont choqué.
En revanche, j'ai noté un certain nombre d'aspects positifs. En particulier, M. Bauer a dit une chose essentielle, à savoir qu'on traite plus les conséquences que les causes.
Pour ma part, ce sont les causes qui m'intéressent pour mener une action à long terme dans une société renouvelée. Les conséquences, elles, sont connues.
Parmi les causes, vous avez défini, au fil de vos interventions, les violences précoces, non détectées, la justice mal adaptée et le manque de moyens de la répression. Vous n'en avez pas défini d'autres.
A mes yeux, les familles monoparentales figurent parmi les causes, car il est tout de même plus difficile d'élever des enfants seul que d'élever des enfants à deux.
M. le président - Il ne faut pas de familles monoparentales !
M. Jacques Mahéas - Premièrement, avez-vous détecté d'autres causes que vous ne nous avez pas définies ?
Deuxièmement, nous sommes de nombreux élus locaux à considérer que, malgré tout, des dispositifs de prévention ont été mis en place. Le développement extraordinaire d'activités sportives, culturelles et sociales permet tout de même de limiter les difficultés et de diminuer très largement le chiffre de la délinquance. Qu'en pensez-vous ?
M. Alain Bauer - Monsieur le sénateur, je ne suis pas un diplomate et je tiens à dire que je suis choqué, moi, par votre phrase sur la peine de mort. Je ne la laisserai pas passer.
M. Jacques Mahéas - Tant mieux !
M. Alain Bauer - Je suis abolitionniste naturel.
Je note simplement que vous devriez être davantage choqué par le contraste qui existe entre la baisse tendancielle du nombre de jeunes tués lors d'affrontements avec des forces de police et l'augmentation gigantesque du nombre de tués lors d'affrontements entre jeunes.
Je pense que la suppression de la peine de mort par la République représente une grande avancée et que son rétablissement par la délinquance ou la criminalité est un immense recul. Quitte à s'inquiéter du rétablissement de la peine de mort, mieux vaudrait se préoccuper de véritablement la supprimer, notamment quand les morts sont des victimes civiles, innocentes par nature, y compris quand elles sont des membres d'autres bandes organisées.
Je le répète, moi je suis choqué par votre intervention et j'y réponds comme je me dois de le faire.
M. Jacques Mahéas - Vous en avez le droit.
M. Alain Bauer - Je le prends donc.
M. Jacques Mahéas - J'ai le droit aussi de vous apporter la contradiction.
M. Alain Bauer - S'agissant de vos questions, ma position est identique à celle d'un certain nombre de chercheurs ou de parlementaires de droite ou de gauche. C'est la suivante.
Quand vous avez une éruption de boutons, vous avez le choix entre deux solutions : soit vous décidez d'y appliquer une crème dermatologique quelconque en considérant que, de toute façon, l'éruption va disparaître ; soit vous allez consulter votre médecin en vous demandant si l'éruption ne serait pas de caractère malin. J'ai la même position entre homéopathie, chimie et chirurgie. Je ne décide pas a priori . De même, je pense que le problème qui nous est posé aujourd'hui est un problème d'analyse.
Je prends pour exemple l'analyse du problème des familles monoparentales. J'ai exactement la même analyse que vous, mais les enquêtes menées notamment par Sebastian Roché ont établi que la monoparentalité n'apparaît en rien comme un élément aggravant des phénomènes de délinquance ou de criminalité.
Dès lors, la recherche ayant fait des avancées et mon a priori n'étant pas validé par la recherche, j'ai changé d'analyse. Je reconnais qu' a priori je pensais que l'analyse était juste. Or, aujourd'hui, les indications de la recherche, provisoires et partielles, démontrent que le phénomène des familles monoparentales ne constitue pas un facteur majeur de délinquance. Je pense notamment aux interpellations effectuées à Strasbourg à la suite des incendies de voitures lors des grandes périodes festives. Il importe donc de prendre en compte ce qui est. Tout ce que nous croyons n'est pas systématiquement vrai tant que ce n'est pas validé par la recherche.
En troisième lieu, j'ignore pour ma part si les activités notamment sportives, sociales, d'accompagnement ont une quelconque utilité. Dans la mesure où personne ne m'a communiqué le diagnostic de départ, il m'est impossible de vous dire si la thérapeutique fonctionne en la matière.
Le jour où l'on aura déterminé le mode de passage à l'acte et la raison pour laquelle les activités criminelles sont organisées, je serai en mesure de vous répondre qu'on peut faire une évaluation qui démontre si effectivement les activités sportives développées donnent des résultats.
Je ne prendrai qu'un seul exemple : une très grande ville de la région parisienne, dirigée par un maire extrêmement dynamique, menait une politique sportive extraordinairement développée, à tel point que ses gymnases ont commencé progressivement à brûler. Pourquoi brûlaient-ils ? Personne ne connaissant la réponse, il a été décidé d'installer des miradors, des grilles, des gardiens et des systèmes électroniques. C'était la stratégie de la tension.
La maire a continué à se demander pour quelle raison brûlaient des gymnases qui ne sont pas a priori des éléments de pouvoir. Une longue enquête a suivi, qui a démontré que l'activité sportive était tellement développée et incitative que l'association sportive avait fini par compter des centaines d'adhérents domiciliés hors de la ville. La ville étant aussi la circonscription, cet afflux avait été salué.
Mais le gymnase n'avait pratiquement plus de tranches horaires disponibles pour les « inorganisés ». Il restait, pour ces derniers, grosso modo un vendredi sur quatre dans les années bissextiles, entre vingt-trois heures huit et vingt-trois heures trente-deux. Comme les habitants du quartier se refusaient à prendre une licence parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans une structure organisée, ils ont décidé d'occuper les lieux. Terrorisées, les mères de familles s'angoissaient pour les élèves. La réaction générale a été d'augmenter les dispositifs de fermeture.
Ainsi, une immense politique sportive qui est un grand succès peut être aussi génératrice de violence et d'insécurité par des effets pervers. Il n'y a pas de politique sans effet pervers. La difficulté, c'est d'analyser les effets pervers de la politique que l'on envisage de mener, de se montrer prêt à les assumer et d'être capable de les anticiper.
A cet égard, je ne crois pas que la solution réside dans le « tout social », le tout « ville-vacances-vie », le tout « venez, on va vous payer des vacances ailleurs », le tout « exportons nos délinquants dans les sites d'activités balnéaires ou de ski ». C'est un pur transfert de criminalité et, tout simplement, une position à la Ponce Pilate en matière d'insécurité. On ne règle rien. On se débarrasse du problème pendant deux mois ou un mois, voire trois semaines.
Voilà pourquoi je ne partage pas votre analyse. Votre démarche peut parfaitement se révéler efficace. Encore faudrait-il en déterminer l'objectif initial.
En matière de criminalité et de délinquance, le prêt-à-porter n'existe pas. Il n'y a que du sur-mesure, mais pour cela, il faut précisément avoir pris les mesures, c'est-à-dire avoir analysé les phénomènes avant toute prise de position. Telle ou telle disposition est peut-être bonne, mais je n'en sais rien a priori .
Mes observations sont très fluctuantes. Sur deux cents villes, réseaux de transport et sociétés HLM que nous avons eu la possibilité de traiter sur le terrain, les résultats sont les plus divers. Ils peuvent être excellents. Ils sont parfois totalement dramatiques, y compris lorsque les mesures appliquées sont identiques d'une ville à l'autre. C'est le cas lorsqu'elles ont été simplement copiées-collées, sans faire l'effort préalable de la première ville qui a effectué de longues études avant de déterminer son choix.
Je pense au correspondant de nuit d'Angers. Cette création a été un immense succès à Angers, mais elle est impossible à copier et à reproduire ailleurs, parce que c'est une mesure de lien social et non pas une mesure de sécurité. Elle n'est pas opérante dans les zones difficiles. Elle fonctionne dans les endroits qui connaissent non pas le développement de l'insécurité mais l'absence de lien social.
Je le répète, je n'ai pas d' a priori sur la question, et comme je n'ai pas d' a priori , je ne sais pas si la politique que vous me décrivez fonctionne.
Le rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville m'a laissé perplexe. J'ai lu un certain nombre de rapports sur de nombreuses opérations locales. Ils montrent l'immense diversité des mesures prises sans concertation et qui ne fonctionnent pas, ainsi que des dispositifs résultant de longues études et qui donnent des résultats. Cela étant, l'inverse est vrai aussi, car il arrive que des dispositifs de concertation débouchent sur d'immenses échecs. Il est toujours possible de se tromper.
Le problème est que, dans notre pays, on n'évalue pas, on inspecte. Le terme « évaluation » est, aujourd'hui encore, un gros mot.
M. Xavier Raufer - Je suis criminologue. Les criminologues exercent leur talent à l'intérieur d'une faculté de droit. Ils savent que la manière simple, efficace pour se faire haïr, c'est d'expliquer aux policiers comment faire la police, aux magistrats comment rendre la justice, aux élus comment faire leur travail et aux agents de renseignements comment espionner.
Nous ne faisons donc pas cela, naturellement. Nous observons les réalités criminelles. Dans une structure hospitalière, nous serions des radiologues. Notre rôle est de prendre des radios et de les transmettre. Il ne nous appartient ni d'opérer ni de prescrire des médicaments.
Notre attitude de neutralité à l'égard de nos collaborateurs en amont et en aval nous amène à accepter le code pénal tel qu'il est, sauf éventuellement à le compléter. Comme la peine de mort ne figure pas au code pénal, nous ne nous y intéressons pas parce que nous ne sommes pas des moralistes ou des nostalgiques. Nous sommes là pour observer la réalité criminelle telle qu'elle est.
Et quitte à vous décevoir et à vous faire de la peine, je dirai qu'il existe dans certains pays des études statistiques sérieuses et crédibles, mais aussi controversées et durement combattues par différentes instances notamment sociales, répressives et judiciaires, qui montrent que les seuls lieux où la criminalité baisse nettement et durablement sont ceux qui se sont éloignés des chimères sociologiques et qui ont adopté la ligne de conduite suivante : le seul angle par lequel on puisse prendre en main les situations criminelles quand on veut y mettre fin, c'est le criminel lui-même.
Si la politique préventive consistant, par exemple, à repeindre les HLM en rose fonctionnait, la France serait un pays sans crime puisque c'est la seule politique qui y a prévalu depuis trente ans, dans l'anarchie et l'improvisation.
Mais, hélas, la criminologie réaliste montre deux choses : d'abord, les malfaiteurs ne cessent de sévir que lorsqu'on les arrête ; il arrive un moment où rien ne sert de leur tendre des sucettes, il faut les arrêter. Ensuite, je le répète, le seul angle pour prendre en main des situations criminelles, ce sont les criminels eux-mêmes.
Des idéologues s'opposent bien entendu à cette vision des choses. Mais dans la réalité, y compris en matière de meurtre, qui est la forme de criminalité la plus intraitable, les résultats concrets et durables sont le fruit d'une politique de répression mesurée, respectueuse des codes et ciblée sur les criminels eux-mêmes, et non pas le fait que leur grand-maman était volage ou que leur papa s'adonnait à la boisson.
Mme Nicole Borvo - Je souscris à vos propos à tous deux faisant valoir que l'arsenal législatif est suffisant et que le problème réside dans la volonté et les moyens de l'utiliser, encore que ce dernier point suscite débat.
En revanche, j'ai eu franchement l'impression, à vous entendre, que la France était à feu et à sang à cause de bandes de criminels mineurs. Telle n'est pas la réalité que je connais. J'ignore la signification de la peinture rose des HLM. Mais je peux vous dire que je connais de nombreuses cités d'HLM peintes en rose et bleu, et qui sont fort dégradées. Ce sont des endroits peu propices à la joie de vivre.
Mais vous avez vous-mêmes précisé que ce que vous appelez criminalité, et qui existe, n'est tout de même pas le plus fréquent. Le plus souvent, il s'agit d'actes de petite délinquance et d'incivilités commis par des jeunes, notamment en bas âge, qui ont de plus en plus tendance à se regrouper en bandes. Ce sont ces actes-là qui suscitent, à juste titre, un sentiment d'insécurité dans de nombreux quartiers. La criminalité avec armes reste heureusement relativement rare et, surtout, il convient de le souligner comme vous l'avez fait vous-même, elle est totalement pilotée par des majeurs.
Or, on a établi un amalgame entre la criminalité de mineurs et l'organisation criminelle de majeurs, notamment de trafic d'armes ou de drogue, qui, pour ses propres besoins, agrège un certain nombre de mineurs. Je souhaite que la distinction soit bien marquée.
S'agissant de la prévention en France, vous avez dit, monsieur Bauer, qu'elle est floue, voire inexistante et dépourvue de moyens. A partir des enseignements que vous avez tirés tant de vos observations à l'étranger que des dispositifs qui existent tout de même en France, qu'entendez-vous par politique de prévention ?
A mes yeux, l'établissement fermé est synonyme d'un traitement sanction, la prévention devant intervenir en amont et dans un champ beaucoup plus vaste.
M. Alain Bauer - Tout d'abord, et vous avez raison de le souligner, madame, la tradition nationale française, assez particulière, a créé, dès 1548, des quartiers de ségrégation, de relégation, qui sont devenus en partie des quartiers de récession. C'est donc un choix particulier qui a créé ce qu'on appelle la banlieue, ou les faubourgs, ou encore les lieux du ban, espaces destinés depuis toujours à des populations dangereuses et aux industries polluantes. Ce sont des lieux historiquement concentrés .
Aujourd'hui, l'insécurité n'est pas un sentiment. C'est un vécu. Le réel vécu n'est pas le réel connu et personne ici n'est en mesure d'expliquer à quelqu'un qui se fait insulter le matin, le midi et le soir, ou qui est agressé, que ce n'est pas grave. La tradition nationale française s'énonce de la manière suivante : négation, minoration, éjection. Autrement dit : « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave et ce n'est pas moi ».
Mme Nicole Borvo - C'est de moins en moins vrai !
M. Alain Bauer - Madame, ce n'est pas parce que c'est de moins en moins vrai -parce que le réel est apparu soudainement, parce que les victimes sont de plus en plus nombreuses et que la peur de l'électeur est souvent le début de la sagesse- que ce phénomène n'a pas été vrai. Moi, je ne suis pas pour la réécriture de l'histoire. Je l'assume telle qu'elle est, dans sa continuité.
Donc, il y a un phénomène dans la tradition nationale française qui vise à ne pas reconnaître la réalité d'un fait, puis à expliquer que ce n'était pas grave et, ensuite, à affirmer que ce n'était pas de sa faute. Ce système a donné des résultats dramatiques, à savoir la construction de l'extrémisme dans ce pays, parce qu'eux nous ont dit : « C'est grave, c'est vrai et, en plus, on sait qui c'est ; il est un peu basané avec les cheveux crépus. » Est apparue alors cette pure invention de l'existence d'un lien immigration-insécurité, faisant passer l'ethnographie pour de la démographie, et on s'est laissé aller à des slogans.
Moi je dis simplement que ce pays connaît une insécurité réelle. La réalité, c'est l'apparition de la victime. La France est passée de 100.000 victimes à plus de 300.000 victimes par an, soit un million en trois ans et autant qu'au cours des dix années précédentes. C'est cette réalité-là qui a tout changé. Les victimes ne sont pas un produit de l'invention ou de la statistique. Elles sont une réalité physique, comme le chômage.
Voilà trente ans, le chômage était un concept. Puis, le concept s'est transformé en individus. Peu à peu, ils ont eu un visage, une identité. Ils se sont rapprochés de notre sphère familiale, amicale. Ils sont devenus nous-mêmes.
La violence, c'est exactement la même réalité. Au-delà des questions d'insécurité, de sécurité ou de délinquance, le grave problème de la France est le retour de la violence physique. C'est cette réalité-là qui a tout changé.
En outre, quoi qu'on dise, la violence en France est devenue un phénomène communautaire. C'est là une autre injustice sociale. A la différence du vol, les premières victimes de la violence sont les pauvres. L'injustice sociale de la violence est telle dans ce pays qu'il s'est créé un univers particulier où auteurs et victimes se ressemblent car ils appartiennent aux mêmes milieux sociaux.
Nier cette violence-là revient à construire une injustice sociale organisée, parce que les riches auront toujours les moyens de se défendre et de se protéger. C'est pour cela que je suis fasciné par cette capacité du refus de dire les choses par ceux qui sont les principaux défenseurs des pauvres et que je reste, je dois le dire, assez curieusement interpellé par les résultats de cette situation.
Effectivement, le nombre des homicides est resté très faible en France. C'est une tradition nationale. Ils n'atteignent pas le millier, encore qu'ils aient enregistré une petite hausse de 15 % l'année dernière. Certes, 15 % sur un millier, c'est peu, mais en termes de tendance, c'est énorme. Quoi qu'il en soit, les chiffres se sont stabilisés dans ce domaine. En revanche, les violences physiques, les violences et vols à main armée, les vols, ont augmenté dans des proportions considérables. Ce sont des statistiques à deux chiffres.
Par conséquent, il importe de se montrer très vigilant pour distinguer ce qui relève d'une poussée d'humeur de ce qui correspond à une réalité tendancielle, d'autant que deux ans, 2000-2001, c'est long.
Au sujet des bandes, vous avez raison, madame, et Xavier Raufer a très bien répondu tout à l'heure en précisant qu'il n'y a pas de bandes de mineurs. Il s'agit de groupes de jeunes mineurs qui sont instrumentalisés par des bandes de majeurs. A ce propos, je salue le dispositif qui a été proposé par le Sénat, relatif à l'incitation des mineurs à la violence, à la délinquance ou à la criminalité. Il manquait dans l'arsenal législatif. On peut penser ce qu'on veut de l'ensemble des propositions qui ont été faites, mais, en l'occurrence, il faut le dire, c'était une bonne initiative parlementaire.
Enfin, le problème fondamental est celui des moyens et de leur répartition territoriale cohérente. Le rapport de MM. Hyest et Carraz sont éloquents. Nos territoires n'ont rien à voir avec la réalité.
La France compte environ 460 circonscriptions de sécurité publique et 100 agglomérations. Sa carte judiciaire date, pour les pessimistes, du XIIIème et, pour les optimistes, du XVIIIème siècle. On cherche vainement de la cohérence. Rien n'est mutualisé. On trouve tout le monde au même endroit à la même heure, ou bien personne. On ne travaille pas en mettant en commun ses propres moyens.
La police illustre ce phénomène. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a largement assez de policiers en France. Ils sont simplement très mal répartis et particulièrement mal spécialisés.
M. le président - Nous sommes deux à le penser !
M. Alain Bauer - Il n'y aurait dans ce pays que 100 circonscriptions d'agglomération du seul ressort de la police nationale que tout le monde y serait très tranquille, le reste étant dévolu à la gendarmerie.
Le secteur des transports constitue le bassin de la délinquance française. Les seuls contrats locaux de sécurité qui ont un sens dans ce pays sont les CLS transports, alors même qu'ils n'étaient pas prévus par le texte de 1997. Apparus grâce à la volonté commune de l'Etat, des policiers et des réseaux de transports urbains, ils ont constitué une approche intelligente de la situation.
Si notre pays réussit à organiser des territoires cohérents, menant des actions complémentaires incluant une mise en commun des moyens, sur des horaires extensifs, avec passage de témoin, en prenant en compte les réalités, tout peut changer.
Aujourd'hui, le grand basculement de la délinquance française s'opère non pas dans le Midi ou en Seine-Saint-Denis, mais à l'Ouest. L'une des villes les plus délinquantes de France est Vernouillet, à côté de Dreux. La Picardie, notamment l'Oise, a basculé dans la délinquance et la violence, en zones à la fois de police et de gendarmerie.
L'extension géographique urbaine par les lotissements a provoqué un transfert mécanique de types particuliers de délinquance en zones purement rurales. On n'a pas réagi, laissant les pauvres gendarmes aux prises avec une délinquance qu'ils ne connaissaient pas et à laquelle ils essaient de s'adapter. D'ailleurs, ils ont été les premiers à mettre en place les brigades pour la délinquance des mineurs sur des territoires qui sont totalement incohérents.
Les transferts d'effectifs au sein de la gendarmerie s'effectuent dans les pires conditions, sous l'effet de la machine infernale de 1995. M. Hyest l'avait indiqué dans son rapport, soulignant les départs à la retraite massifs, par anticipation, l'imprévision généralisée, notamment en matière d'écrêtement des officiers de police judiciaire et des commissaires, d'où la crise dans la police judiciaire, la difficulté des recrutements.
Aujourd'hui, ce sont les adjoints de sécurité qui constituent la colonne vertébrale de la police. Il convient de leur rendre hommage car au moins ils sont là, ce qui relativise beaucoup les critiques dont ils font l'objet. Cette situation se prolongera jusqu'à la fin de l'année.
En fait, à la suite des mesures de 1972 et 1995, l'ensemble du dispositif policier se trouve aujourd'hui dans un état lamentable. Il fonctionne sur des territoires incohérents, avec des spécialités mal réparties et sa relation avec le domaine judiciaire n'a rien à voir avec la réalité.
Le territoire est fondamental. Les maisons de la justice et du droit me paraissent plutôt de bonnes initiatives à cet égard.
En matière de création d'espaces, pour ma part, je ne préconise pas qu'ils soient fermés ou ouverts. Je dis simplement que l'absentéisme scolaire est un problème majeur, parce que si aujourd'hui plus de 50 % des violences de voie publique sont commises par des mineurs pendant la journée, cela signifie qu'ils ne sont pas à l'école alors qu'ils devraient y être. L'obligation scolaire n'est pas un acte du fascisme grandissant. C'est une invention de la République et elle n'est pas appliquée. Je souhaite que ces mineurs retournent à l'école.
Les enseignants ne sont pas masochistes. Quand les « emmerdeurs » sont dehors, les enseignants ne font pas grève pour les récupérer à l'intérieur de l'école. Et on les comprend. Cela étant, il faut remettre ces mineurs à l'école, parce que c'est tout de même ce qu'on a de plus simple, de plus facile et de plus efficace. Cela n'empêche pas que certaines écoles accueillent des enseignants plus spécialisés, un accompagnement spécifique, des agents de gardiennage. Il est à noter d'ailleurs que la plupart des grèves d'enseignants sont destinées à réclamer davantage de « pions » et de surveillants. Ce n'est tout de même pas un détail anodin. Il prouve qu'il s'agit là d'une des réponses réelles au problème.
Par ailleurs, il me paraît nécessaire de conduire une étude sur le thème mineur auteur et mineur victime, de mener de nouvelles enquêtes de victimation sur les mineurs, afin de se donner le moyen de savoir enfin de quoi on parle. Ce n'est pas si difficile que cela. Il suffit de remplacer les noms par des numéros afin de protéger l'anonymat et de parler enfin de la réalité.
Une étude est en cours sur l'explication du passage à l'acte par des enquêtes d'auto-victimation semblables aux recherches de Sebastian Roché. Elle est le fruit d'une initiative privée, financée par le secteur privé ou parapublic mutualiste. Il faut noter une nouvelle fois que ce n'est pas l'Etat qui est à l'origine de cette initiative. Cette étude paraît de nature à répondre à beaucoup de nos questions.
Je suis pour la mutualisation des moyens, pour la création des espaces nécessaires. Je pense qu'il faut créer moins de policiers et plus d'agents de prévention, d'agents de la protection judiciaire de la jeunesse, à condition que cette structure ne s'inscrive pas dans une logique de pensée unique selon laquelle tous les mineurs ne sont que des victimes. Un certain nombre d'entre eux sont des auteurs et des dangers pour la société.
La « tournante » n'est pas un acte social révolutionnaire. Ses principales victimes sont identiques à ses auteurs. C'est à nouveau une injustice sociale et, entre pauvres, plus qu'une oppression, c'est un drame social. En la matière, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont réalisables.
Il s'agit d'un acte de volonté, d'un acte politique, qui n'implique pas systématiquement d'imposer une réponse toute policière, au contraire.
M. Xavier Raufer - Je veux faire part de mon immense étonnement. Depuis une vingtaine d'années, il y a deux choses qui me font peur.
D'abord, je prendrai le cas d'un stupéfiant comme l'ecstasy, dont la composition est une véritable poubelle chimique, puisqu'il est fabriqué à partir de détergent à déboucher les toilettes, de liquide contre le rhume, d'acide chlorhydrique, etc. Or je constate que ceux qui manifestent la plus grande bienveillance au regard de cette drogue se disent écologistes. C'est là un grand motif de stupéfaction.
Le second tient au fait que, parmi les derniers -et heureusement- défenseurs de la culture de l'excuse, figurent ceux qui devraient être les soutiens naturels des 125.000 victimes des vols avec violence commis dans le pays l'an dernier.
Au bout du compte, une fois que la messe est dite, la culture de l'excuse -qui est un peu ce que j'ai entendu au cours des derniers instants- revient à se faire le défenseur des malfaiteurs et non pas des victimes.
Qui sont les malfaiteurs ? Qui sont les victimes ? Les 125.000 victimes des vols avec violence n'ont pas toutes été recrutées dans le nord du seizième arrondissement. Par conséquent, il me semblerait normal que des élus de ces zones-là accordent une attention plus grande aux victimes qu'aux malfaiteurs.
Eh bien, non, tel n'est pas l'avis des écologistes, qui trouvent « sympa » de consommer de l'ecstasy. Ainsi, des élus de territoires où règne, hélas, la violence sociale en viennent à prendre la défense, non pas des victimes, mais des malfaiteurs.
M. le rapporteur - Nous aurions encore de nombreuses questions à vous poser, et nous referons sans doute appel à vous, comme à d'autres intervenants, pour des compléments d'information. Car notre rôle est d'auditionner des experts aux vues différentes, de façon à assumer notre rôle et notre fonction : il s'agit d'une décision politique que nous ne devons pas laisser les experts prendre à notre place.
J'aurai une dernière question. Vous avez souligné que nous avions tendance à faire l'amalgame entre les militants sociaux et les criminels, et l'un des intervenants a évoqué un véritable « péril jeune » en France. Cet amalgame est-il propre à notre pays, ou bien le trouve-t-on dans d'autres pays ?
M. Alain Bauer - L'Angleterre, où je me trouvais hier, est confrontée à un retour fort de la violence. Mais c'est un pays communautarisé ethniquement ; ce sont donc des zones particulières qui apparaissent en fonction du mode de construction de la société britannique.
Les Espagnols viennent de publier des statistiques particulièrement préoccupantes, notamment sur le retour de la violence et, en particulier, de la violence des jeunes, sachant que le concept de mineur est très différent d'un pays à l'autre, puisqu'une analyse à l'échelon européen révèle une immense diversité des codes, très dur en Angleterre et beaucoup plus souples dans le reste de l'Union.
Je ne crois pas qu'il y ait de péril jeune. Ce n'est pas un problème de péril jeune, c'est un problème de péril criminel. Les criminels instrumentalisent des jeunes, et, parce que nous nous sentons un peu coupables de ce que nous n'avons pas fait, donc un peu responsables, nous faisons montre en quelque sorte d'une certaine tolérance. Je n'appartiens pas aux partisans de la tolérance zéro ; je suis au contraire de ceux qui pensent qu'il faut répondre systématiquement à tous les actes de manière appropriée et adaptée. En la matière, l'absence de réponse, parce qu'on ne sait pas, amène systématiquement une réponse très dure, totalement surprenante pour ceux qui, tout à coup, passent de rien à la prison, parce qu'il n'y a aucun élément intermédiaire.
Je ne crois pas qu'il y ait de péril jeune, je ne crois pas qu'il y ait de collusion entre les éducateurs et les malfaiteurs. Nous avons une immense difficulté à dire les choses et à reconnaître que, parmi les criminels, il n'y a pas seulement des militants ou des victimes sociales. Il y a aussi de purs criminels, des malfaiteurs, des personnes malfaisantes qui se cachent derrière les autres ; et l'on permet qu'ils utilisent les autres en ne répondant pas à cette question qui, elle, existe, qui n'est pas une invention, qui fait des victimes qui sont là et qui demandent justice et réparation. Car, souvent, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Quand on n'applique pas la loi...
On a dit que la capitulation, c'est quand on explique au lieu d'agir. Je suis pour expliquer en agissant. En la matière, le lien entre les deux n'est pas fait : on n'explique pas, on ne cherche pas, et on n'agit pas.
Il n'y a pas de péril jeune, il y a un péril criminel, dont les principales victimes sont ceux que l'on devrait défendre dans des espaces de relégation et de ségrégation. Le fait qu'il y ait des espaces de sécession n'est en rien une satisfaction.
M. le président - Messieurs, je vous remercie.
Audition de M. Denis SALAS,
magistrat, maître de conférence
à l'École nationale de la magistrature de Paris
(13
mars 2002)
Présidence de Mme BORVO, secrétaire
Mme Nicole Borvo, président - Nous allons entendre Monsieur Salas. Monsieur Salas, vous êtes magistrat, maître de conférence à l'École nationale de la magistrature à Paris, et vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur la délinquance des mineurs.
( Mme le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole.
M. Denis Salas - Mon intervention est essentiellement un témoignage sur les pratiques judiciaires concernant la délinquance des mineurs.
J'ai moi-même été dans le passé juge des enfants. Par la suite, dans le cadre de la formation de l'École nationale de la magistrature, j'ai conduit plusieurs années un certain nombre de séminaires de réflexion, avec des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, avec des magistrats, avec des procureurs, sur cette question de la délinquance des mineurs. J'ai également participé à plusieurs échanges avec des professionnels.
C'est plutôt à propos de cette réflexion d'ensemble sur la délinquance des mineurs telle que la perçoit la justice des mineurs que je voudrais faire certaines observations préliminaires, en particulier m'interroger sur le rôle que joue aujourd'hui et qu'a joué par le passé la fameuse ordonnance de 1945, qui a été en quelque sorte le texte fondateur à l'intérieur duquel nous avons inscrit notre action éducative et judiciaire pendant plus d'un demi-siècle.
Dans cette perspective, il est tout à fait frappant de constater que ce texte, dans son esprit et dans sa lettre, a organisé deux choses : d'une part, un espace judiciaire que je qualifierai de procédural, caractérisé par une extrême souplesse, par une extrême flexibilité, et, d'autre part, une action éducative autonome, et même de plus en plus autonome, par rapport à l'action judiciaire.
Au cours de toute leur histoire, les rapports entre le judiciaire, d'un côté, et l'éducatif, de l'autre, ont été marqués par une sorte de relation de pouvoir, d'échange, de dialogue, en fonction des rapports de force qui ont pu se nouer. Nous avons connu l'ère du tout-éducatif dans les années soixante-dix ; puis le judiciaire a repris une forme de prééminence dans cette dialectique permanente.
C'est à l'intérieur de cet échange incessant entre, d'un côté, les exigences de la loi, incarnées par les magistrats -le respect de la légalité, le rappel des interdits du code pénal-, et, de l'autre côté, la nécessaire souplesse de l'action éducative que se situait l'action qui a été conduite.
Il me semble important que, précisément, la figure du juge des enfants incarne, au fond, un ordre public de protection, un garant institutionnel ayant la mission, d'une part, de sanctionner et, d'autre part, dans la même configuration institutionnelle, d'éduquer ou de rééduquer.
Une des particularités de l'ordonnance de 1945, on l'oublie trop souvent, réside dans la révision des procédures : à tout moment, le magistrat peut revoir sa décision en fonction de l'évolution du parcours du jeune, être plus restrictif dans les interdictions posées ou plus souple dans les mesures éducatives qui sont instruites, ou bien au contraire en ajouter. Cette flexibilité permanente avait beaucoup d'avantages ; elle avait pour but reconnu non pas de produire un coupable ou un innocent, mais avant tout d'induire une dynamique éducative, une dynamique d'insertion.
L'éducatif n'était donc jamais une dernière chance donnée au jeune, mais bien plus une chance toujours à saisir dans une procédure en boucle offerte en permanence à ses possibilités, à ses libertés.
Ce schéma, qui est toujours valable, me semble malheureusement avoir connu de grandes difficultés à s'adapter à la délinquance des mineurs d'aujourd'hui, en particulier à cause de ce que j'avais appelé il y a quelques années la « délinquance d'exclusion ». Il s'agit d'une délinquance de masse, territorialisée, essentiellement liée à des parcours de désinsertion durable dans lesquels des groupes familiaux tout entiers vivent dans l'illégalité et dans des cultures de survie, dans des modalités de précarité extrêmement importantes les conduisant insensiblement vers la déviance ou vers la délinquance.
La justice des mineurs n'a pas su saisir, ne sait pas saisir ces parcours de déviance -parcours massifs, territorialisés et familiaux- avec ses outils habituels.
D'un côté, ce que l'on appelle la « délinquance initiatique » trouve réponse dans un traitement individuel. Il s'agit d'une délinquance ponctuelle, liée à un passage à l'acte, propre à l'adolescence : entre 70 % et 80 % des mineurs que les juges des enfants voient dans une audience dite de cabinet, c'est-à-dire ponctuellement, ne reviennent plus devant eux. Il suffit donc de marquer un interdit, et une mesure unique peut permettre que les choses s'arrêtent là.
De l'autre côté, il existe une autre délinquance, dite pathologique, qui est beaucoup plus lourde, car elle est liée à des fonctionnements familiaux extrêmement graves dans lesquels le mineur est pris et inscrit ses différents passages à l'acte. Le tribunal pour enfants la traite au moyen d'une batterie d'interventions -psychiatrique, éducative- lourdes. La justice des mineurs sait traiter cette délinquance pathologique, parce que l'équipement éducatif et psychiatrique qui est le sien lui en donne les moyens.
On a donc une action individuelle très forte à la fois sur les passages à l'acte ponctuels et sur ce que l'on appelle les « cas lourds », grâce à l'efficacité de l'intervention pluridisciplinaire que j'évoquais tout à l'heure.
En revanche, la justice des mineurs telle que je la décrivais à l'instant n'a aucune prise sur toutes les autres formes de délinquance, liées à ce que l'on appelle globalement les violences urbaines, la délinquance de groupe, sur tous ces phénomènes de masse, parce qu'elle intervient selon des logiques individuelles et à partir d'actions extrêmement précises et fines découlant du diagnostic posé ; elle ne sait pas gérer des phénomènes de masse ni même des phénomènes de délinquance de groupe, qui lui échappent totalement.
C'est pourquoi il faut bien distinguer entre une approche sociologique de la violence urbaine, une violence globale, et une approche beaucoup plus judiciaire et individuelle de la délinquance des mineurs, qui, pour sa part, relève de l'institution judiciaire elle-même ; mais on ne peut pas demander à la justice de traiter aussi l'ensemble des formes que connaît actuellement la délinquance des mineurs.
Le monde judiciaire a donc apporté des réponses, qui sont venues essentiellement du parquet, car, se situant en amont de l'intervention du juge, nouant des partenariats avec les différentes autorités locales, élues, mais aussi administratives, etc., il a pu développer certains modes d'intervention : je pense en particulier au traitement en temps réel ; je pense au rendez-vous judiciaire ; je pense aussi à la loi sur la comparution rapprochée, qui a permis de raccourcir le délai entre le défèrement du mineur et sa comparution ; je pense encore à la volonté de ne pas laisser un acte de délinquance sans réponse, ce qui a conduit à systématiquement développer les défèrements afin de ne pas laisser s'installer un sentiment d'impunité. Tout cela a conduit à une prodigieuse accélération, à un raccourcissement du temps, pour tenter de répondre à l'urgence sociale et à l'incapacité structurelle de la justice des mineurs à répondre à ces nouveaux défis.
Le problème, à mes yeux, est le suivant : ce temps extrêmement raccourci, qui fonctionne dans l'urgence, peut-il permettre de traiter les problèmes posés par les jeunes, notamment par ceux qui sont en grande difficulté, ceux que l'on appelle communément les « cas lourds », qui vivent dans des situations familiales extrêmement déstructurées et qui n'ont pas a priori , ni sur le plan scolaire ni sur le plan du travail ou de l'apprentissage, les moyens de s'en sortir ?
Les solutions qui ont été avancées reposent sur des impératifs de rapidité et d'urgence, mais elles font l'économie du temps nécessaire à l'acte éducatif. Cette tension majeure entre l'urgence sociale, qui est imposée aujourd'hui, et le temps nécessaire à la maturation d'une réponse pour que celle-ci soit utile entraîne un dysfonctionnement extrêmement préjudiciable à l'efficacité de l'action.
J'évoquais tout à l'heure l'ordonnance de 1945. Je rappelle qu'elle prévoyait un temps long et autonome permettant, précisément, de se donner des chances d'une action durable sur la famille ou sur la psychologie du mineur. Dans le cas qui nous préoccupe, nous devons concilier à la fois l'urgence de l'intervention et des droits individuels qui ont été apportés au mineur -incontestablement, la loi du 15 juin 2000 a constitué un progrès considérable de ce point de vue là. D'un côté, nous avons donc des garanties, des droits, et, de l'autre, une urgence de l'intervention, un temps raccourci. Mais où est passé l'éducatif dans cette nouvelle dynamique ? Je me pose la question.
J'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui un doute fondamental s'est durablement installé sur la capacité de notre société et de ses institutions à réaliser la grande ambition de 1945, qui était une promesse éducative pour ces jeunes en grande difficulté.
Un intervenant évoquait tout à l'heure la culture de l'excuse ; une des causes de ce doute réside précisément dans le discours sur l'excuse permanente, à la fois psychologique et sociologique, selon lequel toute prise en compte du contexte social ou familial dans lequel s'inscrit un parcours de délinquant est forcément une excuse, est forcément un facteur d'impunité qui ne fera que renforcer la violence et la délinquance.
Or je crois que c'est totalement faux. En tant que magistrat, j'ai eu à juger des mineurs. Notre dialectique était très claire, et les mineurs le savaient : d'une part, l'interdit, qu'il ne fallait pas transgresser, à propos duquel des règles étaient posées ; d'autre part, l'espace éducatif, qui donnait sa chance au jeune. Celui-ci pouvait donc, avant que la sanction ne tombe, démontrer par des actes, par une démarche éducative, par une volonté d'insertion, par un certain nombre d'actes positifs, qu'il était capable de présenter un autre visage de lui-même que celui du délinquant, visage que la justice aurait peut-être bien souhaité lui conserver pour pouvoir, sans culpabilité, lui imposer des sanctions.
Un deuxième problème me semble également très important, et l'audition de MM. Bauer et Raufer, à laquelle j'ai assisté en partie, l'a bien montré : c'est la lecture de la violence des jeunes comme menace indifférenciée. On ne distingue plus entre les majeurs et les mineurs, entre la délinquance contre les biens et la délinquance contre les personnes... On ne perçoit plus qu'une menace indifférenciée, globale, qui s'abat sur notre société et à laquelle on répond par des réponses indifférenciées. On « déspécialise » les réponses judiciaire et éducative ; on réagit à cette indifférenciation de la menace par une indifférenciation des réponses, et on tentera plusieurs solutions, dans une certaine confusion, pour essayer d'endiguer le mal.
Cette réponse, désordonnée, indifférenciée et quelque peu aveugle, à l'ennemi intérieur que serait aujourd'hui le mineur me semble extrêmement dommageable pour notre société, parce que je crois que, si nous conservions, dans une perspective pédagogique, le souci de distinguer par des diagnostics les différents types de problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous aurions peut-être quelque chance de trouver les bonnes réponses.
Mais c'est plutôt sur un autre point que je voudrais insister. On a mis tout à l'heure en avant, et j'ai eu moi-même l'occasion de le faire dans d'autres interventions, les réponses pénales au phénomène criminel. Je crois qu'il faut avoir, face à des sous-cultures mafieuses de banlieue, des réponses extrêmement claires.
Face à cela, un autre phénomène apparaît : le pénal de proximité. S'est développée ces dernières années, dans les quartiers difficiles ou les quartiers sensibles, une sorte d'alliance entre, d'un côté, la répression pénale, organisée par le parquet et, de l'autre côté, le souci de « coller » au territoire, avec les groupes locaux de traitement de l'insécurité et, évidemment, les contrats locaux de sécurité. Ce pénal doit, dans le même temps, garantir le respect des grands interdits sociaux, qui nous protègent de la délinquance, et avoir le souci de coller à la réalité. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre des contrats locaux de sécurité a la vertu d'avoir un impact plus efficace ; mais ce n'est pas le champ sur lequel je voudrais insister.
Nous avons besoin, pour ces jeunes mineurs en grande difficulté -et cela me paraît beaucoup plus fondamental-, d'une politique éducative extrêmement ambitieuse qui permettrait de ranimer le pari de 1945, qui serait dégagée de la suspicion de participer de cette culture de l'excuse que nous évoquions tout à l'heure, mais qui aurait précisément pour ambition de répondre au nouveau défi de la délinquance des mineurs aujourd'hui.
Je prendrai quelques exemples, et, d'abord, les questions liées à l'hébergement.
Il se trouve que j'ai participé il y a quelque temps à l'évaluation des programmes des centres d'éducation renforcée que le secteur associatif et la protection judiciaire de la jeunesse avaient réalisés. Ces structures se caractérisent, me semble-t-il, par des réponses d'une très grande efficacité et d'un très grand pragmatisme, et par le souci de mobiliser les associations habilitées « justice » -elles sont actuellement une centaine, mais Mme Lebranchu, que, je crois, vous entendrez, vous le dira beaucoup mieux que moi-, avec des résultats très probants.
Cette évaluation a permis de constater que, manifestement, les structures en question permettent de donner une nouvelle chance aux jeunes, et, même si les périodes d'hébergement renforcé sont très courtes, le travail qui y est fait me semble extrêmement efficace.
Cette solution me paraît devoir être approfondie dans la mesure où, dans le cas de l'hébergement court, l'évaluation avait mis en relief que le grand problème résidait dans la sortie : les jeunes sont là pendant quelques semaines, ont un autre environnement éducatif, se confrontent à des adultes, à des limites, à des lois, ce qui est très structurant pour eux, puis sont complètement lâchés dans la nature et reviennent dans les cités ou ailleurs. Dans les jours qui suivent, on a le sentiment de voir le travail de reconstruction se défaire.
Il faut réfléchir à l'hébergement, non pas, comme on le fait actuellement, en termes d'hébergement « alternatif », c'est-à-dire visant, à court terme, à donner au parquet d'autres solutions que l'incarcération et, en quelque sorte, à le dégager du dilemme entre l'incarcération et la rue, mais en termes de solutions à moyen ou à long terme, en particulier pour les jeunes. Il faut, en l'occurrence, renverser complètement le service public et lui donner la finalité d'une action éducative à moyen ou à long terme dont ces jeunes ont besoin. Le temps éducatif est un temps de la reconstruction identitaire, il est forcément long : ce n'est pas en quelques semaines que l'on parviendra à reconstruire une personnalité qui, pour des raisons que chacun peut connaître, est extrêmement dégradée.
Je rappellerai un point d'histoire. Le dernier centre fermé, celui de Fresnes, a cessé de fonctionner en 1979 ; ont également été supprimées petit à petit, sans peut-être que l'on pense aux difficultés que cela pourrait nous poser par la suite, les structures lourdes de la PJJ, les grandes ISES, institutions spéciales d'éducation surveillée, et les IPES, les internats professionnels d'éducation surveillée, grosses structures d'apprentissage et d'insertion. On peut parfaitement le comprendre, car cela correspondait à une époque de l'histoire de l'action éducative ; mais, depuis, aucun outil éducatif équivalent n'a été créé, si ce n'est ceux que j'évoquais à l'instant, qui sont des outils à très court terme. Ils sont excellents dans le créneau qui est le leur, mais ils sont loin de répondre à la déshérence éducative à laquelle nous sommes actuellement confrontés.
Nous disposons aujourd'hui des centres d'éducation renforcée et des centres de placement immédiat, qui sont des centres d'orientation immédiate pour les jeunes, et c'est tout. Quand on connaît le degré d'exclusion scolaire et l'absence de perspective d'insertion par le travail dont ces jeunes sont frappés -le sujet a été abordé tout à l'heure-, on peut, effectivement, nourrir quelque inquiétude.
La réflexion sur l'hébergement me semble importante, mais il faut la compléter par une réflexion sur le milieu ouvert.
Il faut donner au milieu ouvert ses lettres de noblesse. Je suis frappé, moi qui ai beaucoup eu l'occasion de travailler dans le cadre du milieu ouvert, de voir à quel point ce travail est méconnu par les élus, mais aussi par les professionnels. C'est un travail très obscur, parce que c'est un travail d'investigation, d'observation. Il faut faire preuve aussi de patience et de tact. C'est un travail d'approche, un travail extrêmement minutieux, et ce travail invisible -le travail éducatif est souvent invisible- n'est pas du tout perçu comme ayant une quelconque efficacité d'un point de vue général. Je trouve cela extrêmement dommageable.
Les éducateurs qui ont une mesure d'observation en milieu ouvert font fréquemment part d'une remarque qu'ils entendent souvent : « Vous observez, mais, attendez ! vous n'agissez pas ! » L'exigence de l'acte, de l'action, est vécue comme antagonique avec celle de l'observation ou de l'investigation. Mais il faut, pour trouver la bonne décision pour un jeune, une période d'observation et d'investigation : c'est au terme de cette articulation de décision et de diagnostic que l'on peut avoir la chance de trouver la bonne solution.
Pour résumer mon sentiment, je dirai que l'urgence est plutôt là : une politique éducative ambitieuse, avec la question de l'hébergement que j'évoquais tout à l'heure, une politique de prévention spécialisée qui soit fortement dynamisée par l'action de l'État, laquelle, on le sait, relève des conseils généraux.
L'un des grands oubliés de la politique de la ville, ces dernières années, c'est le Conseil général, dont la capacité à mettre en place des moyens d'intervention et de prévention spécialisée me paraît avoir disparu de la scène. Il faut, là, en amont de l'intervention judiciaire, avant que le mandat judiciaire ne s'applique, donner d'une façon ou d'une autre les moyens d'une action éducative de prévention.
Enfin, pour ces jeunes, ne l'oublions pas, une politique psychiatrique s'impose. J'y insiste, parce que cet aspect est peu connu, alors qu'il est très important pour les cas lourds que j'évoquais tout à l'heure.
Pourquoi ? Parce que la France connaît un déficit considérable dans le traitement de la psychiatrie de l'adolescent. Mme Brisset, défenseure des enfants, qui l'évoquait récemment, soulignait l'un des points qui lui semblaient essentiels dans les signalements qui lui étaient adressés : le chiffre des suicides des adolescents. Il est très important puisque, notait-elle, c'est la deuxième cause de mortalité dans cette classe d'âge, ce qui semble devoir être perçu comme tel. Or, actuellement, les prises en charge en pédopsychiatrie sont très insuffisantes, et 5 % des admissions en hospitalisation de jour en Île-de-France sont refusées, faute de place.
Autre point très important, j'ai souvent été confronté, dans ma propre pratique, à cette incapacité des services de psychiatrie, pour des raisons à la fois dogmatiques, mais aussi de place, de prendre le relais en termes de psychiatrie, en termes aussi de contrainte psychiatrique. La psychiatrie de l'adolescent est un lieu à revisiter, à mobiliser, dans le souci de donner des réponses complètes d'un point de vue éducatif. Si nous parvenons à être présents sur ces différents fronts de la prévention, de l'hébergement, de la psychiatrie et du milieu ouvert, qui constituent un véritable front éducatif dans la lutte contre la délinquance des mineurs, nous pourrons nous donner les moyens d'une force de frappe plus efficace que celle que, malheureusement, nous avons actuellement.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous nous avez dit qu'existaient grosso modo trois formes de délinquance : la délinquance initiatique, la délinquance pathologique et la délinquance d'exclusion. Je n'aborderai pas la délinquance pathologique, qui est le lot commun de toute société et que, bien sûr, il faut traiter. En revanche, je voudrais revenir sur les deux autres.
N'y a-t-il pas aujourd'hui un lien extrêmement fort entre la délinquance initiatique et la délinquance d'exclusion en ce sens que, pour bon nombre de jeunes qui sont en situation d'exclusion, il faut passer à l'acte pour être reconnu par les siens ? A partir de là, vous vous êtes demandé où est la politique en matière de prévention éducative. Il faut une politique éducative ambitieuse, dites-vous, et vous avez sans doute raison. Mais ce type de population est-il réceptif à une telle politique éducative, dans la mesure où il faut agir, bien sûr, sur le délinquant, sur son environnement familial, mais aussi sur son milieu ambiant ?
M. Denis Salas - Je crois que vous avez raison. Des travaux de sociologie ont été menés, et vous avez entendu, je crois, des sociologues qui vous ont donné de bien meilleures explications que moi.
J'ai travaillé voilà quelques années avec Hugues Lagrange, qui s'est lui aussi longuement penché sur la délinquance des mineurs. A l'époque, un groupe de travail avait été formé autour de Mme Guigou pour réfléchir aux réponses à apporter. Il avait constaté que, comme vous le remarquez, l'initiation pouvait fonctionner dans un sens positif, mais aussi dans le sens de la reconnaissance d'une identité délinquante et que, dans certains groupes de délinquance, l'initiation fonctionnait comme une étape obligée pour voir son identité validée, notamment les passages par la prison, qui étaient un titre de gloire considérable pour celui qui voulait se forger une identité de caïd dans le quartier.
Mais, s'il est devenu massif, c'est vrai, le phénomène n'est pas nouveau. Les éducateurs déconstruisent en permanence ces fausses identités. Ce travail est plus visible aujourd'hui, parce que les médias rendent compte de certains phénomènes, mais on ne saurait compter le nombre fois où les éducateurs -je l'ai moi-même fait en tant que juge des enfants- mènent un travail de déconstruction de cette fausse identité : c'est le travail quotidien du magistrat ou de l'éducateur.
Il s'agit de montrer au jeune que l'identité qui lui est proposée par le groupe auquel il appartient ne mène à rien de positif. Le gros travail éducatif consiste donc à lui faire voir que les perspectives identitaires ouvertes par sa bande ou son quartier ne sont pas les bonnes et qu'il doit progressivement en trouver d'autres, afin de déboucher à terme sur une issue positive.
Toutefois, les issues positives sont très peu nombreuses, car le travail est rare, l'accès à un apprentissage suppose un certain niveau et les structures éducatives sont très insuffisantes et n'interviennent que sur une courte durée.
Les handicaps sont donc nombreux et les relais font cruellement défaut pour proposer des solutions solides, alors que les modèles identitaires négatifs sont de plus en plus attirants. Cela ressort très bien de nombreux séminaires et tables rondes : l'argent facile, le pouvoir détenu par certains « caïds », l'appartenance à des réseaux apparaissent comme les solutions les plus faciles et représentent la pente naturelle.
Quoi qu'il en soit, je crois illusoire de penser qu'une présence policière renforcée dans ces quartiers permettrait de mettre un terme à ces phénomènes dangereux. C'est à mon sens davantage un travail fin de déconstruction qui doit être entrepris : la capacité d'éducateurs de terrain d'assurer un suivi individualisé des jeunes et de leur délivrer un certain nombre de messages positifs quant à leur avenir peut permettre d'inverser la tendance.
M. le rapporteur - Qui peut assumer ce rôle éducatif ? La famille, certes, mais elle est souvent absente ou déstructurée. Est-ce plutôt la mission de l'Education nationale ? L'action de celle-ci a également ses contraintes et ses limites. Vous avez indiqué qu'une réponse de proximité était nécessaire. Que voulez-vous dire par là ? Qu'est-il possible de faire ?
M. Denis Salas - Pour ma part, je ne pense pas que compter sur la famille soit un leurre, bien au contraire.
M. le rapporteur - Pas toujours, naturellement !
M. Denis Salas - En effet, les parents, j'y insiste, sont les premiers protecteurs de l'enfant. Je veux les placer en première ligne : leur rôle est primordial. Il faut précisément les mettre en situation d'autorité et leur dire qu'ils ne peuvent pas se défausser de leurs responsabilités éducatives mais qu'ils doivent au contraire les assumer. Pour beaucoup de parents, il est facile de démissionner et de ne pas répondre aux convocations du juge ou de se désintéresser de toute espèce d'intervention éducative.
M. le rapporteur - A ce propos, quel est le taux de réponse des parents ? Dans quelle proportion assument-ils leurs responsabilités après que vous les avez sensibilisés à celles-ci ?
M. Denis Salas - Il s'agit d'un moment très important dans la pratique des juges des enfants. Des collègues exerçant actuellement ces fonctions seraient mieux à même d'en parler, mais il est indispensable que les deux parents assistent aux audiences. Si le jeune se présente entouré de ses copains de quartier et adopte une attitude de défi à l'égard de l'autorité, le juger en l'absence de ses parents revient à cautionner son comportement et à le placer en situation de toute-puissance. En revanche, si les parents sont présents, le contexte est tout à fait différent. Il faut insister pour qu'ils viennent, et alors, comme par hasard, les copains ne se montrent pas. Quelque chose d'essentiel se joue à ce moment. Les jeunes ont pris des libertés considérables dans leur famille et leur quartier et tendent à défier le juge, seuls ou avec leur bande. Ce comportement est très fréquent, et le rôle du magistrat est donc de redonner leur place aux parents et de s'assurer de leur présence quand il prend sa décision.
M. le rapporteur - Est-il possible de contraindre les parents à venir ?
M. Bernard Plasait - S'ils ne viennent pas, est-ce parce qu'ils craignent leur enfant ?
M. Denis Salas - Non, ils ressentent à mon sens une forme de lassitude, d'épuisement. Ils sont déjà allés chercher leur gamin plusieurs fois au commissariat et ils ne comprennent pas bien ce qui se joue. D'une certaine façon, ils perdent pied. Il peut arriver que l'on impose aux parents d'assister à une audience, mais je préférais pour ma part recourir à la persuasion, et cela réussissait dans la plupart des cas. Pour les parents, le juge représente véritablement une bouée de sauvetage : après des mois, voire des années, de désordre éducatif ou d'anomie familiale, on leur restitue enfin leur place, et cela permet de donner des chances d'aboutir à l'action éducative qui sera menée par la suite. En effet, ils seront les garants de l'efficacité de cette dernière.
Cela étant, il ne faut pas se leurrer : ces parents ont besoin d'un soutien. C'est là qu'intervient l'éducateur en milieu ouvert ; il les rencontrera régulièrement, leur rappellera leurs responsabilités et aura pour rôle d'étayer la fonction parentale. La frontière est souvent floue : l'éducateur doit non pas se substituer aux parents, mais les soutenir dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, par le biais d'une sorte de tutorat. Quand des parents sont hésitants ou épuisés -être confronté à des enfants en situation de toute-puissance peut en effet être exténuant et démoralisant !- il est très important pour eux d'avoir cet appui du juge et de l'éducateur. Cela leur permet de reprendre peu à peu leur place ; ce processus est long et difficile, mais le jeune retrouve alors lui aussi sa vraie place dans la famille.
M. le rapporteur - Il faudrait engager ce processus dès le premier délit, afin d'éviter que n'apparaisse cette lassitude des parents que vous avez évoquée.
M. Denis Salas - Je suis d'accord avec vous, mais le mot « délit » me gêne, car c'est l'absentéisme scolaire, lequel ne constitue pas un délit, qui doit donner l'alarme. Ce phénomène représente le premier « décrochage » et, comme cela a été dit, les professeurs ne courent pas après un gamin qui leur crée des difficultés. Je crois donc préférable de dépénaliser, en quelque sorte, l'intervention ; si une assistante sociale scolaire est présente dans le collège ou le lycée et saisit systématiquement le juge des enfants en assistance éducative en cas d'absentéisme, le signalement sera suffisamment précoce pour que l'action de l'éducateur puisse être efficace. Le dispositif de tutorat de la famille pourra alors être mis en place : comme je le disais tout à l'heure, cela représente le meilleur moyen d'agir de façon solide et durable, en utilisant les ressources parentales existantes, même si ces dernières ne sont pas toujours très substantielles. Ce point est important.
M. Bernard Plasait - Je ne comprends pas : on nous dit souvent que le gamin qui commence par commettre une transgression légère -par exemple, en n'assistant pas à un cours- en viendra ensuite à des infractions de plus en plus graves, mais que le juge ne voit pas ce primo-délinquant, qui se trouve alors encouragé, en quelque sorte, à persister dans cette spirale.
Quand il rencontre enfin le juge, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est bien tard pour intervenir et, lorsqu'une sanction est prise, elle paraît souvent très dure, dans la mesure où le jeune, qui n'avait pas été puni pour ses premières fautes, avait fini par croire que ses actes étaient plus ou moins licites. Or, brusquement, il reçoit un coup sur la tête. Par conséquent, comment se fait-il qu'un gamin puisse commettre impunément un certain nombre d'infractions avant de se retrouver devant le juge ? La responsabilité de cette situation incombe-t-elle aux parents, à l'Education nationale, à la police, au procureur ou à tous ces intervenants à la fois ? J'aimerais mieux comprendre.
M. Denis Salas - Il est difficile de répondre à cette question, car plusieurs types d'interventions sont impliqués. On pense spontanément à un dysfonctionnement de la police, qui n'aurait pas une lecture suffisante des actes de délinquance ou d'incivilité, mais j'ai remarqué que les cas les plus préoccupants relevaient moins souvent d'un défaut de signalement par la police que d'un défaut de signalement par les services sociaux. Je n'évoquerai pas la police, que je connais moins parce que je n'ai jamais été en fonction au parquet ; en revanche, je relève que des postes sont vacants dans certaines circonscriptions d'action sociale et que des lycées où l'on constate des phénomènes massifs d'absentéisme sont dépourvus d'assistante sociale.
Ainsi, il m'est arrivé de rencontrer des gamins qui en étaient à deux ou trois années d'absentéisme scolaire. Qu'a-t-on fait pendant tout ce temps ? Pour autant, ils n'étaient pas forcément délinquants, étant souvent eux-mêmes victimes de violences familiales, voire sexuelles. Dès lors qu'un jeune est délaissé par la famille et par l'institution scolaire, il est rapidement entraîné dans un processus de délinquance où il est à la fois victime et auteur. Comme je le disais tout à l'heure en évoquant l'absentéisme scolaire, il me semble que la réponse est précisément de mettre en place des réseaux de signalement très fins et efficaces entre le parquet, d'une part, les services sociaux et la police, d'autre part. Le parquet pourra alors orienter les démarches.
M. Bernard Plasait - N'est-il pas débordé ?
M. Denis Salas - Certes, il le sera si on le saisit de la moindre dispute qui éclate dans un collège ou de toutes les bagarres à coups de cartables dans la cour de récréation : ces incidents doivent être pris en charge par l'institution scolaire. Il me semble même très grave de signaler de telles incivilités à des autorités qui ne sont pas compétentes pour les traiter, car cela revient à disqualifier celles qui le sont. Je ne dis pas que le parquet n'a pas sa part de responsabilité quand survient une telle évolution, mais chacun doit jouer son rôle en restant à sa place. Les incivilités commises au sein d'un lycée ou d'un collège relèvent de l'autorité scolaire.
En revanche, quand un seuil est franchi, par exemple en cas d'agression, le parquet doit être alerté : c'est d'ailleurs ce que l'on pourrait appeler une politique pénale de proximité, notion dont on ne sait pas très bien, à l'heure actuelle, ce qu'elle recouvrira. J'étais pour ma part assez opposé à la logique du « tout-pénal », parce que j'ai constaté les effets désastreux d'une disqualification généralisée des institutions d'amont, si je puis dire, lesquelles s'empressaient de se défausser de leurs fonctions d'autorité.
Sous cette réserve, le parquet peut intervenir, la difficulté tenant à l'orientation des signalements qui lui sont adressés. Il dispose en effet d'une batterie de solutions, puisqu'il peut recourir au juge des enfants, au juge d'instruction, à la médiation pénale, à la réparation, au travail en maison de justice, au classement sous condition, etc. Le parquet doit donc remplir avec beaucoup de finesse le rôle d'orchestrateur de la réponse judiciaire : il s'agit non pas de poursuivre systématiquement, mais d'évaluer les différentes situations.
M. Bernard Plasait - Ces diverses solutions que vous avez citées sont-elles effectivement mises en oeuvre ?
M. Denis Salas - Elles le sont. Je n'ai pas de chiffres à vous donner à cet égard, mais le recours aux mesures de médiation ou de réparation ou au classement sous condition progresse de façon continue. Toutes ces solutions sont d'ores et déjà mises en application à l'heure actuelle.
M. Jacques Mahéas - Se défausser de ses responsabilités sur d'autres est devenu une attitude banale, et pas uniquement dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui : on essaie de se munir à la fois d'une ceinture et de bretelles ! Ainsi est le monde dans lequel nous vivons, et cela est vrai à tous les niveaux.
Cela étant, je me sens plus en accord avec vous qu'avec les intervenants qui vous ont précédé. Nous, élus de terrain, avons souvent créé, partout où cela était possible, des lieux éducatifs, même si, il faut le reconnaître, la coordination a parfois manqué.
Les jeunes que nous évoquons sont souvent en situation d'échec total, notamment sur les plans affectif et scolaire, et trouvent leur seule légitimité au sein de leur bande. Pourtant, quand une passion existe, n'est-il pas possible au juge et aux éducateurs de prendre appui sur elle ?
Par ailleurs, quand la culture des enfants est très différente de celle des parents, la difficulté est grande. En tant qu'élus, nous recevons les familles, et il arrive que des jeunes se plaignent de l'illettrisme ou de l'alcoolisme du père... On découvre alors des situations très douloureuses. Devant ce constat, ne serait-il pas envisageable, quand des violences précoces et des manquements aux obligations scolaires ont été constatés, de réinstaurer ces écoles des parents que j'ai connues lorsque j'étais jeune enseignant et qui constituaient un bon outil ?
M. Denis Salas - M. Alain Bruel, l'un de mes anciens collègues qui se trouve aujourd'hui à la retraite et qui a longtemps été président du tribunal pour enfants de Paris, avait adressé à la direction de la santé deux rapports sur l'école des parents. Il proposait de mettre en place des structures permettant d'aider ces derniers à remplir leur rôle.
M. Jacques Mahéas - Les parents devront être contraints par la justice de participer.
M. Denis Salas - En effet. Des parents pourront être volontaires, mais la justice pourra aussi imposer cette solution. J'évoquais tout à l'heure le milieu ouvert, mais dans ce cadre il est très important d'aider les parents à jouer leur rôle au quotidien et à tenir leur place. De nombreuses mesures de cet ordre visent ainsi à prévenir la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Il s'agit d'un travail très long et minutieux, que chaque éducateur accomplit à son niveau. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le sénateur : la pénalisation des parents me semble être une solution de pure façade. Je pense à la fois plus réaliste et plus efficace de travailler, comme vous le souhaitez, par le biais d'écoles de parents, avec mandat judiciaire -je vous rejoins également sur ce point. Cela pourrait permettre de désamorcer la maltraitance et d'éviter la diffusion de la violence dans les familles, qui explique nombre de comportements des jeunes.
Pour en revenir à la première de vos observations, j'estime que l'empilement des dispositifs représente effectivement une grande difficulté. Beaucoup de jeunes ou d'éducateurs nous disent que les médiateurs sont trop nombreux dans les quartiers et que l'on ne sait plus du tout qui est l'adulte de référence. Trop de personnes veulent aider les jeunes, mais il faut pour cela une légitimité, une parole crédible et une formation -j'y insiste- afin d'éviter les glissements dangereux vers une trop grande proximité. Seuls de tels adultes, ayant eu un parcours proche de celui de leurs cadets, peuvent être efficaces. On en rencontre déjà sur le terrain : on pourrait les appeler les nouveaux éducateurs de prévention. Ils seront aptes à désamorcer la violence en intervenant en amont, grâce à leur capital humain, voire physique, personnel. Cela vaut mieux que d'empiler des dispositifs qui ne feront que brouiller la norme fondamentale, au profit d'un activisme dénué de sens.
S'agissant de la question très importante de la valorisation des jeunes, je peux vous dire que, lorsque l'on exerce la fonction de juge des enfants, on est souvent amené à poser des limites. C'est un travail extrêmement ingrat, mais tant de libertés ont été prises et tant de dérives ont été tolérées qu'il est nécessaire que quelqu'un dise « non » souvent, tape du poing sur la table et marque des interdits. Cependant, on finit alors par s'endurcir et par oublier de relever les indices d'évolution positive, qu'il faut pourtant absolument souligner, aussi légers soient-ils, afin de signifier au jeune qu'il est sur la bonne voie. Il existe donc une dialectique entre l'expression très ferme des interdits et l'indication des perspectives éventuelles de valorisation, et il est nécessaire de garder à l'esprit que la sanction peut aussi être positive : le cas échéant, le magistrat doit savoir sortir de son rôle ingrat de confrontation à la loi, et montrer au jeune qu'il a sa place au regard de celle-ci. Le juge doit le signifier, sa mission n'est pas uniquement de réprimer des comportements.
Mme le président - Je voudrais poser deux questions.
Tout d'abord, en tant que parlementaire, j'aimerais savoir si vous jugez suffisant l'arsenal législatif actuel.
M. le rapporteur - Je comptais moi aussi poser cette question.
Mme le président - Nous sommes au moins d'accord sur quelque chose.
Par ailleurs, vous avez été interrogé sur les moyens de la justice, mais quels sont à votre avis les besoins les plus cruciaux de celle-ci en la matière ?
M. le rapporteur - Si vous le permettez, madame le président, j'ajouterai une autre question, concernant la protection judiciaire de la jeunesse : le dispositif est-il à vos yeux bien adapté, et quelles améliorations pourrait-on éventuellement lui apporter ?
M. Denis Salas - En ce qui concerne l'arsenal législatif, le point avait été fait de manière satisfaisante, à mon sens, par le rapport Lazerges-Balduyck, qui a été présenté voilà quelques années. Celui-ci portait un diagnostic d'ensemble extrêmement intéressant sur le problème de la délinquance des mineurs. J'en avais retenu l'idée que les réponses législatives existaient et qu'il était erroné de penser, comme c'est trop souvent le cas, que l'ordonnance de 1945 n'a pas été modifiée depuis sa promulgation : elle l'a été à de nombreuses reprises, s'agissant en particulier du travail d'intérêt général, de la réparation ou de la médiation. Ces outils ne datent donc pas de 1945.
L'arsenal législatif me paraît suffisant, mais j'avais été très frappé, à la lecture du rapport Lazerges-Balduyck, par l'affirmation que la délinquance des mineurs est un problème relevant de la responsabilité collective et politique. Par conséquent, la justice des mineurs ou la PJJ n'ont pas vocation à assumer seules la charge écrasante de le traiter : toutes les institutions concernées par l'adolescence, cet âge où l'on cherche sa place, doivent être mobilisées. J'ai déjà évoqué, à cet égard, la psychiatrie infantile ou l'école. Si l'arsenal législatif existe, il faut donc être conscient du fait qu'il ne permettra de répondre qu'à cette délinquance individuelle des mineurs dont j'ai abondamment parlé ; les phénomènes de délinquance de groupe, mafieuse ou criminelle relèvent vraiment d'une intervention pénale et policière, y compris à l'échelon international. Cela étant, ces deux modes de délinquance, on l'a vu, sont malheureusement souvent liés et des actions complémentaires doivent être menées. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas l'intervention éducative, qui est du ressort d'une responsabilité collective et pluri-institutionnelle.
En ce qui concerne les mesures urgentes, ma conviction personnelle est que la prison n'est pas une solution.
M. Bernard Plasait - Jamais ?
M. Denis Salas - Elle peut dans certains cas être inévitable, hélas ! s'agissant de jeunes en grande difficulté, quand les passages à l'acte se multiplient et qu'il devient nécessaire de mettre un coup d'arrêt. En même temps, on sent bien qu'il s'agit d'une mesure très ponctuelle et qu'il importe de ne pas rompre le fil de l'action éducative lors du séjour du jeune en maison d'arrêt. Les éducateurs ne doivent pas considérer que l'incarcération met fin à leur mission, au contraire ! Il s'agit alors d'un nouveau défi éducatif, qui appelle une mobilisation des acteurs afin de préparer la sortie.
M. Bernard Plasait - Voilà !
M. Denis Salas - Tel est le problème, mais il faut parfois convaincre les éducateurs qu'un défi leur est lancé, alors qu'ils éprouvent souvent l'envie de souffler, ce qui peut se comprendre au regard des difficultés qu'ils rencontrent. Beaucoup de juges des enfants insistent néanmoins sur la nécessité d'agir.
Un travail éducatif doit donc être conduit, que l'incarcération ne doit pas interrompre. C'est un véritable pari, et la prison ne doit représenter qu'une parenthèse.
En ce qui concerne enfin la PJJ, la revalorisation de l'hébergement me semble cruciale. Je rappelle que les centres d'éducation renforcée sont animés, pour l'essentiel, par le secteur associatif habilité, et relativement peu par les fonctionnaires de la PJJ : un certain nombre de rapports officiels vous fourniront des chiffres à cet égard.
Cela étant, comment mobiliser la PJJ s'agissant de l'hébergement de court, moyen et long termes, alors qu'elle a assumé cette fonction au long de l'histoire, au travers des ISES, les institutions spéciales de l'éducation surveillée, des IPES, les internats professionnels de l'éducation surveillée, ou des centres de placement ? Cette question est incontournable. En effet, l'un des diagnostics posés sur les centres d'éducation renforcée met en relief une action menée à très court terme, sans aucune perspective de sortie. Si l'on veut éviter le recours à la prison, c'est dans cette direction qu'il conviendra de travailler d'arrache-pied, à la fois dans le secteur associatif et dans la fonction publique.
Quant aux autres perspectives offertes, il importe de garantir la très précieuse articulation entre le magistrat et l'éducateur, par le biais des services éducatifs auprès du tribunal, les SEAT, qui sont des outils de diagnostic pour le parquet et le juge des enfants permettant de prendre les bonnes décisions au moment adéquat, afin d'éviter le recours à des solutions peut-être trop faciles, comme l'incarcération. Le juge d'instruction, qui est de plus en plus souvent saisi de phénomènes complexes de délinquance de groupe, est également concerné. Il est donc très important de maintenir, au sein du tribunal, une alliance entre le magistrat et le monde éducatif, en vue de trouver des solutions solides, autres que la prison.
En conclusion, il convient de sauvegarder à la fois des outils de long terme, avec l'hébergement, et des outils de diagnostic au sein du tribunal, afin d'éviter de recourir à des solutions de facilité parce que l'on n'aura pas eu la possibilité, en amont, de mener des investigations suffisamment étayées.
Mme le président - Personne n'a plus de question à poser ?...
Il nous reste à vous remercier, monsieur.
Audition de M. Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY,
directeur de recherches au
CNRS
(13 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle l'audition de M. Aubusson de Cavarlay, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de l'analyse quantitative de la justice pénale, qui s'est notamment beaucoup intéressé à la mesure de la délinquance juvénile.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
M. le président - J'ai entendu dire qu'il existe un adage selon lequel la statistique est la troisième forme du mensonge.
Vous avez la parole, monsieur.
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - J'ai apporté un document qui me permettra d'étayer ma réflexion personnelle sur les chiffres relatifs à la délinquance juvénile dont nous disposons.
Comme vous l'avez précisé, monsieur le président, je suis l'un de ceux qui essaient d'analyser en profondeur ces chiffres, sans toutefois les solliciter au-delà de ce qu'ils indiquent. Il s'agit d'ouvrir quelques pistes de réflexion.
J'examinerai d'abord les statistiques les plus connues, à savoir celles du ministère de l'intérieur concernant la police et la gendarmerie, puis j'évoquerai assez brièvement ce que les chiffres nous permettent de dire s'agissant des réponses judiciaires apportées à la délinquance juvénile, et enfin je m'interrogerai à propos des éléments qui peuvent nous manquer, surtout quand on cherche à procéder à une évaluation au travers des statistiques.
Je serai bref en ce qui concerne les chiffres relatifs à la police et à la gendarmerie, pour la bonne raison que MM. Pandraud et Caresche viennent d'élaborer un volumineux rapport sur la création d'un observatoire de la délinquance et que toutes les questions de méthode me semblent être synthétisées de façon assez accessible dans ce document.
Je rappellerai simplement quelques principes de bon usage de ces statistiques dites de délinquance du ministère de l'intérieur.
Pour l'essentiel, on peut considérer qu'elles fournissent une mesure de l'activité des services de police bien plus qu'une mesure de la délinquance réelle. Cela signifie bien sûr non pas qu'elles sont sans lien avec celle-ci, mais qu'il peut exister des différences sensibles entre le nombre d'infractions commises et le nombre de faits enregistrés. Je suppose que l'exposé de M. Sébastian Roché vous a éclairés sur ce point.
Par ailleurs, même lorsque la police et la gendarmerie ont connaissance d'une affaire pouvant être qualifiée de crime ou de délit, les règles d'enregistrement statistique sont susceptibles de varier dans le temps. Cela joue en particulier pour ce qui concerne la délinquance des mineurs. Vous savez peut-être que la règle fondamentale d'enregistrement statistique pour la police et la gendarmerie veut que ne soient comptabilisés que les faits qui sont signalés au parquet ; tout fait venant à la connaissance de la police ou de la gendarmerie échappe donc à l'enregistrement statistique dès lors que, soit en fonction d'une instruction, soit sur leur propre initiative, ces services estiment ne pas devoir en saisir le parquet.
Ce point est particulièrement important s'agissant de la délinquance des mineurs : il me paraît en effet assez évident qu'en une période où l'on parle d'explosion de cette dernière, les pratiques ont été substantiellement modifiées, notamment parce que, à partir des années 1993-1994, les parquets ont exigé un signalement beaucoup plus systématique, même pour des affaires de délinquance de très faible gravité, dès l'instant où des mineurs étaient impliqués. On entre donc dans cette logique du signalement plus ou moins large que M. Salas a évoquée tout à l'heure et qui entraîne des conséquences sur l'enregistrement statistique.
En outre, lorsque l'on mobilise les chiffres du ministère de l'intérieur pour étudier la délinquance juvénile, il ne faut pas oublier que l'on passe d'un comptage de faits à un comptage de personnes et qu'entre les deux intervient le fameux taux d'élucidation de la police, qui dans certains cas est très élevé mais peut être faible dans d'autres et aller en diminuant. Je rappelle à cet égard que, pour les vols avec violence, par exemple, délits des plus préoccupants en matière de délinquance juvénile, ce taux est passé de 30 % en 1974 à 16 % en 2000. La baisse est donc régulière, et pour les vols avec violence les moins graves, tels que les vols à l'arraché, le taux d'élucidation est probablement inférieur à 10 %. Les chiffres connus ne donnent donc pas forcément une image représentative de l'ensemble des auteurs de faits enregistrés dans les statistiques de police.
Enfin, je ferai un commentaire sur l'usage des statistiques et sur la méthodologie.
Quand on nous annonce que la barre des 4 millions de faits enregistrés dans la statistique des services de police a été franchie, il ne faut pas perdre de vue que, pour parvenir à ce chiffre, on a quand même dû comptabiliser nombre de faits d'une gravité relativement peu importante : on n'arrive pas à un tel chiffre, dans un pays comme la France, en n'enregistrant que des meurtres, des assassinats, des viols, des vols à main armée et des violences significatives. La notion de fait grave pouvant évoluer au fil du temps, les variations d'une année sur l'autre que l'on souligne peuvent souvent résulter au moins autant de la multiplication des actes de faible gravité que de celle des actes les plus graves.
Cela dit, tout le monde sollicite les chiffres du ministère de l'intérieur. J'ai pu observer que vous n'aviez pas échappé à cette règle en mettant en place votre commission d'enquête, et vous avez ainsi cité, dans le rapport sur la création de la commission d'enquête, le chiffre inquiétant de 175.000 mineurs mis en cause en 2000, traduisant une augmentation de 70 % ou davantage selon la période de référence retenue.
Comment se décompose ce chiffre de 175.000 mineurs impliqués ?
En premier lieu, on a dénombré 19.000 infractions en matière de stupéfiants, dont 15.000 implications de mineurs pour usage simple de stupéfiants, principalement du cannabis ; 13.000 atteintes à l'ordre public, arrestations dans le cadre d'altercations avec les forces de l'ordre ou de contrôle qui tournent mal, et 18.000 vols à l'étalage. Il s'agit là d'infractions qui dépendent essentiellement de l'intensité des contrôles et des décisions qui sont prises à l'issue des contrôles. Au total, 50.000 mineurs sont impliqués. La signification de l'augmentation ou de la diminution de leur nombre est très directement liée aux politiques pénales développées dans chacun des trois secteurs que je viens de mentionner.
En deuxième lieu, toujours en termes de mineurs impliqués, on a recensé 11.000 cambriolages, 20.000 vols de véhicules ou à l'intérieur des véhicules et 26.000 vols sans violence ou recels. Au total, 57.000 mineurs sont impliqués. Dans ce domaine, contrairement à ce que l'on entend assez souvent, après la période de deux ou trois ans où l'on a réajusté les pratiques d'enregistrement en matière de statistiques de police, la baisse qui avait commencé au milieu des années quatre-vingt reprend. Pour tous les vols sans violence, où des majeurs ou des mineurs sont impliqués, la tendance est à la baisse.
En troisième lieu, on a enregistré 24.000 dégradations de biens. C'est un chiffre en hausse, qui signifie que des précautions immédiates sont à prendre. Les incendies, notamment de voitures, ne représentent que le dixième de ces dégradations qui, elles, sont globalement à la hausse, qu'elles soient graves ou non graves. La proportion de 24.000 sur 175.000 est importante, mais si l'on recherche le nombre des dégradations graves, il convient de diviser le chiffre par dix.
Enfin, en quatrième lieu, ce qui est plus préoccupant, ce sont les 9.600 vols avec violence, avec la réserve que j'ai formulée sur l'influence de la plus ou moins grande élucidation et les 27.000 infractions en tout genre contre les personnes. Ces deux chiffres sont à la hausse. Les infractions avec violence les plus graves sont, en dehors des homicides, qui sont rares pour les mineurs, les coups et blessures volontaires caractérisés, puisque ce sont des délits ou des crimes (13.300), et les agressions sexuelles (3.800).
Ma décomposition du chiffre de 175.000 reflète un ordre de grandeur différent de celui de la police, s'agissant de la délinquance juvénile qui est la plus préoccupante actuellement, à savoir celle qui concerne les infractions à caractère violent bien caractérisé -destructions et vols avec violence, coups et blessures et agressions sexuelles. Mon total de 29.000 mineurs impliqués représente le sixième seulement de ce qui est enregistré dans la statistique de police, ce qui tend à tempérer les constats faits à partir de la statistique de police. Cela étant, l'augmentation est tout de même de près de 60 % entre 1994 et 2000.
Lorsque j'ai participé à la mission parlementaire Lazerges-Balduyck, j'ai dû me débrouiller dans le maquis des chiffres pour essayer de proposer un chiffrage raisonnable en ordre de grandeur des réponses à la délinquance juvénile.
Je m'efforce d'actualiser le travail que j'avais fait à l'époque. Il est très difficile de s'y retrouver dans la complexité des chiffres et de tenter de mettre bout à bout les sources statistiques qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres, en raison des unités de comptes et des champs statistiques choisis. En outre, il faut bien le dire, le secteur de la statistique judiciaire est un peu sinistré. Il a peut-être subi, d'une certaine façon, le contrecoup des difficultés professionnelles ressenties en général dans le monde de la justice pour les mineurs.
La question a été posée de savoir ce qui a été signalé au parquet, comment réagissait le parquet et de quel indicateur nous disposions dans ce domaine. Nous procédons par comptage. Nous prenons le chiffre de la police et nous procédons à un autre comptage. Il n'est pas facile de faire le raccord.
Les chiffres du parquet affichent une augmentation. Elle est moindre que celle enregistrée par la police, parce que le parquet compte des affaires et non pas des personnes. Dans une affaire, plusieurs personnes peuvent être impliquées. L'augmentation des chiffres du parquet est d'environ 47 % pendant la période 1994-2000. Il est frappant de constater que l'augmentation porte sur les domaines auxquels une réponse a été apportée d'une façon ou d'une autre.
En chiffres absolus, les classements « secs » ont été maintenus.
S'agissant des alternatives aux poursuites, il est très difficile d'indiquer une évolution, puisqu'on est parti de presque rien. Je pourrais dire qu'elles ont été multipliées par dix, mais ce serait un peu un effet de manche. Alors qu'en 1994, seulement quelques recours à la médiation-réparation avaient lieu pour les mineurs, actuellement près du tiers des affaires enregistrées par le parquet font l'objet d'une procédure alternative aux poursuites. On constate une augmentation assez rapide à cet égard.
Cela étant, cet élément principal de l'activité du parquet ne doit pas laisser dans l'ombre le fait que les poursuites sont en augmentation aussi très importante. J'ai avancé le pourcentage de 38 %, mais là encore il s'agit d'un comptage par affaire. Lorsque nous examinerons l'activité des juges pour enfants et des tribunaux pour enfants, nous verrons que les augmentations semblent plus rapides.
Le parquet a joué un rôle régulateur. Il a exigé plus de transmission de la part de la police et de la gendarmerie et il a apporté un plus grand nombre de réponses alternatives aux poursuites. Mais, ce faisant, il a alimenté le dispositif judiciaire proprement dit d'une masse de cas à traiter qui a été en augmentation considérable sur cette période 1994-2000.
Quelle a été la répartition des affaires ? Je me souviens avoir souvent entendu, à l'occasion des auditions de la mission Lazerges-Balduyck, que les parquets manifestaient une méfiance grandissante au regard des juges des enfants et choisissaient plus volontiers la voie de l'instruction dans les cas graves pour obtenir un traitement plus certain des affaires. Je constate pour ma part, avec quatre années de recul, que c'est loin d'être le cas et que l'instruction est au contraire en régression pour le traitement des mineurs délinquants, comme d'ailleurs pour les majeurs délinquants.
Par conséquent, l'essentiel des poursuites est bien absorbé par le passage devant les juridictions spécialisées pour les mineurs. Si je dois avancer un chiffre -au risque de ne pas respecter mon serment- je dirai que l'augmentation me semble quasiment supérieure à celle qui est constatée au sein de la police et de la gendarmerie.
S'agissant des traitements, les dispositifs statistiques sont ici les plus faibles. J'ai pu observer qu'en cette période où l'on cherche à dresser le bilan du traitement de la délinquance juvénile, il est fait appel aux statistiques de condamnation qui sont issues du casier judiciaire. Je vous mets en garde contre cette utilisation.
En effet, mes collègues de la sous-direction statistique du ministère de l'intérieur ont repéré que, depuis cinq ans, en raison des mécanismes de réhabilitation dont bénéficient les mineurs au moment où ils deviennent majeurs et dès l'effacement du casier judiciaire, de nombreuses condamnations ne sont pas enregistrées.
Par ailleurs, il convient de relativiser toute augmentation qui prendrait pour base l'année 1995, qui est une année d'amnistie. Ainsi, une augmentation du nombre de condamnations de 9.000 à 25.000 n'a pas de sens. Il importe de le rappeler pour éviter des erreurs.
Enfin, en raison de l'effacement du casier judiciaire, nous ne savons pas très bien -et c'est là un euphémisme- comment évolue la répartition des peines prononcées au cours de la période écoulée. Pour le savoir, la seule solution consiste à rechercher en aval le suivi en matière pénitentiaire, dans le cadre de la PJJ, afin d'avoir une indication sur le traitement appliqué aux mineurs qui ont été jugés.
Je reviens sur les juridictions de jugement. S'agissant du nombre de détentions provisoires, celles qui sont prononcées par les juges d'instruction stagnent, tandis que celles qui sont prononcées par les juges des enfants augmentent, bien que moins rapidement que l'ensemble des affaires traitées. On enregistre 30 % d'augmentation des recours à la détention provisoire pour les mineurs qui passent par le cabinet des juges des enfants et qui sont jugés par les tribunaux pour enfants. Ce point me semble important quand on évoque les verrous qu'il y aurait dans l'ordonnance de 1945 sur le recours à la détention avant jugement.
Ensuite, le jugement pour des faits criminels se développe aussi très rapidement pour les mineurs, y compris pour des moins de seize ans. Dans ce cadre, la détention provisoire est possible lorsqu'elle se révèle nécessaire.
Comme on le verra, le nombre croissant de placements de mineurs en détention concerne essentiellement des mineurs qui ne sont pas condamnés définitifs. Par conséquent, la détention avant le jugement ou immédiatement après le jugement semble être la règle et se développer assez rapidement au cours de la période 1994-2000.
Je ne développerai pas ici tous les chiffres. Je me concentrerai sur l'évolution de la répartition des prises en charge entre la prison et les différentes composantes du secteur éducatif.
J'ai évoqué la croissance de la population incarcérée. En termes de stock, c'est peu mais le chiffre du stock n'est pas significatif. On se préoccupe quelquefois de connaître le nombre de mineurs en prison à un moment donné. Le mineur incarcéré à dix-sept ans et demi et condamné à deux ans de prison sera majeur au bout de six mois. Il sera alors compté comme majeur. On ne peut donc pas utiliser la donnée du stock de la même manière pour les mineurs que pour les majeurs.
Le flux a plus de signification. Il augmente d'environ 50 % de 1994 à 2000. Cette croissance est comparable à l'évolution du nombre d'affaires traitées. C'est là une première indication qui tend à démontrer qu'il n'y a pas eu de frein manifeste à l'usage de l'incarcération comme réponse à la délinquance juvénile.
Si l'on se place du point de vue des prises en charge par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de relever que les pourcentages d'augmentation des flux sont particulièrement importants, et même supérieurs à l'indicateur d'entrée des mineurs mis en cause par la police qui, lui, s'accroît de 60 %. Ces chiffres confirment les propos de M. Salas sur l'importance de milieux ouverts. En effet, neuf dixièmes des prises en charge dans le secteur public de la PJJ sont des mesures de milieu ouvert.
Néanmoins, les décisions d'hébergement et de placement ont considérablement augmenté puisqu'elles ont doublé. A cet égard, l'évolution enregistrée au cours de la période 1997-2000 n'est pas absolument identique à celle des trois années précédentes, au cours desquelles j'ai pu observer que l'hébergement stagnait en termes à la fois de stocks et de flux. Il a connu un développement sans doute récent.
Le rapprochement des flux et des stocks donne une idée de l'utilisation des ressources.
Par exemple, la croissance du recours aux solutions de placement dans le cadre du secteur public de la PJJ semble confirmer le témoignage selon lequel les durées de prise en charge se raccourcissent. Cela signifie que si l'on a réussi à répondre au flux au-delà de sa moyenne de croissance, c'est en prenant en charge les mineurs pour des temps de plus en plus courts. Un tel constat mérite tout de même d'être relevé car, aux yeux de certains professionnels, ce genre de résultat statistique n'est pas forcément le signe d'une amélioration.
Le chiffrage du secteur habilité est encore plus délicat. Il a toujours un an de retard, et je ne dispose ici que des chiffres de 1999. En outre, il est difficile de distinguer les équivalents du milieu ouvert et de l'hébergement en termes de flux et de stock. Je pense que le secteur habilité a connu une croissance à peu près analogue s'agissant du nombre des prises en charge. Ce dernier reste cependant inférieur, ce qui s'explique par le caractère récent de ce type de structure. L'hébergement, quant à lui, a augmenté, sans toutefois rattraper le retard du secteur public devant la croissance du flux.
Vous me pardonnerez d'émettre quelques jugements de valeur par rapport aux chiffres cités, mais il est difficile d'en parler sans laisser transparaître sa propre position sur le sujet.
La question se pose de l'utilisation de ces chiffres pour tenter d'évaluer ce qui a été fait au cours des cinq dernières années.
Tout d'abord, et je le répète, il ne faut pas conclure à l'échec total parce que l'on a développé l'incarcération et les prises en charge par la PJJ et parce que les statistiques de police ont continué à augmenter, car tout cela participe de la même politique pénale.
Et si l'on estime qu'il faut assurer des interventions et un suivi de plus en plus systématiques, tous les indicateurs seront encore en hausse d'ici à trois ans, mais cela ne signifiera pas forcément qu'on sera dans l'échec total. On ne peut pas considérer les données en amont, de la police ou de la gendarmerie, comme étant le signe de l'augmentation continue de la délinquance, quelles que soient les actions entreprises. Non, les chiffres continuent d'augmenter parce que la politique qui a été développée ces cinq dernières années était de répondre de plus en plus systématiquement.
Ensuite, dans le domaine de la justice pénale en particulier, les chiffres dont on dispose permettent difficilement d'évaluer les taux de récidive en fonction des différentes solutions qui sont apportées. Or, ce que nous attendons tous d'une évaluation, c'est précisément de nous aider dans le choix des soutiens.
J'ai évoqué la situation difficile dans laquelle se trouvait le secteur des statistiques judiciaires, particulièrement celles qui concernent les mineurs. Il existe un projet au sein du ministère de la justice visant à suivre un « panel » de mineurs afin de mesurer les taux de récidive ou de retour dans les différentes institutions suivant les types de prise en charge. Il n'est toujours pas mis en oeuvre.
Quelques chiffres circulent cependant, des évaluations « à la louche », sur ce qu'apporte telle ou telle solution en termes de récidive, notamment sur l'usage de la prison. On sait que le taux de retour en prison est très important et qu'il atteint son maximum -on ne peut pas dépasser 100 % en la matière- dans le cas de mineurs incarcérés qui avaient déjà été condamnés auparavant. Cela signifie qu'incarcérer un mineur au passé pénal chargé, c'est garantir une récidive. Dans ce cas-là, l'incarcération se justifie, non pas pour éviter une récidive, mais parce qu'on est arrivé devant un mur et que c'est la seule solution.
J'entends aussi dire que 80 % des mineurs qui sont passés devant un juge des enfants ne le revoient pas une seconde fois. J'aimerais bien conférer à ce chiffre une grande certitude statistique. Malheureusement, pour l'avoir déjà rencontré lors de l'étude de la mission parlementaire Lazerges-Balduyck, je connais sa source et je sais qu'il n'est pas très fiable. Pour l'essentiel, il recouvre des cas qui ne sont pas très graves et qui ne produisent que peu de récidives après la première prise en charge.
Entre ces cas et ce qu'on appelle le noyau dur des multirécidivistes pour lesquels la solution de l'incarcération est génératrice de nouvelles récidives, il y a des solutions qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation.
Ce sont les centres éducatifs renforcés, appelés également centres fermés, que vous avez évoqués avec M. Denis Salas. Il s'agit de centres de placement immédiat que l'on s'efforce de mettre en place. Ma petite contribution au débat est l'idée qu'il serait temps d'avancer sur une évaluation raisonnable de l'ordre de grandeur des besoins en matière de centres éducatifs renforcés.
Je rappelle qu'avant la mission Lazerges-Balduyck, un rapport d'inspection sur les UEER avait constaté que la barre avait été placée un peu trop haut avec l'engagement pris, il y a maintenant près de dix ans, de créer 100 UEER, alors qu'on n'avait été capable d'en faire qu'une dizaine en deux ans. Le gouvernement qui a suivi a mis la barre à 100 lui aussi, sans l'atteindre tout à fait. En termes de place, une centaine d'établissements représente un stock d'environ 500, l'idée étant de limiter ces structures à l'hébergement de cinq mineurs à un moment donné.
Avec les congés légaux, les structures ne fonctionnent que les quatre cinquièmes du temps sur une année, ce qui représente 400 places. Non seulement on n'a pas atteint ce chiffre mais on en est à peu près à la moitié, soit environ 200.
C'est peu par rapport aux 500 mineurs qui sont en prison à un moment donné et aux 1.500 mineurs qui sont pris en charge dans des structures contraignantes, publiques ou privées.
Quel ordre de grandeur avancer ? Sous le serment, c'est difficile. J'ai entendu des hommes politiques déclarer que 10.000 places devaient être créées dans des centres éducatifs renforcés. Ce chiffre ne me semble pas raisonnable au regard de l'évaluation que j'ai décrite du processus de traitement. M. Rosenczveig, qui est très compétent, a avancé le chiffre de 1.500, qui me paraît un ordre de grandeur beaucoup plus réaliste.
Si l'on se réfère à la croissance globale que l'on a observée des prises en charge, à la transformation des publics concernés, au noyau important que constituent, à mon sens, les auteurs d'actes violents, qui représentent un sixième du total selon mes estimations, il me semble qu'on est encore assez loin du compte en termes de capacités de prise en charge de cette population.
M. Jean-Claude Carle , rapporteur - Je vous remercie de cet exposé. Les mathématiques sont, heureusement ou malheureusement, une science exacte, ce qui n'est pas le cas des sciences humaines auxquelles s'apparente la politique !
Le chiffre que vous nous donnez, de 175.200 mineurs interpellés, est celui qui a été transmis au parquet. Or, si je me souviens bien, M. Sebastian Roché a indiqué que 80 à 90 % des délits considérés comme peu graves ne sont pas connus des services de justice. A-t-on le droit de multiplier les 175.000 par 80 ? J'espère que non, sinon tout cela prendrait des dimensions affolantes !
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - Le chiffre de 175.000 représente le nombre de personnes. On peut compter plusieurs fois une personne dans l'année. Sur ces 175.000 mineurs, certains ont été comptabilisés plusieurs fois parce qu'ils ont eu affaire aux services de police à plusieurs reprises.
En matière de police, il serait intéressant de mettre en regard des 175.000 mineurs mis en cause avec le nombre de faits enregistrés qui leur ont été imputés. Mais ces statistiques-là n'existent pas pour le moment.
M. le rapporteur - Il y a vraisemblablement plus de faits que de personnes ?
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - Cela dépend des infractions. Quand on fait le total, on s'aperçoit qu'il y a des catégories d'infractions pour lesquelles il y a plus de faits que d'auteurs, et inversement. Un équilibre s'établit.
Il n'y a pas lieu de faire la multiplication que vous indiquez. Ensuite, les registres d'information et de qualification utilisés dans le cadre de l'enquête de Sebastian Roché sont différents de ceux de la police.
Par exemple, dans le cas des vols à l'étalage, l'écart avec les chiffres du parquet est sûrement très important compte tenu de l'intervention d'un certain nombre de filtres avant d'en arriver à l'enregistrement policier. Je pense au service de sécurité des magasins, et ensuite à la décision de la police de signaler ou non l'affaire au parquet.
Cela étant, si j'ai bien compris les conclusions de Sebastian Roché, il semble que cet écart a tendance à diminuer en fonction de la gravité croissante des faits qui sont susceptibles d'être constatés. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait se rassurer.
M. le rapporteur - Si l'on peut se rassurer ! Un tel raisonnement décrit bien l'enchaînement des actes délictueux dès lors que l'on passe du vol de friandises à l'étalage au vol avec braquage. Se pose alors une question extrêmement politique : à quel moment faut-il intervenir ?
S'agissant du maintien dans les établissements pénitentiaires, votre tableau montre que le stock des mineurs détenus n'a augmenté, si je puis dire, que de 2 % puisqu'en 1994, on comptait 531 mineurs détenus pour 109.000 interpellations, contre 542 en 2000 pour 175.000 interpellations.
Par ailleurs, en 1994, la durée moyenne de détention était supérieure puisqu'elle était de 2,4 mois, contre 1,8 mois en 2000, ce qui tendrait à dire que la chaîne judiciaire utilise moins la procédure d'incarcération ou de maintien dans la durée, alors que dans le même temps, il nous est dit que la gravité des actes commis est beaucoup plus grande. Comment l'expliquez-vous ?
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - C'est un point technique. En fait, je ne suis pas très fier de mon calcul relatif à la durée moyenne d'incarcération : il me semble donner seulement une indication sur la façon d'utiliser la ressource. En termes de grandes masses, je pense quand même que cette progression du recours à la prison devant la montée de la délinquance, qui se traduit par ce chiffre de 4.000 incarcérations dans l'année, est surtout due à des détentions provisoires courtes. Je me souviens avoir visité le centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, et c'est là un protocole d'incarcération assez standardisé, qui s'inscrit dans les limites légales relatives à la détention provisoire des mineurs. Un programme de prise en charge est mis en place, sur le plan sanitaire ou sur celui du lien avec les éducateurs ou de la préparation de la sortie, pour essayer de faire en sorte que l'incarcération n'ait pas été dépourvue d'utilité. Mais cela se déroule sur un temps très court, et le chiffre de 4.000 incarcérations recouvre de nombreuses détentions de ce type.
En ce qui concerne les cas graves, une note de quatre pages que j'ai rédigée a dû vous être remise, monsieur le président. J'y donne une indication concernant l'accroissement du nombre des peines d'emprisonnement de plus d'un an prononcées contre des mineurs, et, dans de tels cas, l'effacement du casier judiciaire n'intervient pas. Le nombre des mineurs condamnés par les cours d'assises progresse, ainsi que celui des mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement fermes de plus d'un an. En 2000, les chiffres sont loin d'être aussi faibles qu'ils ne l'étaient voilà dix ans. D'une certaine façon, cela ne s'observe pas dans la statistique pénitentiaire, parce que, pour reprendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure, un mineur qui est condamné à deux ans d'emprisonnement dans l'année de ses dix-sept ans n'est pas compté très longtemps au nombre des 500 mineurs du stock, puisqu'il est comptabilisé parmi les majeurs dès qu'il atteint dix-huit ans. En fait, j'avais demandé aux services de l'administration pénitentiaire de me fournir un autre chiffre, qui serait plus pertinent, celui du nombre de personnes se trouvant en prison à l'instant en y étant entrées mineures, qu'elles soient ensuite devenues ou non majeures. Un tel chiffre a un sens, et je pense qu'il doit être en augmentation, puisque, pour les mineurs comme pour les majeurs, il semble bien que les peines prononcées soient de plus en plus lourdes.
M. le rapporteur - Si l'on reste sur le seul plan de la statistique, on peut dire, sans porter de jugement, que le recours à la PJJ ou au secteur habilité a progressé par rapport à l'incarcération.
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - Pour ma part, je porterai un jugement en disant que le pire a été évité d'une certaine manière, si l'on considère qu'incarcérer sans retenue n'est pas la meilleure solution. C'est pour la détention que les chiffres ont crû le moins vite. Là encore, il existe des pièges mathématiques liés aux flux et aux stocks. Le nombre des incarcérations courtes dans le cadre de la détention provisoire a augmenté, mais la solution de facilité aurait été d'aller encore plus loin dans ce sens. Cela étant, même si les ordres de grandeur sont dix fois plus faibles, on relève une progression du nombre des longues peines.
Par conséquent, la question des capacités nécessaires et de la prise en charge dans un cadre contraignant qui ne soit pas celui d'un établissement pénitentiaire continue de se poser.
M. le rapporteur - D'une manière générale, on voit bien la nécessité de procéder à une évaluation et de disposer des chiffres le plus précis possible. Je sais bien que, quand on veut enterrer un dossier, on crée une commission, mais ne serait-il pas souhaitable, s'agissant de la délinquance des mineurs, d'instituer une sorte d'observatoire afin de pouvoir juger, sur le moyen et sur le long termes, de l'évolution de la situation ? En effet, un certain nombre de chiffres sont parlants. Le moindre recours à la répression au sens dur du terme ne peut-il pas avoir une incidence sur l'augmentation de la délinquance ou de la violence de celle-ci ?
M. Bruno Aubusson de Cavarlay - S'agissant de la qualité des chiffres disponibles et de l'évolution du dispositif, la tentative que je fais là n'est pas à l'avantage de mes collègues statisticiens du ministère de la justice. En effet, au cours de ces trois dernières années, ils ont essayé de rénover le dispositif statistique. Ils y parviennent peu à peu ; si vous les interrogez sur ce qui s'est passé en 2000 ou même en 2001, vous obtiendrez certes davantage de détails qu'auparavant, mais vous ne pourrez comparer les chiffres avec ceux des années précédentes, car le changement est tout récent. Ainsi, j'ai évoqué les difficultés que nous rencontrions dans l'évaluation de l'évolution des peines prononcées : le tableau de bord des juges des enfants et des tribunaux pour enfants permet maintenant de donner la répartition détaillée des peines prononcées, mais pas pour les années antérieures à 2000.
Quant au dispositif de mesure de la récidive, je pense que nous devrons attendre une autre occasion pour obtenir des chiffres.
En ce qui concerne la création d'un observatoire, j'ai un peu le sentiment que, si la structure de portée générale qui a été évoquée est mise en place, elle constituera un point de départ permettant de progresser aussi dans l'étude des questions relatives à la délinquance juvénile. En effet, les problèmes affectant les différents producteurs de données sont exactement les mêmes, qu'il s'agisse des majeurs ou des mineurs. Je donne peut-être l'impression de dresser un tableau très négatif de la situation en indiquant que je ne dispose pas des chiffres nécessaires à l'établissement d'une évaluation correcte concernant la délinquance des mineurs, mais un constat presque identique aurait pu être fait à propos de la délinquance des majeurs.
M. le président - Personne n'a plus de question à poser ?...
Il nous reste à vous remercier, monsieur.
Audition de M. Laurent
MUCCHIELLI,
sociologue et historien
(20 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Jacques HYEST, vice-président
M. Jean-Jacques Hyest, président - Mes chers collègues, nous allons entendre M. Mucchielli. Monsieur Mucchielli, vous êtes sociologue et historien, chargé de recherches au CNRS. Vous vous intéressez particulièrement à la sociologie de la délinquance. Seul ou en collaboration, vous êtes l'auteur de divers ouvrages et notamment d'un livre, paru en 2001, intitulé Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français .
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Mucchielli.
M. Laurent Mucchielli - En introduction, je veux d'abord parler de l'état actuel de confusion du débat sur l'insécurité.
Cette confusion procède, à mon sens, d'au moins quatre éléments : le premier, c'est un usage dramatisant d'une seule source statistique, à savoir les chiffres de la police ; le deuxième, c'est un usage intempestif des faits divers dans les médias ; le troisième, c'est une tendance générale à porter des jugements moralisateurs avant d'essayer de comprendre les logiques humaines et sociales, d'où la recherche de boucs émissaires, comme les « parents démissionnaires » ou les « immigrés qui ne s'intègrent plus », ou encore les « juges laxistes » ; le quatrième, c'est l'utilisation de catégories globales, comme « la violence » ou « l'insécurité », qui renvoient non pas à des réalités précises dont on peut faire l'analyse mais plutôt à une perception globale, à des points de vue, à des sentiments.
Dans ce débat, le sociologue se doit au contraire de rappeler l'importance de quatre modes de raisonnement généraux.
Le premier de ces modes de raisonnement consiste à définir précisément ce dont on parle et à examiner les situations au cas par cas avant d'en faire des généralités.
Le deuxième consiste à replacer la réflexion dans la moyenne durée pour sortir de l'événementiel et considérer les tendances lourdes.
Le troisième consiste à resituer chaque type de comportement dans son contexte de production spécifique.
Le quatrième consiste enfin à croiser le maximum d'indicateurs et de sources, qu'il s'agisse d'ailleurs de statistiques ou d'études de terrain.
A ce propos, je veux dire d'emblée que, dans le milieu de la recherche, trois indicateurs statistiques au moins - et non un seul - peuvent être utilisés. Les chiffres de la police sont, certes, l'indicateur le plus connu, mais il faut y ajouter les résultats des enquêtes, dites « de victimation », menées auprès des victimes, et des enquêtes, dites « de délinquance autorévélée », menées auprès des jeunes eux-mêmes pour les interroger sur leurs pratiques.
C'est en croisant ces différents indicateurs - et donc le point de vue de la police, celui des victimes et celui des jeunes - et en procédant au plus grand nombre possible d'études qualitatives de terrain que l'on peut, me semble-t-il, commencer à approcher la réalité.
J'en viens à mon analyse : je ferai d'abord un rapide détour par l'histoire pour proposer ensuite une sorte d'inventaire des principales tendances d'évolution de la délinquance juvénile dans la France contemporaine.
Le détour historique s'impose de mon point de vue parce que la société française a connu au cours du XXème siècle trois grandes périodes d'inquiétude liée à la délinquance juvénile ; il n'est pas inintéressant de rappeler les deux autres.
La première période, c'est celle des années 1900-1914. Les jeunes délinquants avaient alors la figure des « apaches » et l'existence de bandes de jeunes délinquants réputés très violents devenait un élément majeur du débat politique et médiatique de l'époque, au point qu'un journaliste pouvait écrire, en 1907, à la une d'un des principaux quotidiens, La Petite République : « L'insécurité est à la mode, c'est un fait. »
Le problème ne date donc pas d'hier !
Je m'attarderai davantage sur la deuxième période, que l'on connaît peut-être un peu mieux, de cette histoire : lors de l'été 1959 surgissait dans la presse une nouvelle figure du jeune délinquant dangereux, le « blouson noir ».
Or, lorsque l'on fait la comparaison systématique entre les sources et les travaux de cette époque et de la nôtre, on est frappé de constater que les quatre reproches qui étaient faits aux blousons noirs sont encore au coeur du débat sur la délinquance juvénile.
Premièrement, on reprochait aux blousons noirs des affrontements violents entre grandes bandes pouvant compter jusqu'à une centaine de personnes. L'expression « blouson noir » est d'ailleurs née pour qualifier ce type de faits, tout à fait comparables à ceux qui, par exemple, se sont déroulés l'an dernier à La Défense. Ces faits ont pourtant été présentés dans la presse -« une nouvelle escalade dans la violence urbaine »- comme un élément nouveau.
Deuxièmement, on reprochait aux blousons noirs des viols collectifs. Or, de nouveau, depuis deux ou trois ans, on entend parler de « tournantes », présentées dans la presse comme des événements sans précédent dans la jeunesse.
Troisièmement, on reprochait aux blousons noirs des vols ; il s'agissait de vols d'usage immédiat, court et ostentatoire, liés en particulier aux nouveaux biens de consommation, lesquels, dans la société des années soixante, étaient essentiellement la voiture et la mobylette.
Quatrièmement enfin, on reprochait aux blousons noirs des actes de vandalisme dirigés contre les institutions, les écoles et autres bâtiments publics -actes déjà qualifiés de « gratuits »- ainsi que les actes de vandalisme commis par des bandes de jeunes lors des manifestations musicales, en particulier les concerts de rock'n'roll, qui émergent et se généralisent à l'époque. Les chroniques relatent à ce propos un nombre impressionnant de mises à sac de salles de concert et de cinéma, de bals populaires qui finissent mal, etc. Ces actes de vandalisme avaient sans doute une intensité supérieure à celle des actes qui se produisent aujourd'hui dans ce type de manifestations.
Nous devons donc nous garder de croire que nous sommes confrontés à des phénomènes radicalement nouveaux et qui seraient nécessairement -l'escalade- de plus en plus graves : les phénomènes de délinquance juvénile se sont incontestablement durcis depuis un quart de siècle, mais leur nature n'est pas aussi nouvelle qu'on le pense généralement.
Si l'on tente maintenant de faire le panorama des évolutions de la délinquance juvénile depuis la fin des années soixante-dix, on peut dégager cinq tendances lourdes.
Première tendance lourde : les vols et les cambriolages.
Il est significatif que, dans le débat public, on se centre aujourd'hui sur la violence en oubliant toujours de rappeler que les vols et les cambriolages constituent le coeur de la délinquance puisqu'ils représentent les deux tiers des actes de délinquance enregistrés par la police et, sur ce point, il y a une forte convergence entre les sources policières et les sources de victimation.
En d'autres termes, le principal risque dans notre société n'est pas de se faire agresser, il est de se faire voler. Plus précisément, il est de se faire forcer la serrure ou briser la vitre de sa voiture et de se faire voler un objet à l'intérieur de celle-ci.
Si l'on néglige ce constat primordial, c'est peut-être parce que l'on ne veut pas voir l'explication qu'il cache.
S'agissant des mineurs, les vols et cambriolages sont massivement orientés vers des biens particuliers : les biens de consommation. A la voiture et aux deux-roues, ce sont ajoutés le matériel hi-fi, les vêtements de sport et, désormais, les téléphones portables. Ce n'est pas un hasard si, aux dires de la Direction centrale de la police nationale, près de la moitié de ce que l'on appelle, dans les statistiques de la police, des vols avec violence est en réalité constituée par des vols à l'arraché de téléphones portables. Qu'est-ce en effet que le téléphone portable ? C'est, me semble-t-il, le dernier gadget de la société de consommation, celui que tous les adolescents veulent avoir.
Le schéma social général qui se cache derrière les vols commis par des mineurs est donc le suivant : des jeunes, le plus souvent issus de milieux pauvres, volent d'autres jeunes ou des commerces afin de jouir de biens qu'eux-mêmes, ou leurs parents, ne peuvent pas payer.
Ce schéma découle d'un mécanisme très simple, mais très fort, que le sociologue américain Merton a mis en évidence il y a une cinquantaine d'années et appelé le « mécanisme de frustration » : nous vivons dans une société de consommation qui crée, dans l'ensemble de la jeunesse, des aspirations à la jouissance des biens de consommation ; cette société ne cesse de s'enrichir globalement mais elle maintient en son sein de fortes inégalités sociales ; dès lors, il y aura toujours une partie des jeunes pauvres qui voleront pour posséder les mêmes biens que les autres.
Autrement dit, il s'agit d'une délinquance liée de façon structurelle au fonctionnement de notre société.
Deuxième tendance lourde : les atteintes aux personnes.
Ces atteintes recouvrent des situations très différentes, lesquelles connaissent des évolutions très diverses. Trois sous-distinctions, qui correspondent à trois constats, s'imposent en effet, car on risque sinon de parler dans le vide d'une violence en général qui me semble plus fantasmatique que réelle.
Premier constat, contrairement à l'impression que donnent tous les faits divers rapportés par les médias, les violences les plus graves n'augmentent pas dans la société française. L'ensemble constitué par les homicides, les tentatives d'homicide, les coups et blessures suivis de mort est exactement au même niveau qu'au début des années soixante-dix. C'est un fait. De plus, il ne semble pas qu'il y ait significativement plus de mineurs qu'autrefois parmi les auteurs de ces violences.
Le deuxième constat est de nature tout à fait différente. Il faut en effet mettre à part les violences sexuelles, car un problème majeur d'interprétation des statistiques se pose en la matière. Leur apparente augmentation continue dans les statistiques de la police est-elle le reflet d'une réalité ou tient-elle au fait que les victimes portent de plus en plus souvent plainte ? Les enquêtes de victimation ne sont, hélas, pas suffisamment anciennes pour nous permettre de trancher définitivement la question sur le plan scientifique, même si nous disposons de nombreux indices.
Depuis plus de vingt ans, la société française « met le paquet » pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants. La loi pénale s'est beaucoup durcie, des associations d'aide aux victimes se sont créées, des numéros d'appel gratuit ont été mis en place, des campagnes sont réalisées dans les écoles et dans les médias, l'accueil des victimes s'est amélioré dans les commissariats et les palais de justice... Bref, on ose aujourd'hui énoncer et dénoncer des violences autrefois dissimulées. La pédophilie donne un exemple saisissant de cette évolution dont il faut se féliciter. Il faut cependant savoir qu'elle joue dans le sens d'une aggravation continue des chiffres de la police puisque l'on part d'une situation de sous-estimation considérable de la réalité, que révèlent d'ailleurs les enquêtes de victimation.
J'en arrive au troisième constat et à la troisième sous-catégorie de violences interpersonnelles, qui ne sont donc ni des violences mortelles ni des violences sexuelles. Ces violences moins graves, que le croisement des différentes sources fait apparaître comme le seul type de violences en réelle augmentation dans la société française, ce sont - disons-le en langage ordinaire - les bagarres, des bagarres plus ou moins graves, à coups de poing ou de couteau, impliquant deux, trois, cinq, dix, vingt ou trente personnes.
Qui est concerné ? Alors que, selon les résultats des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, les personnes âgées et les femmes sont globalement les plus insécures, les enquêtes faites auprès des victimes indiquent que les victimes de ces bagarres sont en premier lieu des jeunes hommes. Autrement dit, les jeunes garçons se battent entre eux dans la rue, dans les transports en commun, dans les cours de récréation, à la sortie des écoles... C'est le coeur du risque d'agression aujourd'hui et c'est le phénomène qui, incontestablement, s'est le plus amplifié au cours des dernières années.
Troisième tendance lourde et troisième élément du diagnostic : les violences contre les institutions.
Depuis la fin des années soixante-dix, et plus encore depuis la fin des années quatre-vingt, on assiste à une forte augmentation de ce que l'on peut appeler les violences contre les institutions pour désigner à la fois le vandalisme contre les biens publics et les différentes formes d'irrespect envers les personnes symbolisant les institutions publiques, c'est-à-dire, d'une part, essentiellement les policiers et parfois les pompiers, d'autre part, les enseignants.
Cette évolution peut d'abord s'expliquer par un mécanisme général sur lequel je reviendrai peut-être en conclusion : il faut mettre ces violences contre les institutions en parallèle, d'une part, avec l'évolution générale de la société française et notamment le recul d'une certaine forme de soumission à l'autorité, d'autre part, avec la considérable perte de prestige et de légitimité des institutions, elle-même liée à la visibilité des phénomènes de corruption des élites nationales et locales. Ces phénomènes renforcent en effet considérablement les sentiments d'abandon, d'injustice et de victimation collective des habitants et encouragent fortement non seulement la méfiance et l'évitement des institutions mais aussi le développement d'une culture anti-institutionnelle conduisant au dénigrement systématique des institutions.
L'évolution s'explique ensuite par un phénomène, local celui-là, qui découle beaucoup plus directement des interactions entre personnes. Les violences contre les institutions n'ont en effet pas du tout le même degré d'intensité selon les quartiers. Il est évident aux yeux d'un sociologue qu'elles sont plus fortes là où il y a des dysfonctionnements desdites institutions et de leurs représentants, notamment les policiers et les enseignants. Or il faut avoir le courage de reconnaître que, dans certains quartiers, la relation entre la police et l'ensemble des habitants -pas seulement les jeunes- est exécrable.
Dans ces quartiers, on constate fréquemment qu'une sorte de guérilla entre la police et les jeunes s'est installée. Les jeunes « caillassent » régulièrement les voitures de police, mais la police a elle-même des modes d'intervention qui sont à la fois discriminatoires et plus violents qu'ailleurs. On assiste ainsi à des processus réciproques d'engrenage et, si un événement plus grave qu'à l'accoutumée se produit, c'est dans ce type de contexte qu'une émeute peut se déclencher.
Il y a là des interactions et on ne saurait donc analyser le comportement des jeunes sans analyser aussi l'attitude des autres acteurs de la vie du quartier.
Le même raisonnement vaut pour la violence à l'école. Les enquêtes sur ce thème révèlent que, à publics et à environnements urbains équivalents, tous les établissements ne connaissent pas les mêmes niveaux de violence et que, au sein d'un même établissement, tous les enseignants n'y sont pas confrontés au même degré. Autrement dit, nous sommes face à des interactions entre plusieurs acteurs et il faut s'interroger sur le comportement de tous les acteurs et non pas d'un seul, à savoir les jeunes.
Quatrième tendance lourde : le développement des « bizness » et des trafics dans les quartiers populaires.
Avant de développer ce point, je veux souligner deux faits. D'abord, le débat public s'intéresse beaucoup aux délinquances des milieux populaires mais guère à la criminalité d'affaires, qui semble pourtant, elle aussi, se porter assez bien. Ensuite, l'action policière vise beaucoup plus les trafics qui ont pour cadre les quartiers populaires que ceux, non moins réels, qui ont lieu dans les quartiers des classes moyennes, voire des classes supérieures.
Les drogues concernent en réalité aujourd'hui tous les milieux sociaux. Les enquêtes indiquent même que les jeunes en consomment davantage dans les milieux favorisés. Or, les données policières et judiciaires le démontrent, la répression de l'usage et du trafic de drogue touche pour l'essentiel les seuls milieux populaires. Ces inégalités de traitement déforment un peu la vision des choses...
De manière générale, si les délinquances juvéniles sont incontestablement plus intenses dans les quartiers populaires, elles n'en sont pas moins présentes dans les autres milieux sociaux, mais, pour diverses raisons, elles y sont moins repérées et moins réprimées.
Cela étant dit, j'en reviens aux quartiers populaires en rappelant tout d'abord que l'existence des petits trafics et du recel y est extrêmement ancienne : là où la pauvreté est grande, on a toujours pratiqué le « système d » et les divers modes de débrouillardise pour essayer de s'en sortir un peu mieux. La nouveauté, c'est le développement de la place prise par la drogue dans les économies illégales, en particulier depuis la seconde moitié des années quatre-vingt.
Il faut s'en inquiéter, mais il ne faut pas céder à la panique et raconter n'importe quoi.
Il faut s'en s'inquiéter parce que le trafic de drogue génère une circulation d'argent plus importante que les autres trafics, par exemple celui, classique, des pièces détachées de voiture. Il rapporte beaucoup et beaucoup plus vite, et est dès lors beaucoup plus tentant, mais davantage d'argent implique davantage de risques, donc des armes pour se protéger, donc des règlements de compte entre trafiquants plus souvent mortels. Cet argent permet par ailleurs aux trafiquants, le plus souvent des jeunes majeurs, d'utiliser des mineurs pour de petites opérations de surveillance, initiation précoce qui risque incontestablement de faciliter leur entraînement dans la délinquance.
Il ne faut cependant pas céder à la panique et raconter n'importe quoi. Déclarer, comme le font certains syndicalistes policiers et certains prétendus experts, que tous les quartiers populaires sont entrés dans un processus mafieux comme celui que je viens de décrire - processus qui, de surcroît, impliquerait toutes les générations au sein des familles - est une extrapolation parfaitement abusive.
Les recherches, peu nombreuses mais néanmoins sérieuses et impartiales, dont nous disposons laissent au contraire penser que la majorité des quartiers populaires ignore cette logique mafieuse mettant en scène des polydélinquants aguerris et manipulant des sommes colossales, s'alimentant à l'étranger et revendant n'importe quelle drogue au tout venant en cherchant constamment à accroître leur marché pour s'enrichir toujours plus.
Dans la majorité des quartiers, nous avons plutôt affaire à des réseaux de taille modeste, constitués de jeunes hommes non nécessairement polydélinquants, qui ne revendent que du cannabis et qui le revendent pour l'essentiel dans le cadre d'un groupe d'interconnaissances, sans chercher à sortir de leur quartier, fût-ce pour s'enrichir davantage.
Nous sommes donc face à des modes de débrouillardise qui ne sont pas analysables selon la logique mafieuse que j'ai décrite. Cela me semble important.
J'observe du reste, et ce sera ma conclusion sur ce point, que l'évolution de l'organisation de la police va elle-même dans ce sens. En effet, tout au long des années quatre-vingt-dix, on a tendu à fragiliser la police judiciaire au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des brigades spécialisées qui mènent patiemment le travail de fond visant à démanteler les gros réseaux de trafiquants, au bénéfice d'un renforcement de la police ordinaire et d'unités d'intervention rapide, comme les BAC, dans les quartiers populaires. Faut-il se réjouir de cette évolution ? C'est une autre question, mais je suis très réservé en la matière...
Cinquième et dernière tendance lourde dans ce panorama : la place essentielle des « incivilités », notion qui soulève un problème de définition mais qui présente un grand intérêt pour décrire le quotidien des citoyens.
Cette notion soulève un problème de définition parce qu'elle recouvre aussi bien des infractions et des délits - par exemple, mettre le feu à une poubelle ou démolir une boîte aux lettres - que des atteintes à ce qu'on pourrait appeler le code de la politesse, comme le fait de parler mal, de regarder de travers, de cracher, d'uriner dans des lieux de vie commune, de faire du bruit de façon intempestive, de défier ou de provoquer verbalement autrui pour lui montrer qu'on est le plus fort. Tous ces actes se rejoignent en ce qu'ils constituent des ruptures de l'ordre dans la vie de tous les jours, selon l'expression de Sebastian Roché, et en ce qu'ils sont généralement le fait de mineurs, voire de jeunes mineurs, les fameux préadolescents.
J'ai la conviction que, dans la majorité des quartiers et en particulier dans les quartiers populaires, ce sont ces incivilités, et non les formes plus graves de délinquance, qui « empoisonnent » le plus la vie des citoyens aujourd'hui. Les incivilités constituent ainsi un élément très important dans l'analyse du sentiment d'insécurité en même temps qu'elles fournissent une des explications de l'impression de rajeunissement de la délinquance.
Mais comment analyser ces incivilités et le fait qu'elles se concentrent dans les quartiers les plus pauvres ?
Pour ma part, j'estime que les incivilités résultent d'au moins trois phénomènes.
Le premier est un phénomène démographique. Il ne faut pas oublier que les quartiers les plus pauvres sont aussi ceux où la population est la plus jeune. Il n'est pas rare que les mineurs constituent 40 % de la population totale dans les quartiers qui font l'objet de mesures de politique de la ville.
Deuxième phénomène, c'est dans ces quartiers que le discrédit des institutions est le plus fort et que les actes d'irrespect à leur encontre sont les plus nombreux. C'est aussi dans ces quartiers que les heurts avec la police sont les plus durs, ce qui a pour effet, comme je l'ai déjà suggéré, de socialiser de nombreux jeunes dans des pratiques de rapport de force.
Plus globalement, c'est dans ces quartiers que l'on assiste à des spirales ou à des processus d'engrenages négatifs qui concernent souvent l'ensemble des services publics et, en réalité, l'ensemble de la vie du quartier. Les phénomènes d'évitement ou de tentative de fuite du quartier sont, à mon avis, un bon indicateur de ces problèmes lorsqu'ils existent.
Troisième phénomène, c'est dans ces quartiers que se concentrent tous les facteurs qui fragilisent les familles et diminuent donc les capacités de contrôle parental. Le facteur n° 1 est bien entendu le chômage et la pauvreté, mais l'origine étrangère de nombre de familles est également un facteur fragilisant parce qu'elle signifie généralement un faible niveau culturel, à commencer par une faible maîtrise de la langue française et donc une faible capacité de suivi scolaire des enfants. On sait par ailleurs que l'engagement dans la délinquance est souvent lié au décrochage scolaire. Enfin, le fait que ces quartiers accueillent des populations venues -souvent depuis peu- des quatre coins du monde fragilise aussi le lien social, réduit les relations de voisinage, limite la dynamique associative.
C'est souvent dans le cumul de ces handicaps qu'il faut saisir la fragilité des quartiers.
En conclusion, je ferai deux remarques. La première vise à mettre en évidence cinq évolutions profondes ou processus majeurs de la société sous-tendant les phénomènes que j'ai pu évoquer ; la seconde porte sur la manière dont on peut répondre à ces phénomènes.
Le premier des cinq processus majeurs qui sous-tendent l'évolution de la délinquance juvénile pourrait être le processus de « ghettoïsation », mot un peu fort mais qui rend compte à la fois, sur le plan objectif, de l'enracinement de poches de pauvreté et, sur le plan subjectif, du sentiment des habitants, lesquels décrivent souvent eux-mêmes leur quartier comme un ghetto.
Deuxième processus : l'emprise croissante de la société de consommation et de ses valeurs. J'y ai insisté en commençant, je veux y insister en terminant. Il ne faut pas s'étonner de ce que l'appropriation des biens de consommation, par ailleurs définis comme constitutifs du bonheur moderne, soit un enjeu qui donne lieu à des phénomènes de délinquance et de violence dans les milieux où on se les procure moins facilement.
La troisième évolution très générale est celle de nos modes de vie, marqués à la fois par l'individualisme et par l'anonymat, avec une tendance à aller de lieux clos en lieux clos - c'est-à-dire de son domicile à son lieu de travail ou au centre commercial auquel on fait toutes ses courses - au milieu de sortes de no man's land où l'on assiste à une réduction de la connaissance du voisinage.
Un quatrième mécanisme général peut être rattaché à l'écroulement des grandes espérances collectives, combiné à la perte de crédibilité déjà évoquée des institutions : les grandes espérances tombées, on ne voit plus du jeu politique que ses petits aspects.
Cinquième et dernière grande évolution pour ne citer que les principales, car la liste serait longue : la raréfaction, voire, parfois, la disparition de ce que j'appelle les modes de contrôles sociaux infra-institutionnels de la jeunesse. Je vise ici l'ensemble des adultes autres que les policiers, en position ou non d'agents publics, qui jouaient auparavant un rôle d'encadrement dans les quartiers populaires, autrement dit tous les acteurs qui pouvaient participer au contrôle de la jeunesse avant qu'il soit nécessaire d'aller chercher un policier, acteurs qui se raréfient, voire disparaissent.
Lorsque l'on fait à nouveau la comparaison avec l'époque des blousons noirs et de ce que l'on appelait les banlieues rouges, on s'aperçoit que l'une des principales différences réside peut-être précisément dans le fait que toute une série d'acteurs qui participaient au contrôle de la jeunesse et occupaient l'espace public au lieu de le laisser à celle-ci ont disparu.
Ces acteurs étaient liés à l'organisation même du monde ouvrier, qu'il s'agisse de son organisation en tant qu'univers de travail ou de son organisation politique et syndicale. On trouvait également des curés et un ensemble d'acteurs relevant de l'éducation spécialisée et de la prévention.
La principale réponse institutionnelle à la délinquance des blousons noirs dans les années soixante a en effet été la mise en place de l'éducation spécialisée et de la prévention, dans des proportions toutefois très limitées puisque, comme j'ai coutume de le rappeler à titre symbolique, le rapport entre les acteurs de la prévention et l'ensemble des policiers et gendarmes est aujourd'hui presque de un à cent, ce qui donne une idée de l'extrême pauvreté de la prévention en France !
Je conclurai donc en disant que, face à ces évolutions de fond de la société française, la grande erreur dans le débat politique est de croire que quoi que ce soit pourra être résolu en utilisant simplement des recettes policières ou judiciaires. Celles-ci ne sauraient en effet changer fondamentalement les données du problème. Si l'on veut que dans nos sociétés futures, c'est-à-dire dans dix ou vingt ans, la jeunesse soit moins violente, on doit apporter des réponses de fond en termes scolaires, en termes d'emploi, en termes de capacité de régulation collective et locale, en termes de lutte contre les discriminations et en termes de crédibilité de l'action publique.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie, monsieur Mucchielli, de cet exposé très complet.
Vous avez dit que la délinquance actuelle des jeunes différait très peu de la délinquance des blousons noirs des années soixante. Comment expliquez-vous dès lors que la perception de la délinquance ait évolué et qu'elle soit aujourd'hui ressentie de façon beaucoup plus épidermique ?
M. Laurent Mucchielli - Si j'ai dit que les actes se ressemblaient en nature, j'ai aussi indiqué qu'ils ne me semblaient pas avoir le même niveau d'intensité. Il y a incontestablement eu un durcissement sur le plan quantitatif, mais, si les délinquances juvéniles sont plus fréquentes, elles n'en restent pas moins des phénomènes fort anciens dans la société française.
Par ailleurs, le regard des citoyens sur ces phénomènes a changé. Globalement, la société française est plus apeurée qu'elle ne l'était par le passé. Le sentiment d'insécurité générale dépasse d'ailleurs ces seuls phénomènes : il est lié à l'ensemble des modes de vie et des perceptions que notre société a de son avenir. Les enquêtes sur le sentiment d'insécurité font apparaître que celui-ci se manifeste plus fortement, et ce n'est pas un hasard, dans les quartiers populaires, chez les personnes âgées, les femmes, les personnes peu diplômées et les chômeurs, c'est-à-dire chez les personnes qui, en dehors de leur perception immédiate du risque d'être victime de la délinquance, se sentent déjà fragilisées dans notre société.
Il y a donc une double évolution : même si ses actes restent assez banals au regard de l'histoire, la jeunesse est incontestablement devenue plus turbulente alors que dans le même temps le monde adulte s'est fragilisé et est devenu plus inquiet.
M. le rapporteur - Selon vous, l'école réduit-elle les inégalités ou les entretient-elle au contraire ? Dans le dernier cas, quelles solutions préconiseriez-vous pour les résorber ou, tout au moins, pour les réduire ?
M. Laurent Mucchielli - Le paradoxe me semble être que l'école n'a pas réussi à suivre son mot d'ordre de démocratisation alors qu'elle scolarise aujourd'hui l'ensemble des enfants, ce qui n'était pas le cas il y a cinquante ans. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les enseignants sont confrontés à des phénomènes un peu plus durs que jadis. L'objectif de 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat se traduisant par une dévalorisation relative du diplôme, les inégalités se sont en fait déplacées dans la chaîne.
Le point le plus saillant de l'action devrait être la prévention des troubles scolaires, qui est étrangement absente du débat. Une autre raison expliquant la prégnance des phénomènes d'irrespect et de violence à l'école, non plus entre élèves cette fois mais à l'égard des enseignants, est le maintien dans les classes d'élèves qui ne sont pas au niveau. Le fait que ces derniers ne peuvent pas suivre et, anticipant leur destin scolaire, se sentent marginalisés intellectuellement et socialement constitue évidemment une forte source de perturbation.
La prévention des troubles scolaires devrait donc être une grande priorité nationale. Elle ne l'est pas, alors même que l'on dispose de tous les outils tant pour le dépistage que pour la rééducation scolaire précoce. Je pense ici aux troubles de l'apprentissage de la lecture et du calcul, que l'on peut repérer dès le CP et le CE1. L'école n'y consacre pas suffisamment d'efforts.
Un autre problème, qui dépasse l'école pour être celui de la société française dans son ensemble, tient à la manière dont est souvent ressentie l'orientation scolaire, plus particulièrement l'orientation vers les filières techniques à la sortie du collège. Que de nombreux jeunes orientés vers ces filières techniques considèrent que cette orientation signifie la fin de leur vie sociale est un problème majeur, qui renvoie à la dévalorisation du travail ouvrier en France. En la matière, notre pays a peut-être des leçons à prendre sur les pays où la question du chômage des jeunes peu ou pas diplômés me paraît beaucoup mieux traitée, par exemple sur l'Allemagne, où le travail manuel a une meilleure image.
Ce problème, qui est aussi lié à notre histoire industrielle et, partant, à l'histoire de l'immigration puisque celle-ci est directement liée à l'histoire industrielle, a, même s'il la dépasse, des conséquences massives à l'école, en particulier dans les quartiers populaires.
M. le rapporteur - Le problème, qui ne concerne d'ailleurs pas que les délinquants, tient-il au fait que les jeunes sont orientés vers les filières dites manuelles ou au fait qu'ils y sont orientés tardivement ? Ces jeunes ne sont-ils pas maintenus trop longtemps dans un système qui ne leur est pas adapté, qui les rejettent et où ils ne se sentent pas à l'aise ?
M. Laurent Mucchielli - Je ne me sens pas assez compétent pour affirmer publiquement que l'orientation scolaire doit intervenir à tel moment ou à tel autre. Il vaudrait mieux s'adresser à un spécialiste de l'école, ce que je ne suis pas.
Le sociologue généraliste que je suis a néanmoins le sentiment que la question centrale n'est pas tant celle de l'âge précis auquel il faut orienter les jeunes que celle de la représentation symbolique que l'on donne de son avenir à la jeunesse. Déterminer ce que représente l'orientation en termes de projet, d'investissement, de symbolique du travail et d'image de soi importe beaucoup plus que l'âge auquel intervient l'orientation.
M. le rapporteur - Vous avez évoqué parmi les causes de la délinquance l'écroulement des grandes espérances collectives. Pensez-vous que les jeunes en situation d'échec sont réceptifs à ces grandes espérances collectives ? N'est-ce pas une vision un peu idéaliste des choses ?
M. Laurent Mucchielli - Comment pourraient-ils être réceptifs aux grandes espérances collectives puisque ces espérances n'existent plus ? C'était le sens de mon propos.
La jeunesse en général -celle des quartiers populaires en particulier- a toujours été révoltée. Pour reprendre la comparaison historique avec l'époque où ces grandes espérances existaient encore, il y avait alors un appareil militant, lié à ces grandes espérances, qui permettait de canaliser et de traduire politiquement cette révolte et offrait des outils pour l'exprimer dans l'attente d'un lendemain meilleur.
Aujourd'hui, lorsque l'on discute avec les jeunes de certains quartiers, on est frappé de constater que lorsqu'ils ont un sujet de révolte un peu précis, ils ne savent pas l'exprimer. La transmission entre générations d'une culture politique ne s'est pas faite et cette culture a disparu. On est face à une génération qui n'a aucune expérience de l'action revendicative et qui n'est pas encadrée par des adultes.
J'ai ainsi pu voir des jeunes ayant des revendications très précises à exprimer à un maire mais n'ayant aucune idée des canaux habituels auxquels on pouvait penser il y a trente ans - manifestation, pétition, etc.- venir en masse devant la mairie, réclamer d'être reçus et, quelqu'un avec un agenda leur ayant répondu que ce n'était pas possible mais qu'ils pouvaient prendre rendez-vous, se mettre à jeter des pierres et casser la vitre du bâtiment public.
A l'évidence, il y a là un problème de mise en forme, de langage. Or, lorsque la révolte ne trouve pas de moyen de se mettre en mots, elle s'exprime « brute de décoffrage ».
M. le rapporteur - Vous êtes très critique sur les statistiques qui sont faites à partir des chiffres donnés par la police. Quels autres instruments de mesure proposez-vous ?
M. Laurent Mucchielli - Je propose de croiser systématiquement trois sources : les données de la police, les enquêtes auprès des victimes, les enquêtes auprès des populations, en particulier auprès des jeunes. Au-delà de l'aspect purement quantitatif, on obtient ainsi le croisement de trois points de vue, celui de la police, celui des victimes et celui des acteurs eux-mêmes. Par ailleurs, il faut tenter de comparer les données locales de terrain entre elles, mais c'est souvent difficile, car encore faut-il pour comparer disposer d'indicateurs comparables.
A tout le moins, il faut tenir compte de l'existence des trois types de données que j'ai cités et, plus globalement, des trois points de vue qu'ils révèlent. C'est seulement dans la confrontation des différentes subjectivités que l'on peut espérer tendre vers une certaine objectivité, pour reprendre une phrase célèbre de Merleau-Ponty.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs et quelles propositions pourriez-vous faire ?
M. Laurent Mucchielli - C'est une généralité, mais je crois que l'erreur dans le débat sur le laxisme d'une justice qui remettrait immédiatement les délinquants dehors repose sur une confusion. En réalité, les statistiques le montrent, la justice condamne de plus en plus les mineurs, mais elle évite autant que possible de recourir à l'emprisonnement et prononce donc massivement des peines alternatives. Il y a là une nuance fondamentale avec ce qui est admis dans le débat public.
Les magistrats ont quelques bonnes raisons de procéder ainsi : ils connaissent pour en avoir la pratique quotidienne le taux de récidive à la sortie de prison et savent pertinemment qu'un jeune ressort de prison aussi mal, si ce n'est plus mal, qu'il y est entré. Ils ont à leur disposition toute une série de peines alternatives, qui vont des mesures de réparation à la victime jusqu'au placement en centre éducatif renforcé en passant par les travaux d'intérêt général.
Le développement des peines alternatives me paraît une bonne chose. Le renforcement des modes d'accueil en milieux semi-ouverts - ou plus ou moins fermés, mais ce n'est qu'une querelle de mots - encadrés par des éducateurs est éminemment préférable à l'emprisonnement. Mieux vaut être en petit nombre, encadrés par des éducateurs compétents, que lâchés en grand nombre, presque en meute, dans des prisons où le contrôle n'a d'autre objet que le maintien de l'ordre. Mon choix est évidemment très vite fait entre un gardiennage collectif et un véritable travail éducatif !
Au besoin, on peut déplacer les leaders et recourir au placement en milieu fermé dans les cas les plus graves.
Cependant, s'il faut que la justice dispose d'un éventail de mesures, il faut aussi et surtout qu'elle puisse prendre le temps nécessaire pour déterminer la peine la mieux adaptée.
A cet égard, plusieurs choses m'inquiètent aujourd'hui. Ainsi, le renforcement continu depuis vingt ans des effectifs de la police et les consignes données à celle-ci de traiter de plus en plus la petite délinquance ont pour conséquence d'amener vers la justice un flux d'affaires de petite délinquance. Les juges doivent se prononcer de plus en plus rapidement, dans l'urgence, et de manière de plus en plus mécanique -tel acte, telle peine-, sans avoir le temps d'étudier à fond et au cas par cas les dossiers, de prendre l'avis des psychologues et des éducateurs, d'examiner la personnalité.
Or l'examen de la personnalité est au coeur de la justice des mineurs telle qu'elle est encore -heureusement- conçue en France aujourd'hui.
M. le rapporteur - Vous venez d'évoquer les cas les plus graves. Où situez-vous la frontière entre incivilité, délinquance et criminalité ?
M. Laurent Mucchielli - J'ai dit tout à l'heure que l'expression « incivilités » recouvrait à la fois des délits et de simples impolitesses. La question des frontières est donc difficile à trancher.
Cependant, la problématique d'un magistrat de la jeunesse consiste précisément, me semble-t-il, à ne pas s'en tenir au fait en lui-même : il faut examiner non seulement son contexte de production mais aussi l'ensemble du parcours du jeune. La situation est toute différente selon que le jeune est encore scolarisé ou ne l'est plus, selon qu'il est en danger au regard de sa famille ou peut au contraire en recevoir des soutiens.
C'est donc non pas l'acte mais la personnalité de l'auteur et son contexte de vie qui doivent, en principe, constituer l'élément déterminant, et c'est un principe qu'il faudrait renforcer.
M. Bernard Plasait - Premièrement, faites-vous un lien direct ou étroit entre délinquance et chômage et entre délinquance et immigration ?
Deuxièmement, les attaques, dans ce que l'on appelle les zones de non-droit, contre les policiers ou, d'une manière générale, contre les représentants de la société ne sont-elles pas liées dans la plupart des cas avec le banditisme plus classique ? Ne s'agit-il pas en réalité de protéger un territoire d'économie parallèle pour des criminels qui utilisent des jeunes, lesquels deviennent ainsi de jeunes délinquants ?
Troisièmement, la violence contre les personnes, qui est la plus durement ressentie, n'est-elle pas pour l'essentiel le fait de « noyaux durs », c'est-à-dire de quelques meneurs qu'il nous est très difficile de repérer et d'appréhender ?
M. Laurent Mucchielli - Si vous le voulez bien, je distinguerai pour répondre à votre première question, qui est double, le lien entre délinquance et chômage du lien entre délinquance et immigration.
En ce qui concerne le lien entre délinquance et chômage, j'ai été très surpris, comme certains d'entre vous peut-être, des propos que l'on a récemment pu entendre. En réalité, il y a un lien entre délinquance et chômage, et ce lien est même très fort, mais, de même qu'il y a délinquance et délinquance, il y a chômage et chômage.
Le lien entre délinquance et chômage ne se mesure en effet pas au travers du taux de chômage global, que celui-ci soit de 8 %, de10 % ou de 15 %. Le bon indicateur, c'est, dans un quartier donné, le taux de chômage des jeunes de milieu ouvrier peu diplômés, c'est-à-dire au niveau du CAP, ou sans diplôme du tout. Ce taux de chômage est celui qui a le moins profité de la reprise économique alors même qu'il était déjà le plus fort. Il se situe encore ainsi, en moyenne, aux environs de 45 % !
Il faut bien prendre conscience de ce qu'un tel taux de chômage des jeunes pas ou peu diplômés implique : la situation de non-travail devient une norme numériquement aussi importante que la situation de travail. Lorsque l'on prend la mesure de ce fait, on comprend mieux le développement -on en perçoit aussi la légitimité- des économies parallèles.
Les politiques volontaristes d'embauche n'ont malheureusement pas prise sur ce résidu -ou sur ce « noyau dur » pour reprendre une de vos expressions- de chômage et de non-insertion. Le marché de l'emploi « fabrique » ainsi des jeunes qui, en quelque sorte, sont surnuméraires et pour lesquels il n'y a rien. C'est, me semble-t-il, le coeur du problème.
J'en viens au lien entre délinquance et immigration.
D'abord, tout un chacun peut constater que, dans les quartiers les plus pauvres qui font l'objet de la politique de la ville, les jeunes issus de l'immigration sont numériquement sur-représentés au sein de la petite proportion des jeunes qui participent à la délinquance.
Chacun peut faire ce constat. Le problème survient lorsque ce constat n'est pas rapporté à la population de ces quartiers, et c'est ce qui explique la dérive du discours que certains, et notamment de prétendus experts, tiennent. La population étrangère ou d'origine étrangère est en effet aussi majoritaire dans ces quartiers et, dans certains d'entre eux, elle représente jusqu'aux trois quarts de la population globale.
Dans ces conditions, si l'on raisonne en taux et non en chiffres bruts, si l'on tient compte aussi du taux de natalité et de l'importance de la part des jeunes de moins de quinze ans dans ces quartiers, on ne s'étonne pas de trouver une sur-représentation des jeunes issus de l'immigration au sein de la petite proportion des jeunes qui participent à la délinquance.
Cet effet démographique logique constitue un premier élément de réponse.
Ensuite, deuxième élément de réponse, les études locales menées dans diverses villes moyennes de France pour tenter de déterminer, en prenant par exemple pour indice les patronymes, s'il y avait ou non une sur-représentation des jeunes issus de l'immigration -les taux étant bien rapportés ici à la population globale des quartiers- ont montré que ce n'était pas le cas.
En revanche, les enquêtes, en particulier celle de mon collègue Hugues Lagrange, font apparaître une augmentation de la part de ces jeunes au sein de certains des quartiers qualifiés de très sensibles dans l'échelle policière de la violence.
Il s'agit donc d'un effet qui se mesure non pas dans tous les quartiers relevant de la politique de la ville mais uniquement dans certains quartiers très sensibles, qui, en général, sont parmi les plus pauvres, sont situés dans les banlieues des grandes agglomérations et sont le théâtre -souvent depuis la fin des années soixante-dix- de cette guérilla entre jeunes et policiers que j'évoquais tout à l'heure.
Autrement dit, dans les quartiers où se concentre la population étrangère et où existe depuis plus de vingt ans une logique d'affrontement entre jeunes et policiers, avec, de part et d'autre, une logique d'engrenage, le fait d'être étranger devient alors certainement -d'autant que c'est un facteur supplémentaire de fragilisation et de victimation, notamment au regard des pratiques policières- une cause plus fréquente d'entrée dans la délinquance et de violence plus intense, mais cet aspect me paraît absolument indissociable de l'histoire des quartiers et, en particulier, de l'histoire de leur relation à la police.
J'en viens aux zones de non-droit. Pour ma part, je conteste cette expression car je ne connais pas un seul endroit où la police n'entre pas. Il existe en revanche des quartiers dans lesquels la police a du mal à intervenir -ce qui n'est pas du tout la même chose- des quartiers dans lesquels elle se fait presque systématiquement « caillasser ». Je dirai même qu'ayant du mal à intervenir, elle y entre du coup de manière beaucoup plus violente, presque militarisée. C'est d'ailleurs là que la création des brigades anticriminalité a le plus d'impact.
Quelles sont les raisons de ces difficultés et de ces « caillassages » ? Je comprends très bien votre question parce qu'à en croire un certain nombre d'acteurs -notamment les syndicalistes policiers et de prétendus experts- si les policiers sont victimes d'un rejet de la part de la population -en particulier des jeunes- c'est du fait de délinquants organisés, simplement soucieux de tenir la police à distance de leur trafic.
Si cette logique du processus mafieux existe en effet dans un petit nombre de cas, elle n'explique pas fondamentalement les réflexes de rejet à l'encontre des policiers. Les causes, il faut les rechercher plus globalement dans un problème d'image lié aux modes d'intervention ordinaire de la police.
Comprenez-moi bien : loin de moi l'idée d'incriminer particulièrement les policiers. Mais, à force de subir la violence au quotidien, on finit de part et d'autre par entrer dans un système et à s'accoutumer à une catégorie d'affrontements entre jeunes hommes.
Cette situation est également liée aux types d'effectifs policiers. Les problèmes sont plus aigus dans les quartiers où exercent en majorité des jeunes policiers sans expérience, fraîchement débarqués de leur province, que dans les lieux d'affectation de policiers aguerris.
Vous m'avez demandé -c'était votre quatrième question- si cette violence contre les personnes est le fait de meneurs et de noyaux durs. Je suis tenté de répondre à la fois oui et non.
Des éléments d'enquête montrent incontestablement qu'un petit nombre de personnes sont responsables d'un grand nombre de faits, ce qui accrédite cette théorie du noyau dur. Cependant, un certain nombre de processus liés à des phénomènes de bandes se développent également.
En outre, on voit s'affirmer chez les jeunes de manière plus sensible dans les quartiers populaires, dans les transports en commun, dans les cours d'écoles, ce que d'aucuns ont pu appeler « la culture de l'odeur », ce mode d'opposition physique, frontal. Je pense donc que si un petit nombre de polydélinquants sont certainement responsables d'un certain nombre d'agressions, on ne peut pas pour autant analyser toute la réalité à travers cette seule explication.
Mme Nicole Borvo - Je pense comme vous qu'il y a un énorme problème en ce qui concerne la prévention au sens large.
On a parlé tout à l'heure d'orientation à l'école. Je constate que la plupart des jeunes en question, bien qu'étant d'âge scolaire, étaient déjà en situation d'absentéisme scolaire depuis un certain temps. Il est donc bien difficile à l'institution scolaire de jouer son rôle de contrôle.
Selon vous, la prévention telle qu'elle résulte de l'ordonnance de 1945 et des textes actuellement en vigueur est-elle adaptée aux formes collectives de délinquance ? N'y aurait-il pas lieu de repenser le système à l'égard des primodélinquants ? Pensez-vous que le dispositif existant -sous réserve d'être adapté- correspond aux formes actuelles d'incivilité et de délinquance ?
M. Laurent Mucchielli - D'abord, l'ensemble des moyens de prévention souffre aujourd'hui d'une grande faiblesse, pour ne pas dire de misère. Lorsque j'entends dire si souvent au cours des débats politiques : « la prévention, on la pratique depuis trente ans et elle ne marche pas », je suis hors de moi ! Ce discours est révoltant quand on sait le nombre des personnes qui se consacrent à la prévention dans les quartiers.
En outre, il serait bon de prendre en compte un certain nombre d'avancées dans la recherche qui ont mis en évidence l'existence de deux types de parcours délinquants.
Le premier type de parcours délinquant, qui se manifeste très tôt et peut bien souvent être repéré dès la maternelle, voire la crèche, correspond à de lourds problèmes familiaux. Ces cas classiques, bien connus des services sociaux, sont globalement liés aux poches de pauvreté et se traduisent chez les enfants par des comportements d'agressivité ou de repli sur soi. Il y aurait donc des dépistages précoces à faire.
Le deuxième type de parcours délinquant est observé lors de la pré-adolescence, vers dix-douze ans, comme le montrent des enquêtes menées voilà une cinquantaine d'années aux Etats-Unis. Dans ce cas, les phénomènes de groupes l'emportent sur la famille puisque c'est beaucoup plus la socialisation entre pairs qui est en cause.
La prévention est-elle adaptée ? Les comportements juvéniles ayant selon moi évolué plus en intensité qu'en nature, c'est par rapport à l'intensité qu'il faut repenser la prévention.
N'oublions pas non plus que la société n'est plus la même et que les modes de contrôle infra-institutionnels de la jeunesse - c'est-à-dire avant l'intervention des policiers - se sont raréfiés, voire ont disparu. Je citerai un exemple concret pour illustrer mon propos. La « démission » des familles, si souvent évoquée, exprime non pas un désintérêt à l'égard de l'enfant mais un réflexe d'évitement de l'institution scolaire, et ce pour toute une série de raisons.
Il faut donc adapter les outils de prévention classiques qui existent mais dont les familles ne connaissent parfois pas même l'existence. Permettez-moi une image : dans ce type de situation, plutôt que de stigmatiser les familles, il appartiendrait à l'institution de trouver les moyens d'aller vers elles. Il faudrait que le fonctionnaire laisse momentanément son bureau et son formulaire tout prêt pour aller rencontrer les gens qui ont besoin de lui et qui n'osent pas venir.
En France, on ne manque ni de dispositifs, ni de budgets, ni de services sociaux. Encore faut-il les faire parvenir aux familles en difficulté. Or le débat politique interprète ce vide en se retournant contre les familles et en les accusant. Tout l'enjeu serait selon moi de passer de cette attitude moralisatrice à une action d'accompagnement.
M. le président - Nous vous remercions.
Audition de M. Jean-Paul de
GAUDEMAR,
directeur de l'enseignement scolaire
(20 mars
2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Mes chers collègues, nous allons maintenant entendre M. Jean-Paul de Gaudemar, professeur agrégé de sciences économiques, qui a été recteur des académies de Strasbourg et de Toulouse et qui est aujourd'hui directeur de l'enseignement scolaire.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. de Gaudemar.
M. Jean-Paul de Gaudemar, directeur de l'enseignement scolaire - Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de vous préoccuper de la dimension éducative de la délinquance des mineurs en m'invitant à participer aux travaux de votre commission. Je suis pour ma part heureux d'avoir l'occasion d'exposer notre vision du phénomène.
Par délinquance des mineurs, on peut entendre beaucoup de choses. Je me suis demandé si vous reteniez une définition relativement restrictive, visant uniquement les mineurs dont les actes seraient susceptibles d'une qualification pénale ou si vous l'étendiez à tout ce qui peut, de près ou de loin, se rapporter à des comportements violents, ce qu'on appelle communément la violence à l'école.
J'ai pris le parti de me pencher sur ce dernier aspect que nous rencontrons le plus souvent, même si j'aurai l'occasion d'évoquer la population spécifique dont les actes peuvent être qualifiés sur le plan pénal. Mon propos n'aura aucune prétention exhaustive.
Dans une période au cours de laquelle la question de la délinquance en général, et des mineurs en particulier, est d'actualité, il est frappant de constater à quel point ce sujet est ancien. Je suis persuadé que ce problème est au centre des missions fondamentales de l'école, l'éducation apparaissant depuis le XIXème siècle comme la première des réponses organisées à cette délinquance, au moins en matière de prévention, éventuellement en matière de traitement ou de préparation à la réinsertion.
Les missions de l'école -et de l'école publique en particulier- sont au coeur de ce que Durkheim appelait « l'apprentissage de la norme ». Il s'agit d'apprendre à la population d'âge scolaire à intérioriser des normes de comportement social, à se soumettre à une autorité sous ses diverses formes en manifestant de l'obéissance. Le sujet qu'est l'élève apprend sa propre liberté en même temps qu'il apprend la contrainte.
Nous sommes confrontés tous les jours à la délinquance des mineurs à l'école. En outre, cette dernière est elle-même victime de certaines de ces formes de délinquance : on l'a vu récemment avec les affaires de racket.
Je voudrais développer devant vous quatre façons d'aborder le problème. Premièrement, comment appréhendons-nous la délinquance des mineurs ? De quels outils d'observation et d'analyse disposons-nous ? A partir de là, quelle démarche adoptons-nous ?
Les trois autres points seront beaucoup plus axés sur le mode d'action et s'organiseront autour des trois convictions qui nous animent face à la violence en milieu scolaire.
Première conviction : la principale réponse que nous devons apporter, c'est l'éducation parce qu'elle est au coeur de notre mission. Il s'agit en permanence de faire comprendre à l'élève que l'école a un sens, de lui donner des repères dans le cadre de la mission d'éducation civique qui est la nôtre et de l'aider à surmonter une forme de désespoir souvent à l'origine de la délinquance. Le premier volet de l'éducation consiste donc à aider l'élève à se préparer un avenir.
Deuxième conviction : notre travail d'éducation sera d'autant plus efficace que nous serons capables d'apporter des réponses propres à protéger l'école et à la rendre plus solidaire. Toutes les expériences montrent que plus les équipes sont soudées entre elles, et mieux elles réussissent à résister à des agressions internes ou externes. Il importe donc de construire ces rapports de solidarité.
Troisième conviction : l'école ne peut pas surmonter seule ce problème qui doit faire l'objet d'une démarche partenariale d'ensemble. Ce travail est engagé depuis de nombreuses années avec de multiples partenaires.
Je reviens sur chacun de ces aspects. Comment abordons-nous cette délinquance des mineurs ? Il faut bien avouer que pendant des années nous avons été démunis par rapport à l'appréhension objective du phénomène. Nos équipes ressentaient d'autant plus douloureusement cette lacune que leur vécu - dans de nombreux établissements en tout cas - était souvent assez pénible à cet égard.
Nous nous sommes donc employés à affiner nos techniques. Depuis les années soixante-dix, depuis ce qu'il est convenu d'appeler la démocratisation de l'école, le nombre de rapports faits notamment par l'inspection générale sur le développement de la violence à l'école est impressionnant.
Une modification d'importance est survenue dans l'état d'esprit de nos établissements à partir de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix puisque la loi du silence sur les incidents à l'école a été très largement rompue. La pratique du signalement des incidents s'est généralisée, à tel point d'ailleurs qu'à partir de 1997, le matériau rassemblé était tellement divers - mêlant des actes très graves qui relevaient de la délinquance et d'autres qui se limitaient à des incivilités - qu'il devenait fort difficile de les traiter.
Pour y voir plus clair, nous avons fait un travail qui a débouché sur la constitution du logiciel SIGNA, géré par une autre direction du ministère. Il recense les éléments fournis par les établissements et opère un premier tri entre les incidents pour ne retenir que les plus graves.
Le champ de cette enquête, dont la périodicité est de deux mois, dépasse les établissements du second degré et s'étend aux écoles. Les chiffres concernant les deux premiers mois de l'année scolaire ont été publiés dès les premiers jours de janvier. Ceux qui sont relatifs aux mois de novembre et décembre sortiront très prochainement. Grâce à cet outil, la précision de notre vision s'est améliorée.
S'il est fréquemment fait état dans le débat public d'un rajeunissement de la délinquance des mineurs, notre enquête aurait plutôt tendance à démontrer le contraire. Les actes les plus graves qui sont repérés à l'école sont le plus souvent le fait de parents agressant les maîtres. Dans le second degré, ce sont les élèves qui sont majoritairement les auteurs de ces incidents concentrés sur un pourcentage relativement limité d'établissements. Il ressort de notre enquête que l'âge critique se situe à quinze ans.
Nous attendons beaucoup de cet outil pour rendre possible le pilotage d'une action. Cela nous a conduits à envisager un plus qualitatif pour compléter ces observations quantitatives. Nous essayons de mettre en place un Observatoire de l'enfance et de l'adolescence composé d'un certain nombre de spécialistes issus notamment de la pédopsychiatrie ou de la sociologie qui nous permettront peut-être de mieux comprendre la typologie de ces délinquants.
Nous nous intéressons en particulier à la porosité extrême qui existe entre le milieu de vie et l'école. Au terme d'un processus d'intériorisation, les drames qui étaient autrefois le fait des seuls adultes sont désormais des composantes essentielles des comportements enfantins.
Comment agissons-nous ? Le premier dispositif a une dimension éducative et concerne au premier chef ce que nous enseignons, la manière dont nous enseignons. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de donner du sens à l'enseignement et d'apporter des repères aux élèves. Cela touche plus aux comportements qu'aux savoirs.
Rappelons à cet égard la dimension civique et humaine de notre enseignement. C'est François Bayrou qui a lancé pour le collège et le lycée l'idée d'intégrer l'éducation civique à tous les niveaux de notre enseignement. Depuis, cette dynamique s'est étendue.
Nous avons bâti des programmes assez ambitieux qui constituent plus un apprentissage à vivre ensemble qu'un enseignement supplémentaire. Prenant appui sur des savoirs qui portent sur les institutions et les valeurs républicaines, ils visent à apprendre aux élèves la pratique du débat démocratique.
Nous sommes également convaincus depuis très longtemps que la meilleure prévention à l'égard de la délinquance des mineurs, c'est la lutte contre l'échec scolaire, surtout quand il est redondant avec un échec d'un autre type. Nous avons donc multiplié des dispositifs de pédagogie différenciée et autres outils spécifiques qui peuvent intervenir à l'intérieur de l'établissement, voire sous forme de classes relais externalisées si la situation de l'enfant le demande.
A côté de l'enseignement, il y a la vie scolaire. Enseigner l'éducation civique ne sert à rien si la vie quotidienne de l'établissement n'est pas elle-même empreinte des valeurs civiques que nous entendons transmettre. C'est la raison pour laquelle nous portons une attention particulière aux modalités d'accueil des enfants les plus jeunes. L'apprentissage de la ponctualité et de l'assiduité est essentiel. La pratique des délégués de classe, des comités de vie lycéenne participent de cette démarche d'immersion dans une forme de vie démocratique.
Nous misons sur le développement des futurs internats éducatifs pour apporter des réponses en termes de vie scolaire aux enfants en difficulté dans leur milieu d'origine.
Nous attachons beaucoup d'importance aux procédures disciplinaires et aux sanctions. La règle doit être explicite et connue des élèves : nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons fait à cet égard un gros travail. Des textes nouveaux en date de juillet 2000 visent à faire en sorte que les élèves s'approprient les règlements intérieurs, à défaut de les élaborer. Dans certains collèges, des exercices permettent de s'assurer que l'élève a intériorisé dans son propre langage ce règlement intérieur.
Je voudrais maintenant évoquer les dispositifs propres à protéger l'école et à la rendre plus solidaire. Nous avons jugé utile de créer en octobre 2000 un Conseil national de lutte contre la violence à l'école. Nous disposons là d'un lieu de réflexion, d'observation et de production de documents afin de piloter sur le mode qualitatif des plans spécifiques de lutte contre la violence qui sont depuis une bonne dizaine d'années l'une des priorités de notre ministère.
Nous manifestons ainsi l'importance politique que nous attachons à cette question et nous en tirons les conséquences pratiques en identifiant les espaces prioritaires sur lesquels doit porter notre action. Elle concerne dix académies, une vingtaine de sites plutôt urbains. Ce dispositif vise un peu plus de 500 établissements, un peu plus de 2 000 écoles, soit environ 740 000 élèves sur les 5 millions du seul second degré.
Nous pratiquons dans ces zones une sorte de discrimination positive en y consacrant davantage de moyens, notamment en y affectant des personnels médico-sociaux ou des aides éducateurs qui ont pris le relais des appelés du contingent.
Je n'insisterai pas sur les zones d'éducation prioritaire que vous connaissez bien car elles sont de création plus ancienne.
Pour s'acquitter de sa mission de lutte contre la délinquance des mineurs, l'école a besoin de s'appuyer sur d'autres partenaires. Nous avons développé énormément d'actions de coopération avec le ministère de la justice et avec les autorités de la police et de la gendarmerie, actions qui témoignent d'une rupture considérable avec ce qui fut longtemps la culture de l'école.
J'évoquerai enfin deux dispositifs principaux. Premièrement, les dispositifs relais. Mis en place voilà relativement peu de temps, ils constituent un axe fort de lutte contre l'échec scolaire et la marginalisation des jeunes en leur permettant de trouver un accueil adapté à leur situation avant de rejoindre une structure scolaire normale. Arrêté par un texte de 1998, ce système a commencé à fonctionner dès la rentrée 1999 avec 180 dispositifs à l'échelle nationale. L'objectif de parvenir cette année au chiffre de 250 sera atteint. M. le Premier ministre a annoncé la multiplication par deux, dans les deux ou trois ans qui viennent, de cette innovation, qui a fait la preuve de son efficacité.
Deuxièmement, les dispositifs mis en place en partenariat avec le ministère de la justice pour assurer l'enseignement des mineurs incarcérés, tâche qui n'est évidemment pas facile puisque la durée du séjour en milieu pénitentiaire est de l'ordre de six mois. Je tiens à souligner que nous avons souvent pu transposer dans certains de nos établissements des compétences et des méthodes acquises en milieu pénitentiaire.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Pourriez-vous revenir sur le logiciel SIGNA ?
M. Jean-Paul de Gaudemar - Nous avions auparavant une typologie par quatre niveaux de gravité. Nous retenons désormais uniquement les incidents les plus graves, ceux qui relèvent des niveaux trois et quatre. Les incidents qui occupent les deux tiers de nos signalements sont les violences sans armes ou les insultes et menaces graves. Viennent enfin les vols ou tentatives de vols.
Cela signifie que les violences beaucoup plus graves sont moins fréquentes. C'est ainsi que, d'après nos statistiques, le pourcentage de racket est d'ordre de trois ou quatre. Quant au port d'armes à feu, il est statistiquement non significatif.
M. le rapporteur - Vous nous avez dit que l'une des missions de l'école est l'apprentissage de la norme. En cas de transgression, mettez-vous en place une pratique de signalement auprès des caisses d'allocations familiales, par exemple ? Si oui, comment se décline-t-elle et est-elle efficace ?
M. Jean-Paul de Gaudemar - Le fait d'avoir instauré la pratique du signalement est déjà un message. Désormais, tout acte d'un certain type de gravité est porté à la connaissance du chef d'établissement, au-delà à une autorité hiérarchiquement supérieure, voire à des autorités judiciaires. Dans le cadre du partenariat, se sont tissés des liens entre les ministères de l'Education nationale et de la justice qui ne se connaissaient pas bien, entretenaient même parfois des rapports de défiance réciproque. L'impact psychologique de la première convention que j'ai signée en tant que recteur d'académie avec le parquet général de Colmar, a été énorme. Les chefs d'établissement ont compris à quel point il était important que la justice soit saisie de ces incidents et décide des suites à leur donner.
Nous connaissons, grâce à notre logiciel, les suites internes qui sont données à ces actes dans les établissements. Nous savons que la moitié des événements recensés -ceux qui relèvent, par exemple, de l'insulte ou de la violence verbale- donnent lieu à une mesure alternative au conseil de discipline, c'est-à-dire une punition scolaire. Le conseil de discipline n'est saisi que dans 5 % des cas, par exemple le vol ou la violence physique. Environ la moitié des incidents ne font pas l'objet d'une suite interne.
Ces éléments sont déjà les garants d'une certaine efficacité. Il en va de même du travail entrepris pour faire en sorte que les élèves s'approprient le règlement intérieur.
De nombreux élèves ne connaissent pas ou ne comprennent pas le règlement intérieur. Celui-ci est souvent rédigé dans un langage qui n'est pas forcément accessible, surtout aux plus jeunes. La démarche consiste donc à expliquer aux élèves la signification de telle ou telle règle et les sanctions qui s'appliquent en cas d'inobservation de celle-ci. Nous recommandons aux enseignants de s'assurer de la compréhension de leur discours en organisant des travaux pratiques. Cet enseignement fait partie de l'éducation. Tous les établissements qui s'engagent dans cette voie obtiennent des résultats, notamment ceux qui sont les plus sensibles, comme l'a démontré le Conseil national de lutte contre la délinquance.
M. le rapporteur - Dans un document émanant du ministère de l'Education nationale, il est écrit : « Partout où la mobilité des personnels est très forte, les problèmes sont plus nombreux et plus graves ou du moins sont moins bien traités. » Existe-t-il un lien direct entre le turn over des enseignants et la délinquance ?
M. Jean-Paul de Gaudemar - Oui, nous le pensons. Mais où est la cause ? Où est l'effet ? La réponse n'est pas simple. En tout cas, nous avons constaté une corrélation entre les établissements difficiles et le turn over des enseignants. Ces derniers, souvent très jeunes, se trouvaient parachutés, à l'issue de leur formation, compte tenu de procédures de nomination peu adaptées, dans un milieu auquel ils n'étaient pas préparés. De ce fait, ils saisissaient la première opportunité qui se présentait pour partir.
Nous avons voulu réagir en essayant d'adopter des mesures tendant à assurer la stabilité des équipes éducatives. Il ne peut en effet y avoir, en la circonstance, de travail de fond et de longue haleine sans un personnel stable. Nous avons donc pris un certain nombre de dispositions de bon sens tendant à éviter d'affecter dans des postes difficiles des jeunes enseignants qui ne sont pas prêts à assumer de telles fonctions et qui ne sont donc pas volontaires.
Nous avons également mis à la disposition des professeurs un certain nombre de dispositifs de formation afin de les aider à faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer et pris des mesures incitatives en termes de carrière, telles qu'une bonification indiciaire. Nous leur proposons également, en contrepartie de l'engagement de rester pendant un certain temps, par exemple trois ans, dans le même poste, une bonification de points leur permettant d'obtenir plus facilement une mutation. Ce dispositif est très apprécié et très efficace. Il permet aux enseignants de s'engager pleinement pendant quelques années tout en sachant qu'ils ne sont pas condamnés à rester et qu'ils pourront partir dans de meilleures conditions.
Nous observons toutefois bien souvent que certains d'entre eux décident de passer sinon toute leur carrière du moins une grande partie de celle-ci dans des établissements sensibles alors qu'ils pourraient, compte tenu de leur ancienneté, partir vers d'autres horizons. En effet, si nombre d'entre eux souffrent de leurs conditions de vie, d'autres, auxquels il faut rendre hommage, prennent leur travail à coeur. Grâce à eux, nous obtenons des résultats, ce qui nous encourage à maintenir et à développer ce type de système incitatif.
M. le rapporteur - De nombreux postes d'enseignants ont été créés. Qu'en est-il des personnels médico-sociaux et ATOS, qui assument, outre leurs fonctions, un rôle éducatif évident, notamment dans les établissements sensibles ? Les mesures qui ont été prises ont-elles été mises en oeuvre ? Le ministère de l'Education nationale prévoit-il d'en adopter d'autres ?
M. Jean-Paul de Gaudemar - Comme je l'ai souligné dans mon exposé introductif, tous les plans de lutte contre la violence mettent l'accent sur le renforcement des équipes, s'agissant notamment des personnels non enseignants. Un certain nombre de dispositions ont pu être mises en oeuvre grâce au Parlement par le biais des lois de finances. Elles peuvent, certes, paraître modestes, mais elles traduisent des efforts très significatifs.
Permettez-moi de citer quelques exemples. Grâce à la loi de finances pour 2001, nous avons obtenu la création de cinquante postes de médecins, dont trente ont été affectés dans les académies relevant du plan de lutte contre la violence. C'est ce que nous appelons la « discrimination positive ». Nous avons également obtenu la création de cent cinquante postes d'infirmières et de cent postes de personnels sociaux, dont les deux tiers ont été affectés dans ces mêmes académies. Au total, le bilan est d'ailleurs même plus important.
Au cours des dernières années, l'accent a été mis sur ces personnels. Certes, me direz-vous, nous ne créons jamais assez de postes. A titre personnel, je me réjouirai de l'augmentation du nombre de ces personnels parce qu'ils apportent un regard quelque peu différent sur les élèves et peuvent réellement s'attaquer à la prévention et au traitement de la violence dans d'excellentes conditions.
L'accroissement du nombre des aides-éducateurs -ils sont actuellement plus de 60 000- a constitué une aide importante. Un grand nombre d'entre eux sont affectés soit à des tâches éducatives, soit à des tâches de médiation tendant à faciliter le dialogue non seulement entre les élèves, les enseignants et les autres personnels mais aussi avec les parents et les partenaires extérieurs. Nous avons bénéficié d'un effort considérable dont nous nous réjouissons. Plus nous continuerons de renforcer nos équipes, mieux nous travaillerons.
J'ai même tendance à penser que certaines compétences font défaut à nos personnels, notamment en matière de traitement et de suivi individuel des élèves. L'aspect psychologique des difficultés de comportement nécessiterait parfois d'avoir recours à des compétences d'une nature autre que celle que les médecins, les infirmières et les assistantes sociales peuvent apporter afin de mieux cerner la personnalité des élèves. Certains établissements font déjà appel à ce type de compétences. Il nous faudra traiter ce problème.
Les conseillers d'éducation et les personnels d'encadrement constituent également une catégorie très importante. Nous avons décidé d'augmenter le nombre de proviseurs spécialisés qui suivent attentivement les problèmes de violence. Alors que nous en avions d'ordinaire un par académie, nous avons décidé d'en nommer un par département. Cette mesure est entrée en application depuis la rentrée 2001 en Ile-de-France, et nous espérons l'étendre aux neuf académies relevant du plan de lutte contre la violence.
M. le rapporteur - Quel est le suivi des jeunes après leur formation dans les classes relais ?
Le collège unique est-il bien adapté à un type de population en échec scolaire ?
Comment sont choisis les enseignants qui travaillent en milieu pénitentiaire ?
M. Jean-Paul de Gaudemar - S'agissant des classes relais, nous manquons un peu de recul. La clé du succès d'un tel dispositif repose sur un retour réussi des jeunes dans les collèges. Les équipes doivent être capables non seulement de cerner les élèves relevant de ce dispositif, mais aussi de préparer ceux-ci à leur futur retour dans les collèges.
Ce travail est effectué établissement par établissement. Il fait l'objet d'une observation attentive de la part d'un dispositif de pilotage. Je ne puis vous donner de chiffres précis quant au taux de réussite. Nous devons nous doter d'outils nous permettant de calculer le taux des élèves passés par ce dispositif qui reprennent une scolarité sinon normale du moins offrant un débouché.
Nous avons commencé de mettre en place un programme très important qui tend à permettre à tout élève à un moment en difficulté, qu'il ait bénéficié ou non d'un dispositif relais, de sortir du système scolaire avec une qualification minimale. Toute une série de dispositifs permettent, y compris à des jeunes ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, d'accéder, s'ils ne peuvent pas se réinsérer dans une structure normale, à une structure adaptée. Tel est l'objectif de ce que nous appelons la « mission d'insertion ». Nous disposons, au sein d'une scolarisation normale ou adaptée, d'éléments de réponse à d'éventuelles difficultés de réinsertion.
L'expression « collège unique » est mal adaptée, même si nous l'employons couramment, car nous visons à travers elle à la fois l'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'inculquer à tous les élèves une culture commune, et la très grande diversité de ces derniers, en particulier les difficultés, parfois très grandes, que rencontrent certains d'entre eux. Tous les textes que nous avons mis en oeuvre au cours de ces deux dernières années prennent en compte ces deux éléments.
Je vous renvoie au dernier arrêté que nous avons pris concernant les classes de 6ème et permettant à un collège qui le jugerait utile d'organiser un dispositif spécifique d'accueil soit à l'intérieur de la classe, soit à l'extérieur. Ce dispositif apporte une réponse très pertinente aux difficultés rencontrées par les élèves. A cet égard, il faut rappeler que la réussite scolaire de ceux-ci n'est pas toujours liée à leur comportement. Les élèves en très grandes difficultés ne sont pas nécessairement des éléments perturbateurs. En revanche, nous pouvons avoir des élèves très perturbateurs qui réussissent.
Le collège unique ou le collège républicain, pour reprendre les termes de M. le ministre, peut apporter une réponse, y compris dans la diversité des modes d'apprentissage pédagogique. Je pense notamment à ce que nous appelons « les itinéraires de découverte », même s'ils occupent une place modeste dans l'emploi du temps des élèves. Cette plage de deux heures par semaine permet à ces derniers, sur fond d'apprentissage disciplinaire, de travailler d'une autre façon et peut-être de retrouver une motivation qu'ils n'ont pas nécessairement dans un dispositif plus traditionnel. Nous disposons donc là d'éléments de réponse, même s'ils font l'objet d'un débat très légitime.
S'agissant des enseignants en milieu pénitentiaire, ils doivent bien évidemment émettre le souhait d'exercer leurs fonctions dans ce milieu. Par ailleurs, des commissions s'assurent de leur capacité à le faire. Ce métier est à la fois passionnant et très difficile, mais je constate que le turn over est très limité, car ces enseignants, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, sont un peu militants en ce domaine et croient beaucoup à ce qu'ils apportent aux détenus.
Ces personnels, face à ce public, qui a un profil très particulier et qui est très mobile -il peut changer d'établissement d'un jour à l'autre- développent des qualités que nous aimerions pouvoir transposer ou adapter chez d'autres. Ils constituent l'une des richesses, peu connue mais importante, de notre système.
M. François Zocchetto - J'aborderai le thème de la toxicomanie. L'école peut être un marché privilégié d'échange de la drogue. N'existe-t-il pas un décalage important entre le traitement judiciaire de ce trafic -un jeune, lorsqu'il est pris, peut être placé du jour au lendemain en détention, ce qui est une mesure brutale- et le traitement fait par les établissements ? Certains d'entre eux ignorent ce trafic.
Ma seconde question a trait aux conseils de discipline. Il est souvent reproché à la justice de ne pas traiter en temps réel les infractions, de ne pas donner une réponse rapide aux jeunes. La procédure du conseil de discipline me semble un peu lourde à mettre en place. Il faut certes respecter les droits de la défense, mais nous voyons apparaître une sorte de « judiciarisation » de ces conseils, qui vont jusqu'à la présence d'avocats avec des échanges de conclusions. Ce dispositif me semble assez éloigné de l'esprit dans lequel il avait été institué. Ne faudrait-il pas le revoir ?
La délinquance se nourrit en partie, avez-vous dit, de l'échec scolaire. Ne devrions-nous pas abandonner le postulat selon lequel 80 % d'une classe d'âge doit parvenir au baccalauréat ? Tout le monde s'accorde à dire qu'il est tout à fait possible de réussir sans ce diplôme. La répétition permanente de ce slogan risque de confiner une partie des jeunes dans un ghetto dont il est difficile de sortir.
Enfin, ma dernière question concerne les enseignants nommés dans des zones difficiles. L'échelle des rémunérations entre ceux qui travaillent dans ces zones et ceux qui exercent dans les zones « tranquilles » est-elle bien marquée ? Dans l'armée, par exemple, selon que vous êtes au ministère de la défense ou en opération en ex-Yougoslavie ou en Afghanistan, la rémunération peut varier de un à cinq.
Mme Nicole Borvo - Il n'y a plus, dites-vous, de loi du silence à propos de la violence dans les établissements scolaires. Que répondez-vous aux magistrats qui ont souvent reproché à ces derniers de nier la violence en leur sein ? Il s'agit, en quelque sorte, d'une façon d'éluder la question. La tendance actuelle, en revanche, consiste à saisir la police à tout bout de champ, ce qui est une autre façon d'éluder la question.
Vous avez parlé des personnels non enseignants. Certaines mesures positives ont été prises à leur égard. Dans le même temps, une question n'est jamais posée : les jeunes « prédélinquants », en grande majorité des garçons, sont souvent en rupture de référent paternel. Or, dans les établissements scolaires, particulièrement les collèges, les personnels sont en grande partie féminins. Il faudrait donc inciter les hommes à exercer ces professions, car se pose un véritable problème lié notamment aux différentes cultures.
Vous avez évoqué le partenariat. Il est vrai que nous constatons une volonté de progresser en ce domaine. Néanmoins, il existe des réticences s'agissant du partenariat avec les familles. Or, le rapport entre l'institution et celles-ci est essentiel. Si l'institution ne se penche pas sur cette question, nous ne pourrons pas agir contre la violence chez les plus jeunes.
M. Jean-Paul de Gaudemar - Madame Borvo, vous avez fait observer qu'à la loi du silence s'est substitué l'excès inverse. Je l'ai en effet constaté sur le terrain. Mais cela fait partie de l'apprentissage collectif que nous avons à faire. Il est plutôt sain d'avoir eu une période pendant laquelle les parquets étaient encombrés. Nous sommes progressivement en train de réguler la situation.
Vous avez fort justement noté que nos statistiques faisaient très nettement apparaître une distinction entre les filles et les garçons. Plus exactement, la délinquance, selon qu'elle est masculine ou féminine, ne revêt pas les mêmes formes, mais il est clair qu'elle est plus le fait des garçons. J'en profite pour dire que l'intérêt de notre logiciel est de mettre notamment en avant tout ce qui a trait aux violences sexuelles, dont les filles sont en grande majorité les victimes. Cette question nous préoccupe beaucoup.
Le volet de la formation des équipes de prévention comprend une partie très spécifique liée à la prévention des violences sexuelles. Pour autant, sommes-nous capables d'inciter les hommes à être plus présents ? Si la profession est très féminisée dans le premier et le second degré, elle l'est nettement moins dans l'enseignement supérieur. Nous souhaiterions instaurer la parité, mais les modalités d'action ne sont pas simples. Nous sommes confrontés à des choix de profession. Peut-être faudrait-il introduire une discrimination positive ? Je n'ai pas de solution à proposer en ce domaine, mais je reconnais la pertinence de votre question. Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Le partenariat avec les parents est une question essentielle. Il faut poser ce problème sous plusieurs angles. Nous avons un partenariat très développé avec les parents et les associations de parents d'élèves. Le problème est que les parents avec lesquels nous devrions être le plus en contact sont ceux que nous avons le plus de mal à rencontrer. Nous essayons de déployer des trésors d'ingéniosité pour résoudre cette difficulté et nous y parvenons grâce aux personnels sociaux, qui ont une expérience très utile en ce domaine.
Nous rencontrons d'ailleurs des difficultés non pas avec les associations reconnues de parents d'élèves mais avec les parents des élèves les plus en difficultés ou des délinquants dont le comportement déviant provient souvent de l'état de leur structure familiale ou de l'inexistence de celle-ci.
Je reconnais avec vous que ce problème est essentiel, mais il faut notamment l'analyser sous cet angle. C'est là où le partenariat doit être étendu. Je pense notamment aux collectivités locales. Un texte récent confie aux maires le soin d'être le « pilote organisateur » de la vie éducative à l'échelle de leur commune. Ces pistes intéressantes nous permettent de renouer des relations avec certaines familles.
Monsieur Zocchetto, s'agissant de la toxicomanie, nous avons développé un partenariat très riche avec la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Ces organismes ont pour mission d'organiser, autour des établissements scolaires, la prévention de toute dépendance et des conduites à risque.
Vous avez très probablement raison de souligner que nous avons une mauvaise appréhension de ces phénomènes, mais la situation n'est pas si simple. Certains peuvent être minorés ici et grossis là. La parole commence à se libérer en ce domaine. Il existe un véritable problème culturel qui consiste à essayer de créer une prise de conscience chez les jeunes. Nombre d'entre eux considèrent que la consommation de haschisch ou de drogue douce n'est pas nécessairement un acte délictueux. Comment faire évoluer cette situation ? L'école, seule, ne pourra pas apporter de réponse, ce qui explique la difficulté à appréhender la véritable dimension de ce problème. En tout cas, nous essayons de l'aborder, notamment à travers les structures que j'ai citées.
Vous avez également évoqué les conseils de discipline. Nous nous sommes beaucoup interrogés à ce sujet. Nous avons modifié les textes en 2000 après avoir constaté que les procédures étaient si lourdes que les chefs d'établissement renonçaient, la plupart du temps, à réunir ces instances. Les pratiques étaient même parfois contraires aux droits de l'enfant, voire au bon sens. C'est pourquoi nous avons essayé de réactiver ces conseils non seulement dans leur composition et leurs modalités de réunion mais aussi et surtout dans leur usage.
Deux erreurs sont, en effet, à éviter : soit ces conseils ne sont jamais réunis, soit ils le sont à tout bout de champ et prononcent des sanctions qui perdent en grande partie leur caractère éducatif parce qu'elles méconnaissent souvent le principe de la gradation de la sanction. Ainsi, des élèves qui étaient sans doute turbulents et qui avaient beaucoup à se reprocher se voyaient brutalement exclus, soit définitivement, soit temporairement, de leur établissement scolaire, et ce dans l'ignorance complète d'un principe élémentaire du droit, celui de la gradation de la sanction et de son appropriation. Il était donc nécessaire de mettre en place un dispositif de sanctions à la fois scolaires et disciplinaires permettant une utilisation plus appropriée et plus pertinente de ces conseils de discipline.
Nous manquons un peu de recul, dix-huit mois à peine après la mise en oeuvre de ces nouveaux textes. Mais un certain nombre d'indices nous montrent que ce dispositif est mieux et plus souvent utilisé. Nous verrons à l'usage si cette tendance se confirme.
S'agissant de l'objectif de mener 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat, je mets en oeuvre la décision prise par le Gouvernement à travers la loi d'orientation de 1989. Nous n'avons pas atteint cet objectif. Toutes sections confondues, nous sommes parvenus à un peu moins de 70 %, ce qui correspond à la tendance générale dans tous les grands pays industrialisés. La loi de 1989 n'a donc été que la traduction législative de cette tendance.
Compte tenu de ma position, il m'est difficile d'insister davantage. Cela dit, n'importe quel citoyen sensé sait que la question essentielle est de savoir comment une nation veut préparer les générations futures à affronter les défis auxquels elles seront confrontées dans le contexte économique d'ouverture au monde et de mondialisation que nous connaissons déjà actuellement. Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette délicate question.
S'agissant du caractère discriminatoire des rémunérations des enseignants, le système de bonification indiciaire qui a été mis en place n'est peut-être pas suffisamment attractif. L'échelle ne va pas de un à cinq. La bonification de prime des enseignants en ZEP s'élève à un peu plus de 1 000 euros par an, ce qui peut paraître modeste. Peut-être devrions-nous revoir le système, mais nous tombons alors dans un dispositif qui dépasse, de loin, mes compétences : je veux parler des primes, des indemnités et des bonifications indiciaires des fonctionnaires.
Audition de M.
Jean-François RENUCCI,
professeur à l'université de
Nice Sophia-Antipolis
(20 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle maintenant l'audition de M. Jean-François Renucci, professeur à l'université de Nice Sophia-Antipolis, qui a consacré sa thèse à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger, et qui a réalisé de nombreuses études sur le droit pénal des mineurs.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Monsieur Renucci.
M. Jean-François Renucci, professeur à l'université de Nice Sophia-Antipolis - Je suis heureux et très honoré de participer à votre important travail de réflexion sur le droit pénal des mineurs. Je me suis beaucoup intéressé à cette question pendant une quinzaine d'années. Depuis, je l'ai un peu délaissée au profit du droit européen en matière de droits de l'homme. Mais ce domaine n'est pas si éloigné de vos préoccupations. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je ne pourrai donc pas vous apporter des réponses techniques très précises, mais j'ai un certain nombre d'idées que je suis heureux de vous exposer.
La question centrale est l'ordonnance de 1945, qui a été incontestablement un texte remarquable. Ses rédacteurs ont fait preuve d'un esprit particulièrement inventif et d'une extraordinaire faculté d'adaptation. Toutefois, malgré ses immenses qualités, cette ordonnance a vieilli et n'est plus à même, me semble-t-il, de répondre très exactement et efficacement aux nouveaux défis.
Il est vrai qu'elle a été profondément et fréquemment modifiée pour prendre en compte les nouvelles réalités. Le toilettage opéré a été relativement efficace. Les réponses qui ont été apportées à la délinquance des jeunes ne sont pas, loin s'en faut, totalement obsolètes. Ce texte comporte des dispositions très intéressantes relatives à l'action de la PJJ, aux conseils de prévention et à la spécialisation de tous les acteurs intervenant en ce domaine. Il faut impérativement conserver ces acquis considérables.
Les systèmes de protection, les différentes garanties, l'assouplissement et l'accélération de la procédure constituent des avancées très importantes et fort intéressantes. Cela dit, il faut être très prudent. Il est vrai que le fait pour la France d'être assez régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, aux motifs que la justice est rendue trop lentement, incite le législateur à proposer des procédures de plus en plus accélérées. Le mieux est l'ennemi du bien.
Certes, il est nécessaire que de telles procédures existent. Mais si la France est souvent condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est faute de procès équitable. Or, ce dernier implique que les affaires soient jugées dans un délai raisonnable. S'il n'est pas bon qu'une affaire soit jugée trop lentement, il ne faut pas non plus qu'elle le soit trop rapidement -la question ne s'est pas encore posée, mais elle le sera sans doute un jour- car nous risquons d'être condamnés pour avoir jugé dans des délais déraisonnables. Il est demandé de se prononcer non pas rapidement mais dans un délai raisonnable. Or, les affaires doivent être bien jugées, ce qui demande quelquefois du temps.
L'ordonnance de 1945 comporte une gamme très large de mesures qui me paraissent intéressantes, telles que l'admonestation, la remise aux parents ou à des tiers, la médiation-réparation. Ces mesures, que peut prononcer le juge des enfants, me paraissent suffisantes, mais elles doivent être maniées avec d'infinies précautions eu égard aux principes européens. Je pense en particulier à la médiation-réparation.
J'en reviens à la Convention européenne des droits de l'homme. La notion clé est le droit à un procès équitable tant pour le majeur que pour le mineur. Or, je ne suis pas certain que la médiation-réparation permette de respecter tous les droits de ce dernier. Peut-être attache-t-on à la parole de celui-ci trop d'importance. Peut-être fait-on aussi l'économie d'une procédure judiciaire, ce qui peut parfois constituer une erreur. Le fait de passer en justice peut aussi être un atout sur le plan pédagogique. Je ne suis pas certain qu'une procédure rapide incite le mineur à réfléchir à son acte.
Par ailleurs, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment par une circulaire ministérielle de 1998. Je pense notamment à l'éloignement des mineurs, qui me paraît une excellente mesure tant pour le milieu dans lequel ils vivent, parce qu'ils peuvent le dégrader, que pour les mineurs eux-mêmes, qui, lorsqu'ils ont sombré dans la délinquance, se croient parfois obligés de continuer de jouer le rôle de délinquant de service. Le fait de les sortir de leur milieu leur permet d'abandonner ce rôle qu'ils n'ont sans doute plus envie de jouer et les aide à se réinsérer dans le droit chemin.
Le système actuel est loin d'être totalement inefficace. Cela dit, je persiste malgré tout à penser que l'ordonnance de 1945 a trop vieilli, et ce par la force des choses ; 1945, c'est loin. Depuis, le monde, comme la délinquance des mineurs, a beaucoup évolué. Cette forme de délinquance est plus précoce et plus violente. Je n'insisterai pas sur ce point, mais il est vrai que l'évolution profonde de celle-ci doit être prise en compte par le législateur.
Cette délinquance des mineurs n'est plus seulement celle d'un parcours individuel avec les difficultés liées à l'adolescence ou au milieu. Il s'agit d'une délinquance d'exclusion qui lance un véritable défi à l'ensemble des institutions. Les jeunes éprouvent incontestablement une aversion envers certaines valeurs ainsi qu'un sentiment de force et d'impunité.
En réalité, la délinquance juvénile est un phénomène non plus individuel mais collectif. Il s'agit non pas d'un passage difficile vers l'âge adulte mais d'un état permanent. C'est cette préoccupation qui doit nous guider pour essayer de trouver des solutions efficaces. Nous en connaissons les causes : les familles fragiles, le travail qui ne remplit plus sa fonction d'intégration, le manque de moyens de nos institutions.
Je n'insisterai pas davantage sur ce point, mais il me paraît intéressant de noter que les jeunes délinquants étaient, en 1945, des jeunes inadaptés, alors que ceux d'aujourd'hui sont parfaitement bien adaptés mais à la marginalité. C'est cette tendance qui me paraît très dangereuse et qu'il me semble important de prendre en compte.
Cela dit, il ne s'agit pas, à mes yeux, d'instaurer le « tout-répressif » après une période de « tout-éducatif » et inversement. Je ne pense pas que la solution réside dans une sorte d'alternance entre les deux systèmes qui coïnciderait peut-être avec une alternance politique. Il faut instaurer un équilibre entre les deux. Un texte sur la délinquance des mineurs n'a pas à établir une primauté. Il doit comprendre un volet éducatif et un volet répressif. Ce qui doit guider le juge, c'est tout simplement la gravité de l'acte commis et la personnalité du justiciable.
Cela dit, à tort ou à raison, l'ordonnance de 1945 est perçue comme un texte très permissif tant par l'opinion publique, ce qui ne me gêne pas trop, moi qui travaille dans la théorie et l'abstraction, que par les mineurs délinquants, ce qui est beaucoup plus préoccupant, d'autant que ce n'est pas toujours conforme à la réalité.
Incontestablement, nous avons assisté en 1945, pour des raisons historiques liées aux horreurs vécues à cette époque, à un grand élan de générosité et à une volonté éducative de réinsertion et de protection très forte. Or, j'ai l'impression -mais je ne suis pas un praticien- que l'ordonnance de 1945 a été appliquée, au cours de ces dernières années, de façon assez répressive, ce qui me préoccupe.
La plupart des mineurs délinquants continuent de penser que ce texte leur permet de bénéficier d'une certaine impunité, ce qui est très dangereux. En conséquence, il me semble très important d'envoyer un signal fort vers ceux qui s'apprêtent à sombrer dans la délinquance. Ils doivent savoir qu'ils vont commettre un acte grave et que les réponses peuvent être à la mesure de celui-ci.
En réalité, j'estime qu'il convient d'abroger l'ordonnance de 1945, mais il ne faut pas non plus se faire beaucoup d'illusions. Sur le plan de la technique juridique, un texte nouveau, aussi bon soit-il, ne sera pas forcément meilleur que l'ordonnance de 1945, rajeunie. Son intérêt serait beaucoup plus psychologique que juridique, mais il me paraît essentiel d'envoyer un signal et de donner des repères à ceux qui n'en ont plus.
Pour ne pas allonger les débats, je prendrai un exemple qui me paraît significatif, celui du principe de l'irresponsabilité pénale du mineur. Il s'agit d'une fiction totalement infantilisante qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est en ce sens qu'a été interprétée, depuis très longtemps, l'ordonnance de 1945. Ce principe me paraît très dangereux non seulement pour le mineur lui-même, qui cherche désespérément des repères et des points d'ancrage, mais aussi pour la société.
Il me semble donc judicieux d'abandonner ce principe au profit d'un autre concept qui serait celui de la responsabilité pénale atténuée. Il faut en effet parler de responsabilité pénale. Les jeunes délinquants doivent avoir conscience de la gravité de leurs actes, mais il faut aussi prendre en compte l'âge des intéressés. C'est pourquoi une responsabilité pénale atténuée me semble être une solution très intéressante.
Les jeunes délinquants sont d'ailleurs demandeurs de ce type de réponse. Il s'agit de personnes fragiles en voie de structuration. Il faut les aider en leur envoyant -j'insiste beaucoup sur ce point- des signes forts pour leur expliquer leur comportement, leur faire prendre conscience de la gravité de celui-ci et de la nécessité pour la société d'y apporter des réponses efficaces.
Outre la réponse judiciaire, qui est nécessaire mais très insuffisante, il faut une réponse sociale, qui peut être très vaste. Il ne faut toutefois pas tomber dans une sorte de théorie abstraite qui ne nous conduirait pas très loin. Il convient de mener un certain nombre d'actions sociales qui me paraissent importantes.
La prévention est un point important en droit pénal des mineurs. Il faut beaucoup s'intéresser à l'école, qui est souvent, malheureusement, le lieu de l'apprentissage de la violence. A cet égard, il faut mener une action très forte en enrayant, par exemple, la logique de l'échec scolaire. Mais, dans le même temps, ce n'est pas parce que quelqu'un a une très forte fièvre qu'il faut casser le thermomètre en se disant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Le passage automatique dans les classes supérieures n'est pas une très bonne mesure. Les élèves peinent à suivre parce qu'ils n'ont pas les acquis fondamentaux. Ils s'ennuient et, par la force des choses, perturbent leurs condisciples.
Il faut instaurer un lien très étroit entre la justice et l'école. L'idée d'un collège unique est très bonne en théorie mais elle aboutit, concrètement, à des situations assez catastrophiques parce que certains enfants ne sont pas adaptés à l'unique filière qui leur est proposée. La disparition des classes de transition a constitué une erreur. Ces classes doivent subsister sous une forme ou une autre, quitte à établir des passerelles. Il ne faut surtout pas que les élèves n'aient pas d'autre issue que cette filière-là.
L'apprentissage est une très bonne formule, mais il devrait commencer bien avant seize ans. A cet âge, comme vous le diront la plupart des employeurs, c'est beaucoup trop tard. Vous avez des jeunes qui se sont ennuyés pendant deux ans et qui ont pris de très mauvaises habitudes. Ils se sont enfoncés dans la marginalité et il n'est plus possible d'en tirer grand-chose.
Avoir jusqu'à seize ans une filière unique puis un apprentissage est une idée excellente, mais -et l'on n'en parle pas assez- c'est l'une des causes du racket. Des jeunes de quatorze ou quinze ans, qui s'ennuient à l'école, sombrent plus ou moins dans la marginalité. Ils ont besoin d'argent que leur famille ne peut leur procurer. Ils en demandent donc à ceux qui en ont dans l'établissement scolaire ou autour de celui-ci.
Si ces jeunes, au lieu de s'ennuyer pendant deux ans, partaient tout de suite en apprentissage et s'ils pouvaient recevoir un petit pécule en fonction du travail accompli, nous gagnerions sur les deux tableaux : d'une part, l'insertion dans la société serait beaucoup plus facile et, d'autre part, il n'y aurait plus ce risque de racket.
Ce racket classique se double d'un racket aux devoirs. L'élève de quatorze ou quinze ans qui s'ennuie dans sa filière, qui ne cherche même plus à comprendre tant il est dépassé, sera scolairement sanctionné - et c'est normal - s'il ne fait pas ses devoirs. Alors, tout simplement, il se tourne vers son voisin, bon élève un peu timide qui ne peut se rebeller, et lui demande une fois, deux fois, trois fois puis finalement lui impose de lui donner ses devoirs.
C'est aussi du racket et c'est aussi pourquoi il me semble absolument essentiel de diversifier les filières. Il faut trouver des solutions. Le collège unique mérite sans doute d'être réformé et l'entrée en apprentissage doit, à mon sens, intervenir beaucoup plus tôt.
Puis, dernière idée à laquelle je suis farouchement attaché, et je l'ai écrit à plusieurs reprises : la création d'internats urbains.
Il s'agit, bien évidemment, non pas de créer des bagnes, des maisons de correction ou des ghettos, mais un internat classique, comme celui que certains d'entre nous ont connu, dans les collèges des villes. C'est une nécessité absolue.
J'ai connu l'internat de la sixième jusqu'à la terminale, et j'en ai gardé un excellent souvenir. A l'époque qui était la mienne, l'internat se justifiait par l'éloignement géographique. Aujourd'hui, il a deux justifications : au mieux, l'éloignement affectif, les parents n'étant pas présents ou manquant de temps ; au pis, la proximité criminogène, car il est vrai que l'apprentissage de la violence se fait parfois dans la famille.
Ces internats ne recruteraient pas exclusivement, bien sûr, de jeunes délinquants. Ce seraient de vrais internats, accueillants, offrant diverses activités. En réalité, nombre de familles sont demandeuses : familles où les deux parents travaillent, familles monoparentales... De très nombreux parents ayant des difficultés à suivre ou à encadrer leurs enfants ne demanderaient pas mieux que des internats à proximité.
Enfin, une réponse judiciaire est nécessaire, mais elle doit être beaucoup plus moderne : il faut reprendre le flambeau des rédacteurs de l'ordonnance de 1945.
En 1945, on a fait preuve de pragmatisme et d'une certaine générosité ; on a aussi fait preuve d'anticipation. Il nous faut reprendre le flambeau, faire preuve d'imagination et anticiper pour trouver la réponse judiciaire adaptée.
Il ne faut cependant pas se polariser sur cette réponse judiciaire : elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Nous pouvons écrire une loi quasi parfaite et bâtir le meilleur système du monde, mais, si nous n'intervenons pas dans le domaine social, notamment à l'école, ce sera, je le crains, une perte de temps, et les conséquences seront absolument catastrophiques.
M. le président - Je suis très sensible au fait que vous ayez parlé de la nécessité de « reprendre le flambeau des rédacteurs de l'ordonnance de 1945 », expression qui traduit parfaitement l'importance de la tâche à laquelle nous sommes confrontés.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Monsieur Renucci, je vous remercie, pour ma part, de la clarté de votre exposé. Nous vous adresserons un questionnaire, mais, dès à présent, je souhaiterais savoir si les mesures que peuvent ordonner les tribunaux pour enfants vous paraissent suffisantes et, le cas échéant, quelles mesures complémentaires vous semblent nécessaires.
M. Jean-François Renucci - La gamme des mesures est, a priori , satisfaisante, même si d'autres réponses sont, bien sûr, envisageables. L'éventail est large entre mesures éducatives et mesures répressives.
Nous disposons donc des bons outils, mais peut-être leur utilisation n'est-elle pas suffisamment efficace.
Sans doute faudrait-il assurer -mais j'ignore quelles seraient les conséquences sur le plan pratique- une meilleure coordination entre la procédure d'assistance éducative et la procédure relative à l'enfance délinquante. Enfance délinquante et enfance en danger sont deux réalités très proches, parce que l'enfant en danger est souvent un futur délinquant qui peut devenir dangereux. Qu'une partie des dispositions applicables soit dans le code civil et le code de procédure civile, l'autre dans le code pénal et le code de procédure pénale, constitue peut-être une erreur.
Dans ma thèse sur l'enfance délinquante et l'enfance en danger, j'avais examiné les interférences entre ces deux séries de dispositions et je terminais en rêvant à un grand texte sur l'enfance qui regrouperait tout ce qui concerne aussi bien l'enfance délinquante que l'enfance en danger.
Cela étant dit, il ne faut pas non plus instaurer une sorte d'automatisme entre ces deux aspects, car, s'il est vrai que les enfants en danger deviennent souvent des délinquants, nombre d'entre eux, fort heureusement, ne le deviennent pas, ce qui démontre d'ailleurs l'intérêt de la procédure d'assistance éducative.
Le fait que je souhaitais voir regrouper dispositions relatives à l'enfance délinquante et dispositions relatives à l'enfance en danger dans un même texte répondait peut-être à un souci de confort intellectuel sur le plan théorique. L'intervention d'un même juge dans les deux cas doit en effet garantir une certaine unité.
Cependant, cette situation soulève peut-être une difficulté -la question s'est d'ailleurs déjà posée avec l'ordonnance de 1945, puisque le juge des enfants instruit et juge- au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article, qui consacre le droit à un procès équitable, insiste en effet beaucoup sur l'exigence d'impartialité du juge.
La situation est-elle conforme à la Convention européenne des droits de l'homme ? Il semble que oui puisque l'arrêt Nortier, qui, de mémoire, a été rendu en 1993 -cet arrêt concernait les Pays-Bas, mais leur système est sensiblement le même que le nôtre- paraît admettre la possibilité pour un même juge d'instruire et de juger une affaire.
Les juges européens n'en sont pas moins de plus en plus sensibles aux apparences quand il s'agit de statuer sur l'impartialité. Or, ce juge qui instruit et juge les affaires des mineurs tout en ayant la charge de l'assistance éducative peut très bien avoir vu trois fois un même mineur, une fois pour la procédure civile, deux fois pour la procédure pénale.
Il y a incontestablement là une difficulté sur laquelle il faut sans doute mener plus loin la réflexion, d'autant que la convention européenne des droits de l'homme est un traité international et a donc, vous le savez comme moi, une force supra-législative. Le juge doit écarter les dispositions de droit interne si, d'aventure, elles n'y sont pas conformes.
M. le rapporteur - Vous avez dit qu'il fallait se méfier d'une justice trop hâtive, et plus encore s'agissant de mineurs. Mais, sur le terrain, on constate que certaines affaires se prolongent dans le temps, ce qui n'est sain pour personne.
M. Jean-François Renucci - Il est évident qu'une justice trop lente est une mauvaise chose pour les majeurs et une plus mauvaise chose encore pour les mineurs.
J'ai interrogé des mineurs jugés pour des infractions qu'ils avaient commises longtemps auparavant : ils ont souvent l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre.
Il faut donc agir très vite et même le plus vite possible, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Des astuces procédurales pour que les choses aillent vite et bien doivent être trouvées.
Je crois cependant que le temps de la procédure n'est pas inutile, y compris pour les mineurs, parce que cela crée une sorte de choc psychologique qui peut être bénéfique.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la médiation-réparation est une mesure à laquelle j'ai toujours été assez hostile. C'est peut-être une bonne idée, mais j'ai le sentiment qu'en définitive c'est avant tout un moyen de gérer la pénurie de magistrats !
Voilà le problème ! Il faut gérer la situation telle qu'elle est et ne pas se retrancher derrière des préoccupations purement théoriques, mais il est évident que l'on ne peut pas ouvrir les portes de l'ENM à un recrutement massif. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai fait partie cette année du jury pour les trois concours. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas retenir des candidats en trop grand nombre, sauf à abaisser le niveau et à recruter des magistrats qui ne seront pas opérationnels.
En tout état de cause, je crois qu'il faut faire preuve d'une certaine générosité en même temps que d'une certaine fermeté parce qu'il faut envoyer des signaux très clairs aux jeunes délinquants.
Je crois aussi qu'il faut faire preuve d'un très grand pragmatisme. C'est finalement le véritable enjeu : il faut trouver les solutions les plus efficaces. Ce ne sera pas facile, mais, avec beaucoup de bonne volonté, on pourra sans doute y parvenir en gardant les pieds sur terre.
M. Bernard Plasait - Envoyer un signe fort aux mineurs me paraît en effet très important. Vous souligniez tout à l'heure que les mineurs ont une impression d'impunité, alors même que la pratique de l'ordonnance de 1945 est de plus en plus répressive. C'est sans doute pourquoi on sent monter une demande en faveur de sanctions plus fortes.
Pour envoyer ce signe fort, vous envisagiez une modification de l'ordonnance de 1945 ou la rédaction d'un nouveau texte. Vous avez parlé de « responsabilité pénale atténuée ». Pourriez-vous en dire davantage sur cette notion ?
Un juge des enfants nous racontait la semaine dernière s'être entendu dire par un mineur : « De toute façon, tu ne peux pas me mettre en prison ! » Parmi les modifications qui peuvent être apportées à l'ordonnance de 1945, ne faudrait-il pas, pour lutter contre ce sentiment d'impunité, prévoir un abaissement des seuils ?
M. Jean-François Renucci - Absolument, et ces questions sont très importantes.
J'ajoute que la réponse à ce sentiment d'impunité ne réside pas nécessairement dans des sanctions toujours plus fortes. Je parlais tout à l'heure d'une inversion des valeurs. Elle est réelle et il y a parfois chez les mineurs un rapport à la violence absolument ahurissant. Nous avons affaire à des mineurs qui sont, ou disent être, dans des situations de violence extrêmes, y compris à la maison. Dès lors, la notion de fermeté de la sanction devient très relative. Une sanction très ferme pour mon fils qui grandit dans un certain cadre est une chose ; c'en est une autre pour un mineur qui assiste habituellement à des actes de violence, voire les subit physiquement.
C'est la raison pour laquelle l'apprentissage à la citoyenneté est une nécessité. Il faut faire un travail en amont, en particulier à l'école, pour ramener ces jeunes à la réalité.
Aujourd'hui, je ne suis pas certain, au vu des dérives auxquelles on peut assister, que le langage que nous employons à leur égard ait une quelconque portée et que les mots que nous utilisons aient le même sens.
Il faut donc non pas plus de fermeté mais une fermeté comprise, ce qui implique, j'y insiste, qu'il faut agir en amont. Sans quoi, on ne se comprend pas et je crains que de ce fait les jeunes ne prennent pas les institutions très au sérieux !
On ne parle plus le même langage.
M. le président - Comment parler le même langage ?
M. Jean-François Renucci - C'est un travail de longue haleine qu'il faut commencer avec les plus jeunes. L'idée importante, c'est sans doute celle-là.
Je ne dirai pas qu'il n'y a plus rien à faire avec un jeune qui, à seize ou à dix-sept ans, est fortement enraciné dans la délinquance, d'une part, parce qu'il ne faut jamais désespérer de la nature humaine, d'autre part, parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer à agir, mais en ayant conscience du fait que les solutions seront limitées.
En revanche, il faut « mettre le paquet » au collège pour que les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont entre onze et quatorze ans, réapprennent les vraies valeurs et la citoyenneté.
C'est encore une des raisons pour lesquelles je crois aux internats. Un jeune qui commence à « déraper » trouvera dans un internat la structure qui, malheureusement, fait défaut dans sa famille. Que ce soit parce que la famille est totalement déstructurée ou à cause de la vie moderne, si les enfants sont laissés à eux-mêmes et « traînent », il est rare que les conséquences soient heureuses.
Agir parmi les plus jeunes est une façon de couper le recrutement des bandes de délinquants. C'est un impératif.
M. le président - Je vous remercie, Monsieur Renucci.
Audition de Mme Marylise LEBRANCHU,
Garde des sceaux, ministre de la
justice
(20 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Madame la ministre, vous avez la parole.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Vous avez choisi d'enquêter sur un sujet d'actualité. C'est aussi un sujet de fond qui touche à l'équilibre de notre société.
Personne ne nie l'existence d'une délinquance des mineurs. Elle interpelle chacun de nous et les pouvoirs publics en particulier.
Dans le même temps, il faut récuser tout discours qui, en prônant, par imitation ou par facilité, la tolérance zéro prêche souvent pour l'intolérance totale, c'est-à-dire au fond pour l'éclatement de la solidarité collective.
C'est dans cet état d'esprit que j'interviens.
Concrètement, ce gouvernement s'est en effet attaché à privilégier l'écoute et le dialogue avec ceux qui, au quotidien, ont à faire face à cette délinquance et à y répondre, qu'il s'agisse d'abord des victimes -le dépôt de plainte a été facilité et on a renforcé le soutien et l'aide, même si des progrès peuvent encore être faits- ou qu'il s'agisse des parents, des enseignants, des éducateurs, des policiers, ou encore des élus locaux, notamment avec la mise en place des contrats locaux de sécurité.
Pour tout le monde, la délinquance des mineurs est un problème réel. Je vous sais passionnés par le sujet. Sachez que le Gouvernement n'a jamais minimisé l'importance de la question, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là. C'est une question dont le traitement est essentiel, dans l'immédiat mais aussi pour l'avenir.
Pour autant, quand on examine les évolutions de la délinquance, on constate que la part des mineurs dans l'ensemble des actes de délinquance reste limitée et stable.
Cette délinquance a des terrains d'action privilégiés. Ce sont souvent les transports, les centres commerciaux, les écoles et les cités. On voit bien qu'il s'agit d'une délinquance de proximité, d'une violence à l'égard de ce qui est la fois familier et étranger. A cela viennent s'ajouter des affrontements avec tous ceux qui représentent l'autorité -les policiers, mais aussi les pompiers- et qui deviennent malgré eux le symbole pour ces jeunes de l'injustice qui leur est faite : injustice de la vie, injustice d'une société trop inégalitaire, injustice d'une collectivité qui montre du doigt sans chercher à voir ses propres torts, d'où une spirale de victimisation.
Nous nous sommes donné pour objectif la reconstruction d'une confiance collective dans la capacité de notre société à éduquer et à accompagner ces adolescents vers une autre perspective que celle de la violence.
Une action qui aurait pour effet de renforcer les causes mêmes de cette violence ne peut être valable. C'est la raison pour laquelle les propositions qui ne visent qu'à punir ceux qui s'estiment déjà punis par la vie sont vouées au mieux à l'échec, au pis à faire naître plus de violence encore, comme le démontre un travail, mené sur plusieurs mois, sur les origines de la violence.
Pour autant, et j'y ai toujours insisté, il ne s'agit pas de ne pas apporter de réponse judiciaire à des actes délinquants. Je veux d'ailleurs rappeler à ce sujet quelques données objectives.
La réponse de l'autorité judiciaire aux infractions commises par les mineurs n'a jamais été aussi forte que depuis 1997. Le taux de réponses pénales atteint 80 % et les peines prononcées sont de plus en plus lourdes. Le nombre de mineurs incarcérés reste ainsi très élevé : il était de 895 au 1 er mars 2002. Il a d'ailleurs sensiblement augmenté dans les derniers mois. A Fleury-Mérogis en particulier, les capacités d'accueil sont dépassées.
L'incarcération n'est cependant pas la seule réponse proposée.
Les mesures alternatives prennent -tant mieux- de l'ampleur. Les mesures dites de réparation, notamment, se sont fortement multipliées : 15.000 mesures ont été effectuées en 2000.
Pour récuser l'accusation selon laquelle la justice serait trop lente et interviendrait trop tardivement après les faits, je veux souligner que les mineurs sont au contraire le plus souvent convoqués devant le juge au moyen de procédures rapides.
A la suite du rapport Lazerges-Balduick, le Gouvernement a décidé de créer de nouvelles structures d'hébergement des mineurs délinquants, permettant des séjours de rupture. Ainsi, 51 centres d'éducation renforcés sont ouverts aujourd'hui et 87 devraient l'être à la fin du 1 er semestre 2002, mais ce sera peut-être 86, car nous rencontrons à Agde une forte opposition que, très honnêtement, je ne comprends pas. Quant aux centres de placement immédiat, 43 sont ouverts aujourd'hui et 50 le seront en septembre 2002.
Ces centres ont fait leurs preuves. Là encore, des résultats commencent à être mesurés même si on reste prudent. La meilleure preuve de l'efficacité de ces structures -la seule valable au fond pour la collectivité et pour sa sécurité- se retrouve dans le taux de récidive constaté à la sortie tant des CER que des CPI, taux qui est sans rapport aucun avec le taux de récidive après une incarcération puisqu'il est de 10 % pour les mineurs sortant d'un CPI ou d'un CER contre 60 % pour les mineurs sortant de prison, même si de gros efforts sont faits, par exemple à Fleury-Mérogis.
Une autre spécificité de l'action de ce gouvernement est d'avoir misé sur la coopération des acteurs et sur la proximité pour obtenir le meilleur résultat, même si dans quelques régions l'absence d'acteurs de proximité a posé d'autres types de problèmes.
Si nous avons créé, dès 1997, les contrats locaux de sécurité, c'est précisément afin de renforcer, grâce à cette structure, l'implication à l'échelon local des différents acteurs de la prévention et de la sécurité.
L'analyse des chiffres de la délinquance département par département -ce sont ces chiffres qu'il faut examiner- montre ainsi que, lorsqu'une véritable politique judiciaire de la ville est menée et que les acteurs agissent de façon coordonnée en ayant su développer un éventail important de réponses -mesures de réparation, CER, CPI-, la délinquance augmente peu ou recule.
C'est notamment le cas dans la région Rhône-Alpes, où 57 contrats locaux de sécurité ont été signés alors que 20 autres sont en cours d'élaboration. Ainsi, les communes de Pierre-Bénite, Sainte-Foy, Vaulx-en-Velin et Villefranche-sur-Saône, qui ont toutes signé un contrat local de sécurité, connaissent une baisse de la délinquance comprise entre 5 % et 10 %. De même, l'exemple du département de la Loire, avec, en 2001, une délinquance à la baisse de 4,28 %, mérite d'être signalé.
J'ajoute deux cas pour lesquels on ne dispose pas de chiffres aussi précis mais qui sont intéressants parce qu'ils se situent en grande agglomération : Tourcoing, où, en dépit des licenciements, on assiste à une stabilisation du chiffre, et Aubervilliers, où le rapport avec les communes voisines est très fort. Il faudra étudier mois après mois et sur plusieurs années l'évolution de ces secteurs.
Malheureusement, tous ces bons résultats ne sont pas connus tant le sentiment d'impuissance est fort et semble vouer a priori à l'échec toute tentative de traitement de la délinquance des mineurs, quelle qu'elle soit. Même si les expériences positives sont très nombreuses, elles sont considérées comme anecdotiques, voire suspectes, alors que le moindre incident trouve une résonance immédiate.
Nous sommes confrontés à un problème de traitement médiatique et plusieurs maires se plaignent d'ailleurs que soit mis en exergue l'échec qu'a pu connaître leur commune, alors que les cas dans lesquels des résultats satisfaisants ont été obtenus ne sont pas mis en valeur.
J'en viens à l'ordonnance de 1945 : la réforme ne doit pas être un tabou.
Le texte initial de cette ordonnance, qui est un grand texte, a en fait déjà été modifié seize fois, la dernière à fin de l'année 2000. Sur les 49 articles qui forment aujourd'hui ce que l'on appelle l'ordonnance de 1945, seuls trois sont d'origine.
En réalité, c'est un texte moderne qui a été enrichi au fil de ses modifications.
Techniquement performant, il met en oeuvre un principe de responsabilité pour tous les mineurs, gradué, bien sûr, selon leur âge. Il recommande uniquement au juge de privilégier les mesures éducatives sur les mesures répressives, sans interdire toutefois le recours à l'incarcération, au cas par cas et quand les démarches éducatives engagées au bénéfice d'un enfant ont épuisé leurs effets.
Ce qui importe, c'est de maintenir les principes fondamentaux sur lesquels repose le droit des mineurs : éduquer avant de sanctionner et sanctionner moins sévèrement les mineurs que les majeurs. Or, ne disait-on pas, au détour d'une récente rencontre dans vos murs, que les sanctions actuellement prononcées à l'encontre des mineurs sont, toute proportion gardée, plus lourdes que les sanctions prononcées à l'encontre des majeurs ?
Dans la vie quotidienne, il ne viendrait à l'idée de personne d'exiger d'un enfant un comportement comparable à celui d'un adulte. Tel est le fondement de la différence admise par tous entre une personne mineure et une personne majeure.
Il est un point sur lequel nous n'avons jamais varié : toute infraction doit donner lieu à une sanction. C'est essentiel si nous voulons préserver le lien social et donner à chacun l'assurance de pouvoir agir et vivre en toute liberté et en toute sécurité.
En revanche, un système dans lequel le niveau de sanction serait déterminé de façon mécanique et inéluctable, sans tenir compte de la diversité des parcours et de la personnalité des délinquants, ne serait pas acceptable.
Plutôt que de recourir à des slogans, il faut enrichir les actions engagées. Les mesures mises en place depuis cinq ans commencent à porter leurs fruits, même si elles sont insuffisantes. J'ai ainsi pu rencontrer des jeunes placés dans un CPI à Collonges-au-Mont-d'Or ainsi que l'équipe chargée de les accueillir et de les prendre en charge. Je sais, et on me le dit aussi, que ces jeunes ont plus de chance d'échapper au cycle de la délinquance que ceux, du même âge ou à peine plus âgés, qui sont aujourd'hui incarcérés.
C'est pourquoi il faut favoriser non pas une action limitée à la répression, voire à une prévention trop tardive, mais tout un éventail de mesures qui doivent couvrir le plus largement possible, dans le temps et dans l'espace, le champ où se développent et s'entretiennent les comportements délinquants.
Cinq axes doivent être retenus pour l'avenir. Le premier consiste à mettre en place de nouveaux modes de prévention. Nous devons intervenir très en amont, bien plus encore que nous ne le faisons aujourd'hui. Il faut notamment s'intéresser aux enfants de moins de dix ans pour prendre en charge ceux qu'on appelle les « enfants agressifs » avant qu'ils basculent dans la violence délinquante. Ces comportements, nous savons aujourd'hui les repérer, à l'école en particulier, lieu de passage obligé pour tous les enfants.
Il faut créer des centres de jour, lieux d'accueil après l'école ou pendant les congés scolaires, dans lesquels seraient dispensés soutien scolaire et prise en charge éducative. Dans cet ordre d'idées, il faut aussi développer des internats nouveaux ajoutant à l'enseignement un véritable soutien éducatif. Le recours à l'internat bien expliqué aux parents, aux enfants et aux éducateurs est une forme de rupture bien acceptée car elle permet de conserver les liens familiaux.
En clair, l'école a un rôle actif et privilégié dans la détection et l'aide à la prise en charge de l'enfance en danger. J'ai coutume de dire que nous sommes assez bons en ces domaines. Je pense notamment à l'action menée en liaison avec les conseils généraux. Mais nous sommes très en deçà de ce qu'il faudrait faire pour les enfants agressifs. Philippe Jeammet se plaît à se battre en faveur de solutions de rupture en créant, par exemple, certaines places dans des instituts de rééducation qui ont l'habitude de s'occuper de ce type d'enfants et qui parviennent parfois à les sortir de situations jugées insolubles.
Le deuxième axe est l'amélioration du taux d'élucidation. La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie publique dont le taux d'élucidation reste malheureusement inférieur à 8 %. Ce constat, qui n'est évidemment pas acceptable, montre la nécessaire spécificité de la lutte contre ce type de délinquance.
Le désarroi de l'opinion est d'ailleurs à la mesure de cette contradiction : tout le monde connaît les auteurs des infractions, sauf les policiers et les magistrats. Cette situation est d'autant plus mal vécue par la population que la délinquance des mineurs est très territorialisée puisqu'elle s'exerce quasiment exclusivement dans des lieux publics bien définis. C'est la répétition, dans ces lieux, d'une délinquance apparemment sans réponse qui donne l'image d'un Etat impuissant. J'ai lu le compte rendu de conversations téléphoniques avec les commerçants d'un centre commercial de la région nantaise qui décrivaient des actes de délinquance répétitifs.
Pour augmenter ce taux d'élucidation encore trop faible, il faut améliorer la transmission des informations entre les services de police, comme l'avaient prévu les protocoles entre directions qui accompagnaient la création de la police de proximité.
Plus encore, le travail en commun des policiers et des éducateurs avec les interlocuteurs que sont les sociétés de transports en commun, les bailleurs, les chefs d'établissement scolaire et les organisations de commerçants doit être renforcé afin de mettre en place des modalités d'intervention rapide sur les lieux spécifiques à la délinquance des mineurs. Il ne s'agit pas de délation, contrairement à ce que prétendent certains, mais il faut mettre fin à ce type de délinquance tout en protégeant ces jeunes.
Le troisième axe consiste à renforcer la cohérence, l'organisation et l'efficacité du système. La lutte contre cette délinquance et l'amélioration sensible de sa prévention passent par une meilleure articulation entre tous les acteurs intervenant en ce domaine, à savoir les juges, les policiers et les éducateurs mais aussi les services fiscaux ou douaniers, notamment dans le cadre d'actions ciblées, telles que la lutte contre les trafics, les bandes et l'économie souterraine.
Cette lutte et cette amélioration passent également par une meilleure coordination de la justice des mineurs, qu'il s'agisse du juge des enfants, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, des services pénitentiaires ou des établissements habilités. Je viens de diffuser une circulaire en ce sens. Mais cela ne suffit pas. Je veux insister sur la place et la nécessaire implication dans cette démarche des élus locaux. Il faut associer les maires à la lutte contre la délinquance. En revanche, le prononcé des sanctions doit rester de la responsabilité de l'institution judiciaire.
Il faut donner une place importante aux lieux de réparation et les adapter à la délinquance et au territoire que le maire connaît bien. C'est là que s'équilibreront la délinquance et la déstabilisation qu'elle engendre.
Le quatrième axe tend à assurer l'immédiateté de la sanction. Nous avons fait accepter l'idée que toute infraction doit engendrer une sanction, quelle qu'en soit la forme. Mais encore faut-il que cette sanction soit rapide et visible. J'ai dit en souriant à l'un de vos collègues de l'Assemblée nationale que je refusais le port de l'uniforme pour les enfants délinquants en situation de réparation. La question de l'exécution des peines est l'un des problèmes les plus difficiles auxquels est confrontée la justice.
Pour améliorer sensiblement la situation en ce domaine et faire qu'une peine prononcée soit aussi une peine exécutée, nous devons mettre en place un programme très vigoureux de mobilisation des moyens et des acteurs. Parmi les points prioritaires de ce programme figurent l'accroissement du nombre d'éducateurs en milieu ouvert -nous manquons cruellement de ce type de personnel même si un effort budgétaire a été engagé- un nouveau programme de création de CPI, de CER et de foyers -en dépit des réalisations en cours, leur nombre est insuffisant- la mobilisation des collectivités territoriales et du secteur associatif pour développer des mesures de réparation et de travail d'intérêt général pour ceux qui le souhaitent, le développement des centres de jour et, bien entendu, la mise en place d'instruments de suivi de l'exécution des peines afin d'être en mesure de déceler et de gérer efficacement les pénuries de moyens là où elles existent.
Le rapport d'activités pour l'année 2000 a montré que nous étions capables maintenant d'avoir des éléments d'évaluation qui permettent de pointer les dysfonctionnements et de mettre l'accent sur les moyens nécessaires.
Le cinquième axe consiste à organiser l'accompagnement des victimes tout au long de la procédure. Cet accompagnement, selon les associations, est mal assuré. Dans les milieux fermés que sont les cités de banlieue ou dans certaines communes périurbaines, porter plainte c'est demander l'application de la loi commune en refusant la loi du silence. Il s'agit non seulement d'un acte engagé à la fois pour soi-même ou un proche et la société dans son ensemble mais aussi d'un risque personnel.
A ce risque ne répond aucune prise en charge particulière au point que les victimes sont parfois violentées par les amis des mis en cause jusque dans le hall des tribunaux. Nous avons pu constater à Evreux à quelle tragédie les victimes peuvent être confrontées. Cette situation de faiblesse, d'abandon de ces dernières contribue à la dégradation de l'image de l'Etat.
Nous pouvons aussi faire reculer la délinquance en aidant les victimes par un soutien et une protection collective. C'est lorsqu'un individu paraît isolé, impuissant et sans recours qu'il devient une victime possible et, pour ainsi dire, sans risque pour le délinquant.
Certaines mesures permettent de remédier à cet état de faiblesse. Elles consistent, par exemple, à mettre en place des policiers référents qui seraient contactés en cas de menace, à inciter les associations d'aide aux victimes à servir de relais entre les institutions et ces dernières lorsqu'elles sont soumises à des pressions ou encore à veiller à ce que la justice sanctionne plus souvent et plus sévèrement les subornations de témoins. Les associations de victimes en sont d'accord.
En conclusion, vous le voyez, nous ne sommes pas démunis, loin de là, face à la délinquance des mineurs. Dans ce domaine qui engage à la fois l'avenir et la confiance collective, nous ne pouvons pas agir sans perspective ni continuité.
La France est un pays véritablement moderne lorsque, ensemble, nous refusons la tentation du spectaculaire, de l'image forte et facile pour privilégier le travail de fond et sur la durée. En choisissant de ne jamais oublier la dimension humaine qu'il y a en chacun, jeune enfant agressif, adolescent violent, victime fragile ou coupable avéré, nous restons fidèles à des principes essentiels pour une démocratie, principes qui conseillent de choisir la voie de la sagesse confiante plutôt que celle de la vaine passion.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - La sanction, avez-vous dit, doit être rapide. Or, selon les statistiques que nous ont communiquées vos services, le nombre de mineurs par juge des enfants s'élève à 38.300 avec de grandes disparités. Ce chiffre varie, en effet, d'un peu plus de 14.000 à 76.000. Ne faudrait-il pas revoir la localisation de ces juges à l'instar de ce qui se passe pour les commissariats de police ?
Mme le garde des sceaux - Nous allons créer quinze juridictions. Mais nous constatons malheureusement de plus en plus un essaimage de la délinquance. Celle-ci apparaît dans des zones très rurales qui ne connaissaient pas ce phénomène voilà cinq ou six ans. Il ne faut donc pas démunir certaines zones. Ce dispositif ne sera pas suffisant pour couvrir le territoire.
A deux reprises, je m'étais engagée, devant l'Assemblée générale des juges des enfants, à augmenter le nombre de ces magistrats, ce que j'ai fait. J'ai également, à leur demande, refusé de supprimer les parquets spécialisés. C'est important s'agissant de la mise en réseau des informations.
Je n'ai pas pu résoudre le problème de l'absence de candidature pour Epinal et Sarreguemines. Il faut être très prudent s'agissant notamment de nomination à des postes assez sensibles. Là, je n'ai pas trouvé de candidats capables de prendre en charge ces fonctions. Nous avons créé vingt postes en 1998, 10 en 1999, 17 en 2000, 20 en 2001 et 25 en 2002.
J'ai décidé de renforcer les parquets puisqu'il existe un véritable déficit en matière d'application des peines et de suivi. J'ai essayé de ne pas déséquilibrer les nominations. Les juges des enfants sont satisfaits d'avoir affaire à une personne qui s'occupe particulièrement des problèmes des mineurs.
M. le rapporteur - Vous avez manifesté la volonté d'aborder les problèmes en amont. Vous avez parlé de centres de jour et d'internats nouveaux. Quel est le chef de file ?
Mme le garde des sceaux - En la matière, il faut une coordination entre tous les services, notamment au sein des conseils généraux. Je m'y suis engagée auprès du président de l'Assemblée des présidents de conseils généraux.
S'agissant des établissements médico-sociaux, il existe une disparité très importante dans la prise en charge des enfants qui ont des comportements difficiles et qui sont signalés soit par les PMI, soit par l'Education nationale.
Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Education nationale sur le traitement des signalements. La mobilisation est en effet un point fort. Les enseignants mais aussi les garderies et les haltes-garderies sont des partenaires privilégiés. Ces enfants, qui sont parfois très jeunes, ont, nous dit-on, un comportement difficile non pas dans la classe où existe une forme d'autorité incarnée par l'éducateur mais le plus souvent après celle-ci dans les garderies ou les haltes-garderies qui sont des lieux plus ludiques.
La PJJ peut et doit être impliquée. L'absence totale d'associations qui créent ce type d'établissement ou de centre d'accueil nous pose problème. Ce n'est pas à nous d'interférer en ce domaine. Nous sommes dans une situation d'appel collectif à projet. Il faut assurer une véritable coordination avec les conseils généraux, le ministère délégué à la santé et celui de l'Education nationale.
M. Jean-Jacques Hyest - Au sein de l'Education nationale, ce sont souvent les CDES qui placent les enfants.
Mme le garde des sceaux - Ces commissions se réunissent avec l'ensemble des parties prenantes et peuvent décider un placement. Mais encore faut-il qu'il existe un lieu approprié pour les tout-petits. Nous en avons débattu avec des élus et des éducateurs. Même si une CDES prenait une décision de placement, il n'y a pas de place disponible. Il faudrait créer des établissements. Nous sommes, en outre, confrontés à un véritable problème de répartition sur le territoire.
Je suis favorable aux séjours de rupture pour les tout-petits. Après avoir fait un tour de France de la situation actuelle et après en avoir débattu avec M. Jeammet, je suis également favorable aux contrats passés avec les instituts de rééducation qui sont gérés en parallèle avec les IME et les IMPRO et qui disposent d'un certain nombre de places en internat à plein temps pour une durée d'un an pour les enfants en très grandes difficultés.
Les enfants arrivent à s'en sortir assez bien parce qu'ils ne sont pas éloignés de leur famille. Ils peuvent maintenir un lien familial en rentrant chez eux le mercredi et éventuellement le week-end. Par ailleurs, les éducateurs qui les raccompagnent chez eux et qui vont les rechercher peuvent apprécier le comportement des familles. Voilà qui me paraît un élément de réponse.
M. Jean-Jacques Hyest - Vous devez coordonner votre action avec celle du ministère délégué à la santé qui ferme des lits en permanence.
Il faut, avez-vous dit, créer des centres de jour, ce que la PJJ a fait pendant vingt ans.
Mme le garde des sceaux - Certes, il faut créer de tels centres sous diverses formes, mais aussi des places à temps plein dans le cadre des séjours de rupture. Cette question ne relève pas de ma compétence. Peut-être faudrait-il augmenter les cotisations de sécurité sociale ? Il s'agit d'un vaste débat. Sommes-nous prêts à financer une politique de prévention active ? Nous avons vu les conséquences qui ont découlé de l'absence d'une telle politique dans certains grands pays, comme la Grande-Bretagne.
M. le rapporteur - S'agissant des CER et des CPI, avez-vous aujourd'hui assez de recul pour dresser un bilan ? Nous avons appris que le centre du Havre avait provisoirement fermé ses portes. Ces établissements ont-ils des difficultés de fonctionnement ?
Mme le garde des sceaux - Nous comptons quelques cas de fermeture provisoire de centres de ce type dus à des phénomènes de violence. Tel a été le cas au CPI de Montpellier. Sans entrer dans un quelconque esprit de polémique, certains centres créés avant 1981 ont été fermés pour des raisons de violence. Il en est de même des centres Toubon, dont certains avaient été confiés à des associations. La seule solution pour résoudre le problème réside dans des effectifs plus nombreux. Les associations s'étaient engagées en ce domaine sans prendre en compte ce paramètre.
Nous avons toutefois trouvé des solutions à chaque fermeture d'établissement. Je ne me souviens pas d'avoir connu d'échec à long terme. Rappelons que les CPI sont destinés à des jeunes qui sont en grandes difficultés. Ils ne s'y rendent pas volontairement. Il s'agit d'un placement autoritaire auprès d'une équipe pluridisciplinaire qui va essayer de trouver une solution, laquelle peut-être un placement en CER, voire, s'il y a lieu, en prison.
Le bilan que nous avons dressé -je suis très prudente car nous avons un recul de moins de trois ans- montre une chute du taux de récidive. Voilà qui nous conforte dans l'idée que nous devons poursuivre dans cette voie. Les problèmes auxquels nous nous heurtons tiennent en fait plus à l'absence de place qu'à une demande de fermeture de ces centres.
L'autre problème réside dans la difficulté d'ouvrir de tels établissements. Lorsque je suis allée signer une convention avec le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres afin d'ouvrir un centre accueillant six à huit jeunes encadrés par onze personnes, je me suis heurtée à une manifestation de quelque 1.300 personnes contre la délinquance. Or, les délinquants de ce type sont majoritairement dans la rue. Il serait préférable qu'ils soient encadrés dans ces centres vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Un document vous a été remis détaillant le nombre d'enfants concernés et leur profil. Il est intéressant parce qu'il montre bien tout ce qui est lié à l'enfant délinquant. En 2001, 1.300 mineurs étaient accueillis dans des CPI et 520 dans des CER. Nous sommes prudents mais confiants. Visiblement, le dispositif fonctionne. Nous constatons que même les médias prennent la peine de l'évoquer. J'en veux pour preuve l'implantation en Bretagne d'un centre qui n'a posé aucun problème.
Je confirme d'ailleurs à votre commission d'enquête ce que j'ai dit au moment de l'examen du budget : le problème majeur est que, sans recrutements exceptionnels, ces structures -et j'en avais discuté avec Michel Sapin, ministre de la fonction publique, à propos de leur mise en place- fonctionneront bien en Bretagne, dans le Sud de la France ou dans les régions montagneuses, c'est-à-dire là où les gens ont envie d'aller, mais elles ne fonctionneront pas là où elles sont absolument nécessaires, d'où l'intérêt des postes de recrutement régional interne.
M. Jean-Jacques Hyest - Cela tient-il au manque de formation ?
Mme le garde des sceaux - Non, cela tient au fait que, dans notre fonction publique, l'ancienneté donne la priorité pour les mutations. Comme à Paris et en région parisienne les loyers sont deux fois plus chers qu'ailleurs et que les salaires ne compensent pas suffisamment la différence, les « expatriés » essaient souvent de revenir dans leur région d'origine dès qu'ils ont l'ancienneté nécessaire. Ils partent donc lorsqu'ils commencent à avoir une bonne expérience et sont remplacés par les plus jeunes.
M. Jean-Jacques Hyest. Disposer de gens expérimentés est un problème dans tous les secteurs, y compris dans la magistrature.
Mme le garde des sceaux - Eh oui ! C'est pourquoi je m'attriste de ce que Sarreguemines ou Epinal aient, ce matin encore pour la nomination d'auditeurs de justice, été choisis par défaut. Paris, pour un jeune auditeur, c'est la voie royale. Pour ma part, j'estime au contraire qu'il n'y a pas de mauvais territoire dans notre pays et que l'on peut faire une belle carrière partout. J'avais d'ailleurs proposé que les magistrats les plus « gradés » puissent être affectés dans les plus petits tribunaux en fin de carrière afin de démontrer que beaux titres et fonctions ne sont pas forcément la même chose.
M. le président - Et vous n'avez pas eu de réponse ! (Sourires.)
Mme le garde des sceaux - Certains magistrats ont tout de même trouvé que la question soulevée était intéressante et reconnu que la pyramide des carrières ne devait pas être une pyramide géographique. Il me semble de surcroît que Paris n'est pas le lieu idéal pour la préretraite.
M. Jacques Mahéas - On analyse souvent les conséquences plus que les causes de la délinquance.
A la suite des diverses affaires de moeurs et, notamment, de pédophilie, le ministère de la famille s'est récemment attaqué à la diffusion absolument anormale à la télévision d'images dont l'effet d'entraînement est évident.
Le ministère de la justice peut-il porter plainte contre la diffusion de la violence dans les images, dans les jeux vidéo mis sur le marché, dans nombre lieux de « contre-éducation » que je ne pourrais citer tant il y en a dans notre société ? C'est d'ailleurs ce qui la différencie de la société d'il y a trente ans : les lieux d'éducation sont remplacés par des lieux de « contre-éducation » essentiellement basés sur l'argent. Dans nos banlieues, les jeunes ouvrent des yeux étonnés devant les transferts de footballeurs...
Par ailleurs, ma municipalité a, comme d'autres, voulu mettre en place des travaux d'intérêt général, dispositif qui ne vise d'ailleurs pas les seuls mineurs. J'avais l'intention de former cinquante employés de mairie, mais nous n'avons en moyenne que deux TIG. Aucune peine, ou presque, n'est prononcée et les choses n'ont pas été simples : dans un premier temps par exemple, on ne voulait pas nous envoyer de délinquants de notre ville par crainte que nous ne les humiliions ! Or, notre but, c'est de les réinsérer. Les TIG seront-ils vraiment utilisés un jour par les tribunaux ?
J'ai eu une expérience similaire avec les centres éducatifs renforcés : j'étais volontaire pour la création d'un CER à condition qu'il ne soit pas géré par le milieu associatif, ce qui, selon le préfet, était impossible. Cela ne s'est donc pas fait, alors que nous sommes en Seine-Saint-Denis.
Dernière question : un effort particulier va-t-il enfin être consenti en faveur de la formation des éducateurs ?
Il y a une bonne volonté politique. Cependant, les éducateurs s'impliquent essentiellement dans des actions éducatives déjà menées à l'échelon de la commune, par exemple l'aide aux devoirs. Ce n'est pas ce que les élus locaux attendent. Aujourd'hui, on leur demande de s'introduire dans les bandes pour faire éclater celles-ci de façon intelligente. C'est essentiel parce que les bandes décuplent la délinquance. Les jeunes délinquants n'existent en effet qu'en fonction d'elles.
Mme le garde des sceaux - S'agissant des TIG, vous n'êtes pas le premier maire à soulever le problème. Je ne pense pas qu'une longue circulaire de politique pénale soit nécessaire mais peut-être faudra-t-il rappeler leur utilité et engager une étude, par exemple pour recenser les mairies qui ont fait un effort.
M. le président - Je confirme les propos de M. Mahéas : en quinze ans, je n'ai eu qu'un cas.
Mme le garde des sceaux - En revanche, dans le Val-d'Oise, on recherche désespérément des places. Certains magistrats recourent donc davantage aux TIG que d'autres, raison de plus pour engager une étude.
Je parlais tout à l'heure des rapports d'activité. Certains magistrats disent que les cartes servent à juger le travail des uns et des autres. Ce n'est pas du tout le but. Chaque juridiction développe des habitudes et il est bon de pouvoir porter un regard sur les mesures prises ailleurs pour lutter contre la délinquance. Il ne s'agit donc pas d'une évaluation mais d'un encouragement. Dans cet esprit, il faudrait interroger les magistrats qui prononcent des mesures de réparation dans l'intérêt général et ceux qui ne le font pas.
M. Jacques Mahéas - Peut-être faudrait-il adapter la loi.
Mme le garde des sceaux - Je m'engage en tout cas à étudier cette question sur laquelle le rapport de votre commission apportera plus d'éclairage encore.
Concernant les centres, s'il a été fait appel à un moment donné au milieu associatif, c'est parce qu'il n'y avait pas de personnel, en particulier dans la région parisienne. C'est pourquoi j'ai organisé un concours exceptionnel et procédé à un certain nombre de modifications. Mme Perdriolle a ainsi pu monter un module de 150 nouveaux éducateurs qui permettront d'assurer le fonctionnement de ces établissements.
Pour ma part, je ne rejette pas le milieu associatif. On entend, certes, des bruits divers d'un lieu à l'autre, mais dans de nombreux centres le travail entre la PJJ et le milieu associatif donne d'excellent résultats. Nous avons ainsi récemment visité Cap-Aventure dans les Côtes-d'Armor, qui fonctionne merveilleusement bien.
M. Jacques Mahéas - Bien sûr !
Mme le garde des sceaux - Le taux de réussite est même assez exceptionnel. En fait, le problème est un problème de personnel.
Quant à la formation, nous revoyons actuellement les modules de formation de nos éducateurs. C'est un très gros travail.
M. Jacques Mahéas - Il ne faut pas les former en tant qu'animateurs.
Mme le garde des sceaux - Il faut en effet les former en tant qu'éducateurs. En revanche, il faut faire une différence entre les éducateurs de prévention et les éducateurs chargés d'appliquer les mesures prononcées par les juges.
Entrer en contact avec les bandes relève des éducateurs de prévention, c'est-à-dire des éducateurs de rue. La prévention passe par ailleurs par une présence d'adultes dans le cadre de la fameuse reconquête de l'espace public. Ce ne sont ni les mêmes métiers, ni les mêmes techniques, et nous ne disposons pas de suffisamment d'éducateurs de prévention à l'heure actuelle.
Nous sommes en train, je l'ai dit, de revoir la formation, mais je pense que l'arrivée grâce au concours de nouveaux éducateurs permettra par elle-même de faire « bouger » les équipes en place. Je ne suis pas pour les cultures monolithiques et, quoi que l'on puisse faire en termes de formation, je crois beaucoup aux bénéfices d'un apport extérieur.
Vous avez parlé de la nécessité de s'introduire dans les bandes, de les infiltrer. Le problème du danger mis à part, il y a, dans les phénomènes de bande, presque toujours deux choses. D'abord, les jeunes ne se lient pas aux bandes par amitié, mais parce que leur espace privé, c'est-à-dire l'appartement, est invivable. Ils descendent au pied de leur immeuble et une bande de fait se constitue. Ensuite, ces jeunes collectivement déprimés -on les voit d'ailleurs rarement rire ou s'amuser- ne se lient entre eux que « contre » quelque chose, que ce soit contre d'autres bandes ou contre les représentants de l'autorité.
Le travail d'éducateur de prévention est donc avant tout un travail de parole, mais la prévention implique aussi une spécialisation de nos services sur des opérations très ciblées.
Par ailleurs, je suis comme vous affolée par la violence dans la publicité, à la télévision, dans les jeux vidéo et les jeux de rôle... J'ai cru un moment que cela tenait à un problème de non-compréhension de ma part, mais force est de reconnaître que la violence est réelle.
Je me suis d'ailleurs battue contre la violence dans les publicités lorsque j'étais au secrétariat d'Etat à la consommation. Je me souviens par exemple d'une publicité qui mettait en scène une bande cagoulée sortant d'une banque et échappant à la police grâce aux performances de la voiture qu'elle vantait. Ainsi, pour vendre une voiture, on faisait gagner une bande dont les membres étaient de surcroît présentés comme dynamiques, plein de prestance, dotés, découvrait-on lorsqu'ils ôtaient leurs cagoules pour se congratuler, de visages agréables ! Je trouve cela particulièrement grave. J'ai discuté avec des fabricants de voitures. On a beau dire que c'est l'apologie non pas du crime mais de la voiture, répété tous les jours, un tel message est scandaleux !
D'autres publicités me révoltent à cause des valeurs qu'elles transmettent aux enfants. Ainsi, quand une femme dit d'un produit que je ne citerai pas : « Parce que je le vaux », cela revient à s'estimer soi-même en fonction de la valeur du produit que l'on achète.
Notre société est confrontée à un problème de fond. Pour autant, je n'ai pas plus que vous les moyens de porter plainte.
Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes, a beaucoup travaillé sur l'utilisation de l'image de la femme et montré que, dans nos sociétés multiculturelles, on pouvait aboutir à des pratiques suffisamment graves, comme les tournantes, pour « réveiller » les publicistes. Pour les voitures, la violence renvoie à la vieille image de la virilité idiote qu'avec raison vous rejetez tous. J'avoue ne pas comprendre.
Quant au football, on a souvent décrit le hooligan, mais il y a aussi, c'est vrai, le problème de l'argent. Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, s'est penchée sur la publicité donnée aux salaires des joueurs.
Se pose aussi le problème de l'« achat » d'enfants de sept ou huit ans par des écoles sportives. Les parents reçoivent une sorte de bourse, mais, si l'enfant déçoit, on le « jette » ! C'est gravissime. Ce n'est pas de la traite d'êtres humains -cela existe aussi, mais il ne faut pas que je me trompe de combat- et il vaut sans doute mieux entrer dans une école de football qu'être exploité ailleurs. Je ne fais pas d'amalgame, mais je dis que nos clubs de sport sont souvent élitistes. Celui qui ne réussit pas la première année à un être bon ailier ou un bon défenseur est « viré » de l'équipe et prié d'aller jouer tout seul. C'est scandaleux. Il faut donc engager un travail qui touche jusqu'à nos équipes, elles aussi très élitistes. Il n'y a pas que l'argent. Si la volonté de gagner est belle dans le sport, lorsqu'elle implique un tri à l'entrée, c'est la société qui perd. L'équipe gagne, mais la société perd.
Je m'éloigne sans doute du sujet...
M. le président - Pas du tout, et je suis moi aussi frappé par le développement de la méchanceté, notamment dans la publicité.
Mme le garde des sceaux - Il faudrait faire réagir les consommateurs, mais c'est difficile, car, en droit, je n'ai pas de moyen. On n'a pas le droit avec soi dans ce domaine et on ne peut pas l'avoir sans porter atteinte -on me l'a reproché- à la liberté de l'image, de la création, de l'art, etc. Je crois tout de même que mobiliser les consommateurs lorsqu'une publicité est violente non pas en vue d'un boycott -ce serait interdit par la loi- mais pour signifier que l'on ne veut plus de ce type de publicités pourrait aider.
M. le président - Dans les débats, on parle aujourd'hui de comparution immédiate pour les mineurs. C'est peut-être une bonne idée, mais est-ce techniquement possible ?
Mme le garde des sceaux - Pour l'instant, non.
Le problème tient au fait que les très jeunes, c'est-à-dire les moins de seize ans, ont l'impression, une fois qu'ils sont passés à l'acte et ont été arrêtés par la police, qu'ils n'ont plus rien à perdre et ils repassent à l'acte de plus en plus souvent en attendant l'audience. Ils deviennent ce que l'on appelle des « réitérants », même si en droit l'expression ne veut rien dire. Cette situation démoralise un peu la police, elle démoralise plus encore nos concitoyens qui voient ces jeunes continuer à se livrer aux mêmes activités jusqu'à leur jugement.
Je pense, hors tout contexte électoral, que le juge devrait pouvoir prendre une décision provisoire -à lui de déterminer laquelle, CPI, CER...- afin de tenter d'éviter cet enchaînement que l'on rencontre chez certains jeunes, heureusement pas très nombreux, qui, en réitérant des actes contraire à la loi, se mettent eux-mêmes en danger en même temps qu'ils mettent les autres en danger.
Le problème est d'ailleurs déjà pris en compte par certains parquets et juges des enfants qui font en sorte que la réaction intervienne extrêmement rapidement. Il ne s'agit pas de comparution immédiate, expression qui a un fort sens en droit, mais plutôt d'une réaction en temps réel, d'une réaction rapide. Ainsi, il y a une quasi-immédiateté : une fois le parquet prévenu, le juge des enfants est pratiquement tout de suite amené à prendre des mesures, qui peuvent être provisoires quand l'enquête est complexe, ou définitives.
Bien sûr, pour que la première décision soit suivie d'une deuxième décision bien pesée, il faut le temps de mener une enquête sociale approfondie pour déterminer d'où vient l'enfant, dans quelle mesure sa famille peut l'accueillir, par exemple le week-end ou la nuit, etc. La mesure provisoire permet ainsi de préparer la mesure définitive adaptée.
Certains juges procèdent déjà ainsi. Je crois qu'il faut insister pour que ce soit la norme, sachant que pendant la période entre mesure provisoire et mesure définitive on n'a pas à statuer sur la culpabilité du jeune, car, à ce stade, notamment quand il s'agit de violences en bande ou entre deux bandes, on ne sait pas encore s'il est ou non responsable de tel ou tel fait grave, mais on ne peut le laisser attendre la décision judiciaire sans qu'une mesure soit prise.
M. Jean-Jacques Hyest - On pourrait presque parler de mesure conservatoire.
Mme le garde des sceaux - Exactement : il s'agit d'une mesure conservatoire pour éviter la réitération, l'espèce de sentiment d'impunité et de « désinhibition » qui se crée après le passage à l'acte et l'arrestation.
M. le président - Je vous remercie, madame le garde des sceaux.
Mme le garde des sceaux - C'est à moi de vous remercier, car votre commission a entrepris un travail très intéressant.
Audition de Mme Sylvie
PERDRIOLLE,
Directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse
(27
mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Mesdames, Messieurs, avant de commencer nos travaux, je vous propose de nous recueillir quelques instants en mémoire des conseillers municipaux et maires adjoints assassinés cette nuit à Nanterre. ( M. le président ainsi que l'ensemble des personnes présentes se lèvent et observent une minute de silence. )
L'ordre du jour de notre commission appelle l'audition de Mme Sylvie Perdriolle, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, administration qui est évidemment au coeur des investigations que nous menons.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Madame la directrice, ayant accompagné la semaine dernière, lors de son audition, Mme Marylise Lebranchu, vous avez eu connaissance du cadre général qu'elle a tracé et sur lequel je reviendrai tout d'abord. Je vous poserai également plusieurs questions relatives à trois domaines : l'exécution des mesures de justice, l'éducation renforcée et l'hébergement classique et, enfin, les problèmes de personnel.
A l'occasion des auditions que nous avons menées jusqu'ici et des visites que nous avons effectuées sur le terrain, nous avons entendu un certain nombre de remarques, voire de critiques, sur la protection judiciaire de la jeunesse. Première question : la PJJ n'assume-t-elle pas trop de missions au regard de ses moyens et de ses structures actuelles ?
Mme Sylvie Perdriolle - Lors des conseils de sécurité intérieure de juillet 1998 et janvier 1999, le Gouvernement a indiqué que la PJJ devait se charger en priorité des mineurs les plus délinquants, les plus réitérants et des adolescents difficiles, et c'est bien vers ces publics que la direction a aujourd'hui entrepris de recentrer son action. Deux chiffres montrent cette évolution : au début des années quatre-vingt-dix, le secteur public de la PJJ prenait en charge près de 60 % des mineurs en danger ; aujourd'hui, il prend en charge plus de 65 % des mineurs délinquants.
Les moyens de la PJJ subissent, il est vrai, une très grande tension, notamment dans la plupart des départements très urbanisés. Dans les années quatre-vingt, on comptait 3.000 éducateurs et l'on arrêtait entre 80.000 et 100.000 mineurs délinquants. En 1998, le nombre des éducateurs était le même, mais 170.000 mineurs environ étaient arrêtés. Même si un rattrapage a été réalisé depuis trois ans, puisque nous avons, durant cette période, recruté 1.000 personnes, dont 700 éducateurs, qui pour 400 d'entre eux sont en poste et pour 300 en formation, cette évolution, qui est très importante pour une si petite administration, n'est certainement pas à la hauteur des demandes des départements les plus urbanisés, notamment ceux de la région parisienne.
M. le rapporteur - Les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT) vont être en grande partie réformés. Cette réforme ne risque-t-elle pas d'être préjudiciable au lien nécessaire entre les juges des enfants et les éducateurs ? Par ailleurs, dans quelles conditions va-t-on rendre compte de l'exécution des mesures sans cette proximité qui nous semble indispensable ?
Mme Sylvie Perdriolle - Tout d'abord, je souligne qu'il y a une très grande évolution des publics. Je rappelle également qu'il existe des services éducatifs auprès des tribunaux mais aussi des services territorialisés, ce qu'on appelle les centres d'action éducative (CAE), qui suivent les mineurs demeurant dans leur famille.
Au début des années quatre-vingt-dix, il y avait un partage des publics pris en charge au sein des services de la PJJ. Les SEAT prenaient en charge les mineurs délinquants et les CAE prenaient en charge les mineurs en danger. Aujourd'hui, tous les services prennent en charge les mineurs délinquants. Le partage qui était fait autrefois ne paraît plus aujourd'hui cohérent, notamment quand on demande aux services de la PJJ d'être impliqués dans les contrats de ville ou dans les contrats locaux de sécurité, d'être des interlocuteurs possibles à l'égard des collectivités territoriales, des écoles et de tout ce qui participe de la prévention primaire et donc d'être mieux implantés territorialement. Il était paradoxal, d'une certaine manière, que les mineurs délinquants soient suivis au tribunal et ne le soient pas dans des lieux territorialisés.
C'est la première raison qui m'a amenée à une réorganisation des services. Ainsi, le SEAT conserve une fonction de permanence pour tous les mineurs déférés, les mesures nécessitant des délais, telles que la liberté surveillée, le contrôle judiciaire, mais aussi les peines d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME) ou de travail d'intérêt général (TIG), étant dévolues aux services territorialisés.
La seconde raison qui a justifié une réorganisation, c'est que, dans la plupart des tribunaux, nous avions trois ou quatre éducateurs qui étaient sans lien organisé avec l'ensemble des services du département. J'ai donc souhaité que tous les services de l'ensemble des départements soient pilotés par un directeur et que ces unités éducatives auprès des tribunaux soient effectivement dirigées par le directeur du service du CAE le plus proche.
Dans les très grandes juridictions de cinq à sept magistrats, nous allons conserver auprès du tribunal un service éducatif lourd qui sera chargé de l'ensemble des urgences et des comparutions ainsi que des mesures particulières prises en lien avec les magistrats. Dans les juridictions de trois à six magistrats, deux hypothèses sont possibles : soit nous gardons une unité éducative en permanence auprès du tribunal, soit c'est le CAE qui assure la permanence. Enfin, dans les très petites juridictions où nous avions un éducateur, celui-ci est relié au CAE.
Les CAE avaient pris, me semble-t-il, de la distance par rapport aux tribunaux et cette réorganisation va amener l'ensemble des CAE à assurer des permanences dans les tribunaux, donc à entretenir un meilleur lien avec les juridictions, dont ils connaîtront mieux le travail. L'important est que nous assurions les fonctions essentielles que sont la permanence et la prise en charge.
En ce qui concerne la connaissance des juridictions, nous avons engagé avec les tribunaux comme avec les cours d'appel une réflexion qui a abouti, le 8 mars, à une circulaire du garde des sceaux prévoyant que soit installée dans tous les tribunaux ce que nous appelons une cellule départementale « mineurs », qui doit émaner de la cellule justice-ville et qui doit être spécialisée dans la question des mineurs. Aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, les relations de travail entre administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse évoluent de manière assez favorable sur la question des mineurs incarcérés, celle de l'aménagement des peines, etc. En revanche, le champ juridictionnel s'est complexifié entre magistrats du parquet, magistrats du siège, juges d'instruction, juges de l'application des peines, et nous devons construire une meilleure coordination judiciaire. Nous souhaitons le faire à l'échelon du département, le directeur départemental étant chargé de piloter cette coordination. C'est lui notre interlocuteur premier à l'égard des tribunaux.
M. le rapporteur - Nombre de mesures de justice sont en attente d'exécution. Quelles sont celles qui subissent le plus grand retard d'exécution ? Par ailleurs, comment empêcher que les éducateurs de milieu ouvert ne sélectionnent parmi les mesures en attente celles qui leur paraissent les plus urgentes ?
Mme Sylvie Perdriolle - Nous avons procédé très récemment, à la demande de l'inspection des services judiciaires, à une étude, qui pourra d'ailleurs vous être communiquée, sur le délai moyen de prise en charge des mesures. Le délai moyen, qui est de 51 jours aujourd'hui, est beaucoup trop long. Nous l'avons réduit de cinq jours entre 2000 et 2001, grâce à l'arrivée de personnels en poste. Le délai moyen est plus court pour les mesures de réparation et plus long pour les mesures de SME.
Mais il est clair que, sur le milieu ouvert, en dépit de ces moyens nouveaux, des difficultés subsistent dans la mesure où, par ailleurs, le ministère de la justice a développé depuis quatre ou cinq ans une politique de traitement en temps réel. Celle-ci a permis que les parquets traitent 80 % des affaires concernant les mineurs, mais, de ce fait, elle a accru l'activité juridictionnelle, qu'il s'agisse des mesures prononcées par les parquets ou par les juges des enfants.
Pour éviter que les services ne traitent eux-mêmes cette question du délai, j'ai adressé une directive à l'ensemble des directeurs départementaux en leur demandant d'organiser un dialogue avec les juridictions pour fixer des priorités. Je sais, pour en avoir débattu récemment avec un des représentants du Sénat, que ce dialogue n'est pas réalisé ni bien conçu partout. D'une part, certains magistrats refusent de déterminer des priorités, considérant que tout doit être pris en charge immédiatement et, d'autre part, les directeurs départementaux doivent faire face à une pression très importante de la part des écoles et de différents services qui, lorsque les mesures sont prononcées, demandent que nous intervenions immédiatement.
Les critères normalement retenus, qui doivent être élaborés en concertation avec les magistrats, tiennent compte de la gravité des affaires, de l'urgence de l'intervention, de la répétition éventuelle d'actes commis par un même mineur. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre élément de travail que ce dialogue entre les juridictions et les directeurs départementaux.
M. le rapporteur - Lors des auditions et des visites sur le terrain que nous avons effectuées, nous nous sommes rendu compte qu'il était difficile d'obtenir des informations permettant d'évaluer le travail éducatif. Disposez-vous de critères pour mesurer l'efficacité du travail éducatif par rapport à la mesure qui a été prescrite par le juge des enfants ?
Mme Sylvie Perdriolle - L'évaluation est une question très délicate. Nous disposons d'indicateurs d'activité qui sont des indicateurs quantitatifs, que nous nous efforçons d'affiner, mais qui ne sont pas qualitatifs. Le rapport réalisé par l'éducateur sur l'exercice même de la mesure et le rapport d'activité du service constituent également des éléments d'évaluation.
La France est très en retard sur cette question de l'évaluation. Si nous voulons aller plus loin, nous devrons procéder à des études répétées concernant les publics eux-mêmes. J'ai moi-même obtenu, non sans difficulté, que soit mis en place, à partir des statistiques judiciaires, un panel des mineurs. A partir de septembre 2002, nous allons procéder à une étude concernant tous les mineurs nés entre le 1er et le 15 octobre. Cette étude, qui sera répétée chaque année durant quinze ans, prendra en compte les données familiales, médicales et scolaires. Elle permettra de suivre le devenir de ces jeunes et d'évaluer également la récidive.
J'ai par ailleurs lancé une autre étude sur le devenir des mineurs pris en charge en centres éducatifs renforcés (CER). Nous commençons à avoir sur cette question un certain recul puisque les premières unités éducatives à encadrement renforcé (UEER) datent de 1996, mais cette étude ne sera présentée que dans un an.
Une autre étude réalisée en 1998 par Marie Choquet, épidémiologiste, sur les publics pris en charge par la PJJ, pourra également vous être communiquée. Mais je considère que ce chantier très important de l'évaluation est encore largement devant nous.
Je souscris totalement à l'idée d'un observatoire sur la délinquance des mineurs qui permettrait de disposer d'un champ de recherches et d'études très régulier et surtout de s'appuyer sur un comité scientifique ayant une distance salutaire vis-à-vis des administrations concernées.
M le rapporteur - J'en viens aux questions relatives à l'éducation renforcée et à l'hébergement. Madame la directrice, vos services connaissent-ils avec précision le nombre de mineurs pris en charge ?
Mme Sylvie Perdriolle - Nous connaissons précisément le nombre de mineurs pris en charge en hébergement. Contrairement à la tendance observée ces cinq dernières années, nous avons constaté, en 2001, une hausse de 8 % de l'activité en hébergement, qui concernait 1.351 mineurs au 31 décembre 2001.
M. le rapporteur - Comment justifier les ruptures de prise en charge dans les foyers classiques de la PJJ, notamment les week-ends ou durant les vacances ?
Mme Sylvie Perdriolle - Le principe général est l'ouverture 24 heures sur 24 des foyers du secteur public. Pendant l'été, dans les grands départements, nous opérons des redéploiements vers des foyers existants afin que soit assurée une permanence. Par exemple, de cinq établissements, nous en faisons quatre. Les ruptures durant les week-ends ou les périodes d'été sont contraires à mes orientations. J'ai d'ailleurs récemment envoyé une inspection dans un foyer d'hébergement de la Réunion qui, régulièrement, fermait le week-end, les enfants étant alors hébergés dans des familles d'accueil, ce qui est absolument contraire à toutes les directives.
Il peut arriver que nous ayons des problèmes de personnels ou d'organisation d'emploi du temps durant l'été et que nous soyons obligés d'organiser différemment les permanences, mais, en principe, les fermetures de week-end ne sont pas possibles.
M. le rapporteur - S'agissant des CER et des CPI, combien de centres ne fonctionnent pas et pour quelles raisons ? Combien de structures garantissent actuellement un encadrement renforcé, notamment à toutes les heures de la nuit ?
Mme Sylvie Perdriolle - Les CER et les CPI sont probablement un des sujets les plus sensibles aujourd'hui. A travers la mise en place de ces deux programmes, nous avons pu reprendre de vraies questions professionnelles. Encore récemment, les secteurs tant public qu'associatif étaient plus tournés vers l'enfance en danger que vers l'enfance délinquante. Nous avons eu, et nous avons encore, à élaborer de nouvelles pédagogies à l'égard d'adolescents très délinquants ou très violents.
Les CER, d'abord baptisés UEER, ont connu un démarrage difficile, que je constate également pour les CPI. En effet, chacun de ces programmes a nécessité la mise en place d'établissements dans des délais extrêmement brefs et le démarrage s'est fait avec des équipes moins assurées se retrouvant parfois en difficulté.
J'ai été amenée à relancer le programme des CER selon un nouveau cahier des charges qui nous permet des prises en charge de trois à six mois, la moyenne étant de cinq mois aujourd'hui alors qu'elle était à l'origine de trois mois. Le bilan des CER est très positif. Sur les 51 CER ouverts, une ou deux structures sont encore en difficulté, mais je rappelle que, sur les 16 établissements ouverts en 1998, nous avions dû en fermer 6.
Malgré un cahier des charges extrêmement précis, nous avons développé une activité très structurée dans tous les CER, impliquant le respect de règles de vie et un compagnonnage de vie, c'est-à-dire le partage des activités au quotidien par les équipes pédagogiques.
Même pour le secteur associatif, c'est une évolution importante. Ces centres constituent de véritables laboratoires pédagogiques dont doivent aujourd'hui s'inspirer tous les foyers accueillant des mineurs délinquants ou très difficiles.
Nous avons toujours exigé que les CER soient pilotés par un éducateur spécialisé. Les équipes sont composées pour une moitié d'éducateurs spécialisés et pour l'autre de personnes engagées dans un nouveau métier, et il y a là une harmonie, un équilibre d'accompagnement qui me paraissent tout à fait intéressants et innovants.
Sur les 43 CPI existants, nous rencontrons, il est vrai, des difficultés. Alors que les CER fonctionnent par session, en prenant en charge un groupe de jeunes homogène durant toute la session, les CPI accueillent dans l'urgence les mineurs les plus difficiles et connaissent un flux constant d'entrées et de sorties. Bien que le cahier des charges des CPI ait prévu que ces centres devaient s'adresser à un public qui n'était pas nécessairement trop connu, en vue d'établir un bilan-orientation, ils ont en fait accueilli 90 % des mineurs très connus, très réitérants, qui sortaient de prison ou pour lesquels les magistrats hésitaient entre prison et CPI.
Nous nous sommes vite aperçus que, si ces structures répondaient à l'immédiateté, elles étaient confrontées à un public particulièrement difficile et ne pouvaient avec succès remplir leur mission que sous trois conditions.
La première, c'est que doit être mise en place une organisation départementale, notamment un service départemental qui régule l'accueil d'urgence, qui rassemble les magistrats, le secteur public, le secteur associatif et, éventuellement, le Conseil général. En effet, on voit bien aujourd'hui que les foyers de l'enfance sont également confrontés au problème de l'accueil d'urgence pour les mineurs en danger. Nous sommes très sollicités en ce qui concerne les mineurs étrangers ou les jeunes errants, autant que sur les mineurs délinquants. C'est pourquoi une véritable coordination départementale est essentielle.
La deuxième condition, c'est l'évolution, dont je viens de parler, du modèle des foyers. Les CPI qui aujourd'hui réussissent sont ceux qui ont un projet fort autour d'activités très structurées durant toute la semaine, en lien avec les petites structures comme les centres de jour, qui ont des ateliers scolaires ou professionnels.
La troisième condition est la qualité de l'encadrement.
Le recrutement, dont j'ai également parlé tout à l'heure, de 1.000 personnes en trois ans a entraîné une extrême mobilité des personnels. Mais, malheureusement, on a retrouvé les plus jeunes professionnels dans les milieux les plus difficiles.
Pour résoudre cette question, on a d'abord, selon la formule du tutorat, demandé aux professionnels plus anciens de revenir en hébergement pendant une période déterminée sans perdre leur poste d'origine.
Par ailleurs, nous avons décidé de modifier les modalités de recrutement. Ainsi, par le concours exceptionnel, nous avons recruté des personnes qui avaient déjà travaillé au moins trois ans, car j'ai constaté qu'il était très difficile pour de nombreux jeunes sortant de l'université de se retrouver au contact de mineurs très délinquants. Les critères de recrutement qui me paraissent devoir être retenus sont à la fois la parité entre hommes et femmes, l'âge, mais aussi la connaissance des publics difficiles.
La loi de modernisation de la fonction publique, que le Gouvernement a décidé, lors d'un comité interministériel de réforme de l'Ëtat, le 15 novembre, d'étendre à la PJJ, va nous permettre de diversifier les recrutements. Nous allons recruter sur une troisième voie des personnes ayant déjà une expérience professionnelle et cela permettra également de recruter sur titre.
J'ai également souhaité que l'on puisse recruter des contractuels. En effet, l'expérience montre qu'après avoir travaillé dans ce type de structure les gens savent s'ils souhaitent s'engager durablement dans ce métier. Pour 2002, j'ai obtenu, après de très nombreuses discussions, l'autorisation de recruter 150 contractuels, la priorité étant l'Ile-de-France, par anticipation des nouvelles voies de recrutement à venir, car ces personnes pourront se présenter au concours qui sera, je l'espère, ouvert en 2003.
M. le rapporteur - La fonction de la PJJ en matière de contrôle financier et pédagogique des établissements associatifs habilités est-elle correctement assurée ? Ce contrôle s'exerce-t-il à d'autres moments qu'à celui de l'habilitation et, si oui, quelle en est la périodicité ?
Mme Sylvie Perdriolle - La PJJ possède, à l'égard du secteur associatif habilité, des compétences conjointes avec les conseils généraux en matière de tarification, de création et de contrôle.
Sur la tarification Ëtat, nous opérons un contrôle très précis puisque nous sommes seuls à assurer le budget des services concernés. Je pense notamment aux CER pour lesquels un contrôle pédagogique très régulier est effectué.
Sur l'ensemble du secteur « enfance en danger, enfance délinquante » où s'exercent les compétences conjointes, les moyens en termes de contrôle sont certainement insuffisants. Nous sommes présents dans les procédures de tarification conjointe et nous encourageons les démarches de schéma conjoint ainsi que les protocoles de travail conjoint avec les départements.
Je voudrais à cet égard souligner l'évolution du travail réalisé avec les conseils généraux. On a beaucoup dit que ceux-ci n'avaient pas mis en place à temps les schémas départementaux. Je rappelle qu'à ce jour trente schémas départementaux conjoints ont été signés et que trente autres sont en cours d'élaboration. Par ailleurs, à la suite d'une demande qu'avait formulée Mme Guigou après avoir reçu l'Association des départements de France (ADF), la PJJ a mis en place un travail plus particulier sur seize départements dont le résultat a été diffusé à l'ensemble des départements.
Nous continuons à travailler de manière bilatérale avec l'ADF sur la question de l'observatoire partagé, c'est-à-dire sur la façon de communiquer ensemble sur les mêmes données. Je considère que c'est une avancée très positive dans la coopération entre la justice et les conseils généraux.
En ce qui concerne les moyens de contrôle, j'ajoute que certaines directions régionales ont mis en place un contrôle annuel aléatoire de quatre à cinq établissements par an, mais elles sont très minoritaires aujourd'hui. En effet, nous ne sommes pas assez outillés pour faire un contrôle régulier et aléatoire de l'ensemble des départements.
M. le rapporteur - Un partenariat accru avec les conseils généraux me paraît être une très bonne initiative, car ils sont très proches des réalités, qui sont extrêmement diverses.
Concernant la prise en charge sanitaire et psychiatrique des jeunes, les quelques visites que nous avons effectuées nous font dire que cette prise en charge paraît relativement mal assurée. Quelles améliorations comptez-vous mettre en place ?
Mme Sylvie Perdriolle - Le sujet que vous évoquez m'a paru tout à fait prioritaire. En effet, beaucoup d'établissements soulignent qu'ils ont affaire à des adolescents très violents, parfois qualifiés de « border line »
Nous avons travaillé de manière étroite avec la direction des hôpitaux et la direction générale de la santé en organisant un séminaire « santé-justice » sur ce sujet en 2000 afin de rapprocher nos administrations. Comme le professeur Jeammet, je suis très favorablement étonnée du rapprochement des points de vue qui s'est opéré entre médecins et magistrats. Nous avons tous connu une période de mise en cause réciproque des interlocuteurs. Aujourd'hui, les administrations se parlent. Entre l'administration sanitaire et nous-mêmes, un dialogue nouveau s'est construit qui se fonde sur le même diagnostic en ce qui concerne les adolescents et sur une volonté commune d'en faire une priorité. Le chiffre des suicides, par exemple, est tout aussi inquiétant que celui de la délinquance et justifie que l'on essaie de travailler ensemble.
J'ai élaboré avec mes homologues directeur de la santé et directeur des hôpitaux un projet conjoint de directive que nous devons signer dans les huit jours qui viennent sur ce sujet.
Par ailleurs, j'ai inauguré en janvier dernier, avec le professeur Jeammet, un diplôme universitaire sur les adolescents difficiles qui s'adresse à des magistrats, des éducateurs, des enseignants et à des personnels de soins. Cette formation, qui est dispensée à l'institut Montsouris, est copilotée par ma direction et la direction de l'enseignement scolaire et coanimée par le professeur Jeammet et moi-même.
Tout le monde constate que la pédopsychiatrie est en situation très difficile, que l'on manque de médecins, de lits. Mais en ce domaine, comme pour les classes-relais, en travaillant ensemble plutôt qu'en parallèle, nous avons franchi un pas.
En ce qui concerne le mineur accueilli en foyer, l'objectif, lorsqu'une crise se produit, est qu'il puisse être hospitalisé quelques jours et revenir en foyer, que des aller-retour soient possibles. J'ai même autorisé une expérimentation à Nice en mettant à disposition un personnel à l'hôpital. C'est ainsi que l'on cherche à travailler, de manière conjointe, sur de petites unités, même si l'on ne dispose malheureusement que de très faibles moyens.
M. le rapporteur - Vous avez déjà en partie répondu aux questions relatives aux personnels. Je souhaiterais avoir quelques précisions sur le taux de féminisation et l'âge moyen des personnels éducatifs de la PJJ.
Mme Sylvie Perdriolle - Le taux de féminisation est de 53 % pour les éducateurs et de 55 % pour l'ensemble des personnels. Mais ces chiffres ne sont pas très significatifs, car la question se situe en fait dans la pyramide des âges.
Sur le concours normal des dernières années, nous avons recruté 70 % de femmes et 30 % d'hommes. Nous avons quelque peu corrigé ces chiffres à travers le concours exceptionnel en recrutant 60 % de femmes et 40 % d'hommes et, en 2000 précisément, nous avons recruté autant de femmes que d'hommes.
Compte tenu de la pyramide des âges, nous risquons d'avoir, dans dix ans, une grande majorité de femmes. Il est difficilement envisageable, notamment dans les foyers, que les équipes soient à 80 % constituées de femmes. La priorité me paraît donc d'opérer un recrutement à parité d'hommes et de femmes. Ce n'est un secret pour personne que les personnels contractuels sont recrutés majoritairement parmi les hommes âgés de 30 à 35 ans. En effet, on a également un creux d'âge qui se situe entre 35 et 45 ans. Nous allons donc nous efforcer d'équilibrer cette pyramide des âges.
M. le rapporteur - Quel est le nombre de postes vacants étant donné que les congés de maternité n'entraînent pas de vacance de poste ? Ne serait-il pas intéressant de définir un taux de compensation pour pallier ce problème ?
Mme Sylvie Perdriolle - Le taux de vacance budgétaire, qui est le seul taux « officiel », est très bas puisqu'il est de 2 % environ.
Je viens d'obtenir, ce qui est là encore une révolution dans mon administration, la possibilité, en gageant des postes budgétaires, de recruter des éducateurs sur des contrats à durée déterminée pour remplacer les congés de maternité et de maladie. Les modalités financières de cette mesure restent encore à préciser avec le contrôleur financier. En revanche, je n'ai pas obtenu pour ma direction le surnombre que vous évoquez et que seule la direction de l'administration pénitentiaire a obtenu.
M. Jean-Jacques Hyest - Dans un certain nombre de départements, notamment à Paris, il semble que le secteur associatif ne prenne pas sa part des mineurs délinquants ayant eu affaire à la justice alors qu'il est précisément habilité pour le faire.
Mme Sylvie Perdriolle - Vous avez raison de souligner ce point. Historiquement, sur les trente dernières années, le secteur associatif habilité s'est beaucoup investi dans l'enfance en danger. Or, au début du siècle, il était aussi pionnier dans le domaine de l'enfance délinquante. Il s'agit donc de trouver des moyens d'attirer à nouveau le secteur associatif vers l'enfance délinquante. Toutefois, la situation est très inégale selon les régions.
En Normandie par exemple, le secteur associatif est très présent, ce qui n'est pas le cas en Ile-de-France, où l'on constate un retard général d'équipements. J'ai d'ailleurs été amenée à solliciter un secteur dirigé vers les adultes pour le programme des CER. Je viens de signer une convention avec l'association SOS Drogues international pour mettre en place 16 CER en Ile-de-France. Mais je n'ai signé aucune convention avec les associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ce qui est quand même étonnant.
J'ajouterai que, lorsque cette question est articulée conjointement entre le ministère de la justice et le Conseil général, tout le monde est obligé de bouger. On l'a vu récemment dans le Bas-Rhin, qui est un département complexe, où la situation est tendue, mais où l'on est parvenu en coordonnant les initiatives à faire progresser les choses. Les conseils généraux sont d'ailleurs des « poids lourds » par rapport à l'Ëtat en ce domaine.
Les rapprochements récents montrent que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes. Je parlais tout à l'heure des mineurs étrangers ou errants pour lesquels de petits lieux d'accueil d'urgence sont nécessaires. On est bien sûr amené à élaborer des procédures parfois dérogatoires sur ce sujet. Peut-être est-il souhaitable que tous les partenaires se réunissent pour réfléchir à une éventuelle modification des règles actuelles de financement, qui constituent parfois un obstacle.
M. le président - Madame la directrice, nous vous remercions.
Audition de M. Claude FONROJET,
Président de l'Union nationale des
associations de sauvegarde
de l'enfance et de l'adolescence (UNASEA),
et
de M. Jacques ANDRIEU,
Directeur général de
l'UNASEA
(27 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle maintenant l'audition de M. Claude Fonrojet, président de l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (UNASEA), et de M. Jacques Andrieu, directeur général.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole, M. Fonrojet.
M. Claude Fonrojet - Monsieur le président, Messieurs les sénateurs, je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous.
L'UNASEA a été créée en 1948. C'est la première fédération d'associations offrant une palette de réponses socio-éducatives et médico-sociales aux familles, aux mineurs et aux jeunes majeurs frappés d'inadaptation sociale ou de handicap. Elle regroupe environ 10.000 bénévoles et 26.000 professionnels qui prennent en charge plus de 250.000 enfants et adolescents. Sur les 700 établissements et services gérés par ces associations, près de 450 sont habilités par la justice, c'est-à-dire appelés à accueillir des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. Les associations de sauvegarde se sont engagées dès 1995 dans la mise en place des unités à encadrement éducatif renforcé et gèrent aujourd'hui 14 d'entre elles.
Le constat que fait l'UNASEA se distingue peu de celui de la plupart des observateurs et des responsables. Nous observons une forte augmentation de la délinquance juvénile dont les caractéristiques sont peut-être nouvelles. Tout d'abord, les délinquants sont de plus en plus jeunes. Ensuite, les actes commis sont de plus en plus graves, allant de ce que l'on qualifie pudiquement d'« incivilités » -destructions de boites aux lettres, tags- jusqu'aux incendies de voitures voire aux meurtres. Nous sommes donc devant des phénomènes d'une extrême gravité. Cette délinquance est par ailleurs territorialisée, c'est ce que l'on appelle la violence ou la délinquance de quartiers, même si l'on peut observer des phénomènes de délinquance juvénile en zones rurales. Le sentiment d'impunité et le manque de repères sont également caractéristiques de la population que nous observons.
Enfin, nous constatons, comme chacun des observateurs, le malaise croissant des responsables politiques et administratifs ainsi que de l'ensemble de la population, accompagné d'une radicalisation des positions qui sont prises sur ces sujets, faute de maîtriser la violence qui s'exprime.
Quelles sont les causes de cette situation ? La délinquance juvénile est incontestablement un phénomène complexe. Les travaux tels que ceux du sociologue Sébastian Roché montrent que l'on ne peut pas mettre l'accent uniquement sur tel ou tel aspect. Nous pouvons simplement signaler deux facteurs principaux : le premier, c'est le développement de la fracture sociale avec la déstructuration des familles, l'augmentation du chômage de longue durée, une urbanisation mal maîtrisée et, d'une manière générale, le développement des phénomènes d'exclusion.
Naturellement, il ne s'agit pas de stigmatiser les familles ou les jeunes qui sont en situation d'exclusion, mais force est de constater que les phénomènes d'exclusion entraînent une augmentation du nombre de jeunes et d'adolescents en situation de déshérence sociale et ipso facto celle du nombre de jeunes délinquants tenant à ces phénomènes.
Le deuxième facteur, c'est la crise des valeurs. Il s'agit du refus de l'autorité, de la dissociation entre ce qui relève de l'affirmation d'une liberté et, ce qui devrait être son corollaire mais qui ne l'est plus, d'une responsabilité. Comme le disent certains, l'ascenseur social est en panne, l'éducation n'apparaît plus forcément comme le moyen d'une promotion sociale. Les jeunes en question sont conduits à rechercher ailleurs les voies d'une affirmation. Manifestement, dans l'exercice de la violence, il y a l'affirmation de soi, d'une autonomie et, en même temps -même si cela peut paraître choquant- l'affirmation d'une sorte de statut social ; ces jeunes deviennent des caïds dans leur quartier.
Le phénomène est complexe. L'objet de l'UNASEA n'est pas de se livrer à des études sociologiques et je ne fais que transmettre ce que nous disent les éducateurs, les responsables d'associations et les directeurs généraux des sauvegardes.
Quel jugement peut-on porter sur le dispositif qui a été mis en place ? On ne peut pas nier que des efforts aient été accomplis -tous les responsables politiques sont préoccupés par la délinquance des jeunes- ni que plusieurs difficultés subsistent.
La première, c'est l'absence d'une véritable prise en charge préventive et globale de la famille. Nous nous demandons si la décentralisation d'un certain nombre d'actions en soi très positive n'a pas aussi marqué un coup d'arrêt au regard que l'Etat portait sur ces phénomènes, peut-être à tort. L'affirmation de mesures de décentralisation ne signifie pas nécessairement le retrait de l'Etat de ce secteur. L'UNASEA voit avec satisfaction l'Etat réinvestir ce champ de réflexion et d'action, d'autant plus que les fonctions régaliennes exercées par les ministères de la justice et de l'intérieur sont restées de sa compétence.
La deuxième difficulté tient aux défaillances du système scolaire et de la formation professionnelle. Incontestablement, l'école ne joue plus comme par le passé son rôle en matière de formation civique et, d'une manière plus générale, d'intégration d'un certain nombre de populations. Les personnes concernées sont bien souvent en rupture scolaire, à un âge de plus en plus précoce. Il faut s'interroger sur ce point sans stigmatiser les enseignants. En 40 ans, la quasi-totalité de la population, du fait du recul de l'âge de la scolarité obligatoire, a accédé à l'enseignement ; c'est une bonne chose, mais il y a des ratés parce que l'éducation n'est pas forcément adaptée aux besoins de l'ensemble de cette population.
La troisième difficulté est liée aux défaillances de la réponse judiciaire. Bien souvent, les juges ne sont pas spécialisés dans l'appréhension de ces situations. Nous constatons également que la réponse judiciaire aux actes qui ont été commis intervient beaucoup trop tard.
Naturellement, je manquerais à mes devoirs si je ne concluais pas en évoquant le manque de moyens ou leur mauvaise répartition. Certains services de l'Etat ou des collectivités locales manquent de moyens. La désertification sociale de certains quartiers est un constat, ces derniers souffrent à la fois de l'absence de services publics élémentaires et de leur mode d'intervention, qui est parfois inadapté à la situation. Ainsi, les représentants de l'autorité -au sens large- sont présents jusqu'à dix-sept ou dix-huit heures, alors que les phénomènes de violence se manifestent souvent à une heure plus tardive.
D'une manière plus générale, il faut souligner le manque de responsabilisation des mineurs du fait de la réticence des magistrats à l'égard de la sanction pénale. Ainsi que chacun le constate, les phénomènes de délinquance relèvent de la compétence de services multiples qui ont tendance à se cantonner à leur sphère traditionnelle. L'action des différents acteurs manque de synergie.
Nous observons donc un ensemble de phénomènes, trop rapidement exposés, qu'il faut corriger.
L'UNASEA propose trois axes de réflexion. Premièrement, il conviendrait de mettre en oeuvre une action préventive globale. Nous pensons qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. Nous sommes confrontés à des jeunes de dix ans, voire moins, et le problème se pose autant en termes d'action éducative qu'en termes de répression. L'action préventive globale doit être une priorité d'action gouvernementale et doit intervenir le plus en amont possible.
Dans ce domaine, nous ferons plusieurs remarques. Tout d'abord, nous manquons d'instruments d'analyse. Il ne faut pas se cantonner à une réflexion hexagonale. Si nous voulons pallier ce manque, décrisper les débats au sein de notre société entre les tenants de la répression et ceux de la prévention, entre les différents ministères, entre les collectivités locales et l'Etat, nous avons certainement intérêt à nous interroger sur ce que recouvre véritablement la délinquance juvénile et sur la façon dont elle est appréhendée, tant au niveau européen qu'international. Il faut cependant avoir clairement conscience que les phénomènes de culture sont très prégnants en ces matières. Il s'agit d'aller chercher non pas des recettes mais des éléments de réflexion, d'orientation et d'action partout où l'on peut en trouver. Par conséquent, nous serions heureux qu'un centre européen de la délinquance soit créé.
Ensuite, l'Etat doit susciter une synergie entre les différents acteurs afin qu'ils ne se trouvent pas, comme c'est trop souvent le cas, en opposition. Même si leurs préoccupations et leurs aspirations peuvent être à juste titre divergentes, il faut créer cette synergie. Cela suppose un échelon de concertation et d'actions pluridisciplinaires, ainsi qu'une impulsion volontariste. Les formules ne manquent pas pour tenter de rassembler la justice et l'intérieur, mais aussi l'éducation, les affaires sociales.
Nous suggérons -c'est la fonction qui compte, parce que nous connaissons la tendance de chacun d'entre nous à se réfugier dans l'institutionnalisation- la création d'une délégation interministérielle chargée de la prévention de la délinquance pour marquer notre souci de voir l'action préventive et globale affirmée comme la priorité. Cette délégation devrait être rattachée directement au Premier ministre, faute de quoi elle risquerait de ne pas avoir l'efficacité attendue.
Je précise encore une fois qu'il est plus important de combler un vide dans notre dispositif institutionnel que de nous attacher à la mise en place de telle ou telle structure administrative.
Nos propositions concernent également l'échelon local. L'action préventive globale nécessite une conception unifiée au niveau de l'Etat, une implication plus forte de l'Etat et de l'ensemble des acteurs que par le passé, mais aussi une meilleure gestion locale. Dans ce domaine, il faut disposer d'un outil de concertation, de confrontation des responsabilités et des actions de chacun, de mise en commun des moyens. Or cet instrument manque aujourd'hui. Nous nous réfugions encore dans l'institutionnalisation, mais nous préconisons la création d'une commission locale chargée de l'action préventive à laquelle seraient rattachées les équipes d'intervention de terrain.
Il importe que les familles trouvent des référents qui soient capables non pas seulement d'apporter des réponses séparées en matière de logement, d'insertion professionnelle, de soins, d'éducation, mais de définir avec elles un parcours commun et que l'information circule à l'échelon du département afin d'ordonner un secteur qui est par nature éparpillé. En effet, traiter séparément un sujet plutôt qu'un autre, c'est se condamner à l'inefficacité.
Nous sommes tout à fait désireux de voir les familles responsabilisées. C'est une idée très importante sur laquelle les médias et les hommes politiques mettent souvent l'accent. Cependant, compte tenu de notre analyse des facteurs de développement de la délinquance, le droit ne nous paraît pas comporter de lacunes dans ce domaine.
La possibilité de supprimer les allocations familiales est souvent évoquée. Nous n'y sommes pas favorables parce qu'elle manquerait son objet. Le fait de supprimer les allocations familiales à des familles qui sont plongées dans des situations difficiles aggrave ces difficultés. Or nous avons dans notre arsenal législatif et réglementaire tous les moyens de répondre à certaines situations.
Le premier d'entre eux, si les prestations sociales et familiales sont mal utilisées, est la mise sous tutelle. Nous avons d'ailleurs assisté ces dernières années à l'explosion des mises sous tutelle. Le problème serait plutôt de savoir quelle est leur efficacité. C'est un autre débat, qui fait néanmoins partie de notre sujet. Les organismes sont débordés par le trop grand nombre de dossiers qui leur sont confiés. Ils n'ont pas le temps d'accompagner la gestion des prestations sociales et familiales d'une action en profondeur auprès des familles, coordonnée avec les autres acteurs, qui permettrait d'élaborer une pédagogie plutôt que de substituer une autorité quelle qu'elle soit aux familles dans la gestion des prestations.
En outre, lorsque les familles se montrent défaillantes dans l'accomplissement de leurs responsabilités voire complices des actes accomplis par les jeunes, les textes permettent déjà de les sanctionner. Il faut les utiliser. Il convient peut-être de clarifier les positions et en tout cas de ne pas confondre, d'une part, la gestion des prestations sociales qui sont destinées à aider les familles à faire face à leurs responsabilités sur le plan matériel et, d'autre part, la sanction des familles qui sont complices ou démissionnaires.
Pourquoi ne le fait-on pas ? J'ai évoqué précédemment l'utilisation réticente de la sanction pénale pour faire face à certaines situations. On comprend bien pourquoi de telles réticences existent. Dans l'analyse des situations se mêlent la compréhension des difficultés sociales rencontrées par les personnes et la difficulté d'appréhender les comportements qui doivent être sanctionnés.
Le deuxième axe de réflexion que nous proposons est la mise en oeuvre d'une réponse judiciaire rapide, cohérente et adaptée à l'acte primo-délinquant. Nous considérons que le premier acte délictueux constitue un moment décisif qui n'est pas définitif. C'est le moment où le jeune en voie de marginalisation va se reprendre ou basculer. A ce niveau, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs de moins de 16 ans, le caractère éducatif doit incontestablement l'emporter sur le caractère répressif. Nous ne pouvons pas imaginer que l'on considère un jeune comme un adulte. La personne jeune est en formation, elle n'est pas encore un adulte construit et il faut la traiter comme telle.
Cela nous conduit à plusieurs remarques. La première, c'est que la réponse judiciaire ne peut être apportée que par un magistrat spécialisé dans le cadre spécifique de la justice des mineurs. Nous considérons que toute proposition tendant à organiser la comparution des mineurs devant les tribunaux correctionnels aboutirait à nier la volonté de réinsertion des mineurs telle qu'elle est affirmée depuis 50 ans par l'ordonnance de 1945. C'est pourquoi nous sommes très réservés sur toute évolution de cette ordonnance, non pas qu'elle soit taboue -elle a d'ailleurs été modifiée à de nombreuses reprises- mais nous souhaitons que les objectifs soient très clairement affichés.
Pour nous, il serait important que l'accent soit mis davantage sur la formation. Il convient avant tout de conserver la spécialisation des juges pour enfants, puis de faire en sorte que ces juges soient mieux considérés et mieux formés. Il existe aujourd'hui une véritable précarité de la justice des mineurs. Il est nécessaire que la formation des magistrats comporte une spécialisation en matière de justice des mineurs, afin que les juges soient particulièrement aptes à apprécier la complexité de la délinquance juvénile.
Nous proposons depuis longtemps que, dans chaque tribunal, un vice-président spécialisé soit chargé de coordonner l'activité des juges pour enfants. A nos yeux, la création récente de postes supplémentaires de vice-présidents est une avancée qui doit être confortée.
En termes de réponse judiciaire, il faut nous interroger sur les procédures qui sont en vigueur, en particulier sur l'opportunité d'une saisine directe du juge sans passer par le procureur. De même faut-il nous interroger sur la césure pénale, qui génère un délai trop important entre le moment où l'acte est commis et celui où l'enfant -ou l'adolescent- est sanctionné.
Nous préconisons aussi de conférer plus de solennité. Il s'agit non seulement de l'ordre symbolique, mais également de marquer un coup d'arrêt fort en direction du jeune au moment où il a commis un acte délictueux.
Par conséquent, la rapidité, la solennité et l'adaptation des juges sont autant de facteurs qui doivent conduire à la fois à la diminution du sentiment d'impunité des jeunes et à la lutte contre la multirécidive. Or nous observons aujourd'hui que la sanction est non seulement tardive mais parfois même inappliquée.
Je citerai à cet égard les mesures de réparation imposées aux jeunes. Ce système donne de bons résultats dans un certain nombre de cas, mais encore faut-il que la sanction soit encadrée. Or nous manquons cruellement d'encadrement dans l'exercice de la réparation.
Nous avons d' ailleurs organisé des actions dans le domaine de la prévention, notamment dans le département de l'Aube ; si cela vous intéresse, nous pouvons vous communiquer ces mesures qui, si elles ne sont pas la panacée, vont toutefois dans le sens que nous souhaitons.
La troisième dimension de notre réflexion concerne l'élargissement et la meilleure utilisation de la palette des réponses possibles à la délinquance des jeunes. Tout d'abord, le dispositif existant gagnerait à être mieux utilisé. Ai-je besoin de rappeler que plus de 75 % des décisions sont confiées à des associations habilitées, voire à certaines qui ne le sont pas, qui se trouvent malgré tout chargées de jeunes prédélinquants ou délinquants ?
Nous souhaiterions que le secteur associatif, qui démontre tous les jours sa capacité d'innovation et d'évolution, voit son rôle mieux reconnu dans le dispositif actuel. Certes, dans le lot des initiatives, certaines échouent et d'autres émergent. Il est en outre très difficile de généraliser des initiatives qui tiennent bien souvent au charisme de ceux qui les ont montées. Nous sommes dans une matière qui ne relève pas de la règle à calcul, mais il y a incontestablement quelque chose à faire pour reconnaître pleinement le rôle des associations.
Il ne suffit pas d'afficher l'objectif de conventions pluriannuelles avec les associations : encore faut-il que dans les faits, pour assurer la pérennité des moyens, les associations bénéficient de telles conventions.
Les associations doivent par ailleurs pouvoir trouver des interlocuteurs avec lesquels elles négocient le contenu et les moyens nécessaires à l'action entreprise, ainsi que les conditions de son évaluation. Seules cinq initiatives sur dix seront peut-être bonnes. Il faut naturellement que les moyens soient négociés.
Je parlais récemment d'une association à laquelle le juge envoyait des jeunes en urgence. Dans un premier temps, l'habilitation lui a été refusée. On lui a même dit qu'elle était en marge de la loi et qu'on allait peut-être lui interdire de poursuivre son action. Dans un deuxième temps, l'association a été reconnue parce que les juges étaient contents de trouver un concours dans des situations d'urgence. A ce moment là, le doublement des moyens de l'association a été imposé par l'autorité publique ! De telles situations apparaissent ubuesques aux personnes qui y sont confrontées.
Il faut incontestablement faire passer l'idée d'un partenariat. C'est bien souvent avec des arguments fondés que les associations ne souhaitent pas être instrumentalisées et prétendent être plus que de simples exécutants.
De surcroît, il faut négocier les conditions d'évaluation. J'insiste sur ce point, car nous sommes dans des situations difficiles et que certaines d'entre elles échouent. On ne bâtit pas une politique sociale sur de dos des personnels. Il faut que les individus qui acceptent de se lancer dans ce type d'actions trouvent une voie de reprise, qu'ils aient vieilli ou que l'action ait échoué. Par ailleurs, l'association ne doit pas être stigmatisée en cas d'échec, qui signifie non pas une faillite mais simplement une difficulté réelle. Nous savons bien que personne de détient de solution miracle dans ce domaine, y compris en matière de fugue des mineurs. On dit souvent que des centres accueillant des jeunes délinquants ne fonctionnent pas bien si, le jour d'une visite, les jeunes sont dans la nature. A ce propos, nous sommes très réticents.
La nécessité d'une vraie collaboration vise aussi à tirer partie du capital de compétences et de dévouement qu'ont les gens de terrain dans la définition de la stratégie. Incontestablement, il faut mettre en place un partenariat entre les autorités -le ministère de la justice et le ministère des affaires sociales- et le secteur associatif. Ne voyez pas là de ma part une défense corporatiste, mais le simple constat que ce ne sont pas des fonctionnaires de type classique qui vont résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous traversons une crise grave en matière de recrutement du personnel. Il faudrait conduire une réflexion sur le type de profil recherché ; si nous ne mettons pas l'accent sur cet aspect de la question, nous risquons de ne pas avoir les moyens de la résoudre.
Le deuxième aspect de notre réflexion porte sur la palette des réponses. Toute mesure, que ce soit sous forme de sanction ou de prise en charge, doit s'accompagner de mesures éducatives ou d'une préparation à l'intégration. S'agissant de jeunes âgés de 10 à 16 ans, s'il y a d'abord la réparation et certainement la sanction, il est cependant déterminant pour l'avenir de préparer la réinsertion à l'issue de la prise en charge par le système judiciaire ou socio-éducatif.
La préoccupation de la répression risque de l'emporter trop fortement, et, loin d'obtenir l'effet escompté, nous aboutirons à l'effet inverse, c'est-à-dire que nous aurons durci les gens dans leur délinquance.
Ensuite, il y a une trop grande rigidité dans l'appréhension des réponses qu'il convient d'apporter. Il faudrait certainement que les juges pour enfants puissent jouer sur plusieurs tableaux -réparation, accueil dans un foyer, passage par un sas ; dans ce domaine, il faut définir un parcours autant que mettre l'accent sur un type de mesure.
Nous devrions également nous interroger sur la manière de compléter les réponses existantes. Le bilan de l'action des unités éducatives renforcées mises en place en 1995 puis reprises par le gouvernement actuel sous l'autorité de Mme Elisabeth Guigou n'est finalement pas négatif. Nous en gérons quatorze puisque la quinzième a fermé. Nous n'avons pas le recul nécessaire pour savoir si la réponse est d'une ampleur suffisante et s'il n'y aurait pas lieu de procéder à des améliorations. Pour autant, il ne faut pas « jeter le bébé avec l'eau du bain » en estimant que, si la délinquance continue à augmenter, ce n'est pas la bonne réponse et qu'il faut en chercher d'autres. Ce n'est pas notre attitude.
Je le disais précédemment, il faut faire évoluer les structures existantes, mais nous avons l'impression que ces structures atteignent leurs objectifs, au moins pour une partie des jeunes qui y sont accueillis. Atteindre 50 % de réussite, c'est déjà mieux que rien.
Pour compléter le dispositif, nous émettons de sérieuses réserves sur toutes les propositions qui concernent des centres d'enfermement. La situation est complexe pour deux raisons.
Premièrement, nous constatons que les quartiers de mineurs dans les prisons ordinaires ne sont pas adaptés à la préparation de la réinsertion. S'il s'agit de faire autre chose, de faire en sorte que la réinsertion de l'individu soit préparée même s'il accomplit une peine, d'engager une réflexion sur la taille et l'emplacement des établissements, de substituer au quartier de mineurs une structure mieux adaptée à l'objectif que l'on se fixe, nous sommes naturellement favorables aux propositions qui seront faites.
En revanche, nous sommes perplexes quant à l'idée de créer des centres d'enfermement à coté des centres existants s'il s'agit de reproduire les maisons de correction du XIXème siècle, qui ont fait l'objet d'une stigmatisation justifiée, voire certains centres qui ont existé jusque dans les années soixante-dix. Ils constituaient en effet des foyers de violence. Les personnels qui sont en contact permanent avec les jeunes en difficultés ont tendance à dire que cela se fera sans eux. Comment assurera-t-on la conciliation indispensable entre répression et prévention ? Il ne faut pas, selon nous, refaire des maisons de correction. En même temps, nous sommes sensibles à l'idée d'organiser des séjours de rupture, de mieux assurer une sanction et une répression conjointes.
Nous demandons des personnels mieux formés, sur la base du volontariat et mieux protégés.
Il faut incontestablement réfléchir à une ligne de partage entre l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse parce que, des deux cotés, se trouvent des jeunes qui sont dans des situations voisines.
Je terminerai là dans mon exposé -j'ai déjà été trop long- pour répondre à vos questions. Je vous remercie, messieurs les sénateurs, de m'avoir écouté.
M. le président - Nous vous devons une explication sur les mouvements qui se sont produits à la tribune lorsque vous avez évoqué la mise sous tutelle des allocations familiales. J'observais que nous l'avions proposée et que j'avais moi-même inscrit dans un rapport relatif à la sécurité quotidienne la question de son élargissement. Or je soulignais que l'on retenait uniquement les propositions visant à supprimer les allocations familiales et jamais celles tendant à élargir la tutelle. Par conséquent, ne soyez pas troublé, monsieur le président, il ne s'agissait nullement de la mise en cause de vos propos mais de la rémanence de quelques réflexions que nous avions déjà faites.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Monsieur le président, nous vous remercions de cet exposé très intéressant ; j'avais beaucoup de questions à vous poser, mais vous y avez répondu par anticipation dans le diagnostic auquel vous avez procédé sur les causes de l'augmentation et de la gravité croissante de la délinquance et, surtout, dans vos propositions.
J'aurais cependant quelques questions complémentaires à vous poser : pensez-vous que l'action de toute la chaîne judiciaire -police, justice, services de prévention- soit suffisamment cohérente ? Si tel n'est pas le cas, quelles solutions préconisez-vous pour améliorer l'efficacité des différents acteurs ?
M. Claude Fonrojet - Je crois avoir déjà partiellement répondu à votre question. Actuellement, du point de vue institutionnel, chacun est cantonné dans son champ d'action traditionnel. Il manque incontestablement un lieu où cette synergie pourrait s'organiser, à l'échelon national, car nous traitons de fonctions régaliennes. Les ministère de la justice et de l'intérieur se concertent dès à présent, notamment à l'occasion de faits marquants de l'actualité. Pour répondre à la question de la synergie des différents acteurs, il faut élargir le cercle de ceux qui participent à la concertation. S'agissant de jeunes âgés de 10 à 16 ans, l'Education nationale est un partenaire incontournable, au même titre que les affaires sociales, même si c'est le juge qui décide de la mise sous tutelle des prestations sociales. Le lien entre l'action pédagogique et les actions de réparation et de sanction doit être pris en compte. Tout doit être concerté dans la durée et de manière permanente.
Nous ne résoudrons pas le problème de la délinquance juvénile par des mesures d'urgence. Plus on agira en amont, plus on aura de chances que les jeunes ne basculent pas dans la délinquance. De même, il faut essayer de mettre un coup d'arrêt le plus tôt possible afin de rompre la chaîne d'entraînement dans laquelle ils se trouvent.
Au niveau national, j'ai suggéré la création d'une délégation interministérielle -là encore, les formules institutionnelles sont multiples- pour faire en sorte que les gens concernés soient bien éclairés. On voit bien que l'on a du mal à définir les raisons de la montée de la délinquance juvénile. On ne peut pas se contenter de stigmatiser des gens qui sont en difficulté -être pauvre, dans un quartier ou une banlieue difficile, appartenir à une famille dont les parents ont divorcé ou à une famille recomposée- car cela ne constitue pas une prédestination à être violent ou délinquant. La délinquance juvénile ne touche qu'une minorité d'enfants parmi tous ceux qui sont peu ou prou victimes de difficultés.
Je vais tout à fait dans votre sens. L'organisation de la synergie entre les acteurs ne doit pas se faire à propos d'un acte isolé ou d'un moment fort, mais dans la durée, de manière permanente, pour créer l'habitude de travailler en commun, c'est-à-dire rompre le cloisonnement et la verticalité de nos administrations. Ce n'est pas facile, mais c'est vers cela qu'il faut tendre.
M. le rapporteur - Souhaitez-vous ajouter un commentaire, Monsieur Andrieu ?
M. Jacques Andrieu - Il nous paraît vraiment important qu'il y ait une continuité entre les actions de prévention et la réponse qui est donnée au moment du premier acte délinquant. Il convient sûrement de réfléchir tous ensemble sur ce que recouvre un acte délinquant. Aujourd'hui, les incivilités échappent totalement à la définition de la délinquance. Est-ce nécessaire de les qualifier pour y apporter une réponse homogène de la part du monde adulte ?
La continuité recouvre ce que M. Fonrojet évoquait et que l'UNASEA défend depuis plus de 10 ans, à savoir la notion d'action sociale globale.
Le maire n'est pas un acteur reconnu dans l'aide sociale à l'enfance, dans la prévention spécialisée. On a vu apparaître une volonté de coordination avec la mise en place de la politique de la ville. Or cette politique est vouée à l'échec si elle se contente de créer des comités Théodule, d'organiser des grand-messes pour parler de façon théorique et générale de la délinquance dans une ville ou un quartier. Je ne dis pas que c'est inutile, mais il ne faut pas que chacun continue à travailler au niveau de sa « tranche de saucisson ».
Depuis 30 ans, notre pays a développé avec beaucoup d'énergie son action sociale. Ses moyens sont mis en cause du fait de l'empilement des dispositifs, chaque responsable faisant très bien son travail à l'intérieur de sa tranche mais communiquant peu avec les étages inférieurs et supérieurs.
La première cause de la délinquance tient aux difficultés de la famille, mais ce ne sont pas forcément les difficultés de la famille qui en sont la cause. Il existe des familles en difficultés, des familles d'origine étrangère -on dit souvent qu'il ne faut pas nier la dimension ethnique de la délinquance des mineurs- dont les enfants n'ont jamais commis d'actes délinquants. C'est même la majorité puisque cela représente environ 95 % des familles.
Nous devons donc être capables d'agir au niveau de la commune. Le maire est le chef d'orchestre naturel de cette action, c'est une grande responsabilité et il faut lui en donner les moyens. Des expériences concluantes ont consisté à coordonner sur le terrain des « groupes d'intervention locale » comprenant le principal du collège, le commissaire de police, le maire ou un élu, les éducateurs de prévention spécialisée, les éducateurs chargés d'actions éducatives en milieu ouvert, des représentants des parents, bref l'ensemble des acteurs qui, à l'échelle d'un quartier, peuvent se concerter non pas sur des généralités, ni sur l'établissement d'un bilan de la délinquance, mais sur des cas concrets.
C'est parfois à l'école que l'on va repérer qu'un enfant commence à dériver, obtient de moins bons résultats ou commet des actes violents. Il faut se demander pourquoi, mais pas seulement dans l'enceinte de l'école. Or c'est la situation actuelle. Il faudrait, au sein de l'école, travailler avec les intervenants extérieurs. L'assistante sociale et l'office d'HLM n'ont-ils pas constaté que les loyers n'étaient pas payés, le commissariat de police n'a-t-il pas rencontré de problèmes avec la famille ?
L'expérience a été tentée dans certaines communes et dans quelques arrondissements de Paris. Elle donne des résultats, mais reste expérimentale et isolée parce que l'on n'a pas encore pris en compte la dimension institutionnelle.
Au-delà des dispositifs, il faut travailler sur leur cohérence et sur un consensus politique et social, sur la volonté des adultes de parler d'une même voix. Un mineur qui, pour la première fois, graffite la porte de l'immeuble ou crache sur une veille dame doit obtenir une réponse à la hauteur de son acte et en fonction de son âge. On doit lui dire à un moment donné qu'il a commis un délit, que c'est une agression pour quelqu'un d'autre, et ordonner une mesure de réparation. Or la mesure de réparation est très mal utilisée, elle est prononcée mais rarement mise en oeuvre faute de moyens. C'est pourtant la meilleure réponse que l'on puisse donner à un mineur qui vient de faire une bêtise.
Un mineur qui a mis le feu au péristyle de sa cité HLM devrait comparaître devant le juge pour enfants avec toute la solennité requise, mais il faudrait surtout que le magistrat puisse apporter une réponse rapide, lui dise qu'il a commis un acte délictueux qu'il doit réparer. Je pense au cas précis d'un adolescent de 13 ans qui n'avait jamais commis d'infraction et qui a mis le feu à des plaques de styropore à l'entrée de son immeuble pour se faire admettre dans une bande. Le magistrat a indiqué à l'adolescent qu'il allait nommer un éducateur et lui a donné rendez-vous six mois plus tard pour traiter de la qualification pénale éventuelle de son acte. C'est la césure pénale. Cet enfant est donc rentré triomphant dans son quartier ; il n'a rien compris, ses parents non plus. Ce qui compte, c'est qu'il a réussi, en faisant l'imbécile devant ses copains, à se faire admettre dans la bande et que cela ne lui a rien coûté.
Il y a un problème de cohérence dans la réponse des adultes. Ce n'est pas seulement l'affaire des magistrats, des éducateurs, des instituteurs et des enseignants. Il faut que tout le monde travaille de concert sur des cas concrets.
M. le rapporteur - Je voulais vous entendre plus particulièrement sur le fonctionnement des centres, sur les difficultés que vous rencontrez. Comme le temps presse, monsieur le président, je suggère que vous nous présentiez par écrit un bilan général de la situation de vos centres. Nous disposerions ainsi de quelques données chiffrées. Nous ne manquerons pas de vous demander, le cas échéant, des compléments d'informations. Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation.
M. le président - Messieurs, je vous remercie de cette contribution collective au respect de l'emploi du temps. Y-a-il d'autres questions ?...
Messieurs, je vous remercie de cet exposé très complet.
Audition de M. Alain BRUEL,
ancien Président du tribunal pour enfants
de Paris
(27 mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle maintenant l'audition de M. Alain Bruel, magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris, qui a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages sur la justice des mineurs et qui, notamment, en 1998, a rédigé un rapport sur l'avenir de la paternité.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole, Monsieur Bruel.
M. Alain Bruel - Afin d'utiliser au mieux le temps qui m'est imparti, je laisserai de côté la description des formes actuelles de la délinquance juvénile pour me concentrer sur une étude critique des réponses sociales qui lui sont apportées. Celle-ci me servira à introduire quelques propositions qui, j'en suis convaincu, pourraient améliorer la situation.
S'agissant de la connaissance de la délinquance, son évaluation quantitative et qualitative pose en France un réel problème dans la mesure où l'on apprécie un produit social complexe et évolutif, dont l'appréhension dépend non seulement des phénomènes de visibilité et de renvoi mais aussi de l'implantation et du fonctionnement des institutions qui l'enregistrent, le trient et le traitent.
Les statistiques actuelles rassemblent des données hétéroclites provenant de logiciels incompatibles entre eux, dans des perspectives dont l'inspiration corporatiste n'est pas exclue. L'importance du « chiffre noir », dont les enquêtes de « victimisation » et les questionnaires de délinquance auto-révélée donnent une idée approximative, suffit à démontrer la relativité des chiffres officiels et de leur variation d'une année à l'autre.
Quant à l'interprétation, il convient de souligner que notre pays a vu depuis quelques années s'amenuiser le potentiel dont il disposait, la création de l'Institut des hautes études sur la sécurité intérieure ne compensant que partiellement l'effacement progressif du centre de formation et de recherche sur l'éducation surveillée de Vaucresson, la disparition du centre technique national de recherche sur les handicaps et inadaptations et celle du centre international de l'enfance.
Ainsi privés d'une vue globale et multidisciplinaire sur le sujet, nous ne disposons que de travaux épars qui sont souvent l'oeuvre des seuls sociologues.
Le cloisonnement et la rivalité des administrations concernées, une reprise médiatique davantage orientée sur le sensationnel que sur la fréquence des phénomènes expliquent largement le contexte d'exaspération et d'affrontements idéologiques dans lequel nous nous trouvons.
Quelles sont les réactions sociales à la délinquance ? Le débat public se réduit depuis quelques années à une stérile opposition entre les tenants de l'éducation et ceux de la répression. Mais la répression n'est rien d'autre qu'un baromètre qui suit de plus ou moins loin les fluctuations du sentiment d'insécurité. Son incontestable aggravation depuis quelques années n'entraîne aucun effet observable sur l'évolution de la délinquance, ce qui n'empêche pas ses partisans d'en réclamer toujours davantage et de rallier de plus en plus d'adeptes.
Quant à la rééducation, c'est une entreprise périlleuse, aux effets aléatoires, peu visibles et souvent tardifs. Elle est difficile à valoriser dans une société éprise d'immédiateté comme la nôtre.
On débat inlassablement sur le point de savoir si la porte des établissements doit être ouverte -avec tous les risques que cela comporte- ou fermée, avec la quasi-certitude de voir l'éducation se pervertir en surveillance.
Les centres à encadrement renforcé, plus que les centres de placement immédiat, semblent échapper à ce dilemme. Mais leur efficacité reste limitée, en raison de la brièveté de la prise en charge qu'ils exercent, et surtout de l'absence de solution crédible au moment de la sortie.
Nombre de professionnels pensent que la voie royale de l'efficacité se trouve dans la prévention. Mais quelle prévention ?
Commençons par la prévention primaire.
Il est patent que, depuis le début des années 1970, les disparités de revenus entre les générations les plus âgées et les générations les plus jeunes n'ont cessé de croître.
Selon une étude récemment publiée par Christian Baudelot et Michel Gollac, l'écart de traitement entre les salariés de 50 ans et les salariés de 30 ans, qui n'était que de 15 % en 1975, est maintenant de 40 %. Les ajustements à la baisse des niveaux de salaire s'effectuent invariablement au détriment de ceux qui entrent sur le marché du travail. La croissance moyenne, qui, durant la même période, était de 20 %, a été entièrement dévolue aux générations nées avant 1950. Les revenus du patrimoine augmentent plus vite que les revenus salariaux et l'on se doute qu'ils se trouvent rarement d'emblée entre les mains des plus jeunes. Le niveau d'études requis, l'exigence d'une expérience professionnelle préalable à l'embauche rendent les parcours d'insertion plus longs et plus aléatoires. La situation pourrait même empirer si les retraites adossées à des fonds de pension venaient à se développer, les jeunes devenant alors salariés de leurs parents actionnaires. Le partage des bénéfices et des épreuves de la conjoncture se trouve donc faussé, et la tradition selon laquelle les enfants peuvent espérer bénéficier de conditions de vie plus favorables que leurs parents, bouleversée.
Pour remédier à cette situation, il faudrait que la justice intergénérationnelle joue déjà au niveau de l'expression politique, ce qui n'est pas non plus le cas. Selon le sociologue Louis Chauvel, l'âge moyen du représentant syndical ou politique, qui était de 45 ans en 1982, est passé à 57 ans en 1997, soit un vieillissement de douze ans en moins d'une génération.
La crise de transmission du patrimoine se double d'ailleurs d'une crise des projets à long terme et de la responsabilité. Rares -il faut bien le dire- sont les groupes et les lieux où l'on se préoccupe de donner véritablement la parole aux jeunes. Aucun effort n'est fait pour imaginer à leur bénéfice des modalités de reconnaissance sociale adaptées à leurs mérites et comportements citoyens -quand ils en ont- ou pour recréer des ritualités rendant visibles leur progrès vers la prise en main de leur citoyenneté.
Certes, la « conflictualité » des rapports entre les générations n'est pas un fait historiquement nouveau, et la solidarité familiale entretenue par la proximité des liens affectifs reste importante. Mais, lorsqu'il s'agit d'aider leurs propres enfants, les parents ont le sentiment d'agir par affection et non par un simple souci de justice sociale.
Enfin, le caractère abstrait des grands systèmes d'assistance et les modalités économiques complexes qu'ils comportent, en opacifiant les effets du sacrifice consenti au profit d'autrui, poussent à une certaine déresponsabilisation.
Dans ce paysage inquiétant, le rapport de la commission « Jeunes et politiques publiques » du commissariat général du Plan constitue, à mon avis, une lueur d'espoir. La commission reconnaît que la jeunesse a été, plus que les autres générations, victime de la crise économique et elle préconise une vaste réforme touchant à la fois l'éducation et le travail. Chacun disposant au départ d'un crédit de formation décemment rémunéré, celui-ci pourrait être mis en oeuvre tout au long de la vie, notamment à l'occasion des périodes où le chômage contraint à l'inactivité, et faciliter éventuellement une réorientation.
La mise en route d'un tel chantier, outre qu'elle ferait régresser chez les jeunes l'insécurité, présenterait un double avantage : d'une part, sur le plan du travail, elle faciliterait le mixage de l'expérience des anciens et du bon niveau théorique des arrivants ; d'autre part, sur le plan social, elle permettrait à chacun d'accéder à une conscience plus nette des moments où il profite de la richesse produite par les autres et de ceux où il produit lui-même pour les autres. Sans doute faudra-t-il encore du temps pour que ces idées fassent leur chemin. En attendant, il est nécessaire d'améliorer, dans la population jeune, la connaissance du droit et de créer des passerelles entre les cultures pour faciliter le dialogue social.
S'agissant de la prévention secondaire, l'actuelle politique de la ville reste tributaire de la prévention « à la française », dont la théorisation date du début de la décennie 1980.
Dans son rapport déposé le 17 décembre 1982, Gilbert Bonnemaison ne se contentait pas d'entériner le sort des opérations « anti-été chaud » menées l'été précédent et qui s'analysaient en un effort de décloisonnement et de mutualisation des moyens des administrations concernées par la lutte contre la délinquance, il allait beaucoup plus loin. Après avoir souligné les limites d'un appareil répressif saturé, coûteux et d'un rendement décroissant, il affirmait que, au lieu d'un savoir central, abstrait, spécialisé sur la délinquance, il fallait développer un savoir local, concret, partagé par un maximum de personnes. Mais, ce faisant, il contestait implicitement la validité de l'énonciation judiciaire en plaçant le savoir sur la délinquance du côté d'une instance décisionnelle collective et en niant au passage toute valeur à la spécialisation. La délinquance ne pouvait, dès lors, être perçue que comme un phénomène collectif relevant d'une politique pénale appropriée et non comme une pluralité d'actes commis par des individus différents et susceptibles de recevoir des réponses différenciées.
La prépondérance donnée aux constats globaux conduit à une vision totalisante, insensible à la nuance et à la prise en compte de la personne telles qu'elles peuvent apparaître dans une démarche d'individualisation.
Cette conception territoriale et technocratique nie l'intérêt d'une prévention à l'échelon individuel, comme celle qu'exerce la prévention spécialisée par exemple, et s'oppose à un fonctionnement judiciaire jugé encombrant parce que difficilement prédictible alors qu'il respecte des contraintes génératrices de garanties spécifiques comme le débat contradictoire et l'intervention de la défense
Dès 1998, Jean-Pierre Sueur, maire d'Orléans, chargé par le ministre de l'emploi et de la solidarité d'établir un bilan détaillé de la politique de la ville, portait sur sa mise en oeuvre un jugement sévère . Il relevait des financements non négligeables mais complexes, incertains et encore insuffisants, des procédures contractuelles qui s'enchevêtrent et se superposent fréquemment, des politiques de zonage qui s'accompagnent trop souvent d'une diminution de moyens, notamment en matière de service public.
Depuis, les choses n'ont guère évolué puisque, dans son rapport rendu public le mois dernier, la Cour des comptes reproche encore à la politique de la ville un manque de définition précise des objectifs, une instabilité des priorités retenues et une impossibilité à chiffrer le montant des crédits affectés à ces programmes.
De fait, à trop mettre l'accent sur le traitement social de la délinquance au détriment du traitement individuel, on en arrive à dégarnir le maillage social de première ligne.
La confusion entre prévention et développement social urbain a entraîné une dispersion des crédits préjudiciable à l'efficacité.
Les cibles étant mal délimitées, chaque secteur a développé sa logique propre en direction de sa clientèle habituelle sans souci des chevauchements et des lacunes.
On a enfin oublié que la prévention passe d'abord par une éducation à la norme et que, pour la réaliser, l'intelligibilité de la production normative est sûrement aussi importante que la visibilité des décisions pénales.
Avec le recul d'une vingtaine d'années, on découvre que prévention et répression sont, en fait, deux démarches complémentaires qui n'ont ni la même temporalité ni les mêmes objectifs.
Le véritable rôle de la prévention est non pas de faire disparaître la délinquance mais de redéfinir des repères pour humaniser le cadre de vie, de mettre en place des circuits d'information tenant compte des particularités locales, de renforcer les liens familiaux, les relations famille-école, et de soutenir les initiatives citoyennes ; c'est toute une culture à acquérir.
J'en viens maintenant à la prévention tertiaire.
A ce niveau, il s'agit seulement de prévenir la récidive, de lutter contre les conséquences de la transgression pénale, de réadapter le délinquant à la vie sociale et professionnelle ; c'est la tâche de la justice. Mais la collectivité ne peut s'en désintéresser comme elle le fait actuellement.
Paradoxalement, la désaffection portée à l'égard de la justice dans la philosophie du « tout prévention » s'est traduite par une judiciarisation sans précédent de situations qui étaient autrefois traitées en amont de son intervention.
La justice des mineurs ne pouvait qu'être affectée, bien entendu, par les lacunes de la prévention primaire, le dévoiement de la prévention secondaire ; au moins aurait-elle dû s'en démarquer. Tel n'a pas été le cas. Les gardes des sceaux successifs, loin de prendre un minimum de distance critique par rapport à la politique de la ville, ont cru que les magistrats pouvaient s'y intégrer sans autre forme de procès. Ils ont fermement tenu trois orientations qui, pour paraître relever du simple bon sens, méritent pourtant examen : la proximité, la réponse en temps réel, et l'engagement dans le partenariat.
Je n'ai guère le temps d'entreprendre ici une critique construite de cette politique. On comprendra toutefois que la proximité accrue de la justice par rapport au terrain ne présente pas que des avantages, notamment sur le plan symbolique, et que sa sérénité, voire sa nécessaire homogénéité sur l'ensemble du terrain, peuvent en pâtir.
La réponse en temps réel, quand elle ne se limite pas à lutter contre des lenteurs injustifiables, devient le seul critère de l'efficacité, se retourne contre sa propre justification d'intelligibilité de la décision et devient un obstacle à l'intervention en profondeur. Elle génère une véritable thrombose institutionnelle et provoque, pour l'exécution des mesures éducatives notamment, la constitution de listes d'attente préjudiciables à la crédibilité même de la décision.
Quant à la participation des magistrats -au moins des magistrats du siège- au partenariat, j'en ai suffisamment dit sur la philosophie de la prévention pour qu'il soit facile de comprendre le malaise dans lequel ils se trouvent plongés.
Est-ce à dire qu'il faut en conclure -comme certains sociologues n'ont pas hésité à l'écrire- que la juridiction des mineurs est devenue obsolète parce qu'elle travaille dans l'individuel et que seul le travail mené par le Parquet mérite d'échapper aux poubelles de l'histoire ? Je ne le pense pas.
Au demeurant, l'éclatement de la justice en deux moitiés rivales, l'incompréhension actuelle vis-à-vis de l'acte éducatif et de ses exigences, la montée de la déspécialisation des magistrats, ne me paraissent pas constituer des progrès éclatants.
Je crois, en revanche, que la comparution en justice comporte des effets structurants sur ceux que l'on a qualifiés de « sauvageons ». La mise en mots des faits et gestes introduit une distance entre les actes et la personne qui les a accomplis. L'audience est souvent l'occasion d'une rencontre initiatique avec la loi symbolique de l'échange, du sacrifice et du don. Elle permet à chacun de se réapproprier son identité et sa responsabilité. Elle offre au mineur une opportunité de démontrer qu'il est capable de faire autre chose que de commettre des délits en s'engageant volontairement dans un projet à court terme de réparation de lui-même, du lien qui le relie à la société et parfois de la victime elle-même.
De tels effets sont particulièrement adaptés à des jeunes que tous les observateurs décrivent comme ayant le sentiment de n'être ni écoutés ni respectés, privés de tout espace qui leur soit propre et incapables de se projeter dans l'avenir.
Pourtant, il est hors de doute que des réformes doivent être entreprises, tant en amont qu'en aval de la décision judiciaire.
Le déploiement d'une police de proximité est sûrement une bonne chose. Cependant, ses objectifs paraissent encore flous et se distinguent mal de ceux des nouveaux métiers de la ville. Ils gagneraient à être précisés.
Par ailleurs, les vérifications d'identité sont souvent utilisées -au moins dans certains secteurs- au-delà du nécessaire, ce qui provoque une irritation chez des jeunes prompts à se sentir victimes de mesures discriminatoires et vexatoires.
Dans le domaine des investigations, il est certain que la délinquance de groupe et le développement de trafics très « capillarisés » dans lesquels sont impliqués souvent des adultes posent de sérieux problèmes aux enquêteurs quand ils doivent identifier précisément les auteurs et établir les participations respectives.
Toute faille dans ce domaine devient pour ceux qui en bénéficient source d'impunité et pour les autres la cause d'un sentiment profond d'injustice.
Inversement, une enquête approfondie menant au démantèlement d'un réseau peut avoir des effets très positifs sur le sentiment d'insécurité.
Or nous manquons cruellement d'une police judiciaire spécialisée dans les affaires de mineurs, capable de procéder à des recherches approfondies. Les brigades des mineurs, qui, voici une trentaine d'années, s'acquittaient de ce travail en étroite collaboration avec les magistrats se sont peu à peu repliées, faute d'effectifs, sur leurs tâches de protection des mineurs victimes, et ne trouvent aucune aide chez leurs collègues de la police judiciaire. Il faut voir là l'une des causes principales de l'incompréhension qui s'est introduite entre policiers et magistrats et qui, je peux en témoigner personnellement, n'a pas toujours existé.
Au niveau judiciaire, il me paraît important de souligner que la spécialisation des magistrats de la jeunesse, principal pilier du système mis en place par l'ordonnance de 1945 et fortement soutenue aujourd'hui encore dans les recommandations du conseil de l'Europe, est de moins en moins respectée.
Non seulement les chefs de juridiction ont pris de longue date l'habitude d'accaparer plus ou moins régulièrement les juges des enfants en leur confiant des tâches qui ne s'apparentent que de loin à leur travail, mais la politique des services judiciaires ne tient aucun compte de la nécessité d'une certaine durée de fonction dans un poste et de l'intérêt de l'utilisation au profit de tous l'expérience qu'ils auraient acquise.
Trop souvent, les postes d'encadrement de la juridiction des mineurs sont dévolus à des magistrats venus d'horizons intellectuels éloignés, ce qui entretient un malaise.
Seule l'adoption d'un texte réglementaire, ou au moins des instructions très fermes données au plus haut niveau, pourraient remédier à ce gaspillage permanent des compétences. La loi sur la présomption d'innocence, en confiant au juge des libertés et de la détention le pouvoir d'incarcérer les mineurs, n'a pas tenu compte des garanties de la spécialisation pour les mineurs, et la loi du 30 décembre 2000 a même donné à ce magistrat le pouvoir d'ordonner des mesures éducatives dont le maniement lui est parfaitement étranger.
Au niveau des parquets des mineurs, où des observations semblables pourraient être faites, on assiste même à un mouvement de déspécialisation correspondant à une politique de territorialisation des attributions des substituts.
Quant à la réforme de l'ordonnance de 1945 -présentée comme obsolète alors qu'elle a été modifiée pratiquement chaque année depuis son adoption, en fonction des préoccupations du moment-, elle n'a nul besoin d'être renforcée dans un sens répressif.
Les améliorations devraient, selon moi, s'orienter exclusivement dans quatre directions : renforcement des droits des mineurs pour rendre la défense et les possibilités d'appel plus effectives; aménagement de l'application des peines pour permettre notamment l'exécution d'une partie de l'emprisonnement en semi-liberté ; création de mesures d'investigation sur l'environnement extra-familial des mineurs, qui sont actuellement appréhendés exclusivement sur le plan personnel et familial ; redéfinition de la mesure de réparation ordonnée par le siège, qui est trop souvent confondue avec la médiation pénale et dont l'initiative pourrait être confiée aux éducateurs -je dis bien l'initiative, pas le prononcé- dans la perspective d'un élargissement des hypothèses dans lesquelles elle est prononcée.
En aval de la décision, l'accroissement des moyens éducatifs ne doit pas être exclusivement consacré aux structures d'accueil à court terme. L'effort accompli par la PJJ depuis quelques années pour faire face aux prises en charge les plus urgentes par le moyen des centres de placement immédiat et des unités d'encadrement éducatif renforcé s'est traduit par une désorganisation administrative dont, aux dires d'un grand quotidien, la Cour des comptes s'est récemment émue.
Il devrait maintenant se concentrer sur les prises en charge à moyen et long terme, moins spectaculaires mais plus sérieuses, sous peine de voir des résultats péniblement acquis en quelques semaines invalidés par l'absence de prise en charge ultérieure, comme c'est le cas actuellement.
Avant de conclure cet exposé par une liste récapitulative de propositions, je voudrais encore insister sur une double nécessité.
Le principal reproche que l'on peut adresser aux divers intervenants dans le champ de la délinquance juvénile est sans doute de travailler en ordre dispersé, sans trop se soucier des actions qui sont menées par les institutions voisines, sinon pour leur attribuer la responsabilité des échecs communs.
Il paraît donc nécessaire de leur proposer, sinon de leur imposer, des séquences transversales de formation permanente.
Par ailleurs, et sans entrer dans un débat sur l'efficacité de la répression, il faut noter qu'aucune structure partenariale n'existe actuellement pour prendre en charge la réinsertion des mineurs sortant de prison.
Les collectivités locales ne peuvent continuer à exiger la mise hors d'état de nuire d'individus aussi jeunes sans se préoccuper d'offrir, après que la justice est passée, des prolongements qui peuvent seuls décourager la récidive. C'est une lacune qui doit être rapidement comblée.
Mon exposé étant terminé, me permettez-vous maintenant, Monsieur le président, de vous présenter mes propositions ?
M. le président - Je vous en prie !
M. Alain Bruel - J'ai essayé de faire des propositions dans quatre directions correspondant à chacun des sujets qui ont été abordés, à savoir : améliorer la connaissance objective de la délinquance des mineurs ; mettre en place une politique économique et sociale plus équitable envers les jeunes ; recentrer la politique de la ville sur les populations les plus en difficulté ; enfin, optimiser les capacités de traitement de la jeunesse délinquante.
S'agissant de la première direction, je n'ai qu'une proposition à faire, mais elle est importante : il faudrait créer un observatoire de la délinquance indépendant à composition multidisciplinaire qui aurait pour tâche la conception des statistiques et leur interprétation, la mise en cohérence des logiciels des différents ministères, l'exercice d'actions de formation auprès des médias -notamment en liaison avec les écoles de journalisme-, l'organisation de rencontres entre policiers, magistrats, surveillants pénitentiaires et travailleurs sociaux. Cet observatoire s'apparenterait plutôt à un centre de recherche où divers spécialistes et diverses disciplines pourraient se croiser. Je crois d'ailleurs que cette proposition a été faite par plus important que moi.
Par ailleurs, il convient de mettre en place une politique économique et sociale plus équitable envers les jeunes. Je propose -je ne sais pas ce que vous en penserez- de créer une mission parlementaire de réflexion sur la justice entre les générations.
Il faudrait également mettre en oeuvre les propositions de la commission « Jeunes et politiques publiques » du commissariat général du Plan, dont j'ai parlé tout à l'heure.
On pourrait imaginer des rituels sociaux de reconnaissance et de valorisation des conduites citoyennes chez les jeunes. Je suis frappé de voir qu'il n'existe aucun moyen d'honorer publiquement un jeune qui aurait eu une conduite citoyenne. Pourtant, il existe des jeunes qui ne font pas que des bêtises. Je pense que la transposition de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite ne leur serait probablement pas adaptée, mais ils seraient certainement sensibles à toute reconnaissance qui pourrait leur être attribuée.
Il serait envisageable de créer des points d'accès au droit à proximité des écoles, des centres de loisirs, des hôpitaux et autres lieux fréquentés par les jeunes.
On pourrait développer les expériences d'intermédiation culturelle impliquant des anthropologues et des ethnologues dans le fonctionnement des principales institutions. Au tribunal pour enfants, nous avions fait une expérience de ce genre avec des anthropologues. Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions beaucoup avancer dans la communication avec des familles d'origines culturelles différentes, à condition de faire appel à une personne qui fasse un peu plus que de l'interprétariat linguistique et qui, grâce à une analyse culturelle, permette à chacun de faire le pas qui est nécessaire.
La troisième direction consiste à recentrer la politique de la ville sur les populations les plus en difficulté. Il faut d'abord renforcer la prévention spécialisée et redéfinir ses objectifs. Vous avez compris que je reproche essentiellement à la politique de la ville d'avoir effacé tout ce qui s'était fait antérieurement, et d'avoir notamment négligé la prévention spécialisée. Il faudrait y revenir, au moins pour partie.
Il conviendrait de développer les moyens des inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile et d'implanter de nouvelles structures de prise en charge de certains handicaps. Dans la région parisienne, on manque d'établissements spécialisés, notamment pour certains handicaps mentaux.
Au tribunal pour enfants, nous avons souvent eu affaire à des jeunes non scolarisés dans la mesure où ils ne pouvaient pas être accueillis par l'éducation nationale et où il n'existait aucune structure dans laquelle la commission départementale de l'éducation spéciale aurait pu les envoyer.
La politique d'aide et de soutien à la parentalité doit être relancée en encourageant la création de maisons de parents et la mise en place de groupes de parole. Vous avez fait allusion à ce problème. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, car il est important de donner aux parents la place qui leur revient dans la lutte contre la délinquance.
Il serait souhaitable de développer les internats scolaires et les classes-relais, même si ce système est déjà bien en place.
Il conviendrait de redéployer les services publics et d'élargir leurs horaires d'ouverture en soirée et pendant une partie des week-end dans les quartiers en difficulté.
Une occupation plus équilibrée de l'espace public devrait être favorisée en échelonnant les occasions de regroupement de façon à mêler à toute heure du jour adultes et jeunes. Il y a peut-être une politique d'animation à mener dans les quartiers afin que les jeunes ne soient pas les maîtres de la rue à certaines heures et les adultes omniprésents à d'autres heures.
Enfin, la quatrième orientation concerne plus précisément ce que j'ai pu constater au cours de mon expérience professionnelle.
Au niveau policier, il faudrait préciser les missions de la police de proximité au regard des médiations effectuées par les autres acteurs de la ville et revoir les conditions d'exercice des contrôles d'identité. Ce dernier point est régulièrement évoqué ; les jeunes se plaignent en effet d'être contrôlés trois fois par jour par des policiers qui les connaissent par coeur. Ils le ressentent comme une forme de vexation, comme une marque d'autorité sur eux. Autant un contrôle d'identité pour des circonstances relativement exceptionnelles se justifie, autant on peut comprendre les réactions de ceux qui sont contrôlés trois fois par jour.
Une police judiciaire spécialisée pourrait être créée, au besoin en étoffant les brigades de protection des mineurs et en leur donnant compétence à l'égard des jeunes délinquants.
Il y a plus de trente ans, lorsque j'étais en poste à Toulouse, j'ai bien connu une des brigades des mineurs qui s'occupaient de délinquants. Je me souviens d'un commissaire qui m'amenait lui-même « par l'oreille » les jeunes qui étaient déférés. Il me disait alors : « Je vous amène ce jeune pour un vol de disques, mais, en réalité, c'est un pirate qui a très mauvaise réputation dans son quartier. Ne prenez surtout pas ce vol de disques pour une broutille ! » Inversement, il arrivait qu'il me dise : « Compte tenu des conditions de vie de ce jeune, du taudis dans lequel il habite et de l'absence de son père, il ne faut pas être trop sévère à son égard, car il peut difficilement faire autre chose ».
Ce type d'explication par rapport au procès-verbal officiel m'était extrêmement utile, de sorte que mes décisions étaient, à l'époque, relativement bien perçues dans le quartier, ou en tout cas ne « détonaient » pas. Aujourd'hui, les magistrats, qui n'ont plus ce lien direct avec une police spécialisée, prennent quelquefois des décisions qui font scandale, soit parce qu'elles sont trop répressives, soit parce qu'ils n'ont pas mesuré leur résonance sociale.
Au niveau judiciaire, il est nécessaire de redresser la politique des services judiciaires et des chefs de juridiction pour les obliger à respecter la spécialisation. On ne peut pas être un bon juge des enfants sans un minimum d'expérience et de longévité dans son poste. Or la spécialisation n'est prise en compte ni par les chefs de juridiction ni par les services judiciaires. Ils le reconnaissent d'ailleurs.
Des garanties identiques doivent être données au parquet des mineurs. Dans l'optique d'une éventuelle réforme de l'ordonnance de 1945, il faut donner aux mineurs l'effectivité du droit d'appel et les assurer de la présence d'un même défenseur spécialisé pendant toute la durée de la procédure, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Il conviendrait de développer l'exécution des peines en semi-liberté et de créer des mesures éducatives d'investigation sur l'environnement extra-familial des mineurs délinquants. Les juges sont actuellement renseignés sur la psychologie du mineur, sur ses relations avec sa famille, mais ne savent rien sur son appartenance dans le quartier, sur ses occupations, ses activités sportives, sur les clubs dont il peut faire partie et les bandes auxquelles il peut être inféodé.
Tant au niveau policier -grâce à la police de proximité- qu'au niveau éducatif, il faudrait que les services se réorientent, ou du moins élargissent leurs investigations dans ce domaine.
M. le président - On pourrait imaginer que le juge s'interroge et demande un complément d'informations. Pourquoi cela ne se ferait-il pas ?
M. Alain Bruel - Je l'ai fait moi-même, monsieur le président, mais les choses ne changent pas toujours sur un claquement de doigts. Les demandes que j'ai pu faire en la matière ont été écoutées avec beaucoup d'attention ; mais, pour qu'elles se traduisent dans les faits, cela supposait que les personnels eux-mêmes soient conscients de cette lacune et que les embauches se fassent sur des critères un peu différents. On pourrait envisager d'embaucher un anthropologue ou un ethnologue au lieu d'un psychologue, mais ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas rencontré d'opposition de principe, mais, pendant mes deux dernières années de fonction, j'ai constaté que mes demandes n'avaient pas beaucoup d'effet.
Il serait utile de redéfinir la mesure de réparation que peut ordonner le juge des enfants pour la distinguer de la médiation. Il y a souvent une certaine confusion entre les deux notions.
Par ailleurs, les éducateurs pourraient avoir, pendant toute la durée de la procédure, la possibilité de proposer au juge d'ordonner cette mesure. Le texte actuel de l'ordonnance de 1945 donne l'initiative au magistrat. C'est lui qui propose au jeune une mesure de réparation ou qui lui demande d'établir un projet de réparation. Les magistrats n'ont pas toujours -surtout lors des permanences, où ils voient défiler devant eux beaucoup de jeunes- l'idée de faire cette proposition.
C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable de réformer le texte. Ainsi, pendant toute la durée de la procédure, les éducateurs, les psychologues, les assistantes sociales et les travailleurs sociaux qui sont en contact avec le mineur pourraient, s'ils décèlent un minimum de perméabilité à une entreprise de réparation, en suggérer immédiatement l'application au magistrat. Aujourd'hui, les magistrats ne s'y aventurent que de manière frileuse. Certaines mesures de réparation sont très intéressantes, mais leur nombre est bien trop peu important.
M. le président - Je reviens à ma question. Pourquoi cela ne se ferait-il pas spontanément ? Pourquoi un dialogue ne s'instaurerait-il pas entre tous ces gens qui travaillent ensemble ? On pourrait imaginer que les travailleurs sociaux, les éducateurs et tous ceux qui interviennent, à un titre ou à un autre, puissent s'adresser au juge des enfants.
M. Alain Bruel - Cela arrive, monsieur le président, et je suis persuadé que, lorsque les résultats sont bons, c'est très souvent parce que tout s'est passé de cette manière. En fait, aux termes du texte, l'initiative d'une telle décision peut être prise par le procureur, le juge des enfants, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. Les éducateurs n'y figurent que comme éventuels accompagnateurs de l'application. D'ailleurs, certains magistrats sont très jaloux de leurs prérogatives et ne prêtent pas une oreille très attentive aux propositions qui leur sont faites. Parallèlement, nombre d'éducateurs ne font aucune suggestion dans la mesure où ce n'est pas prévu, même si certains s'autorisent à intervenir. En fait, tout dépend de la manière dont fonctionne le binôme éducation-justice qui peut être plus ou moins proche.
M. le président - Cela devrait faire partie de la formation des magistrats !
M. Alain Bruel - Tout à fait ! Cela fait d'ailleurs l'objet de l'avant dernière proposition, qui vise à rendre obligatoires des sessions de formation permanente transversale entre les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les surveillants pénitentiaires -du moins les surveillants spécialisés, puisque vous savez que, maintenant, ce sont des surveillants spécialisés qui opèrent dans les quartiers des mineurs-, les policiers spécialisés, dont j'appelle la création de mes voeux, et les magistrats de la jeunesse. Actuellement, chacun travaille du mieux possible dans son secteur. Quand il y a un échec, on l'impute aux autres.
Pour nous, la faute incombe à la police, et je suis sûr que la police la fait porter sur la justice. De la même façon, policiers et magistrats peuvent se mettre d'accord pour rejeter la faute sur le dos des éducateurs, etc. Cela fait déjà plusieurs années que j'ai suggéré l'organisation de ces sessions. J'ai rencontré un écho très favorable auprès de la direction de l'Ecole nationale de la magistrature. Mais, lorsque je me suis renseigné, on m'a dit que l'on avait tenté l'expérience sans grand succès auprès des magistrats. A la sortie de l'ENM, il ne leur paraît sans doute pas compatible avec leur dignité de partager des formations avec des éducateurs.
Dans les années 1970, j'ai bénéficié de ce type de formation . Cela a duré quelques années, au cours desquelles j'ai appris énormément. J'ai le sentiment que j'en ai plus appris à ce moment-là que pendant le reste de ma carrière. Ces sessions, qui avaient lieu à Vaucresson, duraient quatre ou cinq jours. Elles rassemblaient le psychologue de Brest, le directeur d'établissement d'Avignon, le juge des enfants de Toulouse, le substitut de Marseille... Toutes ces personnes, qui se trouvaient dispersées à travers la France et qui n'avaient donc pas l'habitude d'être en relation, pouvaient communiquer aux autres comment elles percevaient l'action du magistrat, de l'éducateur ou du psychologue. J'en ai entendu des « vertes et des pas mûres » sur les collègues qui travaillaient avec ces personnes. Cela m'a permis d'en « prendre de la graine » et d'éviter un certain nombre d'erreurs, qui auraient pu être catastrophiques pour nos partenaires.
J'en viens à la dernière proposition, qui est tout à fait novatrice. Je ne voudrais pas enfoncer une porte ouverte, mais je dirai que l'exercice de la justice doit s'accompagner d'un certain nombre de garanties. Bien évidemment, il ne faut pas condamner des innocents ou, tout au moins, n'en condamner que très rarement.
Il faut garder une certaine distance, respecter la procédure, donner des garanties de défense et, éventuellement, punir ; dans ce cas, c'est souvent pour quinze jours, un mois, trois mois, six mois. Il est rare que l'on prononce à l'encontre des jeunes des peines d'emprisonnement de plus d'un an ou deux. On se demande toujours ce qui en résultera.
Tout reste à faire à la sortie de l'incarcération, alors que les magistrats ne peuvent plus rien faire. Il serait donc souhaitable de créer localement des commissions locales de réinsertion qui regrouperaient des représentants des collectivités locales et des intervenants du champ judiciaire. Tous ces partenaires pourraient alors s'interroger sur les moyens d'éviter qu'un jeune sortant de prison ne retombe dans ses erreurs passées. Dans quel lycée devra-t-il aller ? Pourra-t-il retravailler, avoir un logement, etc. ? Une réflexion très positive pourrait être ainsi réalisée sur la prévention de la récidive.
Je terminerai mon exposé par une anecdote.
Les premières unités à encadrement renforcé ont été créées au compte-gouttes. Mais le premier jeune qui a été placé dans l'une d'elles par un juge des enfants parisien est revenu ravi au bout de deux mois de séjour. On lui avait fait faire de la varappe, et je ne sais plus combien de choses passionnantes. Il s'était dépassé lui-même. Il a alors dit au juge : « Je vous remercie, car j'ai réappris la discipline, le sens de l'effort. Maintenant, donnez-moi un boulot et une chambre en ville, je démarre ». Or le juge n'avait ni boulot ni chambre en ville. Qu'est devenu ce jeune, plein de bonne volonté ? Je n'ose y réfléchir !
M. le président - Monsieur, je vous remercie de votre exposé. Je vais maintenant donner la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent vous poser des questions.
M. le rapporteur - Je n'ai malheureusement plus le temps de vous poser les questions que j'avais préparées, qui portaient sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur l'éventail des structures d'accueil et sur la réserve que vous aviez émise en 1996 à propos de la procédure de comparution à délai rapproché ; mais peut-être pourrez vous nous répondre par écrit.
M. Alain Bruel - Sur la première question, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre sans commettre d'erreur, je crois qu'il faut savoir le reconnaître.
J'ai pris ma retraite il y a deux ans. Depuis deux ans, des CPI et des CER ont été créés ; j'ai eu des échos, j'en ai même beaucoup, mais je crains qu'ils ne soient orientés. Je ne peux pas garantir.
M. le président - Ce scrupule vous honore.
Audition de M. Jean-Marie PETITCLERC,
éducateur
spécialisé,
Directeur de l'association Valdocco
(27
mars 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons maintenant entendre M. Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé, qui dirige actuellement l'association Valdocco à Argenteuil et qui a publié plusieurs ouvrages sur la prévention spécialisée, sur les banlieues ou sur la violence des jeunes.
( M. le Président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Vous avez la parole.
M. Jean-Marie Petitclerc - Permettez-moi une brève présentation de mon parcours professionnel, qui situera l'angle de vue sur ces problèmes.
Voilà près de vingt-cinq ans que je travaille comme éducateur spécialisé auprès d'adolescents en difficulté majoritairement issus des quartiers sensibles. J'ai fondé, puis dirigé pendant cinq ans le club de prévention spécialisée à Chanteloup-les-Vignes. J'ai dirigé ensuite, pendant une dizaine d'années, un foyer d'action éducative habilité « justice » qui accueillait des mineurs majoritairement confiés par des magistrats, soit au titre de la loi de 1970, soit au titre de l'ordonnance de 1945. J'ai été rappelé à Chanteloup au moment des émeutes urbaines de 1991, et c'est dans ce contexte que j'ai initié ce mode d'intervention que l'on qualifie aujourd'hui de « médiation sociale ». Actuellement, comme on vous l'a dit, je travaille à la direction de l'association Valdocco, qui mène des actions de prévention auprès des enfants et des adolescents en difficulté du quartier sensible du Val d'Argent Nord à Argenteuil.
La plus grande difficulté des enfants et des adolescents que je côtoie au quotidien, c'est qu'ils passent tous les jours par trois lieux : la famille, l'école et la rue. Dans chacun de ces lieux, des adultes font référence : les parents dans la famille ; les enseignants à l'école ; les aînés dans la rue - et l'on sait le poids de la parole des aînés.
Et ces trois catégories d'adultes, qui, qu'on le veuille ou non, font référence et transmettent des repères, sont dans un discours de discrédit mutuel : les enseignants parlent des parents démissionnaires et des voyous de la rue ; les parents disent que les enseignants ne savent plus faire leur travail et ne sont même plus capables d'assurer la discipline, et parlent de la mauvaise influence de la rue ; les aînés disent : « Que tu travailles ou que tu ne travailles pas au collège, tu es dans un collège sans avenir », et, malheureusement, le fossé s'est creusé entre collèges des quartiers sensibles et collèges des centres-villes. Les aînés disent également : « tes vieux sont d'une autre génération, ils ne comprennent plus grand chose à grand chose ».
Autrement dit, l'enfant ou l'adolescent grandit dans trois lieux marqués par trois cultures différentes : la sphère familiale, encore influencée par la culture d'origine ; la sphère scolaire, influencée par la culture républicaine ; la sphère de la rue, influencée par la culture des banlieues.
Nous essayons, au Valdocco, de développer une approche globale de l'enfant et de l'adolescent en l'accompagnant dans ces trois champs, une même équipe d'éducateurs le rejoignant sur la rue -animations de rue des enfants, travail de rue auprès des adolescents dans le cadre d'un agrément de prévention spécialisée-, dans la sphère scolaire -soutien scolaire, médiation famille-école- et dans la sphère familiale, puisque nous sommes agréés dans le réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents.
Je travaille également à temps partiel, comme chargé de mission au cabinet du président du conseil général des Yvelines, sur les questions de prévention de délinquance sur les sites sensibles de ce département.
Il n'est pas évident, en un bon quart d'heure, de présenter les réflexions sur l'évolution de la délinquance juvénile et sur l'inadéquation du système de réponse actuel.
Je me permettrai d'articuler mon intervention autour de deux volets : dans un premier temps, quelques réflexions générales d'un homme de terrain, qui permettront de poser la problématique, et, dans un deuxième temps, quelques réflexions sur les réponses qui me semblent devoir être envisagées aujourd'hui si nous voulons continuer d'être pertinents face aux problèmes posés par le comportement de ces jeunes.
Je commencerai donc par quelques réflexions.
Nous sommes stupéfaits par l'évolution de la délinquance juvénile, qui, selon les chiffres, a doublé en une dizaine d'années, et non pas tant par son évolution quantitative que par son évolution qualitative : une massification de la petite délinquance qui entraîne un déplacement des normes, un rajeunissement de l'âge d'entrée en délinquance et une formidable montée de la violence.
Première réflexion, nous passons, je crois, d'une délinquance de type utilitaire -80 % des délits commis par les jeunes étaient, dans les années quatre-vingt, de l'ordre du vol- à une délinquance qui, pour une large part, pourrait être qualifiée de symbolique : le jeune qui casse un abri-bus, le jeune qui agresse un passant, le jeune qui incendie une voiture, cela ne lui rapporte rien ! Nous sentons bien qu'à côté de cette délinquance utilitaire, qui continue d'exister et qui alimente les réseaux d'économie parallèle dans nos quartiers, apparaît chez les plus jeunes un autre type de délinquance, une délinquance que je qualifierai d'« expressive ».
La grosse difficulté, aujourd'hui, tient à ce que le registre de signification de la délinquance a considérablement évolué alors que le mode de réponse est resté le même.
Deuxième réflexion, on présente souvent les jeunes comme étant les acteurs, les facteurs, les auteurs de cette violence. N'oublions pas qu'ils en sont les premières victimes et que 80 % des actes de violence commis par les mineurs le sont à l'encontre d'autres mineurs ! Quatre faits sur cinq ! Autrement dit, dans notre pays, le climat de violence qui règne est ressenti quatre fois plus douloureusement par les mineurs que par les adultes : comme j'aime à le rappeler aux politiques, il est plus dangereux d'être jeune collégien dans un collège de quartier sensible que d'être enseignant dans un collège de quartier sensible, il est plus dangereux d'être jeune habitant d'un quartier sensible que d'être éducateur dans un quartier sensible.
Troisième réflexion, la violence n'est pas en soi un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau et inquiétant, aujourd'hui, c'est le manque d'intégration des repères et des limites : les jeunes sont capables de mettre leur vie en jeu pour des motifs complètement futiles, on l'a encore vu ces derniers temps.
Le deuxième phénomène nouveau, c'est la décrédibilisation des adultes dans la fonction de régulateurs de cette violence. Car, ne l'oublions pas, comme dit Comte-Sponville, la violence est naturelle : tous les scénarios d'enfant sauvage sont des scénarios d'enfant violent ! Chaque fois qu'il m'est donné de mener un audit dans un collège de quartier sensible marqué par d'intenses phénomènes de violence, je commence par dire aux enseignants : « Vous réunissez six cents adolescents dans un lieu, il y a énormément de violence, c'est complètement naturel ! » Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix, c'est la capacité d'établir une relation pacifique avec l'autre.
Autrement dit, la violence des jeunes n'est pas d'abord un problème de jeunes. J'entends beaucoup de parents, d'animateurs, d'enseignants, me dire : « Que se passe-t-il ? Ils deviennent de plus en plus violents, et de plus en plus tôt ! » Le bébé du XXIème siècle ne naît pas plus violent que le bébé du XXème : la violence des jeunes, c'est un problème d'adultes, et la question que nous avons à nous poser est de savoir pourquoi notre génération d'adultes est à ce point en difficulté, comparée aux générations précédentes, pour assurer l'apprentissage de la régulation de l'agressivité et de la violence chez la génération suivante. Car il revient toujours aux adultes d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent à réguler sa violence.
En d'autres termes, le problème central de notre société, c'est celui de l'éducation, et je rejoins ici l'intuition de ce pédagogue du XIXème siècle que fut Jean Bosco.
Deux grandes difficultés, aujourd'hui, font que cette éducation à la régulation de la violence dysfonctionne, et la première est la perte de crédibilité des adultes. On parle beaucoup d'un manque d'autorité auprès des jeunes générations, je crois qu'il s'agit beaucoup plus d'un manque de crédibilité des porteurs d'autorité :
Perte de crédibilité des parents, que l'on accuse d'être démissionnaires ; j'en rencontre bien plus qui sont dépassés et qui ne se sentent plus crédibles ;
Perte de crédibilité des enseignants, dans une école qui a du mal à assurer sa mission de promotion sociale, car une mesure comme celle de la carte scolaire, excellente lorsqu'il y avait mixité sociale, devient catastrophique lorsque celle-ci n'existe plus dans un quartier ;
Perte de crédibilité des policiers et des magistrats, qui très souvent se discréditent les uns les autres face aux jeunes ;
Perte de crédibilité des politiques : comment éduquer au rapport à la loi quand ceux qui sont chargés de la promulguer, chargés d'en être les garants, sont dénoncés à longueur de colonne dans les médias comme étant ceux qui truquent la loi ?
Deuxième difficulté, il nous faut sortir du faux dilemme, du faux débat entre prévention et répression dans lequel, depuis quarante ans, on a enfermé la réflexion sur la délinquance dans notre pays. Il faut réhabiliter la sanction d'un point de vue éducatif, et je rangerai la sanction du côté de la prévention. Sortons de ce faux débat qui nous a conduits à avoir un corps, celui des éducateurs, voulant éduquer sans sanctionner, et un autre corps qui aurait la prétention de sanctionner sans éduquer.
Réhabilitons la sanction dans le chemin éducatif et articulons plutôt prévention persuasive et prévention dissuasive. Éduquer le jeune tenté de passer à l'acte délinquant nécessite la prévention persuasive : suivre la loi sera synonyme pour lui de son propre intérêt, et il faut alors continuer à former des gens pour rester présents à ses côtés. Prévention dissuasive : si, effectivement, tu transgresses la règle, il y aura une réponse ; et là, ayons conscience que notre système n'est plus crédible.
Je rencontre beaucoup d'adolescents maghrébins multirécidivistes. Certains magistrats ont tendance à psychiatriser le problème, et pourtant, lorsque ces jeunes passent un mois d'été « au pays », comme ils disent, ils cessent toute activité délinquante. Comme quoi ce style de délinquance est aussi lié à une excellente connaissance des failles de notre système !
Cette réflexion m'amène à évoquer les réponses et les améliorations à apporter à notre système de réponse.
Je pointerai trois grandes difficultés.
S'il me fallait être bref -et je risque d'être caricatural, je vous prie de m'en excuser-, je dirais que ce qui dysfonctionne aujourd'hui, c'est l'absence de réponse face à la primo-délinquance, l'incohérence de nos réponses face à la délinquance, l'inefficience de nos réponses face à la multidélinquance.
Première difficulté : l'absence de réponse face à la primo-délinquance.
Le système judiciaire de réponse à la délinquance est fondé sur ce principe, non explicité, mais tellement inscrit dans les pratiques, qui a peut-être sa légitimité du côté des adultes, mais qui, à mes yeux, s'avère désastreux d'un point de vue pédagogique : la première fois, ce n'est pas grave ; ce qui est grave, c'est de recommencer. Or, je suis de ceux qui pensent, comme bon nombre de parents, que si l'on n'apporte pas une réponse crédible à la première transgression, on se discrédite pour la suite.
Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'avec l'avancée de l'âge d'entrée en adolescence -sachons que les jeunes sont dix-huit mois plus tôt pubères qu'ils ne l'étaient en 1945- cette délinquance apparaît avant cet âge de treize ans et que, actuellement, nous n'avons aucune réponse face à la délinquance enfantine. Le problème nouveau qui se pose dans notre pays, c'est qu'il nous faut inventer une telle réponse, et voilà pourquoi je suis de ceux qui militent pour une réforme de l'ordonnance de 1945 et pour la possibilité de sanction dès l'âge de onze ans, mais une sanction, bien sûr, de type réparation.
Je ne pense pas que l'appareil policier et judiciaire soit le mieux à même d'apporter cette réponse. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt d'un commissaire de police de faire courir des risques à une patrouille entière de policiers en menant dans un quartier l'arrestation d'un gamin de onze ans qui a balancé un caillou dans un abri-bus, ni que les juges aient à s'encombrer d'un tel dossier.
Je pense pour ma part qu'il nous faudrait développer des réponses de proximité sous l'égide du maire et, bien sûr, sous contrôle du procureur. Il me semble tout à fait normal qu'un principal de collège ait le pouvoir de convoquer un gamin qui a cassé le CDI, de convoquer ses parents et d'organiser la sanction. Je ne crois pas que la République serait en danger si un délégué du maire avait le pouvoir de convoquer un gamin qui a commis un petit délit sur la voie publique, de convoquer ses parents et d'organiser la sanction. Nous avons trop affaibli le pouvoir disciplinaire de nos institutions, si bien que nous assistons à un véritable encombrement de la justice des mineurs, laquelle, bien sûr, va alors traiter les choses graves, ne traite plus la primo-délinquance : la spirale infernale commence à jouer. Tous les adolescents multirécidivistes que j'ai rencontrés ont deux caractéristiques communes : leur premier délit était de faible importance, et il n'a pas appelé de réponse.
Deuxième difficulté : l'incohérence des réponses face à la délinquance.
Je vous ai parlé de la difficulté majeure de ces jeunes qui circulent entre trois lieux marqués par des cultures différentes. L'important, aujourd'hui, est de donner sens à la sanction, ce qui ne peut se construire que par le partenariat entre tous les adultes qui accompagnent l'enfant et l'adolescent sur des chemins de croissance. Aussi, je crois que nous devons sortir du schéma selon lequel, lorsqu'un jeune pose problème par sa délinquance, il faut faire appel au spécialiste qui, au nom de ses compétences, saura traiter le problème. Je pense au contraire que, lorsqu'un jeune a un comportement délinquant, il alerte l'ensemble du système des adultes qui l'accompagnent et qu'il faut que ceux-ci travaillent ensemble à un projet commun.
Voilà pourquoi le dispositif « Pôle d'accueil, Maison de l'espoir » que préconise le conseil général des Yvelines -dispositif né du rapport sur la violence des villes en 1992, mais qui n'est toujours pas mis en oeuvre à cause de l'inertie des institutions- apporte deux réponses originales. La première, c'est de concevoir l'éducateur non pas comme le spécialiste qui va intervenir auprès du jeune, mais comme la personne qui va utiliser ses compétences pour tenter d'apporter une cohérence au projet dans lequel les différents adultes qui accompagnent le jeune -la famille, les enseignants, les animateurs, les policiers de proximité, les éducateurs- sont partie prenante : il s'agit de travailler dans la cohérence.
La deuxième réponse originale est de travailler dans la durée. Nous savons bien qu'il n'est pas concevable que ces jeunes qui posent problème, en particulier par leur violence, puissent rester tout le temps dans le quartier, car, de temps en temps, ils font planer une menace. Il n'est pas concevable non plus qu'ils restent enfermés longtemps dans un centre, car l'équipe éducative n'est pas capable de gérer la violence interne. Autrement dit, nous savons bien qu'il y aura forcément des allers et retours entre une prise en charge à distance et une prise en charge de proximité.
Ce qui dysfonctionne dans notre système, aujourd'hui, c'est que ces deux types de prise en charge ne se rencontrent absolument pas. Une équipe d'éducateurs de prévention connaît un jeune depuis longtemps, le danger est trop grand, il est placé ; tout le savoir est perdu, et l'institution démarre à zéro. Ce jeune a été placé, un bon travail est effectué pendant six mois, il ressort suite à un fait de violence ; il revient sur le quartier : l'équipe de prévention qui reprend le relais ne connaît quasiment rien de tout ce qui a pu se jouer, en termes éducatifs, dans le centre.
Autrement dit, il semble qu'il nous faudrait inventer, pour être plus pertinents dans la prise en charge de ces jeunes posant des actes de délinquance, une prise en charge dans la durée alternant des phases de proximité et des phases de mise à distance, avec une référence éducative stable. J'insiste sur la référence éducative stable, car nous nous apercevons que, dans notre système, les jeunes les plus en difficulté sont aussi ceux dont les parcours éducatifs sont marqués par le plus grand nombre de ruptures -la politique de la patate chaude, dans laquelle les institutions se les refilent.
Troisième difficulté : l'inefficience de nos modes d'intervention auprès des multirécidivistes.
Nous savons que la prison n'est pas une solution. Nous savons que les laisser dans les quartiers n'est pas une solution. Alors, on nous parle aujourd'hui de centres éducatifs fermés. Il faut savoir qu'aujourd'hui aucun éducateur n'est formé pour travailler dans un tel type de centre : si l'on s'orientait vers ce dispositif, il faudrait d'abord revoir la formation des personnels.
Mais je pense qu'entre le tout ouvert et le tout fermé s'ouvre une piste, celle du centre semi-fermé. Il s'agit de renforcer le pouvoir disciplinaire du directeur du centre, qui doit être en mesure, si, effectivement, le jeune ne respecte pas le contrat, de le faire glisser dans un régime fermé pour quelques jours. Mais il me semble -en tout cas, c'est une conviction de l'éducateur que je suis- qu'on ne peut travailler dans le domaine éducatif que sous l'angle du contrat éducatif, que l'important est de pouvoir sanctionner le non-respect du contrat. Il serait préférable aujourd'hui de travailler sur cette notion de centre semi-fermé dont la vocation serait d'être ouvert, mais qui pourrait apporter une réponse de fermeture lorsque le contrat ne serait pas respecté ; alors que, aujourd'hui, nous avons des centres tout ouverts dans lesquels, lorsque le jeune ne respecte pas le contrat, rien ne se passe.
Ma conclusion sera double.
La première urgence est celle de l'innovation.
Il me paraît tout à fait normal que notre système arrive à bout de souffle, car il apparaît que la durée de vie d'un système de réponse aux jeunes en difficulté est de l'ordre de vingt-cinq ans. En 1945, nous avons eu le courage de tout remettre à plat : fondation des tribunaux pour enfants, des grands centres éducatifs. En 1970, nous nous sommes rendu compte de l'inadéquation des réponses apportées par les grosses institutions, et nous avons eu le courage de tout remettre à plat ; c'était un petit peu le mode de l'intervention psychologique. En 1995, alors que nous assistions à l'émergence de tous ces grands phénomènes de violence collective dans nos quartiers, il aurait fallu avoir le courage de tout remettre à plat. Nous ne l'avons pas fait, et nous continuons de fonctionner aujourd'hui sur le mode issu des années soixante-dix. Ne nous étonnons pas qu'il y ait des dysfonctionnements !
Compte tenu de l'histoire de notre secteur, sur laquelle je me suis penché, il ne me paraît pas imaginable qu'un cabinet ministériel, même le plus performant, soit capable d'inventer le système qui permettrait de prendre en compte les véritables difficultés actuelles. L'histoire montre que les inventions sont toujours nées de l'action sur le terrain de grands pédagogues qui ont été capables d'innover, d'inventer de nouveaux types de prise en charge ; ensuite vient le temps de la modélisation de ce qui a fonctionné.
Voilà pourquoi il me semble qu'aujourd'hui, face à l'ampleur du problème posé, il faut développer les capacités d'innovation : innovation dans les types de réponse à la primo-délinquance, dans le registre de la proximité ; innovation dans une réponse de type « Pôle d'accueil, Maison de l'espoir » ; innovation dans une réponse de type centre éducatif semi-fermé. Il faut, sur la base d'une expérimentation -mais le cadre législatif devrait effectivement permettre de telles expérimentations !-, se donner les moyens d'évaluer puis de faire tout un travail de modélisation de ce qui a fonctionné. Sachons que, depuis le XVIIIème siècle, notre secteur a toujours travaillé ainsi.
La deuxième urgence est celle de la formation.
Ces nouveaux dispositifs exigeront de nouveaux professionnels. Il nous faut sortir de l'éducateur spécialiste qui, au nom de ses compétences, réussira là où les autres ont échoué ; sortir de tout ce corporatisme qui voit chacun se créer sa propre déontologie, et c'est le gamin qui fera les frais de la confrontation à des déontologies différentes ; sortir de ces présupposés idéologiques selon lesquels il faudrait ne jamais enfermer, ne jamais éloigner... Non, il nous faut retrouver un certain type de pragmatisme si nous voulons être capables d'inventer les réponses pertinentes.
Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau mandat, il me semble urgent de tester de nouvelles réponses à la primo-délinquance ; car, vous le savez, lorsque l'on veut réformer l'éducation nationale, on commence par réformer les sixièmes, puis, un an après, les cinquièmes..., puis, trois ans après, le lycée. L'urgence serait donc de réformer notre mode d'action sur les onze-treize ans, deux ans après celui sur les treize-quinze ans, deux ans après celui sur les quinze-dix-huit ans. On prend le problème à l'envers en se centrant aujourd'hui sur les mineurs les plus récidivistes, qui, par leur comportement, montrent les dysfonctionnements du système.
Pour permettre l'innovation, nous avons besoin d'un certain type de marges. Or, actuellement, lorsque les jeunes sont sous le contrôle d'adultes, le système est hyper-réglementé, alors que, à côté, il leur laisse prendre les risques les plus grands. Une toute petite anecdote : au mois d'août, alors que j'étais en camp avec douze adolescents en grande difficulté d'Argenteuil, au fin fond de la Bretagne, à 14 heures, en plein démarrage d'activités, un inspecteur de l'hygiène est venu avec son thermomètre mesurer la température de la glacière, qui dépassait la norme de deux degrés ; 8 000 jeunes étaient à proximité pour une rave-partie, la drogue y circulait... L'écart entre cette sur-réglementation d'un côté et cette déréglementation de l'autre est devenu aujourd'hui insupportable et ne permet pas l'innovation.
Enfin, pour revenir à la deuxième urgence que j'évoquais, celle de la formation du personnel, je crois qu'il nous faut travailler à une refonte des programmes de formation des travailleurs sociaux.
M. le président - Merci, Monsieur. J'ai personnellement apprécié la clarté de votre exposé, qui était tout à fait intéressant.
Notre rapporteur a malheureusement dû repartir en province ; il est remplacé par M. Bernard Plasait, qui a la parole.
M. Bernard Plasait, en remplacement de M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie, monsieur, de votre passionnant exposé, de votre présentation à la fois très complète et très originale.
Vous avez en réalité déjà répondu aux questions que j'avais préparées. Plutôt que de vous demander de vous répéter, j'essaierai donc de mieux comprendre ce que vous avez dit à propos des centres semi-fermés.
Nos auditions et nos visites sur le terrain nous ont toutes permis de constater un consensus sur l'ordonnance de 1945, sur son esprit, qui donne la priorité à l'éducation, sur le fait qu'elle est en soi très complète et que, s'il faut lui apporter des modifications, c'est de façon tout à fait ponctuelle, bref, qu'il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Il est également clair que, si la prison n'est pas la solution, il arrive toujours un moment où l'enfermement, le retrait du délinquant de son milieu est absolument nécessaire.
Sur ce dernier point, la plupart pensent qu'il faut des centres de placement immédiat, mais aussi des centres d'éducation renforcée fermés. Cependant, une autre opinion s'est manifestée selon laquelle ces centres d'éducation fermés, qui seraient de nouvelles maisons de correction, présentant les mêmes causes, produiraient les mêmes effets et les mêmes inconvénients que lesdites maisons de correction ; or, si l'on a été amené à fermer celles-ci, tout laisse à penser que leur nouvelle forme serait elle aussi appelée à connaître des difficultés, à ne pas donner satisfaction. De ce point de vue, puisqu'il y a un moment où l'enfermement devient nécessaire, peut-être que la prison, à condition qu'elle soit une prison de qualité, qu'elle s'accompagne d'une prise en charge éducative, que soient bien imaginés le suivi et la réinsertion, serait à tout prendre une meilleure solution ou, en tout cas, une moins mauvaise solution que ces centres fermés.
Vous indiquez une voie qui semble être à mi-chemin. J'aimerais que vous nous donniez votre sentiment sur ce que je viens de dire et davantage de précisions sur les centres semi-fermés que vous préconisez.
M. Jean-Marie Petitclerc - Je pense effectivement qu'un centre fermé a forcément pour conséquence l'émergence d'un caïdat interne, très souvent suivie -et c'est ce qui a été, à mon avis, la principale dérive des maisons de correction- de l'alliance entre des membres fragilisés de l'équipe éducative et ce caïdat pour pouvoir gérer la violence, ce qui est dramatique. Le phénomène s'est vérifié dans toutes les expériences de centres éducatif fermés.
Je ne connais pas aujourd'hui d'éducateur de la profession capable de gérer la violence dans un centre fermé, sachant que l'administration pénitentiaire n'y arrive pas. Le niveau de violence interne dans les quartiers de mineurs des prisons est intolérable : des jeunes y sont volés, violés, rackettés -je pèse mes mots-, et l'administration pénitentiaire se dit « désemparée », c'est le terme officiel d'un rapport parlementaire, face à ces problématiques adolescentes.
Si nous voulons faire de l'éducatif, il nous faut être conscients que l'éducateur, lui, ne peut travailler que sur le contrat, c'est là son originalité, et que l'important est de pouvoir prononcer des sanctions lorsque le contrat est rompu. Sachons que, dans l'histoire de nos centres, après les maisons de correction, les premiers centres ouverts qui ont fonctionné disposaient tout de même de cachots, c'était le mot de l'époque, si bien que si le jeune ne respectait pas le contrat, pour une durée limitée, une contention était possible. Je pense que ces jeunes ont besoin de contention.
Bien sûr, il faut que la mise en quartier fermé de centre ouvert se fasse sous l'égide de la justice, mais il me semble qu'il faudra lui donner sens d'un point de vue éducatif, que le but est de permettre de restaurer cette capacité de l'éducateur et du jeune à travailler sur ce contrat de confiance.
Je citerai l'exemple du quartier des mineurs de la grande prison de Turin, qui fonctionne sur ce principe tout en étant une prison pour mineurs : le jeune peut être chez lui la nuit, peut être au travail le jour s'il respecte le contrat ; mais dès qu'il y a non-respect du contrat, il y a réponse, le temps de réfléchir avec le jeune au contrat qu'il sera capable de respecter. Cela me semblerait plus intéressant que de l'enfermer pendant trois mois, puis de le laisser ressortir... Nous aurons les mêmes problèmes ! Il nous faut nous servir de cette bonne idée -parce que je ne suis pas un idéaliste grand rêveur, et je connais un peu ces jeunes- ; car si le jeune ne respecte rien et se retrouve dehors, c'est tout qui dysfonctionne !
Un jeune placé en foyer qui veut pouvoir rentrer chez lui le soir n'a qu'à gifler le chef de service de ce foyer pour obtenir aussitôt la décision de justice qui lui permettra de rentrer chez lui. Il y a là un dysfonctionnement. Celui qui ne respecte pas le contrat se retrouve -apparemment, parce qu'en réalité il s'enfonce- dans une situation préférable à celle du jeune qui respecte le contrat.
Il faut donc développer des avantages visibles dans les centres éducatifs pour ceux qui respectent le contrat et profiter de l'enfermement pour mettre en place une pédagogie de contrat permettant l'élaboration de nouveaux projets. Il faut tenter de nouvelles expériences et modéliser celles qui fonctionnent. En tout cas, cela me semble préférable -les mêmes causes produisant les mêmes effets- au centre éducatif fermé, où l'on risque de retrouver un certain nombre de dérives, la plus grande étant selon moi l'alliance qui se crée dans les quartiers des mineurs en prison entre certains gardiens et des caïds.
Mme Valérie Létard - A l'instar de mes collègues, j'ai beaucoup apprécié la présentation de l'expérience, très riche d'enseignements, que vous avez acquise dans le domaine de la prévention. Je voudrais simplement avoir quelques précisions sur la prévention précoce des mineurs avant onze ans.
M. Jean-Marie Petitclerc - Il me semble qu'il faut renforcer les pouvoirs disciplinaires de nos institutions.
Etant né à la campagne, où j'habite d'ailleurs toujours, je me souviens que le garde-champêtre tenait un grand rôle. Il n'était pas policier mais savait réguler la petite délinquance. Nous avons voulu confier la régulation de la petite délinquance aux institutions policière et judiciaire, qui sont aujourd'hui complètement débordées. Par rapport à l'enfant, il me paraît important de restaurer le pouvoir disciplinaire de l'école, celui du gardien de square, celui du gardien d'immeuble. On doit pouvoir convoquer les parents et leur imposer une mesure de réparation.
Depuis 1970, le pouvoir disciplinaire de nos institutions s'est beaucoup fragilisé, et la justice elle-même y a largement contribué. Aujourd'hui, lorsqu'un enseignant gifle un élève, même si ce n'est pas selon moi la meilleure réponse qu'il puisse apporter, il risque d'être traduit devant la justice.
Autre exemple : une information a été faite dans les collèges d'Argenteuil auprès de tous les enfants de sixième sur le numéro d'appel 119. Tous connaissent ce dispositif, ce qui n'est malheureusement pas le cas des parents, qui n'assistent pas aux réunions. Imaginez une famille réunie autour de la table pour le repas. Le père lève la main et fait mine de vouloir frapper son fils. Aussitôt, celui-ci menace son père d'appeler le 119. Si nous, professionnels, savons que son appel n'aura aucune conséquence, le père, lui, ne le sait pas. Dans sa représentation du 119, il imagine qu'un travailleur social peut débouler chez lui et, s'il répond mal aux questions, être convoqué chez le juge...
Un tel système, dans lequel, pour ne courir aucun risque, il ne faut plus sanctionner, a contribué à décrédibiliser les adultes, qu'il s'agisse des parents, des enseignants ou des animateurs. C'est un système paradoxal où l'on ne tolère plus aucune sanction mais où la justice est complètement débordée par les plaintes qui lui sont transmises. S'agissant des mineurs de moins de onze ans, c'est selon moi du côté de la discipline qu'il faut travailler et non du côté de la sanction de la délinquance.
M. le président - Nous vous remercions.
Audition de M. Philippe LUTZ,
Commissaire principal à
Noisy-le-Grand
(3 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Philippe Lutz, commissaire principal à Noisy-le-Grand, après avoir été commissaire au Blanc-Mesnil, que nous remercions d'avoir accepté de venir nous faire part de son expérience.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Lutz.
M. Philippe Lutz - Je vais faire une courte présentation de la circonscription sur laquelle j'exerce -Noisy-le-Grand- et de la Seine-Saint-Denis concernant la délinquance des mineurs.
En Seine-Saint-Denis, l'année dernière, 140 000 plaintes ont été déposées et 31 000 personnes ont été mises en cause, 26 % d'entre elles, soit plus de 8 200, étant mineures. Plus de 3000 ont commis entre deux et sept infractions, près de 600 en ont commis plus de cinq. Sur ces 8 200, 48 ont été écrouées, soit, par rapport à l'année précédente, une baisse de 40 % du nombre d'écrous pour les mineurs.
En répartissant par tranche d'âge, on constate que les moins de treize ans représentent près de 8 % du nombre d'interpellations, les treize-quinze ans, 41 % et les seize-dix-sept ans, la majorité, soit 51 %.
Il existe, sur la Seine-Saint-Denis, deux centres de placement immédiat, qui rassemblent à eux deux seize places, l'un à Villemomble, l'autre à Pantin.
La Seine-Saint-Denis est un département difficile et est un peu un laboratoire, en ce qui concerne la délinquance et les tentatives de règlement de cette dernière.
La circonscription de Noisy-le-Grand compte 6 500 habitants. L'an passé, 6.200 plaintes y ont été enregistrées. L'une de ses particularités est d'avoir la population la plus jeune de toute la Seine-Saint-Denis : l'année dernière, encore 34 % des mises en cause, contre 27 % pour l'ensemble du département, visaient des mineurs.
J'exerce depuis la fin de 1997 à Noisy-le-Grand. Il est intéressant d'y constater l'évolution de la part des mineurs dans la délinquance : en 1997, elle était de 39 % ; elle était encore de 38 % ou de 36 % en 1998, de 32 % ou de 34 % en 1999, est remontée à 35 % en 2000 et à plus de 33 % en 2001.
En matière de délinquance sur la voie publique, celle qui touche le plus la population -vols avec effraction, dégradations, vols à la roulotte- les mineurs représentent 46 % des auteurs interpellés par les services de police et, pour certains types d'infractions encore plus emblématiques, à savoir les vols avec violence, 71 %.
Suite à ce bilan chiffré à partir de 1997-1998, nous avons pris des mesures évolutives. Le dispositif qui a été instauré a lui-même continué à progresser, avec à la fois le contrat local de sécurité et la mise en place de la police de proximité, voilà juste un an, à Noisy-le-Grand.
Le constat sur lequel nous nous sommes appuyés pour construire ce dispositif, c'est qu'en 1997 les moins de treize ans représentaient 13 % des auteurs d'actes de délinquance, donc un potentiel explosif pour les années suivantes, et, en 1997 et en 1998, 80 % des auteurs de vols avec violence, ces derniers progressant, chaque année, sur Noisy-le-Grand, à peu près de 60 % à 70 %.
Enfin, au sein des établissements scolaires, les incidents violents se multipliaient, notamment dans le collège Victor-Hugo, directement intégré, architecturalement, au Pavé-Neuf, l'une des cités de Noisy-le-Grand, et ce aussi bien contre les professeurs que contre les bâtiments, régulièrement dégradés, du fait de jets de pavés dans les vitres, notamment.
Ce dispositif s'est également appuyé sur un certain nombre d'éléments qui existaient déjà, tant sur Noisy-le-Grand que sur la Seine-Saint-Denis.
Le premier était le partenariat entre la police et l'Education nationale, qui a été créé en Seine-Saint-Denis en 1992.
Le deuxième était le contrat local de sécurité, signé en 1998, avec, comme corollaire, la création d'un groupe de traitement local de la délinquance sur le Pavé-Neuf et Champy.
Le dernier était la mise en place de la police de proximité et, surtout, l'un des éléments clés de cette dernière, à savoir la gestion par objectifs de la sécurité.
Par ailleurs, nous avons analysé le plus précisément possible les quartiers sur lesquels nous allions travailler : quelles en étaient les particularités ? Quels étaient les types de délinquance ? Quel était l'âge des délinquants ?
Le constat fut rapidement fait que, d'un quartier à l'autre, les types de délinquance, les tranches d'âge de participation des mineurs à la délinquance différaient.
Tous ces éléments devaient être impérativement intégrés dans le dispositif à mettre en place.
L'une des mesures de base de ce dispositif était le renforcement du maillage sur les différents quartiers, maillage tant institutionnel qu'associatif.
La première initiative consista à créer des brigades des mineurs.
Certes, cela n'avait rien de particulièrement original. Toutefois, jusqu'à présent, les brigades des mineurs - un petit groupe, au sein des commissariats, composé en général d'un, de deux ou de trois fonctionnaires au grand maximum, la plupart du temps plutôt d'un - ne s'occupaient que des mineurs victimes.
La délinquance des mineurs n'était pas traitée, parce que les familles n'étaient pas identifiées et que les officiers chargés de ces affaires changeaient quasiment en permanence. Le phénomène n'était par conséquent pas véritablement connu.
Nous avons donc décidé, en septembre 1998, de créer une brigade des mineurs renforcée, formée de sept personnes - deux officiers, quatre gardiens de la paix et un adjoint de sécurité - ayant une compétence totale sur la problématique des mineurs, à la fois auteurs et victimes, et s'attachant à mettre en place des partenariats relativement novateurs avec l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse.
Cela a nécessité un investissement relativement important, et, puisque les effectifs des services de police ne sont pas extensibles, leur redéploiement au sein de la circonscription de Noisy-le-Grand.
Cette brigade des mineurs, qui existe toujours, à effectif presque constant, traite l'intégralité des procédures concernant les mineurs.
En ce qui concerne essentiellement le racket, nous avons constaté assez rapidement qu'il y avait un échange des rôles, dans certaines affaires, entre le statut de victime et celui d'auteur. Le système antérieur ne permettait pas de faire le lien entre les auteurs et les victimes ; aucun travail n'était fait sur les familles. Grâce à la création de cette brigade, la même unité voit l'intégralité des mineurs.
Parmi les initiatives prises par cette brigade des mineurs, je citerai la création d'une fiche à l'intention des parents. Le but était de faire du répressif, mais aussi de la prévention en direction des parents et d'essayer d'éliminer ce noyau qui gonflait chaque année des moins de treize ans - je rappelle que 13 % des mineurs délinquants avaient moins de treize ans en 1997 et en 1998 - afin d'éviter qu'ils ne passent dans la phase supérieure, que, chaque année, ce type de délinquance ne se renouvelle et que nous n'ayons, finalement, une espèce de tonneau des Danaïdes. Chaque année, les mineurs délinquants de moins de treize ans sont de plus en plus nombreux.
Tous les mineurs qui sont interpellés ou qui font une fugue pour la première fois sont convoqués par la brigade des mineurs avec leurs parents.
Ces derniers reçoivent une fiche ; leur devoir d'éducation et le texte du code civil leur sont rappelés ; le nom et le numéro de téléphone direct des officiers de la brigade des mineurs leur sont indiqués. Ils peuvent les contacter en cas de problème dans la gestion de leur enfant après l'interpellation par les services de police ou après la fugue. Sur cette fiche, il est mentionné que, dans les deux mois, la brigade reprendra contact avec eux pour faire le point sur la suite qui a été donnée à cet incident et savoir comment l'enfant a évolué.
Un suivi a donc lieu. Nous avons enregistré très peu de cas de récidive entre 1998 et 2002, pour ce type de primo-délinquants.
Pour cette brigade des mineurs a été mis en place un partenariat élargi, notamment institutionnel.
Jusqu'à présent, le travail sur les mineurs était situé uniquement dans une optique police - justice - Education nationale, qui fonctionnait relativement bien, mais la problématique des mineurs ne peut pas se réduire uniquement à ces trois institutions. L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, travaille sur l'antériorité, et la protection judiciaire de la jeunesse travaille a posteriori , finalement.
Régulièrement - tous les trois mois environ - ont lieu des réunions au cours desquelles sont examinés les cas qui nous préoccupent chacun de notre côté, ceux de fugue, notamment, chacun ayant son propre point de vue. L'ASE, quant à elle, vise essentiellement un aspect purement préventif.
Les cas d'expulsion, qui concernent directement les commissaires de police, sont également évoqués - certaines familles peuvent poser problème - ainsi que, parfois, ceux de primo-délinquants dont les familles sont déjà connues. Nous cherchons si des mesures peuvent être prises.
Au-delà de ce travail de réunion -il existe également avec la PJJ- des liens beaucoup plus directs entre la police et l'aide sociale à l'enfance ont pu être développés, et ont un peu cassé cette barrière qui se dresse la plupart du temps entre elles, chacune ayant tendance à travailler de son côté. C'est un aspect essentiel.
D'autres partenariats ont été développés avec les associations -j'y reviendrai un peu plus tard- notamment avec les fédérations de parents d'élèves.
Le partenariat scolaire a été une des bases de la création de la brigade des mineurs. La Seine-Saint-Denis a une expérience nettement plus ancienne que les autres départements dans ce domaine, puisqu'elle a été pionnière.
Le collège Victor-Hugo fait partie d'un partenariat renforcé depuis la rentrée scolaire, comme six établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis. Nous constatons, quand nous rencontrons les professeurs, que la plupart ignorent encore plus ou moins en quoi consiste le partenariat, ce qu'il peut apporter, aussi bien à l'institution de l'Education nationale qu'aux services de police, et que, parfois, il n'est pas si bien vu que cela. Il est difficile d'y impliquer les enseignants.
Je ne nie pas du tout l'avancée très importante qui a été réalisée grâce à ce partenariat mais, de toute évidence, des choses restent à améliorer.
Ce partenariat permet également aux policiers d'intervenir dans les établissements scolaires. Nous étions entrés dans une logique de répétition : chaque année, depuis 1992 ou 1993 -cela s'est vraiment mis en place en 1995- nous faisions une intervention bien rôdée sur le racket, sur le recel, sur les coups et blessures et une présentation de la police, mais sans réel travail en profondeur, ni avec les élèves ni avec les professeurs. Nous étions incapables d'évaluer exactement la portée de ces interventions, tant auprès du corps professoral que des élèves à qui nous nous adressions.
Nous avons donc décidé tout récemment, à la rentrée 2001-2002, de les modifier profondément.
Dorénavant -nous l'avons expérimenté sur le collège Victor-Hugo- nous distribuons un questionnaire à tous les élèves qui vont recevoir cette formation. Il se présente sous la forme d'une trentaine de questions auxquelles ils doivent répondre par oui ou par non : considèrent-ils qu'il est grave ou non d'insulter un professeur, un camarade, un policier ? De jeter une pierre à un policier, de voler une voiture, de dégrader un abri-bus ?
Les questionnaires sont ensuite compilés par le chef de secteur et par le CPE, le conseiller principal d'éducation. L'intervention des îlotiers se fonde sur ce sondage : elle n'est pas ciblée sur le racket ou les coups et blessures, elle est adaptée aux réponses. C'est la première phase.
La deuxième phase est celle de l'évaluation : nous remettons aux élèves, à la fin de chaque intervention, un questionnaire d'évaluation sur ce qu'ils en ont tiré : ont-ils finalement appris quelque chose, et, dans l'affirmative, vont-ils changer leur comportement, vont-ils en parler à leur famille ?
Dans une troisième phase, nous faisons un debriefing avec la classe et les professeurs.
Ce dispositif lourd, parce qu'il nécessite une préparation intensive, nous permet de travailler beaucoup plus en profondeur, et est relativement intéressant.
Je reviendrai tout à l'heure sur la dernière phase, qui est en cours d'élaboration, et vise à associer les parents des élèves sur lesquels nous sommes intervenus.
Les interventions scolaires ont donc été un peu repensées.
Nous avons créé, en 1999, des cellules d'écoute au sein des établissements scolaires dont le principal s'était montré intéressé. Elles étaient tenues, à l'époque, par les îlotiers, la police de proximité n'existant pas encore. Tous les quinze jours environ, l'îlotier du secteur s'installait dans un bureau réservé et attendait que des élèves viennent lui parler des problèmes qu'ils rencontraient dans leur vie soit personnelle, soit scolaire.
Nous avons arrêté totalement cette expérience parce que plus aucun jeune ne venait. Dans un certain nombre d'établissements, ces cellules n'avaient pas été clairement mises en place.
Un travail en amont très important avec les enseignants avait été nécessaire : nous avions rencontré tous les professeurs des établissements dont les principaux étaient volontaires pour tenter l'expérience, nous leur avions expliqué qu'il s'agissait non pas d'attenter à leur légitimité, mais d'essayer de raccourcir la chaîne de traitement de la délinquance, puisque tel était l'un des objets essentiels du partenariat entre la police, la justice et l'Education nationale.
Chaque chef d'établissement est tenu de signaler tout incident au sein du collège à la police, à la justice et à l'inspection de l'Education nationale. Nous recevons régulièrement des fiches, soit directement par fax, soit lors des cellules de veille que nous tenons avec la mairie, sur des affaires de racket. Le collège Victor-Hugo m'informe ainsi régulièrement de trois, de quatre ou de cinq affaires de racket par mois.
Nous constatons que nous en restons au signalement, que nous n'avons jamais la plainte.
A partir du moment où un policier était présent au sein de l'établissement, nous pouvions espérer que, dans certains cas, l'entretien se déroulerait directement sur place. L'îlotier était chargé non pas d'enregistrer la plainte, mais d'indiquer à l'élève qu'il était là pour faire défendre ses droits, car ce qui lui était arrivé n'était pas normal.
Cette expérience a échoué parce que des locaux ont rarement été mis à notre disposition : les cellules d'écoute se déroulaient parfois en plein milieu de la cour. Ce n'était pas viable.
Le seul établissement où elle s'est révélée relativement efficace est le collège situé à Gournay-sur-Marne.
La circonscription de Noisy-le-Grand couvre deux communes : Noisy-le-Grand, qui est mixte, en termes de délinquance, avec à la fois un habitat très résidentiel et un habitat de cités, et Gournay-sur-Marne, qui est très résidentielle.
Les élèves scolarisés dans ce collège, même s'ils ne viennent pas que de Gournay-sur-Marne, ont pour la plupart des parents assez aisés. Cette cellule d'écoute a tout de même eu vent de certaines affaires relativement graves, notamment d'attouchements.
Cette expérience a été assez positive, mais, dans cet établissement qui ne compte que 500 élèves, nous ne pouvions pas espérer - le but n'est d'ailleurs pas d'espérer ! - que se produisent chaque semaine des incidents. L'année dernière, il ne s'y est plus rien passé : nous y avons donc mis un terme.
La dernière phase du dispositif consiste à travailler avec les associations. Nous avons souhaité collaborer tout d'abord avec les fédérations de parents d'élèves, qui, jusqu'à présent, n'étaient pas associées au travail de la police. Nous ne leur ordonnons pas de nous aider. Nous leur présentons tout simplement l'existence des brigades de mineurs, leur rôle, vis-à-vis à la fois des mineurs délinquants, des victimes, et, grâce à ce partenariat, des fédérations de parents d'élèves.
La première réunion que nous avons eue ainsi sur Noisy-le-Grand a été un peu tendue, parce que les parents ne savaient pas trop ce qu'ils devaient penser de la police. Nous avons noté une évolution radicale dès la deuxième réunion.
Je ne vais pas faire d'échelle de Richter du partenariat, mais c'est l'un des plus efficaces. Lorsque, l'année dernière, nous avons eu à traiter, sur Noisy-le-Grand, une affaire de coups de couteau à la sortie d'un collège entre élèves de deux établissements scolaires, la réactivité a été de part et d'autre exemplaire : les faits se sont produits le vendredi ; le lundi, les représentants de la police, de l'Education nationale et des fédérations de parents d'élèves étaient réunis dans le bureau de la principale de l'établissement où les auteurs de l'agression avaient été identifiés.
Sans ce partenariat, nous n'aurions peut-être pas pu réaliser cette opération.
Grâce à lui, nous avons vraiment une meilleure réactivité en cas d'incidents graves, nous pouvons passer un certain nombre de messages et avoir un retour au sein des établissements scolaires.
Dans certains cas, les fédérations de parents d'élèves, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, aussi bien la PEEP que la FCPE, nous ont aidés dans une large part à intervenir dans les établissements scolaires.
J'en viens à notre collaboration avec les associations de quartier, qui est essentielle.
Les institutionnels, à l'exception des policiers, arrêtent de travailler à dix-sept ou dix-huit heures. Les associations de quartier -c'est un euphémisme de le dire- sont implantées sur le terrain.
Nous avons créé, sur Noisy-le-Grand, en partenariat avec la police de proximité, quatre comités d'usagers, rassemblant vingt ou trente personnes par quartier. Nous nous réunissons tous les trois ou quatre mois environ, pour discuter avec eux des problèmes de sécurité.
Le but est d'essayer de casser ce type de réunion où les gens crient, ne sont jamais contents : la police ne répond pas au téléphone, ou, si elle répond, ne dispose d'aucun véhicule ; quand, par miracle, elle en a un, elle arrive une heure après, et, de toute manière, sa venue n'apporte aucune solution. La première réunion, en général, se résume à peu près à cela.
Nous devons clairement expliquer que le comité d'usagers a pour but, non pas d'organiser une réunion défouloir, mais de faire un travail constructif avec les habitants du quartier ou avec les associations.
Au Pavé-Neuf vit une population africaine extrêmement importante. Nous évoquons sans cesse la responsabilisation des parents. Sur un tel quartier, ce n'est pas que la loi ne signifie rien -ne vous trompez pas sur ce que je vais dire- mais les parents, s'ils viennent chercher leur enfant après dix-neuf heures, donc en dehors de la présence de l'officier qui a traité le dossier, sont reçus par le chef de poste -un gardien de la paix qui n'a absolument pas participé à l'affaire, qui a juste comme mission de dresser un procès verbal aux termes duquel ils ont récupéré leur fils ou leur fille après la garde à vue et s'engagent à déférer à toute convocation ultérieure de la police ou de la justice- et, la plupart du temps, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nul ne leur a expliqué exactement ce qui était reproché à leur enfant.
L'un des rôles de ces comités d'usagers est de pouvoir, le lendemain, s'ils sont saisis par la famille, nous recontacter pour faire le point avec nous sur ce qui s'est véritablement passé. Le gamin n'aura évidemment pas avoué qu'il a été mis en garde à vue parce qu'il a commis un vol avec violence -qu'il ait été reconnu ou non, il a une convocation pour dans six mois- et il va affirmer qu'il a été relâché parce que les policiers se sont trompés.
L'association, au sein du quartier, expliquera à la famille ce qui est arrivé et ce qui va se passer maintenant.
Telle est l'une des idées qui a surgi au cours des réunions de ces comité d'usagers.
Par ailleurs, ces associations nous aident à organiser des réunions avec les parents des élèves devant lesquels nous intervenons : nous souhaitons que ces parents soient au courant de notre intervention, du sondage que nous diffusons ; nous désirons savoir si leurs enfants leur en ont parlé à la maison.
Dans l'une des classes dans lesquelles nous sommes intervenus, 10 % ou 15 % des élèves estimaient que jeter une pierre sur un policier n'était pas grave. Nous voulons donc qu'il y ait un écho auprès des parents.
Enfin, nous avons développé notre action sur les primo-délinquants : au sein des quartiers, aidés par ces associations, nous revoyons un certain nombre de familles qui ont posé problème. Il peut s'agir -je le répète- soit d'un premier acte de délinquance, d'un vol à l'étalage, d'une main courante dans laquelle un voisin se plaint d'avoir été insulté par tel enfant, ou d'une fugue, qui est révélatrice lorsqu'elle se produit à moins de treize ans. La police doit également accepter le fait qu'elle n'est pas le seul interlocuteur à avoir connaissance de ces faits de délinquance ou de ces problèmes concernant les mineurs.
Sur le Pavé-Neuf, les associations travaillent dans une maison des services. Le dispositif se déroule sur un mois. Au cours de la première réunion, des noms sont confrontés : la police en cite un certain nombre, explique pourquoi, l'association également ; la médiatrice de justice, qui travaille en liaison avec la mairie et le tribunal de grande instance, peut être, elle aussi, informée de problèmes et signaler des noms.
L'association essaie de faire une petite enquête, va voir les familles quand elle les connaît, fait venir parents et enfants devant cette structure -dont le rôle n'est pas du tout de réprimer, mais de conseiller, d'informer- pour lui exposer les faits et lui demander son sentiment.
Le but est de parvenir à un maillage extrêmement fin des différents quartiers.
Quelles conclusions, quels principes pouvons-nous tirer du dispositif mis en place ?
J'ai développé uniquement l'aspect préventif, mais il ne peut pas se passer d'un dispositif répressif très fort : ce type d'actions ne peut pas être mis en place si, auparavant, un certain nombre de problèmes -à savoir le stationnement de jeunes dans les halls d'immeubles, les petits trafics, le non-respect de la loi- n'ont pas été éradiqués avec la plus grande exemplarité.
L'utilisation du tissu associatif -je l'ai largement expliqué- permet à la fois de renforcer la proximité vis-à-vis des habitants et de rétablir les adultes sur le quartier dans un rôle d'autorité.
Le maillage réalisé sur les quartiers, tant institutionnel qu'éducatif, permet de repérer, dès leur plus jeune âge, des mineurs qui peuvent devenir déviants, donc d'apporter un traitement le plus vite possible.
Il évite que les mineurs n'aient l'impression que le passage à l'acte est facile, évite que le premier acte de délinquance, s'il n'est pas réprimé -parce qu'il n'aura pas été vu, parce que personne n'aura rien dit, ne se sera senti concerné- n'entraîne d'autres actes de délinquance. C'est une évidence.
Grâce à lui, nous avons une observation beaucoup plus fine et -nous l'espérons- une réaction beaucoup plus rapide.
Nous devons privilégier l'expérimentation : il nous faut essayer d'avoir en permanence des idées, même si elles peuvent paraître parfois farfelues, et, rapidement, c'est-à-dire au bout de six mois ou d'un an, évaluer si l'action qui a été mise en place a porté ses fruits, s'est révélée positive. Le plus beau des dispositifs peut être instauré, mais si personne n'appelle le chef de secteur, si aucune association n'agit, il sera voué à l'échec.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Monsieur le commissaire, pour quelles raisons rencontrez-vous quelques difficultés à impliquer les professeurs dans l'action que vous menez ?
M. Philippe Lutz - Notre interlocuteur direct est le chef d'établissement. Nous ne pouvons pas nous adresser directement aux professeurs et, parfois, une barrière se dresse entre eux et nous.
Le problème, en Seine-Saint-Denis, d'une génération de professeurs qui pourraient refuser la police n'existe quasiment pas, puisque la moyenne d'âge des enseignants y est extrêmement basse.
Depuis trois ans, nous organisons, chaque année, sur deux quartiers, une réunion de présentation de ce partenariat pour les nouveaux enseignants, tant dans les écoles primaires que dans les collèges.
Le cas m'a été soumis récemment d'un écolier qui avait volé une petite somme d'argent, l'équivalent, à l'époque, de cent francs. Il avait été identifié, et la question se posait de savoir s'il était vraiment utile de le signaler à la police. C'est là qu'il est utile d'expliquer ce partenariat et le rôle de la police. Nous n'allons pas mettre en prison un gamin de huit ans qui a volé cent francs ! L'important est de le signaler, de mettre en relation d'autres institutions, d'indiquer que nous travaillons avec l'ASE, laquelle a peut-être déjà repéré la famille, travaille sur elle ; d'autres éléments sont peut-être parvenus à la police au sujet de cet enfant. Peut-être a-t-il déjà été interpellé pour un vol à l'étalage.
Je n'ai jamais ressenti, au cours de ces réunions avec les jeunes enseignants, de défiance vis-à-vis de la police. Je n'y ai pas entendu de discours selon lequel il est hors de question de travailler avec la police parce que ce serait faire de la répression. Le « chacun de son côté » est, heureusement, dépassé. En effet, l'institution de l'Education nationale est désormais confrontée aux actes de délinquance.
Les difficultés viennent d'une méconnaissance de ce travail de partenariat, de l'efficacité qu'il peut avoir.
Quand nous collaborons directement avec les professeurs, cela se passe très bien. Ils enseignent essentiellement en sixième et en cinquième. Nous préparons avec eux notre intervention devant les élèves, nous leur communiquons les résultats du sondage et de l'évaluation réalisés dans leur classe. Il est tout de même intéressant pour eux de les connaître.
Il est vrai que le partenariat est difficile à instaurer : c'est l'un des problèmes de la police de proximité. En effet, la notion de sécurité, de coproduction de sécurité, n'est pas acquise par tout le monde.
A mon arrivée à Noisy-le-Grand, l'un des objectifs était de renouer le contact avec les entreprises.
Cette ville fait partie du secteur I de Marne-la-Vallée et abrite les sièges de DIAC, de Groupama, la direction générale de l'ANPE, la division formation d'IBM, et des cadres s'étaient fait agresser. En général, les incidents passent non pas par le commissariat de police, quand il s'agit de ce type d'entreprises, mais par la direction générale, le ministère de l'intérieur, puis le préfet, avec, toujours, la menace d'aller s'implanter ailleurs si cela continue.
Le contact a été repris grâce à la mise en place, par la ville de Noisy-le-Grand, d'un comité d'entreprises, d'une commission de sécurité, que nous rencontrons régulièrement. Or, une fois que les choses vont mieux, les contacts se distendent de nouveau et l'impératif de sécurité, qui doit être intégré par tous, a du mal à résister.
M. le rapporteur - Vous nous avez dit qu'il fallait privilégier l'expérimentation et, si possible, évaluer très rapidement les expériences. Au vu des vôtres et de l'évaluation que vous avez peut-être pu en tirer, pensez-vous qu'il est possible, si ce n'est de généraliser, du moins d'étendre à une grande partie du territoire les actions que vous avez menées ?
M. Philippe Lutz - Plusieurs brigades des mineurs existent déjà en Seine-Saint-Denis. Elles ont désormais toutes une compétence totale sur les mineurs.
D'autres mesures sont, à mon avis, plus difficiles à étendre.
Nous avons réussi à faire baisser de façon notable la part des mineurs dans la délinquance mais - nous l'avons vu - en 2000, elle était remontée brutalement à 35 %, alors qu'elle avait régressé à 32 % ou 33 %. Rien n'est acquis. L'une des clés du succès est qu'il faut prendre en compte la réalité du terrain.
J'ai deux expériences complètement différentes sur Noisy-le-Grand : celle du secteur du Pavé-Neuf et celle du Champy.
Il ne faut pas se focaliser sur la spécificité. La problématique du Champy et celle du Pavé-Neuf ne sont pas du tout les mêmes : ces deux quartiers n'ont pas le même type de population, nous avons eu beaucoup plus de mal à travailler avec le tissu associatif du Pavé-Neuf qu'avec celui du Champy.
Sur une même circonscription, il est déjà difficile de déterminer quelle action mener. Sur Neuilly-sur-Marne, le même dispositif ne pourrait peut-être pas fonctionner, parce que le tissu associatif et la réalité de la délinquance n'y sont pas les mêmes qu'à Noisy-le-Grand.
Sur la Seine-Saint-Denis, le chiffre de 27 % de mineurs mis en cause recouvre des disparités considérables.
J'ai travaillé auparavant sur Le Blanc-Mesnil : la délinquance des mineurs tournait aux alentours des chiffres nationaux, c'est-à-dire 23 % ou 24 % ; elle n'allait pas plus loin. Je n'y avais pas été confronté à une vague du type de celle que j'ai pu constater à Noisy-le-Grand, quand cette délinquance avait atteint 39 %.
Des expériences peuvent être étendues, celle de la brigade des mineurs, notamment.
Il faut essayer de privilégier un travail non seulement avec les institutionnels, mais aussi avec le tissu associatif, donc au plus près du terrain.
Il faut en revenir aux principes basiques, en particulier à la notion d'autorité. La police a une figure d'autorité, mais dont nous constatons qu'elle n'est pas toujours respectée, contrairement à celle de quelqu'un qui vit en permanence dans le quartier et avec lequel nous allons pouvoir travailler.
Notre but n'est pas du tout de déléguer. Je ne suis pas favorable à ce que les conflits soient réglés à l'amiable, tout le monde étant gentil, et grâce à une fausse médiation permanente. Dans le travail qu'elle accomplit avec les associations, la police est vraiment partie prenante : elle ne leur donne pas une liste de gamins en les chargeant d'aller voir les familles et de se débrouiller avec elles.
Notre but, au contraire, est de voir en permanence ce qui a été fait, de savoir comment l'association a été reçue, comment certains points peuvent émerger dont nous, nous n'avions pas connaissance, non plus que certaines institutions, et de déterminer ce que nous pouvons faire.
M. le rapporteur - Il est beaucoup question, dans le débat public, de zones de non-droit. Existe-t-il des quartiers où la police ne pénètre pas ou ne peut pas pénétrer ?
M. Philippe Lutz - Vous avez lu mon curriculum vitae : je suis un cas un peu particulier, parce que je travaille en Seine-Saint-Denis depuis quinze ans, en dehors du fait d'y être né. J'ai été inspecteur, commissaire dans trois circonscriptions différentes, je fais des permanences de nuit régulièrement : je ne connais pas, en Seine-Saint-Denis, qui est l'un des départements les plus difficiles de France, de zone de non-droit.
Il faut bien nous entendre sur ce que nous appelons « zone de non-droit » : il n'existe aucun secteur en Seine-Saint-Denis où la police ne se rend pas.
En revanche, les applications de la loi peuvent être différentes d'un quartier à l'autre. C'est une réalité, mais ce sont les habitants qui peuvent nous le dire.
A partir du moment où, les halls de leurs immeubles étant squattés en permanence, les résidents sont obligés d'utiliser des méthodes de contournement -passer par la cave, qui est à trois numéros de leur accès, pour rentrer par derrière- afin de ne pas croiser les jeunes, pas même du regard, et où nous ne parvenons pas à faire respecter la loi, nous pouvons effectivement considérer que se pose un problème.
Pour cette raison, j'ai bien précisé que le dispositif préventif devait être impérativement couplé avec un dispositif répressif fort.
Le stationnement des jeunes peut cacher plusieurs choses. Il peut n'être rien : ainsi, dans les rues de Gournay-sur-Marne, une dizaine de gamins jouant au football indispose la population. Les halls d'immeubles peuvent abriter des alcooliques ou des délits de stupéfiants.
Cela relève du travail de la police de proximité.
A Noisy-le-Grand, notamment sur le Pavé-Neuf, depuis sa mise en place voilà un an, douze affaires de trafic de stupéfiants au lieu de deux ont été réglées. Il ne s'agissait pas de gros trafics -ils ne portaient pas sur dix kilos à chaque fois- mais ces jeunes étaient identifiés, semaient le trouble au sein de la population. Il faut casser ces groupes compacts qui créent des difficultés.
Telle est la notion de « zone de non-droit ».
M. le rapporteur - La mise en place de la police de proximité a-t-elle conforté ou affaibli le rôle de la police judiciaire ?
M. Philippe Lutz - C'est un vaste débat. Je ne me dérobe pas à votre question, mais il existe vingt-cinq façons d'organiser la police de proximité.
L'unité de police de proximité de Noisy-le-Grand ne procède peut-être pas de la même façon que celle de Saint-Denis, de Calais ou de n'importe quelle ville de France. Elle n'est pas exceptionnelle -ce n'est pas ce que je veux dire- mais les fonctionnaires qui travaillent dans les quartiers, dont les zones pavillonnaires, sont en contact avec la population et, ensuite, exploitent les renseignements, c'est-à-dire qu'ils assurent un traitement judiciaire.
La plupart des affaires de trafic de stupéfiants que j'ai évoquées tout à l'heure ont été traitées par les unités de police de proximité. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait en concordance avec la doctrine de la police de proximité, mais qui fonctionne bien. Les policiers de proximité sont vraiment polyvalents : ils exécutent des actes judiciaires, enregistrent des plaintes, font des constatations, des surveillances. Ils sont vraiment investis, ce qui est très important pour la population.
J'ai parlé des comités d'usagers tout à l'heure. Si, certes, lors des premières réunions, il est reproché à la police de ne rien faire ou de relâcher deux heures après les quelques jeunes que, de temps en temps, elle interpelle -ce qui ne sert donc à rien- des problèmes très pratiques sont posés, des problèmes de stationnement de jeunes, mais aussi de véhicules. Quand nous répondons, nous devons être crédibles : si, lors de la réunion suivante, trois ou quatre mois plus tard, nous n'avons pas réglé ces problèmes, nous ne le sommes plus.
Les aspects judiciaires découlent de cela : lors d'une réunion, peut être évoqué un trafic de stupéfiants : à tel endroit, les dealers ont été vus, ils s'échangent des choses. Ce n'est peut-être pas vrai, car beaucoup d'habitants, dès qu'ils voient trois jeunes ensemble, les soupçonnent automatiquement, mais il ne faut pas non plus faire l'impasse, ces soupçons, dans certains cas, se vérifiant. Nous devons pouvoir expliquer, la fois d'après, que nous avons pris telle et telle mesure, pour tel et tel résultat. Il nous faut avoir cette sorte de transparence devant les gens.
L'année dernière, la délinquance a été stable. Voilà deux ans, nous avions commencé à tenir des comités d'usagers, car elle avait fortement augmenté. Nous devons annoncer aux habitants du quartier que, selon nos chiffres, la délinquance a beaucoup baissé -de 10 % à 15 %- et leur demander si ces chiffres correspondent à ce que eux ressentent.
La mise en place de la police de proximité n'a pas affaibli la police judiciaire parce que les renseignements exploitables parviennent de façon beaucoup plus massive.
Auparavant, les îlotiers signalaient dans leurs rapports un trafic de stupéfiants sur tel ou tel quartier. Ces rapports étaient totalement inexploitables et ne présentaient pas le moindre intérêt. Maintenant, ils sont forcément beaucoup plus précis, comportent des noms, des modes opératoires. Nous avons une obligation de réponse.
M. Jacques Mahéas - Monsieur le commissaire, vous avez bien mis en exergue tous les travaux qui sont faits en Seine-Saint-Denis, terre d'expériences. Je suis aussi satisfait de constater qu'un partenariat y existe entre la justice, la police et, notamment, les travailleurs sociaux, en vue du maintien de la sécurité.
Alors que, souvent, la police est mal considérée, comme vous l'avez indiqué, nous apprenons en vous écoutant que la motivation de tous et la mise en place de la police de proximité permettent d'obtenir des résultats positifs. Vos propos sont très réconfortants.
La police est-elle présente aux moments les plus criminogènes, les plus difficiles, c'est-à-dire lorsque les jeunes délinquants sont, eux, encore dans la rue, et qu'il ne reste plus que la brigade anti-criminalité, c'est-à-dire en soirée, le samedi et le dimanche, notamment ? Ne doit-elle pas s'adapter en conséquence ?
Le fait qu'au Pavé-Neuf, par exemple, la population soit extrêmement mobile, extrêmement renouvelée, pose-t-il d'importantes difficultés, en particulier en ce qui concerne cette délinquance des mineurs ? Comment pouvez-vous obtenir des renseignements sur une famille qui arrive auprès de vos collègues, s'ils sont hors département ?
Enfin, que penseriez-vous d'une coordination des actions en cours chapeautée par le maire ?
M. Philippe Lutz - Les policiers de proximité, sur Noisy-le-Grand, travaillent en cycles et n'ont pas les mêmes horaires selon les secteurs : ceux du centre-ville, pavillonnaire, finissent à vingt et une heures trente ; en revanche, ils commencent plus tôt le matin, à cause du marché. Ils s'adaptent.
Ceux des autres secteurs -du Champy et du Pavé-Neuf- terminent leur service à vingt-deux heures trente, y compris le samedi.
Ces horaires ne sont pas considérés comme un dogme : ils varient en fonction de la délinquance, comme les effectifs. A de très nombreuses reprises déjà, sur un an, y compris dans le centre-ville, ils se sont décalés, parce que des augmentations de délinquance étaient constatées. Ainsi, sur le Pavé-Neuf, l'année dernière, nous avons eu quelques petits soucis : le quartier ayant été plongé dans le noir plusieurs fois, les effectifs se sont décalés.
Que les effectifs de police de proximité s'adaptent à la délinquance est un impératif : c'est le B A - Ba de la police.
Il y a eu une première vague où la police de proximité était très efficace, parce que d'un seul coup, grâce aux redéploiements d'effectifs, beaucoup plus d'hommes étaient affectés sur les créneaux les plus sensibles, c'est-à-dire la fin d'après-midi et le début de soirée.
Les délinquants, en face, notent les arrivées, les départs ; ils savent à partir de quelle heure nous n'avons plus personne, il ne reste qu'un véhicule de police secours et la brigade anti-criminalité.
Il faut casser cette espèce de cercle qui nous conduirait à retrouver très rapidement les problèmes que nous avons connus voilà quelques années.
Il faut une adaptation très régulière, sans, évidemment, que les fonctionnaires de police ne vivent quasiment un calvaire, ne sachant pas, d'une semaine sur l'autre, selon quels horaires ils vont travailler. C'est un problème de gestion des personnels.
Dans mon secteur - et c'est le cas de nombreuses autres circonscriptions de la petite couronne - je dispose de fonctionnaires extrêmement jeunes. Certes, c'est un inconvénient, car ils ont une faible expérience, mais c'est aussi un énorme avantage car ils sont très motivés, notamment en matière de police de proximité. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de leur signaler une augmentation de la délinquance après minuit ; ils constatent eux-mêmes ce fait car ils ont communication de plaintes tous les jours. Ainsi, au bout de deux ou trois jours, ils décalent leurs horaires. Il faut impérativement prendre en compte cette mobilité.
En ce qui concerne votre deuxième question relative à l'obtention de renseignements au sujet de personnes qui viendraient notamment d'autres départements, actuellement, il est plutôt rare d'être renseigné ; on attend qu'un premier fait soit commis pour s'intéresser au problème. C'est un handicap. Mais la fourniture de renseignements est obtenue par un autre canal, à savoir celui de l'Education nationale. En effet, celle-ci détient les dossiers des familles qui peuvent poser problème.
Les personnels de mon service rencontrent ceux de l'Education nationale, de la mairie, des centres commerciaux dans les cellules de veille, tous les mois. De ce fait, nous réduisons le laps de temps entre le moment où des personnes arrivent, commencent à soulever quelques petites difficultés alors que nous ne les connaissons pas.
Ce point est évidemment perfectible. Un travail énorme doit être effectué avec les bailleurs. Mais nous n'en sommes qu'au tout début. La police de proximité a été mise en place en France voilà au mieux deux ans : dans certaines circonscriptions, son installation date de quelques semaines ; dans mon secteur, elle remonte à un an. Parfois encore, elle est inexistante. Pour ma part, je commence à enregistrer le résultat du travail avec les bailleurs. Ainsi, ils ont un réel pouvoir sur les expulsions. Au lieu d'engager des procédures d'expulsion fondées exclusivement sur des dettes locatives, on peut en ouvrir en raison de troubles du voisinage. Mais les bailleurs considèrent qu'il existe un risque, et c'est vrai. Ainsi, cette semaine, un jeune a frappé un gardien d'immeuble. Une procédure d'expulsion a tout de suite été engagée. Bien évidemment, on sait qu'elle ne va pas aboutir tout de suite.
La troisième question qui m'a été posée concerne la responsabilité du maire. Les contrats locaux de sécurité ont peu prévu la phase d'évaluation. Or si cette phase était véritablement menée à bien, un travail en lien beaucoup plus étroit pourrait être effectué.
A titre personnel, je suis moyennement favorable à une espèce de « chapeautage » du maire sur la police nationale. A Noisy-le-Grand, les relations avec la mairie sont satisfaisantes ; des dossiers avancent de façon régulière. J'ai connu la même situation au Blanc-Mesnil. C'est un intérêt bien compris. Aller au-delà me semble délicat.
M. Bernard Plasait - Pourquoi ?
M. Philippe Lutz - En raison de l'indépendance que doit avoir la police vis-à-vis du politique.
M. le président - Je vous remercie, monsieur le commissaire.
Audition de M. Jean-Marc DELAYE, vice-président de l'Union
nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement
libre (UNAPEL),
de Mme Danièle FLOCKE, secrétaire
régionale de l'UNAPEL,
et de Mme Régine FLORIN,
enseignante, permanente de l'UNAPEL
(3 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Mes chers collègues, nous allons entendre M. Delaye, vice-président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL), Mme Danièle Flocke, secrétaire régionale de l'UNAPEL, et Mme Régine Florin, enseignante, permanente de l'UNAPEL.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Delaye.
M. Jean-Marc Delaye - Nous sommes parents d'élèves ; nous représentons les familles de l'UNAPEL, qui compte 800 000 cotisants. Environ 2 millions d'élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique, soit à peu près un enfant sur cinq. Il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, un enfant sur deux est passé, passe ou passera par nos établissements. Par conséquent, on ne peut pas considérer nos écoles comme des espèces de citadelles à l'abri des marées du temps.
Une spécificité de nos établissements tient au rôle des parents, qui y est assez fortement affirmé. Cependant, nous estimons que, si les parents se doivent d'être les premiers éducateurs, ils ne peuvent pas être les seuls.
Nous avons besoin de tous nos partenaires, au premier rang desquels figure la puissance publique. La plupart de nos écoles sont régies par des contrats d'association avec l'Education nationale.
En ce qui concerne la lutte contre la délinquance, nous partons d'un projet fondateur. Le projet éducatif de l'école catholique se raccroche à l'Evangile. Nous accueillons 10 % à 15 % d'enfants catholiques pratiquants. Ceux qui ont une culture chrétienne représentent environ 70 % des effectifs. Le reste des élèves est constitué de musulmans, de juifs et de personnes qui ne pratiquent aucune religion.
Nous souhaiterions qu'à un moment donné la puissance publique, l'Etat ou les hautes institutions comme la vôtre se penchent sur le problème du sens que l'on peut donner à l'éducation. Nous rencontrons trop souvent des enfants qui n'ont aucune référence à de quelconques valeurs. Selon nous, c'est le début de la délinquance. Pour moi qui suis juriste de formation, la loi, qui fonde la République, est un indicateur.
L'école catholique est constituée de grands établissements situés dans des quartiers très protégés et d'autres qui se trouvent dans des quartiers plus populaires. Ce n'est pas une école fermée. Mais ce qui nous inquiète beaucoup c'est le phénomène des bandes et de leur impunité. Petits, les enfants commencent par commettre de petites incivilités ; l'année suivante, ils vont venir par exemple dans nos kermesses et ils vont se livrer à des bousculades, des chapardages ; l'année d'après, comme ils n'ont jamais eu aucune sanction, leurs agissements sont un peu plus désagréables. Puis, lorsqu'ils atteignent quinze ou seize ans, nous finissons par avoir recours à des vigiles qui surveillent la porte d'entrée ou nous demandons au commissaire de procéder à des rondes perpétuelles. Il existe donc un problème. Il est essentiel de proposer aux jeunes des valeurs qui ne soient pas celles de la rue ou celles des bandes.
Dans l'éducation, il y a trois piliers, à savoir la famille, l'école et la rue.
En ce qui concerne la famille, nous voulons essayer d'aider les parents, mais il faut reconnaître que nombre d'entre eux sont très démunis. Qu'allons-nous tenter de faire ? Nous avons un projet qui s'attache à un certain nombre de valeurs, que l'on partage ou non. Cependant, il est très étonnant d'assister à l'inscription dans nos écoles de jeunes musulmans par leurs parents. Nous leur indiquons qu'il s'agit d'un établissement catholique, ce à quoi ils nous répondent : « c'est très bien ». Nous leur demandons alors pourquoi. Certains veulent que leurs enfants n'aient pas de mauvaises fréquentations. Pour d'autres, c'est le seul endroit où l'on va parler de Dieu, de valeurs, ce qui est rassurant pour eux.
Je sais que la loi a déjà prévu de nombreuses dispositions, mais il s'agit d'un axe. Il faudra un jour parler clair et indiquer quelles sont les valeurs de la République, les valeurs citoyennes et quelles mesures seront prises pour les faire respecter. Il faut cependant garder à l'esprit que tous les enfants ont besoin de transgresser. A notre époque, la transgression était bénigne, ou tout au moins sanctionnée.
Je cède maintenant la parole à Mme Florin, qui va vous expliquer comment nous fonctionnons et quel début de réponse pourrait être apporté à cette lutte contre la délinquance.
Mme Régine Florin, enseignante, permanente UNAPEL - On sait que les Français sont très avides de Prozac ; nos jeunes délinquants sont attachés à la violence : c'est leur Prozac. Si la violence est leur premier antidépressseur, c'est qu'ils n'ont pas le moral. Si tel est le cas, c'est qu'ils n'ont pas donné de sens à leur vie et qu'ils se demandent vers quoi ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils vivent et où ils vont.
Dans nos établissements, la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enseignants et tous les adultes, essaie d'occuper le terrain en donnant un sens à son action, en l'inscrivant dans un projet éducatif ou d'établissement. En ma qualité de formatrice non seulement d'enseignants mais aussi de parents d'élèves, je constate dans nombre d'écoles la mise en oeuvre de grands chantiers visant à revoir le projet éducatif de l'établissement, en coordination avec les parents d'élèves, les enseignants, les cadres éducatifs et les jeunes, les élèves eux-mêmes. On rédige ensemble des projets éducatifs qui donnent du sens à un dialogue.
Dans l'un de ses ouvrages, Eric Debarbieux analyse les composantes de la violence. Il estime que quelque chose tient au climat scolaire, au climat d'insécurité. Selon des chiffres qu'il cite, les enseignants considèrent qu'en trois ans, le climat d'insécurité est passé de 8 % à 47 %. Ils ressentent, constatent plus d'agressivité, même si l'on ne sait pas si les actes ont augmenté. Quand on intervient dans des établissements en prévention de la violence, est évoquée en tout premier lieu la violence verbale. Cette notion est très difficile à définir. Où commence cette violence ? Où s'arrête-t-elle ? Chacun a son système de valeurs.
Au sein des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, nous sommes là pour accompagner les parents dans la prise de conscience progressive de leurs responsabilités éducatives. Pour ce faire, des structures ont été mises en place, sur proposition des parents d'élèves. Ainsi existent des services d'information familles. Des bénévoles ou des salariés vont y être à l'écoute des parents. Dans le cadre de commissions dénommées « jeunes et leurs difficultés », des parents démunis pourront se tourner vers des conseillers. Ils seront écoutés par des bénévoles ou par des professionnels qui vont les accompagner. Nous mettons également en place un bouquet de services par le biais duquel les parents, au cours d'une conversation téléphonique, vont disposer d'une écoute au sujet de problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est un travail de partenariat et de dialogue constructif. Ont également été mises en place des rencontres intitulées « parents-école » axées sur ce qui est actuellement fait en matière de parentalité au cours desquelles des parents, des enseignants, des cadres éducatifs, des responsables, des chefs d'établissement traitent de sujets éducatifs qui ne sont pas spécifiques à l'établissement, ce qui donne l'occasion de construire ensemble la parentalité. Le premier thème qui a été abordé était dénommé « autorité-éducation ». L'une des affirmations à propos de laquelle tout le monde réagit est la suivante : les parents sont démissionnaires. Enseignants, chefs d'établissement et parents disent que ce n'est absolument pas le cas. Nous nous rendons compte que nous sommes un peu tous dans « la même galère » et que nous avons tous besoin de construire ensemble ce dialogue.
La spécificité des commissions « jeunes et leurs difficultés » est que l'on s'appuie d'abord sur des structures régionales puis départementales. Pour moi, c'est un peu l'éloge de l'action modeste, car l'on s'aperçoit qu'il est possible ponctuellement, dans des établissements scolaires, d'influencer le climat scolaire.
M. Jean-Marc Delaye - Je souhaite apporter une précision. Autrefois, notre commission s'appelait « jeunes en difficulté ». Nous avons voulu modifier l'intitulé et viser les jeunes et leurs difficultés, ce qui, à notre sens, est beaucoup plus significatif de ce qu'ils doivent affronter.
Mme Flocke, à qui je vais céder la parole, est sur le terrain, à Marseille, où elle s'occupe d'une commission de sécurité aux abords des établissements scolaires.
Mme Danièle Flocke, secrétaire régionale de l'UNAPEL - La délinquance n'est pas une fatalité et en s'en donnant les moyens, on peut inverser l'évolution. Depuis treize ans, à Marseille, existe la commission « sécurité aux abords des écoles ». Elle est parfaitement adaptable à tous les établissements scolaires de France. Je représente les 15.000 familles de Marseille et des communes voisines ainsi que les 30.000 autres de notre région académique.
Force est de constater malheureusement -et les chiffres sont là pour le souligner- qu'il existe une montée en puissance de l'incivilité d'où découle tout ce qui nous inquiète, à savoir les agressions, le racket, la drogue, les dealers. Pour traiter cas pas cas ces menaces, pour les prévenir et pour les combattre, j'essaie, à chaque appel, de trouver la solution adéquate et de mettre les intéressés en relation avec la personne appropriée, le bon service, naturellement le plus rapidement possible.
Je vais tout d'abord évoquer la mairie. A Marseille, je demande à ses services de sécuriser le devant des établissements scolaires par le biais d'élargissements de trottoirs, d'installations de feux, etc. Je réclame également la venue de personnes sous contrat emploi-solidarité pour aider les plus petits à traverser. Ce sont des adultes, présents tout au long de la journée. A Nice, il existe même des papis et des mamies « trafic », et le système fonctionne très bien. Je demande aussi du matériel pédagogique de prévention routière. Toutes ces mesures constituent un point de départ. Souvent, des officiers de police m'ont indiqué qu'il était bien d'avoir un site propre autour des établissements, sans petits buissons où pourrait être cachée notamment de la drogue.
En ce qui concerne la police et la gendarmerie, je téléphone à mes correspondants scolaires pour obtenir des îlotiers. En cas de problème plus important, je joins la brigade des mineurs ou celle des stupéfiants.
J'accompagne également parfois les parents dans leurs démarches compliquées, éprouvantes. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'amener un enfant derrière une glace sans tain dans des affaires de pédophilie.
L'unité de prévention urbaine a été créée à Marseille voilà une dizaine d'années. Elle est constituée par des policiers volontaires qui se déplacent dans les écoles. Ils abordent la délinquance, la drogue, les sectes et toutes sortes de préventions. Ils travaillent aussi la nuit.
En ce qui concerne les actes de pédophilie, des actions d'information ont également été menées.
En fait, je suis le lien entre les établissements scolaires, les parents et les pouvoirs publics. Au cours de différents entretiens que j'ai pu avoir, mes interlocuteurs ont estimé qu'il fallait responsabiliser tant les parents que ceux de substitution. J'ai souvent entendu qu'il s'agissait d'une obligation citoyenne.
A titre personnel, je rappellerai que la loi de 1945 avait certes été adoptée à l'égard d'enfants qui n'avaient plus de parents, au lendemain de la guerre. Même si elle ne correspond plus aux enfants d'aujourd'hui, il serait bien de la faire appliquer, car elle a de bonnes bases.
M. Jean-Marc Delaye - Quand on est parent d'élèves et que survient un acte de délinquance dans un établissement, il est extrêmement important d'accompagner les parents. Il faut arriver à les convaincre de porter plainte. Globalement, nous sommes très présents dans nos établissements et, structurellement, nous entretenons des liens très forts avec les chefs d'établissement. De ce fait, un réel dialogue se noue au sein de l'école.
Pour terminer, je citerai quelques chiffres. En 1995, 24 % des élèves ont éprouvé un sentiment d'insécurité alors que 41 % d'entre eux ont connu le même sentiment en 1998. Il est à relever une nouveauté. Dorénavant, l'insécurité ne concerne plus seulement la cour ou les extérieurs de l'école ; elle est également ressentie à l'intérieur des classes. Chez les adultes, cette même impression est passée de 7 % à 49 %. Quant aux actes d'agressivité dont les enseignants sont les victimes, ils ont grimpé de 6 % à 37 %.
Cependant, ces données doivent être tempérées. Certes, quatre fois plus d'élèves sont agressés, mais ces faits ne représentent que 0,042 % de la délinquance.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Les chiffres que vous venez de nous communiquer, monsieur Delaye, concernent-ils l'enseignement privé ?
M. Jean-Marc Delaye - Ce sont des données globales.
M. le rapporteur - La délinquance touche-t-elle de la même manière l'enseignement privé et public ?
M. Jean-Marc Delaye - Nous avons plus de moyens de lutter contre la délinquance, les parents étant très présents dans et aux abords des établissements. Se crée de ce fait une espèce de réseau. Les parents se connaissent et connaissent les enfants qui fréquentent l'établissement. Dans le XVIIIème arrondissement, où était scolarisé l'un de mes enfants, certains parents d'élèves étaient commerçants et, lorsqu'ils s'apercevaient d'actes douteux, ils téléphonaient à l'école ou à l'association de parents d'élèves. Il existe par conséquent des référents. Cela fait partie de nos projets d'établissement ; c'est une volonté affirmée. Quand vous entrez dans un établissement privé, vous prenez l'engagement de suivre certaines règles du jeu. De plus en plus, nous allons essayer de développer cela avec les enfants. Ainsi, une petite école de Paris a mis en place en primaire un conseil, dont les membres sont élus à l'issue d'une campagne électorale, et qui élabore des projets. Il s'agit, par exemple, de définir comment les élèves vont se mettre en rang, qui va balayer la cour, qui va éviter de mal parler, etc. Ce sont des projets à leur niveau, mais c'est là que tout commence. Dans l'école du XVIIIème arrondissement où était mon fils, existait un conseil d'élèves avec des élections ; les représentants des élèves participaient au conseil d'établissement, etc. Cela permet aux enfants de savoir ce qu'est la vie citoyenne.
Plus les parents seront présents dans les établissements et plus nous pourrons sinon les former, du moins les informer des dangers et leur apporter une écoute. L'expression « comité éducatif » a été créée par les parents d'élèves de l'enseignement libre voilà vingt-six ans environ. Grâce à vous, messieurs, il est repris dans la loi.
A titre personnel, il me paraît extrêmement important de revaloriser la philosophie, puis de la réintroduire dans les enseignements technologique et professionnel et d'intégrer le questionnement philosophique, y compris chez les petits. Pour les personnes aux cheveux blancs comme moi, cela s'appelait l'instruction civique et la morale. Je sais que l'Education nationale fait de grands efforts en ce sens, mais elle peut mieux faire.
M. le rapporteur - Mme Flocke a parlé du bien-fondé et de l'efficacité du partenariat entre les parents, la police, la justice, les différents acteurs. Vous sentez-vous suffisamment associés aux diverses réponses qui peuvent être proposées, aussi bien par votre fédération nationale qu'au niveau local ?
Mme Danièle Flocke - Au niveau local, la réponse est positive. Le maire, M. Gaudin, met tout en oeuvre pour cela. Tout le monde y met du sien.
Je suis persuadée que la présence et l'engagement des parents aux abords des écoles est essentielle. C'est un gage de sécurité pour nos enfants. Il faut demander cet effort aux parents.
M. Jean-Marc Delaye - A l'échelon national, depuis quelque temps, les différents ministères, qu'il s'agisse de celui de l'Education nationale ou de celui qui est en charge de la santé, affichent une volonté assez forte d'associer les parents à la réflexion qu'ils peuvent mener. Nous pouvons apporter sinon des solutions, du moins des pistes de réflexion.
Mme Régine Florin - Ainsi, dans les réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité qui ont été mis en place par la délégation interministérielle à la famille, les actions de sensibilisation à la prévention des conduites à risques, à la drogue, à la violence qui sont organisées à l'intérieur des établissements scolaires à l'attention des parents ont bénéficié de subventions dans le cadre des réseaux. Le délégué interministériel est récemment venu présenter ces réseaux d'écoute au conseil des présidents et il s'est vivement intéressé à ce que nous faisions. En réalité, il faut que nous nous prenions par la main et que nous allions demander.
M. Jean-Marc Delaye - Il est à noter une bonne écoute, notamment dans les établissements parisiens. Les policiers viennent assez souvent en uniforme, fait qui est nouveau et que je trouve très bien, expliquer comment lutter contre le racket, présenter les dangers de la drogue, etc. De plus en plus, les actions sont réalisées avec les chefs d'établissement, voire avec les enseignants. Les parents, tout comme leurs enfants les premiers, ont encore peur des représailles et des violences. A ce stade, un important travail reste à accomplir.
M. le président - Tout le monde se rend compte que rien ne peut se faire sans que toutes les parties prenantes soient associées. Tous ceux qui, à un titre ou à un autre, doivent faire face à ces problèmes de délinquance doivent assumer leurs responsabilités. Il est effectivement normal que les parents soient de plus en plus associés. Leur présence à la sortie des établissements est certainement une bonne chose. Si elle est facilement envisageable dans le primaire, qu'en est-il dans le secondaire ?
M. Jean-Marc Delaye - En ce qui concerne les lycées, malheureusement, une telle présence n'est pas assurée. Au collège, elle fait l'objet d'une espèce de tractation. En cinquième ou en quatrième, les enfants acceptent encore que leurs parents les accompagnent, surtout si ceux-ci sont impliqués dans le milieu éducatif et qu'ils en profitent pour rencontrer d'autres parents. Ils leur demandent simplement de leur lâcher la main 50 mètres ou 100 mètres avant l'école. Une telle attitude est dissuasive. J'en veux pour preuve l'anecdote que m'a racontée une amie hier soir. Elle accompagnait sa fille à l'école et celle-ci lui a demandé de la laisser à 100 mètres de l'école ; sans que la mère sache pourquoi, sa fille est revenue vers elle sous prétexte qu'elle avait oublié de lui demander quelque chose, et elle s'est laissée conduire jusqu'à la porte de son établissement.
Une personne d'une communauté africaine faisait remarquer que les membres de ladite communauté ne nous comprenaient pas nous, parents. Ils se demandaient pourquoi, si l'on voyait l'un de leurs fils commettre une incivilité, on ne lui donnait pas une claque. Dans nos écoles, on ne sait pas agir ainsi, mais on pourrait se permettre de faire une observation.
M. le président - Lors d'une audition précédente, un intervenant nous expliquait que les communautés africaines, notamment, vivent ainsi ; dans les villages, n'importe quel adulte peut réprimander n'importe quel enfant, et tout le monde trouve cela très bien. La transplantation en France pose quelques problèmes, et on peut le regretter.
M. Jean-Marc Delaye - Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai le souvenir de m'être fait rappeler à l'ordre lorsque je laissais un peu trop vivement éclater ma jeunesse sur le trottoir de l'école. On était repris par des adultes à l'époque et on trouvait cela tout à fait normal. Nos moeurs ont évolué. Mais je crois qu'il faut laisser le droit aux jeunes de transgresser. Le seul problème est qu'ils sachent s'arrêter.
M. le rapporteur - Que pensez-vous de la proposition tendant à redynamiser les internats au collège et au lycée ?
M. Jean-Marc Delaye - Elle peut engendrer le pire et le meilleur. Si ce sont des internats-prisons dans lesquels on va enfermer des jeunes sans leur fixer un projet, il s'agira de ce que l'on appelait avant des « maisons de correction ». En revanche, si, dans ces structures, on leur apprend à vivre en société, à respecter un certain nombre de valeurs collectives, cette formule peut être la meilleure des choses.
A un moment donné, il va falloir que le Parlement soit unanime sur un certain nombre de points. C'est très important pour moi. Vous devez donner des orientations.
M. le rapporteur - Que pensez-vous de la sanction éventuelle infligée aux familles défaillantes sur les allocations familiales ?
M. Jean-Marc Delaye - C'est une tentation. S'il s'agit de les en priver, on les rend encore plus volatiles et on les enferme encore plus dans la délinquance. Si une telle mesure est imposée de façon brutale, ce n'est pas une bonne solution. En revanche, si l'on trouve un biais afin que l'argent bénéficie aux enfants exclusivement et non à toute la famille, cette proposition peut être intéressante.
M. le président - Au cours d'un débat en séance publique, j'avais suggéré d'élargir les possibilités de tutelle, de façon que les allocations continuent de profiter à l'enfant.
M. Jean-Marc Delaye - Le tutorat me paraît être une solution.
M. Jacques Mahéas - Je suis optimiste à propos du tutorat car de plus en plus de jeunes retraités s'occupent par exemple des aides aux devoirs. Je félicite les parents car l'on ressent une prise de responsabilité de leur part dans les écoles que vous avez mentionnées.
Je voudrais tout d'abord savoir si le choix de mettre son enfant en école privée est toujours dicté, comme autrefois, par des considérations religieuses ou si ce n'est pas plutôt la crainte de l'insécurité dans les écoles publiques qui motive les parents.
Par ailleurs, quand se produit dans un établissement privé un fait dramatique, qu'en tirez-vous comme conclusion ?
M. Jean-Marc Delaye - Deux de mes enfants ont été scolarisés dans le public et les deux autres l'on été dans le privé. Par conséquent, mon cas correspond tout à fait à la statistique française.
M. Jacques Mahéas - Avez-vous mis vos enfants à un moment donné de leur scolarité dans le public et ensuite dans le privé ?
M. Jean-Marc Delaye - Plusieurs critères ont motivé mon choix. Dans certains cas, la qualité de l'enseignement public était supérieure à celle du privé, ce qui a pu influencer ma décision. Mon choix n'a pas été à proprement parler purement religieux. D'ailleurs, seuls 10 % à 15 % des parents qui optent pour l'enseignement catholique le font par conviction religieuse. C'est fort bien car nous sommes sous contrat d'association avec l'Etat et nous estimons faire partie du service public de l'éducation.
Ma situation est cependant un peu particulière. En ce qui concerne le premier de mes enfants, je n'ai pas eu le choix : lorsque j'ai voulu l'inscrire à l'école la plus proche de mon domicile dans le XVIIIème arrondissement, la directrice m'a indiqué qu'il n'y avait pas de place. Elle m'a également fait part des difficultés qu'elle rencontrait en matière de réussite scolaire en raison du nombre important d'élèves par classe -une trentaine- et de la diversité des ethnies qui pouvaient aller jusqu'à vingt-cinq par classe. Elle m'a donc conseillé de rechercher un autre établissement, public ou privé, qui accepterait mon fils. J'ai alors trouvé une école dont le projet éducatif et le mode de fonctionnement m'ont convaincu.
Si un projet éducatif existe, car tel n'est pas toujours le cas, il faut le faire vivre. S'il s'agit simplement d'une feuille de papier que l'on fait signer aux parents en début d'année sans faire respecter ce projet, cela n'a aucun intérêt. Ce fait a entraîné mon engagement personnel. Mes enfants et petits-enfants ont fait ou font leurs études dans l'enseignement privé. De surcroît, un tel choix implique des sacrifices pour certains parents.
Parfois, des parents musulmans nous disent : « c'est mieux tenu dans vos établissements ». Je n'aurai pas l'outrecuidance de soutenir que c'est vrai mais ces personnes le perçoivent ainsi. Cela signifie que les parents sont réellement en attente de repères pour leurs enfants.
Je disais tout à l'heure que pour moi, en République, la loi est la valeur suprême. Si elle n'est pas bonne, il est de votre responsabilité, messieurs les sénateurs, de la changer.
Nous sommes des parents vraiment engagés et nous ne comptons pas notre temps. Lorsque des catastrophes se produisent dans un établissement, nous allons en rechercher la raison et nous allons essayer d'accompagner les parents. Une personne m'a fait la réflexion suivante : « Si j'ai un fils qui a de brillants résultats scolaires mais si, alors qu'il a quinze ans, on m'apprend qu'il est assassin ou qu'il est mort, je considérerai que je n'aurai pas réussi mon éducation ».
Nous avons l'impression qu'il faut absolument prendre en compte cette dimension. Pour ma part, j'estime pouvoir faire quelque chose. Mais, dans le secteur public, c'est moins évident. Les chefs d'établissement ont un peu moins de pouvoir sur leur propre établissement ; par conséquent, ils ne peuvent pas donner la même impulsion.
Mme Régine Florin - Il est clair qu'il y a le sens d'une équipe d'adultes qui est soudée autour d'un enfant, lequel se reconnaît comme étant identifié individuellement et non comme étant perdu dans l'anonymat. De ce fait, le comportement n'est pas le même. Au lieu de dire : « toi, là-bas », si je dis : « Charles, qu'es-tu en train de fabriquer ? », cela change tout !
Audition de M. André TANTI,
vice-président de la
fédération des parents d'élèves
de
l'enseignement public (PEEP)
(3 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. André Tanti, vice-président de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP).
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Tanti.
M. André Tanti - Votre commission a décidé de travailler sur le problème de la délinquance des mineurs. Permettez-moi d'intervenir devant vous au nom de mon organisation de parents d'élèves. De temps en temps, je ferai quelques digressions, car je ne peux m'empêcher de me rappeler qu'entre 1990 et 1993, et plus particulièrement au cours de l'année 1992, j'ai été rapporteur de l'instance d'évaluation des politiques publiques d'insertion des adolescents en difficulté. Par conséquent, certaines idées que je développerai seront issues de mes activités professionnelles et non associatives.
La fédération des parents d'élèves de l'enseignement public est la plus ancienne des fédérations de ce type. Ses origines remontent à 1906, avec la création de la première association de parents d'élèves au lycée Carnot, à Paris, dans le XVIIème arrondissement. La constitution de la fédération date de 1926. En 1968, la fédération des parents des lycées et collèges s'est transformée en fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Il nous a fallu soixante-deux ans pour que soit satisfaite la principale de nos revendications, à savoir que des parents puissent participer à la vie scolaire de leurs enfants. C'est particulièrement important. Depuis 1968 dans les lycées et collèges, depuis 1977 dans les écoles, les parents qui sont présents sont élus. Tel n'est toujours pas le cas dans les écoles privées. Seules les écoles publiques se sont ouvertes à cette démocratie.
La principale valeur que nous mettons en avant est le fait que nous soyons les premiers éducateurs de nos enfants. C'est l'un des points qui nous distinguent le plus de nos concurrents de la FCPE, qui prônent la coéducation. Avoir encore aujourd'hui le courage de soutenir que les parents sont les premiers éducateurs et qu'il n'entre pas dans le rôle de l'école d'être éducateur des enfants, c'est croire en la responsabilité des parents. Nous tenons fortement à cette idée.
Je présenterai en quelques mots notre fédération. Notre organisation est calquée sur celle de l'Education nationale et compte une fédération nationale, des unions régionales et des associations départementales. De la même manière qu'en 1906 au lycée Carnot, des associations sont créées autour d'un établissement ou éventuellement d'une ville. Dans le département des Hauts-de-Seine, par exemple, une seule association représente la ville de Châtillon, alors que six associations sont présentes à Issy-les-Moulineaux. La situation dépend du contexte local.
Le problème de la délinquance des mineurs est grave et délicat. Il faut avant tout éviter l'anathème sans tomber dans l'angélisme. C'est peut-être une formule, mais elle souligne combien la crête pour traiter de la délinquance des mineurs est étroite. La PEEP ne croit ni aux remèdes miracles ni aux solutions universelles.
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Nombreux sont ceux qui tirent à boulets rouges sur cette ordonnance et qui la jugent obsolète ; j'invite ceux qui la critiquent le plus à m'indiquer ce qu'ils ajouteraient s'ils devaient la réécrire. Le texte de cette ordonnance est assez volumineux : j'ai pris la peine de le relire et je crois que tout y est. Je ne ferai pas comme le ministère de la justice, qui, sur son site internet, fait une déclaration analogue mais sans en tirer les mêmes conséquences. Le problème de l'ordonnance de 1945 est qu'elle n'est pas appliquée. On n'a pas pris le soin d'en appliquer les différents éléments, car tout est prévu : l'incarcération des jeunes, la liberté surveillée.
Permettez-moi de faire une remarque. J'ai consulté les statistiques du ministère de la justice et de la protection judiciaire de la jeunesse. En tant que commission parlementaire, vous devriez demander que l'on vous communique les stocks et non pas les flux, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Il est très compliqué de remonter les statistiques, et l'année 2000 n'est pas encore consultable ; j'ai cependant pu regarder les années 1998 et 1999. Le nombre d'enfants suivis au 31 décembre est indiqué, soit 37000, mais beaucoup ne figurent pas quand vous regardez de plus près. A ce sujet, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants suivis au titre de l'ordonnance de 1945 dans les statistiques de la protection judiciaire de la jeunesse.
Je ne connais pas les statistiques relatives à l'ordonnance de 1945, mais, dans la plupart des cas, la sanction est l'admonestation ou la remise à la famille. Or je ne pense pas que les statistiques aient beaucoup évolué depuis 10 ans.
La prise en charge des jeunes qui ont de graves difficultés pose donc un problème. J'ai entendu des juges parler de l'ordonnance de 1945. Ils disaient qu'il y avait en réalité un noyau dur qui était difficile à traiter. A-t-on le courage d'investir les sommes nécessaires sur les jeunes concernés ? Savez-vous combien coûte un enfant qui est placé dans un foyer ? En 1986, M. Chalandon avait voulu ouvrir une maison à Roubaix ; le coût journalier par enfant était estimé à 2000 francs ! Il faut avoir conscience que le fait de s'occuper correctement de ces jeunes, avec de réelles actions éducatives -car les mettre en prison ne servirait à rien- coûte très cher. Sommes-nous prêts à le faire ? Il faut être très clairs sur ce point.
Je vous prie de m'excuser de cette digression sur l'ordonnance de 1945, mais je crois qu'elle est au coeur de vos débats et il me paraissait nécessaire d'en dire quelques mots.
L'objet des associations de parents d'élèves est l'école. Nous n'avons pas attendu ces derniers mois pour prendre conscience des problèmes d'insécurité et pour interroger les parents d'élèves à ce sujet. L'observatoire des parents sonde deux fois par an depuis 1996 un panel représentatif de mille parents d'élèves issus de l'enseignement public et privé. Nous posons régulièrement la question suivante : « Estimez-vous que l'établissement fréquenté par votre enfant est un lieu à risque concernant la violence, la drogue et le sida ? » En septembre 1996, en ce qui concerne la violence, nous dénombrions un peu plus de 30% de réponses positives. En septembre 1998, ce pourcentage était descendu à moins de 15%. Lors de notre dernier sondage, en août 2001, il atteignait 51%. Nous observons donc une forte remontée du sentiment d'insécurité des parents d'enfants scolarisés. Ce sondage est régulièrement repris par la presse ; il sort au mois de mai, à l'occasion de notre congrès, et au moment de la rentrée scolaire, puisqu'il sert de support à notre président. Les résultats ont été envoyés à des responsables politiques et certains ont bien voulu réagir.
Monsieur le président, je vous remettrai les télécopies que je me suis fait envoyer ce matin par la fédération. En effet, j'ai reçu votre courrier hier et j'ai dû préparer cet exposé rapidement.
J'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, mais je voudrais intervenir encore sur quelques points. J'ai essayé de voir quelles pouvaient être les causes de la délinquance des mineurs. Nous constatons aujourd'hui l'émergence de l'image de mineurs délinquants impunis. Là, la société fait des choix. Lorsque des voitures sont incendiées ou que des exactions sont perpétrées dans une école et que les auteurs restent impunis, cela ne peut être qu'incitateur pour les autres.
Il existe donc des problèmes de prévention et d'encadrement. Je me faisais la réflexion suivante : qui est véritablement, aux termes de la loi, chargé de la prévention dans les quartiers difficiles ? Il se trouve que les services de prévention dépendent du président du Conseil général. Or, à l'occasion d'une explosion de violence dans un quartier, on met l'accent non pas sur la présence du président du Conseil général, mais sur celle du maire ou du représentant de l'Etat.
Nous devons faire face également à des problèmes de personnels, qu'il est difficile de stabiliser dans ces quartiers. Je ne ferai pas le procès des différentes instances qui peuvent intervenir. Lors d'une visite à la cité des 4 000, à La Courneuve, des travailleurs sociaux m'ont dit qu'il fallait avant tout coordonner les moyens plutôt que d'en accorder davantage. On a été confronté à ce genre de situation pour la politique de la ville, même si depuis le préfet a plus de pouvoirs. Il est vrai que des actions sont menées par la police, par la gendarmerie, par le conseil général, par la caisse d'allocations familiales, et que chacun a besoin d'argent pour le faire. Ensuite, on se retrouve avec des actions éparpillées, des partenariats qui manquent parfois de leader. Cependant, le leader est celui qui arrive à fédérer différentes actions, et ce n'est pas toujours le même.
On peut donc noter une certaine défaillance en matière de prévention et d'encadrement.
Nous voyons des établissements situés dans des zones où cela devrait mal se passer et où cela se passe bien parce que les chefs d'établissements prennent les choses en main. Je pense au principal d'un collège du Val-d'Oise qui était arrivé dans un établissement dans lequel la délinquance était particulièrement grave. Il a commencé par inscrire ses enfants dans ce collège puis il s'est attaqué aux problèmes. Si on n'arrive pas à les résoudre, ce n'est pas parce qu'il y a vingt-cinq ethnies, comme je l'ai entendu tout à l'heure, ou que les gens manquent de courage ; il faut savoir dialoguer avec les personnes, il faut savoir remettre de l'ordre. Ce principal a fait baisser significativement la délinquance dans son établissement. J'ai vu des établissements qui étaient bien tenus parce que les équipes éducatives se serraient les coudes et ne lâchaient rien.
Je suis délégué des parents d'élèves dans le lycée que fréquente ma fille. Depuis le début de l'année, six ou sept conseils de discipline ont eu lieu. Les élèves qui y sont convoqués ont déjà fait l'objet d'un rapport, ils sont passés chez le proviseur, ils ont reçu un avertissement. Lorsqu'un avertissement est donné en conseil de classe, les parents sont convoqués directement -les courriers, on le sait, n'arrivent jamais !- et on leur explique les difficultés que leur enfant rencontre, qu'il s'agisse de travail ou de discipline. Lorsque l'on met en place ce genre de système, les établissements sont tenus et il n'y a pas de problèmes.
En revanche, j'ai connu des établissements situés dans des zones favorisées où cela se passait mal. Le proviseur niait la présence de drogue dans son établissement. Le jour où il a admis qu'il y avait un problème, il a pu commencer à être traité. Selon moi, il faut absolument évoquer le problème de la drogue, car c'est l'une des causes de la délinquance des mineurs.
L'insécurité des établissements est particulièrement mal vécue par les parents, et il faut impérativement la traiter. Elle provoque des perturbations dans les classes. Dans ces conditions, le règlement n'est plus appliqué. Il y a un important travail à faire dans les établissements scolaires sur le règlement intérieur, qui doit être discuté à tous les niveaux. Il faut le faire comprendre aux élèves et l'appliquer. Un jour, un élève me faisait remarquer qu'il devait se présenter au surveillant pour tout retard excédant cinq minutes, alors que ce n'était pas le cas d'un professeur qui avait quinze minutes de retard.
Le nombre d'adultes dans un établissement n'est pas nécessairement insuffisant. Il convient cependant de ne pas créer une entrée distincte pour les professeurs et pour les élèves. Je le dis souvent, la meilleure solution consiste à obliger les professeurs à traverser la cour en installant la salle des professeurs à l'opposé. La présence d'adultes est ainsi assurée. Il ne faut pas toujours plus de moyens, il suffit parfois de petites choses. Naturellement, l'absence de prévention -le manque de surveillants, par exemple- peut se payer très cher, comme je le disais tout à l'heure à propos de la délinquance.
Je ferai quelques remarques sur les moyens. Aujourd'hui, on demande tout à l'Education nationale. Elle ne peut pas faire du « cousu main ». L'Education nationale n'a pas à prendre en charge les élèves qui ont des difficultés et qui sont délinquants. La protection judiciaire de la jeunesse est prévue pour cela ; qu'elle fasse son travail !
Les idées ne manquent pas. Lors d'un colloque organisé par M. Jack Lang à la fin de l'année 2000 à l'Ecole nationale supérieure de Chimie, de nombreux intervenants avaient prôné l'internat pour la réinsertion d'élèves délinquants. Mme Pérol-Dumont, chargée par M. Jack Lang de rédiger un rapport sur l'internat, a fini par conclure à l'issue de ses auditions que ce n'était pas la meilleure solution. Des expériences ont été réalisées dans des collèges ruraux du Poitou. On a envoyé des élèves « à la campagne », comme on le faisait au XIXème siècle, et cela a été un échec. Ce n'est pas parce que certains chefs d'établissements réussissent à réinsérer quelques délinquants que l'on peut généraliser de telles mesures.
Nous n'avons malheureusement pas ressenti les effets de l'opération de communication relative à l'école du respect qui a été décidée par M. Lang au début de l'été. Il faudrait aujourd'hui faire le compte des semaines à thème organisées dans les écoles, en sachant qu'il y a 36 semaines de cours. Nous ne savons même plus quand se tient la semaine des parents !
J'en viens au sujet délicat des caméras de vidéosurveillance, sujet qui prête à polémique parce que nous ne savons pas comment les choses se passent. Lorsque le président du conseil général des Hauts-de-Seine envisage l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les collèges, les réactions sont nombreuses. A chaque fois que je parle de l'insécurité dans les lycées aux instances régionales, on me répond que ce n'est pas un problème, que M. Dray dispose de crédits pour installer une vidéosurveillance dans les lycées qui le désirent. Je n'ai cependant jamais entendu M. Dray interviewé sur ce sujet. Je ne fait pas de polémique ; ce qui nous intéresse, c'est la sécurité de nos enfants.
Il est difficile de dire à un proviseur qu'il y a un problème dans son établissement. Il va vous répondre que cela se passe non pas dedans mais devant le collège. Je me souviens d'un collège dans lequel quelques élèves avaient décrété que c'était mardi gras tous les jours et lançaient des oeufs sur les collégiens qui ne pouvaient plus entrer dans l'établissement. Le principal était calfeutré chez lui, il n'en pouvait plus. Il m'a dit qu'il avait demandé à la police d'intervenir et que cela lui avait été refusé. En tant que parent d'élève, j'ai appelé le commissariat et j'ai demandé qu'une voiture de police soit présente devant le collège à huit heures et à midi ; cela a résolu le problème. Dans les établissements qui ne connaissent pas trop de difficultés, il suffit quelquefois de petites mesures pour que les choses rentrent dans l'ordre. Néanmoins, quelques temps plus tard, à propos d'un autre problème dans ce collège, j'ai suggéré au principal d'appeler le commissariat et il m'a répondu qu'il n'avait pas le numéro !
J'en termine sur le thème des caméras de vidéosurveillance. Sous réserve que toutes les règles soient respectées, nous ne sommes pas opposés à toute mesure qui permettrait d'assurer une meilleure sécurité pour nos enfants. Nous ne souhaitons pas que les enfants délinquants soient surprotégés, nous voulons que nos enfants aient la sécurité qui leur revient.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous poserai les mêmes questions qu'aux intervenants précédents. Vous avez souligné, monsieur le vice-président, que ce n'était pas à l'Education nationale de prendre en charge les enfants délinquants. N'est-ce pas à l'Education nationale de donner le signal d'alerte en cas de décrochage scolaire, qui est la porte entrouverte -pas toujours, Dieu merci !- au cercle infernal de la délinquance ?
M. André Tanti - Lorsque je dis que ce n'est pas à l'Education nationale de s'occuper des délinquants, je pense au cas de jeunes qui ont déjà été entendus par des tribunaux pour mineurs et pour lesquels on préconise le retour à l'école comme solution de réinsertion. Là, je dis halte ! Il faut faire attention à ce que l'on fait.
En revanche, un chef d'établissement devrait naturellement avoir des contacts avec le commissaire de police ou avec l'officier de gendarmerie. Une collaboration est nécessaire.
Faut-il pour autant faire entrer la police dans les écoles ? Nous avons sondé les parents et ils y sont opposés. Je le comprends, parce que nous ne voulons pas d'un dispositif policier dans les écoles. Il ne faut pas qu'il y ait deux policiers à l'entrée des écoles. Il ne faut pas non plus aboutir à l'extrême inverse.
Dans le lycée dont je vous parlais, une exaction importante a été commise et nous sommes en train de repérer les enfants concernés. Deux d'entre eux sont passés en conseil de discipline. A chaque fois, une plainte est déposée par le chef d'établissement et les enfants sont aussi entendus par la police. A mon sens, c'est un devoir de collaborer, de travailler ensemble.
Face à un sujet aussi complexe et délicat que celui que vous traitez, les différents acteurs doivent collaborer ; si chacun travaille dans son coin, nous n'y arriverons jamais. Je suis donc tout à fait favorable au signalement, je dirai même qu'il faut aller jusqu'à la plainte. La drogue ne sort d'un établissement que lorsqu'elle disparaît complètement, c'est la seule solution.
M. le rapporteur - Dans le domaine de la concertation et du partenariat, vous avez évoqué la nécessité d'avoir un chef de file de façon à coordonner les moyens ; les parents estiment-ils aujourd'hui être suffisamment associés aux mesures qui sont prises en matière de prévention de la délinquance, tant à l'échelon national que dans chaque établissement ?
M. André Tanti - Vous me permettrez de faire une digression sur ce point. Les parents sont bénévoles, ils donnent parfois beaucoup de leur temps parce qu'ils croient qu'ils ont un rôle à jouer dans le domaine de l'éducation. Or les organisations de parents d'élèves sont peu aidées tant par l'Education nationale que par les élus. A notre sens, c'est une erreur, car nous considérons que des parents organisés sont des parents bien informés. Les textes relatifs à l'Education nationale sont complexes. En outre, il faut avoir le goût de la représentativité. Les fédérations de parents d'élèves ont pour objet la défense de l'intérêt général des parents. Depuis vingt ans, je peux dire que je ne suis pas beaucoup intervenu pour mes propres enfants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours reconnus par les pouvoirs publics et on nous accorde rarement les facilités qui pourraient nous être offertes.
Nous avons dû aller devant le tribunal administratif pour faire comprendre à l'Education nationale qu'il fallait qu'elle joue son rôle afin que la représentation des parents soit assurée dans les établissements et que la loi soit appliquée. Les directeurs d'école ont fait grève à propos des élections de parents d'élèves. Même chez Zola, on fait la grève quand on perd quelque chose. Je ne sais pas ce que perdaient les directeurs d'école. Ils s'attaquaient aux parents dans leur rôle au sein de l'école. Tout cela est parti d'un syndicat d'enseignants qui a l'intention, depuis 1977, de « virer » les parents de l'école.
Que veut-on aujourd'hui ? On n'a pas toujours les aides que l'on pourrait obtenir de la part des élus. Quand on n'est pas d'accord avec une fédération de parents d'élèves -certes, je reconnais que ce n'est pas toujours facile pour un chef d'établissement de m'avoir en face de lui- on demande à quelques amis de créer une liste en précisant qu'elle s'occupe uniquement de l'école et qu'elle ne fait pas de politique ; elle reçoit de l'aide de la mairie, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la représentation n'existe pas. Or le rôle d'une fédération de parents d'élèves n'est pas de donner des mots d'ordre. Nous ne l'avons jamais fait et même nos concurrents le font de moins en moins.
Les fédérations de parents d'élèves ont un rôle à jouer en matière de délinquance des mineurs, car il faut former les parents à aborder les problèmes de violence dans un établissement. C'est ce que nous essayons d'apporter en tant que fédération et il faut nous en donner les moyens.
M. le rapporteur - Je voudrais vous poser une dernière question : que pensez-vous d'une éventuelle sanction sur les allocations familiales des familles défaillantes ?
M. André Tanti - Ce sujet est très délicat. J'avais fait le calcul avec un inspecteur d'académie : on supprimait au mois de mai les allocations familiales d'un élève qui commençait à se déscolariser au mois d'octobre et il fallait six mois pour les rétablir ! Certes, les procédures ont été un peu améliorées. Il faut surtout avoir des outils adaptés.
Je ne voudrais pas dire de bêtises sur ce sujet. M. Lang a écarté les élus des conseils de discipline des lycées et des collèges. Les règles de droit sont-elles parfaitement respectées lors des conseils de discipline ? Le problème, c'est que la sanction tombe vite. Il ne faut pas faire de la justice expéditive. Trois mois, cela passe vite à nos âges, mais cela représente un tiers d'année scolaire pour des jeunes.
Par conséquent, pour ce qui est de la sanction sur les allocations familiales, il faudrait qu'un travail soit effectué en amont sur la famille. Combien de familles sont-elles concernées ?
Si vous allez sur le terrain, vous verrez que ce n'est pas en coupant les allocations familiales ou en décrétant que dorénavant les enfants de treize ans iront en prison que vous ferez cesser la délinquance.
Il faut travailler sur cette question. Est-ce normal de voir des enfants âgés de douze ans mendier dans le métro alors qu'ils devraient être à l'école ? Il faut essayer de traiter les problèmes à la base et non pas de manière générique.
M. le président - Monsieur le vice-président, nous vous remercions.
Audition de M. Philippe CHAILLOU,
président de la chambre
spéciale
des mineurs de la cour d'appel de Paris
(3 avril
2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Philippe Chaillou, président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Paris.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Monsieur Chaillou.
M. Philippe Chaillou - Monsieur le président, pour faire écho à ce que disait mon prédécesseur, je vais essayer d'être le plus concret possible. Je vais partir de mon métier, de ce que je fais. A mon sens, la justice des mineurs souffre avant tout d'être méconnue, du fait de ce que l'on appelle « la publicité restreinte », principe qui veut que les audiences pénales de mineurs ne soient pas publiques, à la différence des audiences concernant les majeurs. Ce principe de publicité restreinte est sain, il est édicté pour préserver l'avenir des jeunes, mais, en entretenant l'ignorance, il finit par se retourner contre les mineurs.
Au-delà de ce principe, la responsabilité de cette méconnaissance incombe aussi à ceux dont le métier est d'informer et qui ont tendance à privilégier le fait divers au détriment de l'analyse. Je pense à la série télévisée sur le travail du juge des enfants qui, il y a quelques années, avait passionné l'opinion et qui avait bien donné à voir le travail des juridictions pour mineurs.
Je préside la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Paris, cette chambre ayant pour mission de statuer sur tous les appels interjetés à l'égard des décisions prises par les juges des enfants tant en ce qui concerne l'enfance délinquante que l'enfance en danger. Je suis dans cette chambre depuis plus de six ans, après avoir été substitut du procureur, juge des enfants en province et à Paris, président d'un tribunal pour enfants en province et exercé d'autres fonctions à la cour d'appel, mais toujours dans le droit des personnes.
Ce n'est pas de ces fonctions juridictionnelles que je vous parlerai, même si, lorsque l'on a pour ambition de réformer la justice, il n'est peut-être pas inutile d'être informé sur l'acte particulier de juger. La seule remarque que je ferai concernant cette activité juridictionnelle est que le laxisme supposé de la justice des mineurs est un mythe. Je vais citer un seul exemple : la chambre que je préside a confirmé une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée à l'égard d'un mineur de quatorze ans et demi au moment des faits. Je puis vous assurer, avec le recul d'un certain nombre d'années, que les peines prononcées par les tribunaux pour enfants sont de plus en plus lourdes.
Je vais essayer de vous expliquer le rôle de coordination que j'exerce au sein de la cour d'appel de Paris depuis de nombreuses années, en dehors de tout texte et de toute obligation, même si une toute récente circulaire du garde des sceaux du 8 mars 2002 vient d'officialiser cette pratique.
Le ressort de la cour d'appel de Paris comporte sept tribunaux pour enfants -Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Melun et Auxerre- tout cela n'est pas très facile. Il y a plus de cinquante juges des enfants dans le ressort de la cour d'appel de Paris, soit un peu plus d'un sixième des juges des enfants sur le plan national.
J'exerce ce rôle d'animation dans la plus étroite collaboration avec l'avocat général chargé des affaires de mineurs. Je réunis tout d'abord régulièrement les présidents des tribunaux pour enfants du ressort, la dernière réunion datant du 19 mars dernier, pour tenter d'harmoniser les pratiques au sein de la cour. Je réunis tous les juges des enfants du ressort pour des réunions à thème, par exemple sur les commissions d'incarcération des mineurs, sur les mineurs étrangers isolés -des commissions parlementaires se sont penchées sur cette question. Je tiens également des réunions partenariales avec la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire, des réunions transversales avec d'autres magistrats qui s'occupent des affaires de mineurs, juges de l'application des peines.
Je visite régulièrement les juridictions de mineurs, le plus souvent avec l'avocat général chargé des affaires de mineurs. Ce ne sont pas des visites de courtoisie. Elles durent une journée. On commence par un entretien avec les chefs de juridiction ; on tient une réunion avec tous les partenaires extérieurs de la juridiction, en présence des chefs de juridiction, des juges des enfants, des substituts chargés des affaires de mineurs, avec la police, la gendarmerie, la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide sociale à l'enfance, l'Education nationale et le barreau. L'après-midi, le magistrat délégué à la protection de l'enfance du siège que je suis réunit les juges des enfants, en général en présence du président du tribunal, pendant que l'avocat général est avec le procureur et les magistrats du parquet, les substituts chargés des affaires de mineurs. Je crois que, si les activités doivent être absolument complémentaires, il y a des moments aussi où il ne faut pas mélanger le rôle d'un magistrat du siège avec celui d'un magistrat du parquet. J'organise enfin une réunion avec les chefs de juridiction, les juges des enfants, les substituts chargés des affaires de mineurs, les juges d'instruction chargés d'affaires de mineurs et les juges de l'application des peines pour avoir un regard un peu global sur la politique de la juridiction dans le domaine des mineurs.
Je fais un rapport de ces visites au premier président. Je vous remettrai d'ailleurs le dernier rapport, si vous le souhaitez, qui date du mois de juin 2001.
Chaque année, je visite tous les quartiers de mineurs des maisons d'arrêt du ressort, le plus souvent avec l'avocat général, parfois avec le premier président. Vous avez sans doute visité le centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis. Nous y avons mené une action importante sur les problèmes de violence, qui se sont depuis beaucoup améliorés, au point que la prison peut être considérée comme pilote dans ce domaine. Néanmoins, le CJD abrite soixante jeunes et il faudrait faire des unités moins importantes.
Je me rends également dans les établissements privés habilités qui accueillent les mineurs placés, afin de les contrôler -c'est la loi.
Vous comprendrez que j'ai non pas une connaissance théorique de la délinquance des mineurs, mais une appréhension extrêmement concrète des mineurs eux-mêmes, que je vois tous les jours à la cour d'appel, mais également sur le terrain par des contacts avec les différents intervenants institutionnels que je viens d'évoquer.
Comment vois-je la situation actuelle ? J'étais le rapporteur général de la mission Lazerges-Balduyck, dont le rapport de quatre-vingt-six pages comporte cent trente-cinq propositions ; je ne vais pas vous les répéter, j'imagine que vous les avez lues. Les choses ont évolué ; je vous ferai donc part de la façon dont je vois les choses aujourd'hui.
La situation n'est pas très bonne. On assiste à une massification de la délinquance des mineurs, avec des réponses qui sont à mon sens de plus en plus inadaptées. Cela dit, la situation n'est pas pire qu'il y a un an ou deux. Je constate plutôt, dans mes visites des juridictions, une certaine stagnation par rapport à la délinquance des adultes. Or, depuis peu et sans le moindre fondement objectif, les discours se sont énormément radicalisés, contribuant à finir d'affoler un système et une opinion qui ont besoin de tout sauf de cela.
Face à une telle situation, l'urgence, me semble-t-il, est de reprendre les fondamentaux, d'avoir une sorte de « discours de la méthode ». Premièrement, et c'est essentiel, parce que je crois que la plupart des errements viennent de là, il ne faut pas confondre ce qui ressort du politique et ce qui ressort de la justice.
Devant un problème qui devient de plus en plus collectif -j'ai parlé de massification- la justice ne peut donner, c'est son essence même, que des réponses individuelles, ce qui marque d'ailleurs la limite de son action. Grosso modo : tu y étais ou tu n'y étais pas ; si tu y étais, tu as des comptes à rendre de ce que tu as fait. La justice peut casser une bande en renvoyant chacun à sa responsabilité individuelle dans les faits qui ont été commis, mais elle ne peut pas empêcher que la bande se reconstitue ou qu'une autre bande prenne la relève pour toutes les raisons qui font que, dans certains quartiers et pas dans d'autres, des bandes se constituent. La justice n'est pas et ne peut pas être dans la gestion collective des populations.
En revanche, il est de la responsabilité du politique qu'il n'y ait pas de manière endémique 30% de délinquants dans une rue pour des raisons socio-économiques et culturelles que tout le monde connaît, qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la justice. Je me suis occupé en même temps des XVIème et XVIIIème arrondissements de Paris ; je ne vous apprendrai rien en vous disant que le taux de mineurs délinquants dans ces deux arrondissements n'était pas le même. Pourtant, la même justice y était rendue.
Or, il faut bien constater qu'il n'y a pas de réponse politique en matière de délinquance des mineurs. Ne nous payons pas de mots, la délinquance des mineurs est essentiellement un mal des quartiers en difficultés, qui cumulent tous les handicaps : chômage, immigration forte, absence de services publics. Ce n'est pas une problématique du VIème arrondissement de Paris.
Qu'est-il fait pour ces quartiers en difficultés ? A l'évidence, pas assez. Une récente étude de l'INSEE relève que, malgré la baisse de la population dans ces cités entre 1990 et 1999, le nombre des chômeurs y a nettement augmenté. En 1999, le chômage y était toujours deux fois plus élevé que sur l'ensemble du territoire national.
Or, les mineurs délinquants sont dans ces cités, tout comme les mineurs délinquants sont pour beaucoup des jeunes d'origine étrangère qui cumulent toutes les inadaptations et devant lesquels toutes les portes se ferment lorsqu'ils cherchent du travail. Il est peut-être ainsi difficile d'accepter les règles d'une collectivité qui ne vous laisse de place que devant un écran de télévision ou une console de jeux, d'autant qu'il vous sera alors servi meurtres en série, publicités affriolantes, sommes astronomiques gagnées par quelques vedettes ou hommes d'affaires parfois véreux et pornographie.
La raison de la massification de la délinquance des mineurs n'est pas ailleurs que dans les dysfonctionnements sociaux que je viens d'évoquer. Elle n'est pas ailleurs que dans l'absence d'action sur les causes. Plutôt que de s'attaquer à ces vraies raisons, il est plus facile de trouver des boucs émissaires comme la justice ou la protection judiciaire de la jeunesse, institutions certes tout à fait imparfaites, mais qui n'auront jamais le pouvoir à elles seules de juguler le phénomène.
Pour ce qui concerne la justice des mineurs, ce que je connais le mieux, cela ne va pas très bien dans une institution -la justice- qui, globalement, va mal. Je citerai quelques points d'appui, simplement pour tenter d'y voir clair. Une sorte de tolérance « zéro » a été mise en place pour apporter une réponse à tout acte de délinquance ou d'incivilité commis par un mineur. En conséquence, le contentieux des mineurs délinquants est le contentieux judiciaire qui a le plus augmenté. Le résultat, c'est que l'institution judiciaire est engorgée. Cela rentre, mais cela ne sort pas ; ou, ce qui sort, c'est parfois du vent. Je suis désolé de tenir des propos aussi crus.
Je vais vous lire des extraits d'une lettre qui m'a été adressée le 25 février 2002 par le président du tribunal de grande instance de Meaux : « Monsieur le président, nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur une difficulté de fonctionnement que nous rencontrons dans l'exercice de nos fonctions, relative à l'inexécution des décisions prises par les juges des enfants du tribunal de grande instance de Meaux.
« En effet, les magistrats du tribunal pour enfants de Meaux font depuis plusieurs années le constat d'un retard important dans l'exécution de leurs décisions, tant au pénal qu'en assistance éducative. En dépit des moyens accordés en 2000 par les autorités concernées -protection judiciaire de la jeunesse et Conseil général-, la situation n'a pas cessé de se dégrader en 2001. Ainsi, le département de la Seine-et-Marne a atteint au 30 septembre 2001 le chiffre de 476 mesures en attente d'exécution, soit 23% des mesures en attente de la région d'Ile-de-France. » Le nord de ce département est une zone difficile ; c'est en outre un département pilote en matière de délinquance des mineurs.
« Au sein du département, la juridiction de Meaux est plus particulièrement touchée puisque le nombre des mesures en attente pour cette juridiction représente 64% du chiffre départemental (...).
« La liste d'attente comprend aussi bien des mesures d'investigation -enquêtes rapides, investigations et orientations éducatives- que des mesures éducatives -assistance éducative en milieu ouvert, liberté surveillée, mesures de réparation- ou des peines prononcées par le tribunal pour enfants -sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général. A titre d'exemple, certains sursis avec mise à l'épreuve prononcés pour une durée de dix-huit mois ne sont pris en charge que durant les six derniers mois. Certaines peines de travail d'intérêt général ne sont pas exécutées à l'expiration du délai de dix-huit mois. Des mesures de réparation ordonnées pour une durée de quatre mois sont prorogées à deux reprises et exécutées un an après leur prononcé.
« Dans ces conditions, il est facile d'imaginer à quel point notre action pénale est frappée d'inefficacité et comment cette situation génère ou renforce un sentiment d'impunité chez les mineurs auteurs d'infractions. L'action éducative posée en principe de l'ordonnance du 2 février 1945 n'est pas exercée et conduit tout droit à la récidive certains mineurs qui, s'ils avaient été pris en charge à temps par un service éducatif, auraient pu mettre un terme à un parcours délinquant. »
Je ne vous ai pas parlé des peines de prison qui, prononcées par un tribunal, ne sont pas exécutées par le parquet. C'est aussi la réalité. Contrairement à ce que l'on dit, l'ordonnance de 1945 n'est pas un texte laxiste puisqu'il permet l'exécution provisoire de la décision, ce qu'aucun texte concernant les majeurs ne prévoit. Personne n'en parle, mais c'est tout à fait important et les tribunaux la prononcent de plus en plus. Vous pouvez faire arrêter un adulte à l'audience uniquement si vous prononcez une peine d'emprisonnement ferme ou s'il comparaît à la suite d'une procédure de comparution immédiate.
Pour un mineur, le texte est beaucoup plus répressif puisque, dans tous les domaines, le tribunal pour enfants peut assortir sa décision de l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'un mineur en situation de réitération que l'on condamne à trois mois d'emprisonnement ferme peut être arrêté à l'audience. Il ira en prison même s'il fait appel. Si cela fonctionnait bien, cela permettrait d'aller très vite. Par rapport à la question de la détention provisoire, c'est l'un des arguments qui revient souvent en matière correctionnelle pour les mineurs âgés de treize à seize ans. Si on fait venir les affaires relativement vite devant le tribunal, on peut arrêter très rapidement et assez fermement un mineur qui est dans la réitération.
Après cette parenthèse sur les peines de prison qui ne sont pas exécutées -je parlais uniquement des mesures éducatives dans un premier temps- j'en reviens à mon propos. On a le sentiment qu'il faut que l'institution judiciaire donne à voir qu'on fait quelque chose ; peu importe si on sait très bien que ce quelque chose qui est fait par la justice n'a pas de prise sur la réalité, peu importe s'il s'agit d'une machine qui tourne à vide !
Le problème, c'est que les gens comprennent vite que le roi est nu et que tout cela peut finir par décourager les magistrats, même ceux qui aiment beaucoup leur travail -et il y en a quand même un certain nombre.
Dans un tel contexte, que croyez-vous que je puisse penser des miracles que l'on nous annonce avec la réforme de l'ordonnance de 1945, avec les procédures de comparution immédiate ou les centres fermés ? Avec tous ces projets, j'ai bien peur qu'on finisse de casser un outil qui n'était pas si mauvais, qui reposait -les technocrates l'ont oublié- sur une rencontre singulière entre un jeune et son juge ou entre un jeune et son éducateur. Quand on arrive à un certain âge de la vie, on sait très bien que c'est toujours à partir d'une rencontre avec un autre qu'un jeune peut s'en sortir.
A mon sens, avant toute fuite en avant, donnons-nous premièrement les moyens d'agir sur les causes de la délinquance des mineurs et, deuxièmement, faisons en sorte que la justice ait tout simplement les moyens de faire son travail.
M. le président - Monsieur le président, nous vous remercions de votre exposé fort clair et très intéressant.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Pour reprendre vos conclusions, monsieur le président, comment peut-on améliorer la situation et faire en sorte que la justice ait les moyens d'agir sur la délinquance des mineurs ? Quelles grandes propositions pouvez-vous nous faire ?
M. Philippe Chaillou - Des moyens ont été donnés, des annonces ont été faites dans le milieu éducateur, mais tout cela met beaucoup de temps à arriver sur le terrain.
Par ailleurs -j'ai parlé de la juridiction de Meaux- ces moyens ne sont pas toujours accordés là où ils devraient l'être. Il faudrait une prospective, une analyse des évolutions de population ; il faut « mettre le paquet » sur les quartiers, « changer de braquet ».
Je vous livre quelques suggestions dans le désordre.
Les maisons de la justice et du droit, par exemple, offrent une justice assez proche des citoyens. Elles ne seraient pas adaptées aux grosses infractions, qui doivent être traitées au tribunal avec un certain cérémonial, mais les juges des enfants doivent leur être plus étroitement associés.
Il faut agir davantage sur le terrain.
Peut-être cela provoquera-t-il des levées de boucliers, mais, dans le texte de l'ordonnance de 1945, étaient prévus des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Ils ont fonctionné, puis ont été abandonnés. Dans les quartiers, quelques adultes bénévoles, à la personnalité bien trempée, des pères de famille -certains se mobilisent parfois pour aller chercher les enfants- qui seraient bien identifiés, bénéficieraient du soutien des institutions, pourraient agir auprès de ces jeunes : ils sont en effet au plus près d'eux, ils connaissent la réalité de leur quartier.
Je crois enfin -cela a été évoqué- que les juridictions ne sont pas très bien gérées. Peut-être le temps est-il venu d'en confier la gestion à des ingénieurs en organisation, par exemple, à des gens dont c'est le métier d'organiser. Les choses deviennent de plus en plus complexes, et la justice des mineurs est tributaire des modes de fonctionnement de la justice en général.
Je disais que la justice allait mal : c'est une évidence. Toutefois, même si elle est actuellement extrêmement fragilisée, et qu'il ne faut donc pas trop en rajouter, elle a quand même besoin, à mon sens, de réformes fondamentales.
Ainsi, les citations par huissier sont complètement inopérantes dans les quartiers. A Paris, elles sont toujours délivrées : les huissiers convoquent les gens au Palais de justice -ils perçoivent bien sûr des émoluments- pour la leur remettre. Des moyens plus simples -lettre recommandée avec une sorte de contrat avec La Poste- pourraient être adoptés. Un employé de l'étude se rend -ou non- dans les quartiers ; du fait des décisions prises par défaut, avec des possibilités d'opposition, les procédure traînent pendant des années.
Sur les voies de recours devant la justice, il y aurait, à mon avis, à dire. La justice doit être un peu efficace : elle n'est faite ni pour les juges, ni pour les auxiliaires de justice ; elle est faite pour les justiciables. Il faut qu'il y ait une certaine autorité de la chose jugée.
Je vais tenir des propos peut-être un peu iconoclastes : en France, toute affaire peut-être jugée deux fois. C'est un principe. Je ne suis pas certain que, pour le justiciable, ce soit une bonne chose.
Ce droit d'appel rallonge évidemment la durée des procédures. Dans d'autres pays, il est possible uniquement s'il y a des raisons de faire appel : soit le premier juge, soit une petite commission au niveau de la cour d'appel en décide.
Basculer les moyens dévolus à l'appel en première instance, prendre le temps d'écouter les gens, faire moins de justice à l'abattage, restreindre un peu le droit d'appel, permettrait d'avoir une pyramide avec beaucoup plus de moyens en première instance.
M. le rapporteur - Les structures d'accueil sont-elles bien adaptées, en nombre suffisant ?
M. Philippe Chaillou - Je ne sais pas où vous en êtes de vos investigations.
Un gros problème d'hébergement se pose. La PJJ est en difficulté sur ce point, même si les CER, les centres éducatifs renforcés, ne fonctionnent pas mal.
Il existe malgré tout des solutions. Je vais parler un peu de mon expérience passée.
J'ai beaucoup travaillé, quand j'étais en province, et ensuite, à Paris, en première instance, en tant que juge des enfants, avec des « lieux de vie ». Il ne s'agit pas de « Cheval pour tous », qui a été évoqué dans la presse. Les magistrats doivent contrôler ces endroits, mais il est bien évident qu'un certain nombre de jeunes qui se sont marginalisés et qui ont vécu avec le moins de contraintes possible -il faut dire les choses telles qu'elles sont- ont le plus grand mal à intégrer une structure d'hébergement classique. Pour eux, il faut du « cousu main », des structures qui proposent quelque chose auquel ils puissent « accrocher ».
Je me souviens avoir travaillé avec des gens qui avaient retapé un thonier. Une fois sur l'océan, ils faisaient faire de la plongée aux jeunes, qui quittaient ainsi la cité. J'étais alors dans le XVIIIème arrondissement de Paris. J'avais une photo du bateau dans le tiroir de mon bureau. Un gamin m'était déféré ; après l'avoir sermonné -c'était un peu une mise en scène- je la lui montrais : « Cela te dirait d'aller là-bas ? » Je passais un coup de téléphone aux éducateurs, qui venaient le chercher, et il partait dans ce lieu de vie où il était encadré.
Se pose bien sûr la question de l'après : il n'y a pas de miracle dans ce domaine-là, mais on peut s'appuyer sur des structures alternatives qui offrent un projet dans lequel ces gamins puissent rencontrer des limites.
En effet, tel est bien le problème : ce sont des gamins qui n'ont pas de limites. Ils doivent pratiquer des activités formatrices, se confronter un peu à quelque chose, rencontrer des adultes sachant s'opposer à eux.
Il y a aussi tout le côté prestance. Il est difficile d'analyser, de ne pas dramatiser, cette délinquance des mineurs. Pourtant, un très grand nombre d'entre eux sont de très pauvres garçons -il faut bien dire ce qui est- et, dans la rue -parce que c'est sur la voie publique que cela se passe- ils adoptent une attitude de prestance : ils en rajoutent par rapport aux copains.
Les différents intervenants ne doivent pas se laisse prendre, parce que dès que l'on gratte un peu, on voit bien que les masques tombent : ces gamins peuvent « rouler des mécaniques » et, cinq minutes après, se mettre à pleurer.
Il ne faut pas non plus en faire des « durs à cuire », si je puis dire ; il faut que ce masque tombe : la délinquance s'arrêtera quand ce masque, ce besoin de se rassurer avec la bande n'auront plus lieu d'être.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur la mission, l'organisation, le fonctionnement et, éventuellement, l'évolution de la PJJ ?
M. Philippe Chaillou - Je ne peux pas juger la PJJ : j'ai bien assez de juger les mineurs et leurs familles ! Je ne vais pas m'en sortir par une boutade ; je vais essayer de vous expliquer les choses tout simplement.
J'ai d'ailleurs, à ce sujet, émis certaines critiques. Selon les départements, elle donne satisfaction ou non.
On trouve de tout à la PJJ. Des éducateurs remarquables y travaillent -j'en ai vu me tirer d'affaire des gamins ... chapeau !- des hommes extraordinaires.
Il faut que vous ayez cela vraiment présent à l'esprit, quelque conclusion que vous rendiez : c'est sur la personnalisation des relations que tout se joue ; ce sont des gamins qui n'ont pas eu, à un moment donné, soit dans leur famille, soit après, quelqu'un avec lequel un accrochage ait pu se faire et avec lequel ils aient véritablement eu des échanges.
Il faudra se méfier, de toute façon, de tout ce qui pourra être mis sur pied.
Ainsi, les comparutions immédiates sont le pire de tout : ce sera la justice à la chaîne, un tribunal où les prévenus vont défiler. Or, en matière de justice, il ne faut surtout pas de choses systématiques, de stéréotypie des fonctionnements. En introduire dans un domaine comme celui-là serait terrible. Il faut qu'à chacun soit rendu son dû. Ces enfants ont un tel sentiment d'injustice vissé au corps -légitime ou pas : c'est une autre question- que si l'institution en rajoute en fonctionnant d'une manière stéréotypée, elle va provoquer une casse effroyable.
Ceux qui se consacrent à la PJJ doivent donc avoir la fibre éducatrice.
La question sociale qui est posée est la suivante : qui « se coltine » ces gamins ? Il n'y a pas beaucoup de candidats, il faut bien dire ce qui est. Nous parlons de la PJJ, pas des élus, mais ces derniers, quand un centre éducatif renforcé va s'implanter sur leur territoire, ont un peu peur.
Si, donc, à la PJJ, certaines personnes sont absolument remarquables, d'autres le sont moins. Elle a sans doute dû recruter des éducateurs très jeunes, avec un profil uniquement universitaire, sans, peut-être, l'épaisseur humaine nécessaire. Il n'est pas commode de gérer ces gamins au quotidien.
Cela étant, pour connaître d'autres milieux éducatifs, que ce soit l'aide sociale à l'enfance ou les établissements privés habilités, j'estime que, sur le plan individuel, elle donne satisfaction.
L'institution elle-même rencontre parfois des difficultés de fonctionnement.
Je vais encore poser des questions peut-être un peu iconoclastes : peut-on être éducateur et fonctionnaire ? Un fonctionnement administratif n'est-il pas absolument contradictoire avec cette implication qu'il faut avoir au jour le jour ?
Ce n'est pas une histoire d'horaires : à un moment donné, vous irez vite, et à un autre, il faudra être capable de passer des heures. C'est pour cela que je disais voilà un instant que, pour les cas un peu lourds, les structures alternatives me semblent les mieux à même de répondre à cette problématique : elles n'ont pas la pesanteur d'une institution.
Il faudrait que la PJJ -je ne sais pas si elle le pourra ; toutefois, des expériences ont été menées- puisse s'améliorer sur ce plan.
C'est aussi une question de valeurs. Nous avons connu des époques de grands pédagogues : Antoine Makarenko, et, dans un registre totalement différent, don Bosco. Il n'y en a plus, ni dans notre pays, ni ailleurs. Quelles valeurs avons-nous ? L'argent ? Quelles valeurs collectives, humaines, sur l'éducation des enfants, au bon sens du terme ?
J'ai beaucoup travaillé avec Françoise Dolto. Une femme comme elle aurait pu formuler de nombreuses remarques dans le contexte actuel, avec son intuition, son coeur, la connaissance qu'elle avait des hommes. Elle n'hésitait pas, d'ailleurs -c'était une femme courageuse qui avait beaucoup de franc-parler- à dire ce qu'elle pensait.
M. le président - Sur l'ordonnance de 1945, il semble bien que tout le monde soit à peu près d'accord. Peut-être devrait-elle être modifiée et mise à jour mais, en général, elle donne satisfaction.
Le problème n'est-il pas plutôt un problème de seuils ?
M. Philippe Chaillou - J'y avais pensé, bien évidemment. Il faut prendre du recul et dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement.
Vous savez que la loi ne fixe pas l'âge auquel un mineur peut faire l'objet de poursuites pénales. Selon la formule un peu alambiquée de la jurisprudence, le mineur peut être poursuivi pénalement « quand il peut vouloir et concevoir l'acte », à savoir quand il a à peu près l'âge de raison, donc entre sept et dix ans. Je laisse cela à la réflexion de chacun.
Il peut passer devant une juridiction de mineurs.
Le deuxième seuil est celui de treize ans : une sanction pénale peut être appliquée.
L'acte de délinquance d'un mineur de moins de treize ans, quel qu'il soit, justifie-t-il d'autres mesures qu'un placement ? C'est une question.
Le troisième seuil, vous le connaissez : c'est seize ans, pour la détention provisoire, et le dernier, c'est dix-huit ans.
Si, en Allemagne, les seuils sont un peu plus élevés qu'en France, en Grande-Bretagne, ils sont plus bas. Depuis une récente loi, un mineur peut faire l'objet de sanctions pénales dès dix ans.
Pour ces gamins qui font un peu peur, entre dix ans et treize ans, faut-il une réponse pénale ? C'est aussi une vraie question. Faut-il entrer tout de suite dans cet engrenage-là ?
Ce que je vais dire vous choquera peut-être. Je sais être véritablement ferme quand cela se justifie, j'ai confirmé des peines très lourdes : j'estime que, pour une mineur, la détention provisoire ne peut parfaitement se justifier que si ce mineur est dans une fuite en avant, qu'il convient de l'arrêter et que nous n'avons pas d'autre moyen pour ce faire que de le bloquer. Annoncer : « Je te mets en prison, je t'arrête pour les autres, pour toi aussi ; tu vas réfléchir un peu, nous reprendrons les choses après » ne m'a jamais posé de problème.
Cela étant, il faut être prudent : on peut faire énormément de casse. Nous savons ce qu'est la prison. Il est vrai que, sur le plan des principes, et même si, dans les faits, je n'hésitais pas, j'essayais toujours de me dire qu'il aurait bien le temps d'y aller quand il aurait dix-huit ans et qu'auparavant, nous devions essayer tout ce qu'il était possible d'essayer.
Tel est un peu le type de réflexion que je me ferais à propos de ces gamins qui font peur. Prenons du recul ! Si nous, les adultes, ne savons pas en venir à bout alors qu'ils ont entre dix et treize ans, cela nous renvoie, par des moyens qui ne sont pas pénaux, à une impuissance de notre société par rapport à sa jeunesse qui me semble terrible.
Il faut que nous nous regardions en face. Ce sont des choses dont je suis persuadé. La démission des parents existe depuis longtemps. Qu'est-ce que cela signifie ? Que des milliers de jeunes doivent venir devant la justice pour trouver enfin des limites ?
Les limites doivent se rencontrer très tôt : il faut savoir dire « non » à un enfant, sans nécessairement donner d'explication. « Non », c'est « non » ; cela ne se discute pas, et c'est structurant. Or, dire « non » semble être impossible à un certain nombre de parents, malheureusement.
M. Bernard Plasait - Nous apprenons, au fil des auditions, que cette ordonnance de 1945 fait l'objet d'un très large consensus, au moins quant à ses principes et quant au fait qu'elle est une espèce de catalogue d'outils mis à la disposition du magistrat, ce dernier se plaignant le plus souvent que, si les outils existent bien sur catalogue, ils ne sont pas forcément disponibles au moment où il en a besoin.
M. Philippe Chaillou - En magasin !
M. Bernard Plasait - Je vous ai bien compris : il faudrait plus de moyens, pour passer du virtuel au réel.
Beaucoup de ceux qui nous ont donné leur sentiment positif sur ce texte précisent néanmoins qu'il a été souvent retouché depuis 1945 et qu'il mériterait sans doute de subir encore deux ou trois petites modifications, et ce quelquefois, d'ailleurs, sur des points très particuliers, qui sont presque des détails. Toutefois, selon les magistrats, les procédures, par exemple, s'en trouveraient simplifiées, accélérées.
Voyez-vous quelques retouches de cette nature à apporter à cette ordonnance ?
Un outil, peut-être, manque, parce que la délinquance a sans doute changé depuis 1945, est devenue beaucoup plus violente : nous avons besoin de traiter les « noyaux durs », ce qui est difficile. Lorsqu'ils ont pu être isolés, il faut quelquefois pouvoir les enfermer, sans pour autant les mettre en prison, d'où l'idée de centres fermés.
De tels centres ont existé -c'étaient les maisons de correction- mais ont été fermés pour de bonnes raisons. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si nous les réinventions, même sous un autre nom, nous nous heurterions aux mêmes difficultés, et nous serions sans doute obligés d'y renoncer.
Un intervenant nous a soumis, en fonction de son expérience, l'idée de centres semi-fermés.
Dans un centre fermé, les éducateurs, les surveillants, le personnel doivent être particulièrement bien formés pour parvenir à résister à la pression de mineurs très violents. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui.
Dans son esprit, un centre semi-fermé serait un centre éducatif renforcé particulièrement bien surveillé, assorti d'un volet réellement fermé qui serait utilisé de façon très limitée et provisoire : quand, à l'intérieur du centre, un jeune ne serait plus maîtrisable, il serait mis quelques jours dans ce centre fermé avant de réintégrer ensuite la structure normale.
Cette idée vous paraît-elle être une piste ou bien relève-t-elle de l'utopie ?
M. Philippe Chaillou - Je vous remercie : vous avez avancé sur des choses très concrètes, vous êtes allés assez loin dans vos réflexions.
Sera-t-il possible de ne pas toucher à l'ordonnance de 1945 ?
M. Bernard Plasait - J'ajoute simplement que ne pas la modifier sera sans doute difficile, parce que nous avons besoin de mesures symboliques, ne serait-ce que vis-à-vis des jeunes délinquants, et, bien sûr, de l'opinion publique.
M. Philippe Chaillou - Cela ne m'a pas échappé. Cela étant, je ne peux pas répondre : il appartient au législateur, au Gouvernement, de prendre leurs responsabilités par rapport à l'opinion, par rapport à la population. Les juges appliqueront les textes tels qu'ils seront.
En tant que professionnel, je ne suis pas certain qu'il faille procéder à des retouches. Il faut à mon avis absolument garder cette idée essentielle -je crois que vous en êtes convaincus- là aussi en termes de symboles, même si cela peut être parfois perverti, qu'il ne s'agit pas de la même justice que celle des majeurs. Il faut le signifier clairement. Si on l'abandonne, on abandonne tout, on abandonne l'essence de la justice des mineurs.
Ce texte -même si les juges le manient avec la plus grande souplesse, même si, après avoir essayé une mesure éducative, ils s'aperçoivent très vite qu'il leur faut prononcer une peine, appliquer une sanction- doit préciser qu'aux mineurs de moins de dix-huit ans ayant commis une infraction qui relève de la loi commune, nous répondons tout d'abord d'une manière éducative, par des mesures éducatives. C'est absolument fondamental.
Par ailleurs, il faut absolument conserver cette relation entre les personnes, autrement dit la personnalisation.
Vous savez qu'il existe deux sortes d'audiences en matière correctionnelle : l'une devant le juge des enfants, qui officie en chambre du conseil, dans son cabinet, l'autre devant le tribunal pour enfants, avec tout son cérémonial, c'est-à-dire que le juge est en robe, il est assisté par deux assesseurs qui ne sont pas magistrats. C'est le juge des enfants qui décide seul de l'orientation d'une affaire, soit en cabinet, soit devant le tribunal. A la place que j'occupe à la cour d'appel, j'ai parfois eu le sentiment que des « erreurs d'aiguillage » avaient été commises. Je n'aurais pas renvoyé certaines affaires, qui avaient notamment trait à la violence, en cabinet. Elles auraient pu être justiciables du cérémonial du tribunal pour enfants et de son arsenal de peines. Je m'en ouvrais voilà peu de temps à une collègue, juge des enfants ; elle m'a rétorqué que l'audience en cabinet « dégonfle » les choses. La justice des mineurs doit être capable de surprendre et de ne pas faire endosser à un gamin les oripeaux de délinquant qu'il veut revêtir à tout prix afin de se faire passer pour un dur. J'ai trouvé cette observation assez pertinente.
Une possibilité serait de se tourner vers le parquet, qui représente l'accusation et la poursuite dans la justice classique. Certes, il connaît moins le jeune en question, notamment en cas de récidive. Il aura moins de finesse dans l'analyse que le juge des enfants car il ne voit que des procédures.
Pour bien faire, il faudrait une entente entre le siège et le parquet. Le juge des enfants peut parfois être dans l'identification au jeune. Le parquet, lui, se place plutôt du point de vue de l'identification à la victime. Cela étant, il faut bien qu'il y ait un juge.
Que le juge des mineurs, au pénal ou dans le cadre de l'assistance éducative, soit plus proche du mineur n'est pas scandaleux.
J'espère, messieurs, que vous assisterez à une audience du tribunal pour enfants.
M. le président - Nous l'avons déjà fait.
M. Philippe Chaillou - Il se passe parfois des choses extraordinaires. Certaines victimes arrivent extrêmement vindicatives. Le rôle du président est de les laisser s'exprimer devant le gamin. Puis celui-ci va avoir la parole et va raconter son histoire. Alors, la majorité des victimes changent d'attitude et l'on assiste à un rapprochement des positions. Et le gamin lui-même fait du chemin.
La justice doit rechercher cette pacification sociale. Le jugement est un plus, mais l'objet de l'opération est bien d'arriver à ce que les gens puissent vivre ensemble.
La personnalisation peut également avoir lieu avec un policier. La première rencontre d'un gamin avec un agent de police peut être extrêmement forte. Si un jeune s'entretient « à chaud » avec un policier ferme mais bienveillant, bien dans son rôle de représentant de l'ordre, cela peut être très important.
A contrario s'il est face à quelqu'un qui se laisse prendre à cette prestance et qui ne prend pas les choses au deuxième degré, on peut arriver à une sorte d'escalade.
M. le président - C'est un peu le rôle de l'officier de prévention, qui agit ainsi dans les quartiers.
M. Philippe Chaillou - Certes, mais lorsque l'on est arrêté alors que l'on commet une bêtise, que l'on est placé en garde à vue, apparaît la culpabilité ; l'auteur de la faute a des comptes à rendre devant la société. Le jeune a devant lui, physiquement, quelqu'un qui lui demande des explications. Mais, en matière de prévention, il peut s'agir uniquement de bla-bla.
M. le président - En tant que maire de banlieue, j'observe que tout ce travail préventif avec la police est effectué. C'est la répétition des actes qui pose des problèmes.
M. Philippe Chaillou - J'aborderai maintenant la question des centres fermés ou semi-fermés. Il faut prendre garde. N'est-ce pas le désir secret d'écarter les jeunes délinquants pendant un laps de temps important qui sous-tend cette idée ? Que va-t-il se passer ? J'estime que la détention en prison est plus claire. Il ne faut pas transiger en matière de liberté. En France, existent des lieux de contention. Il s'agit de l'hôpital psychiatrique, où l'enfermement est ordonné sur décision de placement d'office. Il y a aussi la prison, y compris pour un mineur.
Les centres fermés à vocation éducative où seraient placés les mineurs pendant on ne sait combien de temps satisfont tout le monde. On ne va plus entendre parler de ces jeunes pendant un bon moment, mais, lorsqu'ils vont sortir, ce sera la pagaille. Ils vont être entre eux. La situation va être explosive. Pour moi, ce n'est pas la solution.
Je vous ai parlé d'endroits alternatifs qu'il faudrait développer en France. Il faut certes prévoir des garanties et des contrôles sur place : il n'est pas question que l'on y fasse n'importe quoi. Ces structures ne devraient accueillir que quelques gamins. Il ne faut pas se leurrer : on ne peut pas mettre ensemble quinze, vingt gamins extrêmement durs. Personne n'y tient. Les lieux de vie doivent regrouper trois, quatre, cinq jeunes, ayant des activités, encadrés par des adultes, bénéficiant éventuellement du soutien d'un psychologue.
M. François Zocchetto - Ma première question concerne l'éventuelle restriction du droit d'appel, que vous avez évoquée tout à l'heure, monsieur Chaillou. Si l'on s'engageait dans cette voie, il faudrait être certain qu'une telle mesure a une utilité. Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que les décisions rendues par un tribunal pour enfants qui sont frappées d'appel soient très nombreuses. Pouvez-vous nous donner une indication de leur pourcentage ? Quels sont également les délais ?
M. Philippe Chaillou - Il est exact qu'il ne s'agit pas d'un problème central de la justice des mineurs, même si tel est le cas en ce qui concerne la justice, prise dans sa généralité.
Je ne saurais pas vous dire le nombre de procédures pénales qui existent dans le ressort des tribunaux pour enfants. Chaque année, 200 à 250 arrêts pénaux sont rendus, y compris dans des affaires criminelles concernant des mineurs qui ont moins de seize ans au moment des faits.
Les délais sont longs ; l'appel intervient au moins un an après le jugement. C'est beaucoup trop.
Quant à l'assistance éducative, environ 500 décisions sont rendues par an. Quand on statue, par exemple, sur une ordonnance de placement provisoire prise par un juge des enfants au titre de l'enfance en danger, autrement dit, le retrait d'enfant, cette mesure étant valable six mois, on doit se prononcer avant. On accorde par conséquent une priorité au traitement de certaines affaires.
M. François Zocchetto - Lorsque l'on assiste à des procédures impliquant des mineurs, on a parfois l'impression que certaines personnes devraient être jugées non à leur place mais à leurs côtés, alors qu'elles sont absentes. Je pense en premier lieu aux parents. J'ai été frappé de constater que des mineurs qui comparaissent devant le juge des enfants ne comprennent pas la procédure, qui peut être trop solennelle. C'est parfois le cas en cabinet où va être employé le vouvoiement, où le jeune va peut-être être appelé « monsieur » pour la première fois de sa vie. Ce jeune a l'air absent, regarde derrière pour voir si ses parents ou une personne de connaissance ne sont pas présents. Selon vous, monsieur Chaillou, existe-t-il des possibilités d'associer une responsabilité pénale des parents dans ces procédures ?
On comprend bien l'absence de sanction pénale ou une responsabilité pénale atténuée pour les mineurs -souhait partagé par la majorité d'entre nous- mais on constate l'existence d'un vide, à savoir qu'à un moment, il n'y a plus de responsable. Comment pourrait-on organiser une responsabilisation pénale éventuelle des adultes qui ont la charge de ces enfants ?
Je me demande même parfois si l'on applique vraiment les textes relatifs à la corruption des mineurs, notamment dans des affaires de moeurs où l'on voit des mineurs totalement dépassés par les événements en raison de l'environnement dans lequel ils vivent. Parallèlement, les adultes qui vivent à leurs côtés ne font pas l'objet de poursuites.
M. Philippe Chaillou - En droit pénal, la responsabilité est individuelle : c'est celui qui a commis l'acte qui est responsable. Les parents ne seront jamais les auteurs moraux de l'infraction. Au sein de la mission à laquelle j'ai participé avait été mise en exergue cette responsabilité des parents. Je crois que les choses avancent.
Sur le plan strictement pénal, un texte prévoit des possibilités de poursuites contre des parents. Nous sommes dans un domaine d'interprétation stricte : il faut que les parents aient failli dans l'éducation. Ce sont des termes assez vagues. Le travail du juge consiste essentiellement à faire rentrer des faits dans une qualification pénale, mission peu facile.
Je suis assez d'accord avec cette idée d'insister sur cette place, cette responsabilité des parents. Mais il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur l'aspect pénal. Il convient aussi de mener des actions de soutien car certains parents sont totalement dépassés.
Monsieur le sénateur, vous avez évoqué les affaires sexuelles. L'une de mes collègues, qui, après avoir travaillé dans l'administration centrale, est revenue en juridiction, m'a dit être frappée par le fait qu'il y a un avant les cassettes pornographiques et un après. Les parents laissent traîner à la maison de telles cassettes, que les enfants visionnent. Il existe un réel problème.
On fait ceux qui sont surpris par le nombre d'agressions sexuelles, par les tournantes, etc. Il faut garder à l'esprit ce que peuvent voir des gamins à longueur de temps. J'ai traité des affaires dans lesquelles des mineurs ont mis en scène des actes de violence qu'ils ont vus. En matière sexuelle, j'estime que nous avons une responsabilité écrasante du fait de la publicité, des cassettes pornographiques. Des gamins de quatorze ans qui soumettent avec violence une jeune fille ou une femme à ce qu'ils appellent « la doublette » n'ont pas inventé cet acte. Ils l'ont vu dans des cassettes.
A l'audience, on essaie d'expliquer la situation aux jeunes coupables d'agressions sexuelles graves, mais ils ne comprennent pas ou font comme tel. Dans de telles affaires, ils sont donc condamnés à de fortes peines de prison. Il ressort ensuite de discussions avec les personnes qui les prennent en charge qu'ils n'ont toujours pas compris et qu'ils ont le plus grand mal à le faire. Dans quelle société vivons-nous pour que ces interdits assez fondamentaux ne puissent pas être entendus ?
M. le rapporteur - En ce qui concerne la PJJ, j'estime qu'il existe des difficultés de lisibilité dans son action et, par conséquent d'efficacité. Monsieur Chaillou, vous avez indiqué que la compatibilité est difficile entre un éducateur et un fonctionnaire. La solution ne consisterait-elle pas à prendre l'exemple de l'éducation où ont été mises en complémentarité les fonctions d'éducation et de bâtisseur ? Il conviendrait alors de faire appel à des partenariats avec les collectivités locales. La PJJ n'y gagnerait-elle pas ?
M. Philippe Chaillou - On pourrait effectivement faire de ces agents des sortes d'experts, de contrôleurs et de garants vis-à-vis de l'Etat de ce qui peut se faire à l'échelon local. Mais, si l'on agit ainsi, cela revient petit à petit à faire changer leur métier. Il faut bien qu'ils soient sur le terrain, sinon ils vont perdre leur savoir-faire et devenir des ronds-de-cuir.
Lorsque j'exerçais les fonctions de rapporteur général de la mission précitée, j'avais pensé essayer de créer une grande direction de la PJJ. Cette option n'a pas été retenue.
Récemment, je me suis orienté vers une autre direction. Il ne faut pas que la PJJ meure car personne d'autre ne peut exercer ses missions. Il faut l'améliorer.
En matière de délinquance des mineurs, il convient tout d'abord d'en déterminer les causes. Et nous devons mettre l'accent sur les quartiers. Il est tout de même presque question de guerre civile ! Pour moi, c'est le problème politique numéro un. Or il est assez absent du débat actuellement, et je trouve cela dramatique. Le politique est fait de gestes symboliques. Récemment, j'indiquais préférer la mise en oeuvre d'un ministère de la jeunesse à l'affectation de moyens à la PJJ.
Sur la question de la délinquance des mineurs, à un moment donné, une parole politique forte, qui rassemble, doit s'exprimer. On entend tout et n'importe quoi sur ce sujet, comme si la France n'avait pas de tradition en la matière. Or tel n'est pas le cas. Partons de l'acquis. Nous n'avons absolument pas à rougir de ce que nous avons élaboré patiemment.
Audition de M. Hubert BRIN,
président de l'Union nationale des
Associations familiales
(10 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle l'audition de M. Hubert Brin, président de l'Union nationale des associations familiales.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Brin.
M. Hubert Brin - Permettez-moi de me référer, en substance, à un texte que j'ai écrit voilà quelques mois et dont la philosophie n'a pas été remise en cause par le conseil d'administration qui s'est réuni samedi dernier.
Je rappelle que l'UNAF a vocation à défendre et à représenter toutes les familles, y compris celles qui connaissent des dysfonctionnements. Cela dit, si les familles avaient réellement démissionné, notre société aurait explosé depuis longtemps. Sans doute sommes-nous aujourd'hui dans une période incertaine dont il convient collectivement de prendre la mesure. Cependant, on se trompe lorsqu'on cherche des solutions immédiates à un phénomène durable et profond.
Le « sort d'exclusion » que notre société fait à toute une partie de sa jeunesse laisse à penser que nous n'avons pas besoin d'elle. Comment s'étonner dès lors que ces jeunes détruisent un monde auquel ils pensent ne pas avoir accès ?
D'un point de vue général, plutôt que le terme « démission » des familles, j'emploierai le mot « désarroi » face à une nécessaire et nouvelle affirmation des repères, des plages de liberté et des interdits comme principe de construction de l'enfant, du jeune, comme de toute société. Ce désarroi concerne d'ailleurs une population bien plus large que les seules familles en difficultés.
Nous avons vu se multiplier les arrêtés instaurant un couvre-feu pour les enfants et les jeunes. Aujourd'hui, comme hier, d'aucuns évoquent la suppression des allocations familiales aux familles dont les enfants sont délinquants ou leur placement sous le régime de la tutelle. Outre qu'une telle approche traduit une méconnaissance totale de la philosophie tant des allocations familiales que de la tutelle, je réaffirme qu'elle n'a ni valeur ni sens et qu'il ne s'agit que de solutions inadaptées à un problème réel.
Acceptons d'abord de reconnaître que, lorsque les conditions minimales d'existence ne sont pas assurées, la famille, parents et enfants réunis, ne peut que se mobiliser sur la satisfaction de besoins élémentaires au détriment de toute préoccupation éducative et parfois même de la légalité. La recrudescence très problématique des phénomènes d'incivilité trouve son fondement, pour une part importante, dans le malaise des parents dont la situation sociale est si fragilisée et si dégradée qu'elle hypothèque toute transmission des valeurs de notre société.
La violence urbaine et la délinquance juvénile ne trouveront donc pour partie de solutions durables qu'en prenant en compte le temps nécessaire à l'élaboration d'une politique de prévention sociale et familiale alliée à une tout aussi nécessaire politique de répression -la loi doit s'appliquer- qui ne peut se construire à partir de telle ou telle escalade médiatique.
Il faut cesser de croire que l'importance d'un problème justifie l'urgence dans laquelle des propositions sont avancées en réponse au désarroi de l'opinion publique. En refusant, comme certains le font, de soutenir les rôles structurants de la famille dans l'apprentissage des repères tout comme celui, tout aussi structurant, de la différence des sexes -il faut un équilibre entre les pôles masculins et féminins dans l'éducation des enfants- on brouille les repères eux-mêmes et plus personne n'y retrouve sa place, pas même les institutions.
Nous devons également, me semble-t-il, analyser sereinement mais très sérieusement l'incidence d'un monde qui fonctionne de plus en plus en temps réel sur les comportements des individus dans la gestion de leur pulsion de toute nature. Plus que jamais, il revient aux politiques publiques de donner un sens à la cohésion de notre société au lieu d'être guidées essentiellement par des choix techniques et financiers ou médiatiques.
Une politique familiale globale doit donc être réaffirmée et les parents doivent être aidés, encouragés et soutenus par un discours de vérité et d'exigence. Il me paraît dangereux de déconsidérer les familles pour atteindre l'objectif d'une « reparentalité » car l'exercice de la responsabilité ne peut se faire sans dignité ni liberté. La perception plus exacte des devoirs parentaux ne s'appréhende pas forcément efficacement par la contrainte.
L'idée, par exemple, de placer ces familles sous tutelle accréditerait la thèse selon laquelle celles qui seraient considérées comme démissionnaires devraient être démissionnées. A l'inverse, il serait à cet égard tout aussi dramatique de laisser entendre aux familles dont les prestations sociales sont sous tutelle qu'elles ressortissent inévitablement de phénomènes, comme l'exclusion et la délinquance.
Au regard de l'autre alternative qui est quelquefois proposée, à savoir la suspension ou la suppression des allocations familiales, je dirai que la politique de prestations familiales est aussi un élément constitutif du droit de l'enfant. Les allocations familiales, par exemple, sont un droit ouvert par l'enfant. Ainsi, la valeur philosophique de chacun se trouve symboliquement reconnue par la société quel que soit le statut ou le revenu de ses parents. Je ne peux donc accepter l'idée de suspension ou de suppression des allocations familiales.
Paradoxalement d'ailleurs, après avoir voulu supprimer ces allocations aux familles plus aisées, on en modifierait l'affectation aux plus pauvres ou à celles qui sont le plus en difficultés. Il s'agirait en quelque sorte, après la mise sous conditions de ressources, de la mise sous conditions de civisme. D'autres avaient déjà demandé la mise sous conditions de citoyenneté.
Un droit est un droit ; il ne saurait être érodé par de successives justifications d'opportunité même si celles-ci flattent l'opinion publique. On ne bâtit rien de solide sur l'irrationnel. L'espoir et la confiance en l'avenir peuvent renaître non par l'exercice d'une autorité résultant d'un rapport de force même imposé de l'extérieur mais par le dialogue et la négociation avec les parties considérées dans une égale dignité.
Je demeure encore perplexe face à toute solution visant à faire intervenir un travailleur social, -celui qui saurait -dans chaque famille en difficultés -celle qui par avance ne saurait pas. En revanche, j'estime qu'il convient de soutenir toute démarche qui mobiliserait les parents eux-mêmes, les jeunes et les enfants dans un exercice plus communautaire d'entraide, de solidarité et d'éducation car tout ne peut reposer sur l'école, le travail social, la police ou la justice ; il y a une complémentarité des rôles de chacun, institution et personne. Les mouvements associatifs, au premier rang desquels le mouvement familial, pourraient, à cet égard, être utilement mobilisés.
Enfin, au risque de me répéter, soyons prudents au regard d'une communication qui, en privilégiant l'instant, exacerberait les peurs et mettrait exclusivement en exergue des dysfonctionnements, certes réels, au détriment de la sérénité nécessaire et de la valorisation de toutes les réussites individuelles, familiales et collectives.
Puissions-nous construire l'avenir dans la perspective d'un partage lucide et fraternel des responsabilités et non sur la base de désignations successives de boucs émissaires impuissants à faire valoir leur innocence ou leurs difficultés et dont le visage est parfois si proche du nôtre !
Je me suis donc référé à un texte qui traduit bien la philosophie de l'institution familiale. Mais, dans le même temps, l'UNAF est démunie quant aux propositions à formuler sur un certain nombre de situations actuelles et comprend le désarroi des élus. Le conseil d'administration a travaillé pendant deux heures, samedi dernier, sur cette question et tous les administrateurs avaient relu depuis un mois au moins l'ordonnance de 1945. Il ne veut pas être pollué dans sa réflexion par le climat ambiant et souhaite prendre le temps nécessaire pour avancer des propositions constructives.
Nous avons donc décidé d'engager pendant deux ans une réflexion sur la responsabilité des parents ; comment réapprendre à dire « non » même aux tout-petits, à transmettre les règles du « mieux-vivre ensemble » ? A cet égard, permettez-moi de citer une anecdote.
Dans une école privée -je cite cet exemple non pour fustiger le privé mais pour bien montrer que ce problème concerne l'ensemble de la population- deux élèves de cours préparatoire se sont amusés, depuis la cour de récréation, à lancer des cailloux sur une Espace garée sur le trottoir d'à côté. Au bout de quelque temps, ils ont cassé une vitre. L'équipe pédagogique a décidé de leur infliger deux heures de colle un samedi matin.
Quelle a été la réaction des parents ? Les premiers ont jugé la punition normale car leur enfant avait commis une faute. Mais les seconds ont estimé que la sanction était disproportionnée par rapport à la faute. Pour eux, celle-ci n'était pas si grave ; il ne s'agissait que d'un jeu. Il n'y avait pas eu mort d'homme ! Vous voyez bien à quel point il est nécessaire, par rapport à un certain nombre d'actes d'incivilité, de repartir de très loin pour réapprendre aux parents quelles sont leurs responsabilités et que le « non » est un acte éducatif.
Par ailleurs, le conseil d'administration de l'UNAF est extrêmement sensible à l'idée d'une réflexion approfondie sur les mesures de réparation concernant non seulement les enfants mais aussi les familles. Il a également manifesté son intention de ne pas stigmatiser un espace géographique.
Enfin, il nous semble important de réfléchir de manière approfondie à la valorisation des « réussites paradoxales ». Pourquoi, dans tel ou tel quartier difficile, certaines familles, qui vivent parfois dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, parviennent-elles à éviter à leurs enfants d'entrer dans le cycle de la violence et de la délinquance et connaissent des réussites personnelles et professionnelles ?
Concernant la responsabilité des adultes, l'ensemble du conseil d'administration a souligné leur abandon. Partant de là, nous avons réfléchi -et je reprends à mon compte l'expression d'une administratrice de l'UNAF- à la « coveillance » du monde des adultes. Un autre administrateur s'est interrogé sur la possibilité de redonner une autorité aux voisins car si la responsabilité de la famille est en cause, il ne faut pas non plus oublier celle de l'entourage.
S'agissant de la responsabilité des jeunes, le conseil d'administration, tout en sachant que les difficultés sont souvent le fait de quelques-uns, a estimé qu'il fallait malgré tout analyser le rôle de ceux qui ne franchissent pas le pas mais qui n'y seraient pas foncièrement hostiles parce que le monde des adultes ne leur donne pas de repère. Par ailleurs, il a considéré qu'il était nécessaire de valoriser les actions menées par les jeunes.
Et puis est apparu un autre élément, à savoir la responsabilité des médias. Avec la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, toutes les fédérations de parents d'élèves, tous les syndicats d'enseignants, des associations de défense des droits de l'homme et des associations de travailleurs sociaux, nous avons créé le « Collectif interassociatif enfance, média et dignité humaine ».
Un certain nombre d'éducateurs nous ont informé de l'existence d'un lien assez direct entre le fait que 30 % des enfants écoutent, le matin, la radio pendant une demi-heure, voire trois-quarts d'heure, avant de se rendre au collège et le comportement de plus en plus sexiste des garçons au sein des établissements.
L'UNAF et les adhérents à ce collectif estiment qu'il est désormais nécessaire d'affirmer, sur un certain nombre de sujets, la coresponsabilité des médias. Je pense notamment à la manière dont ils ont rapporté les incendies de voitures à Strasbourg. Là encore, il faudrait analyser leur rôle.
S'agissant de l'ordonnance de 1945, le conseil d'administration de l'UNAF a estimé, à l'unanimité, qu'il s'agissait d'un bon texte. Il faut néanmoins prendre en compte les éléments psychologiques attachés à la datation de ce texte. Parler en permanence de l'ordonnance de 1945, alors que ce texte a été modifié à plusieurs reprises depuis, revient aussi à le décrédibiliser. Il est donc sans doute nécessaire de procéder à une relecture, voire à une réécriture de celui-ci mais sans en changer le fond.
Enfin, le conseil d'administration est aujourd'hui partagé sur les centres fermés. Nous nous efforcerons, d'ici à la fin de l'année, de prendre une position publique sur cette question.
En revanche, il s'inquiéterait de l'octroi aux familles d'un droit d'accès aux dossiers constitués sur elles. Certains membres du conseil d'administration estiment que le comportement et la pratique professionnelle des travailleurs sociaux seraient modifiés dès lors que les familles seraient en mesure de connaître tout ce qui est écrit sur elles dans le cadre d'un dossier précis.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - L'augmentation du nombre d'actes de délinquance et le jeune âge de ceux qui les commettent sont-ils liés à la démission des familles, à ce que vous appelez leur « désarroi » ?
M. Hubert Brin - Nous sommes dans une société qui, du point de vue familial, perd certains repères. Par ailleurs, le père, dans ces familles en difficultés, est très souvent déconsidéré à la suite de ce que certains administrateurs ont qualifié de « violence économique ».
Permettez-moi de citer l'exemple d'une famille qui habite dans un quartier que je connais bien. Le père touche le RMI, la mère n'exerce pas d'activité professionnelle, les deux grands sont dans des galères, seul le petit qui est âgé de huit ans va à l'école. Un soir, ce dernier dit à son père qu'il veut sortir. Celui-ci ne l'y autorise pas. Le gamin lui a alors répondu qu'il était le seul à travailler dans la maison et qu'il avait droit à ses loisirs.
Je sais bien ce que j'aurais fait à mon gosse s'il m'avait répondu ainsi ; cela n'aurait peut-être rien changé mais j'aurais été quelque peu soulagé. Mais, moi, je n'ai jamais touché le RMI et je ne me suis jamais senti dévalorisé dans mon rôle de père. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte, en ce domaine, la violence que subissent ces pères et la déconsidération dont ils font l'objet.
De même, nous le savons bien, même si certains me disent parfois que c'est politiquement incorrect, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte la situation des familles monoparentales. Je ne reviendrai pas sur le droit de la famille. Pour nous, autant le couple parental peut se séparer -c'est une décision d'adultes- autant il n'est jamais possible de divorcer de son enfant. Il est donc nécessaire de réaffirmer le rôle des deux parents quel que soit le devenir du couple parental.
Toutefois, dans les familles monoparentales, un seul parent est confronté à l'éducation quotidienne des enfants. Il est alors nécessaire de mener des actions autour de la responsabilité des parents et de rappeler la responsabilité de l'entourage.
Bien sûr, nous constatons non seulement une augmentation des actes de délinquance mais aussi une diminution de l'âge de ceux qui les commettent. Ce rajeunissement provient de l'évolution des situations familiales ainsi que de l'absence de repères clairement affichés. Et puis, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de l'organisation de l'économie parallèle qui conduit certains adultes ayant une connaissance même approximative des règles et des lois à se mettre en réserve et à faire gérer une partie de leurs trafics par des plus jeunes.
Je le répète, nous n'avons guère de propositions concrètes, autres que celles que nous avons déjà formulées par rapport aux allocations familiales ou à la tutelle. Toutefois, s'il est un point sur lequel l'institution évoluerait peut-être le plus, c'est la tutelle. Il faudrait mettre en oeuvre une nouvelle mesure qui soit éducative et contractuelle mais non privative de liberté. Or, la tutelle, dans sa forme actuelle, entre dans ce dernier cadre. Il n'est pas possible d'espérer une « reparentalité » en s'inscrivant dans une telle démarche.
Nous avons bien conscience d'être un peu « courts » une fois notre opposition exprimée à l'encontre de la suppression des allocations familiales même si, depuis deux ans, des réseaux d'écoute, d'accueil et de soutien à la parentalité ont été mis en place. Il s'agit d'ailleurs d'une démarche très intéressante et positive qu'il faut développer. La difficulté -elle ne vous surprendra pas- notée par nombre d'associations locales engagées dans ces réseaux est véritablement d'arriver à faire en sorte que les parents qui sont le plus en difficultés puissent venir s'exprimer.
Cette démarche ne s'inscrit pas dans le cadre d'une action sociale institutionnelle ; elle vise simplement à réapprendre aux parents le métier de parents, à dire « non », à gérer un projet avec leurs enfants, à choisir leur vie et non à la subir.
M. le président - Etes-vous favorable à un élargissement de la tutelle ?
M. Hubert Brin - Comme je l'ai souligné, c'est sans doute le point sur lequel l'institution évoluerait le plus aujourd'hui. Considérer que les familles démissionnaires doivent être démissionnées ne procède pas d'une bonne démarche. En revanche, il est clair que la tutelle adaptée à l'évolution des situations familiales peut être intéressante dans la mesure où il s'agit bien d'une démarche contractuelle, voire un peu coercitive, avec la famille. Mais il ne faut surtout pas la prendre dans le même sens que la tutelle aux prestations sociales « enfants », telle qu'elle existe aujourd'hui, qui relève avant tout de la gestion des allocations familiales.
Il s'agit d'une tout autre démarche qui n'est pas liée aux aspects financiers puisque nous refusons que les allocations familiales soient prises en otage. Il faut réfléchir à une évolution de la tutelle à partir non pas des prestations sociales mais de la responsabilité éducative de la famille.
M. le président - Il peut exister des cas où les allocations familiales sont prises en otage par ceux qui les utilisent à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées.
M. Hubert Brin - La tutelle aux prestations sociales « enfants », telle qu'elle existe aujourd'hui, est effectivement conçue pour des parents qui n'utilisent pas les prestations pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Si nous nous engageons dans une démarche éducative, nous nous inscrivons dans un autre cadre que celui de la seule utilisation des ressources financières.
M. le rapporteur - Je reviens sur vos propos concernant la responsabilité éducative. Lors du tour de France que nous venons d'engager, nous avons entendu dire que le premier signal d'alerte est très souvent donné par l'instituteur ou le professeur : c'est le décrochage scolaire.
Quelles mesures pourraient être prises en ce domaine ? D'une manière générale, les familles se sentent-elles suffisamment associées dans les actions mises en place par les pouvoirs publics, en l'occurrence par l'Education nationale ?
M. Hubert Brin - S'agissant de la relation entre les parents et l'école -je ne parle pas de parents d'élèves- il est clair que, pour une part importante des familles concernées par ces phénomènes, les parents ont eux-mêmes été en situation d'échec scolaire. La rencontre avec l'école est un renvoi permanent à leur échec personnel. Il est donc nécessaire de réfléchir à l'amélioration de la relation entre l'école et ces parents.
Le conseil d'administration de l'UNAF estime qu'il faut sortir de ce monde d'adultes qui en permanence, devant nos enfants, est en train de se critiquer sur la manière dont il conçoit son rôle par rapport à ceux-ci. L'école reproche aux parents de démissionner et de ne pas suivre leurs enfants ; les parents disent que l'école ne respecte pas leurs enfants et ne leur permet pas d'être les meilleurs ; le monde des adultes, dans son ensemble, reproche à l'école et aux parents de ne pas faire leur boulot. S'y ajoute la question des médias parce qu'elle n'est pas neutre dans cette affaire.
M. le rapporteur - Je partage tout à fait vos propos. Comme j'ai l'habitude de le dire, le corporatisme et les caméras cohabitent très bien dans notre pays. Ne faut-il pas contourner la difficulté en l'attaquant au plus près, c'est-à-dire au niveau de l'école ?
M. Hubert Brin - C'est évident.
M. Jacques Mahéas - Je suis très satisfait de vos propos. Vous êtes l'un des premiers à avoir analysé un certain nombre de causes de l'insécurité. Cette approche me paraît importante. En effet, en ce domaine, on examine souvent plus les conséquences que les causes. S'occuper de celles-ci est un travail à long terme. Je comprends donc qu'il vous faille du temps pour prendre une position.
Selon un sondage publié hier sur l'insécurité en Ile-de-France, 62 % des personnes interrogées estiment que les responsables sont les parents ; 30 % montrent du doigt la justice, 29 % les médias, 21 % les hommes politiques, 21 % la police et 18 % l'Education nationale. A la question : quels sont les acteurs de la réussite des jeunes ? les réponses auraient peut-être été les mêmes.
Il est indéniable qu'il existe de plus en plus de familles monoparentales. Mais nous avons aussi, dans nos quartiers difficiles, des familles pluri-culturelles qui introduisent des problèmes venus de l'extérieur, comme nous avons pu le constater lors d'événements nationaux. Avez-vous réfléchi à une coordination de tous ces aspects ? Comment peut-on faire en sorte que les parents n'aient plus peur de ces adolescents ?
Vous avez parlé de réparation. Les TIG vous paraissent-ils une bonne solution ?
Nos assistantes sociales doivent-elles changer leur fusil d'épaule et être plus des conseillères en économie sociale et familiale dans nos quartiers difficiles ?
M. Hubert Brin - Vous avez évoqué la « pluri-culturalité ». Il faut essayer d'analyser les « réussites paradoxales » même dans les familles d'origine étrangère.
M. Jacques Mahéas - Seriez-vous favorable au développement des internats ?
M. Hubert Brin - Nous y sommes plutôt favorables.
Les TIG s'inscrivent dans la réflexion que nous engageons sur la réparation. Mais nous réfléchissons plus à la mise en oeuvre de mesures de réparation familiale et non pas individuelle. Comment intégrer la famille, pas seulement le jeune, dans cette démarche ? Si ce dernier se trouve dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu déficience, pour telle ou telle raison, de l'éducation et de la responsabilité parentale.
Les assistantes sociales doivent-elles être des conseillères en économie sociale et familiale ? Il ne s'agit pas tout à fait du même métier. Par ailleurs, il faut mener un ensemble d'actions coordonnées. Vous avez les assistantes sociales, les conseillères en économie sociale et familiale mais aussi les travailleuses familiales. L'important, en ce domaine, est d'avoir une démarche de proximité.
Certes, la tâche des assistantes sociales et des conseillères en économie sociale et familiale est dure mais elle l'est encore plus pour les travailleuses familiales car elles interviennent pendant plusieurs heures au domicile des familles. Elles pénètrent dans leur intimité. L'assistante sociale, quant à elle, reçoit dans son bureau ou se rend au domicile des familles pendant une heure pour discuter avec elles. Il serait très intéressant d'entendre les travailleuses familiales sur ces situations-là.
Mme Michèle André - Je me réjouis que vous ayez décidé de consacrer deux ans à votre réflexion. Il est en effet important que vous vous donniez du temps pour traiter d'un sujet qui n'est pas central pour l'UNAF mais que vous avez à connaître par tel ou tel aspect.
Nous avons encore beaucoup à faire dans le domaine de la parentalité. On croit qu'être parent est quelque chose de naturel. Ce n'est pas tout à fait un métier. A un moment de sa vie, on se retrouve parent sans y être toujours préparé en termes de responsabilité et d'aptitude éducative. Ce n'est d'ailleurs pas le seul rôle des parents.
Il faut que les pouvoirs publics soient très attentifs. Ils doivent non pas se contenter d'expérimentations mais mener des actions plus massives avec des institutions qui jouent et veulent jouer leur rôle pas seulement dans des activités de loisirs mais dans des domaines plus essentiels.
Il me paraîtrait dommage de lier en permanence la délinquance des mineurs aux seules familles en difficultés matérielles. Si l'on effectuait, par exemple, une analyse rapide de la violence en général, on s'apercevrait que la délinquance routière, qui est aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité dans notre société, est un mauvais exemple au sens réel du terme.
Un père qui conduit mal, surtout quand il a une puissante voiture et que son gosse est assis sur la banquette arrière, n'est pas un bon exemple. Ce ne sont pas les pauvres familles monoparentales qui n'ont pas de voiture qui donnent ce mauvais exemple. Voilà quelques années, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai mené une campagne contre les violences conjugales. Nous avions beaucoup de mal à faire admettre que les femmes victimes de violence n'étaient pas seulement celles qui vivaient dans des milieux sociaux défavorisés. Elles étaient issues de tous les milieux.
Si l'alcool est parfois à l'origine de la violence notamment envers les enfants, il serait trop simple de montrer du doigt ceux qui n'ont pas de grosses situations. Il faut déconnecter ces deux aspects. Réapprendre aux parents à dire « non », c'est leur faire prendre conscience des responsabilités qu'ils doivent toujours assumer à l'égard de leurs enfants.
J'ai apprécié votre volonté de ne pas tomber dans la facilité avec certains slogans simples. S'ils marchaient, nous le saurions et nous les aurions déjà utilisés.
M. Hubert Brin - Je veux de nouveau insister sur la question de l'exemplarité. Il n'est pas concevable que nos enfants puissent intégrer les règles du « mieux-vivre » alors qu'ils sont en permanence confrontés à des adultes qui transgressent ces règles. Il s'agit d'un réel problème.
Je suis sensible à votre discours sur les familles monoparentales car c'est un discours de raison. Il ne faut pas stigmatiser ces familles comme on le fait pour un espace géographique ou un quartier. Néanmoins, il n'est pas possible de ne pas prendre en compte une certaine réalité sociale et sociologique qui conduit des familles monoparentales à être confrontées à ces difficultés. Soyons donc très prudents car nous risquons de décourager, par de tels discours, tous ceux qui, bien qu'ils soient quelquefois dans des situations matérielles très difficiles, prennent leurs responsabilités.
Je citerai un exemple qui peut vous paraître en dehors du sujet mais qui vous montrera notre sensibilité en ce domaine. Il arrive, ici ou là, qu'on fustige l'allocation de rentrée scolaire parce que certains parents en profitent pour acheter un poste de télévision ou un magnétoscope. Soyons, là encore, très prudents. Comment expliquer à une famille qui a peu de moyens, qui gère toute l'année au plus près son budget, qui renouvelle régulièrement les baskets et les jeans de ses enfants qu'elle n'est pas « dans les clous » si elle achète, grâce à cette allocation, un magnétoscope ?
Il ne faut donc pas tout stigmatiser. Mais nous ne devons pas non plus nous voiler la face. Pour reprendre mon exemple, il est vrai aussi que l'allocation de rentrée scolaire qui serait bien utile dans certaines familles pour renouveler la garde-robe des enfants est utilisée à d'autres fins. Soyons conscients des réalités.
Mme Nicole Borvo - Je vous remercie de votre exposé qui est équilibré. Il est bon que vous réfléchissiez à ces problèmes même s'ils n'entrent pas dans vos attributions les plus immédiates. Permettez-moi de dire, entre parenthèses, que je suis toujours scandalisée d'entendre ceux qui ne manquent de rien donner des leçons sur l'utilisation de l'argent à ceux qui manquent de tout.
Vous avez insisté sur les réseaux d'aide à la parentalité. Si je comprends bien, vous êtes favorable à la mise en commun des moyens des adultes à l'égard des jeunes. Jusqu'à présent, nous sommes dans le domaine du facultatif. L'Ecole des parents, que je connais bien, procède d'une démarche intéressante. Réfléchissez-vous, par exemple, à la création de réseaux auxquels pourraient participer les associations familiales ?
Comment créer ces associations là où elles n'existent pas ? Comment les transformer en partenaires obligés d'un certain nombre de structures, ce qui matérialiserait l'idée, que beaucoup peuvent partager, d'une coresponsabilité de nombreux acteurs dans la société ? Il faut une coordination des réponses à ce niveau. Il ne peut pas y avoir de réponse unique ni de réponse répressive. Il faut parvenir à créer cette synergie entre les différents partenaires.
Vous refusez la stigmatisation des familles monoparentales ou des quartiers. Je partage tout à fait ce souci. Il y a une réalité qu'on retrouve encore davantage dans ces familles, qui se caractérisent par l'absence du père. Nous savons que les enseignants du primaire et des collèges, tout comme les travailleurs sociaux, sont très souvent des femmes. Or, la violence est quand même très masculine. Ne faudrait-il pas inciter davantage les hommes à travailler sur le terrain associatif ou professionnel avec les jeunes, en particulier les adolescents ?
M. Hubert Brin - Cette observation, nous l'avons faite également. Dans le cadre d'une famille monoparentale où, pour diverses raisons, les relations avec le père se sont distendues, il est clair que les enfants, pendant une dizaine d'années, ne vont avoir comme pôle de référence adulte qu'un seul sexe. Comme le monde des adultes s'est, je le répète, retiré de la « coveillance », de la coresponsabilité, certains enfants se trouvent donc dans cette situation. Toutefois, depuis quatre ou cinq ans, la situation a évolué.
Pendant des années et des années, on nous a dit, y compris s'agissant de familles de culture différente, que la porte de sortie passait par le biais des femmes. Bien loin de moi l'idée de m'y opposer. Dans le même temps, je constatais en permanence dans les quartiers - c'est une réalité que j'ai vécue personnellement pendant vingt-cinq ans - l'absence du père dans l'éducation des enfants.
Nous devons donc effectivement nous pencher sur le rôle que doivent jouer le père et la mère, lesquels ne peuvent pas avoir des rôles indifférenciés. Si j'ai abordé dans mon propos liminaire la différenciation des sexes, c'est parce que je crois vraiment que nous devons également examiner ces points.
Audition de Mme Claire BRISSET,
défenseure des
enfants,
accompagnée de M. Alain VOGELWEITH,
magistrat
(10
avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, qui est accompagnée de M. Alain Vogelweith, magistrat.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Madame Brisset.
Mme Claire Brisset - Vous avez souhaité m'entendre sur le thème délicat de la délinquance des mineurs, je vous en remercie. Je suis venue accompagnée de M. Alain Vogelweith, ancien juge des enfants, qui était à Créteil, et qui a été mis à ma disposition par la Chancellerie. Il dirige le pôle juridique de notre institution.
Une institution comme celle que j'ai l'honneur de diriger, qui a été créée par le législateur, ne peut à l'évidence pas se désintéresser de la délinquance des mineurs.
Je voudrais, en introduction, replacer mon propos dans une réflexion que je mène depuis deux ans, date de ma nomination, et qui porte sur l'adolescence et la post-adolescence dans notre pays. Ce sont, selon moi, les grandes oubliées de la politique de l'enfance dans notre pays.
Notre société n'a pas su se doter - mais il n'est pas trop tard - d'une réelle politique pluridisciplinaire de l'adolescence. En amont de la délinquance, il y a bien souvent la souffrance, des appels, des conduites à risques, des conduites auto-agressives qui sont autant de signes d'alerte que nous aurions dû, nous adultes, saisir lorsqu'il en était encore temps.
Je diviserai mon propos en trois parties d'inégale importance.
En premier lieu, je citerai quelques chiffres, que vous connaissez peut-être déjà, et je vous prie alors de m'en excuser, mais ils me paraissent essentiels. En deuxième lieu, je procèderai à un rapide état des lieux de notre dispositif. Je formulerai, enfin, quelques propositions.
Les chiffres de la délinquance des mineurs sont longtemps restés assez stables, notamment entre le milieu des années 1980 et celui des années 1990. Depuis huit ans environ, nous assistons à un véritable décrochage. En 1994, 110 000 mineurs ont, en effet, été mis en cause dans des procédures de police alors que 172 000 l'ont été en l'an 2000, soit une augmentation d'un tiers environ. Cette augmentation est très forte et très rapide.
La nature des infractions n'a, pour sa part, pratiquement pas changé. Depuis 1995, les trois quarts des infractions commises par des adolescents et des post-adolescents, des mineurs, sont -c'est une constante- des atteintes aux biens, un quart d'entre elles sont des atteintes aux personnes.
Ces chiffres ne témoignent pas d'un rajeunissement significatif des délinquants qui commettent des actes graves tels que les meurtres ou les viols par exemple. En revanche, ce rajeunissement existe quant aux incivilités.
Nous avons très récemment enregistré une augmentation saisissante du nombre des incarcérations de mineurs. En un an, le nombre des incarcérations a augmenté de 44%. Je vous cite deux cas que j'ai retenus dans la région parisienne.
A Fleury-Mérogis, le 1 er janvier 2001, quarante-huit mineurs se trouvaient dans le quartier des jeunes détenus alors qu'en mars 2002 ils étaient cent dix-neuf, pour une capacité de soixante-cinq places.
A Villepinte, seize mineurs connaissaient cette situation contre trente et un aujourd'hui, pour une capacité de vingt places. Ces chiffres mettent à mal, comme vous pouvez le constater, la règle de l'« encellulement » individuel, qu'il est bien évidemment impossible d'appliquer.
Comme vous devez certainement le savoir, 80% des mineurs en moyenne sont incarcérés en détention provisoire et non pas à l'issue d'une condamnation.
Face à cette évolution, nous avons à notre disposition l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui, comme vous le savez, accorde la primauté à l'éducatif par rapport au répressif. A cet égard, je voudrais mettre en exergue trois éléments.
Premièrement, cette ordonnance permet de réprimer, même en première intention, un acte extrêmement grave, tel qu'un meurtre par exemple, sans que l'on ait tenté une démarche éducative.
Deuxièmement, elle permet -et les faits nous le montrent fréquemment- le défèrement immédiat, même en l'absence d'un jugement, d'où l'importance de la détention provisoire.
Troisièmement, elle autorise la comparution à délai rapproché. Le procureur peut demander au juge des enfants de juger le mineur dans un délai de un à trois mois.
Notre dispositif comprend également des structures de prévention - c'est un point sur lequel j'insisterai. La prévention peut prendre de nombreuses formes.
J'aborderai tout d'abord la prévention non spécialisée, un sujet qui me semble particulièrement important.
En amont de la délinquance, de nombreuses procédures de prévention sont à notre disposition : le repérage des familles en difficulté par les services sociaux des départements, le rôle de l'école par exemple. Je voudrais insister sur le rôle que joue l'école.
Dans la société dans laquelle nous vivons, ce rôle est devenu incertain. L'école est-elle simplement le lieu de la transmission du savoir ou est-elle aussi le lieu de l'éducation ? Cette mission de l'école, que j'estime pour ma part complémentaire, n'est pas claire à l'échelon national tant pour ceux qui dirigent l'école que pour les enseignants. Elle n'est plus, me semble-t-il, clairement définie au sein de notre société. Ce point est très important pour le sujet qui nous préoccupe.
Je prendrai un exemple de ce malaise. Les classes-relais, des structures mixtes où sont associées la Protection de la jeunesse judiciaire et l'Education nationale, qui s'adressent à des enfants en très grandes difficultés, en situation d'échec, sont peu nombreuses. Les financements ne sont probablement pas assez conséquents. En outre, les enfants éprouvent des difficultés lorsqu'ils veulent reprendre le cours normal de l'école classique, lorsque la classe-relais estime qu'elle a rempli sa mission. La transition entre les classes-relais et l'école classique n'est pas facile.
J'en viens maintenant aux psychologues scolaires : dans le primaire, on en compte un pour 1 800 enfants. On peut aisément imaginer la difficulté pour ce psychologue de veiller à la santé mentale de tous ces enfants. On peut dresser le même constat pour la médecine scolaire, pour les infirmières scolaires. Je le répète, l'école est-elle le lieu de la prise en charge de l'enfant dans sa globalité ou est-ce simplement le lieu de la transmission du savoir ? Cette question mériterait d'être analysée.
Toujours en amont de la délinquance, abordons la psychiatrie, secteur que j'analyse abondamment dans le rapport que je vous ai remis.
Certains enfants donnent très tôt des signes d'alerte, quelquefois même dès le primaire. Faute d'être correctement analysés, car la pédopsychiatrie connaît dans notre pays une situation de grand dénuement, ces signes ne sont parfois ni repérés ni traités. Un certain nombre d'enfants échouent dans la délinquance pour des raisons qui tiennent à la maladie mentale.
A Fleury-Mérogis, lorsque j'ai visité le centre des jeunes détenus, le psychiatre m'a dit que certains mineurs étaient incarcérés uniquement parce qu'ils avaient commis une infraction sous l'empire d'un état psychiatrique. La prison est alors pour eux le premier lieu où ils découvrent la psychiatrie.
En France, dix-sept départements n'ont aucun lit en pédopsychiatrie. Or, nous le savons bien, l'hospitalisation en pédopsychiatrie est quelquefois nécessaire pour les enfants, même si elle est d'une durée assez brève.
J'aborderai maintenant la prévention spécialisée.
Elle est généralement assurée par des associations qui sont financées par les conseils généraux. Cette prévention est informelle, elle est assurée sans mandat particulier ni de la justice ni de l'administration. Toutefois, elle a démontré son utilité ; je pense par exemple aux éducateurs de rue. Mais ces derniers connaissent de très grandes difficultés. Faute de financements adaptés, leur mission s'en ressent profondément.
Par ailleurs, les conseils de prévention de la délinquance relèvent, comme vous le savez, de la politique de la ville. Ils ont été en quelque sorte « éclipsés » par les contrats locaux de sécurité, des structures plus formelles, qui ont absorbé les financements. Or, ces conseils de prévention de la délinquance présentaient pourtant, selon moi, une grande utilité.
Que prévoit notre dispositif lorsque des actes délictueux ont été commis ?
En amont de la prison, nous pouvons répertorier toutes les activités de la Protection judiciaire de la jeunesse. Elles évoluent dans les structures d'hébergement, que nous avons multipliées au cours de ces dernières années : les centres de placement immédiat, les CPI, les centres éducatifs renforcés, les CER, les lieux de vie, les foyers d'hébergement par exemple.
Ces structures existent certes, mais la PJJ traverse, vous le savez, une crise profonde en dépit des recrutements qui ont été décidés en 1998. En effet, la formation est quelquefois peu adaptée. Ainsi, nous avons observé que, souvent, les éducateurs les moins expérimentés, les plus jeunes -c'est une situation que l'on retrouve au sein de l'Education nationale- sont priés de s'occuper des jeunes les plus difficiles, ceux qui sont les plus « enkystés » dans des situations de délinquance. Il y a là un véritable dysfonctionnement.
Par ailleurs, peut-être à cause de cette crise chronique qui affecte la PJJ, nombre de jeunes éducateurs s'éloignent de ces missions qui les effraient et les inquiètent parce qu'ils ne veulent pas affronter les jeunes les plus difficiles. Ils se tournent donc de préférence vers les structures externes de la PJJ, celles qui se situent en dehors de l'hébergement, c'est-à-dire vers les mesures de liberté surveillée. Toutefois, ces structures externes se ressentent tout autant de la crise de la PJJ. Tant que notre société ne se sera pas donnée les moyens d'affronter cette crise, nous continuerons à avoir des adolescents délinquants qui seront mal pris en charge.
J'en arrive à la prison.
Pour rédiger mon rapport, je l'ai beaucoup fréquentée. J'ai visité de nombreux quartiers de mineurs dans toute la France. Je vous résume brièvement les observations que j'ai consignées dans mon rapport.
Dans les quartiers de mineurs, les condamnés et les prévenus sont ensemble, contrairement à la règle habituelle. Cela ne va pas sans poser de problèmes. Nous constatons un surpeuplement des quartiers des mineurs qui rend absolument impossible, je le répète, le respect de la règle de « l'encellulement » individuel. Je sais que cet encellulement individuel peut être source d'une certaine angoisse, mais c'est rare. Je sais surtout que sa réalisation pose de grands problèmes. J'ai observé par exemple à la prison Saint-Paul de Lyon un surpeuplement absolument inadmissible dans notre démocratie, des conditions physiques d'accueil telles qu'elles rendent la violence, qui est déjà souvent intériorisée dans les murs de la prison, presque perceptible dans l'atmosphère.
J'ai pu également constater l'insuffisance de la psychiatrie à l'intérieur de la prison. Comme de nombreuses personnes incarcérées me l'ont confié, je souhaite également que chaque jeune détenu puisse bénéficier au moins d'un bilan psychiatrique et, lorsque c'est nécessaire, avoir un suivi. Or, nous en sommes très loin. Les psychiatres font défaut en prison. Il en est de même des psychologues. J'ai été choquée, je dois le dire, de constater que certains d'entre eux se contentaient d'attendre la demande du détenu. La demande qu'exprime un adolescent à l'égard d'un soutien psychique est déjà rare en milieu normal, elle est donc rarissime en milieu carcéral. Par conséquent, comme l'a souligné le psychiatre de Fleury-Mérogis, il faut aller au devant de cette demande, il faut la susciter, et c'est le travail du psychiatre. Toutefois, comme ils sont en quantité infinitésimale, ils ne peuvent malheureusement pas le faire. Notre société, j'y insiste, manque donc à ses responsabilités à l'égard de ces jeunes incarcérés.
Je voudrais maintenant vous parler de la préparation de la sortie de prison.
Lorsqu'un jeune est averti trois heures auparavant de sa sortie, lorsque sa famille n'en a pas été informée ou qu'il a fallu trouver avec beaucoup de difficultés le père ou la mère, on rend un mineur à une famille qui n'est pas prête à le recevoir. La sortie doit se préparer, et j'y reviendrai dans les solutions que je vous propose. Cela fait appel à toute une conception d'ensemble de la délinquance des mineurs que j'appelle de mes voeux.
Il faut un projet avant la prison lorsque cela est possible ; il en faut un pendant et après la prison.
J'arrive donc, monsieur le président, aux ébauches de solution que je propose.
Nous devons, me semble-t-il, redéfinir la politique de prévention, qu'il s'agisse de la prévention non spécialisée ou de la prévention spécialisée. Nous devons leur consacrer davantage de moyens : des moyens financiers certes, mais aussi des moyens en réflexion, en conception d'ensemble de la délinquance des mineurs et de ses origines. Je pense à la prévention à l'école - on pourrait même commencer dès l'école maternelle. Il faut donc repérer les enfants en difficulté.
Le nombre des classes-relais doit être relevé de manière significative. Surtout -et c'est là le point le plus ambitieux-, nous devons redéfinir les missions de l'école et revoir les moyens dont elle dispose. Il n'est pas question de laisser l'école seule face à la problématique de la délinquance. Mais il faut mettre l'école au coeur du dispositif pour repérer ce qui peut engendrer la délinquance plus tard. On gagnerait beaucoup à redéfinir ses missions dans la prise en charge des adolescents et des pré-adolescents.
Selon moi, l'école n'a pas pour seule mission de transmettre les savoirs, et je voudrais être entendue par vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et plus largement par la société. L'école de la République a une mission beaucoup plus large qui doit être réaffirmée. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec moi sur ce point, mais je suis prête à en débattre tout à l'heure.
Par ailleurs, nous devons reconsidérer la pédopsychiatrie dans son ensemble, pas seulement pour prévenir la délinquance, mais pour tous les enfants. Je parle des enfants parce que je suis défenseure des enfants mais, dans ma bouche, le mot « enfant » concerne les jeunes jusqu'à dix-huit ans.
En effet, certains enfants passent d'une conduite auto-agressive à une conduite agressive à l'égard des autres sans qu'il y ait quelquefois une grande transition. La conduite auto-agressive remplace parfois une conduite, ou se substitue à une autre qui, six mois ou un an plus tard, pourra se transformer en une conduite agressive à l'égard d'autrui. Nous savons bien que le passage de l'état de victime à l'état d'agresseur existe. Les deux ont besoin de la pédopsychiatrie. Nous ne pouvons pas laisser une discipline entière de la médecine dans l'état de dénuement - je dirais même de délabrement - dans lequel nous l'avons laissé s'installer. Ce n'est pas acceptable dans notre pays. Nous devons donc repenser la pédopsychiatrie dans son ensemble.
Nous devons aussi repenser et redynamiser la prévention spécialisée. C'est une matière essentielle dans la politique de la ville, mais pas seulement.
Les clubs de prévention de la délinquance doivent être réinvestis par la puissance publique, à l'échelon local, régional, départemental ou national. Une nouvelle politique de la prévention spécialisée doit être mise en place.
Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité absolue de revoir la politique préventive. La prévention doit être le maître mot si l'on veut mener une véritable politique de prise en charge de la délinquance dans notre pays.
J'aborderai maintenant un autre point : nous devons, me semble-t-il, redéfinir l'éducatif par rapport à la prison.
Lorsqu'un acte de délinquance a été commis, il conviendrait que les juges des enfants puissent définir une mesure d'ensemble qui s'inscrive dans la durée. Il ne me semble pas possible de remettre un adolescent ou un post-adolescent sur les rails par une mesure purement ponctuelle. Cet enfant a besoin, à un certain moment, d'une structure qui le maintienne dans sa famille, à laquelle nous devons simultanément apporter notre soutien. A d'autres moments, ce jeune peut avoir besoin de la prison, même ponctuellement. Toute une panoplie de solutions peuvent être envisagées et le juge des enfants doit pouvoir, en confiant cet adolescent à un service référent, un service de la PJJ, garder la maîtrise de la situation sur une durée relative. Ne choisissons pas des mesures ponctuelles.
Après un ou deux mois de prison, rendre cet adolescent à sa famille qui devra ensuite gérer la situation, c'est aller droit à l'échec. Comme je le dis en d'autres enceintes, s'agissant des adolescents qui ont commis des tentatives de suicide, mais cela vaut aussi pour les adolescents en grande difficulté ayant séjourné en prison, si nous voulons éviter la récidive, nous devons soutenir cet adolescent ainsi que sa famille.
Il nous faut donc mettre en place une politique d'ensemble qui constitue un véritable projet pour le mineur en coordination avec sa famille, avec l'école, tout en prévoyant, si le besoin s'en fait sentir, des aller-retour en prison sous le contrôle de la Protection judiciaire de la jeunesse.
Par ailleurs, nous devons multiplier les alternatives à la prison. Il est prévu d'augmenter les capacités des centres de placement immédiat : elles devraient passer de trente à cinquante entre 2001 et 2002 ; de même le nombre des CER devrait passer de trente-sept en 2001 à cent en 2002. Je ne sais pas si cet objectif sera respecté mais, quoi qu'il en soit, il est insuffisant. Les structures alternatives à l'incarcération doivent bien entendu être multipliées, mais nous devons aussi multiplier les formules de réparation directe et indirecte, dont Alain Vogelweith est un spécialiste. Il pourra, si vous le désirez, vous en parler tout à l'heure car, en tant que juge des enfants, il a pu le vivre directement auprès d'eux.
Dans le cas où la prison s'avère nécessaire, il faut redéfinir son rôle. Nous devons multiplier les formules de semi-liberté. Contrairement à d'autres pays, elles existent en France à titre absolument homéopathique : développons la prison de jour, la prison de week-end. Ces formules peuvent se concevoir et elles ont fait les preuves de leur efficacité. Multiplions les formules de liberté conditionnelle. Développons les travaux d'intérêt général, les TIG, c'est-à-dire aménageons les peines lorsqu'elles sont inférieures à un an et lorsque, bien entendu, l'adolescent est âgé de plus de seize ans.
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous devons revoir le suivi avec la famille, pendant et après le temps de l'incarcération.
Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la prison n'est pas nécessaire au dispositif. En vérité, il me semble qu'elle l'est, mais elle doit être réinsérée et réintégrée dans un projet de vie pour l'adolescent ou le post-adolescent qui est incarcéré. Le temps de la prison ne doit pas être un temps mort ; il doit être non pas, ce qu'il est trop souvent, l'apprentissage de la violence, mais un temps utile.
M. le rapporteur - Vous avez déjà répondu, madame Brisset, à certaines questions que je voulais vous poser, s'agissant notamment des ébauches de solution que vous proposez.
Vous avez souligné le fait que la nature des infractions n'avait pas beaucoup évolué, que leur nombre avait augmenté mais que l'on constatait un rajeunissement des délinquants qui commettent des infractions.
Mme Claire Brisset - Ce sont les chiffres de la Chancellerie !
M. le rapporteur - Ces dernières sont certes mineures, mais elles sont souvent un premier pas vers la délinquance. Avez-vous une explication à ce phénomène de rajeunissement du premier acte commis par les délinquants ?
Mme Claire Brisset - Il serait quelque peu présomptueux de ma part d'avoir une explication. Je vous livrerai cependant quelques hypothèses.
Nous vivons dans une société qui, comme le dit le docteur Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre que vous connaissez peut-être, n'ose plus énoncer l'interdit. Nous devons dire aux enfants dès leur petite enfance que certaines choses sont interdites. Dans la famille ou à l'école, ils ont face à eux des adultes qui n'osent pas énoncer l'interdit. Tous les pédopsychiatres savent ce que signifie « non » pour un enfant. Or, la gradation de l'énonciation de l'interdit fait défaut dans toutes les structures de notre société.
Cette réflexion ne vaut évidemment pas pour les actes graves. Les enfants ont intériorisé l'idée selon laquelle ils n'ont pas le droit de tuer, de voler le sac de quelqu'un par exemple. En commettant ces délits extrêmes, ils savent qu'ils sont dans l'interdit. Tuer quelqu'un fait partie des interdits élémentaires de l'humanité. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais je dis simplement qu'ils savent qu'ils transgressent la loi. Pour autant, ils commettent certains délits sans avoir conscience de transgresser la loi. Cette hypothèse peut répondre en partie à la question que vous m'avez posée, monsieur le rapporteur.
M. le président - Certaines personnes que nous avons auditionnées nous ont confié que, s'agissant même des délits les plus graves, certains délinquants -c'est exceptionnel fort heureusement- n'ont pas le sentiment d'être dans la réalité, et n'ont pas conscience que la réalité est différente des fictions qu'ils ont pu connaître.
Mme Claire Brisset - Absolument ! Je laisse M. Vogelweith vous apporter des éléments de réponse à cette remarque.
M. Alain Vogelweith - Tout cela dépend bien évidemment de la nature des faits. Il est un domaine dans lequel les délinquants perçoivent difficilement la réalité - on en parle beaucoup dans la presse -, c'est celui des tournantes, des viols qui peuvent poser des problèmes de représentation. Ce n'est que lors du procès qu'ils prennent conscience de la gravité du délit qu'ils ont commis. Cette prise de conscience n'était pas du tout évidente au moment de l'acte.
On doit distinguer les incivilités, les petits actes qui participent de la création d'un sentiment d'insécurité et qui ne sont pas perçus comme des actes de transgression, des actes plus graves. Les mineurs que nous rencontrons dans les cabinets des juges des enfants savent bien qu'ils transgressent la loi lorsqu'ils commettent des vols avec violence. Nous devons donc nous demander qui pose les limites, quels sont les interdits et comment ils peuvent être suffisamment intériorisés pour éviter que l'on ne se retrouve face à des mineurs qui commettent certains actes dont ils ne perçoivent même pas que ce sont des actes de transgression.
M. le rapporteur - J'aimerais revenir sur la prévention et sur le rôle que peut jouer la famille. Nous n'allons pas ouvrir le débat sur la mission de l'école. Mais doit-elle transmettre le savoir ou faire plus ?
Pour ma part, je pense qu'elle doit transmettre le savoir-être et ce terme inclut le comportement. Le manque de moyens est réel, et le manque de pédopsychiatres évident. Cette situation est-elle uniquement due au manque de moyens ou n'est-ce pas aussi la conséquence d'une mauvaise coordination entre les différents acteurs ?
Nous avons vu, notamment à Lyon, que, entre le premier signal d'alerte déjà relativement grave donné par l'instituteur, et la décision, deux ans se sont écoulés. Ce sont deux années pendant lesquelles il est bien évident que le mineur n'est pas rentré dans le droit chemin ; sa situation s'est encore aggravée. N'est-ce pas l'absence d'une sorte de pilote, de fil rouge, permettant d'améliorer considérablement le délai d'exécution, qui constitue aujourd'hui un frein réel ?
Mme Claire Brisset - J'abonde dans votre sens. En effet, nous constatons une sorte de « balkanisation » des services. La décentralisation a peut-être quelque peu facilité, si je puis dire, la vie des délinquants, mais elle n'a pas toujours facilité la vie de ceux qui tentent de lutter contre la délinquance. C'est un effet induit. Ne pourrait-on pas envisager par exemple des schémas d'organisation tels que ceux qui ont été mis en place par la politique de l'enfance? Nous devons, c'est certain, créer des liens entre les services de l'Etat et les services départementaux.
Je voudrais revenir sur un autre point très important que vous avez soulevé, à savoir l'inexécution des peines dans certains cas.
L'inexécution des peines incite l'adolescent à penser que le délit qu'il a commis n'est pas très grave puisqu'il n'exécute pas la peine pour laquelle il a été condamné. J'aimerais beaucoup que vous entendiez le point de vue d'un juge des enfants à cet égard. En fait, ce sont les moyens qui font défaut.
M. Alain Vogelweith - Certes, il est difficile de faire exécuter les peines. Mais, bien avant les peines, ce sont les mesures éducatives qui ne sont pas exécutées.
En effet, j'ai connu des cas où les mesures éducatives qui avaient été prononcées contre des mineurs en situation de décrochage n'avaient pas été exécutées. Vous avez sans doute entendu parler des listes d'attente qui existent dans les services éducatifs.
En fait, il est très pénible pour un juge des enfants, après avoir repéré une situation qui pose problème et mis en place une mesure éducative, de constater que celle-ci n'est pas exécutée et de retrouver le mineur, pour des faits identiques ou parfois plus graves, dans une situation où l'intervention éducative sera plus difficile encore. En effet, le mineur et sa famille auront attendu en vain l'intervention de l'éducateur et n'y croiront plus ; pis encore, sa situation aura pu se dégrader pendant cette période d'inaction des services éducatifs. Nous ne pourrons alors plus lui apporter qu'une réponse ponctuelle qui tiendra plus compte du délit commis que de son parcours, qui aurait pu être infléchi. L'inexécution des mesures éducatives nous pose donc de réelles difficultés.
Mais nous rencontrons d'autres difficultés dans la mesure où une partie importante des condamnations prononcées ne sont pas exécutées. Des mesures aussi intéressantes que la réparation, qui peuvent être pré-sentencielles ou post-sentencielles, se heurtent à des difficultés de mise en oeuvre. Je ne veux pas critiquer le service de la Protection judiciaire de la jeunesse, qui fait déjà l'objet de nombreuses critiques, mais ce service a, il est vrai, une responsabilité importante dans la mise en place de ces mesures de réparation. Or, en de nombreux endroits, l'on peut constater que c'est plutôt le secteur associatif qui tente de travailler dans une perspective éducative.
Le cadre juridique existe donc, les solutions aussi, mais la mise en oeuvre reste pour l'instant extrêmement difficile tant du point de vue éducatif que du point de vue des sanctions qui peuvent être prononcées par les juridictions.
M. le président - Les tribunaux de Seine-et-Marne nous font savoir que 476 mesures sont actuellement en attente.
Mme Claire Brisset - Pour le sentiment d'impunité, c'est formidable !
M. le rapporteur - Vous avez parlé, madame la défenseure, de la Protection judiciaire de la jeunesse. Ne souffre-t-elle pas d'une crise d'identité ?
Mme Claire Brisset - Bien évidemment. Nous l'avons observé au cours de nos visites dans nombre d'établissements, qu'il s'agisse des CER, des CPI ou des prisons. Je ne voudrais pas être caricaturale, mais j'ai rencontré des personnes qui ne savent plus vraiment pourquoi elles sont là. Sont-elles là pour aider à punir un adolescent qui a commis un acte que la société ne peut pas accepter, et aider à le remettre sur le droit chemin ou sont-elles là pour ne pas punir ? Certaines personnes au sein même de la PJJ n'ont pas intégré la dimension psychologique de la sanction. Certes, ce n'est pas la majorité des personnes qui y travaillent, mais cela témoigne d'un profond malaise, comme vous l'avez souligné, et d'un sentiment de perte d'identité de ce service.
M. Alain Vogelweith - Il est vrai que la PJJ a été sollicitée d'une manière intense au cours des quinze dernières années : le nombre des demandes de prises en charge a augmenté alors que les moyens sont restés très limités. En effet, une augmentation sensible de ces moyens n'a été décidée qu'il y a trois ans et celle-ci ne s'est pas encore vraiment traduite dans les faits.
Par ailleurs, nous devons faire une distinction entre l'hébergement et le milieu ouvert. Nous connaissons une crise de l'hébergement pour deux raisons.
D'une part, l'hébergement est souvent pensé comme un temps de rupture. Toutes ces structures -les CER, les CPI- ne sont pas intégrées dans un projet éducatif qui s'inscrive dans la durée.
D'autre part, lorsque l'on concentre les mineurs les plus difficiles - et l'actualité nous le rappelle - sur certains lieux, il est évident que cela devient extrêmement difficile à gérer. Certains CPI se sont retrouvés face à des situations lourdes, concentrées, confrontés à des phénomènes de dynamiques de groupes explosives particulièrement difficiles à contenir.
De plus, de nombreux éducateurs expérimentés ont tendance à demander leur mutation dans des services de milieu ouvert où l'on gère les choses d'une manière différente parce que l'enfant est dans sa famille. Le travail éducatif peut donc y être moins stressant, moins difficile. Je connais dans le Val-de-Marne un foyer d'action éducative qui a été transformé en CPI. Cela s'est traduit par une demande de mutation de la quasi-intégralité des personnels qui géraient cet établissement. Se sont donc retrouvées dans l'établissement essentiellement de jeunes éducatrices qui venaient de terminer leur formation, tout à fait compétentes et motivées, mais dont certaines étaient totalement dépourvues d'expérience pour gérer ce type de situation.
Il faudrait donc faire le bilan du fonctionnement de ces établissements, ce qui ne devrait pas être très difficile, pour observer la manière dont on pourrait motiver les équipes mixtes qui comprendraient à la fois des gens expérimentés et des éducateurs plus jeunes.
Comme Claire Brisset l'a indiqué, il convient de replacer cet hébergement dans un projet éducatif à long terme. Les CER donnent des résultats intéressants mais qui restent souvent sans effet. Le constat est pire encore pour les CPI. Nous devons donc réfléchir à une mesure éducative globale qui permettrait de faire le lien entre le milieu ouvert et l'hébergement. Même lorsque l'emprisonnement est nécessaire parce que les faits incriminés sont d'une certaine gravité, nous devons pouvoir aider le jeune à sa sortie. Si la PJJ se borne à penser que tout peut être résolu individuellement avec l'aide du seul éducateur, je crains qu'il ne soit très difficile d'avancer. Nous devons régler ce problème en partenariat avec certaines autres institutions qui ont aussi à traiter ces mêmes mineurs. C'est autour de cette idée d'un décloisonnement de ces interventions et d'un travail plus collectif et plus pluridisciplinaire de ces services que nous renouvellerons les pratiques éducatives et c'est ainsi que nous éviterons d'avoir ces « cocottes-minutes » que sont ces établissements dotés de personnels qui sont très vite dépassés par les situations qu'ils doivent gérer.
M. le rapporteur - Lors de nos visites sur le terrain, certains nous ont proposé à plusieurs reprises d'étendre la comparution immédiate aux mineurs. Qu'en pensez-vous ?
Mme Claire Brisset - J'ai essayé de brosser un tableau des actions qu'il me semble nécessaire de mener. Notre dispositif actuel ne manque pas de formules qui s'apparentent tout à fait à la comparution immédiate.
Je vous ai parlé tout à l'heure de la comparution à délai rapproché. Pendant un mois après la commission des faits, il est possible de diligenter une enquête sur ce qui s'est passé. Le mineur comparaîtra ensuite et pourra être condamné dans un délai se situant entre un mois et trois mois. Cette procédure ressemble beaucoup à la comparution immédiate à la seule différence que nous disposons d'un mois pour faire une réelle évaluation satisfaisante de la situation du jeune délinquant. Plutôt que d'élaborer un nouveau dispositif, utilisons celui qui existe déjà. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est pleine de ressources. Si nous l'appliquions davantage et si nous respections les dispositions qu'elle prévoit, nous y trouverions de nombreuses solutions. Cette ordonnance a, me semble-t-il, fait ses preuves. Elle a d'ailleurs été remaniée plusieurs fois pour s'adapter aux situations évolutives de notre société.
M. le rapporteur - Certains acteurs ainsi que l'opinion publique pensent que la justice traîne, que certaines mesures ne sont pas exécutées, et qu'il serait peut-être souhaitable d'aller plus vite et de suivre par exemple la même procédure que celle qui est utilisée pour les majeurs. Cette question est revenue sur le devant de la scène au cours de la plupart de nos déplacements.
Mme Claire Brisset - Franchement, le délai d'un mois ne s'apparente-t-il pas à la comparution immédiate ?
M. Alain Vogelweith - Nous devons distinguer deux points. Il faut certes apporter une réponse rapide à l'opinion publique eu égard au trouble à l'ordre public que peuvent représenter des actes commis par un jeune dans un quartier, mais il faut aussi éviter la récidive. Pour ce faire, il faut trouver la réponse la plus adaptée, ce qui demande un minimum de temps d'évaluation. Toutefois, il ne faut pas non plus en arriver aux situations que connaissent nombre de juridictions où le délinquant est jugé un an ou deux ans après les faits. Cela n'a plus de sens pour le mineur, d'autant qu'à quatorze ou à seize ans il n'a pas la même perception des choses. C'est bien évidemment là un dysfonctionnement auquel il faut remédier.
Pour autant faut-il passer à un système de comparution immédiate ? Nous n'en voyons pas vraiment l'intérêt. Des réponses peuvent déjà être apportées en termes de détention provisoire et d'augmentation du nombre des défèrements. Si l'on a par ailleurs besoin de juger dans des délais brefs, le dispositif de la comparution à délai rapproché peut être utilisé. Quelle serait donc la place de la comparution immédiate ?
Elle permettrait simplement d'avoir très rapidement, sur jugement au fond, une peine ferme. Cette réponse montrerait simplement qu'une sanction, une peine ferme, a été prononcée. Or, je ne suis pas du tout certain que les acteurs de terrain ou que l'opinion publique attendent vraiment que des peines fermes soient prises. Nous attendons surtout une visibilité dans les réponses apportées, notamment dans les actions éducatives. Des choses se font à certains moments mais elles ne sont absolument pas comprises par les personnes qui sont sur le terrain, voire les victimes. C'est une vraie difficulté.
Il faut aussi que les services en charge de ces mesures sachent davantage expliciter le contenu de leurs interventions. Nous devons garder à l'esprit que des réponses trop urgentes et trop brutales provoqueront de fait une récidive puisque personne n'envisage de prononcer des peines de prison lourdes. La sortie devra bien évidemment être préparée pour éviter la récidive.
Mme Claire Brisset - Quelque chose est, à mon sens, beaucoup plus toxique pour la société et pour ces jeunes, c'est la non-exécution des mesures. Le délai rapproché, c'est quasiment de la comparution immédiate, et il répond à votre question. En revanche, si l'on doit vraiment rendre les peines exemplaires tant pour les autres que pour l'intéressé, il faut veiller à ce que les mesures soient exécutées. Les chiffres que vous avez cités sont absolument terrifiants : la non-exécution des peines est une porte ouverte à la récidive.
M. le président - Je ne suis pas certain que la comparution immédiate ou la comparution à délai rapproché signifie obligatoirement une condamnation ou la prison. Nous ne devons pas laisser croire que la demande d'une comparution la plus rapide possible signifie que s'ensuivra inévitablement une condamnation, et une condamnation sévère. Cela peut être aussi l'occasion de marquer une solennité et de prendre des mesures salvatrices en préconisant des mesures d'éducation ou d'éducation renforcée par exemple.
La quasi-totalité d'entre nous sommes d'accord avec votre perception de l'ordonnance du 2 février 1945. Je profite de cette occasion pour le rappeler parce que l'on se trompe parfois sur nos intentions. Cette ordonnance prévoit tout l'arsenal nécessaire. Nous l'avons toilettée vingt fois, nous pouvons continuer de le faire si cela s'avère nécessaire, mais je n'ai pas perçu de critiques fondamentales à cet égard, sauf de la part de personnes qui portent sur elle des jugements très éloignés des nôtres.
M. Alain Vogelweith - Pour ce qui est de mettre en place des mesures éducatives, on peut actuellement le faire. Le juge des enfants peut ordonner toute une série de mesures qui pourraient d'ailleurs être améliorées. En revanche, si l'on ne dispose pas d'un minimum de temps pour évaluer la situation -bien évidemment il n'est pas obligé de prononcer une peine de prison ferme, il pourra trouver d'autres réponses-, il ne pourra pas considérer le mineur dans sa particularité.
Pour ma part, j'ai exercé différentes fonctions. Je fus juge d'instruction. Je me suis occupé des adultes, puis des mineurs. Bien évidemment, au pénal, lorsque l'on a affaire à des mineurs, même si l'on considère la personnalité du mineur, l'acte qu'il a commis est déterminant. Or, l'ordonnance de 1945, que personne ne veut sérieusement remettre en cause, me semble-t-il, et je l'espère, nous donne la possibilité de tenir compte de la personnalité du délinquant en mettant en place par exemple des mesures éducatives. Or, pour savoir quel type de mesures il faut prendre, quelle réponse il faut apporter au délinquant, un temps d'évaluation est nécessaire. Il faut donc se demander si la comparution immédiate peut permettre la mise en place de réponses fines, individualisées et efficaces eu égard à la situation du mineur. Telle est la seule réserve que j'émettrai sur ce dispositif.
M. le président - Elle peut être plus intéressante que l'admonestation qui est plutôt un coup d'épée dans l'eau.
M. Alain Vogelweith - Cela pose surtout un problème lorsque l'on fait vingt-quatre admonestations de suite !
M. le président - Je vais maintenant donner la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent poser des questions.
La parole est à M. Plasait.
M. Bernard Plasait - Ma première question a trait à la comparution immédiate ou à la comparution à délai rapproché. Vous nous dites que la comparution à délai rapproché suffit, mais ne vous heurtez-vous pas à des non-exécutions des enquêtes que vous demandez par manque de moyens ? N'est-ce pas là que se situe la vraie difficulté ?
Par ailleurs, vous avez parlé, madame la défenseure, de l'impunité. Il est évident que, à côté de l'impunité qui est moins forte que ce que l'on imagine, il y a le sentiment d'impunité. Ce sentiment est purement catastrophique parce qu'il encourage la réitération et parfois même le passage à l'acte puisque l'on sait qu'un très grand nombre de faits ne sont même pas signalés. En plus des chiffres importants de la délinquance, il faut noter que 80% à 85% des faits ne sont pas signalés. Pour ces délinquants, c'est un formidable encouragement.
Vous nous avez parlé des peines qui n'étaient pas exécutées. Concrètement, j'aimerais savoir sur quoi l'on bute. Pour quelles raisons des peines ne sont-elles pas exécutées ? Quelle est alors la responsabilité du juge de l'application des peines ?
Mme Claire Brisset - Vous avez tout à fait raison, vous posez là deux questions qui sont voisines puisque, dans les deux cas, nous nous heurtons essentiellement au manque de moyens de la Protection judiciaire de la jeunesse, des éducateurs de la PJJ, des services les plus variés qui peuvent diligenter l'enquête pour la comparution à délai rapproché et qui permettent par ailleurs l'exécution des peines. C'est là que se situe le noeud essentiel du problème. On en revient toujours à la crise que connaît la PJJ, au manque de moyens dont elle souffre en dépit du recrutement important qui a été décidé en 1998 mais qui n'a pas encore permis de produire ses effets.
M. Alain Vogelweith - La PJJ connaît des difficultés, par manque de moyens, pour mettre en place le sursis avec mise à l'épreuve, les travaux d'intérêt général, voire les mesures de réparation pré-sentencielles ou post-sentencielles : elle ne peut assumer l'exécution d'un certain nombre de décisions. Certains services de la PJJ vont parfois privilégier les mesures de liberté surveillée par rapport aux mesures de sursis avec mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général.
Je le répète, les moyens qui sont accordés aux services de la PJJ doivent être renforcés et, en définissant la politique qu'elle doit suivre, nous devons fixer des priorités en matière d'exécution des peines. Ce point est extrêmement important.
Je vous rappelle que, s'agissant des mineurs, c'est le juge des enfants qui, pour ce qui concerne le milieu ouvert, est le juge de l'application des peines. C'est à lui d'impulser une véritable exécution des peines. Il est d'ailleurs important que ce soit le juge des enfants parce qu'il peut établir un lien entre ce qui a été fait en amont de la condamnation et la manière dont la condamnation doit être exécutée.
S'agissant de l'exécution des peines, une disposition du code de procédure pénale, l'article D.49-1, prévoit que la peine peut être aménagée lorsqu'elle est égale ou inférieure à un an de prison ferme. Mais, certains membres de la PJJ ou certains juges des enfants considèrent que l'on n'y a recours que dans très peu de cas. Se pose donc là un vrai problème. Pourquoi les mineurs auraient-ils moins de droits que les majeurs ? Telle est en quelque sorte la situation que nous connaissons actuellement en matière d'exécution des peines.
S'agissant de toutes les infractions qui ne seraient pas connues ou qui ne sont pas poursuivies, il est évident qu'il existe un décalage entre les faits commis et les faits poursuivis -et les enquêtes de « victimation » le montrent bien. Je note simplement que les poursuites sont nettement plus nombreuses s'agissant des mineurs. Cette politique a été développée ces dernières années pour répondre à tout acte commis. Il s'agit certes d'un slogan, mais s'est exprimée la volonté de poursuivre davantage les mineurs. En effet, j'ai pu observer que, pour les mêmes faits, les majeurs bénéficiaient du classement de leur dossier alors que les mineurs étaient poursuivis. Veillons toutefois à ne pas engorger la machine judiciaire avec certains faits. Les incivilités pourraient peut-être par exemple être traitées en amont du judiciaire de manière à concentrer les moyens sur les faits, sur les peines, les éléments qui nécessitent vraiment une bonne exécution des peines.
Comme vous allez auditionner un principal de collège, je souligne que, dans certains établissements scolaires, des conventions ayant été passées entre la justice, la police et l'école, le nombre de poursuites pour de petites incivilités et des problèmes à l'école a augmenté alors que le nombre des poursuites disciplinaires au sein de l'école a diminué. Le judiciaire et le pénal ont donc réglé des faits qui étaient auparavant réglés en termes de discipline.
Lorsqu'un fait se passe au sein d'un collège, il faut bien entendu y apporter une réponse. La question est de savoir si la réponse doit être pénale ou judiciaire, même s'il ne s'agit que d'une vague admonestation ou d'une rencontre avec le commissaire de police par exemple, ou si elle devra être donnée en termes disciplinaires au sein de l'école, voie qui sera peut-être mieux comprise par les familles et par l'intéressé. Il ne faudrait pas transférer au judiciaire des réponses qui finiraient par engorger la machine et qui seraient mal perçues et mal comprises par les intéressés.
M. le président - Ne peut-on pas penser, même s'il est regrettable de choisir, qu'il est peut-être plus urgent d'intervenir sur les mineurs parce que nous manifestons là un espoir. Cette attitude peut sembler paradoxale, mais il est désespérant de se dire que des mineurs vont entrer dans la délinquance à tout jamais. Si nous devons accorder une priorité et réaliser des efforts importants, c'est vers ceux qui sont les plus susceptibles de rédemption, si j'ose dire, que nous devons nous tourner.
Mme Claire Brisset - Cela est d'autant plus vrai que la pédopsychiatrie en est un exemple flagrant.
Lorsque l'on parvient à remettre sur les rails un enfant qui connaît des difficultés psychologiques, on évite ainsi qu'il ne tombe dans la maladie mentale. C'est tout à fait similaire.
Toutefois, si vous me le permettez, monsieur le président, je voudrais émettre un souhait. Puisque vous allez recevoir des spécialistes de la violence à l'école et des représentants du milieu scolaire, je voudrais soulever un problème auquel je suis confrontée : l'exclusion scolaire.
Lorsqu'un adolescent a commis un délit grave à l'école et qu'il en est exclu, en le rendant à sa famille, quel choix lui donne-t-on si ce n'est celui de se laisser entraîner par des adolescents plus aguerris que lui dans des activités répréhensibles ? Si on l'avait maintenu à l'école, on aurait peut-être pu trouver une autre solution pour éviter cette situation.
M. le président - La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas - Vous nous avez fait un exposé extrêmement structuré, très intéressant, tout de même pessimiste, me semble-t-il.
Mme Claire Brisset - Je vous ai aussi exposé des solutions !
M. Jacques Mahéas - Je voudrais être un petit peu plus optimiste. En Seine-Saint-Denis, département qui n'est pourtant pas facile, je ne perçois pas les choses comme vous.
Ainsi, j'ai demandé à la mairie de Neuilly-sur-Marne quel était le nombre des bénéficiaires des TIG. Il y en eut onze l'an dernier. Certes, ce n'est pas assez, mais nous avons réussi pour dix d'entre eux. Quarante employés municipaux ont été formés pour les accueillir. J'attends que les juges nous envoient des jeunes. J'ai l'impression que le vivier existe. En tant que juge et défenseure des enfants, vous pourriez exploiter cette formule. Les collectivités locales, pour nombre d'entre elles, sont prêtes à répondre à toute sollicitation.
En revanche, je vous rejoins sur de nombreux points, s'agissant par exemple de la formation des éducateurs de rue. C'est un métier extrêmement difficile.
Par ailleurs, je voudrais vous interroger sur un phénomène nouveau qui existe depuis quelques années et qui s'est généralisé, je veux parler des bandes.
Si vous avez visité de nombreuses prisons, en dialoguant avec les jeunes, n'avez-vous pas observé qu'ils étaient entraînés encore plus dans la délinquance à cause de ce phénomène de bande, de caïdat ? C'est très préoccupant. Comment peut-on y remédier ? Avez-vous des propositions spécifiques ? Les éducateurs de rue pourraient-ils faire éclater ces bandes ? A l'école, ce phénomène de chef existe-t-il ?
En tant que collectivité, nous nous trouvons dans une position particulière. Nous essayons, il est vrai, de fédérer les jeunes en organisant des clubs de prévention, en mettant à leur disposition des éducateurs. Mais ces bandes se constituent quelquefois au sein même de ces lieux éducatifs.
Mme Claire Brisset - C'est tout à fait juste.
Vous avez parlé de la Seine-Saint-Denis. J'observe que, bien souvent, ce département - où je me rends souvent, justement parce que je suis invitée par des gens qui veulent me montrer ce qu'ils y font -, qui compte nombre de cités et de situations de difficulté, est aussi un laboratoire de l'innovation sociale, que ce soit dans le domaine de la psychiatrie, pour les TIG, ou dans d'autres domaines. Par exemple, va bientôt s'ouvrir à Avicenne une maison de l'adolescent, comme il en existe une au Havre. C'est une expérience que je trouve vraiment exceptionnelle et dont je souhaiterais la multiplication partout. Il va donc y en avoir une en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Bordeaux, à Paris, etc., et c'est heureux.
Tout à l'heure, Alain Vogelweith vous parlera d'un autre département où l'on trouve aussi des cités et des choses difficiles, le Val-de-Marne, où il était juge jusqu'à il y a peu.
A propos des bandes, tout le monde sait que l'adolescence est un âge de la vie où l'on a besoin de pairs - de pairs, bien sûr, mais aussi de pères ; mais ce n'est pas le sujet du moment. C'est à nous, les adultes, qu'il revient de donner à ces jeunes les moyens de trouver des sentiments d'intégration à des groupes d'adolescents autrement que par la délinquance, celle-ci étant finalement l'acte qui fédère la bande. C'est pourquoi j'en reviens à ce que je disais précédemment : il faut multiplier les lieux d'accueil, les centres, les éducateurs de rue dont vous nous parlez, etc., et même les maisons d'adolescents - je pense qu'il en faudrait partout -, pour qu'ils aient des lieux où ils puissent parler entre eux et se retrouver, par exemple grâce à des activités culturelles. Nous avons laissé tomber beaucoup d'activités culturelles destinées aux jeunes, alors qu'ils en ont besoin, si bien qu'ils fédèrent leur amitié, leur sentiment d'appartenance grâce à la délinquance, autour de la bande.
Je suis désolée de vous avoir donné l'impression d'être pessimiste. Je ne me sens pas pessimiste, j'ai l'impression que l'adolescence est devant nous comme un chantier qui en serait encore à ses débuts. Notre société a bien travaillé sur le problème de la petite enfance. Depuis ma nomination, qui me donne en quelque sorte une loupe, j'observe que les adultes, que ce soient l'État, les départements..., ont bien développé l'accueil des petits enfants, etc. En revanche, à partir du moment où les adolescents arrivent en sixième, nous avons en quelque sorte baissé les bras, j'ai le regret de le dire. Mais je vous assure que je ne suis pas pessimiste, et je pense qu'il n'est pas trop tard.
M. Alain Vogelweith - Sur la question des bandes, deux approches sont possibles.
La bande crée une difficulté, notamment en favorisant les passages à l'acte des individus en bande : nous avons tous connu des mineurs qui ne posaient pas de problème seuls et qui, dès qu'ils étaient dans leur groupe de pairs, passaient à l'acte. Il y a généralement, autour des bandes, des mineurs qui sont un peu dans la périphérie, qui ne se font jamais prendre et qui sont en quelque sorte dans l'animation.
Mme Claire Brisset - Des caïds !
M. Alain Vogelweith - La dynamique de la bande fait que ce sont ceux qui courent le moins vite qui sont pris, ou ceux qui veulent à tout prix, on peut dire « revendiquer » leur passage à l'acte, en particulier en se confrontant avec les forces de l'ordre. C'est une difficulté.
Les réponses, je le disais, peuvent être apportées à deux niveaux différents. D'un côté, cela peut être des réponses en termes répressifs, en termes d'interpellations..., que connaissent bien les différents intervenants, notamment les brigades anti-criminalité.
D'un autre côté, on peut répondre en termes éducatifs, et il n'est pas inintéressant de se demander ce que l'on peut faire de ce point de vue. On se demandait tout à l'heure si la PJJ n'était pas en difficulté pour répondre, et il est certain qu'il faut repenser certaines choses.
Nous concevons l'éducatif comme une relation entre un éducateur et un jeune ; mais on peut aussi le concevoir comme un travail sur le groupe. Une expérience très intéressante a eu lieu dans un centre d'action éducative du Val-de-Marne. Des gamines « éclusaient », si je puis dire, les grands magasins du département et commettaient à répétition toute une série de vols. Un juge des enfants a décidé de mettre en place avec un centre d'action éducative une mesure globale ; plus exactement, il a pris une mesure pour chaque enfant, mais les a toutes confiées au même service, qui a travaillé non pas avec un enfant d'un côté et un éducateur de l'autre, mais sur la dynamique de groupe. Ils sont même allés jusqu'à faire venir les gamines qui ne s'étaient pas fait prendre par la police mais qui étaient néanmoins dans la périphérie de la bande. Leur travail était extrêmement intéressant parce que, pour la première fois, ils avaient accès à ces gamines, qui ne venaient jamais quand elles étaient convoquées individuellement, mais qui, dans ces circonstances, acceptaient de participer au groupe. Et, du jour au lendemain, ils ont pu résoudre le problème du passage en l'acte en orientant ensuite les enfants sur des projets individuels, tout en maintenant le groupe.
Cela ne marche pas pour tout. Certains types de délinquance, certaines organisations - je pense par exemple à l'économie souterraine - appellent des réponses en termes de police judiciaire. Mais, pour ces phénomènes de groupes qui créent un certain nombre de difficultés, soit d'incivilité, soit de petits actes de délinquance, on sait mettre en place des réponses de cette nature.
Hélas, un éducateur de ce centre d'action éducative est parti à la retraite et n'a pas été remplacé, si bien que la décision a été prise d'abandonner tout ce qui était expérimental, parce que la priorité était de répondre aux mesures individuelles, et ce travail-là n'a plus été fait. C'est donc un vrai problème et, souvent, le secteur associatif fait preuve de plus d'imagination. Mais la PJJ a des ressources, et c'est pour cette raison que je veux tout de même la défendre un peu, elle a des gens qui font des choses intéressantes ; malheureusement, ce n'est pas toujours assez porté par l'institution pour que cela aboutisse.
Pour revenir à cette question des bandes - je pense notamment aux occupations des cages d'escalier -, on peut, bien sûr, répondre en envoyant des policiers faire des contrôles d'identité ; mais on peut également répondre par un travail sur ce groupe : pourquoi occupe-t-il ce territoire ? que se passe-t-il entre les habitants et ce groupe ? comment est généré un sentiment d'insécurité chez les gens qui rentrent et qui voient des jeunes attroupés ?... Des réponses peuvent être données, je les ai vues, je sais qu'elles marchent. Le seul problème, c'est que, en général, elles sont expérimentales et qu'il est extrêmement difficile de les modéliser.
M. Jean-Claude Frécon - Nous sommes tous d'accord pour dire que l'inexécution de la peine est très mauvaise et a des effets très ravageurs sur le comportement des autres.
Mme Claire Brisset - Tout à fait !
M. Jean-Claude Frécon - Je voudrais cependant revenir sur la procédure de la comparution immédiate. Malgré ce que vous en avez dit, monsieur - et j'ai noté vos propos avec attention, car personne ne nous en a parlé lors des visites que nous avons faites -, elle n'existe pas pour les mineurs.
En l'absence de comparution immédiate, le jeune qui a commis un acte de délinquance et qui, vingt-quatre heures ou quarante-huit heures après, rentre chez lui, au milieu de sa cité, cité qui peut au demeurant être assez paisible, devient alors - je reprends l'image qu'a employée Jacques Mahéas - le caïd, parce qu'il a fait des choses répréhensibles mais a été relâché. Il devient presque un modèle et, pendant quelque temps au moins, il est le point de mire de ses copains et de ses copines.
Dans les situations de ce type, l'absence de comparution immédiate a pour effet d'entraîner certains autres adolescents à accomplir eux aussi un acte ; et, quitte à accomplir un acte, pourquoi ne pas gravir un échelon de plus ?
Ne pourrait-on améliorer l'ordonnance de 1945 en trouvant une formule qui s'apparente à la comparution immédiate, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui, sans s'accompagner forcément d'une condamnation immédiate, permette au moins que le jeune ne soit pas remis dans son milieu en situation de quasi-virginité, permette de ne pas réenclencher d'autres actions similaires à la précédente ? Car c'est bien cela qui pose problème.
Mme Claire Brisset - L'adolescent ne va pas rentrer immédiatement, il y a d'abord la garde à vue ! Ensuite, il y a le défèrement, et il peut être déféré tout de suite !
M. Jacques Mahéas - Il faut que ce soit grave !
M. Alain Vogelweith - Cela se développe beaucoup.
Mme Claire Brisset - Il y a aussi la comparution à délai rapproché : il rentre chez lui, certes, mais il sait que dans un mois... Et pendant ce mois, il y a l'enquête !
M. Jean-Claude Frécon - Les voisins ne le savent pas, et tout son entourage le porte aux nues !
M. Bernard Plasait - Et ce n'est pas lui qui va démentir !
Mme Claire Brisset - C'est pour cela qu'Alain Vogelweith disait tout à l'heure qu'il faut une visibilité. Vous savez, le caïdat existe aussi à l'intérieur de la prison !
M. Robert Bret - Et quand il ressort de prison, là, il est breveté !
Mme Claire Brisset - Par conséquent, le caïdat peut exister partout.
M. Jean-Claude Frécon - Je ne dis pas qu'il faut forcément l'emprisonner ! Je dis qu'il faut trouver une mesure qui permette au moins d'arrêter l'enchaînement.
Mme Claire Brisset - Nous sommes tous d'accord là-dessus.
Il existe aussi, tout de même, ce qui s'appelle précisément « centre de placement immédiat », puisque vous recherchez quelque chose pour l'immédiat.
M. Jean-Claude Frécon - Nous en avons vu.
Mme Claire Brisset - Par définition, c'est exactement de cela que vous parlez.
M. Jean-Claude Frécon - Non, parce que le placement dans ces centres fait souvent suite à une décision judiciaire, donc intervient un ou deux mois après.
Mme Claire Brisset - Non !
M. Jean-Claude Frécon - C'est en tout cas ce que nous avons constaté !
M. le rapporteur - C'est le manque de moyens !
Mme Claire Brisset - Pour toute la France, et nous avons tout de même huit millions d'adolescents, il y a cinquante centres de placement immédiat.
M. Alain Vogelweith - Je pense qu'il y a deux aspects : d'une part, la question de savoir quelle est la mesure la plus adaptée pour le mineur et, d'autre part, la question que vous posez de la perception que la société a de la mesure.
Les réponses rapides existent. Les défèrements sont en augmentation vertigineuse. Notamment, puisque nous parlions de la Seine-Saint-Denis, ils sont devenus un mode de saisine que les juges des enfants de Bobigny utilisent dans une proportion extrêmement importante. Ils existent, ils se développent, et ils permettent aux juges des enfants d'apporter une réponse rapide.
La difficulté, vous avez tout à fait raison de le souligner, réside dans l'accueil d'urgence : de quelles structures disposons-nous pour prendre en charge un mineur lorsque le placement est possible et souhaitable ? L'accueil d'urgence permet en outre une certaine visibilité, si je puis dire, puisqu'il donne le temps d'évaluer la situation du mineur pour savoir quel projet éducatif peut être mis en place et dans quelles conditions il peut retourner dans sa famille.
Les centres de placement immédiat, qui visaient à répondre à cette demande, ne fonctionnent pas, d'abord en raison des problèmes de moyens qui ont été évoqués, mais aussi en raison du temps d'évaluation nécessaire avant l'arrivée dans le centre de placement immédiat. Les éducateurs ont besoin d'une phase d'évaluation pour savoir si cette solution est adaptée ou non, si bien qu'ils bloquent un peu, en quelque sorte, l'orientation sur la prise en charge. Si l'on veut résoudre cette difficulté, puisque vous envisagez de réformer l'ordonnance de 1945, il faut que, dans ce cas-là, le juge des enfants prononce une mesure globale qui, par la suite, sera éventuellement une mesure de milieu ouvert.
Notre dispositif contient déjà une mesure judiciaire globale de ce type, ce que l'on appelle la « mise sous protection judiciaire », qui comprend une phase dans laquelle on estime que, tant pour des raisons d'ordre public que pour pouvoir évaluer la situation de l'enfant, il faut faire le point. L'enfant est alors orienté vers un accueil d'urgence et, dans le même temps, on réfléchit à son retour dans la famille ou dans son environnement dans de meilleures conditions que précédemment.
Ce type de dispositif serait beaucoup plus intelligent que le seul CPI, qui a été présenté comme une alternative à la prison, comme une action isolée ; car la panique envahit souvent les éducateurs lorsqu'ils se demandent ce que l'on fera de l'enfant après le placement.
L'idée est donc une mesure globale dont l'hébergement serait une modalité. L'hébergement, cela peut être le recours à la prison, si cela apparaît nécessaire au juge et souhaitable pour l'intéressé. Il s'agit de ne pas déconnecter celui-ci de quelque chose qui serait plus global. On pourrait ainsi concilier le temps éducatif, c'est-à-dire la durée, et, en quelque sorte, la visibilité de la réponse.
On a déjà fait l'expérience de l'éloignement. On sait que l'éloignement peut avoir du sens pour un mineur s'il est préparé en relation avec un projet, avec quelque chose que l'on peut construire. On sait aussi qu'un éloignement brutal aggrave le problème, coupe l'enfant des quelques « tuteurs de résilience », pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, des quelques soutiens qu'il pouvait trouver dans son environnement, puisqu'il est transplanté dans un autre milieu : on ne fait que déplacer géographiquement les difficultés de ce mineur, voire les aggraver en cassant les appuis qui pouvaient étayer le travail éducatif.
Il faut donc trouver un équilibre subtil, et la seule réponse immédiate que l'on peut apporter à cette question me paraît résider non pas tant dans une comparution immédiate que dans une mesure éducative dont les modalités seraient variables et pourraient être adaptées en fonction de la situation du mineur.
La réponse d'urgence peut être prise très rapidement, puisque le défèrement peut être utilisé non pas, précisément, pour mettre l'enfant en prison, mais pour apporter des réponses de cette nature. Mais on revient à la case départ : quels moyens y consacre-t-on ? Quel projet politique global pour la protection judiciaire de la jeunesse permettra d'apporter une réponse à ce type de demandes ? Les questions essentielles sont là, bien plus que dans la procédure. Car, comme praticien, je peux vous dire que l'on arrive à faire à peu près tout ce que l'on veut, en termes de temps, avec la procédure actuelle. Le problème, c'est l'exécution, ce sont les moyens dont on dispose, notamment la question que vous posez avec une grande acuité, celle de l'accueil d'urgence. Or, vous le savez, elle fait actuellement l'objet de tensions très fortes entre les services éducatifs et les juges, qui, dans un certain nombre de situations, souhaiteraient pouvoir disposer de lieux d'accueil d'urgence et n'ont pas ces réponses.
Mme Nicole Borvo - Que pensez-vous de la recréation de centres fermés, qui devient quasiment un enjeu électoral, ce que je regrette personnellement.
Vous avez également souligné que vous ne parliez pas seulement de moyens financiers, mais qu'il s'agissait aussi de repenser la PJJ. Qu'elle soit en crise, c'est évident, car elle traite des problèmes très lourds. Avez-vous cependant une petite idée des moyens publics qu'il faudrait consacrer à tout cela ?
Mme Claire Brisset - Il n'est pas dans mes attributions de procéder à des évaluations financières de ce qu'il faudrait faire pour régler les problèmes propres à la PJJ. Tout n'a pas encore été évalué, mais l'évaluation elle-même doit être le fait de la Chancellerie. Une première mesure a été prise en 1998 qui a consisté à réinjecter des moyens, à former davantage. Mais je pense que nous sommes très loin du compte, et si vous parveniez à ce qu'une véritable évaluation chiffrée soit faite du coût des moyens humains, de la formation, ce serait un résultat essentiel de votre enquête.
Pour ce qui est des centres fermés, il y a deux possibilités. Nos amis belges - je parle de la Belgique francophone, car je connais moins bien la Belgique néerlandophone - n'ont pas de quartiers de mineurs : ceux-ci sont remplacés, dans les prisons belges, par des centres fermés qui ont une mission très précisément, très clairement édictée comme éducative. Une autre possibilité est d'établir des centres fermés à côté, en plus des quartiers de mineurs.
J'estime que si nous appliquions pleinement le dispositif existant tel que nous l'avons rappelé, notamment en misant sur la prévention, qu'elle soit spécialisée ou non, en appliquant les peines édictées, en rendant à la PJJ un niveau de moyens compatible avec ses missions ; si l'on recréait du lien dans les quartiers par quantité de structures comme celles qui ont été évoquées ; si l'on donnait aussi davantage de moyens à l'administration pénitentiaire pour que, par exemple, il n'y ait pas deux ou trois détenus dans les cellules prévues pour une seule personne et pour que, dans les quartiers de mineurs qui existent, on puisse faire un véritable travail éducatif - ce qui est l'objectif des centres fermés - ; si tout ce que j'ai énuméré était réalisé, on n'aurait pas besoin des centres fermés et la question ne se poserait plus.
M. le président - Madame, monsieur, je vous remercie.
Audition de M. Dominique BUCHERT,
principal du collège d'enseignement
secondaire du Stockeld à Strasbourg accompagné de
Mme Mireille KUHN, responsable des sections
d'enseignement
général et professionnel adapté
(10 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons maintenant entendre M. Dominique Buchert, principal du collège d'enseignement secondaire du Stockfeld, à Strasbourg, accompagné de Mme Mireille Kuhn, responsable des sections d'enseignement général et professionnel adapté.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
La parole est à M. Buchert.
M. Dominique Buchert - Il me semble important, en préliminaire à cette audition, de nous resituer devant votre commission, en quelques termes très clairs et très simples, en tant que citoyens, certes, mais surtout en tant que fonctionnaires responsables d'un établissement public local d'enseignement à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, quartier particulier que d'aucuns connaissent.
Dans l'exercice de notre travail et de la mission que nous remplissons dans ce quartier, il nous semble important d'avoir des objectifs clairs.
Il nous faut d'abord être en accord avec les objectifs de l'école : instruire, éduquer et insérer ; nous aurons l'occasion, certainement, d'y revenir. Il nous faut également être clairs sur les objectifs et sur la mission des personnels, car ce sont les ressources humaines qui permettront d'accueillir les élèves de ce quartier dit difficile. Enfin, il nous faut être clairs sur les objectifs des élèves. Or leur objectif, quoi qu'on en pense, est de réussir ; il nous paraît donc important que le service public exerce coûte que coûte sa mission, c'est-à-dire accueille tous les élèves, tous les enfants, quels qu'ils soient : c'est à nous de construire l'outil adapté de façon que tous puissent être accueillis.
L'équipe du collège du Stockfeld, en tout cas depuis que j'en assure la responsabilité, est tombée d'accord qu'il était inutile de déplacer les problèmes, que ce soit par transfert d'élèves ou par la voie des conseils de discipline : de toute façon, le problème devra être traité quelque part.
Nous nous sommes donc inscrits dans une double stratégie visant à n'occulter aucun problème, et nous avons retenu deux axes : d'une part, protéger les élèves qui ont intégré le sens de l'école et ses enjeux ; d'autre part, et surtout - c'est d'ailleurs ce qui nous coûte le plus d'énergie -, identifier et prendre en charge de façon adaptée ceux qui en ont besoin. C'est par ce biais-là que l'on peut aborder la problématique de votre commission.
Je rappellerai quelques principes philosophiques simples.
Il nous paraît important de considérer que l'école n'est pas un lieu de démocratie, mais un lieu d'apprentissage de la démocratie ; la nuance est très importante.
Il nous a également paru très important de prendre pour base l'idée qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous adapter à des événements probables : nous avons choisi d'y substituer des objectifs possibles, des objectifs auxquels nous pouvions parvenir. Nous avons donc calibré notre mission et les objectifs à atteindre de manière que, à un moment ou à un autre, tout le monde puisse se retrouver dans une logique de réussite, que ce soient les personnels ou les élèves. Cela nous a permis de mener notre action avec pragmatisme, si l'on peut utiliser ce terme emprunté à la Realpolitik , ce qui est très important dans un établissement scolaire de ce type.
A mon arrivée dans l'établissement, discutant avec des collègues, je citais Goethe : il n'est pas tout de faire des pas qui un jour nous mènent au but, il faut que chaque pas soit un but en même temps qu'il nous porte en avant. Au collège, le travail a été construit ainsi ; nous nous sommes attaqués à cette face nord qu'il fallait escalader pour arriver au sommet, avec et pour les enfants, en nous disant : pas après pas, mousqueton après mousqueton, nous allons essayer d'arriver au sommet.
Un autre point nous a paru important, pour lequel nous nous sommes un peu inspirés de Hegel : Geist ist Zeit . L'esprit est le temps, au sens où c'est l'esprit qui permet de matérialiser le temps et ce que l'on en fait.
Un principe nous a également marqués - nous sommes à deux ou trois kilomètres seulement de la frontière allemande, et nous avons pris quelques inspirations de ce côté-là -, formulé dans une phrase que j'ai retenue lors de l'exercice de fonctions précédentes en Allemagne : « Allein du kannst es tun, aber du kannst es nicht allein tun . » Traduction littérale : toi seul peux le faire, mais tu ne peux pas le faire seul. Nous avons donc choisi de ne pas inscrire l'établissement scolaire ni l'école publique dans une logique d'autarcie.
Enfin, il nous a paru important que la loi et la justice dites à l'école, puisque les établissements publics disposent d'outils de ce type-là, évoluent vers un concept de justesse et d'adéquation, en somme, d'opportunité des décisions prises à l'encontre des jeunes qui nous sont confiés et qui bénéficient de notre service public.
Je vous donnerai maintenant une très rapide photographie du collège.
Un diagnostic a été fait, sans complaisance : l'équipe se serait menti à elle-même si elle avait travaillé sur des bases non fiables.
Au niveau humain, nous avons une équipe d'enseignants jeunes, très jeunes - mais tout le monde sait que ce sont souvent les issus du concours que l'on envoie dans les zones d'éducation prioritaire, et c'est le cas du collège du Stockfeld ; en d'autres termes, on envoie souvent, pour utiliser une expression symbolique, les « Marie-Louise » mener la guerre nucléaire. Est-ce adapté ? Quoi qu'il en soit, cela a l'avantage de créer une solidarité dans l'équipe, qui apprend le métier ensemble.
Au niveau des élèves, la population scolaire est très complexe. Le collège du Stockfeld est un laboratoire en ce sens que, sur une population de zone d'éducation prioritaire largement déterminée, ou qualifiée, nous accueillons différentes formes de handicaps : sur un effectif de 650 élèves pour l'ensemble du collège, nous accueillons actuellement huit enfants amblyopes et aveugles en intégration totale ; nous accueillons une douzaine d'enfants malentendants ou sourds, également en intégration totale ; nous accueillons une unité pédagogique d'intégration d'enfants handicapés mentaux légers ; nous accueillons des élèves de SEGPA, les sections d'enseignement général et professionnel adapté, dont ma collègue ici présente est responsable, qui représentent 96 élèves ; nous accueillons enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, environ 80 jeunes qui n'ont pas leurs parents ; or votre commission doit savoir à quel point la présence des parents, à un moment donné, est primordiale, sinon essentielle.
Nos 80 jeunes qui n'ont pas leurs parents à proximité proviennent de trois horizons : une trentaine sont internes dans une école régionale du premier degré qui s'est transformée en internat public pour des élèves dont les parents sont bateliers - Strasbourg, le Rhin, les canaux Marne-Rhin, Rhône-Rhin... - ou que leurs parents n'arrivent plus à prendre en charge, notamment dans le cas de familles monoparentales, de commerçants ambulants, etc. ; en outre, 45 élèves proviennent de deux structures : d'un foyer d'accueil départemental, donc de la DDASS, et d'un foyer d'obédience associative qui remplit la même mission.
Au niveau du matériel également, il nous a paru important de faire un diagnostic très précis et d'obtenir un cadre de qualité, parce que nous croyons beaucoup au respect de la qualité dès lors qu'on y est confronté. Le Conseil général du Bas-Rhin a fourni de gros efforts pour restructurer l'établissement scolaire, en concertation avec l'équipe de direction, avec les personnels et avec les élèves, afin d'essayer de construire et de bâtir ensemble le collège adapté à ce quartier. C'est pour nous un outil précieux d'amélioration des comportements, parce que c'est le collège lui-même qui nous permet de construire le projet d'établissement et de le réaliser.
Au niveau contextuel, le quartier est effectivement très difficile. Cela étant, nous avons choisi de mettre en oeuvre un collège qui soit une zone de droit et de respect de la loi, une zone de droits et de devoirs, peut-être, nous pourrons en reparler, dans une zone qui peut parfois être qualifiée comme une zone de non-droit. Il se trouve que, au collège, notre priorité, c'est le respect de la règle.
A partir de là, il a été très intéressant de constater l'évolution de nombre d'indicateurs pour le collège ; car un diagnostic de départ, dès lors qu'il est fiable, effectué sans complaisance et avec un grand réalisme, permet, à un moment donné, de mesurer l'évolution des choses dans le temps ; or, qui dit évolution, dit automatiquement évaluation des méthodes et des pratiques.
Quelques chiffres.
En 1996-1997, le taux de réussite au brevet était de l'ordre de 27 % réels, c'est-à-dire par rapport à la cohorte - tous les élèves n'étaient pas inscrits à l'examen. En juin 2001, il était de 62 %, sachant que l'année précédente, en 2000, il s'élevait à 71 %. Réaction immédiate des élèves : « Monsieur, eh bien, maintenant, on peut de nouveau réussir dans ce collège, on y croit ! » Cela a eu une répercussion sur les collégiens, qui y croient de nouveau, qui ont confiance, et cela me paraît important.
En 1996-1997, le taux d'absentéisme était de 14,5 % : plus d'un élève sur six n'était pas au collège. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant trois ou quatre ans, il est de l'ordre de 5 % à 6 %, dans la moyenne des collèges du département, même hors ZEP. C'est normal : l'élève, pour être formé, pour être pris en charge, pour s'intégrer dans la société, doit être là ; pour être enseigné, il faut être présent.
Les mesures mises en place sont effectivement très strictes. En cas d'absence, nous appelons les parents, heure par heure, et ils viennent au collège. Il y a donc un partenariat fort avec les parents, ce qui me permet d'aller plus loin.
Nous avons également les rencontres parents-professeurs. Actuellement, la moyenne de participation des parents à ces rencontres s'établit aux alentours de 60 % à 80 %, selon les classes, pour atteindre même 90 % dans certaines classes ; la moyenne du collège est au-dessus de 70 %. Aucun bulletin n'est envoyé au premier trimestre : les parents viennent obligatoirement le chercher. Cela dit, les outils qui ont été mis en place sont aussi l'expression du respect des personnes. L'informatique permet de donner un rendez-vous individuel à chaque parent, avec un professeur ou deux professeurs, dans une salle donnée, à une heure donnée : les parents ne peuvent pas avancer l'alibi du « il y avait beaucoup de monde », « j'ai dû attendre », etc. - tous les parents d'élèves connaissent cela. On n'attend pas, on a un endroit, un rendez-vous. Le taux d'absentéisme s'est donc amélioré.
Autre indicateur, la participation des parents aux élections au conseil d'administration s'est élevée en cinq ans, passant de 20 % à 70 %.
Le taux de passage en seconde, qui est tout de même un élément important, s'est également amélioré et s'établit entre 52 % et 53 %. C'est, en effet, légèrement en-dessous de la moyenne départementale ou académique, mais il faut aussi savoir où nous travaillons : notre objectif n'est pas d'envoyer de manière mythique ou illusoire des élèves, excusez l'expression, « dans le mur ».
Le projet d'établissement est essentiellement fondé sur les activités que l'on peut qualifier d'annexes au programme : nous ne souffrons pas de « programmite » aiguë ; c'est le temps scolaire imposé.
Par une construction très particulière de l'utilisation du temps, notamment grâce à des séquences de soixante-quinze minutes au lieu de cinquante-cinq - le montage que cela suppose est très complexe ! -, le professeur peut choisir d'utiliser une partie de son temps de service au profit des élèves pour remédier à des situations particulières de difficultés d'acquisition de connaissances, de difficultés de comportement... ; il y a donc des remédiations de toutes sortes.
Les collègues ont également pu se réunir autour de projets forts, et nous connaissons une très forte mobilisation autour de la dimension culturelle, de l'accès à la culture.
Il y a d'abord la culture artistique, bien sûr, et nous devrions signer prochainement une convention de jumelage avec l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Je vous livrerai une anecdote à ce propos. Il y a trois ans, j'étais sur le point de traduire un élève de quatrième en conseil de discipline. Il se trouve que, pour une raison que j'ignore - mais c'est très bien pour lui ! -, il s'est inscrit au groupe qui travaillait déjà sur l'opéra et la pratique de la musique. Je me rappelle encore, c'était début décembre, nous étions à la répétition générale de Háry János à l'Opéra du Rhin à Strasbourg, lambris, dorures, cadre tout à fait inhabituel pour ces jeunes-là, trois heures et demie de spectacle. Et aussitôt la fin : « Monsieur Buchert, quand est-ce qu'on revient, quand est-ce qu'on revient ? » Eh bien, cet élève est passé en seconde générale.
Je crois donc beaucoup à ce type de leviers, de parcours un peu atypiques ou accompagnés, et innovants.
Je signalerai, par parenthèse, que nous offrons aux élèves la possibilité de pratiquer gratuitement un certain nombre d'instruments de musique, tant il est vrai que l'inscription dans une école de musique pour un an représente l'équivalent de plus d'un mois de RMI. Alors, rendons possibles les choses !
Nous avons aussi un projet culturel scientifique, et un groupe très pointu d'élèves de quatrième et de troisième travaille sur un projet en partenariat avec le département d'informatique de l'Institut universitaire de technologie de Strasbourg-Sud. Là aussi, nous avons constaté le travail des élèves.
Un autre aspect est, bien sûr, que le collège fonctionne en « école ouverte ». Durant les vacances de Pâques, qui s'achèvent ce vendredi, 120 à 125 élèves de CM1, de CM2 et de collège étaient présents dans l'établissement ; or ce sont des élèves qui, paraît-il, n'aiment pas l'école ! « L'école ouverte » est centrée sur l'environnement : environnement culturel, environnement sportif, environnement architectural, environnement social..., et a de multiples partenariats avec des structures sportives ou autres, dans le cadre notamment du CEL, le contrat éducatif local.
Notre but est que les élèves puissent constater qu'ils peuvent réussir dans ce collège, et je le leur souhaite beaucoup. Une élève me disait récemment : « Monsieur, c'est bien ! Ma grande soeur ne pouvait pas travailler comme moi dans ce collège, j'aimerais que mes trois petites soeurs puissent continuer à réussir ici. »
Au collège, les élèves respectent la règle : depuis cinq ans que je dirige le collège, nous avons mis en place entre deux et trois conseils de discipline par an, au grand maximum ; une année, il n'y en a même pas eu du tout. Car, je le rappelais, il est inutile de transposer les problèmes : nous sommes payés pour les résoudre avec les jeunes, c'est notre mission.
Je disais à l'instant que je souhaitais beaucoup à ces élèves de réussir, et c'est là un des basiques : on peut croire à leur réussite, c'est important pour l'avenir, pour le leur, pour celui du quartier, pour celui de la ville et, plus largement, pour celui du pays.
Mme Mireille Kuhn. Il est évidemment très difficile de faire une synthèse rapide de cinq ans de travail.
M. Buchert évoquait les résultats d'affectation en seconde. Environ 50 % des élèves partent en seconde générale. Mais pour la tranche la plus difficile, puisque c'est celle qui vous intéresse, il faut savoir qu'aucun enfant de troisième ne quitte le collège sans solution, absolument aucun : c'est notre défi. En général, tout est bouclé à la fin du mois de juin, et quand je dis bouclé, cela signifie que toutes les voies ont été explorées : aide à la recherche d'apprentissage, car nous sommes tout de même dans une culture alsacienne ; orientation en lycée professionnel pour ceux qui en émettent le désir, cela tombe sous le sens ; suivi particulier pour ceux qui pèchent ; redoublements, mais vous imaginez bien qu'il y a très peu de candidats. Aucun gamin ne quitte l'établissement scolaire sans que nous ayons précisément défini un projet avec lui.
Ceux qui, néanmoins, devraient se trouver dans une situation difficile en septembre sont repris en charge par l'établissement scolaire. De toute façon, le réflexe des jeunes est de revenir voir, et j'en parle d'autant plus volontiers que je connais bien la question, puisque c'est en général chez moi qu'ils viennent sonner. En 1999-2000, zéro : tout le monde a été affecté en juin, et quand je dis affecté en juin, c'est qu'ils y étaient encore en décembre. Car partir en juin avec une solution est une chose, la garder en est une autre.
Le suivi du jeune ne s'arrête pas au 30 juin pour nous, et de loin. De toute façon, il y a les enquêtes de la MGI, la mission générale d'insertion, que tout le monde connaît, où est répertorié précisément le devenir de tous les jeunes. Mais nous nous assurons que les élèves sont bien toujours en place, ou ont choisi une autre solution. C'est arrivé : j'avais un jeune en lycée professionnel qui ne s'y plaisait pas ; les contrats d'apprentissage pouvant être signés jusqu'à la fin du mois de novembre, il est parti en contrat d'apprentissage, mais il est d'abord revenu dans la maison pour voir comment faire et quelles étaient les solutions qu'il pouvait proposer.
M. Dominique Buchert - J'évoquerai une autre expérience, et non des moindres.
Le collège du Stockfeld a bénéficié d'une expérimentation de cartables électroniques, ce qui permet aussi aux élèves de se sentir valorisés. Nous sommes dans une très forte dimension de développement des outils de nouvelles technologies, et c'est extrêmement important. C'est la deuxième année que cela se fait, et, je me permets de le répéter, cela permet aussi de situer la philosophie que nous appliquons dans notre travail.
Je rédige tous les ans un bulletin de rentrée qui fait la synthèse du travail de l'année précédente, mais aussi le lien avec le projet pour l'année à venir. J'y écrivais que, pour continuer à réussir, ce dont je félicite chaque élève et adulte, personnel et parents, chacun d'entre nous aura le pouvoir, au sens de possibilité, et peut-être le devoir de décider juste, et c'est bien de cela qu'il s'agit : quelle est l'école adaptée à ce quartier et à ces enfants-là ? Ils sont comme ils sont, ils ne sont pas forcément comme on voudrait qu'ils soient, c'est du réalisme. Le pragmatisme, c'est très important.
Je poursuivais en disant que nous pouvions opérer des choix réels entre les différents possibles et en mesurer les impacts à court, moyen et long terme, et que nous pouvions aussi faire ces choix en fonction de l'avenir à construire avec les enfants, sans nous limiter aux moyens que nous avions. C'est à nous, adultes qui prenons en charge ces jeunes, de trouver avec les élus locaux, avec les partenaires, les moyens de répondre aux besoins diagnostiqués : si un gamin souffre d'une angine, on ne va pas le soigner comme pour une fracture du bras ! C'est exactement pareil au collège.
Enfin, je concluais, m'appuyant sur Bergson, que le plus grand succès est souvent atteint là où a été pris le plus grand risque de réussir.
M. le président - Maxime de sportif !
Mme Mireille Kuhn - Cela peut paraître très démagogique, mais ce n'est pas parce qu'on travaille dans un quartier difficile, où certains jeunes ont des difficultés personnelles, sociales et scolaires, qu'il faut faire une école au rabais. J'ai l'habitude d'être très franche, je m'exprimerai donc exactement comme d'habitude : il faut garder un projet très ambitieux.
Comme le disait M. Buchert, l'analyse de départ est fondamentale : il faut faire un diagnostic, il faut repérer précisément le type de gamins que l'on accueille et le potentiel humain dont on dispose, parce qu'on ne fera pas les même choses avec des gens qui n'ont pas envie d'agir. L'autre aspect fondamental, c'est qu'il faut définir où l'on veut aller. Ce n'est pas parce que le potentiel est carencé a priori qu'il faut faire n'importe quoi et se dire : « Oh, ça suffira bien ! » Non, « ça » ne suffit pas !
Le cartable électronique est un exemple, le projet opéra en est un autre, mais nous travaillons aussi des choses beaucoup plus modestes, beaucoup plus quotidiennes, et qui portent leurs fruitsLa question de l'ambition me paraît extrêmement importante. Plus les jeunes sont en difficulté, plus il faut en demander, plus il faut être exigeant, à tous points de vue. Et quand je dis qu'il faut être exigeant, c'est aussi vis-à-vis de soi. En tant qu'adultes, nous avons un statut, nous avons un métier, nous sommes avant tout des hommes ou des femmes qui ont fait un choix professionnel. On ne travaille pas n'importe comment dans un collège de ZEP ou dans un collège qui accueille beaucoup de jeunes en difficulté ! J'ai envie de dire que c'est une prise de responsabilité, c'est le sens des responsabilités. Mais c'est ma conception ; elle n'est pas forcément partagée, ni par tous ni par l'institution.
M. le rapporteur - Madame, monsieur, on ne peut être qu'admiratif devant le travail que vous effectuez et les résultats que vous obtenez, et c'est une leçon d'optimisme que vous nous donnez.
Une chose m'a beaucoup frappé, monsieur : vous avez employé cinq fois au moins le mot « partenariat ». C'est certainement l'une des raisons - ce n'est sans doute pas la seule - de votre succès.
Malgré tous ces bons résultats, je suppose que vous connaissez aussi des échecs et que vous êtes confrontés à des problèmes de violence ou de délinquance. Comment les résolvez-vous ? Pensez-vous que le décrochage scolaire ou l'échec scolaire soit un premier pas possible vers la violence ou vers la délinquance ?
Par ailleurs, comment alertez-vous les familles et, éventuellement, d'autres partenaires ?
M. Dominique Buchert - Mireille Kuhn, dans le cadre de fonctions précédentes, a été à l'origine d'un projet qui a été mis en place préalablement aux classes-relais pour Strasbourg et qui prenait en charge, dans une structure partenariale avec la PJJ, des élèves qui, pour différentes raisons, étaient en rupture totale. Il est clair que, de même qu'il ne viendrait pas à l'idée de l'entraîneur national de l'équipe de France de football de mettre Laurent Blanc dans les buts mais qu'il le laissera dans le champ, de même, nous essayons d'utiliser le mieux possible les compétences, les ressources humaines qui sont disponibles. C'est pourquoi je proposerai à Mireille Kuhn de répondre, parce qu'elle a participé à la mise en place des outils internes de traitement de ces questions.
Mme Mireille Kuhn - Vous évoquez le décrochage scolaire. Nous sommes évidemment très attentifs aux résultats scolaires.
Cela passe d'abord par la présence du gamin. Comme le disait M. Buchert tout à l'heure, lorsqu'un enfant est absent, la famille est immédiatement prévenue. Évidemment, le numéro de portable change à peu près toutes les semaines... Quand cela ne fonctionne pas, je demande à l'association de prévention du quartier, la JEEP -pour « Jeunes équipes d'éducation populaire »-, avec laquelle nous travaillons très étroitement, d'aller dans la famille. Ils vont donc chercher la famille, ils s'y rendent, physiquement. Moi aussi, il m'est arrivé de le faire, c'est très clair ! Un élève de troisième qui devait être en stage et qui n'y était pas, je suis allée le réveiller à onze heures du matin. Ce n'est pas forcément ce pour quoi je suis payée, mais enfin, toujours est-il que je l'ai fait. Et je peux vous assurer qu'il n'a plus jamais manqué le stage ! Il était tellement gêné quand je suis arrivée et que je l'ai trouvé en pyjama que c'était fini !
M. Dominique Buchert - Il lui disait même bonjour, le lendemain !
Mme Mireille Kuhn - C'est vrai qu'il faut un petit peu de culot, de temps en temps. Mais, vous savez, il suffit de le faire une fois, ce n'est finalement pas très compliqué ! Cela prend du temps une fois, puis c'est terminé. Parce que les choses se disent ! Les jeunes savent très bien que je suis capable de le faire, et ils s'arrêtent là.
Pour en revenir au décrochage scolaire, nous exigeons d'abord que les élèves soient réguliers en classe. Un enfant malade une fois, cela peut passer. Quand nous repérons des choses un peu curieuses, ils viennent systématiquement nous trouver. Les CPE aussi travaillent avec nous, il ne faut pas les oublier, ainsi que les surveillants et les aides-éducateurs. Un enfant qui ne vient pas régulièrement est donc repéré.
Les résultats de CASIMIR en sixième nous donnent également des indicateurs relativement précis sur les jeunes qui sont potentiellement en échec scolaire, et tout un travail de lien est fait avec l'école primaire d'où ils sont originaires.
Quand nous avons identifié les jeunes en difficulté, nous leur proposons immédiatement, c'est l'aspect plus pédagogique, un travail de remédiation, mais scolaire cette fois-ci.
Évidemment, le gamin qui pose des problèmes de délinquance ou de comportement importants est rarement en réussite scolaire : un gamin qui ne vient pas en classe, que fait-il pendant sa journée ? Forcément, il est occupé, mais pas nécessairement à ce qui lui permettra de construire son avenir.
Quand un gamin pose des problèmes de comportement gérables, toute une procédure est mise en place.
Je soulignerai en préliminaire un point important : le collège possède l'équivalent d'une petite classe-relais, une structure de remédiation qui s'appelle Regain et qui est gérée par la CPE de l'établissement, aidée par des aides-éducateurs, mais aussi par des enseignants qui ont le jeune en classe. Un repérage est donc fait, une fiche de suivi est mise en place qui mentionne la difficulté rencontrée. Si le jeune pose des problèmes en maths, il ne sortira pas de tous les cours, il sera pris en charge pendant les heures de maths, quitte pour l'enseignant de mathématiques, d'une part, à lui donner le travail, bien sûr, et, d'autre part, à venir le retrouver à d'autres moments de la journée pour essayer de voir ce qui s'est passé, car ce sont souvent des problèmes relationnels.
Un jeune qui pose des difficultés un peu plus importantes reste en cours, à condition bien sûr que les problèmes ne soient pas apparus pendant les cours. Nous n'allons pas le sortir de l'école, cela me paraîtrait idiot, alors que l'objectif est qu'il aille en classe ; nous n'allons pas râler parce qu'il s'absente pendant trois jours pour ensuite le mettre dehors, cela ne tient pas debout.
Donc, il reste en classe. En revanche, de la fin des cours, vers quatre heures et quart, jusqu'à dix-huit heures, il vient à Regain et rattrape. On va retravailler avec lui la question des comportements, si c'est celle qui se pose. S'il a dégradé, matériellement, un objet dans la cour, la notion de réparation, que M. Buchert a mise en place à son arrivée - je suis arrivée deux ans après lui - joue : si un gamin qui a craché dans la cour, par le plus grand des malheurs pour lui, vient à se faire attraper, il travaille avec l'agent d'entretien au nettoyage des couloirs où il a craché. Somme toute - c'est vrai que je présente les choses de façon très réductrice et raccourcie, alors que tout cela a fait l'objet d'une longue réflexion -, c'est ce que, en tant que parent, je demande à mes gamins ! Ce n'est pas plus compliqué que cela !
Un gamin est en apprentissage ; c'est un jeune en évolution qui se trouve à une période particulièrement difficile qu'est l'adolescence. Si le repère adulte qu'il a en face de lui n'est pas un repère solide dans l'exigence, mais aussi dans la cohérence de ce qu'il met en oeuvre pour punir ou pour faire réparer, cela ne va pas. Souvent, d'ailleurs, le gamin le pointe et me dit : « Ah ! vous aviez dit que vous viendriez me trouver pour ceci et cela », il suffit que je n'aie pas eu le temps. Il a raison, le môme ! Alors, je lui réponds que je ne l'ai pas oublié, ce qui est exact, et je lui demande de venir tout de suite.
L'autre aspect important, c'est l'immédiateté de la réponse. Dire à un gamin : je t'ai vu cracher dans la cour il y a trois jours, tu passes dans mon bureau dans trois semaines, cela n'a pas de sens. Alors, c'est vrai, on lâche tout. Souvent, le patron est occupé, mais il a des adjointes qui attrapent le gamin, là, maintenant, tout de suite. On ne peut pas l'avoiner trois semaines après la bêtise, de quelque nature qu'elle soit, qu'elle soit grave ou non. Si le gamin a fait quelque chose de très important, nous allons immédiatement chercher les parents et, si nécessaire, les services de police, qui travaillent avec nous dans le quartier, puisqu'ils ont affaire aux mêmes gosses, et la JEEP, l'association de prévention.
Nous donnons évidemment une place prépondérante aux parents. Quand il s'agit de parents divorcés, nous faisons venir les deux, nous nous débrouillons. Alors, c'est vrai, c'est parfois le parcours du combattant : l'animateur de prévention du quartier passe sa journée à me chercher les deux, parce qu'ils ne sont pas forcément au même endroit, parce que les numéros de téléphone sont tronqués... De fait, cela nous coûte beaucoup d'énergie.
Mais ce sont somme toute des règles de base : le respect de soi, le respect des autres et le respect, disons, des biens matériels et des locaux dans lesquels ils se trouvent. C'est leur établissement, c'est l'endroit où ils vivent ! Et ils s'en sont rendu compte, car certains l'avaient connu dans des conditions un peu moins agréables.
Nous avons un gros règlement intérieur, comme tous les établissements scolaires, mais au dos du carnet de correspondance figurent les quatre points essentiels. D'abord, je viens avec mes outils quand je viens travailler, cela paraît évident. Ensuite, je viens dans une tenue adéquate, un tant soit peu propre. C'est vrai, ils ne sont pas tous propres, et je reconnais que, avec certains, c'est très difficile. Alors, nous travaillons avec l'assistante sociale, avec l'infirmier, avec tous ceux qui connaissent le jeune, et avec les parents. Les choses ne sont pas toujours faciles à dire, mais cela fait partie de notre boulot.
Figurent également la question du respect des adultes, la question du respect de soi, des jeunes...
Si l'un de ces points basiques de la vie en société - c'est au fond ce que l'on demande à tout un chacun, même dans la rue - n'est pas respecté, l'enfant se fait attraper. Du moins, nous essayons de l'attraper, parce que, avec 650 gamins, j'imagine bien que l'un ou l'autre, de temps en temps, passe à travers les mailles du filet... Mais, en général, quand il n'est pas pris, même s'il se dit que c'est bon, qu'il peut faire ce qu'il veut, il se fait attraper à un autre moment ; de toute façon, cela finit par venir.
M. Dominique Buchert - Une des philosophies que nous avons essayé de mettre en place, et qui est partagée par l'équipe, c'est le droit à l'erreur. Quel est l'élève ou le jeune qui n'a pas fait de bêtise ? Qu'il se lève !
Mme Mireille Kuhn - Je reste assise !
M. Dominique Buchert - Moi aussi !
En revanche, dès lors que l'on déstabilise l'image du collège, on a le devoir de réparer. C'est vrai, cela prend vraiment beaucoup de temps. Je vois moi aussi certains élèves dans mon bureau, et il y a souvent de longs silences. Cela permet à l'élève de réfléchir, et ce n'est pas forcément ce que l'adulte va dire qui m'intéresse, c'est ce que l'enfant me dit, comment il a compris ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait... Souvent, d'ailleurs, c'est lui-même qui trouve la solution. Tout homme est doué de raison, et l'objectif de l'école est d'amener l'élève à en prendre conscience. Lorsque ce but est atteint, en général, cela se passe très bien. Et même si, le lundi après-midi, cela se passe mal ou difficilement dans mon bureau, le mardi matin, j'entends souvent : « Monsieur, bonjour, je ferai plus de bêtise ! » Ce sont des gosses, et c'est important. Nous leur disons bonjour, et cela aussi est important : ils sont reconnus par les adultes, c'est essentiel.
La relation humaine est fondée sur la réciprocité et le respect mutuel. Alors, trois règles sont intangibles au collège : respect des biens, respect des personnes, respect de la règle. Dès que, d'une manière ou d'une autre, ce dernier point est transgressé, nous mettons en oeuvre ce qu'il faut, mais d'une manière adaptée. Aucun « microdélit », si on peut appeler cela ainsi, ne reste sans enquête au collège. Pour le moment, nous avons eu la chance -cela nous a parfois coûté des heures et des heures- que pas un vol, pas un problème majeur ne soit resté sans réponse. Une fois que les élèves le savent, c'est fait. Certains viennent me voir, c'est presque marrant, en me disant : « Bon, monsieur, vous m'avez coincé, qu'est-ce que je dois faire ? » Quand on en est à ce stade-là, je crois qu'on est en pleine éducation et en pleine prévention, et c'est cela qui importe.
Depuis cinq ans que je dirige ce collège, nous sommes passés, et cela me réjouit pour les élèves, d'une phase curative à une phase de prévention. Les outils internes de remise à niveau comportemental, etc., servent aujourd'hui plus à de la prévention qu'à du curatif. Par exemple, certains élèves viennent spontanément me montrer leurs devoirs le soir. Je leur demande pourquoi : « Mais, monsieur, à la maison, mon papa et ma maman ne regardent pas, ils ne s'intéressent pas ! » ; ou bien : « Mes parents ne comprennent pas ! »
Nous avons une grosse communauté turque, et Mireille Kuhn essaie, depuis le début de l'année, d'avoir un suivi régulier avec eux, car ils représentent tout de même près d'une centaine de gamins au collège, 90 exactement. Nous faisons des soirées d'information avec traducteur, grâce à une association partenaire. Je parlais des partenaires : il est clair que l'école seule ne peut pas tout faire, je n'ai pas cette prétention-là ! En revanche, il est important que l'école puisse orchestrer sur le terrain, en tant que relais du service public, la prise en charge complète de l'élève. Il serait intéressant, à cet effet, d'essayer de travailler avec les associations partenaires de l'école publique, comme le CEMEA ou Pupilles de l'enseignement public, dont je suis président dans le département du Bas-Rhin.
Mon plus grand regret est que les élèves, qui respectent dans leur collège les règles, sont téléguidés, à l'extérieur, par les grands frères ou les adultes complices qui les utilisent et abusent d'eux pour brûler des voitures. C'est le paradoxe du quartier. Il s'agit d'une question délicate. Il faut également revenir sur le courage des adultes. C'est une condition sine qua non . Celui qui choisit d'exercer son métier dans ces quartiers-là ne devrait pas y être par hasard, par erreur ou par contrainte. C'est essentiel. La qualité doit primer la quantité.
Mme Mireille Kuhn - Nous parlions tout à l'heure de la multiplicité des moyens. Je dois dire, au risque de faire hurler certains de mes collègues, que les collèges des ZEP sont relativement bien dotés. Cela dit, il vaut mieux avoir un personnel d'encadrement bien choisi qu'une multiplicité de personnes. Quand une dizaine de personnes surveillent la cour de récréation, chacune se dit que son voisin regarde. Vous avez tendance à vous défausser parce que vous êtes trop nombreux. Mais s'il n'y a plus que deux personnes dans la cour, je puis vous assurer qu'elles ont des yeux partout.
M. Jacques Mahéas - Combien avez-vous de surveillants et d'aides-éducateurs ?
M. Dominique Buchert - Nous avons deux conseillers principaux d'éducation et quatre surveillants d'externat. Nous avons des demi-pensionnaires entre midi et quatorze heures. Nous sommes ouverts le mercredi et le samedi matin. L'amplitude de la semaine est donc assez grande. Nous devrions normalement disposer de huit aides-éducateurs. Cela dit, nous n'en avons actuellement que trois.
Pourquoi avons-nous des difficultés à trouver des personnes adaptées aux besoins ? Lorsque la sélection nationale de l'équipe de France de football procède à des recrutements, elle dit qu'il lui faut tel ou tel joueur. Quand nous avons besoin de quelqu'un, nous cherchons. Or, il est illusoire de croire aujourd'hui qu'un jeune de dix-neuf ans, recruté dans le cadre des emplois-jeunes, puisse résoudre des problèmes qu'un adulte de trente ou quarante ans n'ose pas affronter.
Ces jeunes -nous le constatons lors des entretiens d'embauche- sont pleins de bonne volonté, mais quand ils se rendent compte de ce qu'on attend d'eux sur le terrain, ils sont complètement déboussolés. Finalement, l'instinct grégaire l'emportant, la situation est bloquée.
De plus, il faut savoir qu'on ne se précipite pas pour aller dans des quartiers difficiles comme le mien. Quand je recrute un jeune, je lui montre mon gilet pare-balles. Je me promène dans la cité sans aucun problème. Je n'ai pas peur dans l'exercice de mon travail. Je l'ai choisi ; je l'assume. Il comprend des aspects positifs mais aussi difficiles. C'est un tout.
La qualification, la « qualité », au sens noble du terme, des personnels qui prennent en charge les élèves est un problème important. Après, c'est une question de coût. J'ose le dire en tant que citoyen. Vaut-il mieux rembourser des voitures et reconstruire des quartiers qui ont été détruits ou investir dans des partenaires ou des associations ? Les associations qui jouent un rôle complémentaire ont été mises en difficulté, voilà une dizaine d'années, lorsque les mises à disposition d'enseignants, en application du traité de Maastricht, ont été supprimées. Prendre en charge l'élève dans sa globalité est aujourd'hui un enjeu social majeur. Le projet du collège va en ce sens.
Enfin, il est également important d'avoir une réelle évaluation des personnels en place assortie d'une obligation de résultat. Les chefs d'établissement ont un contrat d'objectifs avec le recteur qui lui-même en a un avec le ministre. Or, nous sommes amenés à diriger des personnels qui, eux, n'ont pas de contrat. Là aussi, il faut sortir de la logique de l'inspection épisodique ou périodique pour tendre à un réel travail d'accompagnement évaluatif des personnes. La plus-value pour l'élève me semble importante. La qualité de l'équipe est primordiale.
Là aussi, et ce n'est pas péjoratif, permettez-moi de faire un parallèle avec l'entreprise. Celle-ci fait aujourd'hui du « juste à temps ». Elle a atomisé ses lieux de décision et de réaction au marché pour répondre « juste à temps ». Si nous pouvions avoir les moyens, en tant que chef d'établissement, de répondre « juste à point », ce serait bien pour les élèves et les jeunes.
M. Jacques Mahéas - Quel est le rapport heures de cours/élèves ?
M. Dominique Buchert - Il est de 1,35.
M. Jacques Mahéas - Je me réjouis que vous ayez réussi aussi bien avec de gros moyens. Cela prouve qu'on a raison d'injecter beaucoup de moyens dans l'Education nationale.
Audition de Mmes Nicole PRUD'HOMME,
présidente de la Caisse
nationale des allocations familiales,
et Annick MOREL, directrice
générale
(10 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - L'ordre du jour appelle maintenant l'audition de Mmes Nicole Prud'homme, présidente de la Caisse nationale des allocations familiales, et Annick Morel, directrice générale.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. A cet égard, Mme Morel émet des réserves sur les chiffres qui seront communiqués.)
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Ma première question concerne l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la mise sous tutelle des prestations familiales lorsque les enfants sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou insuffisantes ou lorsque le montant de ces prestations n'est pas utilisé dans leur intérêt.
Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette procédure ? Combien de fois a-t-elle été utilisée ? Quelle est la durée moyenne de la tutelle ? Cette mesure est-elle efficace ? A-t-elle fait l'objet d'évaluations?
Mme Nicole Prud'homme - Dans les fonctions que j'occupe, je considère que les choses doivent être dites, y compris à nos élus. Je ne méconnais pas la réglementation, puisque je suis membre du Conseil économique et social. Au moment où l'on a jugé utile de mettre en place la COSA, il me semble que les rapports entre nos élus et les citoyens devraient comporter un certain nombre de précautions pour mieux faire comprendre le message.
Je ne vous ferai pas un long discours sur la baisse de la citoyenneté, car nous serions déjà au coeur du sujet, ni sur le désintérêt de certains à l'égard du devoir de voter, qui sera peut-être malheureusement confirmé, ce que je déplore pour avoir enseigné pendant longtemps l'instruction civique à mes élèves, ni sur les rapports qu'on peut entretenir avec les politiques. Un courrier comme celui que nous avons reçu, même s'il est tout à fait conforme à la Constitution, ne peut, dans certains cas, que creuser un fossé encore plus grand entre les politiques et les citoyens.
Si je me suis permis de formuler publiquement un certain nombre de remarques, c'est probablement pour essayer de faire comprendre à nos élus que certaines précautions doivent être prises quand ils s'adressent aux citoyens, sauf à avoir affaire à des personnes complètement obtuses, ce qui, je crois, n'est pas mon cas. Un peu plus de forme et de pédagogie à leur égard faciliterait grandement les rapports.
Dans l'exercice de mes fonctions, j'essaie, tout comme vous en tant qu'élu, de faire oeuvre utile pour l'ensemble de la collectivité nationale. La menace de sanctions pénales, si je ne me présentais pas devant vous, m'afflige beaucoup. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette remarque qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais qui, dans une certaine mesure, n'en est pas si éloignée.
M. le rapporteur a posé quelques questions à Mme Morel. Toutefois, pouvant m'exprimer beaucoup plus librement que les représentants administratifs de la CNAF, dont le plus éminent est ma directrice, je tiens à dire qu'il est aussi nécessaire de prendre quelques précautions à l'égard de nos services, dont j'essaie à tout moment de défendre les conditions de travail.
Nous avons reçu votre questionnaire vendredi. Vous comprendrez que la densité des questions posées et les chiffrages qu'elles impliquent obligent nos services à arrêter tout autre travail et à se concentrer exclusivement sur ce questionnaire. Les personnels sont donc obligés de travailler dans l'urgence, qui est toujours de la « sur-urgence ». C'est pourquoi Mme Morel a eu raison, en prêtant serment, d'émettre quelques réserves quant aux chiffres qui vous seront communiqués, car ils sont entachés d'un certain nombre d'incertitudes. Nous allons nous en expliquer.
J'ai bien volontiers prêté serment, mais nous débattons de phénomènes de société. Mon propos, qui traduit la position de mon conseil d'administration, ne peut pas être complètement exhaustif ni complètement vrai, car il repose sur des appréciations. Ces appréciations, même si elles sont exprimées sous serment, peuvent être entachées d'un facteur d'incertitude que je vous demande de prendre en compte tant dans notre entretien d'aujourd'hui que dans les échanges écrits que nous pourrions avoir.
Je comprends, compte tenu du sujet qui vous préoccupe, que votre première question concerne la mise sous tutelle des prestations familiales. Permettez-moi de vous dire que ce n'est, heureusement, pas la seule mission de notre institution. Elle en assume bien d'autres qui sont beaucoup plus utiles. Nous gérons dix millions d'allocataires je vous demande de bien garder en mémoire ce chiffre - et versons 300 milliards de francs de prestations- je m'exprime encore en francs -ce qui vous donne l'ampleur de notre mission.
Sur ces dix millions d'allocataires, six millions sont des « familiaux » et quatre millions des « non-familiaux ». Ces derniers perçoivent les minima sociaux et les allocations de logement, ce qui va des étudiants à la personne âgée aux ressources limitées. Nous allons avec bonne grâce nous prêter à ce jeu des questions-réponses, mais je tenais à apporter ces précisions en préambule.
J'ajoute que notre budget d'actions sociales s'élève, à la fin de l'exercice de notre convention d'objectifs et de gestion, à 16 milliards de francs, ce qui n'est pas du tout négligeable compte tenu de l'aide que nous apportons à l'ensemble de la population, y compris aux mineurs, qu'ils soient délinquants ou non.
M. le président - Permettez-moi de vous faire observer que nous sommes obligés de respecter certaines procédures. Le fait de prêter serment montre bien le caractère solennel de notre commission. Ces contraintes s'imposent à moi comme à tout le monde. Je tiens néanmoins à vous dire, peut-être pour vous consoler, que vous n'avez pas été la seule à subir cette espèce de brimade épistolaire puisque les ministres, eux-mêmes, reçoivent la même convocation. J'ai toutefois bien noté vos observations. Nous verrons si nous pouvons en tirer un enseignement. S'il est possible de faire évoluer ce formalisme, nous le ferons mais, pour le moment, il s'impose.
Vous avez évoqué les rapports avec les citoyens. Nous nous adressons, en l'occurrence, non pas à eux mais à une administration, même si elle est paritaire. Vous avez eu raison de rappeler le travail important que vous accomplissez, mais nous enquêtons sur la délinquance des mineurs. Votre opinion sur ce sujet nous intéresse et c'est à ce titre que nous vous entendons.
Mme Annick Morel - La tutelle aux prestations sociales représente, au mois de juin 2001, pour la branche famille, un coût de 413 millions de francs environ, pour parler toujours en francs, et concerne 25 500 familles environ, résultats non consolidés. Nous aurons les chiffres définitifs bientôt. Le nombre de familles sous tutelle diminue de façon très impressionnante depuis maintenant huit ans puisque, en 1994, elles étaient plus de 38 700.
Le profil de nos familles d'allocataires est assez simple : un tiers sont des familles monoparentales ; un tiers ont plus de trois ou quatre enfants. Il s'agit bien évidemment de familles pauvres. Le taux de pauvreté dans les familles monoparentales est de 14 % contre 7 %, selon les critères de l'INSEE, pour la population. Enfin, ce sont souvent des familles qui n'exercent qu'une activité.
Qui saisit le juge ? En général, ce sont des bailleurs ou des créanciers qui peuvent être les services sociaux mais aussi les offices d'HLM ou EDF, c'est-à-dire tout organisme confronté aux dettes de leurs clients.
La diminution du nombre de mises sous tutelle s'explique par des facteurs favorables et des facteurs défavorables. Les premiers sont les effets d'une prévention, notamment en matière de surendettement, qui a permis d'éviter la saisine du juge. Les seconds tiennent peut-être au fait qu'il n'y a plus rien à mettre sous tutelle pour ces familles qui ne gèrent plus que des prestations familiales ou des allocations sociales.
Nous nous apercevons que la tutelle, telle qu'elle est pratiquée, n'est pas réellement assortie d'un accompagnement social, alors que celui-ci est inclus dans son coût. Au terme de la tutelle, les familles n'ont pas plus de soutien social. Il est donc permis de douter de l'efficacité à long terme de cette mesure.
Nous ne savons pas réellement ce que deviennent les familles à l'issue de la tutelle. La branche famille a décidé de se pencher sur ce sujet très délicat. Il doit être rapproché de la tutelle aux incapables majeurs, qui est un dispositif parallèle moins bien rémunéré.
Il faut souligner que, dans les départements d'outre-mer, il n'existe pas de mise sous tutelle. Les CAF ont développé des actions alternatives à cette mesure, notamment à la Réunion. Ainsi, lorsqu'une famille en difficultés est repérée par un travailleur social ou un créancier, la CAF lui propose un service d'accompagnement social. Les engagements réciproques de la caisse et de la famille sont contractualisés, ce qui permet un accompagnement et un suivi beaucoup plus précis et donc une plus grande efficacité.
M. le rapporteur - Ce dispositif pourrait-il être étendu à la France métropolitaine ?
Mme Annick Morel - Pourquoi pas ? Il a, certes, un coût, mais il pourrait être envisagé d'étendre cette forme d'accompagnement, qu'elle soit gérée directement par les CAF, les services de travailleurs sociaux ou les conseils généraux.
M. le rapporteur - Nos questions peuvent vous paraître orientées sur une seule fonction de la CNAF qui n'est pas la plus importante. Mais la commission d'enquête a pour mission de faire le point sur la délinquance des mineurs et non un audit de la CNAF. Il s'agit d'un tout autre problème.
Mme Annick Morel - Nous n'avons pas d'études très précises quant à la durée de la tutelle. Elle s'étend de six mois à dix ans, la moyenne s'établissant autour de trois ans.
M. Jean-Claude Frécon - Pourriez-vous me transmettre une note écrite sur la pratique en outre-mer, car je dois m'y rendre dans une dizaine de jours ? (Mme Morel fait parvenir une fiche à M. Frécon.)
M. le président - La mise sous tutelle nous intéresse parce qu'une des solutions consisterait à l'étendre éventuellement aux familles d'enfants délinquants qui utiliseraient les allocations familiales à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été instituées.
M. le rapporteur - J'ai un principe simple : on n'agit bien que lorsqu'on connaît bien. C'est pourquoi nous nous permettons de demander votre opinion.
Mme Annick Morel - Pour rebondir sur cette question sans me prononcer sur la mesure elle-même, je dirai que les services des tutelles sont devenus des services administratifs et non des services d'accompagnement social, ce qu'ils regrettent. Les tuteurs n'ont plus le temps, ou la capacité, de faire de l'accompagnement social. Ils gèrent en quelque sorte l'argent, ce qui ne permet pas un accompagnement et un soutien des familles.
M. le rapporteur - Dans une déclaration faisant, me semble-t-il, suite à l'un de vos conseils d'administration qui s'était tenu en janvier 1999, vous avez rappelé que, lorsque l'Education nationale avait connaissance de comportements agressifs, elle pouvait saisir la caisse d'allocations familiales en vue de procéder à une éventuelle enquête sociale.
Cette procédure est-elle effectivement utilisée et, dans l'affirmative, combien de signalements avez-vous enregistrés au cours des années 2000 et 2001 ? Combien ont-ils été suivis d'une enquête ?
Mme Nicole Prud'homme - Il faut bien préciser les choses. Lorsque sont constatés des comportements agressifs d'élèves, il appartient tout d'abord à l'Education nationale elle-même et à ses assistantes sociales de voir pourquoi le jeune se retrouve dans cette situation, avant de faire directement appel aux services sociaux de la caisse. Il existe une gradation parmi les assistantes sociales qui peuvent agir sur ce terrain. Ensuite, le faisceau des travailleurs sociaux apporte son aide si cela s'avère nécessaire.
Nous n'avons pas de suivi statistique du type de saisine ni de ses motifs. Je ne puis donc pas vous apporter d'éléments chiffrés.
Mme Annick Morel - Sur le plan juridique à proprement parler, le comportement agressif ne relève pas du domaine des CAF alors que l'absentéisme scolaire, lui, en dépend.
Comme vient de le souligner Mme la présidente, si un enfant a un comportement agressif, c'est à l'assistante sociale scolaire, en relais avec les services sociaux du département ou la polyvalence du secteur, de s'en saisir. La CAF, sauf si elle se situe dans la polyvalence du secteur, n'a pas à traiter du comportement agressif de cet élève ni de la manière de le sanctionner.
En réalité, la procédure préconisée n'a pas été suivie d'effets, car ce sont les services de l'Education nationale qui devraient être les premiers en alerte.
M. le rapporteur - Vous venez de parler de l'absentéisme scolaire. Au sein de votre propre service ou grâce aux services de l'Education nationale, disposez-vous de quelques données chiffrées à ce sujet ?
Mme Annick Morel - S'agissant de la suspension des prestations familiales au motif d'absentéisme scolaire, nous disposons d'une donnée chiffrée : 8 900 suspensions de prestations familiales ont été prononcées. En vérité, nous sommes assez perplexes sur ce chiffre et sur ses conséquences.
En effet, si elle était suivie, la procédure entraînerait une profusion de saisines et une augmentation considérable du nombre de suspensions des prestations. Vous le voyez bien, le chiffre que je viens de citer est dérisoire par rapport à l'absentéisme scolaire.
En réalité, l'Education nationale ne signale pas l'absentéisme, et ce pour diverses raisons. Elle n'est pas organisée pour le faire ou encore elle le signale avec beaucoup de retard.
Ainsi, la CAF de Dunkerque, au siège de laquelle je me suis rendue, a passé un protocole d'accord avec l'Education nationale pour être saisie dès qu'un absentéisme scolaire est réitéré. Elle était en effet saisie avec quatre mois de retard. Envoyer, après un tel délai, une lettre aux parents, qui n'avaient pas forcément connaissance de ce fait, n'a pas vraiment d'effet pédagogique.
L'Education nationale ne saisit donc pas la CAF de manière très opérationnelle. Au demeurant, si elle le faisait, le système serait complètement débordé et deviendrait, de fait, inefficace.
On constate de plus en plus que, lorsque les CAF ont un contact avec l'Education nationale, des conventions peuvent être passées non pas avec toutes les communes mais avec un certain nombre de zones sensibles qu'elles identifient en commun. C'est le cas par exemple des Hauts-de-Seine, de Dunkerque, de Douai. Les CAF disposent maintenant d'une procédure bien rodée grâce à laquelle les signalements sont opérés avec une très grande rapidité : c'est en quelque sorte une procédure d'escalade, qui est assez efficace.
Au lieu de suspendre d'emblée les prestations, la CAF envoie une première lettre à la famille pour l'avertir que, si l'enfant réitère son absence, les allocations seront suspendues. Une deuxième lettre est envoyée si cette réitération a lieu et, enfin, la suspension intervient.
L'épée de Damoclès du retrait des prestations familiales est assez efficace. Une étude précise a été menée dans les Hauts-de-Seine : on peut constater que les récidives y sont assez peu nombreuses.
Si l'on appliquait vraiment le dispositif à la lettre, il serait totalement inefficace parce que pratiquement ingérable tant par l'Education nationale que par la CAF. Il doit donc être appliqué avec discernement et efficacité. Lorsque cette procédure est accompagnée d'une approche pédagogique et est effectuée selon ce principe de l'escalade, les résultats sont relativement bons. Toutefois, nous ne disposons que d'une évaluation insuffisante du nombre des récidives. La CAF de Dunkerque a notamment mis en place une procédure bien ficelée en coordination avec l'inspection académique.
En résumé, ce système fonctionne bien s'il est bien pensé et s'il suit un objectif de prévention.
M. le rapporteur - S'agissant de l'allocation de parent isolé, l'API, M. Petitclerc, que nous avons auditionné dans le cadre de cette commission, a écrit : « On constate fréquemment sur le terrain que des pères sont dissuadés d'officialiser leur paternité par crainte de priver la mère du bénéfice de l'allocation de parent isolé. »
Cela existe-t-il réellement ? Avez-vous dû régler de tels cas ? Dans l'affirmative, quels moyens préconisez-vous pour tenter de corriger cet effet pervers ?
Mme Annick Morel - Cette observation est assez paradoxale dans la mesure où l'API est soumise à une condition d'isolement. Ce n'est pas la reconnaissance de la paternité qui entre en jeu : un père peut tout à fait reconnaître un enfant et laisser la maman l'élever toute seule. Il n'existe pas de lien entre l'absence de reconnaissance en paternité et la situation de l'isolement de la mère.
Voilà quatre ans, Véronique Aillet, chercheur, a dirigé une étude sur l'API. D'après un échantillon de bénéficiaires, l'on peut observer que la prestation est assez bien utilisée. Elle est surtout très bénéfique aux allocataires. Il existe bien entendu certaines dérives. Dans les départements ou territoires d'outre-mer, par exemple, la rumeur circule selon laquelle des familles auraient des enfants pour pouvoir bénéficier de l'API. Quoi qu'il en soit, cette allocation est particulièrement utile et aide vraiment les bénéficiaires.
Par ailleurs, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, vient de mener une enquête relative à l'API et à l'ASF, l'allocation de soutien familial.
Lorsqu'une personne demande à bénéficier de l'API, elle doit pouvoir témoigner qu'elle a utilisé tous les recours pour obtenir la pension alimentaire auprès du père ou de la personne qui devrait élever l'enfant. De plus, l'ASF devrait être demandée préalablement à l'API. En effet, l'ASF est en quelque sorte une prestation de substitution de la pension alimentaire. L'API, pour sa part, vient en supplément. Or, l'IGAS a constaté qu'un très grand nombre de bénéficiaires de l'API n'avaient pas demandé au père de l'enfant une pension alimentaire.
Nous avons donc très récemment adressé une circulaire à nos caisses pour leur rappeler que le demandeur de l'API doit tout d'abord faire une démarche auprès du père de l'enfant, puis, le cas échéant, faire une demande d'ASF avant de recourir à l'API.
Pour notre part, nous n'avons pas constaté que les pères hésiteraient à officialiser leur paternité pour ce motif.
M. le rapporteur - S'agissant de la suppression des prestations familiales à l'égard des mineurs délinquants, quelle est votre position ?
Mme Nicole Prud'homme - Cette question extrêmement sensible revient de manière récurrente, surtout actuellement. Le conseil d'administration de la CNAF n'a pas vraiment délibéré sur ce point. Il m'est donc difficile de rapporter sa position.
Comme nous l'avons souligné depuis le début de cette audition, il nous semble que la suppression, la suspension ou la réduction des prestations familiales à l'égard des délinquants ne sont pas forcément opérantes. J'oserai même dire qu'elles seraient plutôt inefficaces. Non seulement elles sont particulièrement complexes et difficiles à mettre en oeuvre mais, en outre, elles risquent d'entraîner des effets pervers. On peut donc se demander si c'est la bonne solution. Peut-elle répondre au problème posé ?
En fait, elle présenterait un caractère de dépendance des parents vis-à-vis des enfants. Votre commission doit y réfléchir de manière approfondie. Si les parents ne devaient plus percevoir les allocations familiales, la hiérarchie des normes serait inversée. Ils se retrouveraient soumis à la pression des enfants. Nous devrions donc, me semble-t-il, envisager d'autres mesures. Cette sanction financière n'est certainement pas la bonne réponse au problème complexe et difficile qui nous est posé. On risquerait d'aboutir à l'inverse de ce que l'on cherche. On sanctionnerait les parents alors que l'on doit plutôt envisager des sanctions à l'égard des enfants ou agir sur l'environnement dans lequel ils évoluent. Nous sommes plus favorables à un accompagnement des familles.
Supprimer cette source de revenus pourrait, en outre, accroître les difficultés des parents et dès lors renforcer encore la délinquance que nous cherchons à combattre. Vous savez qu'une délinquance à caractère financier peut parfois s'ensuivre.
Comme Mme Morel vient de vous le dire d'une manière tout à fait pertinente, eu égard aux actions qui sont menées dans certaines caisses, la menace est plus efficace que l'application de la sanction elle-même. Celle-ci serait, à mon avis, plus déstructurante pour les familles.
M. le président - J'aimerais lever une ambiguïté, car les positions que le Sénat a prises ont souvent été déformées.
En effet, personne n'a jamais envisagé une sorte d'automaticité de la sanction dès lors qu'un mineur serait punissable. Nous nous demandons plutôt si, de manière tout à fait exceptionnelle, j'y insiste, nous pourrions prévoir non pas de supprimer les allocations familiales -je m'y étais, pour ma part, opposé-, mais de les mettre sous tutelle si l'on s'apercevait qu'elles étaient détournées de leur but éducatif et qu'elles ne profitaient pas à l'enfant.
J'ai été consterné de lire que nous aurions imaginé de bloquer les allocations familiales dès lors qu'un mineur serait arrêté. Tel n'est pas du tout le cas, et je souscris tout à fait à votre mise en garde. En effet, si la procédure était automatique, le remède risquerait d'être pire que le mal.
Mme Annick Morel - Pour apporter un éclairage différent à la réponse qu'a faite Mme la présidente, il faut se demander à quoi sert la sanction. Sert-elle à punir la famille - et elle le fait en l'excluant plus encore - ou sert-elle à lui faire prendre conscience de la réalité ? Le sujet devient intéressant.
Cette sanction financière peut-elle aider la famille à prendre conscience de ses responsabilités ? Toutes les études que nous avons menées montrent que le lien familial est très compliqué. Lorsque les parents rencontrent des difficultés avec leurs enfants ou lorsqu'ils « démissionnent » vraiment -mais ils le font rarement-, en quoi une sanction financière leur permettra-t-elle de trouver en eux-mêmes la ressource pour retisser le lien ? Elle ne le permettra pas sauf si elle est subordonnée à un accompagnement social, une écoute, un soutien.
M. le président - Ce n'est pas du tout ce qui est en cause. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il y a un malentendu. Ce qui nous intéresse, ce sont les parents complices. Ce ne sont pas les parents qui se désintéressent de leurs enfants, ce sont au contraire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, ceux qui s'y intéresseraient de trop près. C'est sur ce point que nous menons une réflexion, et je ne suis pas certain qu'il soit facile de trouver une solution.
Mme Nicole Prud'homme - N'ayant pas la compétence des uns et des autres, je me hasarde sur un terrain que je ne maîtrise pas : la réponse à la question tout à fait pertinente que vous vous posez ne se trouverait-elle pas dans un article du code pénal qui permet de sanctionner d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende le fait de se soustraire à ses obligations au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur.
On est largement au-delà du problème tout à fait étroit de la suppression des allocations familiales. Dans le sujet qui nous préoccupe, d'autres réponses sont peut-être plus pertinentes, puisque le code pénal permet de répondre à la problématique que vous soulevez, problématique que nous ne pouvons pas nier même si elle est tout à fait marginale.
M. le rapporteur - Quelles sont ces ébauches de solution ?
Mme Nicole Prud'homme - Dans le droit-fil de la question que vous nous avez posée quant à l'action que peuvent mener les caisses d'allocations familiales, je me suis permise de citer quelques chiffres puisque c'est aussi le Parlement qui, depuis les ordonnances Juppé, adopte nos budgets. Il est donc parfois bon de rappeler les masses financières.
Depuis les ordonnances Juppé, une convention nous lie à l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion, la fameuse COG. Aux termes de celle que nous avons signée le 3 juillet 2001, notre fonds d'action sociale passera de 2 millions à 3 millions d'euros entre 2000 et 2004.
Comme vous le savez, nos caisses d'allocations familiales n'ont pas pour objet premier de lutter contre la délinquance même si, bien évidemment, cela fait partie de leurs préoccupations. Elles ne sont pas les seules à être saisies de ce dossier, et heureusement ! Tout ce que l'on peut faire en matière d'action sociale contribue à prévenir la délinquance juvénile.
Le conseil d'administration de la CNAF, parmi les orientations d'action sociale qu'il a rédigées, a réaffirmé l'importance de l'accompagnement de la fonction parentale, du développement de l'épanouissement de l'enfant, contribuant au développement social local et à la cohésion sociale qui, ne l'oublions pas, sont autant d'éléments de nature à endiguer cette délinquance.
Comme vous le savez peut-être, nous avons à notre disposition différents outils. Un certain nombre d'entre vous connaissent certainement les contrats enfance, mais j'insisterai ici sur les contrats temps libres des enfants et des familles.
Ces contrats, signés avec les collectivités locales, contribuent au développement des services, qu'ils soient à caractère individuel ou collectif, affectés à l'accueil des jeunes enfants, et ce -c'est en quelque sorte une politique de prévention- dès le plus jeune âge, parce que c'est dès ce plus jeune âge que l'on peut appréhender la vie en société et faire l'apprentissage des repères.
Du fait du développement du salariat féminin, vous le savez aussi bien que moi, le temps libre des enfants pose problème. Nos contrats temps libres y répondent. Une des nouveautés de l'action sociale que le conseil d'administration a souhaité mettre en place en faveur des jeunes réside dans l'allongement de la durée du contrat temps libres qui s'arrêtait à la date de l'obligation scolaire, c'est-à-dire à seize ans. De manière expérimentale, puisqu'une demande s'exprime, nous avons souhaité proroger ces contrats jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Offrant aux jeunes des services de qualité, ces actions peuvent s'apparenter à la prévention de la délinquance.
Nos caisses d'allocations familiales apportent aussi des aides aux centres sociaux et à tout ce qui constitue l'animation de la vie sociale.
Après avoir parlé des actions que nous pouvons mener auprès des jeunes, ou des plus petits, je ne veux pas oublier une action extrêmement importante qui tend à se développer ; je veux parler de l'accompagnement de la fonction parentale et de tout ce qui touche les relations enfants-parents.
De manière un peu plus concrète, en visitant un certain nombre de caisses d'allocations familiales, j'ai été agréablement surprise de constater avec quelle ingéniosité nos caisses faisaient en sorte que les parents soient accueillis dans des lieux où ils puissent parler entre eux de leurs problèmes, de leurs difficultés. Cette forme d'auto-formation leur permet de mieux appréhender certains problèmes en coordination avec les services de médiation familiale, qui se développent de plus en plus. Des actions sont également menées pour que les familles se rapprochent plus encore de l'école et pour assurer un accompagnement scolaire. Des groupes de parole sont aussi mis en place, mais je pense que vous avez entendu parler de toutes ces actions. N'oublions pas que des actions de soutien avec les travailleurs sociaux sont menées en faveur des familles les plus en difficulté. N'omettons pas non plus tout ce que nous faisons en coordination avec les professionnels qui travaillent en relation avec les parents. Bien entendu nous portons toutes ces préoccupations à la connaissance de nos partenaires.
D'une manière assez globale, nous pouvons dire que les collectivités locales reconnaissent généralement la compétence des caisses d'allocations familiales pour ce qui concerne la situation des familles. Nous disposons d'informations extrêmement précises qui peuvent aider à la prise en compte du problème que vous voulez traiter aujourd'hui.
Un fort partenariat dans ce domaine s'est donc mis en place. Nos caisses développent aussi des réseaux d'écoute et d'accompagnement des parents. Cette action a été lancée par la délégation interministérielle à la famille. Localement, nos caisses sont très impliquées et elles essaient de fédérer toutes ces actions en coordination avec nos partenaires, les associations et les organismes institutionnels.
Nous pourrions aussi parler de tout ce qui touche à la prévention précoce des relations enfants-parents.
M. le président - Le travail de partenariat est tout à fait excellent !
Mme Nicole Prud'homme - J'insiste, notre action s'inscrit plus dans le registre du préventif que dans celui du curatif, même si nous ne l'oublions pas.
J'élargis quelque peu le débat, mais nous avons parfois les uns et les autres de grandes difficultés à évaluer les politiques publiques. Quel est finalement l'impact de nos actions ? Personne n'aurait l'idée saugrenue de tout arrêter pour en évaluer les conséquences.
Toutes ces énergies qui se développent en partenariat et tous les financements qui sont accordés ont très certainement un impact sur la vie de la cité ainsi que sur la prévention de la délinquance des mineurs. Peut-être y a-t-il là matière à réflexion, car c'est en traitant ces problèmes en amont, en coordination avec l'ensemble des partenaires, que nous pourrons prévenir la délinquance.
La prévention est beaucoup plus importante à nos yeux même si, confrontés à certaines situations, nous sommes aujourd'hui obligés de faire du curatif. Lorsqu'une hémorragie se fait jour, il faut bien la stopper. Il y a là matière à réflexion pour tous les acteurs de la jeunesse. Ce n'est certainement pas une action précise, ciblée, même si le droit le permet, qui permettra de résoudre ce problème extrêmement difficile et délicat que constitue la délinquance des mineurs.
Audition de M. Éric DEBARBIEUX,
professeur en sciences de
l'éducation
et spécialiste des questions de violence à
l'école
(10 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre maintenant M. Éric Debarbieux, professeur en sciences de l'éducation et spécialiste des questions de violence à l'école, qui vient de publier une étude sur les mécanismes de la violence des jeunes intitulée L'Oppression quotidienne .
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, M. Debarbieux.
M. Éric Debarbieux - Je ferai un exposé d'une quinzaine de minutes, à l'issue duquel je vous donnerai un exemplaire du rapport lui-même, si vous ne l'avez pas, ainsi que du premier tome des actes du colloque mondial que nous avions organisé à l'UNESCO, l'année dernière, sur le thème de la violence à l'école, document qui regroupe une série de synthèses élaborées par quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux de la question.
L'Oppression quotidienne est un titre un peu fort pour un rapport scientifique, et je crois que la meilleure façon de présenter ce texte est d'en expliquer l'intitulé. Bien sûr, résumer en quelques minutes un tel travail, qui est un travail scientifique, casse la nuance ; or celle-ci est importante sur ce sujet.
Si nous avons choisi L'Oppression quotidienne , c'est que le rapport porte sur un sujet bien précis, sur un certain type de délinquance des mineurs : j'avoue que j'ai du mal à croire à la délinquance des mineurs en tant que phénomène massif qui aurait partout les mêmes causes et les mêmes manières de s'exprimer.
Il s'agit donc bien d'une étude sur la délinquance des mineurs, mais dans des quartiers défavorisés extrêmement variés qui vont du quartier du Cul de Four à Roubaix jusqu'à certains quartiers comme les Créneaux à Marseille, Saint-Michel à Bordeaux ou Belleville à Paris.
Ce rapport est le fruit d'un travail de longue durée : notre équipe travaille depuis maintenant plus de dix ans sur les phénomènes de violence à l'école, et nous avons interrogé plus de 35 000 jeunes en France. Il nous permet ainsi de bien montrer les évolutions depuis des années et dépasse un peu ce que nous avions fait précédemment : il ne porte que relativement peu sur les phénomènes de violence à l'école, auxquels nous ne consacrons qu'un huitième de notre étude, pour s'intéresser à la délinquance des mineurs dans un certain nombre de quartiers.
Nous avons séjourné pendant de très longues durées dans les quartiers concernés. En effet, nous avons mené une enquête extensive en faisant passer des questionnaires directement -ils n'ont pas été envoyés par courrier ni transmis par le biais des CPE dans les établissements scolaires-, si bien que mon équipe et moi-même avons vécu en immersion dans ces quartiers, où nous sommes restés quelquefois plusieurs semaines par mois pendant plus d'un an, voire deux ans, et même trois ans pour certains.
Si nous avons retenu ce titre, L'Oppression quotidienne , c'est que nous avons été frappés, progressivement, par un terme que les jeunes emploient sans arrêt : la « loi du plus fort ». Nous ne le défendons pas nous-mêmes, mais, où que ce soit, les gosses nous disent : « Ici, c'est la loi du plus fort . »
Je résumerai cela d'une manière qui ne figure pas dans le rapport et que m'a confiée une journaliste du Figaro . Après avoir assisté dans un collège à une séance de lancement de l'« école du respect » par le capitaine de l'équipe de handball « Les Barjots », qui, toute la matinée, avait parlé respect, droits de l'homme, citoyenneté, République, égalité, etc., elle a demandé aux enfants s'ils avaient compris ce qu'était le respect. Et les gosses lui ont répondu : « Mais, madame, ici, le respect, ce n'est pas ça, le respect, c'est la loi du plus fort. » Cela pose évidemment un problème important.
Cette loi du plus fort, nous l'avons vue fonctionner à plusieurs niveaux.
Je choisirai pour illustrer le premier niveau l'exemple d'un immeuble - nous avons d'autres cas dans d'autres quartiers - qui, depuis maintenant près de cinq ans et, j'y étais encore il y a très peu de temps, cela continue, est pris en otage par un petit groupe qui oscille entre dix et trente individus et qui rend tout simplement la vie impossible aux habitants. Ceux-ci, du coup - c'est le mécanisme bien connu de l'incivilité - ont complètement abandonné les espaces publics et se calfeutrent derrière des portes blindées, alors qu'il s'agit d'un quartier très populaire où les habitants ne sont pas particulièrement de riches propriétaires. Cet espace est donc totalement livré à ce groupe qui, depuis maintenant quatre ou cinq ans, toutes les nuits jusqu'à cinq heures du matin, empêche les habitants de dormir. C'est tout à fait remarquable.
Du coup, cet espace est tout à fait ouvert au trafic, au business . Les jeunes en question ne sont pas forcément tous des dealers, ne sont même pas forcément tous conscients d'être pris dans ce jeu du business , mais ces phénomènes sont utilisés, par les trafiquants en l'occurrence. La délinquance des mineurs est ici une petite délinquance qui résulte beaucoup plus de microviolences répétées que de grandes choses, bien qu'il y ait eu dans cet immeuble des choses assez dures tout de même, et produit une telle oppression à répétition que l'on peut dire que le pouvoir de proximité - c'est ainsi que j'appellerai la loi du plus fort - n'appartient plus aux habitants.
Je citerai un autre exemple, celui d'une mère de famille qui, dans un quartier roubaisien, nous disait : « Moi, vous savez, je n'ai pas d'ennuis dans mon quartier, je sais où il ne faut pas aller. Là, je passe... » Le problème reste de savoir ce que c'est qu'un quartier, dans une République, où les habitants ne sont que des passants et s'expriment en tant que passants.
Le deuxième niveau, le deuxième grand type de phénomènes que nous avons exploré - il est très étudié dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France, où l'on commence cependant à s'y intéresser -, ce sont tous ces phénomènes de harcèlement répétitif que subissent certains adolescents, certains enfants dans les établissements scolaires. Nous avons donc étudié le cas d'une jeune fille qui était victimée depuis deux ans par ces micro-violences répétées et qui, du coup, vivait un véritable cauchemar.
La loi du plus fort a ceci de particulier qu'elle se fait d'abord au nom du respect ; que, pour être respecté, il faut être fort ; et que, pour être fort, il faut désigner des faibles : il faut prouver sa place dans une hiérarchie. Je n'hésite pas devant ce terme de « hiérarchie », que l'on a quelquefois du mal à accepter actuellement en France, notamment quand on parle de bandes. Une hiérarchie peut être moins organisée qu'un organigramme, mais, pour être fort, j'ai véritablement besoin de prouver que l'autre est faible.
L'autre, c'est d'abord le proche ; cette délinquance est d'abord une délinquance de proximité, non pas comme on dirait : « Je suis tout près, je saisis le téléphone portable », mais bien au sens de : « C'est mon prochain . » Mon prochain, ce sont d'abord des personnes qui vivent la même condition sociale que moi, dans les mêmes quartiers que moi. Les recherches criminologiques, les grandes enquêtes de victimation nord-américaines, les nôtres aussi, montrent qu'environ 80 % des victimes ont un rapport quelconque avec les agresseurs, que ce soit un rapport de voisinage ou tout simplement le fait d'être dans la même classe, éventuellement dans la même famille, etc.
Le phénomène d'oppression répétitive est un phénomène majeur qui a des conséquences très importantes à la fois sur la vie sociale -c'est, si vous voulez, ce que l'on appelle la théorie de l'incivilité, que l'on pourrait distinguer de certaines autres théories dont, dit-on, elle procéderait, comme la tolérance zéro, etc.- et sur les individus. C'est très clair, notamment, sur ce dernier point. Ainsi, le school bullying , le harcèlement entre pairs dans les écoles, a concerné des centaines de milliers d'enfants. Ceux-ci ont été interrogés, dans le cadre d'enquêtes qui ont commencé depuis près de 1973, en Europe du Nord en particulier, mais qui se sont maintenant étendues un peu partout. Toutes les grandes recherches sur ce sujet montrent qu'un enfant harcelé à répétition présente, quand il est adolescent, quatre fois plus qu'un autre le risque de faire une tentative de suicide et que les phénomènes de répétition victimaire tendent à créer des phénomènes de dépression, des dépressions continues.
Je suis là dans la partie descriptive. Je vais bien sûr beaucoup trop vite, il y a bien d'autres exemples, bien d'autres choses dont on pourrait parler.
Le phénomène de la loi du plus fort est complexe, parce qu'il a plusieurs utilités, si l'on peut dire, dans un quartier.
Sa première utilité - je me place un peu dans la théorie actionniste, la théorie de l'acte délinquant - est de construire la hiérarchie que j'évoquais, d'affirmer ma place, d'affirmer mon respect. Que le respect, très beau terme, devienne prétexte à affirmer une loi du plus fort a bien entendu de quoi étonner, et l'on peut même essayer de combattre cela.
Ce respect a un autre sens. Il veut dire aussi : attention, je veux être respecté pour ne pas être moi-même faible, pour moi-même être protégé. En particulier, nous avons beaucoup de témoignages - nous avons beaucoup travaillé sur les problèmes de délinquance des filles - qui montrent que les jeunes filles qui se livrent à des actes de violence répétitive, qui sont regroupées dans un certain nombre de bandes et dont nous avons longuement étudié plusieurs cas très intéressants qui figurent dans le rapport sur Marseille, sont d'abord des filles qui cherchent à se protéger : à se protéger de la loi un peu machiste, à se protéger aussi, il faut bien le dire, des violences sexuelles.
Enfin, on rencontre également des gosses qui se trouvent embarqués dans cette surenchère de la loi du plus fort et qui n'en sortent plus, de peur de passer pour faibles.
Il y a donc un côté de recherche de la protection. Il y a également un côté de recherche de la domination, c'est très clair, et un dernier côté qui est une recherche très ludique : la loi du plus fort est aussi une valeur ludique pour un certain nombre de gosses - valeur assez partagée, y compris par ceux qui s'en éloignent - où le découpage du monde en forts et faibles paraît naturel à bien des adolescents.
La deuxième utilité de la loi du plus fort, c'est qu'elle peut être récupérée. Elle représente un mode de socialisation qui n'est pas un mode de socialisation de sauvages, ne soyons pas caricaturaux, mais qui, en revanche, peut être récupéré pour le business , pour le trafic, je l'ai évoqué, et on assiste à des choses tout à fait remarquables. Cela peut concerner, par exemple, plusieurs bas d'immeubles : ce n'est pas tout un quartier, c'est un endroit précis dans des quartiers qui ne sont pas forcément tous des coupe-gorges, où l'on peut très bien se promener, et se promener agréablement ; mais il y a des lieux interdits, tenus par des groupes où les mineurs sont bien souvent utilisés par des majeurs pour préserver la planque, l'espace du commerce.
Bien entendu, il existe d'autres espaces de commerce, et des études récentes ont mis en évidence le rôle des rave parties , par exemple ; on connaît aussi les commerces illégaux qui, dans les faits, se tiennent dans les appartements mêmes. Mais, pour préserver l'endroit où le client pourra venir, l'espace est tenu par des pitbulls..., est tenu aussi par le vide qui, grâce à ces mécanismes d'oppression quotidienne, est créé autour de ces lieux.
J'ai employé des métaphores très utilisées en géostratégie des drogues. La géostratégie des drogues, c'est d'abord l'utilisation du vide, au niveau stratégique, pour réussir à faire passer ce commerce. C'est vrai aussi en microstratégie des drogues : c'est l'art de créer de l'ordre par le désordre, mais un ordre propice au trafic.
Le phénomène de loi du plus fort est aussi un phénomène de classement très lié à ce que l'on appelle souvent -je pense à Denis Salas- la « délinquance de l'exclusion », c'est-à-dire à une construction du monde en amis et ennemis, ou en eux et nous ; cette délinquance s'exprime également à travers un partage du monde entre inclus et exclus. Ce que je dis n'est pas une excuse, c'est une description de la manière dont le monde est découpé et décrit par tous les adolescents rencontrés, avec une particularité que nous avons vue monter - nous la décrivions dès 1997-1998 dans un rapport que nous avions rédigé, à l'époque, pour Claude Allègre -, à savoir le durcissement des violences collectives, et l'on peut citer les phénomènes de racket collectif, que l'on a vus durcir fortement, agies précisément par ces petits groupes hiérarchisés qui, se voulant les plus forts, prouvent leur force en s'opposant. Ils s'opposent d'abord, éventuellement, à d'autres catégories sociales, ethniques ou autres, dans le quartier, donc à des proches ; ils s'opposent évidemment aux institutions, l'Education nationale étant, de ce point de vue, tout à fait centrale.
Je vous donnerai un chiffre précis. Les enquêtes que nous avions faites en 1994 et 1995 étaient essentiellement des enquêtes de victimation, des enquêtes de climat scolaire, et s'intéressaient à la fois aux faits, aux représentations, au sentiment d'insécurité, etc., mais je ne vais pas vous faire un cours de méthodologie. Lors des enquêtes de 1995-1996, 7 % des enseignants du même type d'établissements pensaient qu'il y avait une très forte agressivité de leurs élèves tournée contre eux. En 1998, ils étaient 49 %, soit sept fois plus. Et cela ne repose pas simplement sur de la représentation, sur une montée du sentiment d'insécurité liée aux médias, qui, quelquefois, jouent le jeu de l'affolement, mais bien sur ce découpage du monde, sur ce qui fait que « le professeur, voilà l'ennemi ; l'institution, voilà l'ennemi ». On sait que ce sont des phénomènes extrêmement forts, et cela pose aussi un problème clef en termes de stratégie, puisque tout ce qui augmenterait ce sentiment de découpage du monde et de partage en amis et ennemis, en eux et nous, ne ferait que renforcer la délinquance, ne ferait que créer du noyau dur contre la délinquance.
Pour faire une transition très rapide avec tout ce que l'on peut écrire et dire sur la violence en milieu scolaire, je préciserai que moi-même et mon équipe étudions essentiellement une délinquance très liée à une sociologie de l'exclusion. Nous ne disons pas pour autant que c'est parce qu'on est chômeur qu'on est violent. Il n'y a pas un facteur unique, il n'y a pas un stresseur unique, toute la recherche mondiale le sait bien : c'est la complexité des facteurs de risque qui, en se cumulant, peuvent éventuellement amener vers la délinquance ou la violence. Et même ainsi, ce n'est pas fatal : il n'existe pas de lien, pas de lien direct en tout cas, entre pauvreté et délinquance, entre pauvreté et violence. Cependant, le cumul de ces facteurs de risque, le cumul en termes d'exclusion sociale, est tout de même relativement prouvé, et nos enquêtes sur la violence à l'école le montrent tout à fait clairement.
D'ailleurs, je me permettrai une observation de terrain qui n'est peut-être pas très scientifique, mais, à force d'entendre dire : « Vous savez, c'est très difficile, la violence que nous ressentons quelquefois, nous qui sommes dans un établissement favorisé, vous ne vous rendez pas compte ! », je réponds souvent aux professeurs : « Mais alors, changez ! » Il y a tout de même moins de volontaires pour aller dans certains types d'établissements que dans d'autres - ce qui ne veut pas dire que la vie est toujours facile ailleurs.
Au-delà de tous ces mécanismes, qui sont des mécanismes macroéconomiques, macrosociaux, nous avons mis au jour un autre problème, et c'est peut-être sur ce point que peut porter l'action : c'est qu'il y a une part de construction, j'appelle cela la cofabrication, de la violence et de la délinquance par les institutions ou par les communautés, et j'emploie ce terme au sens anglo-saxon de communautés de voisinage.
Cette cofabrication peut être, par exemple, liée à l'augmentation du sentiment d'opposition suscitée par la construction de classes ethniques dans les établissements scolaires, c'est-à-dire d'un lieu où se fabrique du noyau dur parce que se retrouvent généralement ensemble des gosses d'une même origine ethnique plus ou moins bricolée.
Ce peut être aussi la manière dont les failles dans la chaîne de traitement du mineur délinquant, que l'on a également beaucoup étudiée, cofabriquent la codélinquance. L'article du Monde a très peu fait allusion à cette partie de nos travaux, qui nous a pourtant demandé beaucoup de temps, et a surtout retenu l'aspect un peu spectaculaire des cas étudiés. Or, après avoir rencontré aussi bien le substitut du procureur que des adjoints de sécurité, des éducateurs de la PJJ ou des professeurs..., nous nous sommes rendu compte que l'un des problèmes, c'est que le seul à connaître tout le système, c'est le mineur délinquant : il est le seul à savoir ce que ne se disent pas les institutions ; le secret professionnel, le secret médical, le secret de l'instruction, tout ce qui cause tant de frustrations sur le terrain, chez les policiers, chez les enseignants, etc., le secret ne tient pas pour le mineur, par principe, puisqu'il voit toute la chaîne. Si bien que, paradoxalement, cette cofabrication, c'est l'augmentation des capacités du mineur délinquant au fur et à mesure qu'il passe dans le système et qu'il en apprend les failles ; on a beaucoup écrit là-dessus.
Cela rejoint aussi la difficulté à essayer de penser un peu différemment le problème des fameux noyaux durs. L'article du Monde était bien sur point, les journalistes ont bien compris et bien résumé la question qui, c'est vrai, était compliquée. Nous avons, nous aussi, rencontré cet « allant-de-soi » de terrain qu'est le noyau dur, l'élimination des noyaux durs. Or, nos travaux montrent plutôt une réalité que tout le monde connaît, l'importance des mineurs délinquants, qui sont des mineurs réitérants, pour ne pas dire récidivistes, et la grande difficulté à traiter ces noyaux durs, d'une part, mais aussi, d'autre part, la fabrication de ces noyaux durs.
En d'autres termes, l'élimination simple des noyaux durs, qui est souvent souhaitée, notamment dans les établissements scolaires, ne servirait pas à grand chose, parce qu'elle ne met pas en place les instruments qui permettraient d'enrayer les mécanismes de cofabrication de ces noyaux durs. Je vous donnerai un exemple : un établissement scolaire qui, le trimestre dernier, avait tenu un certain nombre de conseils de discipline et éliminé trois ou quatre meneurs, a constaté pas plus tard que la semaine dernière que ceux-ci, bien entendu, avaient déjà trouvé successeurs : la manière dont l'établissement a pensé la chose n'a pas suffi à enrayer la fabrication de ces noyaux durs.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Un certain nombre de mesures ont été mises en place, des crédits importants ont été débloqués pour essayer d'améliorer les choses. Or on s'aperçoit que cela ne marche pas. Quelles en sont les raisons ? Quelles préconisations feriez-vous ? Est-ce lié à cette opposition entre eux et nous, entre l'exclu ou l'inclus, que vous venez d'évoquer, et à cette révolte contre l'institution ?
M. Éric Debarbieux - Ce mécanisme-là me paraît effectivement essentiel, même pour comprendre ce que l'on appelle quelquefois les « bandes ethniques », qui reposent en fait sur cette construction du monde et qu'il faut éviter de penser en termes raciaux.
Je serai tout à fait de l'avis du grand criminologue québécois Maurice Cusson, selon qui, quel que soit l'impact des mesures prises par les professionnels, tant qu'il n'y a pas un travail de la communauté, un travail citoyen, un travail de tous, cela ne peut pas suffire. Or nous sommes dans une situation où les communautés, où les habitants eux-mêmes sont en très grand repli. Ils ne s'auto-organiseront pas, il ne faut pas être romantiques ! Mais si l'on accepte le modèle d'une oppression répétitive, si l'on accepte que cela se passe là, à cet endroit, tout le temps, sans cesse, il est évident que le problème ne se réglera pas par des coups, ne se réglera pas par un débarquement de Rambos : cela ne sert à rien. C'est d'ailleurs cela qu'il faut retenir de la théorie de la vitre cassée : non pas l'idée de la tolérance zéro ou des choses de ce genre, qui sont un peu excessives, mais bien l'idée que des mesures de ce type, aussi intéressantes qu'elles soient quelquefois, seront inutiles.
Je reprends l'exemple précis de cet immeuble, parisien en l'occurrence, car il est très intéressant. Les plaintes n'aboutissent pas, c'est clair : ce sont des petites choses, comme le tapage nocturne, qui ne sont pas tellement prises en compte. Il y a pourtant, en face, un commissariat de proximité - il est fermé à vingt heures.
Alors, on pourra parler de faillite des pouvoirs publics, de faillite du politique... Bien sûr, ce n'est pas faux, mais c'est totalement insuffisant pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe dans cet immeuble, c'est aussi que les habitants eux-mêmes ont lâché complètement. Une solution technique intéressante, puisqu'il y a un problème d'intrusion classique, serait de fermer. Alors, on ferme. Sauf qu'il n'y a guère de système inviolable et que la porte électronique sert de jeu aux mômes du quartier, qui sautent dessus en position de karatéka et qui l'ouvrent. Les habitants ont donc pris une autre décision et, depuis trois semaines, il n'y a carrément plus de porte. Le bâti s'est horriblement dégradé alors qu'il venait d'être refait, etc. Mais le syndic ne fait rien, refuse d'aller voir la police, refuse de porter plainte ; et les habitants disent : « C'est au syndic de le faire. » C'est exactement comme dans les établissements scolaires où l'on nous dit : c'est au CPE de le faire, c'est au principal... C'est toujours à une autorité supérieure, c'est toujours à des spécialistes de l'ordre. Or les phénomènes d'oppression répétitive ne peuvent pas être réglés par les seuls spécialistes.
Je n'ai pas vraiment la possibilité de développer devant vous les résultats de nos recherches comparatives ; vous trouverez dans l'ouvrage qui s'intitule Violence à l'école et politiques publiques quelques éléments sur la comparaison entre la France et l'Angleterre, par exemple. Ces recherches nous montrent tout de même que, dans les deux pays, les établissements scolaires qui réussissent le mieux - et nous avons tout de même travaillé, en France, avec plus de 250 établissements, du primaire au lycée professionnel - sont d'abord des établissements auxquels, certes, la puissance publique a donné certains moyens, dans lesquels les collectivités locales ont joué leur rôle de manière intéressante, notamment en ce qui concerne la rénovation, où donc l'accent est mis sur le respect évident des bâtiments scolaires, mais que ce sont surtout des établissements où il y a une vraie équipe, où les adultes ne sont pas eux-mêmes en conflit, où les conflits d'adultes sont régulés, où l'aspect de communauté éducative est réel.
On constate également que les écoles les plus insérées dans la communauté même, dans la communauté de voisinage, sont celles qui sont le moins prises pour cibles. Je ne parle pas d'écoles ouvertes à tous les vents, ce sont des trucs baba-cool que je ne partage pas ; pourquoi pas, à la limite, dans une situation merveilleuse ! ... Mais ce n'est pas à cela que je pense, car il faut bien clore pour pouvoir ouvrir. Les écoles dont je parle sont avant tout l'objet d'un véritable travail communautaire. Je suis actuellement des expériences extrêmement intéressantes, par exemple en Hollande, aux États-Unis ou en Angleterre, sur des écoles de ce type, beaucoup plus proches, qui deviennent du coup des arguments de stabilité dans le quartier au lieu d'en être des cibles.
Vous connaissez la théorie de la disponibilité des cibles qui, je pense, est très juste. L'idée est de cesser de se focaliser simplement sur le délinquant pour se demander d'abord comment mieux protéger les victimes. Cela paraît très simple. On a beaucoup sollicité le regard des victimes, et l'on a constaté qu'il y a des mesures tout à fait techniques que, je crois, il ne faut pas hésiter à prendre ; dans l'immeuble dont je citais le cas, poser une vraie porte au lieu d'avoir retenu une solution à meilleur marché pourrait peut-être servir à quelque chose !
Pour mettre un terme à la disponibilité des cibles, il faut d'abord savoir que les personnes, mineurs ou majeurs, qui sont le plus prises pour cibles sont d'abord des gens isolés, des gens qui n'ont pas la possibilité de recourir à ce que l'on appelle les contrôles sociaux informels. Il faut donc aller vers ces solutions techniques, vers ces solutions d'aide institutionnelle, par exemple vers des gardiens qui soient des gardiens officiels. Bien entendu, il y a la police, bien entendu, il y a d'autres types de gardiens, plus préventifs ; je ne les mets pas dans la même fonction, mais bon, gardiens, éducateurs...
Je suis de ceux qui pensent que la France ne s'est pas donné les chances de la prévention. Il suffit d'observer la disproportion du nombre de familles que doit suivre une assistante sociale de secteur, par exemple, ou un éducateur de la PJJ ! C'est assez scandaleux.
Il s'agit aussi d'aider les gardiens à être des gardiens en termes d'amis, en termes de voisinage, en termes de communauté, de manière que ces gardiens ou ces communautés ne se vivent pas d'abord comme à l'extérieur de la communauté nationale, et ne se vivent pas comme : « les autres, voilà l'ennemi ».
M. le rapporteur - Vous avez souligné que le délinquant était le seul à connaître l'ensemble du système, et c'est tout à fait juste. La faiblesse des mesures, ou plutôt la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui dans leur application, n'est-elle pas due, justement, à la segmentation, au nombre d'acteurs différents ? Ne manque-t-il pas un pilote, ou disons un « fil rouge », à l'échelon non pas le plus haut, mais au contraire le plus proche du terrain ?
M. Éric Debarbieux - Je le pense très franchement.
J'ai évidemment beaucoup travaillé sur la politique de la ville, notamment pour bon nombre de municipalités. Nous mentionnons dans notre ouvrage que, très volontairement, nous avons fait figurer dans les rapports remis à certaines municipalités dix lignes qui sont chaque fois les mêmes, et chaque fois on nous a dit : « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut un coordinateur... » Le seul problème, c'est que, du coup, on a leur mis un coordinateur, et le nombre de métiers de coordination qui se sont mis en place est catastrophique ! Il y a de vrais pouvoirs de compétences, de vrais pouvoirs qui font, et c'est tout de même lamentable, que ce qui devrait créer de la proximité crée de l'éloignement.
Sur ce point, nous sommes dans une véritable impasse, ou peut-être au milieu du gué, entre une véritable décentralisation et un public qui se vit toujours comme : « Les moyens doivent venir d'en haut . » Et dans les attitudes non citoyennes, il y a aussi, je dirai, cet effet pervers du beau jacobinisme à la française.
M. le président - Monsieur, nous vous remercions.
Audition de M. Gérard MOREAU,
Conseiller-maître à la
Cour des Comptes,
de M. Rainier d'HAUSSONVILLE, auditeur,
et de Mme
Sylviane MIROUX, rapporteur
(17 avril
2002)
|
La commission d'enquête a entendu, lors d'une audition à huis clos, les magistrats de la Cour des comptes qui mènent un contrôle de la gestion des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette instruction n'étant pas terminée au moment de la publication du présent rapport, la commission a décidé de ne pas rendre publics les termes de cette audition. |
Audition de M. Thierry BARANGER,
Président de l'Association
française des magistrats
de la jeunesse et de la famille
(AFMJF),
Premier juge des enfants à Bobigny
(17 avril
2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Thierry Baranger, président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, Premier juge des enfants à Bobigny.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Monsieur Baranger.
M. Thierry Baranger - Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, mesdames, Messieurs les sénateurs, comme vous avez déjà auditionné de nombreuses personnalités, des sociologues et des magistrats notamment, je développerai un aspect plus parcellaire de la délinquance et vous exposerai mon point de vue en tant que praticien, juge des enfants, une fonction que j'exerce depuis un certain temps. De plus, grâce à l'Association française des magistrats de la jeunesse, l'AFMJF, j'ai la possibilité de voir ce qui remonte du terrain, hors de la région parisienne notamment.
Je laisserai de côté certains aspects qui ne sont certes pas négligeables mais qui n'entrent pas directement dans le cadre de votre commission d'enquête, qu'il s'agisse des difficultés que nous rencontrons, du découragement que peuvent éprouver certains juges des enfants ou d'aspects plus institutionnels, c'est-à-dire plus internes à la justice. Je pense notamment à la gestion du corps des juges des enfants, à la reconnaissance de cette fonction, à la déspécialisation rampante que nous constatons depuis quelques années ainsi qu'au problème des moyens auquel nous sommes confrontés, notamment en termes de personnels de greffe, lesquels sont, en dépit des recrutements, en nombre très insuffisant.
Tout d'abord, on peut se demander si l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est efficace. Est-elle opérationnelle ou faut-il la modifier pour tenir compte des mineurs qui commettent actuellement des actes de délinquance ?
Pour illustrer mon propos, je prendrai une image biblique, celle du pasteur et des brebis.
L'ordonnance de 1945 a été mise en place à une époque où les mineurs délinquants pouvaient s'apparenter à la brebis égarée. Le juge des enfants devait se demander pourquoi cette brebis s'était égarée et comment il pouvait la remettre dans le droit chemin. La situation actuelle est très différente. A cause d'une certaine massification des problèmes, ce n'est plus une brebis qui est égarée, mais c'est une grande partie du troupeau. A l'arrière-plan, il y a le problème de la socialisation déviante des jeunes dans certains quartiers et, faute d'une véritable prévention, celui de la délinquance massive, pour lequel la justice des mineurs est actuellement saisie.
Je n'aborderai pas ici les causes de ce phénomène qui tiennent aux évolutions profondes de la société depuis les années 1970. Des personnes beaucoup plus averties que moi pourront vous en parler, tels les sociologues Hugues Lagrange ou Irène Théry. Vous avez d'ailleurs auditionné Denis Salas, magistrat. Vous pouvez aussi vous reporter aux travaux de Christian Bachman, décédé. Toutefois, je le souligne au passage, nous devons prendre en compte ces changements si nous voulons apporter des réponses pertinentes au symptôme que constitue la délinquance des mineurs.
Je développerai d'abord différents aspects de la délinquance et je me demanderai ensuite ce que peut faire la juridiction des mineurs pour les traiter.
La massification de la délinquance que nous observons actuellement est liée à une certaine socialisation déviante des jeunes, qui s'exprime sous deux formes. Nous sommes confrontés à des petits faits, qui sont à la limite des infractions pénales -je veux parler des petites destructions, des dégradations de biens publics, des incendies ponctuels- et à des comportements hostiles, impolis ou encore irrespectueux, tels que les regards menaçants et provocateurs, les conduites gênantes, bruyantes et ostentatoires ainsi que toutes les injures. Nous déplorons notamment l'augmentation du nombre des outrages et des rebellions envers la police.
Tous ces faits se déroulent dans un espace public, dans la rue, sous le regard de tous. Or, les élus locaux peuvent constater sur le terrain que les mineurs délinquants ne font pas toujours la différence entre l'espace privé et l'espace public.
Pour ma part, je reste convaincu que de telles situations relèvent plus d'une véritable prévention que de la justice des mineurs. La prévention spécialisée, qui est malheureusement très absente du dispositif, a plus d'outils pour traiter ce type de problème que la justice. Cela vaut aussi -mais j'y reviendrai ultérieurement-, pour les institutions, à commencer par la famille, ou l'école. Peut-être pourrait-on mettre en place des commissions locales qui regrouperaient à la fois des élus de terrain et des associations de proximité. En effet, le juge des enfants doit trop souvent traiter ces problèmes, et c'est cette masse qui, d'une certaine manière, le noie.
Parallèlement, se pose le problème des économies souterraines et des trafics, qui sont, à mon avis, la forme ultime de l'isolement de certaines cités, totalement résignées à leur marginalisation. Là encore, ce n'est pas le juge des enfants qui est le plus apte à traiter ces problèmes, ni la police de proximité, qui règlera, pour sa part, les problèmes visibles. A mon avis, compte tenu du travail de terrain difficile et de longue haleine à mettre en place, ces faits devraient relever de la compétence de la police judiciaire ou d'une brigade des mineurs qui serait chargée des mineurs victimes et des mineurs délinquants. Depuis fort longtemps déjà, nous souhaitons la mise en place d'une police judiciaire à cet effet. Or, ces dernières années, nous avons observé une baisse des capacités de la police judiciaire par rapport à celles de la police de proximité.
Tels sont les deux aspects de la socialisation déviante des jeunes que j'ai observés et que le juge des enfants ne devrait pas avoir à traiter.
Nous avons l'habitude de parler de deux types de délinquance classique : la délinquance dite initiatique et les bandes. Toutefois, les choses sont plus complexes et moins rigides. On peut retrouver dans le phénomène des bandes un aspect initiatique.
On peut constater -je ne sais pas si nous disposons de statistiques en la matière, mais c'est la réalité, et tous les juges des enfants pourront le confirmer- que 70 % à 80 % des mineurs que le juge des enfants rencontre pour un délit ne recommencent pas. En revanche, tous les adolescents qui accumulent des facteurs de risques et qui se révèlent dangereux pour eux, mais aussi pour la société -il n'est plus question ici d'incivilités- posent problème.
Même si leur nombre est marginal, environ 10 % des cas que nous traitons, nous rencontrons dans nos cabinets des adolescents qui additionnent les handicaps. Ceux-ci peuvent être de différentes natures.
Les handicaps peuvent être familiaux, avec notamment des problèmes de violence familiale, scolaires -le parcours de l'adolescent peut être marqué par l'absentéisme et l'échec massif- ou encore psychologiques car la prise en charge des problèmes pédopsychiatriques fait singulièrement défaut en France. On manque en effet d'hôpitaux de jour, de centres médico-psychologiques -pour ceux qui existent, les listes d'attente sont longues- et d'internats spécialisés, sous la tutelle de la CDES, dont certains mineurs peuvent relever et pour lesquels il faut s'armer de patience pour obtenir une place.
J'ajouterai un dernier handicap qui est, à mon avis, important, c'est le handicap culturel. Ce n'est pas un hasard si une partie très importante des jeunes que nous avons à traiter et qui se retrouvent en prison sont issus de l'immigration. Il s'agit bien souvent, me semble-t-il, de familles fragiles, de parents qui ne peuvent pas dialoguer avec l'école et ne trouvent pas leur place au sein des institutions. Un travail important doit donc être fait à ce niveau.
Toutefois, je tiens à vous dire que le juge des enfants est capable de traiter les jeunes qui sont les plus en difficultés, ceux qui sont les plus dangereux mais aussi ceux qui sont les plus en souffrance. En effet, le travail du juge des enfants procède d'une démarche individuelle. Cela ne signifie pas qu'il ne doive pas oublier le contexte psychologique ou social du quartier dans lequel vit ce mineur. Je note cependant que le juge des enfants n'en a que très peu connaissance parce que les informations ne remontent pas. Le parquet, lui, en aura éventuellement connaissance, mais pas le juge des enfants. Quoi qu'il en soit, à condition qu'on lui en donne le temps, le juge des enfants a un savoir-faire pour traiter ces cas lourds et complexes.
Or, actuellement, on s'oriente de plus en plus -et c'est tout le paradoxe- vers un traitement en temps réel et une réponse judiciaire systématique à tout acte commis par un mineur.
Apporter une réponse à tout acte commis par un mineur ne me choque pas en soi, mais le fait d'y apporter une réponse judiciaire me choque. Cette situation provoque une augmentation du nombre des procédures pénales pour des faits mineurs, qui peuvent entraîner des non-lieux ou des relaxes. Les chiffres de mises en cause dont nous disposons sont très différents de ceux qui sont avancés par le ministère de la justice. A cet égard, je souhaiterais la création d'un observatoire indépendant qui puisse évaluer toutes ces questions et faire un travail de recherche. Voilà quelques années, en région parisienne, environ 30 % des dossiers que les cabinets des juges des enfants traitaient allaient au pénal et environ 70 % des dossiers étaient de l'assistance éducative et de la protection. Aujourd'hui, la situation s'est inversée : presque 60 % des affaires relèvent du pénal et 40 % de l'assistance éducative, des tutelles aux prestations sociales ou des mesures jeunes majeurs.
Cette situation conduit donc le juge des enfants à traiter des dossiers et à les évacuer. A cause de cette massification -et c'est un danger sérieux-, le juge des enfants se retrouve à traiter des faits plus banals et il n'aura donc pas le temps de se consacrer à des affaires plus lourdes qui exigent des années de travail éducatif et judiciaire.
Je ferai un autre constat. La délinquance procède moins de personnalités pathologiques que d'individualités rendues problématiques par une véritable crise de la socialisation. Nous sommes face à des jeunes qui se socialisent beaucoup plus par leurs pairs que par leurs parents. A cet égard, une sénatrice, qui était venue à mon cabinet, m'a confié que, lors de l'audience à laquelle elle avait assisté, elle avait ressenti que les parents étaient en grand désarroi. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Nous assistons non pas à leur démission, mais à leur détresse.
Je reviendrai au phénomène de bandes dont je parlais tout à l'heure. Ce ne sont pas des bandes au sens classique du terme, car il s'agit plus de regroupements territoriaux que de bandes réelles telles que nous les avons connues dans les années 1950 ou 1960. Elles présentent néanmoins, je ne le conteste pas, un caractère assez violent.
Face à tous ces problèmes, la politique du traitement en temps réel a été appliquée. Toutefois, à la lecture des enquêtes de « victimation » conduites par Sébastian Roché ou par d'autres sociologues, on s'aperçoit qu'elle présente quelques limites du fait des aléas rencontrés tant dans la détection que dans le traitement des actes de délinquance. Même si l'on doit peut-être nuancer ces études, moins de 10 % des faits délictueux seraient traités, selon Sébastian Roché, par la justice et par la police, et il s'agirait plus de délits contre les biens que contre les personnes. Ce dernier point est avéré car, avec le système de l'assurance, les victimes déposent plus facilement plainte pour leurs biens que pour elles-mêmes. Effrayées, elles hésitent bien plus à porter plainte pour elles-mêmes et il nous est très difficile de les y inciter.
En tout état de cause, ne laissons pas dire que les juges des enfants rechignent à faire du pénal. Cela était peut-être vrai dans les années 1970. Ils préféraient alors faire un travail sur le long terme et s'occuper des questions de protection du mineur au sens large du terme. C'est une époque que j'ai moi-même connue au début de ma carrière, mais elle est révolue. On ne peut plus actuellement faire ce reproche aux juges.
J'aborderai maintenant les solutions que nous pouvons apporter à la délinquance.
Je ne suis pas convaincu qu'en envoyant un message fort aux mineurs la nature de la délinquance se modifiera. Les problèmes sont beaucoup plus complexes. Ce n'est pas par une plus forte répression que le problème sera réglé. J'ai, en effet, le sentiment que les délinquants que nous rencontrons, pour une très grande majorité, ne sont pas du tout conscients de leur acte.
Par ailleurs, cessons de dire que l'ordonnance du 2 février 1945 conforterait les mineurs dans une impunité totale. En fait, ce texte me semble extrêmement souple dans la mesure où il permet au magistrat de choisir entre le répressif et l'éducatif.
Si un mineur âgé de moins de treize ans n'encourt pas de sanction pénale, il peut être, je tiens à le rappeler, responsable pénalement. Contrairement à ce qu'affirment souvent les médias, la responsabilité pénale existe avant l'âge de seize ans. Elle peut même être invoquée très tôt puisque, de plus en plus, des enfants âgés de huit ans ou neuf ans sont poursuivis au pénal. Je me demande toutefois si, à cet âge-là, un travail d'assistance éducative et de protection, conduit en coordination avec la famille, ne serait pas plus adapté.
La situation que nous connaissons n'est pas sans conséquence sur une certaine cohérence de la justice des mineurs. J'analyserai cette observation au niveau du parquet et du siège.
Ainsi, le fonctionnement de l'institution judiciaire des mineurs a été profondément modifié avec, pour le parquet, la mise en place de la « troisième voie » et de ce que l'on appelait -cette notion est beaucoup plus significative- le traitement autonome des mineurs, ainsi que, pour le siège, toutes les questions de comparution immédiate sur lesquelles je reviendrai.
S'agissant du parquet, après des débuts prometteurs, la politique dont je viens de parler a atteint ses limites. En effet, le parquet ne peut pas être l'organe de prévention de faits qui pourraient être traités en amont. Cette décision est partie d'une bonne intention, mais elle a conduit les institutions à se défausser sur la justice. Je pense notamment à certains accords, qui ont pu être passés pour des faits mineurs, entre l'Education nationale et le parquet. Si l'on a pu régler rapidement des problèmes plus graves au sein de l'Education nationale, cette situation a également entraîné le signalement de faits mineurs à l'école que l'on appelle « rackets » et qui n'en étaient pas forcément, notamment pour des petits enfants. Ce surcroît de travail a donc pénalisé le travail du parquet.
Par ailleurs, on observe une « déspécialisation » des parquets en matière de mineurs au profit de la montée de ce que l'on appelle la « territorialisation » de l'action publique. A ma connaissance, trois ou quatre tribunaux en France ont fermé les parquets des mineurs pour recentrer leur action sur des parquets fondés sur le territoire. Je pense notamment aux parquets de Nanterre, de Toulon ou d'Aix-en-Provence. Cela procède effectivement d'un choix, mais il n'est pas sans conséquence.
Pour ce qui concerne le traitement des affaires en temps réel, se pose le problème de la formation des délégués du procureur.
La mise en place de ces délégués a été tout à fait positive, mais nous n'avons malheureusement pas assez de garanties quant à leur formation et au contrôle de leur mission qui consiste à savoir si, après une rencontre avec le mineur, l'affaire peut être réglée en amont ou si, à cause d'un problème de fond plus grave, d'un dysfonctionnement plus grand au niveau de la famille, dont le délit ne serait que le symptôme, l'on doit se tourner vers le judiciaire.
S'agissant des éducateurs, je note que le contexte actuel a aussi modifié leur travail. Ils ont, de plus en plus, me semble-t-il, été utilisés à contre-emploi et sont devenus plus des conseillers chargés d'une aide à la décision que des éducateurs investis d'une véritable mission éducative, qui est un accompagnement dans le temps. Le monde éducatif se retrouve de ce fait déstabilisé.
Je m'interroge donc bien évidemment sur les conséquences induites de la dyarchie judiciaire tant dans le fonctionnement interne des juridictions des mineurs que dans l'image de l'institution à l'extérieur. Je me demande notamment comment les responsables locaux et nos concitoyens perçoivent la juridiction des mineurs. C'est une question que j'aimerais vous poser.
J'interviens dans de nombreux colloques et je m'aperçois que beaucoup confondent le procureur, le juge des enfants, l'éducateur, le délégué du procureur, le médiateur. Pour des raisons légitimes que je ne conteste pas, des solutions ont été empilées et elles ont entraîné une certaine incohérence et un manque de visibilité de notre politique. Et je ne parle pas de la communication ! La justice des mineurs aurait bien besoin d'améliorer sa communication avec l'extérieur ! En effet, on parle beaucoup des mineurs qui ne sont pas allés en prison après avoir été déféré devant le juge des enfants, mais on ne parle absolument pas des autres mesures qui peuvent être prises, notamment des mesures éducatives, des mesures de placement. On fait comme si la réponse ne pouvait s'entendre qu'en termes d'incarcération. Or, Dieu merci, d'autres réponses telles que la réparation ou le placement peuvent être très importantes.
S'agissant maintenant du siège, le traitement des affaires en temps réel a conduit à prédéterminer le type de procédure que le juge des enfants allait appliquer en fonction de la voie choisie par le parquet.
Les procédures sont nombreuses, notamment depuis 1996, lorsque M. Toubon a mis en place la comparution à délai rapproché, qui permet d'obtenir une comparution rapide, ainsi que des mesures provisoires immédiates, comme les convocations du mineur par officier de police judiciaire en vue de jugement dans un délai se situant entre un et trois mois, ce qui est, à mon avis, une réponse rapide à une transgression. On observe actuellement une explosion du nombre des mineurs déférés.
En France, en 2001, environ 8.000 mineurs ont été déférés devant les tribunaux. De plus en plus, le mineur arrive chez le juge des enfants non pas en ayant suivi la voie qui, voilà dix ans, était classique, c'est-à-dire après un courrier ou une convocation à délai différé, mais par défèrement. Ces défèrements sont positifs lorsque les faits sont graves, mais des enfants se retrouvent parfois déférés pour des faits mineurs. Cela n'a plus aucun sens, tout comme la garde à vue peut ne plus avoir de sens pour certains mineurs.
En l'espèce, je ne vois pas très bien ce que pourrait apporter l'instauration d'une comparution immédiate telle qu'elle existe pour les majeurs. Je n'y verrais comme seul intérêt que de pouvoir réprimer immédiatement l'absence de renseignements tant sur la personnalité du mineur que sur son environnement. Qui plus est, elle ébranlerait définitivement la logique de l'ordonnance de 1945.
En effet, cette ordonnance a été modifiée de nombreuses fois et elle reflète plutôt un choix de société : elle met en avant le fait de vouloir éduquer ces jeunes qui transgressent la loi pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société, plutôt que de les réprimer. Si l'on adoptait la procédure de la comparution immédiate, on retiendrait de la justice des majeurs les dispositions qui ne sont pas forcément les meilleures. Certes, la comparution immédiate des majeurs permet de régler rapidement nombre de problèmes, mais, parfois, elle n'empêche pas les récidives. La comparution immédiate ne règle pas tout fondamentalement ; elle est plus un traitement de l'instant. Elle est ce qu'elle est pour les majeurs, mais elle serait catastrophique pour les mineurs.
Autre danger de la comparution immédiate : nous en arriverions, même si je caricature quelque peu mon propos, à une justice de plus en plus virtuelle.
Ainsi, la France connaît des situations parfaitement inégales : les tribunaux de Pau ou de Montpellier ne connaissent pas les mêmes situations que ceux de Paris, de Bobigny ou de Créteil. Dans les grandes agglomérations, des délais de trois mois à quatre mois sont souvent nécessaires avant la prise en charge effective des mesures qui ont été prises par les juges, s'agissant notamment des mesures éducatives en milieu ouvert, de la liberté surveillée préjudicielle ou des mesures d'hébergement. Comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, de nombreux adolescents figurent sur des listes d'attente pour entrer dans l'établissement que les institutions leur ont préconisé. C'est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Mais se pose également le problème des décisions qui ne sont pas exécutées faute de personnels, notamment de greffes, et d'encombrement des services des tribunaux. Je pense à certains sursis avec mise à l'épreuve, mais aussi à certaines peines de prison qui ne sont pas exécutées.
Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. Il serait particulièrement grave que la justice n'aie pas les moyens de traiter les affaires qui lui sont soumises et de tenir ses engagements. Elle perdrait alors son sens et sa crédibilité. Cette perte de croyance en la justice est le vrai risque d'impunité. C'est un danger très sérieux pour notre démocratie.
Certes, je le reconnais, je vous ai dressé un constat sévère. Toutefois, j'ai de plus en plus souvent l'impression d'évacuer des stocks de dossiers plutôt que de faire le travail pour lequel je suis devenu juge des enfants. J'ai vraiment le sentiment de procéder parfois -pardonnez-moi ce terme un peu dur- à un « abattage », une notion que je ne connaissais pas, je vous l'assure, il y a une dizaine d'années. Je n'en reste pas moins convaincu de l'intérêt d'une rencontre rapide entre le juge et le mineur à condition qu'elle soit cohérente, qu'elle permette un travail qui puisse s'étaler dans le temps et qu'elle puisse aller au-delà de la sanction qui est certes nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. La réponse rapide au délit ne doit pas obligatoirement entraîner une sanction.
Faisons vraiment une distinction entre la rencontre et le jugement. Si la rencontre a lieu en même temps que le jugement, le travail éducatif ne pourra pas se faire. C'est tout le danger de la comparution immédiate, qui serait contre-productive pour le mineur sur le moyen terme.
Je le répète, je crois également -et j'y suis fortement attaché- au pari éducatif inscrit dans l'ordonnance de 1945, que je ne considère pas comme une baliverne vieille de cinquante ans, mais comme l'attitude que doit avoir un adulte face à une société en devenir. Ce n'est pas une attitude angélique : il n'est pas question de dénier toute réponse ferme et responsable face à des actes de délinquance, mais il faut faire tout le travail utile en aval de l'acte, en tenant compte notamment du contexte familial, social et, si nécessaire, culturel du mineur délinquant, sinon la sanction perdra tout son sens et sera vécue comme une simple violence sans protéger la société sur le moyen terme.
On peut, bien entendu, estimer que l'ordonnance de 1945 peut être améliorée. Je pense notamment à des modifications qui pourraient donner un coup de fouet à la mesure de réparation. C'est une mesure qui est profondément éducative et qui constitue une réponse à des actes délictueux. C'est, selon moi, la meilleure mesure de ces dix dernières années. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez utilisée, et ce pour plusieurs raisons.
Le juge, au moment où il rencontre le mineur, n'est peut-être pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus apte à savoir si c'est le bon moment d'édicter une mesure de réparation. Ainsi, l'ordonnance de 1945 pourrait envisager la possibilité pour les services éducatifs, qui interviendraient par exemple dans le cadre de la mise en place de mesures pénales telles que la liberté surveillée, de proposer au juge, à un moment donné de la procédure, une mesure de réparation. Cela favoriserait peut-être le recours à la réparation.
Par ailleurs, nous rencontrons, je ne vous le cache pas, des difficultés à l'échelon local pour trouver des lieux d'accueil où mettre en place la réparation. Il en est de même des travaux d'intérêt général. Les instances locales doivent se mobiliser pour mettre en oeuvre ces mesures, qui pourraient être développées.
L'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille a élaboré une plate-forme qui a regroupé pendant trois ou quatre mois des professionnels appartenant à différentes instances, des commissaires de police, des éducateurs, des psychologues, des juges.
Après avoir analysé la situation, nous avons formulé une quarantaine de propositions. Je vous remettrai tout à l'heure le texte que nous avons rédigé. Parmi ces propositions figure la possibilité de prendre une mesure à caractère général en matière pénale qui tiendrait compte de toutes les facettes de la personnalité du mineur, les problèmes éducatifs, familiaux qu'il rencontre, ainsi que, éventuellement, le problème économique de la famille. Un référent fil rouge assurerait la continuité et pourrait peut-être aussi prendre des contacts avec les associations locales, s'intéresser à l'environnement du délinquant, être présent lors de l'incarcération, parce que c'est un moment de rupture où l'éducatif est très souvent absent. Au cours de la détention se pose aussi la question de l'articulation entre les services éducatifs et les services de la pénitentiaire. Nous constatons que la coordination est souvent absente. Ce référent permettrait de travailler dans la continuité et dans le temps, ce qui serait tout à fait positif.
M. le président - Comme vous allez nous remettre ce dossier, peut-être pourriez-vous resserrer votre exposé, Monsieur Baranger ?
M. Thierry Baranger - Je vais faire une synthèse de mon propos.
Tout d'abord, l'ordonnance de 1945 est opérationnelle à condition que nous n'ayons pas à traiter tous les problèmes de délinquance dus à une socialisation déviante. Un travail important de prévention doit être fait en amont. S'agissant des économies souterraines et des trafics qui existent dans certains quartiers, c'est la police judiciaire qui doit être saisie.
Comme je vous l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, le juge des enfants est capable de traiter des mineurs en grandes difficultés, qui peuvent être des mineurs particulièrement dangereux. En revanche, il n'a pas les moyens -les services éducatifs non plus d'ailleurs- de traiter toute une masse d'affaires, qui sont en fait de petites transgressions, mais qui lui sont soumises parce que toutes les institutions, qu'elles soient familiales ou scolaires par exemple, n'ont pas réussi à définir un cadre. Tout adolescent ou tout enfant cherche, à un moment ou à un autre, à transgresser la loi. Cela a toujours existé. Le problème est de savoir quels cadres permettent de limiter la délinquance. Notre objectif est de remettre ces mineurs au sein d'un monde commun. Nous devons faire en sorte que ces jeunes partagent notre monde, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous nous avez dit que vous aviez plus l'impression d'évacuer des stocks de dossiers que de faire votre véritable métier.
M. Thierry Baranger - C'était une caricature !
M. le rapporteur - Certes ! Cela pose le problème du délai de la réponse que la justice apporte au délinquant. Ce délai nous semble particulièrement long. Qu'en pensez-vous ? N'y aurait-il pas d'autres réponses plus rapides que le recours à la procédure judiciaire ?
M. Thierry Baranger - Dans le traitement judiciaire ou hors du traitement judiciaire ?
M. le rapporteur - Hier, nous étions aux Pays-Bas. La procédure des Haltburö y a été mise en place pour traiter les délits mineurs. Elle permet de soulager toute la chaîne judiciaire d'un certain nombre de délits mineurs. La police présente à des éducateurs les mineurs qui ont commis des délits relativement bénins, ce qui permet de les traiter très rapidement et de désengorger toute la chaîne judiciaire.
M. Thierry Baranger - Je parlerai en mon nom personnel, parce que telle n'est pas la position de tous mes collègues.
Pour ma part, je ne serais pas choqué que de petites affaires soient traitées en amont, dans le cadre de commissions au sein desquelles siègeraient des élus locaux, des associations. La prévention et le traitement de la délinquance ne peuvent pas venir que de la justice. La justice peut intervenir en fin de chaîne, mais elle n'est pas capable de régler un problème de société. Mobiliser les structures locales en ce sens ne me choque pas ; je pense notamment aux commissions qui ont été mises en place au Portugal. Reste à en définir le cadre, et à prévoir un certain contrôle. Le parquet devrait y être représenté pour dire si, éventuellement, l'affaire examinée relève du judiciaire ou non. Personnellement, je ne suis pas opposé à une telle ouverture parce que la justice ne peut pas régler tous les problèmes de transgression des mineurs. Le problème est beaucoup plus vaste. Il y a un problème de société, un problème de cadre institutionnel, d'environnement, de famille. Il faut mobiliser tout le monde.
M. le rapporteur - Vous avez parlé des inconvénients de la comparution immédiate. La comparution à délai rapproché est-elle suffisamment utilisée ?
M. Thierry Baranger - Elle est assez utilisée.
En revanche, une mesure émanant de l'AFMJF , que M. Toubon avait retenue, qui me semble particulièrement intéressante, ne l'est pas assez, je veux parler de la césure pénale du procès. Cette mesure offre la possibilité au tribunal pour enfants ou au juge des enfants de se prononcer immédiatement sur la culpabilité du délinquant, d'indemniser les victimes et de renvoyer à quelques mois la sanction pénale. Cette mesure est particulièrement riche parce qu'elle permet de faire tout un travail éducatif. Du fait de l'embouteillage des dossiers, elle n'est toutefois pratiquement pas appliquée.
Voilà deux mois, j'ai traité d'une affaire où un mineur avait commis une trentaine de délits, c'est vraiment ce que l'on appelle un multirécidiviste. J'ai passé une journée au tribunal pour enfants uniquement pour ce mineur et j'ai appliqué cette mesure. Depuis deux mois, il n'a pas été déféré devant le tribunal. La césure pénale permet de régler la question des victimes, problème important qu'il faut pouvoir régler rapidement, de dire si le délinquant est coupable et, dans l'affirmative, de lui dire que la sanction dépendra aussi beaucoup de lui, de ce qui se passera dans les mois qui viennent. Je le répète, juger la culpabilité du mineur et prévoir la sanction le jour où le magistrat le rencontre casse toute la logique du travail qui est nécessaire. La césure est malheureusement peu employée parce que les magistrats estiment ne pas pouvoir renvoyer l'affaire dans six mois alors que de nombreux dossiers attendent.
M. le rapporteur - Que pensez-vous de la réforme en cours des services éducatifs auprès des tribunaux qui va conduire, dans la plupart des cas, ces services à ne plus être localisés au sein du tribunal ?
M. Thierry Baranger - L'AFMJF a toujours été opposée à cette mesure, estimant que la coordination entre les services éducatifs et judiciaires était fondamentale pour le travail de la juridiction des mineurs. Si les services éducatifs ne sont plus localisés au sein des tribunaux, il n'y aura plus de contact entre les juges et les éducateurs, lesquels ne pourront plus s'interpeller sur leur travail respectif. Deux logiques différentes, qui ne se retrouveront pas, se mettront en place. Or, les juges sont dans la même « galère » que les éducateurs. Ils doivent faire un travail dans le temps, qui nécessite de connaître les autres, de pouvoir échanger, de ne pas être d'accord, mais au moins de se rencontrer. Pour ma part, je me suis toujours clairement opposé à cette mesure.
M. le président - Je vais maintenant donner la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent poser des questions.
M. Jean-Jacques Hyest - Les services éducatifs dont vous venez de parler vous servaient aussi de relais pour savoir, après avoir engagé un débat, quelle structure semblait la mieux adaptée à la situation du mineur.
Nous avons appris qu'un certain nombre de structures n'étaient pas remplies mais, dans le même temps, les juges se plaignent de ne pas trouver de structure pour accueillir les jeunes. En dépit de la présence des services éducatifs au sein des tribunaux, le système semble ne pas bien fonctionner. Qu'en sera-t-il alors lorsqu'ils ne seront plus localisés au sein des tribunaux ? Ce sera pire encore ?
M. Thierry Baranger - Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest - Nombre de vos collègues nous ont dit qu'ils n'avaient pas de solutions parfaitement adaptées à la situation du mineur parce qu'ils ne trouvent pas de place. Mais, simultanément, on constate que des places sont vacantes dans un certain nombre de structures de la PJJ. Ces structures ne seraient-elles pas parfaitement adaptées aux besoins de ces mineurs délinquants ?
M. Thierry Baranger - Vous parlez des structures qui ne sont pas employées. Pour ma part, je relève plutôt qu'il est difficile de trouver des structures telles que les centres d'éducation renforcée, les CER, ou les centres de placement immédiat, les CPI, pour accueillir les délinquants. S'il y a des structures vides, nous n'en avons pas connaissance.
J'ajoute que les éducateurs au sein du tribunal sont aussi un relais avec les services éducatifs extérieurs.
M. Jean-Jacques Hyest - Tout à fait !
M. Thierry Baranger - C'est la raison pour laquelle je tiens à ce qu'ils restent localisés au sein du tribunal. Mon propos peut paraître quelque peu provocateur mais, la justice sans l'éducatif, c'est la violence. L'éducatif humanise le travail du juge, et c'est fondamental. Si l'on creuse le ravin qui est déjà, à mon avis, profond, on aura deux domaines qui n'auront plus rien à voir l'un avec l'autre.
Par ailleurs, je défends aussi l'idée d'une formation conjointe entre les éducateurs et les juges, non pas sur des thèmes, mais sur des pratiques professionnelles. Il est, en effet, très important que, d'un côté, un juge des enfants sache que tel mineur, s'il est placé dans tel établissement, risque peut-être de le déstabiliser et que, de l'autre, l'éducateur sache qu'une audience est très importante parce qu'elle est le point de départ du travail éducatif qui sera fourni ensuite. Ce face-à-face est tout à fait nécessaire.
M. Jacques Mahéas - Un grand éventail de solutions vous est proposé : les lieux de vie, les familles d'accueil, les travaux d'intérêt général, les TIG, par exemple.
La commune de Neuilly-sur-Marne est prête à accueillir de nombreux TIG ; elle n'en a eu que onze depuis un an et trois mois. Quarante personnes ont été formées à cet effet, pourtant il semble que plus personne n'assure actuellement la liaison entre le tribunal et la municipalité. Quelquefois, comme on a pu le relever, vous ne connaîtriez pas le nombre de places disponibles. L'articulation entre les services est donc mauvaise.
Vous nous dites que la réparation vous semble la meilleure solution dans la mesure où elle permet de juger rapidement et de répondre à la demande de la population. Pourquoi vos collègues ne la mettent-ils pas en place ? Rencontrent-ils une difficulté particulière ?
M. Thierry Baranger - Il leur est peut-être difficile d'avoir la connaissance du terrain. En outre, comme je l'ai déjà souligné, ce n'est pas forcément le jour de la rencontre, de la mise en examen du mineur que le juge est le plus apte à savoir s'il faut mettre en place la réparation. Ce ne sera peut-être qu'un mois plus tard, dans le cadre de la mesure éducative, qu'il se rendra compte que c'est la mesure la plus efficace pour le mineur.
Par ailleurs, même si je n'ai pas été directement confronté à ce problème, nous nous demandons si la réparation doit être mise en place dans la commune d'origine du mineur.
M. Jacques Mahéas - Je me suis battu pendant très longtemps pour qu'elle ait effectivement lieu dans la commune d'origine.
M. Thierry Baranger - C'est une question que nous nous posons tous.
M. Jacques Mahéas - Pendant très longtemps, le tribunal n'a absolument pas voulu envoyer les gens dans leur commune d'origine, arguant du fait que les élus ne feraient pas de l'éducatif, mais du répressif. Or ce n'est pas vrai. Les élus savent faire de l'éducatif.
M. Thierry Baranger - Un débat est engagé sur ce point.
Il faut dépasser le problème en organisant des rencontres. Les élus doivent pouvoir rencontrer les juges pour en débattre.
M. Jacques Mahéas - D'après vous, quelle est, au sein de la délinquance, la proportion de la délinquance économique, qui est quelquefois nécessaire à la survie, avec la mise en place d'économies parallèles, et celle de la délinquance gratuite, telles que les dégradations gratuites ?
M. Thierry Baranger - Je ne sais pas si l'on peut dire que cette délinquance est gratuite.
Par définition, l'économie souterraine et les trafics qui en découlent nous sont inconnus, et c'est tout le problème. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'un travail important devait être mené par la police judiciaire.
Ce sont plus les élus locaux qui peuvent se rendre compte qu'une autarcie règne dans certains quartiers, que des économies souterraines y sont mises en place et que des incidents y sont créés uniquement dans le but d'écarter l'existence de toute institution.
M. Jacques Mahéas - Depuis une vingtaine d'années, nous constatons une montée en puissance de la délinquance gratuite qui est surprenante.
M. Laurent Béteille - Je voudrais revenir sur le problème des délais. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, mais nous avons tout de même affaire à des enfants qui n'ont pas la même échelle du temps que nous. Juger un adulte huit mois ou un an après la commission des faits, ce n'est pas grave parce qu'il n'a pas oublié, qu'il est toujours sous pression...
M. le rapporteur - Parfois, c'est grave !
M. Laurent Béteille - Certes, mais pas toujours !
En revanche, pour un enfant, l'échelle du temps est plus étroite. La famille qui a vocation à le sanctionner le fait tout de suite. La paire de claques n'est pas donnée une semaine après, mais dès que la famille a connaissance du fait. Je me demande si le fait de prononcer une sanction quelquefois deux ans après les faits n'est pas trop tardif.
M. Thierry Baranger - C'est parfaitement inadmissible !
M. Laurent Béteille - Je ne doute pas que le tribunal de Bobigny soit plus performant, mais fréquentant un peu celui d'Evry, j'ai pu voir comment les choses s'y passaient ! J'ai l'impression que, lorsqu'elle intervient trop tard, la sanction est inefficace ou elle est comprise comme une injustice. Il faudrait envisager un système pour qu'elle intervienne plus rapidement. Cela n'exclut pas, naturellement, que se développe et que soit privilégié le côté éducatif, mais, je le répète, une sanction trop tardive est, dans le meilleur des cas, inutile, dans le pire, nuisible.
M. Thierry Baranger - J'abonde dans votre sens. Une sanction qui intervient deux ans après les faits n'a plus aucun sens pour le mineur, c'est une évidence.
Faisons toutefois une distinction entre les petits délits pour lesquels les mineurs peuvent être jugés assez rapidement -et on ne les revoit pas par la suite- et, paradoxalement, les situations particulièrement lourdes qui exigent un travail important et pour lesquelles le jugement ne doit pas être trop rapide. Je ne dis pas qu'il faille attendre deux ans, mais prononcer un jugement entre six mois et un an permet de voir l'évolution du jeune. Vous nous avez dit que les jeunes n'ont pas du tout la même conception du temps que nous ; de même, je vous dis que la situation d'un jeune peut avoir évolué un an plus tard, à condition toutefois qu'un travail éducatif ait été mis en place après la rencontre avec le juge et la mise en examen. Distinguons cette situation de celle où le délinquant qui a commis un délit ne voit personne pendant un an, ce qui est inadmissible.
Mme Nicole Borvo - Si je vous comprends bien, le délai ne doit pas être compris comme une absence totale d'intervention, mais comme le laps de temps pendant lequel la mesure éducative permettra au mineur d'accepter une sanction ultérieure.
M. Thierry Baranger - Il faut qu'il prenne conscience de son acte !
Mme Nicole Borvo - Il faut qu'il en prenne conscience et qu'il adhère à la réparation ou à des mesures coercitives.
Vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant : le judiciaire ne devrait plus avoir à traiter un certain nombre de faits. On constate, en effet, que l'école se défausse souvent sur la justice. Localement, des commissions appropriées ne pourraient-elles pas favoriser la rencontre de différents secteurs ? Nous avons auditionné des représentants des associations familiales. Ne pensez-vous pas que des familles, même si ce ne sont pas les familles concernées, pourraient être associées à cette instance qui n'existe malheureusement pas pour l'instant ? Devons-nous favoriser la participation de groupes de parents ?
M. Thierry Baranger - Tout à fait !
Ainsi, en Seine-Saint-Denis, un service éducatif mène une expérience avec les familles de trois ou quatre jeunes qui connaissent des difficultés sensiblement proches. L'idée est de mettre en place des réunions de groupes de parents pour que le travail éducatif se déroule dans un contexte collectif. Cette initiative est tout à fait positive.
M. le président - Nous vous remercions, Monsieur Baranger.
Audition de M. Christophe MÉTAIS,
Colonel, chef du bureau de police
judiciaire
à la sous-direction de l'emploi de la
gendarmerie
(17 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons procéder à l'audition du colonel Métais, chef du bureau « police judiciaire » à la sous-direction de l'emploi de la gendarmerie.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, mon colonel.
M. Christophe Métais - Mes collègues et moi-même sommes convenus d'articuler nos propos en trois temps : en ma qualité de chef du bureau de police judiciaire chargé de la statistique de la gendarmerie en matière de délinquance, je brosserai un état de la situation dans la zone gendarmerie nationale, que je rapporterai au constat national tel qu'il est établi officiellement dans les ouvrages de la Documentation française ; le colonel Petit, quant à lui, chef du bureau de police administrative-circulation routière, vous dépeindra le dispositif de la gendarmerie en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, ainsi que l'ensemble du système de partenariat ; enfin, le colonel Cachat et le lieutenant-colonel Wujkow vous parleront des violences commises en zone urbaine, des violences scolaires et des actions menées.
En ce qui me concerne, je voudrais débuter mon propos en mettant l'accent sur quelques précautions qui doivent être prises dans l'examen des chiffres.
Quand on observe les chiffres bruts, on constate une augmentation de 9,69 % de la délinquance des mineurs en zone gendarmerie pour l'année 2001. La progression atteint 5,34 % pour le premier trimestre 2002 par rapport au premier trimestre 2001. Cette évolution fait suite à une hausse de la délinquance des mineurs de 1993 à 1996, à un mouvement sinusoïdal de faible amplitude pour 1997 et 1998 et à une baisse sensible en 1999-2000. Certes, la montée de la délinquance des mineurs est bien réelle et je ne voudrais pas relativiser les chiffres, mais je souhaite essayer de mieux vous faire comprendre ce qu'ils représentent. L'évolution constatée n'est pas une fatalité.
Il faut considérer que le chiffre de 9,69 % d'augmentation de la délinquance des mineurs, qui paraît important, doit être ramené aux modifications de prise en compte statistique intervenues dans la police et la gendarmerie depuis la mise en place, en 1995, d'un guide de méthodologie visant à rapprocher les systèmes statistiques. Cette évolution a pour conséquence technique de faire apparaître une délinquance en plus forte croissance en zone gendarmerie qu'en zone police nationale.
Je voudrais également rappeler les effets de la mise en oeuvre du « guichet unique », résultant de l'application de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Il est imposé à tout service de police ou unité de gendarmerie d'enregistrer systématiquement la plainte d'une victime. Les études que nous avons menées, notamment en janvier et février 2002, nous ont amenés à observer que 7 % de la délinquance constatée en zone gendarmerie -tout fait dénoncé est enregistré sous forme de procès-verbal- provient de la zone police, c'est-à-dire que les faits ont été commis dans celle-ci mais que la première plainte a été prise en zone gendarmerie.
Il est en outre indéniable, les statistiques de l'INSEE le prouvent, que la population française s'est déplacée. On estime que 5,5 millions de personnes se sont installées en zone gendarmerie depuis cinq ans et que 1 million de personnes supplémentaires devraient encore s'y établir.
Enfin, la fidélisation mise en place en zone police nationale produit ce que nous appelons un « effet splash », à savoir un transfert de la délinquance des zones urbaines vers les zones péri-urbaines -lesquelles sont surveillées par la gendarmerie-, d'autant plus important que les activités économiques se sont déplacées du centre des villes vers leur périphérie, voire en zone rurale : j'en veux pour preuve les nouvelles zones industrielles ou commerciales implantées aux abords des villes.
Par conséquent, pour aboutir à un constat plus objectif, il serait certainement nécessaire d'évaluer l'augmentation de la délinquance des mineurs à l'échelon national, puisqu'une croissance de 9,69 % portant sur la moitié de la population française et un quart des crimes et délits constatés équivaut à un taux de 3,2 % pour la zone police nationale, où sont commis les trois quarts des crimes et délits.
J'en viens maintenant aux constats concernant la zone gendarmerie.
En premier lieu, j'évoquerai les évolutions les plus significatives sur le plan national, en me fondant sur des données générales, des statistiques par tranche d'âge et par grand type d'infractions commises par des mineurs.
En deuxième lieu, je décrirai la situation dans les vingt-trois départements déclarés prioritaires par le conseil de sécurité intérieure et dans cinq départements que la gendarmerie considère comme sensibles.
En troisième lieu, je quantifierai la part de la gendarmerie dans le total des mises en cause de mineurs.
En quatrième et dernier lieu, je repréciserai les tendances du premier trimestre 2002, qui confirment ce que l'on enregistre depuis quelques années.
En ce qui concerne tout d'abord les évolutions les plus significatives, 47.124 mineurs ont été mis en cause en 2001, contre 42.963 en 2000, soit une hausse de 9,69 %, comme je l'indiquais tout à l'heure. Dans le même temps, la proportion de mineurs dans l'ensemble des personnes mises en cause est passée, en zone gendarmerie, de 17,59 % à 19,58 %.
Cette délinquance des mineurs en zone gendarmerie se caractérise par un recours accru à la violence, que l'on parvient à quantifier notamment par le biais du décompte des cas de coups et blessures, le nombre de mineurs mis en cause pour de telles infractions étant en hausse de 31,23 %. L'augmentation est de 20,98 % pour les vols avec arme et violence et de 19 % pour les incendies volontaires.
Une seconde évolution caractéristique tient à la très légère progression de la délinquance féminine chez les mineurs, qui représente 11,01 % de la délinquance juvénile totale. Cela confirme les tendances observées depuis quelques années. Il est à souligner que, en 2001, le recours à la violence a crû davantage, en pourcentage, chez les jeunes filles que chez les garçons.
En ce qui concerne la répartition par tranche d'âge des actes de délinquance, le constat est intéressant car il ne corrobore pas entièrement certaines études réalisées ces dernières années. Je pense notamment ici à une enquête menée par M. Sébastian Roché sur la délinquance autodéclarée des jeunes, qui tendait à conclure que, entre dix et treize ans, on attente surtout à l'autorité, et que plus on s'approche de la majorité, plus on commet des infractions visant à se procurer des biens pour jouir de la vie.
Certes, nos statistiques montrent que les violences et les atteintes aux biens sont effectivement davantage le fait des jeunes âgés de seize à dix-sept ans, puisque ceux-ci sont responsables, dans notre zone, de 52,4 % des coups et blessures volontaires, de 65 % des vols avec arme et violence et de 58,76 % des cambriolages. En revanche, les atteintes aux moeurs sont plutôt le fait de jeunes âgés de treize à quinze ans, de même que les incendies volontaires et les destructions et dégradations. Quant aux infractions aux autorités et à la réglementation, elles sont dues, pour l'essentiel, aux jeunes de seize ou dix-sept ans : le taux est significatif puisqu'il est supérieur à 67 %. On peut également imputer à cette tranche d'âge la majorité des falsifications, usages de faux et abus de confiance.
D'une façon plus globale, on note un abaissement de l'âge des auteurs d'infractions, puisque l'implication des jeunes de dix à douze ans est en hausse de près de deux points et celle des adolescents âgés de treize à quinze ans de plus de quatre points, tandis que l'on constate un léger recul s'agissant des jeunes âgés de seize à dix-sept ans.
J'aborderai maintenant la situation des départements qualifiés de prioritaires par le conseil de sécurité intérieure. La gendarmerie exerce une compétence partagée en matière de police judiciaire dans vingt-trois d'entre eux, ce qui n'est plus le cas dans les trois départements de la petite couronne. Si le nombre de mineurs mis en cause dans ces vingt-trois départements était en baisse entre 1999 et 2000, il a connu une hausse de 10,43 %, donc un peu supérieure à la moyenne nationale de la zone gendarmerie, entre 2000 et 2001. Cette évolution est plus particulièrement significative en Loire-Atlantique, où la progression a atteint 39 %, soit 396 mineurs supplémentaires mis en cause, et dans l'Eure, où elle s'est élevée à 56 %, soit 386 mises en cause de plus.
S'agissant des violences en milieu scolaire enregistrées en zone gendarmerie, la croissance est exponentielle. En effet, on est passé de 1.563 faits en 1999 à 6.751 en 2000 et à 15.970 en 2001. On pense toutefois que l'importance de ces chiffres doit être appréciée à l'aune de la focalisation sur ce type de violences constatée depuis quelques années. A partir du moment où l'attention se concentre sur certains actes, ceux-ci sont beaucoup plus souvent enregistrés par nos enquêteurs. Par rapport aux violences du même ordre commises en zone urbaine, l'augmentation est d'environ 9 % sur les deux dernières années.
En ce qui concerne la comparaison entre les statistiques de la gendarmerie et les chiffres nationaux, j'indiquerai tout d'abord que 177.010 mineurs ont été mis en cause en 2001, contre 175 256 en 2000, soit une hausse de 1 % pour l'ensemble du territoire national. Quant à la proportion de mineurs dans l'ensemble des personnes mises en cause, elle varie de 21,33 % en 1999 à 21 % en 2000 et à 21,18 % en 2001. Toutefois, le pourcentage de mineurs enregistrés en 2001 est plus important, proportionnellement, en zone gendarmerie que sur l'ensemble du territoire national. La part de la gendarmerie dans le total des mises en cause de mineurs est ainsi passée de 24,51 % en 2000 à 26,62 % en 2001. Pour la même période, le pourcentage de mineurs dans la population globale des personnes mises en cause a davantage augmenté en zone gendarmerie qu'à l'échelon national, mais y reste cependant inférieur de 1,6 point.
Enfin, au cours du premier trimestre 2002, la hausse enregistrée par la gendarmerie dans sa zone de compétence s'élève à 5,34 %. On observe aussi une légère augmentation de la part des mineurs dans le total des personnes mises en cause en zone gendarmerie : 19,68 % en 2002 contre 18,51 % en 2000. La hausse du nombre de mineurs mis en cause au premier trimestre tient notamment à leur implication croissante dans les outrages à dépositaire de l'autorité -à hauteur de 48 %- et dans les vols avec arme blanche -à hauteur de plus de 28 %. En revanche, au rebours des tendances que j'avais évoquées plus tôt, la délinquance féminine est en très légère diminution chez les mineurs, puisqu'elle représente 10,28 % de la délinquance juvénile totale, contre 11,47 % en 2001.
Tels sont les principaux chiffres que je pouvais vous donner. Ils traduisent la réalité de la situation en zone gendarmerie mais doivent être relativisés au regard des statistiques nationales.
M. le rapporteur - Compte tenu de la situation que vous venez de dépeindre et des chiffres que vous avez cités, estimez-vous que la gendarmerie dispose de moyens suffisants pour assumer les fonctions de police judiciaire qui lui incombent ? Sinon, dans quel secteur le manque de moyens est-il le plus flagrant ?
M. Christophe Métais - Ma réponse comportera deux aspects : le premier concernera l'organisation et le redéploiement des effectifs ; le second aura trait au travail proprement dit des enquêteurs sous la direction des magistrats et au temps qu'ils peuvent consacrer à leur mission de police judiciaire.
S'agissant de la réorganisation des unités et du redéploiement des effectifs, c'est un sujet qui nous occupe depuis une bonne dizaine d'années. Ainsi, des protocoles qui avaient été passés entre la police nationale et la gendarmerie dans les Bouches-du-Rhône prévoyaient que, aux environs de Marseille, des secteurs qui relevaient normalement de la zone police nationale seraient surveillés par la gendarmerie. Or, entre février 2001 et février 2002, ces protocoles sont devenus caducs et l'on a constaté une baisse de la délinquance, parce que les gendarmes concernés ont pu revenir travailler dans leur zone de pleine compétence. Un travail de rationalisation et de réorganisation est sans doute à entreprendre à cet égard.
Cela étant, il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre d'évolutions se sont récemment fait jour en matière de redéploiement d'effectifs et de temps de travail quotidien. Je ne dispose pas des chiffres exacts sur ce point, qui pourront vous être communiqués par la direction de la gendarmerie, mais le temps moyen de travail quotidien du gendarme a baissé. Quant aux redéploiements, ils ont abouti à l'affectation dans des zones péri-urbaines d'un certain nombre de gendarmes d'active qui travaillaient auparavant en zones rurales. Ces mouvements ont été compensés par des gendarmes auxiliaires puis, après la disparition du service national, par des gendarmes adjoints volontaires qui n'ont pas les mêmes compétences que leurs camarades d'active en matière de police judiciaire. Par conséquent, il arrive parfois que, sur une brigade comptant six gendarmes, seuls quatre puissent vraiment intervenir. En outre, entre les repos indispensables à tout être humain et les diverses activités, il peut se produire qu'un seul gendarme soit disponible. Les questions d'organisation, d'effectifs et de redéploiement doivent donc être prises en compte.
En ce qui concerne les effectifs budgétaires qui ont été accordés ces dernières années, je ne peux pas être plus précis. Il conviendrait d'interroger le chef du bureau de l'organisation et des effectifs, qui pourrait vous donner davantage d'éléments, mais je crois que les pertes ou les « trous à l'emploi » que l'on constatait sont à peine compensés. On peut, bien sûr, toujours demander des moyens et des effectifs supplémentaires, mais plus de 130.000 fonctionnaires de police et quelque 100.000 personnels dans la gendarmerie, c'est déjà beaucoup. Peut-être faut-il plutôt se pencher sur l'approche des lieux de délinquance et le ciblage des meneurs dans certains quartiers. A cet égard, M. Sébastian Roché, dans l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure, estimait qu'environ 5 % de la population délinquante commettait de 60 % à 65 % des faits. Nos statistiques, quant à elles, ne font pas apparaître le critère de réitération : sur les 47.124 mineurs mis en cause, combien sont enregistrés plusieurs fois ?
Par ailleurs, en ce qui concerne le travail proprement dit des enquêteurs, j'ai ébauché une réponse en indiquant que ces derniers ne pouvaient pas toujours se consacrer aux tâches qui leur incombent. De surcroît, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a rendu la procédure plus complexe. L'enquêteur doit maintenant remettre une procédure écrite et en même temps tenir compte de considérations techniques d'enregistrement audiovisuel. A ce propos, je suggère d'examiner les méthodes qui ont cours dans d'autres pays. Nous avons notamment accompli une mission au Canada, où, quand un enregistrement est effectué, que la personne mise en cause soit majeure ou mineure, la procédure n'est transcrite que sur demande du magistrat. Ce serait peut-être là un moyen d'alléger le travail des enquêteurs et donc de leur éviter de rester bloqués au bureau par des tâches administratives. Ils pourraient alors être davantage présents sur le terrain pour assurer leur mission de base, à savoir la surveillance générale, intervenir et enquêter.
M. le rapporteur - Vous avez constaté une augmentation globale de la délinquance des mineurs en zone gendarmerie ; cette délinquance touche-t-elle aujourd'hui des zones qui étaient auparavant épargnées, comme certains secteurs ruraux ou péri-urbains ? Si oui, comment expliquez-vous cette évolution ?
M. Christophe Métais - Les zones péri-urbaines sont indéniablement les plus touchées. Il s'agit du transfert d'une délinquance qui est gênée dans la zone police nationale. Il conviendrait d'étudier de plus près la situation dans certains départements où la fidélisation a été mise en place : à partir du moment où l'on renforce les effectifs en zone police nationale, les délinquants se déplacent vers la zone gendarmerie. Cela apparaît très nettement sur les cartes que nous tenons.
Un peu plus à l'intérieur du territoire, dans les zones plus rurales, il me semble que les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai eu la chance de commander, de 1996 à 1999, le groupement de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie et de vivre les évolutions institutionnelles survenues à cette époque. Je me suis alors rendu compte que, dans les zones où existaient encore des structures tribales, avec des conseils des anciens et, parfois, des conseils des jeunes, les choses se passaient très bien. En revanche, dans les tribus où avaient disparu les conseils, les structures familiales et l'encadrement, y compris religieux, les jeunes étaient en rupture de scolarité et de famille : on retrouve les mêmes symptômes et les mêmes conséquences que dans certaines banlieues. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'adage de Platon, abondamment cité par les médias, selon lequel lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, c'est là le début de la tyrannie.
M. le rapporteur - Vous êtes chargé, en liaison avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de la conception d'un fichier informatique. Croyez-vous utile que les différents acteurs puissent avoir accès aux informations relatives aux mineurs délinquants ? En outre, pensez-vous qu'un tel fichier soit réalisable ?
M. Christophe Métais - Il existe déjà des fichiers de police judiciaire recensant les auteurs d'infractions et les faits qu'ils ont commis. On peut toujours imaginer de concevoir un fichier spécifique pour les mineurs mis en cause, mais je ne sais pas si cela apporterait une plus-value. En revanche, il conviendrait, à partir d'un fichier général des délinquants, de pouvoir situer géographiquement ceux-ci. On pourrait par exemple, en ce qui concerne la zone gendarmerie, descendre jusqu'à l'échelon de l'arrondissement, et peut-être, pour la zone police nationale, jusqu'à celui de la ville ou du quartier. Cela permettrait d'identifier les meneurs dans une cité, car il s'agit bien souvent de quelques personnes qui veulent affirmer leur autorité. Un grand travail de repérage de ces meneurs est à entreprendre en amont, avant d'intervenir pour les neutraliser.
M. le rapporteur - C'est en effet la préoccupation de nombre d'acteurs locaux que nous avons rencontrés. Ils nous ont dit que ce sont parfois cinq, dix ou vingt jeunes assez bien identifiés qui posent problème et que l'on arrive difficilement à maîtriser.
M. Christophe Métais - Tout à fait !
Mme Michèle André - A propos de la délinquance des jeunes filles, je ne crois bien sûr pas que le fait qu'elles deviennent les égales des garçons sur ce plan représente un progrès, mais il est clair que l'on observe une évolution. Cela étant, quelle est la répartition des délinquants entre garçons et filles, et celles-ci se livrent-elles de préférence à certains types de délinquance ?
M. Christophe Métais - En 2001, les jeunes filles ont été responsables de 11,01 % de la délinquance juvénile totale en zone gendarmerie. Elles recourent de plus en plus à la violence. L'augmentation du nombre des infractions est de plus de 33 % pour ce qui concerne les coups et blessures volontaires, et de 32 % pour les vols avec arme blanche. Ce sont des tendances, mais je crois que, en matière de statistiques, il faut prendre davantage de recul.
Mme Nicole Borvo - Mais on est parti de chiffres très faibles !
M. Laurent Béteille - Le recours croissant à la violence concerne-t-il toutes les classes d'âge ?
M. Christophe Métais - On constate une évolution dans le temps. S'agissant par exemple des coups et blessures volontaires, les jeunes âgés de dix à douze ans représentaient 2,98 % des auteurs de tels faits en 1999, mais ce taux est passé à 7,5 % ; pour la tranche d'âge de treize à quinze ans, le pourcentage a crû de 35,12 % à 47,2 % ; en revanche, on enregistre une petite diminution, de 67,12 % à 52,4 %, pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans. On observe donc un rajeunissement de cette population de délinquants.
M. Jacques Mahéas - Disposez-vous de statistiques géographiques ? Outre les causes majeures de la délinquance juvénile que l'on cite habituellement, à savoir la pauvreté, l'échec scolaire ou la crise de la famille, on a découvert que des facteurs plus surprenants intervenaient parfois, notamment l'alcoolisme des parents et des jeunes. Cette cause vous paraît-elle prendre de l'ampleur ? On sait bien que les actes délictueux se multiplient le week-end.
M. Christophe Métais - En matière de délinquance violente, en particulier d'atteintes aux personnes, l'alcool joue toujours un rôle désinhibiteur et favorise le passage à l'acte. L'état d'imprégnation alcoolique éventuel est relevé à chaque fois en cas d'atteinte aux personnes, mais nous ne détenons pas de statistiques s'agissant des autres délits. Je partage votre impression, Monsieur le sénateur, mais je ne puis vous en dire plus.
M. le rapporteur - On peut faire la même remarque à propos de la drogue.
M. Christophe Métais - L'usage de drogue est beaucoup plus répandu.
M. Jacques Mahéas - La consommation de drogue s'étend, mais l'alcoolisme reste quand même la première des toxicomanies.
M. Christophe Métais - Je ne puis fournir de chiffres sur ce point, mais l'usage de la drogue se banalise. On assiste pour le moins à une dépénalisation morale.
M. le président - Il nous reste à vous remercier, mon colonel.
Audition de M. Christian PETIT,
Colonel, chef du bureau de police
administrative-circulation routière
à la sous-direction de
l'emploi de la gendarmerie
(17 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons maintenant entendre le colonel Petit, chef du bureau de police administrative-circulation routière à la sous-direction de l'emploi de la gendarmerie, et le commandant Gamet, conseiller technique.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, mon colonel.
M. Christian Petit - Le bureau que j'ai l'honneur de diriger comporte une cellule « prévention, partenariat et politique de la ville », qui travaille sur tous les problèmes liés à la prévention, en particulier celle de la délinquance juvénile.
Je vais tenter de présenter brièvement le dispositif préventif que la gendarmerie a mis en oeuvre pour faire face aux difficultés qu'elle peut rencontrer en raison de l'émergence de la délinquance juvénile. Je tiens à rappeler que la raison d'être de la gendarmerie, qui est une force à vocation essentiellement répressive, n'est pas de faire de la prévention. Toutefois, nous avons développé cet axe, aussi bien au sein de l'institution que dans le cadre de différentes politiques locales de sécurité.
En ce qui concerne tout d'abord le dispositif mis en place au sein de l'institution, la gendarmerie est une force de proximité dont l'action est fondée sur deux grands principes : un maillage territorial, puisqu'elle dispose de 3.551 brigades territoriales, la règle étant qu'il en existe une par canton, et la polyvalence des personnels. Le gendarme est en effet un généraliste de la sécurité, qui accomplit des missions de police judiciaire, de surveillance générale, de recherche de renseignements, de protection de l'environnement, de préservation de la tranquillité publique, de contacts avec les élus, etc. Du fait de la nature de ses tâches, il est proche de la population, en particulier des jeunes, et cette proximité tend à se renforcer depuis une dizaine d'années.
Cependant, le gendarme qui, dans le cadre de la surveillance quotidienne qu'il assure, entretient ces relations, est confronté depuis quelques années à différentes difficultés qu'il ne connaissait pas auparavant.
En effet, comme l'a indiqué tout à l'heure le colonel Métais, la gendarmerie se trouve de plus en plus souvent en butte, dans sa zone de compétence, qui est plutôt à dominante rurale bien que la situation évolue rapidement, à des problèmes d'insécurité de type urbain qui n'ont longtemps concerné que les villes et leur périphérie. De surcroît, elle affronte une délinquance de plus en plus juvénile et de plus en plus mobile. Les délinquants se déplacent entre villes, banlieues et campagnes, ainsi que de leur lieu de résidence habituelle aux zones touristiques, en bord de mer ou à la montagne. Cela aussi soulève des difficultés qui étaient inconnues voilà quelques années.
Devant cette situation, la gendarmerie a estimé nécessaire de mettre en place, à partir du début des années quatre-vingt-dix, un certain nombre de structures de prévention. Cette politique a débouché sur la création des brigades de prévention de la délinquance juvénile, les BPDJ, à vocation exclusivement préventive.
Nous nous appuyons sur des dispositifs-relais dont vous avez sans doute déjà entendu parler. On trouve ainsi les formateurs-relais anti-drogue -leur installation remonte à 1990, ils sont au nombre d'environ 500 dans la gendarmerie et ont touché en 2001, au travers des conférences qu'ils ont données, 570.000 personnes, dont 350.000 jeunes d'âge scolaire- et les formateurs environnement et écologie, qui s'efforcent, par le biais de conférences, de sensibiliser le public au respect de l'environnement et de le responsabiliser en cette matière.
A côté de ces formateurs, qui portent la bonne parole aussi bien à leurs collègues qu'à la population, il existe des relais à différents échelons : les « correspondants gendarmerie-Education nationale » dans les brigades, les « correspondants jeunes » dans les arrondissements et les « référents jeunes » dans les groupements de gendarmerie. L'action de tous ces personnels vise à nouer des relations avec les différents partenaires en matière de sécurité et de traitement de la délinquance des jeunes et à mettre en place des tableaux de bord qui permettent de suivre l'évolution des phénomènes de délinquance.
Dans un autre ordre d'idées, des « référents sport » ont été installés très récemment, à la suite du développement des violences dans le sport. Ils sont répartis dans vingt-six départements considérés comme « sensibles » à cet égard. Les officiers qui assument cette fonction, laquelle s'ajoute à d'autres, constituent l'interface entre les élus et les associations sportives, d'une part, et la gendarmerie, d'autre part.
Un troisième dispositif se compose des brigades de prévention de la délinquance juvénile, qui ont été mises en place à partir de septembre 1997. Elles sont créées dans les départements les plus sensibles, et l'on en compte actuellement quarante. Leur vocation est de travailler dans les zones péri-urbaines difficiles, ce qui n'exclut bien sûr pas qu'elles puissent accomplir des missions en zone rurale. Il s'agit de petites unités, constituées de six personnels dont une femme, qui reçoivent une formation spéciale au centre de Fontainebleau et s'efforcent de retisser le lien social entre les forces de l'ordre et les jeunes des banlieues. Elles ont une mission essentielle de prévention, mais jouent aussi un rôle en matière de renseignement et de détection de signaux d'alerte. Leurs membres participent également, au titre de conseillers techniques, aux auditions de mineurs victimes, qui doivent maintenant être filmées. Enfin, ces unités s'impliquent dans tous les dispositifs de prévention existants, notamment les opérations « ville, vie, vacances », auxquelles la gendarmerie prend une part non négligeable.
On peut se demander si ces dispositifs de prévention sont réellement efficaces. Je suis incapable de vous répondre sur ce point, parce que, par définition, la prévention donne des résultats difficiles à évaluer. Nous pouvons annoncer que nous touchons un nombre « x » de personnes par le biais de nos conférences, mais il est particulièrement délicat d'affirmer que là où existent des brigades de prévention, la délinquance recule. Je ne m'engagerai donc pas dans cette voie. Nous pouvons seulement indiquer que l'activité des BPDJ varie selon l'implication des commandants de groupement et que, globalement, leur action est ressentie de façon très positive par l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse de l'Education nationale, des magistrats du parquet ou des tribunaux pour enfants.
Outre le dispositif institutionnel, la gendarmerie s'est impliquée encore davantage depuis quelques années dans un cadre contractuel. Comme je l'ai déjà relevé, une petite cellule, qui compte deux officiers et un sous-officier, s'occupe de ce domaine au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, notamment en participant aux travaux de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité, les CLS. La gendarmerie est partie intégrante de ce dispositif ; elle a signé 213 des quelques 600 CLS, soit 37 % d'entre eux. Presque tous les CLS comportent maintenant un volet relatif à la prévention de la délinquance juvénile.
Les axes de travail concernent le traitement en temps réel des infractions -mais c'est plus particulièrement le rôle de la police judiciaire-, le renforcement de la coordination entre les différents partenaires, qu'il s'agisse de l'Etat, des associations ou de la population, la mise en place d'actions de responsabilisation des parents -des problèmes se posent sur ce plan, puisque l'on crée maintenant des écoles de parents-, le développement des opérations « ville, vie, vacances », qui consistent non pas, à nos yeux, à occuper les jeunes pendant les vacances, mais à leur inculquer un certain nombre de règles en matière de respect et de comportement.
A cet égard, je voudrais évoquer un souvenir personnel. J'ai eu la chance de commander le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, département très sensible. Nous avions monté une opération « ville, vie, vacances », et mes personnels avaient été stupéfaits de voir des jeunes en danger qu'ils avaient emmenés au restaurant manger avec leurs doigts. Il s'agissait de jeunes en apparence normaux, mais il était nécessaire de leur apprendre à se servir de couverts et à ne pas manger n'importe comment, en éructant ou en bavant. Cette expérience remonte à trois ans seulement. Elle montre que, dans notre pays, on rencontre des personnes qui n'ont pas reçu l'éducation la plus élémentaire.
Quoi qu'il en soit, nous avons essayé de dresser le bilan, à notre sens très mitigé, de la mise en oeuvre des CLS, bien que le dispositif ait été instauré récemment.
Les CLS permettent aux différents acteurs de mieux se connaître et de définir une approche plus ciblée de la délinquance et des zones de délinquance. A partir du moment où il existe une « locomotive », on constate un véritable engagement des divers partenaires. Ce chef de file peut être le directeur départemental de la sécurité publique, le magistrat, le commandant du groupement de gendarmerie, le représentant du préfet, etc. Quand un tel chef de file apparaît, le dispositif fonctionne bien, mais l'application de celui-ci ne doit pas trop se prolonger dans le temps, car il est conçu pour régler un problème ponctuel ; ensuite, on passe à autre chose.
En revanche, on observe un certain nombre de carences, la principale tenant à un évident phénomène d'empilement des dispositifs, avec les CLS, les conseils communaux de prévention de la délinquance, les plans départementaux de sécurité, les plans locaux de sécurité, etc. Cela nuit à la fois à la lisibilité et à l'efficacité.
Nous sommes également engagés dans d'autres dispositifs. Je citerai simplement le protocole « gendarmerie et sécurité de l'école », qui n'est pas encore signé et qui vise à la mise en place de correspondants spéciaux dans les départements les plus exposés aux risques, qui sont généralement aussi les plus touchés par la délinquance. Nous participons également à l'action du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, ainsi qu'à la mise en oeuvre des contrats éducatifs locaux.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous intervenez dans un domaine où les acteurs sont multiples. Est-ce pour vous un frein, et quels sont, parmi ces partenaires, les plus réticents à coopérer ? Par ailleurs, vous avez mis l'accent sur l'intérêt de disposer d'une « locomotive ». N'est-il pas nécessaire qu'un « fil rouge » guide l'action ?
M. Christian Petit - En ce qui concerne nos partenaires, il est certain que, jusqu'à une époque assez récente, nous avons rencontré des difficultés avec l'Education nationale. Ce n'est un secret pour personne. En effet, pour diverses raisons, les enseignants ne souhaitaient pas voir des uniformes dans l'enceinte des établissements scolaires, qu'il s'agisse de gendarmes ou de policiers. Fort heureusement, la situation a changé. Nous sommes maintenant accueillis, même s'il existe encore de fortes réticences. Ainsi, dans le Bas-Rhin, nous avions organisé une série de conférences au sein des écoles et certains chefs d'établissement m'avaient opposé une fin de non-recevoir catégorique. C'est un peu dommage ; ce n'est pas la règle, mais cela arrive.
Je ne pense pas qu'il existe d'autre frein ; en revanche certains partenaires pourraient peut-être s'impliquer davantage. Les conseils généraux, en particulier, pourraient, à mon avis, s'engager un peu plus, notamment sur le plan financier. J'ai ainsi été amené, l'année dernière, à procéder à l'audit d'un CLS à Nancy, et une carence avait été constatée à cet égard.
Cela étant, je crois que, d'une manière globale, les différents partenaires sont assez satisfaits du fonctionnement des dispositifs, même si, en ce qui concerne les CLS, certains d'entre eux regrettent l'absence de moyens affectés. Il s'agit d'une demande récurrente émanant de nombreux élus qui pensaient que les CLS seraient dotés de crédits, voire de moyens humains. C'était d'ailleurs l'objectif visé, mais dans une optique un peu particulière puisqu'il s'agissait de recruter les fameux ALMS, les agents locaux de médiation sociale. Ces derniers ont été embauchés en nombre beaucoup moins important qu'il eût été nécessaire, et beaucoup d'élus espéraient que, en revanche, les effectifs de la police ou de la gendarmerie seraient renforcés dans les zones concernées par les CLS. Tel n'a pas été le cas ; j'ai entendu tout à l'heure le colonel Métais parler de « trous à l'emploi », et le problème est donc connu : les gendarmes adjoints n'ont pas remplacé, en nombre et en qualité, les gendarmes auxiliaires. Dès lors que l'on fait appel au volontariat, c'est inévitable.
En ce qui concerne maintenant le « pilote dans l'avion », c'est en théorie l'autorité administrative qui remplit ce rôle. Le préfet n'ayant bien sûr généralement pas le temps d'assurer personnellement le suivi du dispositif, il délègue son directeur de cabinet ou un fonctionnaire de la préfecture. Cependant, cela n'est pas satisfaisant, parce que, en raison de la multiplicité des intervenants, il est difficile de donner une ligne directrice à l'action. On voit de plus en plus souvent apparaître des coordonnateurs chargés précisément de fédérer les énergies et de rassembler les moyens. C'est sans doute une piste à explorer plus avant, mais, là encore, soit l'autorité administrative, un élu ou un magistrat désigne ce coordonnateur, soit l'on engage un contractuel qu'il faudra bien payer. On en revient donc au problème des moyens.
M. le rapporteur - Vous participez à la formation des formateurs-relais anti-drogue. Quel bilan tirez-vous de cette action de formation et quelles sont les difficultés les plus importantes que rencontrent ces formateurs ?
M. Christian Petit - Leur formation est assurée par le centre national de Fontainebleau. Cela ne présente pas de difficulté majeure ; les connaissances sont régulièrement remises à jour et ces personnels disposent de mallettes spéciales contenant tous les produits stupéfiants couramment utilisés. Leur rôle est double : il est à la fois de former d'autres militaires de la gendarmerie et, de plus en plus, de donner des conférences dans les groupements. C'est la raison pour laquelle on tend maintenant à affecter ces personnels dans les brigades de prévention de la délinquance juvénile. Chacune d'entre elles en compte un dans son effectif.
En principe, ces formateurs ne rencontrent pas de difficultés particulières lorsqu'ils prononcent leurs conférences. Les jeunes sont en général attentifs, posent des questions. L'adjudant qui commandait la BPDJ à Strasbourg me disait que certains d'entre eux étaient très étonnés d'apprendre que le shit, c'était, en quelque sorte, passez-moi l'expression, de la « merde de chameau ». Cette découverte les écoeurait et cela suffisait parfois à enrayer leurs velléités. Le besoin d'information de notre jeunesse est donc manifestement très important, et ce dès le très jeune âge. Ainsi, nous organisons des conférences sur le racket ou l'incivilité dans des classes de cours moyen, c'est-à-dire pour des enfants de huit à dix ans. Pour informer les jeunes et les dissuader de s'engager dans la délinquance, il faut s'y prendre assez tôt.
M. Jacques Mahéas - Je voudrais poser une question sur l'insécurité et la délinquance routière.
Un permis pour les mobylettes a été mis en place, et j'ai eu l'occasion d'en remettre un certain nombre. Souvent, lorsque je disais à ces jeunes :« Maintenant, vous allez pouvoir conduire une mobylette », j'observais quelques sourires.
J'aimerais savoir si la gendarmerie et la police opèrent des contrôles dans ce domaine. Menez-vous une action spécifique, en sanctionnant les jeunes qui ne sont pas en possession de ce permis spécial ? Je rappelle qu'en mobylette et en moto on a onze fois plus de risques de se tuer qu'en voiture.
M. Christian Petit - Tout d'abord, ce permis est extrêmement récent. Il se situe dans un dispositif d'ensemble qui vise à faire acquérir aux jeunes un certain nombre de brevets ou de diplômes à travers plusieurs étapes qui mènent au permis de conduire, ces étapes étant obligatoires. Honnêtement, nous ne menons pas d'actions particulières dans ce domaine. Mais, face aux excès, nous menons des opérations ciblées essentiellement sur le bruit. En effet, les citoyens se plaignent beaucoup du bruit de certaines mobylettes sur lesquelles sont installés des dispositifs normalement destinés aux mobylettes de compétition. Il y a donc, à cet égard, une certaine hypocrisie.
Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai acheté un scooter à mon fils. La première chose que m'a demandée le détaillant était : « Est-ce que je vous débride le moteur ? » Il ne savait pas que j'étais gendarme. Je lui ai dit ma façon de penser. L'hypocrisie tient à ces fameux kits qui font du bruit. Nous pourrions certainement agir dans ce domaine. La vente libre de ces appareils ne devrait pas être autorisée sous prétexte qu'ils sont réservés aux mobylettes de compétition. On sait parfaitement que n'importe qui peut les acheter et les installer. Un certain nombre d'évolutions réglementaires sont en cours et concernent notamment l'immatriculation des deux-roues. Cette mesure simplifiera certainement notre travail.
Dans la pratique, quelle est la situation ? Imaginez deux gendarmes en voiture, dans leur 4L, leur Clio ou leur 206. Ils voient un jeune qui slalome entre les voitures avec sa mobylette. Même s'ils ont la volonté de verbaliser, que peuvent-ils faire ? A la limite, s'ils sont très sportifs et s'ils courent très vite, ils peuvent se lancer à la poursuite du jeune. Sinon, malheureusement, ils ne peuvent que déplorer une telle attitude. La problématique de l'adéquation des moyens de la gendarmerie à ses charges se trouve posée, comme celle de l'adaptabilité des personnes à la loi, ou l'inverse. En effet, il n'est pas toujours très simple d'appliquer les lois qui sont votées. C'est même parfois très difficile. Il faut systématiquement se poser la question :« Les gens qui vont être chargés d'appliquer cette loi, vont-ils pouvoir l'appliquer correctement ? » S'il y a un doute, il faut songer à simplifier les procédures. A nos yeux, beaucoup de procédures, qu'il s'agisse des procédures judiciaires ou administratives sont extrêmement complexes. Le temps passé à vérifier que nous avons bien respecté tel ou tel article de loi, nous ne le passons pas sur le terrain à contrôler les permis pour mobylette, les assurances et les comportements des conducteurs.
M. le président - Je vous remercie, messieurs.
Audition de M. Guy CACHAT,
Colonel, chef du bureau de
renseignement-violences urbaines
à la sous-direction de la
gendarmerie
et de M. Alex WUJKOW,
Lieutenant-colonel, chef du bureau
animation-coordination
à la sous-direction des opérations de
la gendarmerie
(17 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre le colonel Cachat, chef du bureau « renseignement-violences urbaines » à la sous-direction de la gendarmerie, ainsi que du lieutenant-colonel Wujkow, chef du bureau animation-coordination à la sous-direction de la gendarmerie.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Monsieur Cachat.
M. Guy Cachat - En propos liminaire, je tiens à préciser que mon bureau de renseignement s'occupe des violences urbaines, mais que cette préoccupation ne représente qu'une part infime de son activité. Les quelques travaux que je vous remettrai à la fin de mon audition ne sont pas exhaustifs ; c'est le reflet d'une partie marginale de l'activité.
Dans mon intervention, je parlerai en tant que chef du bureau de renseignement de la Direction générale de la gendarmerie nationale, la DGN. J'ai le regret d'annoncer dès à présent qu'une grande partie de mes propos risque d'être hors du sujet de l'enquête que vous êtes en train de mener. En effet, mon bureau ne suit le phénomène des violences urbaines que de manière marginale et, surtout, sans discriminer l'âge des auteurs ou des victimes. Les chiffres que je vais vous présenter sont donc à considérer avec beaucoup de précautions. En effet, même si les jeunes sont fortement impliqués dans les violences urbaines, il n'est pas possible de déterminer exactement dans quelles proportions, parce que nous ne discriminons pas l'âge des agresseurs et que, très fréquemment, les auteurs des divers jets de pierre, incendies de véhicules ou de poubelles demeurent inconnus.
Les faits recensés, pour entrer dans la catégorie des violences urbaines, doivent présenter quelques caractéristiques : ils doivent se dérouler dans des quartiers sensibles ou jugés tels et être commis en bande, c'est-à-dire à plus de deux. Ainsi, pour les incendies de véhicules, nous excluons de la catégorie des violences urbaines les véhicules incendiés qui ont précédemment servi à un délit, voire qui ont fait l'objet d'une escroquerie à l'assurance. Ce suivi ne constitue pas une comptabilité exacte du phénomène. Il tend à déterminer les grandes tendances et surtout à délimiter les secteurs géographiques les plus sensibles, dans un strict objectif opérationnel, en vue de répartir les moyens de la manière la plus opportune.
Au niveau national, dans sa zone de compétence, la gendarmerie suit le phénomène des violences urbaines depuis le milieu de l'année 1996. Si la croissance des trois premières années apparaît comme tout à fait exponentielle -le terme me paraît parfaitement applicable-, c'est, bien sûr, lié à un développement du phénomène lui-même, mais aussi, très largement, à sa prise en compte progressive dans les unités de terrain. Les chiffres des trois premières années, à mon avis, doivent être relativisés.
Ainsi, de 1997 à 1999, le nombre des faits est passé de 800 à 4300, soit une multiplication par cinq du phénomène, due, je le répète, à la conjonction des deux facteurs que je viens d'exposer. Néanmoins, à partir de l'année 2000, on peut considérer que la part liée au facteur de saisie interne devient marginale. Nous constatons alors que l'évolution se poursuit très largement. En 2000, nous recensons 7100 faits et, en fin d'année 2001, nous en sommes à 12.600 faits.
Dans ce cadre, quelques données méritent, à mon avis, de retenir l'attention. Les atteintes contre les forces de l'ordre et leurs moyens -je ne retiendrai pas les chiffres antérieurs à l'année 2000, qui ne me paraissent pas significatifs- représentent 390 faits en 2000 et 560 en 2001. Les incendies de véhicules ont quasiment doublé entre 2000 et 2001, pour atteindre, en fin d'année 2001, 4000 faits annuels. En moyenne, onze véhicules sont incendiés chaque jour dans le cadre des violences urbaines. Si je considère les trois premiers mois de l'année 2002 et que j'en fait une projection sur l'année, j'obtiens une moyenne de quatorze véhicules incendiés par jour dans le cadre des violences urbaines. Ce phénomène touche donc largement le secteur de la gendarmerie.
Les violences urbaines en milieu scolaire méritent également de retenir l'attention. Depuis deux ans, elles se stabilisent pour atteindre quelque 800 faits. Ce chiffre est nettement inférieur à celui que vous a présenté précédemment le colonel Métais. Cependant, ces deux chiffres ne sont pas discordants. En effet, à titre d'exemple, mon bureau ne prend pas en compte les cambriolages dans les écoles, qui sont une délinquance d'appropriation et qui, à ce titre, ne rentrent pas dans le cadre des violences urbaines. A contrario, nous prenons en compte toutes les dégradations des salles de classe ou des cours d'école. Nous recensons également les rackets ou les menaces lorsque ces actes sont le fait d'une bande. Le racket d'un jeune par un autre jeune n'est donc pas considéré comme une violence urbaine. Cette nuance peut paraître un peu ésotérique, mais elle est prise en compte.
Je vais essayer de vous donner brièvement mon sentiment sur les causes de cette croissance.
La première de ces causes est, indubitablement, une extension de la zone périurbaine, qui est une zone de compétence de la gendarmerie. En moins de dix ans, cette population a augmenté d'un million d'habitants environ. La population de la zone de la police nationale s'est déplacée vers la zone de la gendarmerie. L'augmentation des forces de sécurité dans la zone de la police nationale, qu'il s'agisse de la police d'Etat, de la police municipale ou des emplois-jeunes, entraîne de facto un déplacement de la délinquance vers la zone périurbaine de la gendarmerie. Cette observation, pour politiquement incorrecte qu'elle soit, n'en est pas moins clairement vérifiée sur le terrain.
La deuxième explication de la croissance des violences urbaines est induite par la première. La proximité des différentes zones crée un phénomène de contagion. Les jeunes des villes ou villages qui jouxtent les grandes agglomérations étudient dans ces grandes agglomérations, y passent leurs loisirs et introduisent en zone rurale le mode de vie qu'ils ont côtoyé en milieu urbain.
La troisième et dernière explication concerne les petites villes ou petits villages isolés. S'ils sont également touchés par le phénomène des violences urbaines, c'est par pur mimétisme. La contagion est alors véhiculée prioritairement par les médias. Je donnerai deux exemples. J'ai vécu le premier en tant que commandant opérationnel sur le terrain. Le 30 novembre 1997, dans une commune du Cher de 6.000 habitants, cinq jeunes, dont deux mineurs de quinze et dix-sept ans, renversent deux véhicules et dégradent gravement quinze autres, uniquement pour faire comme on fait dans les grandes villes. Cet exemple m'apparaît intéressant à deux titres. Pour la gendarmerie, il est clair qu'il s'agit de violences urbaines. Cependant, l'implication des mineurs est relative : sur les cinq auteurs, deux seulement étaient mineurs. Nous le savons parce qu'ils ont été appréhendés. S'ils n'avaient pas été appréhendés, nous n'aurions pas pu vous apporter ces chiffres.
A Buneville, dans les Vosges, village totalement isolé de 1.200 habitants, en une seule nuit, les pneus de dix véhicules stationnés sur la voie publique ont été crevés. Dans ce cas, nous n'avons pas réussi à appréhender les auteurs.
En conclusion, je dirai simplement que la zone gendarmerie est largement touchée par les violences urbaines. Celles-ci caractérisent de moins en moins des zones géographiques. Il s'agit d'une violence démonstrative et gratuite qui se généralise sur l'ensemble du territoire. Il est clair, pour nous, que les jeunes en sont très largement responsables. Mais les données que possède la gendarmerie ne permettent pas de déterminer la proportion de ces jeunes dans le cadre des violences urbaines.
M. le président - Monsieur Wujkow, vous avez la parole.
M. Alex Wujkow - Mon travail de direction au sein du bureau de l'animation et de la coordination consiste essentiellement à faire remonter du terrain les informations de la police judiciaire, qui concernent la délinquance et la criminalité, via nos bureaux en région. Nous avons actuellement sept régions de gendarmerie. Nous nous appuyons donc sur les bureaux régionaux de la police judiciaire pour faire remonter les informations, de façon à mettre en place les moyens les plus appropriés pour prévenir la délinquance et, surtout, la criminalité. Lorsque, malheureusement, nous ne pouvons pas faire face, nous nous efforçons de mettre en oeuvre les moyens les plus appropriés pour constater les infractions -je cite l'article 14 du code de procédure pénale : « rassembler les preuves, arrêter les auteurs et les déférer à la justic e ».
La délinquance des mineurs est un fait. Le colonel Métais vous a dit qu'elle avait augmenté de 9,69 %. On constate donc une forte poussée de la délinquance en 2001, poussée d'ailleurs confirmée en 2002. Nous devons également nous interroger sur le rajeunissement des mineurs en cause. En effet, la tranche des treize-quinze ans est la plus représentée, notamment dans des affaires de moeurs. En revanche, le nombre des mineurs âgés de seize à dix-sept ans impliqués dans des violences diminue, ce qui pourrait nous faire plaisir. Mais mon bureau les retrouve dans le cadre des infractions les plus graves, les coups et blessures volontaires et les infractions qualifiées, c'est-à-dire les vols à main armée. Un effort de prévention doit donc être fait en faveur de la tranche d'âge des treize-quinze ans et de la tranche d'âge inférieure. En effet, dès que cette tranche intermédiaire et celle des jeunes majeurs sont impliquées, on les retrouve immédiatement dans la criminalité organisée.
Le dispositif de la gendarmerie en place actuellement s'appuie, bien sûr, sur une organisation départementale : prévention, lutte contre la petite délinquance par nos brigades territoriales dont nous possédons 3.600 unités et qui constituent le maillage territorial.
La police judiciaire dispose, au sein de chaque arrondissement, c'est-à-dire de chaque sous-préfecture, de deux brigades de recherche. Actuellement, nous en avons environ 300 et bientôt toutes les compagnies seront dotées d'une brigade de recherche. Pour faire face à la grande délinquance et à la criminalité qui commencent à toucher notre jeunesse, nous disposons de trente sections de recherche, c'est-à-dire d'une section par cour d'appel.
Le colonel Cachat a évoqué tout à l'heure un transfert. Il se fait, à mon sens, à deux niveaux. On observe tout d'abord un transfert de population de la zone urbaine vers la zone rurale. Mais il existe aussi un transfert d'activités : la ville ne peut plus contenir les centres commerciaux et industriels, qui sont déplacés là où il y a de la place, c'est-à-dire dans la proche périphérie des grandes villes, en zone de compétence de la gendarmerie. On observe également un transfert de délinquance. Par exemple, lorsque nous constatons une augmentation de la criminalité dans le secteur bancaire, nous rencontrons immédiatement les professionnels. Ces rencontres sont bien institutionnalisées. Or le milieu bancaire a commencé à s'équiper pour assurer sa propre sécurité. Que constate-t-on ? Malgré une légère augmentation en 2001 dans la zone de compétence de la gendarmerie, on observe depuis cinq ans une nette diminution des vols à main armée dans les banques. Mais il y a un transfert, car la nature a horreur du vide. Les personnes qui ne peuvent plus aller voler dans les banques vont dans les supermarchés. Quand elles ne pourront plus aller dans les supermarchés, il y a tout à parier qu'elles attaqueront les personnes âgées qui ne peuvent pas courir et qui sont donc faciles à dévaliser.
Ce transfert des actions délinquantes apparaît nettement. Il est d'autant plus grave qu'il intéresse un nombre croissant de personnes, notamment de jeunes. S'il est très difficile d'entrer dans une banque pour y prendre plusieurs centaines de milliers de francs, il est très facile en revanche de s'emparer, à la campagne, d'une poignée d'euros dans un bar-tabac, tenu quelquefois par une personne âgée.
Ce transfert de la population et des infractions est particulièrement inquiétant au regard de la délinquance des mineurs.
Que la zone relève de la police ou de la gendarmerie, ce n'est pas le sujet, car personne n'est réellement propriétaire de « sa » délinquance. Aujourd'hui, la délinquance est extrêmement mobile. Elle touche les majeurs et les mineurs. Le colonel Cachat vous disait que beaucoup de jeunes allaient au lycée en ville et vivaient à la compagne. Si on habite la campagne, on va au bowling à la ville et à la rave party en bordure des grandes villes.
Le dispositif de la gendarmerie s'appuie sur des moyens spécialisés qui sont, peut-être, la vocation de mon bureau. Je ne dispose pas de statistiques particulières sur la délinquance des mineurs puisque cette mission revient au colonel Métais. Je constate cependant qu'il n'existe pas, actuellement, de structures d'enquête nous conduisant à nous intéresser spécifiquement à des mineurs, y compris sur des affaires de criminalité organisée. Celle-ci, qu'elle touche les stupéfiants, les vols de voitures, la contrefaçon, les vols de fret ou la délinquance d'appropriation alimente une économie parallèle et souterraine dans les cités.
J'aurais peut-être dû évoquer l'appareil législatif et décliner, à l'intérieur de cet appareil, l'appareil gendarmerie. Bien évidemment, la police judiciaire est dirigée par les magistrats, notamment les procureurs de la République. La gendarmerie s'appuie donc sur le dispositif législatif pour lutter contre la délinquance des mineurs et des majeurs.
En conclusion, je souhaiterais insister sur deux idées.
La première, c'est qu'il ne doit pas y avoir de message brouillé. La gendarmerie est une force de prévention et d'action répressive. Ces deux missions doivent être conduites avec humanité. La vocation de la gendarmerie et de nos unités dans le domaine judiciaire est la suivante : prévenir et guérir. Quant à la justice, elle poursuit les infractions, instruit, juge et exécute les peines. Les services sociaux, de leur côté, mettent en place une politique sociale. On ne peut pas demander à l'acteur gendarmerie d'agir sur les trois créneaux en même temps.
Ma deuxième idée est qu'il ne faut pas démotiver nos agents et nos officiers de la police judiciaire qui travaillent dans les unités de recherche. Aujourd'hui, leur rythme de travail est évalué -sincèrement- à plus de douze heures de travail par jour. Ces personnels sont extrêmement motivés. Il est hors de question, pour eux, à l'heure actuelle -et j'espère que cela durera le plus longtemps possible- de « décrocher », d'arrêter une enquête qui leur a été confiée. Ils s'impliquent et se font un devoir et un honneur de rassembler les preuves et d'élucider une affaire.
Nous disposons aujourd'hui d'un arsenal réglementaire et législatif qui, je pense, est relativement confortable. Il ne servirait sans doute à rien de prendre de nouvelles dispositions si les textes précédents ne sont pas appliqués.
Les mineurs que nous rencontrons et que nous entendons sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Certes, ils ne maîtrisent pas les termes juridiques, mais ils savent très bien que, lorsqu'une infraction est punie de trois ans d'emprisonnement, son auteur ne subira jamais trois ans d'emprisonnement. Aucun tribunal n'a prononcé ces trois ans. Et quand bien même il prononcerait une telle peine, il serait difficile de l'exécuter.
En dernier lieu, il convient de veiller à l'utilisation des mineurs par les majeurs, notamment ce qui concerne la délinquance d'appropriation. A l'évidence, la minorité est une notion bien maîtrisée par les mineurs mais aussi par les majeurs. Veillons à ce que les majeurs ne se servent pas des mineurs pour commettre certains vols. En effet, le mineur interpellé échappera en grande partie à la sanction et le butin reviendra au majeur.
M. le président - Messieurs, vos propos reprenaient un ensemble de propositions que j'avais présentées en tant que rapporteur sur des textes précédents. Je m'aperçois que mes idées cheminent, y compris chez ceux qui y étaient assez farouchement opposés. Gardons donc espoir !
M. Alex Wujkow - Il faut laisser le temps au temps.
M. Jean-Jacques Hyest - Vous avez bien décrit le déplacement des violences urbaines vers la zone de gendarmerie. En ce qui concerne les outils d'analyse de la délinquance en zone périurbaine, existe-t-il une base unique de recensement ? Vous savez qu'un problème de statistiques oppose la gendarmerie à la police nationale. Certes, des efforts ont été faits, des protocoles signés. Rencontrez-vous les services de police pour essayer d'analyser en commun, à partir de bases communes, ces statistiques ?
M. Guy Cachat - Je vais répondre à votre question de deux manières.
Tout d'abord, il n'y a pas de cohérence totale entre la saisie de la police et celle de la gendarmerie. En effet, les Renseignements généraux ont été précurseurs en matière de statistiques des violences urbaines. Ils avaient commencé à les prendre en compte bien avant 1995. Lorsque la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, a pris en compte l'analyse des violences urbaines, elle a utilisé son propre logiciel, appelé SAIVU. De son côté, la gendarmerie a utilisé un autre logiciel. Voilà trois ans, quand j'ai pris la direction de ce bureau, je me suis posé la même question que vous : les violences urbaines constatées par la gendarmerie sont-elles totalement identiques à celles de la zone urbaine ? Je ne suis pas capable de répondre à cette première question.
Ensuite, j'ai estimé que, si je changeais mon système de saisie de données, toutes les données des années antécédentes devenaient caduques. Ce point constituait pour moi un obstacle majeur puisque, alors, je n'aurais plus disposé d'historique ni de références. Or mon rôle -et le politique dans ce domaine ne nous donne aucune directive- est de dégager de grandes tendances. Si je changeais la prise en compte des données, je repartais de zéro. Mais il faudra peut-être le faire un jour ou l'autre, c'est clair.
Ma deuxième observation concerne le logiciel SAIVU. Bien que je sois très mal placé pour parler d'une maison qui n'est pas la mienne, je pense que ce logiciel est certainement plus performant que le nôtre mais qu'il présente un écueil majeur. En effet, il est très consommateur en personnel, alors que notre logiciel nous permet de ne pas extraire du personnel de terrain pour réaliser la saisie.
En conclusion, et en essayant de ne pas faire preuve d'étroitesse d'esprit, je pense que l'Observatoire de la délinquance, en particulier avec le rapport Pandraud-Caresche, nous imposera, certainement, une prise en compte homogène.
M. Jean-Jacques Hyest - En matière de délinquance des mineurs, vous dites qu'on observe à la fois une délinquance propre aux mineurs et un développement de l'utilisation des mineurs pour des formes de délinquance organisée.
M. Alex Wujkow - Les mineurs sont surtout utilisés pour des délinquances d'appropriation. Le majeur qui fait agir le mineur pour son compte sait que, lorsque le mineur sera interpellé, il ne risque pas grand-chose. S'il est clandestin sur notre sol, par exemple, il sera placé dans un foyer ouvert, d'où il pourra aussitôt s'échapper, sachant qu'il ne risque même pas une expulsion, car il finit par bien comprendre la loi du pays qui l'accueille.
Pour lutter contre la grande délinquance ou la criminalité organisée, nous mettons en place, soit des groupes d'enquêteurs, soit des cellules d'enquête. Dès que nous détectons, dans une région, un phénomène particulier touchant les vols et les trafics de véhicules ou les vols dans les mairies, comme c'était le cas dans le centre de la France récemment...
M. Jean-Jacques Hyest - Pas seulement dans le centre de la France !
M. Alex Wujkow - ... ou dans un département que vous connaissez bien. Nous avons pu, grâce à certaines arrestations, élucider plusieurs centaines de cambriolages dans les mairies. Dans de tels cas, nous mettons en place une structure propre pour lutter contre le phénomène. Nous désignons un officier qui devient chef de cellule, directeur des opérations, ou un officier d'une section de recherche ou encore un sous-officier supérieur d'une brigade départementale, qui devient directeur d'enquête. Nous lui donnons une dizaine d'enquêteurs ainsi que les moyens logistiques et financiers pour travailler. Ces enquêteurs sont réservés aux phénomènes régionaux ou nationaux.
Mon bureau est impliqué dans ces actions, en liaison avec le centre de documentation de Rosny-sous-Bois, le STERJD. Nous procédons aux analyses, y compris à l'analyse criminelle et à l'analyse criminelle stratégique, pour déterminer si le problème est cyclique et si on risque de le retrouver à certains endroits durant certaines périodes.
Au cours des opérations judiciaires, nous ciblons les équipes de malfaiteurs et rassemblons les preuves en amont. En effet, avec le renforcement de la présomption d'innocence, les enquêteurs sont conduits et c'est certainement très bien- à faire en amont un travail de « rassemblement de la preuve », qui est particulièrement long et difficile. Certes, la police judiciaire n'a pas de prix et l'élucidation d'une affaire non plus, mais elle a quand même un coût. Nous nous efforçons de réduire les coûts parce que les budgets ne sont pas toujours à la hauteur nécessaire. Une fois le travail effectué, nous nous apercevons -c'est le cas d'une affaire récente de vols avec violence- que, sur trente personnes arrêtées, dix sont mineures. Il s'agissait de vols de scooters et de vols de voitures, qui partaient à l'étranger. Des mineurs étaient rémunérés à la commande pour pouvoir alimenter ce trafic.
M. le président - La gendarmerie, par sa structure hiérarchique, arrive très bien, en fin de compte, à coordonner ses moyens. Vous avez dit que des sections de recherche se constituaient pour les grandes affaires. On a pu constater, d'ailleurs, que des affaires extrêmement complexes qui touchaient plusieurs régions, notamment l'affaire du pillage des banques et de l'arrachage de distributeurs automatiques de billets, dans le sud-ouest, avait nécessité la mise en oeuvre de gros moyens. La gendarmerie y a pourvu.
Cette coordination est-elle aussi facile avec les autres services concernés, surtout quand il existe plusieurs services de police judiciaire, comme cela arrive parfois ?
Au niveau de la territorialisation des moyens de la justice, comment cela se passe-t-il pour les mineurs ?
M. Alex Wujkow - En ce qui concerne l'échange d'informations et la coordination avec les autres services, qu'il s'agisse de la douane ou de la police nationale, nous ne rencontrons pas de difficultés majeures. On relève bien, çà et là, quelques points de friction qui tiennent davantage à des problèmes humains qu'à des problèmes de structures. Ces frictions amusent plus les journalistes que les enquêteurs eux-mêmes. On fait un bon film sur le thème de la guerre des polices, alors que, franchement, sur le terrain, ce n'est plus une réalité. La coordination entre les services existe. Au niveau régional, elle dépend des sections de recherche. Parmi les attributions du commandant de la section de recherche figure l'échange d'informations avec son homologue du service régional de police judiciaire.
Mon bureau organise au niveau central l'échange d'informations entre les différents services, qu'il s'agisse des Renseignements généraux, de la DST ou de la DNAT pour tout ce qui touche au terrorisme -dans ce domaine, on traite une criminalité particulière qui est certainement la plus grave- mais également des autres services de la police nationale, comme la préfecture de police ou les offices de la direction centrale de la police judiciaire. Lorsqu'un problème de « conflit de compétences » nous est soumis, c'est-à-dire quand un service fait valoir qu'il a obtenu le renseignement le premier ou qu'il a plus de saisines que les autres, le chef de l'office concerné et un personnel de mon bureau, qui est souvent le chef de l'animation judiciaire, se rencontrent. Depuis trois ans que je dirige ce bureau, nous avons toujours trouvé une sortie honorable pour les gendarmes comme pour les policiers.
En ce qui concerne la territorialisation des moyens de la justice, vous voulez certainement parler du regroupement des procédures, qui pose un problème plus délicat. La règle veut que le magistrat qui est saisi conduise son dossier jusqu'au bout, sauf dans certains cas qui, malheureusement, sont minoritaires. Encore faut-il que tous les magistrats instructeurs aient bouclé leur dossier. En outre, ce n'est qu'au niveau des curriculum vitae que le magistrat saisi va récupérer l'ensemble. Pour ce qui concerne la recherche de la preuve, chaque magistrat s'occupe de son dossier et ne le transmet qu'une fois achevé au magistrat qui le récupère.
Pour les dossiers de vols à main armée, relativement simples à constituer, la preuve s'obtient par des moyens de surveillance habituels, la génétique ou les empreintes. Pour d'autres dossiers, notamment ceux qui portent sur des phénomènes nationaux à répétition de moindre importance, il se trouve peu de magistrats -et ce n'est pas mal que de le dire- pour récupérer l'ensemble des saisines qui existent à l'échelon national. Du reste, le voudraient-ils, qu'ils ne le pourraient pas. En effet, la loi ne le permet pas dans la plupart des cas.
Audition de M. Jean-Pierre ROSENCZVEIG,
Président du tribunal pour
enfants de Bobigny
(17 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, Monsieur Rosenczveig.
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Je ne sais pas si je vais dire la vérité, mais je vais dire ma vérité.
Je vous remercie de procéder à mon audition. Vous avez entendu M. Baranger tout à l'heure, qui est premier juge des enfants à Bobigny et, surtout, président de l'association des magistrats de la jeunesse. Nous avons pu recevoir certains d'entre vous au tribunal pour essayer de leur montrer in vivo ce qui se passait et comment nous réagissions.
J'ai apporté un support diaporama que je vais essayer de suivre. C'est une première pour moi.
Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par les officiers de gendarmerie que j'ai pu entendre, il y a une réalité de la délinquance, de l'insécurité, mais aussi un sentiment d'insécurité dans certains endroits où il n'y pas de problèmes. On dit un peu trop rapidement que les jeunes, les mineurs notamment, sont responsables de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, de tous les maux de la société. Cela ne me surprend pas dans un pays que je trouve vieillissant. La fracture sociale est béante et nous sommes loin d'en avoir payé tous les « impacts ». Les limites de la politique d'intégration sont évidentes, j'aurai l'occasion d'y revenir.
S'il est vrai que l'on « charge la barque » des jeunes délinquants de ce pays, il n'empêche qu'il existe quelques éléments sur lesquels nous pouvons nous entendre, en apportant certaines nuances à nos propos. C'est d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice. Il est vrai qu'on observe une augmentation des faits. Pour autant, l'ensemble de la délinquance, y compris de rue, ne peut pas être mise sur le compte des jeunes. On sait bien qu'il y a aussi un effet de mode. Je prends un exemple : j'étais de permanence la semaine dernière. Dans le même après-midi, on m'a présenté comme jeunes délinquants deux jeunes qui avaient frappé leur mère. Les deux affaires étaient distinctes. Bien entendu, je ne justifie en aucune manière ces bagarres intrafamiliales, mais, il y a cinq ou dix ans, ces affaires n'auraient jamais été considérées comme relevant de la délinquance. C'est tellement vrai que je me suis refusé à mettre ces jeunes en examen, car j'ai bien vu les problèmes familiaux qui existaient. Mères de famille et enfants sont partis du tribunal bras dessus bras dessous, apaisés. Ce n'est sûrement pas en qualifiant de délinquant le jeune qu'on avait réglé un quelconque problème.
En d'autres termes, à l'heure actuelle, on qualifie souvent de délictueux des faits qui n'auraient pas été jugés tels auparavant.
Cependant, personne ne peut nier qu'il n'y ait une augmentation du nombre des faits qu'on peut mettre à la charge des mineurs, qui sont plus violents. C'est même la caractéristique fondamentale de la situation. Dans la délinquance juvénile moderne, il s'agit moins d'une délinquance transitionnelle où l'on passe de l'adolescence au monde adulte en affirmant sa personnalité -cela existe encore, cela existera toujours- que d'une délinquance liée à une période d'asocialisation, voire de rupture avec la société, bien que cette rupture soit partielle. M. Chevènement parlait de « sauvageons ». Ces jeunes, cependant, ont un pied à la maison. Le problème, c'est qu'ils ont aussi deux pieds dans la rue. Ils sont donc dans la loi de la maison et les parents nous disent qu'ils n'y posent aucun problème. Mais leurs deux autres pieds dans la rue les rendent dangereux. Ils appartiennent à un dispositif mafieux, comme le disait le lieutenant de gendarmerie qui était là il y a quelques instants. Ils sont plus ou moins utilisés, mais ils y trouvent aussi leur compte. La surreprésentation des jeunes issus de l'immigration est incontestable. Je pense qu'il faut reprendre l'analyse de Christian Delorme dans Le Monde il y a un mois. Il faut oser dire qu'une partie des jeunes issus de l'immigration rencontre de sérieuses difficultés à intégrer la société française.
Je rejoins les propos liminaires de l'officier de gendarmerie qui s'exprimait il y a quelques instants. Il convient de dépasser le niveau polémique, qui se manifeste particulièrement en période électorale. Les politiques, les professionnels et la population doivent disposer d'instruments de mesure fiables et appropriés, semblables à ceux que nous possédons dans d'autres domaines, en matière de toxicomanie, notamment. Depuis que nous avons ces instruments d'observation, il y a moins de débats sur « l'écume de la mer », c'est-à-dire les données subjectives, mais il y a un débat sur le fond.
Au coeur de la campagne électorale actuelle, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Vos questions permettront ensuite, éventuellement, d'approfondir tel ou tel point.
Nous nous sommes engagés, les uns les autres, au cours du débat qui dure depuis maintenant six mois, dans de fausses réponses. Comme professionnels et citoyens, nous devons sortir de tout cela. Connaître les vraies réponses suppose d'identifier les vrais problèmes. Le discours politique, tous bords confondus, à quelques exceptions près, s'attache à prévenir la récidive de la délinquance. C'est une préoccupation en soi. Qui va contester une telle nécessité ? Mais on en est souvent resté là : on ne parle pas de la prévention des passages à l'acte. Or c'est là, à mon avis, que se situe l'enjeu politique d'une commission comme la vôtre. Il ne s'agit pas uniquement de constater dans quelles conditions l'instrument technique -policier, judiciaire et éducatif- arrive à juguler la délinquance ou le passage à l'acte de jeunes en difficulté. La question est de savoir comment on peut éviter que de nouvelles vagues encore plus violentes que les précédentes -c'est le pronostic de certains- ne déferlent sur notre société.
Je suis profondément convaincu qu'on est loin d'avoir épuisé les effets ou les conséquences négatives de la fracture sociale. A gauche comme à droite, les élus, qui représentent la société, ont cru que deux ou trois points de développement économique, la richesse irradiant le monde et la société française, suffiraient à tout régler. Ce n'est pas vrai. Quand des familles ont vécu pendant quinze ou vingt ans, sur deux ou trois générations, d'une manière déstructurée, on ne peut pas s'attendre à ce que, par miracle, par l'opération du Saint-Esprit, la reprise -qui n'est d'ailleurs pas là, mais peu importe- les sauve. Comment peut-on gérer l'ordre public à court terme, aujourd'hui, ce soir ? Comment faire en sorte qu'un jeune qui a commis un délit et qui ne peut pas rentrer chez lui soit incarcéré s'il faut l'incarcérer ou se voie offrir une alternative au retour à la maison s'il ne doit pas rentrer à la maison ? Comment ne pas se « prendre les pieds dans le tapis » lorsqu'il sortira de cette structure six mois plus tard ? Comment allons-nous gérer la situation à long terme pour éviter que de nouveaux jeunes ne tombent dans la délinquance ?
Je vais essayer de faire le procès des faux débats. Vous disiez, Monsieur le président, que ces auditions étaient diffusées. Nous sommes là pour nourrir le débat public et apporter du matériau à la réflexion. Alors soyons pédagogues autant que faire se peut !
Je prétends que l'ordonnance de 1945 n'est pas un texte obsolète. Notre code pénal a duré deux siècles et nous avons fait avec. Bien sûr, il fallait le rénover ! Mais vous savez comme moi que ce texte a été rénové une vingtaine de fois. Nous vous disons, en tant que professionnels, que l'ordonnance de 1945 est opérationnelle. Tous les jours, elle nous permet d'agir. Mon raisonnement est très simple. Tout le monde s'appuie sur ce que nous avons fait en Seine-Saint-Denis en 1992. Or nous l'avons fait sur la base de l'ordonnance de 1945. Si ce texte n'était pas bon, nous n'aurions jamais pu le faire. En effet, en tant que magistrats du parquet et du siège, nous n'aurions pas pu violer la loi. Ce texte, depuis, a été modifié par la loi Toubon et par la loi Guigou. Le débat sur l'ordonnance de 1945 est un faux débat. Ce texte défend certaines valeurs. Il affirme que dans toute éducation il y a de la contrainte et que dans toute contrainte il y a de l'éducation. Qui va prétendre que ce qu'a signé le général de Gaulle en 1945 n'est plus valable aujourd'hui ? Il s'agit de valeurs universelles, indépendamment du général de Gaulle. Le problème n'est pas celui de la loi en général. Le texte de 1945 est perfectible à la marge. J'essaierai tout à l'heure d'avancer quelques propositions.
Peu de gens vous l'auront sans doute dit, mais, à un détail près, nous sommes plutôt en cohérence avec l'ordre international, que nous avons ratifié, que vous avez ratifié, en tant que sénateurs. On ne peut pas dire blanc un jour et noir le lendemain. Vous êtes donc en conformité avec la convention internationale sur le droit de l'enfant. A un détail près, tout de même : le législateur devrait établir dans la loi un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés incapables. Actuellement, il existe une présomption d'incapacité avant sept ou huit ans, mais rien n'est précisé dans les textes. Pour l'essentiel, la convention internationale préconise une certaine déjudiciarisation. En d'autres termes, nous commençons à prendre une orientation contraire à la convention : nous multiplions les interventions du judiciaire, alors que nous devrions trouver des mécanismes de régulation civile des problèmes. Régulation civile signifie régulation familiale, scolaire, de quartier, plutôt que régulation policière et judiciaire. Les incidents qui ont lieu dans un hall d'immeuble nécessitent-ils obligatoirement une intervention policière et judiciaire qui laissera des séquelles ? N'est-ce pas un problème d'habitants, de bailleurs, de municipalité ?
Nous devons donc nous demander quels types de contentieux sociaux doivent relever d'une convention policière et judiciaire en sachant -et c'est le problème- que, à trop vouloir faire intervenir la justice, elle n'intervient plus.
Dans un contexte où la violence est plus présente que par le passé -on ne peut plus attendre que jeunesse se passe comme auparavant- le problème qui nous est posé est celui de l'attente d'une réponse immédiate qui soit relativement ferme. Je vous ai rappelé tout à l'heure à cet égard les propositions qui ont été avancées : la comparution immédiate pour jugement, l'abaissement de la majorité pénale à quatorze ans, la responsabilité pénale des enfants à dix ans, les centres de sécurité pour mineurs, les couvre-feux, ou encore la mise sous tutelle des allocations familiales.
A mes yeux, cette révolution ne s'impose pas même si l'on a pu critiquer certains principes qui guident notre fonctionnement. Je pense par exemple à la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui a été adoptée en 2000 et qui ne tient plus compte de la spécificité de la justice des mineurs. Contrairement au texte qui avait été adopté en 1993, la filière spécifique pour l'incarcération des mineurs n'est plus aujourd'hui garantie. Au mois de décembre, le Parlement a d'ailleurs été obligé d'adopter en catastrophe un texte visant à donner au juge délégué la possibilité de prendre des mesures éducatives si le mineur n'était pas incarcéré. On a ainsi créé -je le souligne au passage- un nouvel échelon judiciaire. Cela dit, les grandes lignes du droit pénal relatif aux mineurs restent aujourd'hui valables et opérationnelles.
Le lieutenant-colonel de gendarmerie nous a parlé tout à l'heure des jeunes étrangers qui étaient manipulés. Je ne sais pas s'il pensait aux jeunes d'origine roumaine, mais on peut le supposer.
Comme nous l'avons expliqué à ceux d'entre vous qui sont venus au tribunal de Bobigny, à Bobigny comme à Paris, nous avons notre lot de jeunes de ce genre. Contrairement à ce que certains affirment, face à ces jeunes, nous ne sommes pas dans l'impossibilité de réagir. Certes, ils ne sont pas placés dans des foyers parce que, d'une part, ils ne le demandent pas et, d'autre part, comme ces foyers sont des structures ouvertes, nous n'allons pas les fermer pour eux. Cependant, nous pouvons recourir aux procédures répressives classiques, et notamment à l'ordonnance de 1945, en les condamnant rapidement à une peine de prison ferme avec exécution immédiate. Certes, le jugement sera prononcé par défaut, mais la diffusion de la sanction sera nationale. Si ces jeunes restent sur le territoire français et commettent à nouveau un délit -on le voit régulièrement- ils iront immédiatement en prison. En d'autres termes, même si nos moyens sont limités, nous avons la possibilité de lutter contre ce type de délinquance où des jeunes sont utilisés.
Je vous ai rappelé les principes de responsabilité des mineurs parce que ce point me semble important pour vous. Il faut décoller le nez de la vitre et voir les choses d'un peu plus loin.
Certes, on peut changer les frontières -cela relève du législateur-, et, en tant que praticien, je ne peux rien dire à ce sujet. Si vous voulez les changer, vous le ferez. Quoi qu'il en soit nous avons un dispositif qui prévoit une gradation de la responsabilité du jeune en fonction de son âge. Sa responsabilité est plus ou moins grande selon qu'il est âgé de moins de sept ans, qu'il se situe dans la tranche d'âge des treize-seize ans, des seize-dix-huit ans, ou après sa majorité.
Avant sept ans ou huit ans, un enfant est plutôt un « bébé », tourné sur lui-même. Entre l'âge de treize ans et de seize ans, il se tourne sur l'extérieur, et nous pouvons le rendre responsable de ses actes, mais notre action devra s'inscrire dans une démarche d'ordre éducatif. On ne peut pas le punir. Avant les lois Chalandon de 1987-1989, on pouvait le mettre en détention provisoire, mais on ne pouvait pas le punir, ce qui était incohérent. Certes, on peut retenir l'âge de douze ans, mais c'est le législateur qui le dira. Les sociologues, les médecins, les pédiatres ou d'autres encore vous convaincront-ils que l'enfance moderne n'est plus l'enfance d'il y a cent ans ? Ce débat m'échappe totalement. Quoi qu'il en soit, je le répète, la législation en vigueur nous offre une gradation des situations, y compris après la majorité, puisque, sur la base de l'ordonnance de 1945, dans un certain nombre de cas, différentes mesures peuvent être prises.
Par ailleurs, comme nous vous l'avons expliqué à Bobigny, non seulement les réponses peuvent être graduées par rapport aux individus, mais elles peuvent être diverses en fonction des situations que nous avons à traiter.
Le parquet dispose désormais de six ou de sept modalités d'intervention alors que, voilà quelques années encore, il n'avait pour seul choix que de classer ou de poursuivre : 60 % des affaires classées pouvaient viser les biens et 40 % les infractions contre les personnes. Aujourd'hui, il peut certes classer le dossier lorsqu'il estime qu'il n'est pas assez solide -cela représente entre 6 % et 8 % des affaires traitées par le tribunal de Bobigny- soit pour des raisons d'opportunité pure, soit pour des raisons juridiques ou judiciaires, mais s'offrent à lui plusieurs autres possibilités. Le procureur peut fixer un rendez-vous au délinquant dans un délai de cinq à six jours -les parents et la victime peuvent y assister- pour lui « remonter les bretelles » et évaluer la situation. Le premier substitut chargé des mineurs, M. Kross, et moi-même, nous vous avons dit à Bobigny que, dans neuf cas sur dix, on ne revoyait pas le jeune, la peur du gendarme ayant été efficace. Cette mesure a, de plus, un coût quasiment nul.
Si le procureur estime que cela ne suffit pas parce qu'il est confronté à un multirécidiviste, il peut le poursuivre selon une procédure classique devant le tribunal. Une convocation par officier de police judiciaire peut être adressée au délinquant pour qu'il soit mis en examen, mais il peut aussi être jugé en cabinet. Nous avons également à notre disposition la procédure issue de la loi Toubon, qui permet de déférer un récidiviste non plus devant le bureau du juge des enfants, mais devant le tribunal pour enfants, dans un délai de deux mois. Je parle là uniquement en termes de jugement. Nous avons, enfin, la possibilité de déférer le délinquant. Ainsi, à Bobigny, tous les jours, quatre à cinq personnes sont déférées. La semaine dernière, au cours de ma permanence, seize l'ont été. Si les circonstances l'exigent, on peut aussi prononcer à leur encontre des mandats de dépôt.
En d'autres termes, nous disposons d'une large gamme de réponses judiciaires, et donc de réponses juridiques, puisque ces réponses judiciaires sont fondées sur la législation, qui prouvent que l'ordonnance de 1945, l'instrument de travail dont vous nous avez doté, est opérationnel.
On peut à la fois faire respecter l'ordre public, en incarcérant, si nécessaire, et prendre en compte la personne. Le fait de recevoir individuellement chaque enfant primo-délinquant au tribunal, ce qui ne se faisait pas avant 1992, est une « sacrée » application de l'ordonnance de 1945. Il y a, en effet, une grande différence entre un dossier et un enfant qui est en face de vous. Lorsque, de surcroît, l'on rencontre ses parents, on peut savoir s'ils sont vraiment capables ou non de le prendre en charge. La défense de l'enfant est presque réelle, ce n'est pas la peine de se payer de mots ! Certes, on ne peut pas encore garantir qu'un avocat -c'est le problème du revenu économique de l'avocat- suivra la situation du jeune délinquant, ce qui pourtant est important, et c'est un grand défaut de notre dispositif actuel. Je tenais à le souligner même si ce n'est pas le sujet dont nous traitons aujourd'hui.
Par ailleurs, contrairement au discours dominant que nous entendons, les parents sont présents dans 70 % des affaires environ. Ils sont certes parfois dépassés par les événements, mais affirmer que les parents sont démissionnaires relève d'une erreur d'analyse. Cela ne correspond pas à la réalité.
Même s'il reste encore beaucoup à faire, la victime est mieux prise en compte qu'auparavant. Bien entendu, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche.
Sur le papier, les réponses éducatives existent. Tout le problème est de les mettre en oeuvre. Où le bât blesse-t-il alors ?
L'opinion attend une réponse ferme, rapide et qui soit portée à sa connaissance. La question qui nous est posée est très simple. Elle vise notamment la catégorie des jeunes âgés entre treize ans et seize ans. S'agissant des autres tranches d'âge -j'y reviendrai ultérieurement-, il n'y a pas de problème.
Je ne mets jamais les institutions en opposition, mais j'attire votre attention sur le fait que le problème qui nous est aujourd'hui posé est moins judiciaire que policier.
Des études récentes démontrent que le chiffre noir de la délinquance est de quatre cas sur cinq. Si l'on considère que la police règle aujourd'hui -elle était un peu plus efficace dans le passé- 15 % des affaires qui lui sont soumises, on voit bien que le problème se pose d'abord en termes d'efficacité policière plutôt qu'en termes d'efficacité judiciaire.
La justice a mis en place, par le biais du traitement en temps réel et des permanences, une intervention judiciaire prompte, dont Thierry Baranger vous a certainement dit -puisque c'est l'AFMJF qui a réalisé cette analyse- qu'elle confine dans certains cas à l'activisme judiciaire. On a, il est vrai, de temps en temps, l'impression que la machine tourne sur elle-même pour faire un effet d'affichage.
En effet, un certain nombre de décisions, on le sait, ne seront pas exécutées. Ainsi, le magistrat de permanence peut prononcer, le dimanche, une mesure de liberté surveillée qui ne sera pas exécutée avant plusieurs mois. Il se demandera alors pourquoi il a passé son week-end au tribunal. Toutefois, au risque d'être traité de liberticide, le tribunal pour enfants peut prononcer l'exécution provisoire -aux termes de l'article 22 de l'ordonnance-, ce qui n'est pas possible pour les majeurs, pour lesquels il faut attendre un an. Le problème, c'est donc l'exécution d'un certain nombre de décisions.
Trois réponses peuvent être apportées : l'introduction du flagrant délit, que l'on appelle la comparution immédiate pour les mineurs, la réintroduction de la détention provisoire ou les centres de sécurité pour mineurs, toutes ces solutions s'inscrivant dans le registre de l'élimination. Je conçois parfaitement que l'ordre public prenne en compte, à court terme, le souci de la population de voir disparaître de son champ de vue une partie de la population qui est dangereuse. Mais nous savons que cela ne peut être que provisoire. Il ne suffit pas d'éliminer, il faut traiter, et c'est la question à laquelle nous devons répondre.
On parle dans certains cas de multirécidivistes, mais c'est une tautologie. Jean Lecanuet disait que la peine de mort devait être uniquement envisagée pour les cas graves. On n'a jamais prévu la peine de mort pour un vol de vélo ! Or, tout le monde s'est rejoint sur le thème « la peine de mort pour les cas graves ». Parler d'un délinquant multirécidiviste, c'est une tautologie. J'ai volé lorsque j'étais jeune, comme 80 % d'entre vous d'ailleurs ! Je ne vous demande pas de vous confesser, il y a prescription de toute façon, mais les études du ministère de la justice montrent que nombre d'entre nous avons commis des actes de délinquance. Pour autant, nous n'étions pas des délinquants ! Nous étions formellement des délinquants, mais nous n'étions pas ces délinquants dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes en situation d'asociabilité. On nous a fait comprendre à la maison, à l'école, qu'il fallait arrêter de plaisanter, et l'on est passé à autre chose. On a même pu par la suite devenir magistrat de la République !
Les jeunes dont nous parlons sont donc, par définition, des multirécidivistes. Réserver le flagrant délit aux multirécidivistes, c'est prendre le risque de réduire à néant l'ordonnance de 1945. Le problème est de savoir si l'on se donne le temps de mettre en oeuvre des mesures éducatives ou si, au contraire, on supprime cette possibilité. En réalité, il faut faire les deux. Il faut être ferme. Comme au sein de toute famille où il faut être ferme avec son fils et, dans le même temps, prévoir l'avenir. Il ne faut donc pas opposer l'un à l'autre. Si l'on met en place le flagrant délit ou la comparution immédiate, la démarche éducative n'est plus possible. Si l'on est dans le tout-éducatif et si l'on ne prévoit pas, à certains moments, une punition ferme, on se situe alors dans l'angélisme. Il faut trouver un équilibre entre les deux.
Juger sur le champ constitue, me semble-t-il, un danger majeur. De toute façon, l'ordonnance de 1945 le permet dans certains cas. La COPJ, la convocation du mineur par officier de police judiciaire, pour jugement le permet et le jugement peut même être rendu dans un délai très bref.
En réalité, les questions qui nous sont maintenant posées, il faut oser le dire, ce sont celle de la détention provisoire et celle des centres de sécurité pour mineurs. Tels sont les points que vous devez trancher.
Selon moi, le problème est en fait circonscrit aux délinquants âgés de treize ans à seize ans. En matière criminelle, la détention provisoire est possible ; en matière contraventionnelle, elle ne l'est pas parce que ce serait périlleux. Pour toutes les autres catégories d'âge, un dispositif existe.
Je vous invite à revenir sur l'histoire.
Lorsque, en 1987, M. Chalandon a accepté les propositions qui ont été avancées par un certain nombre de magistrats, par Françoise Dolto ou d'autres encore, c'est parce qu'il s'est fondé sur l'argument selon lequel l'ordonnance de 1945 n'était pas appliquée. Toutes les études émanant du ministère de la justice démontraient à l'époque que, pour la moitié des enfants, le premier contact avec la justice se faisait à la prison. C'est pour cette raison qu'Albin Chalandon a accepté qu'une proposition de loi devienne projet de loi et qu'il a restreint le recours à l'incarcération pour les jeunes âgés entre treize et seize ans.
Certes, les choses ont changé. Mais, comment éviter de ne pas retomber dans l'erreur qui prévalait avant les lois Chalandon tout en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui ? Tel est l'enjeu actuel.
Au risque de me faire critiquer par certains de mes collègues, je pense qu'il faut savoir faire des compromis dans la vie, des compromis qui peuvent être dangereux, parce que si l'on ne prévoit pas de verrou, la situation peut déraper.
Instinctivement, je suis convaincu que le juge des enfants a un rôle à jouer, mais c'est maintenant le juge délégué qui joue ce rôle, ce n'est plus le juge des enfants comme celui que j'ai été car il n'existe plus.
Au passage, permettez-moi de vous inciter à ne plus « taper » sur les juges des enfants. Entre le parquet qui intervient d'un côté et le juge délégué qui intervient de l'autre, le juge des enfants a les mains propres ! C'est un saint ! Ne le rendez pas responsable de la situation actuelle ! Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, le temps où le juge des enfants pouvait dire au jeune : « je te mets la pression, si tu ne fais pas cela, je t'incarcère ». Pour ma part, je vous propose de revenir à ce dispositif en plaçant le délinquant sous contrôle judiciaire et en lui faisant comprendre que c'est un ordre du juge, un ordre de la République. C'est plus que l'ordre de son père, non seulement il doit respecter son père et sa mère bien sûr, mais il doit aussi respecter l'ordre du juge.
M. le président - C'est ce que j'avais proposé ! Ma proposition n'a pas été retenue par le Sénat !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être optimiste ! Vous nous avez dit que vous aviez prêché dans le passé...
M. le président - Notamment cela !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - ... et que les esprits évoluaient !
En tant que professionnel, j'insiste sur ce point. Je suis convaincu qu'un certain nombre d'enfants vont bien entendu venir se brûler les ailes pour savoir à quoi s'en tenir, d'autant que les adultes qu'ils auront rencontrés auparavant n'auront pas agi en conformité avec leurs paroles. Mais je suis convaincu qu'il faut suivre cette stratégie.
Si vous restaurez la détention provisoire en matière délictuelle, vous embarquez en prison un grand nombre de jeunes. Certes, ce peut être la solution dans certains cas mais, en l'état actuel des choses, on sait bien que ce n'est pas la solution. Il faut prévoir un filtre, pas seulement en termes de liberté, mais un filtre qui permette d'avoir une démarche éducative. Il faut que le juge des enfants reste au coeur du dispositif, ou alors il faut le supprimer. Tel est l'enjeu.
Bien sûr, vous pouvez aussi revenir au dispositif d'avant 1912. Pourquoi pas ? En tant que parlementaire, vous pouvez tout faire. Si l'on veut une détention rapide, il faut non pas un jugement rapide, mais une détention provisoire. Il faut apporter des réponses fermes.
Au cours de mes recherches, un chiffre m'a frappé : en 2001, on a enregistré 7.400 condamnations à des peines de prison ferme pour 65.000 nouvelles procédures. On peut donc dire, alors que la justice est qualifiée de laxiste, que, dans plus de 15 % des cas, les peines de prison sont fermes ! Par ailleurs, 12 000 mesures de réparation ont été prononcées. Sont aussi mises en place des mesures de sursis simple et de sursis avec mise à l'épreuve, ainsi que des mesures d'éloignement, contrairement à ce que l'on croit. Le problème n'est pas de prononcer une mesure d'éloignement, c'est de trouver le lieu d'accueil.
Ne mélangeons pas tout. Lorsque l'on veut punir quelqu'un, lorsque l'on veut le mettre à l'écart pour des raisons de sécurité, pour protéger la société, il y a un endroit pour le faire, c'est la prison, même si je ne suis pas favorable à la prison en tant que telle. La prison n'est pas une fin en soi. Elle ne peut rien apprendre, c'est une punition et une mise à l'écart.
Me vient à l'esprit l'exemple d'un gamin qui avait tué son frère par accident. On lui a dit que la chose la plus grave qui pouvait être, c'était de tuer et, qui plus est, de tuer son frère. Or, il n'a jamais été puni. Si on l'avait mis, ne serait-ce qu'un jour en prison, il aurait le sentiment d'avoir payé sa dette. Quand je l'ai revu, il devenait fou à force de chercher la punition. Avant, on coupait la main gauche, puis la main droite, on mettait la fleur de lys, on plongeait le coupable dans la rivière. Aujourd'hui, c'est la prison. Il ne faut pas avoir honte de la prison. La prison française, il est vrai -le rapport de la précédente commission d'enquête du Sénat le souligne-, « ce n'est pas le pied ». Cela dit, il faut poursuivre le travail qui a été engagé sous les ministères Guigou et Lebranchu pour la justice des mineurs. Reprenez la proposition de maintenir le travail de rénovation des centres pour mineurs avec des moins de dix-huit ans. Il faut que la majorité pénitentiaire soit la même que la majorité pénale, dix-huit ans et non pas vingt et un ans, comme c'est le cas actuellement. Ainsi, la Seine-Saint-Denis compte un centre de détention pour mineurs, consacré uniquement aux moins de dix-huit ans.
Il faut rénover plus que jamais la prison. Tant dans le programme de rénovation des prisons, que dans celui des centres d'éducation renforcée, vous avez des hommes, en l'espèce des gardiens de prison, des personnels pénitentiaires, qui vont au contact des jeunes, qui ne se contentent plus d'être des gens qui ouvrent les portes. On a compris que le drame majeur de ces jeunes qui sont dangereux pour les autres, c'est d'être en danger eux-mêmes. Ils n'ont pas de père de référence, ils n'ont pas d'homme de référence. Il faut mettre en face d'eux des hommes. C'est ce qu'essaient de faire les personnels de la pénitentiaire, pour des raisons certes très prosaïques, pour éviter que la prison n'explose.
Ce point a peut-être été développé par Thierry Baranger, mais nous sommes de plus en plus nombreux à penser que la semi-liberté pourrait être une solution efficace. La journée, le jeune serait scolarisé ou en formation et, la nuit, il serait dans un lieu clos. Pourquoi ne pas développer ce système ?
Si l'on recourt à la détention provisoire, soyons clairs. Au cours de la campagne électorale, à droite comme à gauche, on nous a parlé des centres éducatifs fermés. On ne peut pas faire un travail éducatif dans un lieu clos. Tous les jeunes qui ont vécu dans ce type de structure ou l'ont animé le savent. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que M. Peyrefitte avait supprimé, en 1979, le centre de Juvisy, après avoir pris connaissance d'un rapport relatif à la violence. La violence ne date pas d'aujourd'hui !
Selon moi, ou l'on doit punir et éliminer, c'est la prison ; ou l'on doit rééduquer, et cela se fera dans des lieux spécifiques, qui peuvent être des familles, des foyers, mais qui doivent être des lieux dans lesquels le jeune est dans une structure contenante. Il roule avec un moteur de 2 CV à 150 kilomètres par heure, il faut ralentir le moteur en évitant qu'une durite ne lâche. Cela prendra environ trois mois pour que le gamin redevienne un enfant et fonctionne selon le rythme d'un enfant. Ensuite, il faudra penser à la reconstruction. C'est tout le pari que nous relevons avec le dispositif de formation actuel : l'Education nationale classique ou le système de formation patronale par exemple. En coordination avec un patronat éclairé, il faut inventer de nouvelles formations pour ces gosses qui ne savent ni lire ni écrire et qui sont complexés. Ne songeons pas un seul instant les mettre dans des centres de formation classique. On doit leur offrir les moyens de vivre dignement dès qu'ils ne seront plus dangereux. Je le répète, le choix doit être clair : si l'on veut punir, c'est la prison ; si l'on veut rééduquer, c'est dans un milieu éducatif qui ne peut être qu'ouvert.
Le programme mis en place par les centres d'éducation renforcée réussit relativement bien -le rapport du CIRESE en témoigne- parce que la mesure intervient six mois après l'acte, mais la situation est plus difficile dans les CPI, les centres de placement immédiat, où il s'agit un peu de calmer les enfants, parce qu'on ne trouve pas les adultes capables de vivre avec eux. Ce n'est pas la loi qui changera cet état de fait. Il faut envisager un nouveau statut de « hussard de la République ». Il nous faut trouver 2.000 ou 3.000 personnes -pas 10.000 ou 100.000 !- qui acceptent de remplir cette mission. Il faut reconnaître leur travail et leurs responsabilités en prévoyant une récompense, un statut, éventuellement une rémunération. Il faut aller chercher des personnes âgées de cinquante ans, qui n'ont pas envie de mourir idiotes, qui n'ont pas échoué dans leur vie professionnelle, mais qui ont envie de faire autre chose et de s'engager. Il faut mener une campagne de mobilisation pour trouver au fin fond de ce pays des gens qui sont capables de s'engager pour des jeunes. Il y en a.
Lorsque l'on a mis en place des opérations d'été en faveur des jeunes en difficulté, des hommes et des femmes se sont engagés dans un mouvement politique, égalitaire, pour faire quelque chose, non pas pour faire un métier. Il faut reconnaître leur travail.
Un autre problème, qui a sans doute été soulevé au cours de vos auditions, c'est le travail des éducateurs. En tant que juge, je ne peux pas le traiter, mais je me demande ce que l'on attend d'eux. Qu'ils contiennent, qu'ils dressent, qu'ils apprennent aux enfants à se respecter pour respecter les autres ? Aujourd'hui qu'est-ce qu'éduquer ? C'est une question importante qui nous est posée. A l'heure actuelle, l'appareil de formation des travailleurs sociaux est incapable d'y répondre facilement. Comment peut-on former les gens ? De toute façon, leur nombre est totalement insuffisant.
Enfin, sur ce transparent (M. Rosenczveig présente un transparent) , j'ai fait un petit dessin humoristique. « Tout le monde interroge les gamins : « pourquoi tu fumes ? pourquoi tu voles ? pourquoi tu fugues ? » mais personne ne sait ce qu'il faut faire. » Et l'on appelle cela le travail d'équipe !
S'agissant du consensus qui se dégage actuellement sur les lieux éducatifs fermés, je dirai que ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord, que tout le monde a raison ! Les professionnels que nous sommes savent que, si l'on adopte ce que nous proposent les candidats, de droite comme de gauche, pendant la campagne électorale, on va dans le mur. On nous propose des murs linéaires de façade, mais cela ne garantira pas la prise en charge des jeunes qui sont à l'intérieur. A supposer même que ces lieux éducatifs fermés existent, la sortie de prison n'aura pas été préparée, et le problème sera reporté à deux mois ou à trois mois. On aura géré le court terme, mais pas le moyen terme. On est donc obligé de faire un pari éducatif. Il faut avoir préparé le jeune à la sortie de prison pour qu'il puisse vivre avec. Certes, ces thèses datent de vingt ans, mais elles restent valables, et ce sont celles que nous appliquons chez nous, dans nos familles.
Il ne faut pas seulement faire bien, il faut le faire savoir. Or, avec la campagne présidentielle actuelle, l'opinion publique est convaincue que personne ne fait rien pour ces jeunes délinquants. Il faudra beaucoup de temps pour que les Français prennent conscience du travail que les institutions font à l'heure actuelle. J'avancerai, pour ce faire, une mesure technique. Il faut faire en sorte que les contrats locaux de sécurité associent mieux les associations locales.
La loi n'est pas en cause. Le problème est moins judiciaire que policier et éducatif. Je ne veux pas dire qu'il ne l'est pas, sinon nous serions restés les bras croisés pendant dix ans. Or, ce n'est pas ce que nous avons fait et c'est bien parce que nous avons fait des choses que nous pouvons nous permettre de le dire. Certes, les policiers en ont fait aussi, tout comme les éducateurs. Mais, je le répète, le problème n'est pas judiciaire. C'est un problème de moyens, c'est un problème policier et éducatif.
Les solutions qui nous sont proposées restent institutionnelles. Il faut accentuer l'effort d'équipement. Je ne pense pas qu'il faille plus de moyens. Vous mettriez aujourd'hui sur la table un chèque de 1 milliard d'euros que cela ne nous donnerait pas les hommes. Il est trop simple de dire qu'il faut légiférer et accorder plus de moyens. Il faut, en réalité, trouver les hommes qui sont capables de vivre avec ces jeunes.
Par ailleurs, comme je l'ai expliqué à ceux d'entre vous qui sont venus à Bobigny, nous rencontrons un problème de gestion.
Ainsi, au mois de septembre prochain, le parquet des mineurs de Bobigny sera démantelé parce que certains ont obtenu leur mutation. Quatre magistrats sur dix partent. Pas une entreprise ne fonctionne de cette manière ! 40 % des effectifs du tribunal pour enfants disparaissent ! Mais la mémoire, c'est important ! On doit gérer différemment la justice, en termes de production. Il faut avoir le souci de la production judiciaire comme on a celui de la production économique. Or, on ne peut pas respecter le statut du personnel tout en gérant la mission de service public. Je suis favorable à une mission de service public, mais il doit être géré différemment.
Par ailleurs, on doit identifier ce que l'administration peut gérer directement et ce qu'elle doit confier à d'autres services. En effet, je ne suis pas convaincu que, aujourd'hui, -c'est une provocation très politique- la PJJ doive gérer en prise directe l'hébergement. Si elle sait passer le relais au secteur associatif, elle sera dégagée des lourdeurs de la gestion du personnel. Il faut, en effet, mettre en place une équipe qui, pour qu'elle soit opérationnelle, pendant quatre ou cinq ans, s'occupera de jeunes en grandes difficultés. Il faut qu'il y ait un chef, que des gens croient en lui et croient au projet. Or, il n'y a pas de miracle, ce ne sont pas les commissions paritaires de l'administration qui permettent de le faire. Le plus difficile, ce n'est pas de recruter des personnes, c'est de les garder pour que ne soit pas réduit à néant le travail qui a été fait la veille. Combien de fois ai-je vu la PJJ fière comme Artaban d'avoir remis en place tel foyer et, six mois ou un an plus tard, dire qu'il y a une crise parce qu'untel part. Il faut qu'on envisage d'autres modes de gestion.
Comme l'a noté Thierry Baranger, nous devons faire le partage entre ce qui relève du droit pénal national et ce qui relève d'autres contentieux, de l'autorité parentale, de la discipline scolaire, voire de l'autorité dans la rue, les gens ne devant pas laisser faire n'importe quoi. Il importe que tout ne remonte pas au judiciaire.
Soyons cohérents, parce que nous posons les bases pour dix ans ou quinze ans. Si vous devez remettre en cause l'ordonnance de 1945, demandez-vous si vous ne devez pas en étendre le champ d'application. Voulez-vous un statut spécifique pour les jeunes délinquants ? Tous les sociologues affirment que la jeunesse va de quinze ans à vingt-cinq ans. Tintin s'adresse bien à des jeunes âgés de sept ans à soixante-dix-sept ans ! Mais c'est pousser le bouchon un peu loin !
Ne faut-il pas se demander s'il faut maintenir le statut civil issu, vous vous en souvenez, de la réforme mise en place par Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République tendant à abaisser la majorité de vingt et un ans à dix-huit ans, réforme extraordinaire que personne n'avait prévue. Certes, il fallait le faire, mais il l'a fait trop vite. Il a dû mettre en place très rapidement un dispositif pour éviter que, du jour au lendemain, des jeunes âgés entre dix-huit ans et vingt et un ans ne soient précipités dans un statut civil auquel ils n'avaient pas été préparés. Aujourd'hui, cela n'a plus de sens. Voulez-vous réserver un sort pénal et civil spécifique à ce que l'on appelle la jeunesse, c'est-à-dire à ceux qui sont âgés entre quinze ans et vingt-cinq ans ? Il serait facile de répondre que, comme l'on n'a déjà pas les moyens de s'occuper des jeunes de dix-sept ans, on ne voit pas comment on pourrait s'occuper des jeunes de vingt et un ans ? Mais c'est là où le politique doit faire du politique !
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas tout attendre de la justice, sinon on va se « planter ». De toute façon, le juge des enfants n'a plus aucun pouvoir, sinon celui du verbe. Parlons donc !
Tout ce que je viens de développer devant vous est lié à la réponse que l'on peut apporter aujourd'hui à la délinquance, mais n'oublions pas la prévention. Comment lutter contre ce qui va arriver ? La politique familiale, la politique sociale, la politique d'intégration, la politique citoyenne doivent permettre, demain, de diminuer le nombre de jeunes en grandes difficultés.
Certes, on a marqué quelques points. Ainsi, le 4 mars dernier, le projet de loi relatif à l'autorité parentale a été adopté. C'est bien beau d'avoir dit qui, au sein de la famille, était responsable et en quoi il l'était, mais encore faut-il que législateur et le Gouvernement, donc le monde politique, assurent la promotion civile et laïque de la loi de la République pour rassurer les gens. Cela va nous prendre cinq ans pour définir la place du beau-père, de la belle-mère au sein de la famille. Or, le soutien aux familles est essentiel, notamment celles qui sont issues de l'immigration. Quelles mesures ont été prises pour aider les familles appartenant à une autre culture ?
Comme Thierry Baranger vous l'a confié, il est urgent de mettre en place une prévention spécialisée pour éviter que tout ne remonte au judiciaire. En outre, il faut très vite, en amont, introduire du social à l'école. On a commencé à le faire, mais on est loin du compte. Il faut soutenir et aider les familles, je le répète, notamment celles qui sont issues de l'immigration. Il faut restaurer l'autorité en la recrédibilisant. Nous avons pu entendre, à gauche comme à droite, qu'il fallait restaurer l'autorité pour l'autorité. Mais on n'a pas compris que, pour être respectée, l'autorité doit être légitime.
A cet égard, elle doit non seulement fixer les droits, mais aussi protéger le citoyen. En d'autres termes, tant que vous n'aurez pas donné l'image d'une autorité, d'une police, des parents, d'enseignants qui protègent les enfants, ces derniers ne respecteront pas l'autorité. Ils respectent une autorité qui les protège, mais pas une autorité dont ils n'ont pas vu les bénéfices. C'est tout le débat sur la citoyenneté : une partie de la population française ne voit pas les avantages que présente la loi. Pourtant, ils sont extraordinaires. Il faut donc expliquer la loi.
Enfin, il faut donner de l'espoir, mais cela relève du politique. La prévention, on peut en faire. Mais il ne faut pas « paniquer » parce que vous allez légiférer pour une génération. Il faut faire attention aux simplifications et clarifier le débat : l'ordre public à court, moyen et long terme. Suivons nos valeurs : ce n'est pas en faisant le contraire de ce que l'on pense que l'on sera crédible.
La France a pris des engagements internationaux auxquels elle n'a pas, jusqu'à présent, « tordu le cou ». Mais, on peut faire une réponse à la française et ne pas opposer une France à l'autre, la jeunesse aux autres. Si l'on ne rassure pas l'opinion, on risque de « miter » la société : les riches vont s'enfermer derrière de hauts murs, ce que les pauvres font déjà en se renfermant sur eux-mêmes et interdisant leur territoire, ce qui est la pire des choses.
Le problème, c'est que l'on doit être exemplaire. Avant de faire du droit, il faut être pédagogue et réexpliquer les règles du jeu.
Pour résumer mon propos, je dirai qu'il faut faire une réforme, à la marge de l'ordonnance de 1945, s'agissant notamment de la détention provisoire. Il faut poursuivre les CPI et les CER et régler les problèmes de gestion et de personnels. Il faut maintenir les équipes compétentes. Le SEAT, le service éducatif auprès du tribunal, qui a pour mission d'évaluer les situations et de formuler des propositions, est essentiel dans une juridiction. Il faut faire évoluer la prison pour les mineurs et envisager un programme de semi-liberté. Enfin, il faut mener une réflexion sur la PJJ. Est-ce une administration de gestion ou une administration de mission ? C'est la question clé, car je ne suis pas certain que la PJJ ait besoin de 6 000 personnes. Selon moi, être éducateur à la PJJ devrait être le bâton de maréchal. Il faut faire du social à l'école, mettre en place une politique de prévention sociale, apporter un soutien aux familles issues de l'immigration, développer les internats scolaires. A cet égard, j'ai pu me rendre compte au cours de mes déplacements -hier, j'étais à Montlhéry- qu'il existe quelques internats scolaires non conventionnés, mais que les internats scolaires qui ont été annoncés par le ministère de l'Education nationale ont beaucoup de mal à se mettre en place. Or nous en avons besoin. Le coût journalier est de 220 francs par jour contre 2.300 francs dans un CPI ou dans un CER. Enfin, il faut restaurer la loi dans les actes et dans les esprits.
Si j'avais à actualiser ce dessin qui date de vingt ans (M. Rosenczveig montre un transparent) , j'ajouterais le procureur de la République. En effet, à l'heure actuelle, ce n'est pas le juge pour enfants qui rend la justice pour les mineurs. On a une juridiction à deux pieds : un grand pied, le procureur, et un petit pied, le tribunal. C'est un petit clin d'oeil humoristique.
M. le président - En tant qu'élu local, je suis bouleversé par le problème des halls d'immeuble. En effet, les plus défavorisés d'entre nous, parce que ce sont ceux qui le vivent et qui en sont victimes, ne peuvent pas rentrer chez eux sans avoir à se faufiler au milieu d'une bande, ou pis, sans croiser un regard. Je me demande même si ce n'est pas le problème numéro un de l'organisation de la vie dans la cité. Vous nous avez dit, et je vous comprends, que ces faits ne devraient pas relever de la justice. Il y aurait une insuffisance des intermédiaires qui devraient normalement les prendre en charge. Mais de quelle manière ?
J'ai la chance de diriger une commune dont le taux de délinquance est relativement faible -Châtillon dans les Hauts-de-Seine-, mais je suis néanmoins sollicité pour intervenir en tant que médiateur, ce que je fais de bonne volonté. Cette situation est tout de même difficile à vivre car, quoi qu'on fasse, même lorsque la police intervient, les jeunes reviennent, et on a le sentiment qu'on ne s'en sortira jamais.
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Ils reviennent et pour cause ! Ce qu'ils ont fait est très perturbant dans la vie quotidienne, mais n'est pas d'une gravité...
M. le président - En l'occurrence, oui !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Les faits sont ressentis comme tels par la population !
A cet égard, je me référerai au film qui a été tourné sur Bobigny. Au cours d'une de mes permanences, j'ai rencontré trois jeunes, qui se faisaient d'ailleurs passer pour des victimes, alors que tel n'était pas du tout le cas. Dans un premier temps, on pouvait les croire, mais quinze jours plus tard, ils ont commis d'autres faits et, quinze jours plus tard encore. Avec les magistrats qui étaient aussi de permanence, nous en avons mis deux en prison et nous avons éloigné le troisième à six cents kilomètres. Ces jeunes -TF 1 a diffusé des images, je ne sais pas si vous les avez vues- avaient effectivement tenté de me « rouler dans la farine ». Ils ne pouvaient pas savoir que j'étais au courant d'un certain nombre de choses. Ils faisaient, il est vrai, régner la terreur, et encore le film n'a pas tout dit. La réalité, c'est qu'ils montaient chez les personnes âgées avec des pistolets réels ou non -c'est ce qui m'avait le plus choqué. Une femme avait osé parler au péril, peut-être pas de sa vie, mais de ce qui pouvait lui arriver, et elle osait, à visage découvert, parler à la télévision.
Des jeunes de ce genre peuvent être dangereux. Mais ce niveau d'acuité reste exceptionnel. En l'occurrence, nous avons, toutefois, réglé le problème en incarcérant deux jeunes et en éloignant l'autre. Certes, ce n'est pas le soir même où cette femme a parlé que nous avons pris cette mesure, mais quinze jours plus tard. En d'autres termes, si les faits sont relativement graves, nous sommes armés. C'est plus difficile, et je rejoins tout à fait vos propos, lorsque les actes sont plus mineurs alors qu'ils sont pour autant impossibles à supporter. Si tant est qu'une sanction puisse régler les problèmes, dans le cas que vous évoquez, Monsieur le président, on ne peut même pas y recourir. On est donc condamné à laisser la situation s'envenimer et à laisser les gens s'« autodéfendre », éventuellement en s'armant, ou à mettre en place des procédures diverses. En outre, l'intervention policière, dans un premier temps, et l'intervention judiciaire, dans un second, ont généralement pour effet de mettre de l'huile sur le feu, d'exacerber les choses, et cela se traduira par des rébellions ou des injures, par exemple. Nous devons nous demander pourquoi ces jeunes n'ont rien à faire, pourquoi ils agissent de la sorte et entrent dans ce rapport de forces. Ce sont les vraies questions qu'il faut aborder.
Il faut donc gérer différemment ces problèmes de halls d'immeuble, mais je touche à mes limites de magistrat. Pour ce qui nous concerne, notre action ne peut aller au-delà. Peut-être faut-il aménager les halls en y organisant des activités plurielles : un kiosque où acheter des journaux, un point télévision, par exemple ? C'est une caricature, mais qu'a-t-on fait dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans le métro ? On a remis de la vie dans des lieux où il n'y en avait plus. Certes, je ne dis pas qu'il faut réaménager les halls, mais il faut remettre de la vie dans ces quartiers. Comment gérer ces lieux de passage qui sont devenus des lieux de vie ?
Voilà un mois environ s'est tenu à La Villette un colloque sur ce sujet. Nous avons été quelques-uns à nous demander si la gestion devait être policière ou judiciaire. Il faut poser quelques limites car on se réfère toujours au mauvais exemple : tel office d'HLM qui pose des difficultés, tel comité de locataires qui n'est pas bon. Je pense qu'il faut apporter des réponses au niveau local et territorial en coordination avec les habitants de l'immeuble, le bailleur, la municipalité. Si certaines personnes sont indésirables, ne respectent pas les règles du jeu social, il faut qu'on puisse les éliminer de ce circuit. On ne va pas tout barricader ! Souvent, l'arrivée de Police-Secours ne résout rien. C'est même pire parce que c'est tout le quartier qui se mobilisera contre les policiers. La police et la justice doivent uniquement intervenir dans le cas de violences, d'atteintes graves aux libertés, mais le problème du bruit et de la gestion de l'espace ne doivent pas relever d'une intervention policière ou judiciaire. Je ne le crois pas, car on est face à un problème d'organisation de la cité. Il y a une responsabilité municipale, une responsabilité des bailleurs, des habitants. Je n'ai pas la solution !
M. Bernard Plasait - M. Rosenczveig a posé un très grand nombre de questions, que nous nous posons aussi, et il y a apporté de nombreuses réponses.
Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur Rosenczveig, nous nous demandons, nous aussi, comment le citoyen français ressent à l'heure actuelle les problèmes d'insécurité. Qu'elle soit importante ou limitée, l'augmentation de la délinquance et de la criminalité affole le citoyen, et ce n'est pas la campagne électorale qui apaise les choses. Elle les exacerbe plutôt ! Qu'il soit réel ou non, le laxisme prêté au juge et l'idée d'impunité font des ravages puisqu'ils scandalisent les honnêtes gens et encouragent les délinquants. Comment pouvons-nous et devons-nous répondre à ce sentiment ? Comment pouvons-nous corriger cette image laxiste de la justice ? Vous y avez répondu par des chiffres, mais il faut aller au-delà.
Comment supprimer ce sentiment d'impunité ? Je dirais même, comment réhabiliter l'idée de la sanction dans une société qui est plutôt à l'affaiblissement des peines ? Comment lutter contre les noyaux durs, puisque cette notion est souvent mise en avant, notamment par les médias ? Si l'on peut apporter une réponse à certaines formes de délinquance, quelle réponse peut-on apporter à ces noyaux durs, qui sont certes une très petite minorité ?
Par ailleurs, je constate que de nombreuses mesures prononcées sont en attente d'exécution.
Vous nous dites que la prison ne peut rien apprendre. Maintenez-vous cette affirmation dans sa brutalité ou la nuancez-vous ? La prison ne peut-elle pas aussi apporter une certaine formation ?
On entend beaucoup dire que la réponse judiciaire aux actes de délinquance des mineurs intervient trop tardivement après l'infraction. Est-ce votre sentiment et comment remédier à cet état de fait ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Vous avez raison de dire -et les chiffres le prouvent- que sont prononcées des condamnations à des peines de prison ferme, qui ne sont pas exécutées : 7.400 condamnations à des peines de prison ferme ont été prononcées en 2001 ainsi que 4.400 mandats de dépôt. Dans un certain nombre de cas, même si la proportion est faible, le parquet n'exécute pas volontairement la décision. Il le fait en accord avec le juge. Certes, il a prononcé la condamnation du jeune parce que celui-ci l'a mérité mais il pense que, en l'envoyant en prison, il précipite sa chute. On préfère donc laisser peser sur lui la menace.
M. Jean-Jacques Hyest - Est-ce pour cette raison que vous ne voulez pas mettre en place le sursis ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - On le fait, mais les jeunes ne comprennent pas le concept du sursis ! Intellectuellement, ils ne comprennent pas le mot « sursis ». Si je lui dis qu'il a six mois, mais que je peux faire exécuter la peine d'une heure à l'autre, là il comprend.
M. Bernard Plasait - Admonestation est un mot que les jeunes ne comprennent pas non plus !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Tout à fait, c'est un mot châtié ! Ils ne le comprennent pas.
En ce qui me concerne, je procède différemment. Je sors le casier judiciaire. Je le montre au jeune en lui disant que, pour l'instant, rien n'y est inscrit, mais que, demain, peut-être, figurera « condamné » ou « avertissement ». Avec ces gamins qui ont trois cents mots, il faut parfois être très concret.
Je n'esquive pas la réponse mais, vous le savez aussi bien que moi, l'exécution des peines est un problème de parquet. C'est le procureur de la République qui fait exécuter les peines. Il est confronté à deux problèmes.
D'abord, le délinquant a pu lui échapper. On pourra alors exécuter une condamnation à une peine de prison ferme le jour où on arrivera à l'interpeller. Toutefois, un grand nombre de ces délinquants se méfient de la condamnation et essaient de ne plus croiser la police ou la justice. Soit ils vivent terrés, soit ils partent à l'étranger. C'est notamment le cas des jeunes dont je parlais tout à l'heure.
Par ailleurs, se pose un vrai problème, que nous ne pouvons pas nier, que les gendarmes et Thierry Baranger auront certainement évoqué : l'appareil judiciaire a mis le paquet sur sa façade, mais n'a rien mis en arrière-boutique. En d'autres termes, le service d'exécution des peines a été sacrifié au profit du parquet actif au quotidien. Les chiffres le prouvent. Bobigny comptait, il y a dix ans, deux substituts ; aujourd'hui, le tribunal compte cinq substituts, quatre délégués du procureur, des assistants de justice. On a fait en sorte que l'intervention soit rapide et ferme. Toutefois, il y a un problème de moyens. Si une administration ne refuse pas de prendre les gens, c'est bien l'administration pénitentiaire. Objectivement, je le dis rarement, mais je pense qu'on est confronté à un problème partiel de moyens en nombre de magistrats pour exécuter les peines.
Vous m'avez ensuite interrogé sur la prison. On est pour ou contre la peine de mort. On n'a pas à ergoter sur ce problème. Certes, un détenu peut suivre des études et obtenir un doctorat. Mais, pour reprendre ce que disait Alain Peyrefitte, la prison, c'est l'école du crime. C'est la rare chose qu'on puisse y apprendre. La prison n'apprend rien d'autre. Elle ne peut pas apprendre la vie. Il ne faut pas la charger d'une mission mythique, sinon on se prend les pieds dans le tapis. Comme j'ai tenté de vous le démontrer tout à l'heure, la prison c'est d'abord une peine. Ne pas pouvoir circuler, c'est une peine. De plus, c'est une mise à l'écart. On vous met à l'écart parce que vous êtes dangereux.
Même si je n'ai pas développé ce point, on peut penser que, pour certains jeunes, la prison peut être un temps contraint pendant lequel ils vont retrouver un cycle de vie à peu près normal : une heure pour se lever, se coucher, etc. On peut rêver, moi je n'y crois pas.
L'un des problèmes qui est aussi posé, c'est l'état de santé des jeunes. Si, en prison, on peut se préoccuper de leur santé, leur faire passer un bilan, et les amener à se préoccuper enfin d'eux, de leurs dents, de leur estomac, de leur tête aussi en rencontrant des psychiatres, c'est bien. Mais, honnêtement, on ne leur apprendra rien, parce que l'on ne peut pas apprendre la vie dans un lieu artificiel. Il faut qu'ils aillent en prison le temps nécessaire, mais n'attendons pas autre chose de la prison.
On peut certes occuper les jeunes en prison. A Fleury-Mérogis, vous avez pu apprécier la qualité des ateliers de formation. Cette conception remonte à dix ans ou quinze ans et je ne suis pas convaincu que la plupart des jeunes que je connaisse aujourd'hui soient capables de suivre ces formations. En plus, ça leur « prend la tête ». L'effort leur « prend la tête », tout leur « prend la tête ». Il faut réconcilier ces jeunes avec eux-mêmes.
Pour ma part, je pense que la prison doit les punir, les éliminer, éventuellement les aider à reprendre un rythme de vie normal et traiter leurs problèmes de santé. Mais je ne pense pas qu'elleuisse leur apprendre quoi que ce soit.
M. Jean-Jacques Hyest - Ne faut-il donc pas envisager d'autres établissements que cette prison, que ces quartiers de mineurs,...
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest - ... sous une forme complètement différente ?
Certes, les centres d'éducation renforcée sont une bonne mesure. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum de discipline, que des adultes jouent le rôle de surveillants. On a tous connu l'internat de lycée et on n'en est pas mort ! Il y régnait une discipline, on ne sortait pas quand on voulait !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest - On ne faisait pas ce que l'on voulait ! On se levait à l'heure ! Il faut au moins prévoir une structure qui certes permettra aux jeunes concernés de retrouver un cours normal de la vie, comme vous l'avez dit, parce que beaucoup de gamins sont, il est vrai, complètement désocialisés, mais il faut qu'il y ait une certaine discipline et un certain ordre.
M. Bernard Plasait - Pardonnez-moi, mais je voudrais compléter les propos de M. Hyest.
J'aimerais vous parler des centres fermés ou semi-fermés, comme cela nous a été suggéré. Une des personnes que nous avons auditionnées nous a dit qu'un centre fermé était ingérable et reviendrait aux maisons que nous avons été obligés de fermer, les mêmes causes produisant les mêmes effets.
En revanche, on peut envisager la mise en place de centres semi-fermés qui, comme aux Pays-Bas, permettent à des jeunes de passer du centre semi-fermé à un centre fermé pendant quelques jours. Quel est votre sentiment à cet égard ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - M. Jean-Jacques Hyest et vous-même avez raison, j'ai aussi développé l'idée de la semi-liberté. Vous pouvez décliner cette mesure comme vous le voulez. Alors, pourquoi pas ?
Pourquoi ne pas se référer à la Convention internationale sur les droits de l'enfant ? Il faudrait prévoir un système pénitentiaire spécifique pour les mineurs. Si vous voulez le mettre en place, faites-le. Ce ne sera pas une régression. Simplement, osez le dire clairement. Pourquoi ? Pour ne pas créer une confusion, et on n'attendra pas alors de ces structures autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire, je le répète, une privation de liberté, une mise à l'écart et une reconstruction de la personne. Mais si l'on veut être dans le registre de l'éducation, outre ce système pénitentiaire spécialisé pour les mineurs, il faut mettre en place des dispositifs d'éducation où les jeunes doivent retrouver une présence humaine, des gens qui ne lâchent pas, tout comme les parents ne doivent pas lâcher. Si mes enfants ne sont pas sortis de la maison lorsqu'ils étaient jeunes, ce n'est pas parce que la porte était fermée à clé -elle ne l'est jamais-, c'est parce qu'ils savaient que je ne voulais pas qu'ils sortent. Il faut que les adultes aient un charisme, des valeurs, une cohérence.
Ce qui nous fait enrager les uns et les autres, c'est de voir que, pendant la campagne électorale, on mélange tout.
S'il faut mettre en place des structures fermées pour les mineurs, il faut une administration pénitentiaire spécifique pour les mineurs ; si ce sont des structures éducatives, envisageons des lieux éducatifs ouverts. Je pense, pour ma part, qu'il faut faire les deux : il y a un temps pour punir, il y en a un autre pour rééduquer. Je ne peux pas être plus clair.
Votre dernière question est passionnante, mais il est difficile d'y répondre.
On demande au juge des enfants -restons dans la configuration actuelle- d'étayer son intervention sur un fait pénal et de donner une réponse non seulement au jeune, mais aussi à la victime. Il ne faut pas l'oublier. Mais, on lui demande également de prendre en compte la vie de ce jeune. Or celui-ci ne va pas avoir un dossier, mais il en aura plusieurs. Ce n'est pas le jeune que l'on croise une fois et à qui on a fait une admonestation qui pose problème. Ce n'est pas pour lui que vous avez mis en place une commission d'enquête parlementaire. Celui qui pose problème, c'est celui qui a plusieurs faits à son actif et pour lequel le magistrat devra apporter une réponse judiciaire à tous les dossiers, ainsi qu'à la victime -c'est l'intérêt de la césure pénale qui a été introduite dans l'ordonnance du 2 février 1945. Dans le même temps cependant, le législateur a donné mandat au juge de transformer le jeune pour qu'il ne soit plus le même que celui qui a commis les faits.
Concrètement, on me demande de juger vite pour l'opinion et pour la victime, mais on me demande aussi de prendre du temps pour que le jeune évolue. En tant que parlementaire, vous ne me demandez pas de distribuer des condamnations, vous me demandez de faire en sorte que le délinquant d'aujourd'hui ne le soit plus demain. Vous ne me demandez pas de faire du chiffre, vous me demandez d'être efficace. Moi, je vous dis que, pour être efficace, j'ai besoin de temps. Comment faire la synthèse ?
M. Bernard Plasait - C'est la raison pour laquelle je vous parlais des noyaux durs ! Pour le plus grand nombre des délinquants, vous avez raison, mais pour les noyaux durs ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Je crois être cohérent : c'est l'avantage que nous avons à nos âges, car nous avons essayé d'éliminer les contradictions. Il peut en effet être nécessaire, en cas d'urgence, de donner une bonne gifle, si je puis dire, à chacun des membres d'un noyau dur et de les retirer provisoirement du circuit, parce qu'ils sont dangereux et qu'ils ont commis une faute et méritent d'être punis. Il faut donc les placer à l'écart, dans un lieu qui s'appelle la prison. Pour autant, le problème n'est pas réglé, car si vous laissez ces jeunes ressortir, le noyau dur sera reformé trois mois plus tard.
Il faut donc s'attaquer aux membres de ce noyau dur. Ce sera assez facile pour certains d'entre eux, très compliqué pour d'autres. Par conséquent, des mesures à géométrie variable doivent être prises. Dans certains cas, il faut répondre vite et fermement par le biais de la détention provisoire, par exemple quand il s'agit de multirécidivistes, dans d'autres, il faut laisser le temps au travail social de produire ses effets. La situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons actuellement tient au fait qu'il n'était déjà pas facile autrefois d'éduquer ou de rééduquer des gamins voleurs de voitures -il fallait donner du temps au temps, mais la statistique judiciaire montrait que, vers vingt-six ans, les choses s'apaisaient, grâce à une vie de couple ou à la naissance d'un enfant- mais que, aujourd'hui, les jeunes ne suivent plus la petite formation professionnelle qui débouchera sur un CAP et leur permettra d'élever une petite famille, d'avoir une petite vie où, à cinquante ans, on se rappelle le passé en regardant ses tatouages.
La difficulté, c'est que si l'on pouvait prendre du temps lorsqu'il s'agissait d'infractions contre les biens, il faut aujourd'hui, s'agissant d'infractions contre les personnes, donner une réponse rapide alors que le problème est dix fois plus complexe. C'est la question la plus délicate à résoudre : comment apporter une réponse rapide et visible pour l'opinion ?
M. Bernard Plasait - Absolument !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Dans le même temps, on engage le travail de fond avec le jeune : j'estime que si l'on a déjà clairement défini ce qu'il convient de faire et identifié qui peut faire quoi, on peut y arriver. L'administration pénitentiaire détiendra éventuellement le jeune si l'on juge que, pendant un certain temps, il faut le punir et le mettre à l'écart. La prison ne doit pas être un temps mort ; dès l'instant où le juge incarcère un jeune, il doit préparer l'avenir avec lui. Bien des jeunes que j'ai incarcérés me remerciaient en sortant de mon bureau, alors que je les avais fait pleurer une demi-heure plus tôt. Pourquoi ? Parce que je leur avais donné de l'espoir. Ils savaient qu'ils devaient être punis, et ils m'auraient pris pour un « bouffon » si je ne l'avais pas fait. Mais, dans le même temps, comme au sein d'une famille, on leur annonce que les choses ne s'arrêtent pas là et que l'on va essayer de transformer leur vie. La question est donc de savoir comment articuler la punition et l'éducation, avec les lieux et les personnes adéquats, ainsi qu'un chef d'orchestre. C'est toute la mission du juge des enfants, avec cette difficulté supplémentaire que l'opinion nous demande des comptes, alors que, voilà quelques années, nous agissions discrètement.
A cet égard, je pense très modestement qu'il faut maintenir la publicité restreinte des audiences, mais que l'on pourrait peut-être organiser une publicité des décisions rendues, région par région. L'anonymat devra sans doute être garanti, même si cela ne sera pas facile dans certaines banlieues ou zones rurales, mais je crois qu'il conviendrait de mieux rendre compte de l'action de la justice que ce n'est le cas actuellement.
Le problème politique auquel vous êtes confrontés est simple : soit vous perfectionnez les rouages du système, qui est complexe parce que la vie est complexe, mais qui fonctionne relativement bien et que l'on nous envie plutôt ailleurs ; soit vous le brisez et vous revenez à un droit pénal distributif pur et dur, quitte à réduire de moitié les peines. Dans la première hypothèse, vous conserverez un régime qui, depuis 1912 et non depuis 1945, se donne pour vocation de transformer l'individu. Je n'ai pas de leçons à donner, mais je vous rappelle au passage que tout le XXème siècle a été marqué par le fait que les innovations de la justice des mineurs ont ensuite été reprises pour la justice des majeurs. Par conséquent, les préconisations que formulera votre commission d'enquête, les votes que vous émettrez en tant que parlementaires auront demain des incidences sur la justice des majeurs. C'est incontestable ! La question qui se pose à vous est donc la suivante : revenez-vous sur le virage essentiel pris en 1912, lorsqu'il a été affirmé que l'on ne doit pas seulement juger les faits, mais que l'on doit faire en sorte que l'individu ne soit pas en situation de récidiver, et donc le transformer. Le législateur d'alors a fait un double pari sur le temps et sur le travail social. Tout au long du XXème siècle, on a travaillé à améliorer ce système.
Pour ma part, je crois qu'il faut reprendre les fondamentaux. La meilleure référence est, à mon sens, l'attitude que nous adoptons vis-à-vis de nos propres enfants. Premièrement, il faut énoncer la loi -il ne suffit pas de l'afficher par des dazibaos, il convient de conformer nos actes d'adultes à nos paroles-, qui doit être vécue comme protectrice, ce qu'elle n'est plus aux yeux d'une partie de la population. Deuxièmement, je pense que des actions symboliques doivent être menées en direction des personnels de la police et de la gendarmerie, qui portent la loi au premier degré. Troisièmement, s'il faut punir, la punition doit être claire et rapide. Enfin, il faut permettre l'espoir et pour cela transformer la situation, c'est-à-dire transformer la psyché de l'individu, ses conditions de vie et son statut : grosso modo, c'est de l'action sociale. Les mesures doivent éventuellement être coordonnées par un magistrat. Cela débouchera ensuite sur une peine moins lourde ou plus sévère, selon que l'intéressé aura coopéré ou non. Je dis aux jeunes qu'ils sont jugés sur trois choses : ce qu'ils ont fait, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus. Il est trop tard pour revenir sur ce qu'ils ont fait, des enquêtes permettent de déterminer ce qu'ils étaient : la marge de manoeuvre concerne leur évolution, et c'est bien parce que je les jugerai sur cela qu'ils ont intérêt à changer. Il y aura une prime à leur transformation.
En voulant des réponses rapides, comment allez-vous garantir aux juges que nous sommes une prise sur les jeunes ? En effet, si nous les jugeons le soir même, la seule solution qui nous restera sera de ne pas faire exécuter la peine.
M. Bernard Plasait - Vous parliez de publicité. Je me demande s'il ne faudrait pas approfondir cette idée, parce que, à partir du moment où il y a une réponse, il s'agit en réalité d'un début de réponse. Tout un processus s'ensuivra, mais personne ne le sait. Par conséquent, il pourrait être souhaitable de donner une publicité à ce début de réponse, s'il est formalisé de façon adéquate.
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Vous avez raison. Nous nous sommes engagés dans la bonne voie, et il est peut-être possible d'aller plus loin ; des expérimentations ont été menées, peut-être pourrait-on mieux organiser les choses.
J'ignore si le parquet vous l'a indiqué, mais il existe, en Seine-Saint-Denis, une cellule composée d'emplois-jeunes qui constituent par exemple l'articulation entre le parquet et l'Education nationale. Cette cellule informe les enseignants des décisions qui ont été prises par les juges. Peut-être devrions-nous aller plus loin et faire en sorte que le maire et son équipe soient tenus au courant s'ils le souhaitent.
M. Bernard Plasait - Ils le souhaitent.
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Dans ce cas, nous devrions pouvoir leur donner des informations, et aussi les responsabiliser, parce que l'on ne peut pas dire n'importe quoi. En tant qu'élus, si vous êtes destinataires d'une information, vous ne pourrez pas la diffuser dans n'importe quelles conditions. Pour répondre brièvement à votre question, je pense que, autant il ne faut pas confier au maire le rôle de coordonnateur de la politique de sécurité locale, autant il faut prendre le maire pour ce qu'il est, à savoir une interface entre la population et les institutions. Cela suppose qu'il fasse circuler l'information et que, réciproquement, on lui donne les éléments qui lui permettront d'évaluer la situation, de demander des comptes si le processus achoppe et d'en rendre à la population. Vous avez raison : il faut organiser un circuit d'informations qui doit, à mon avis, passer par le maire.
M. Bernard Plasait - Vous avez évoqué la comparution immédiate. Pourquoi la procédure de comparution à délai rapproché est-elle aussi rarement utilisée ? Vous dites que la « palette » de l'ordonnance de 1945 est suffisante, sauf à introduire dans certains cas la détention provisoire, si je vous ai bien compris, peut-être sous forme adaptée, par exemple quand il y a révocation du contrôle judiciaire. Ne peut-on envisager de mettre en place un contrôle judiciaire mieux adapté aux mineurs ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Vos suggestions me semblent intéressantes, mais le contrôle judiciaire offre une grande souplesse. Par exemple, j'impose systématiquement aux jeunes de ne pas se trouver hors de leur domicile après dix-neuf heures le soir sans autorisation parentale et sans avoir indiqué où ils vont, qui ils fréquentent et à quelle heure ils doivent rentrer. Quand je dis aux gamins qu'ils ne doivent pas fréquenter leurs copains ni la victime, ils s'en fichent, mais quand je leur annonce que désormais ils seront tous les soirs à la maison à dix-neuf heures et que si jamais les policiers les rencontrent dans la rue à dix-neuf heures une sans autorisation parentale, je les mets au « trou », je les vois changer de tête ! Cela étant, il faut peut-être en faire plus.
M. Bernard Plasait - Mais vous n'en ressentez pas le besoin ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Le contrôle judiciaire laisse une grande latitude au magistrat. J'ai inventé la contrainte que je viens de décrire en me fondant sur le bon sens : en France, l'après-midi s'achève à vingt heures -ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le journal télévisé s'ouvre à cette heure-là !-, et c'est la soirée qui commence. Or, on ne sort pas tous les soirs, car sinon on ne peut plus se lever pour aller travailler, à l'école ou ailleurs. Les sorties doivent être exceptionnelles et subordonnées à l'accord des parents, qui doivent savoir où sont leurs enfants. Une fois que la confiance est installée, le contrôle n'est plus nécessaire.
Le problème est de pouvoir sanctionner le contrôle judiciaire quand il s'agit de jeunes âgés de treize à quinze ans. En effet, jusqu'à présent, le discours qui a prévalu, c'est que le magistrat tiendra compte, au moment de juger, de l'attitude du jeune qui a été placé sous contrôle judiciaire. Pour ma part, je pense que, dans un certain nombre de cas, il faut révoquer celui-ci. La situation est différente pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans, car s'ils commettent un délit, il est possible de les incarcérer.
Contraint et forcé, j'en viens donc à proposer le contrôle judiciaire révocable. Je ne sais si l'on peut le dire, mais il m'est arrivé, à une unique reprise, sur le fondement d'une jurisprudence de Grenoble, de révoquer le sursis d'un gamin de quatorze ans et demi qui avait été arrêté pour la troisième fois après avoir foncé sur des policiers, la nuit, au volant d'une voiture volée. Je l'ai donc incarcéré, à la demande du parquet, afin que son père puisse le prendre en charge et le renvoyer au Mali. Ce père passait son temps à courir après son fils, qui était le seul de ses enfants à poser problème.
En conclusion, je pense que la révocation du contrôle judiciaire doit être exceptionnelle mais possible. Il faut surtout éviter que ne se répande l'idée selon laquelle on ne risque pas d'aller en prison avant seize ans.
En ce qui concerne la comparution immédiate, y recourir, même pour les multirécidivistes, signerait la mort du dispositif prévu par l'ordonnance de 1945. Si c'est ce que l'on veut, autant le dire crûment. Cela reviendrait à aligner le régime des mineurs sur celui des majeurs. En revanche, si l'on part du principe que, sauf cas exceptionnels, il faut entreprendre une démarche éducative qui exige du temps, on ne peut pas introduire le flagrant délit pour les mineurs.
M. Laurent Béteille - La comparution immédiate n'interdit pas, par exemple, d'ajourner la peine.
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Non, mais je crains que vous n'ouvriez la boîte de Pandore. Il faut savoir ce que l'on veut ! J'essaie d'être clair et cohérent dans mon propos : si l'on doit placer quelqu'un en détention provisoire, faisons-le sur le fondement de la législation relative à la détention provisoire ! Pourquoi toujours taper à côté de l'objectif que l'on vise ? Si l'on estime que, avant que n'intervienne le jugement, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de sûreté, faisons-le ! La détention provisoire est une mesure de sûreté, mettons-la en oeuvre !
Je le dis crûment, car il est parfois bon de mettre les pieds dans le plat, mais l'idée de réintroduire la détention provisoire ne me fait pas plaisir. Je me suis battu contre elle dans le passé, mais, vingt ans plus tard, tout en conservant le même souci de la protection du droit des enfants et de la société, j'estime qu'il ne faut pas laisser des gosses rouler à cent cinquante kilomètres à l'heure. Je pense être cohérent en affirmant que recourir à la détention provisoire peut laisser le temps à l'action éducative de se développer et permettre de juger plus tard. La détention provisoire est le premier levier, mais il en faudra d'autres par la suite, éventuellement le contrôle judiciaire, la condamnation ou l'exécution de la peine. Il s'agit de gamins qui ont besoin d'être encadrés pendant un certain temps. Si je grille toutes mes cartouches le premier jour, je n'aurai plus aucun moyen de les tenir. Je crois donc que vous avez raison sur le plan technique : rien n'oblige à condamner ! Cependant, le législateur doit anticiper : si le Parlement introduit la comparution immédiate pour les mineurs, il ouvrira une autoroute menant à l'abrogation de l'ordonnance de 1945. Si c'est cela que l'on veut, il faut le dire clairement.
M. Bernard Plasait - Alors pourquoi la comparution à délai rapproché est-elle si peu utilisée ?
M. Jean-Pierre Rosenczveig - C'est un instrument qui existe, que l'on a quelquefois utilisé, mais il doit être réservé à un nombre limité de cas. La plupart des situations ne justifient pas qu'on l'emploie. N'oubliez pas un détail : le jeune doit être en état de récidive, avoir déjà été condamné une première fois. Le mécanisme est simple ; si l'on a à faire à un multirécidiviste, il faut très vite une convocation par officier de police judiciaire, éventuellement pour jugement. Si, en dépit des mesures législatives qui accompagnent la convocation par officier de police judiciaire, le gamin continue à faire des bêtises, il sera alors en état de récidive, donc il relèvera des deux mois. Il faut mettre en place le dispositif le plus complet possible, afin que nous puissions faire du « sur mesure ». Si l'on passe beaucoup de temps sur le mécanisme judiciaire, il faut en consacrer autant aux outils éducatifs qui l'accompagnent.
Je terminerai sur une note d'optimisme : la situation a un peu changé au regard de ce qu'elle était voilà cinq ans, à l'époque de la commission Lazerges-Balduyck. En effet, il était alors quasiment impossible de faire prendre en charge un jeune par une structure éducative. Le programme des CPI et des CER nous permet aujourd'hui de trouver de telles structures, qui accueillent les jeunes ne pouvant retourner chez eux.
A cet égard, il est essentiel de souligner que la prise en charge dans un foyer n'est pas, à la différence de la liberté, une solution de rechange à la prison ; c'est la solution de rechange au retour à la maison. Le jeune ne doit pas aller en prison, mais peut-il pour autant retourner chez lui ? Si tel n'est pas le cas -par exemple parce qu'il risque de récidiver ou parce que la famille est absente-, le placement dans un CPI ou un CER doit être présenté comme une mesure éducative. Il ne doit pas y avoir de barreaux, mais les jeunes doivent trouver en face d'eux des gens qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Dans un CPI de la région parisienne que je désignerai pas, on a lâché du lest et on laisse les gamins rentrer à vingt et une heures trente le soir, voire ne pas rentrer du tout : cela ne correspond pas à la mission confiée à un tel établissement ! Dans un CPI, on ne doit pas quitter les jeunes des yeux.
M. Jean-Jacques Hyest - Comme dans une famille !
M. Jean-Pierre Rosenczveig - Exactement. Quand, en ma qualité de juge des enfants, j'ordonne le contrôle judiciaire en imposant que le jeune soit rentré à dix-neuf heures tous les soirs, il y a incohérence si le CPI autorise celui-ci à rentrer à vingt et une heures trente, voire à dormir chez lui. Toutefois, il ne s'agit là que de scories, qui s'expliquent par le fait que les éducateurs ne parviennent pas à tenir les gosses : tel est le vrai problème. Toute la question est de trouver des personnels adéquats.
M. le président - Il nous reste à vous remercier, Monsieur Rosenczveig.
Audition de M. Patrice BERGOUGNOUX,
Directeur général de la
police nationale
et M. Christian DECHARRIÈRE,
Directeur central de
la sécurité publique
(24 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre MM. Patrice Bergougnoux, directeur général de la police nationale, et Christian Decharrière, directeur central de la sécurité publique.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête, précise que les intervenants ont demandé à être entendus à huis-clos et fait prêter serment.)
Monsieur Bergougnoux, vous avez la parole.
M. Patrice Bergougnoux - Vous avez souhaité, dans le cadre des travaux de votre commission, recueillir mon témoignage sur le problème de la délinquance des mineurs et les mesures mises en oeuvre par la police nationale pour y faire face. Je vous en remercie. J'ai demandé à M. Decharrière de m'accompagner car ses services couvrent toutes les circonscriptions de sécurité publique sur le territoire national, c'est-à-dire près de trente millions d'habitants, dans les zones à forte et moyenne densité urbaine, et sont confrontés en première ligne aux phénomènes de la délinquance, notamment celle des mineurs.
L'aggravation de la délinquance des mineurs au fil des années est une réalité incontournable pour tous ceux qui ont en charge non seulement la sécurité publique mais aussi l'équilibre social des espaces urbains. La qualité et l'efficacité de sa prise en compte conditionnent aujourd'hui la crédibilité des institutions et par là même celle de l'Etat auprès des populations qui subissent ces phénomènes.
S'agissant du constat, je rappellerai simplement quelques statistiques établies par la direction centrale de la police judiciaire et relatives aux zones couvertes tant par la police nationale que par la gendarmerie.
Entre 1992 et 2001, la progression du nombre des mineurs mis en cause, toutes infractions confondues, a été de 79 %. Dans les zones urbanisées, où la sécurité publique est assurée par la police, avec 128.893 mineurs interpellés en 2001, elle est supérieure à 100 %.
En 1992, 13 % de l'ensemble des personnes mises en cause pour crimes et délits étaient des mineurs. Ce taux est aujourd'hui supérieur à 21 %. Les mineurs représentent désormais plus du tiers des auteurs de vols contre moins du quart en 1992, 35 % des auteurs de cambriolages, 37 % des auteurs de vols de véhicules et près de 48 % des auteurs de vols avec violence. Ce taux est supérieur à 50 % dans les agglomérations et atteint, voire dépasse 60 % dans certains secteurs urbains sensibles.
Ils représentent, enfin, un peu plus de 15 % des auteurs de crimes et de délits contre les personnes -27.224 mineurs ont été mis en cause en 2001- et près de 34 % des auteurs de dégradations contre les biens. Je note particulièrement leur représentation en matière d'incendie volontaire contre les biens publics, 59 % , et contre les biens privés, près de 51 %.
Les actes de violence à l'encontre des agents de la force publique ou des représentants de l'autorité ont quadruplé en dix ans. Il en va de même pour les outrages à agent. Je remarque d'ailleurs, mais sans y voir de lien direct, que cette augmentation de la participation des mineurs en matière de vol et de violence contre les personnes et les biens est à mettre en parallèle avec la multiplication par quatre, au cours de la même période, du nombre de jeunes dealers ou consommateurs de stupéfiants.
Sans vouloir évoquer de façon exhaustive toutes les autres catégories d'infraction pour lesquelles la part des mineurs est en progression, je note qu'il est clair qu'au cours des dix dernières années la situation est devenue plus préoccupante. Nous venons de le voir dans trois domaines : la violence acquisitive, la violence contre les personnes et celle contre les biens, notamment sous ses formes les plus graves, comme les incendies.
Tous ces chiffres représentent non seulement la réalité statistique mais aussi et surtout une réalité sociologique difficilement vécue par la population des quartiers les plus sensibles et par les policiers qui doivent y faire face quotidiennement.
Cette délinquance des mineurs se manifeste de diverses manières : agressions individuelles dont d'autres jeunes sont fréquemment victimes, violences urbaines le plus souvent contre les institutions ou encore, reflets de sentiments identitaires exacerbés au sein de quartiers différents, violences et dégradations dans les transports en commun, violences scolaires et dans le sport auxquelles s'ajoutent ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les « incivilités ».
Beaucoup de choses pourraient être dites sur chacun de ces phénomènes et sur leurs causes. J'insisterai simplement sur deux aspects. Le premier, qui est plus préoccupant encore que l'augmentation du nombre des mineurs mis en cause, est le rajeunissement de ces derniers. Ils sont de plus en plus jeunes à commettre des actes agressifs. Sur l'ensemble des mineurs interpellés par la DCSP, la part des seize à dix-huit ans régresse légèrement de 2 % en 2001, celle des quatorze à seize ans reste stable. En revanche, celle des moins de treize ans augmente. Les mineurs de moins de seize ans représentent 12 % des personnes interpellées par la sécurité publique et près de 49 % des mineurs mis en cause.
Nombre de nos policiers y voient là à la fois un effet d'entraînement, de leadership de mineurs ou de jeunes majeurs réitérants sur les plus jeunes, et un exemple de « désocialisation » plus précoce de certains mineurs par une perte des repères sociaux et par des troubles comportementaux non traités dès la prime enfance.
Le second aspect est la déstabilisation que cette délinquance de très jeunes individus introduit ou engendre dans de nombreux secteurs urbains. Elle a plusieurs conséquences dont certaines sont particulièrement dommageables.
Tout d'abord, la présence permanente et provocatrice au sein des quartiers de ces jeunes délinquants, malgré leurs arrestations successives par les services de police ou de gendarmerie, crée un sentiment permanent d'insécurité auprès de la population et une perte de confiance envers la puissance publique ou les autorités publiques.
Ensuite, nous assistons à une déstructuration progressive du tissu économique et commercial due à la lassitude des professionnels et au départ des commerçants. Enfin, il faut faire en sorte que, dans les quartiers sensibles ou défavorisés, l'ensemble des mesures d'aménagement, d'éducation ou d'intégration trouvent, à travers la politique de la ville ou de grands projets urbains, leur pleine efficacité.
On comprend, à la lumière de ce constat trop bref, que la délinquance des jeunes ne concerne qu'une part infime de notre jeunesse mais cette part infime a aujourd'hui un impact considérable sur la vie des quartiers et constitue l'une des préoccupations majeures de la police nationale tant sous l'angle qui lui est propre, celui de la prévention et de la répression, que sous celui où elle n'intervient que de manière accessoire ou complémentaire, c'est-à-dire le traitement judiciaire ou éducatif des situations individuelles.
Quelles sont les réponses apportées par la police nationale ? A l'échelon gouvernemental, le problème posé par la délinquance des mineurs a fait l'objet de trois conseils de sécurité intérieure en 1998, en janvier 1999 et en janvier 2001.
De façon synthétique, disons que trois catégories de mesures ont été prises. Les premières, d'ordre structurel, concernent l'organisation des services de sécurité publique ; les deuxièmes, de fond, sont relatives à la prise en charge pénale ou éducative des mineurs délinquants les plus difficiles, à la responsabilisation des parents ou à l'amélioration de l'accès des jeunes à l'emploi ; enfin, les troisièmes, de nature opérationnelle, concernent certaines formes de délinquance des mineurs. Je pense notamment à la lutte contre la violence à l'école et dans le sport.
S'agissant des mesures structurelles, le CSI a décidé de créer de nouvelles brigades des mineurs sur l'ensemble du territoire concerné par la police nationale. A leurs compétences traditionnelles, à savoir le traitement des mineurs victimes, s'est ajouté le suivi des affaires relatives à des mineurs délinquants particulièrement jeunes ou auteurs d'infractions très graves. Cette compétence a également été étendue au traitement des violences en milieu scolaire et, de manière plus traditionnelle, à la prévention et à la protection des mineurs : enquête sociale, recherche de mineurs en fugue, absence scolaire.
A ce développement des brigades des mineurs, dont l'action a changé de nature, s'est ajoutée la création d'officiers référents « jeunes » dans chaque direction départementale de la sécurité publique associés, dans chaque circonscription de la sécurité publique -il peut y avoir plusieurs circonscriptions au niveau d'un département- à un correspondant « jeunes ».
Ce triptyque référent départemental-brigade des mineurs-correspondant local vise à avoir, dans chaque direction départementale de la sécurité publique et dans chaque circonscription, de véritables spécialistes de la délinquance des mineurs, marginaux ou délinquants.
Ces spécialistes jouent un triple rôle : ils assurent, d'abord, le traitement de la délinquance ; ils constituent, ensuite, une interface, en tant qu'interlocuteurs bien identifiés, avec l'ensemble des partenaires, tels que les administrations, les différents services, au premier rang desquels bien sûr la justice, ou les structures partenariales avec lesquelles les policiers sont amenés à travailler ; enfin, ils développent des actions permettant de nouer un dialogue positif entre les jeunes et la police.
Leur rôle, en tant qu'interlocuteurs de l'Education nationale et de la justice, dans le suivi des mineurs délinquants, est fondamental. Il en est de même de la part qu'ils ont prise dans l'élaboration des contrats locaux de sécurité au côté des commissaires de police et des chefs de circonscription.
S'agissant des mesures de fond, la nécessité d'éloigner les mineurs délinquants réitérants, voire multirécidivistes, de leurs quartiers et de développer à cet effet des centres de placement immédiat et des centres éducatifs renforcés répond à une préconisation du monde policier et à une grande attente de la population concernée par ces phénomènes.
Il est parfaitement clair, tant pour les policiers que pour nombre de nos partenaires, que le maintien de certains mineurs délinquants, au seul bénéfice d'une mesure éducative, dans le quartier où ils commettent leurs méfaits et ont un rôle de leadership nuit au travail préventif, éducatif et d'encadrement réalisé par ailleurs. Il conforte un sentiment d'impunité chez les plus jeunes et constitue en quelque sorte un contre-exemple qui entraîne une escalade dans l'échelle de la délinquance.
Partant de là, la multiplication de ce type de structures d'accueil permettant une mise à l'écart pour un temps déterminé paraît une solution nécessaire. Ces structures constituent aujourd'hui, en dehors de la détention provisoire étroitement encadrée par l'ordonnance de 1945, la seule véritable possibilité de placement en urgence de mineurs nécessitant un encadrement hors de leur localité ou de leur territoire, comme ils disent, d'origine.
Il existe, à ce jour, trente-trois centres de placement immédiat pouvant accueillir chacun dix mineurs et quarante-quatre centres éducatifs renforcés pouvant prendre en charge chacun six à sept mineurs. Cet effort ne peut qu'être poursuivi et accéléré.
S'agissant des mesures opérationnelles, une collaboration de plus en plus étroite a été instaurée avec les services de l'Education nationale et a fait l'objet de plusieurs circulaires interministérielles. Cette relation repose sur un diagnostic précis pour chaque établissement scolaire rencontrant des problèmes de violence et sur l'élaboration d'un véritable plan de lutte contre la violence associant les responsables de l'établissement et les services locaux de police. Une liaison permanente est établie avec un correspondant scolaire qui est souvent le correspondant « jeunes ».
Enfin, cette relation se traduit par le signalement à l'autorité judiciaire, aux autorités académiques et aux services de police des mineurs ayant commis des actes de violence au sein de l'établissement ou aux abords de celui-ci.
Ce travail en profondeur permet de prendre en compte à la fois les besoins généraux de l'établissement en matière de sécurité, tels qu'une patrouille ou une présence policière aux heures de sortie, et, en liaison avec le Parquet, les besoins individuels ou familiaux des mineurs dont le comportement est potentiellement dangereux.
Par ailleurs, la politique de lutte contre la violence a été étendue au sport dans vingt-six départements. Cette action est partie d'un constat, à savoir le développement de la violence dans les stades ou aux abords de ceux-ci tant comme défoulement collectif qu'en tant que prolongement de rivalités apparues entre groupes de jeunes de quartiers ou de communes différents.
Des officiers de prévention de la violence dans le sport ont ainsi été désignés pour assurer une liaison constante avec les responsables des clubs et analyser les risques des compétitions à venir comme des incidents déjà survenus afin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour en prévenir le renouvellement.
Cette politique de sécurité autour de l'activité sportive, notamment du football, commence à porter ses fruits. Nous avons notamment de bons exemples en ce sens en Seine-Saint-Denis. Ces correspondants « jeunes » sont les conseillers naturels des élus, des responsables des clubs sportifs et, lorsque des infractions sont commises, des victimes.
Mon propos serait incomplet si je ne citais pas deux autres types de mesures particulièrement importantes dans la lutte contre la délinquance des mineurs. La première mesure est la mise en place de la police de proximité qui est présente dans les quartiers et dont les acteurs sont bien identifiés : il s'agit d'un groupe de policiers qui est affecté à un secteur défini et qui est en contact permanent avec la population.
Le policier de proximité a en effet un rôle primordial à l'égard des mineurs à la fois par le dialogue qu'il doit entretenir avec eux, par le contact qu'il doit nouer et par le suivi des mineurs délinquants qu'il assure dans son secteur. Il renseigne l'officier correspondant « jeunes » ou la brigade des mineurs de la circonscription, rencontre les familles et les éducateurs et s'interpose, en cas de nécessité, entre les délinquants et les victimes de leurs agissements. Il dresse, enfin, les procédures judiciaires chaque fois qu'il le faut. Il est, en quelque sorte, par sa présence et son action, un rappel permanent de l'autorité et de la règle dont ont effectivement besoin les jeunes mineurs délinquants.
La seconde mesure importante concerne les contrats locaux de sécurité. Ils sont fondés sur un diagnostic des problèmes de sécurité et de leurs causes avec les élus des communes signataires et l'ensemble des partenaires concernés, au premier rang desquels la police et la justice. Il s'agit, à partir de ce diagnostic, de définir des objectifs et des moyens propres à remédier aux situations et aux difficultés rencontrées.
La délinquance et la violence des mineurs doivent être au premier rang de ces préoccupations. Les contrats locaux de sécurité permettent, dans ce domaine, de mettre en oeuvre des actions ponctuelles ou permanentes, dont l'efficacité tient au partenariat, comme la prise en compte éducative des primo- délinquants.
De telles expériences ont été tentées non sans résultat dans plusieurs communes. Elles ouvrent la voie à une collaboration intéressante des collectivités locales sous l'égide d'un magistrat en mission de la protection judiciaire de la jeunesse mais elles devraient certainement être étendues. Un ralliement sans réserve des magistrats des enfants comme des fonctionnaires de la PJJ est nécessaire pour aboutir.
Je conclurai mon propos liminaire en évoquant quelques actions préventives menées par les services de la police nationale, notamment ceux de la sécurité publique, qui encadrent déjà depuis de nombreuses années des mineurs des quartiers sensibles dans ce que nous appelons les « centres de loisirs de jeunes ». En 2001, 54 CLJ sur 59 sites ont été créés dans 37 départements, mobilisant plus de 300 policiers et 167 adjoints de sécurité, et ont ainsi contribué à l'intégration citoyenne des jeunes en leur offrant des activités à la fois sportives, éducatives ou simplement ludiques.
Des opérations ponctuelles sont également développées pendant la période estivale. Ce dispositif a concerné près de 82 000 jeunes pendant l'été 2001. Il est en outre complété par des missions d'information notamment sur l'usage des stupéfiants et ses dangers. Cette mission est assurée par 300 fonctionnaires spécialisés qui traitent aussi de la violence, du racket scolaire et des conduites à risque. En 2001, plus de 10.000 actions de ce type ont été menées par les services de police et ont concerné plus de 320.000 personnes, jeunes ou parents.
La police nationale, vous le voyez, développe donc, depuis de nombreuses années, une politique globale, multiforme et adaptée faisant appel à un large partenariat pour lutter contre la délinquance des mineurs ou y contribuer.
Les efforts consentis en ce domaine ont commencé à porter leurs fruits même s'il faut être très prudent en la matière. En 2001, le nombre de mineurs délinquants a ainsi diminué de près de 2 % par rapport à 2000. Ces résultats doivent cependant nous conduire à renforcer encore notre action afin de diminuer les actes de violence commis par les mineurs réitérants. Ils ne seront d'ailleurs significatifs que s'ils trouvent leur prolongement, éducatif ou répressif, dans un traitement judiciaire efficace.
A ce titre, outre le regroupement des procédures concernant un même mineur délinquant, la comparution immédiate devrait être possible pour les multiréitérants dont la situation familiale et sociale est connue et ne nécessite donc pas d'enquêtes complémentaires.
A leur égard, la rapidité de la réaction sociale, l'éloignement immédiat de leur territoire ainsi que l'exécution des décisions de condamnation ont une véritable valeur éducative et, pour ceux qu'ils entraînent, une réelle valeur d'exemple. A cet effet, ces actions de mise à l'écart des quartiers pour une durée déterminée doivent être à l'avenir plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui.
La protection judiciaire de la jeunesse dispose des centres de placement immédiat et des centres éducatifs renforcés qui permettent de placer quelques centaines de jeunes. Mais les besoins sont bien plus importants. Pour le seul département de la Seine-Saint-Denis, les experts, quels qu'ils soient, estiment qu'il faudrait 1.000 à 1.500 places.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous avez souligné l'augmentation du nombre des délits et de la violence ainsi qu'un rajeunissement des jeunes qui commettent ces actes. M. Roché estime que 15 % environ des délits sont connus de la police. Ce taux vous paraît-il réaliste ?
M. Patrice Bergougnoux - Cette observation renvoie à une question plus générale qui est celle de la statistique de la délinquance. Les services de police et de gendarmerie comptabilisent les faits qui sont portés à leur connaissance ou qu'ils relèvent à travers leurs activités quotidiennes et qui font l'objet d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire d'une transmission à l'autorité judiciaire. C'est ce que nous appelons l'état statistique « 4001 ».
Ces statistiques n'ont bien entendu jamais eu la prétention de comptabiliser l'ensemble des actes de délinquance commis sur le territoire national. Une partie de la délinquance n'est pas connue. Elle n'est donc pas comptabilisée parce qu'elle n'a pas été signalée à la police ou n'a pas été relevée par elle. C'est ce que nous appelons plus simplement le « chiffre noir » de la délinquance.
Des initiatives se sont développées pour essayer d'analyser ce que représente cette part -cela vaut tant pour la délinquance des mineurs que pour la délinquance en général -à travers des outils complémentaires, comme les enquêtes de victimation. Mais celles-ci doivent être aussi manipulées avec une certaine précaution car elles sont le reflet non pas de la délinquance mais du sentiment ressenti par la population, c'est-à-dire non pas par les victimes mais par ceux qui répondent aux questions posées. Ces chiffres n'ont rien de commun avec les statistiques rappelées à l'instant ou celles que vous avez évoquées.
En tout état de cause, la part des mis en cause mineurs dans la délinquance générale n'a pas cessé d'augmenter depuis une dizaine d'années. Les statistiques montrent certes une légère diminution de 1,80 % en 2001 mais elle n'est pas significative. Il faut regarder la tendance.
M. le président - Je voudrais être certain d'avoir bien compris. Une personne se fait arracher son sac par un individu qui roule en scooter. Elle a le sentiment que c'est quelqu'un de jeune. Elle va déposer plainte ou inscrit cette agression sur une main courante. L'agresseur n'est pas retrouvé car il était casqué. Dans quelle catégorie entre cette agression ?
M. Patrice Bergougnoux - Si la personne dépose plainte, cette agression est enregistrée comme un délit qui fera l'objet d'une procédure judiciaire. Puis, la police fera des investigations pour rechercher l'auteur. Une fois celui-ci retrouvé, on pourra dire s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur.
M. le président - A partir de quel moment cette agression figure-t-elle dans les statistiques ?
M. Patrice Bergougnoux - Elle figure dès le dépôt de plainte, c'est-à-dire dès l'enregistrement des faits par les services de police. Par exemple, un fait délictuel ou présumé tel est enregistré et instruit par un service de police puis transmis à l'autorité judiciaire. Si celle-ci classe cette affaire, elle reste dans les statistiques de la police comme un fait constaté. Il n'y a pas de retour. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations des services de police.
Pour être plus proches des victimes et leur apporter un meilleur service public, nous estimons qu'il serait intéressant d'avoir un retour des suites judiciaires données à l'enquête de la police afin d'en informer les victimes. Cela permettrait de contribuer à notre objectif de lutte contre le sentiment d'insécurité. Il est également important pour la victime de savoir quelle suite a en définitive été donnée à sa plainte. Nous nous efforçons de parvenir à ce résultat mais le dispositif existant ne nous le permet pas encore de façon généralisée.
M. Bernard Plasait - Quand vous dites que vous constatez une baisse de 1,80 % en 2001, s'agit-il d'une baisse de la délinquance des mineurs ou de la part de cette délinquance dans la délinquance générale ?
M. Patrice Bergougnoux - Il s'agit de la baisse de la part des mis en cause mineurs dans la délinquance générale.
M. Jean-François Humbert - L'absence de retour des suites données par l'institution judiciaire aux services de police a-t-elle une influence sur le comportement de nos concitoyens dans leur décision de déposer plainte ?
M. Patrice Bergougnoux - Il est utile d'informer les citoyens et la victime des suites données à l'affaire que cette dernière a soumise au service public de police ou de gendarmerie. Il serait nécessaire d'avoir non seulement une statistique de la délinquance établie par la police mais aussi une statistique judiciaire permettant à la fois d'informer individuellement les victimes et de donner à l'opinion les renseignements concernant les suites judiciaires données aux affaires en général. L'idéal serait bien sûr d'informer chaque victime.
M. Jean-François Humbert - J'ai été victime une première fois, voilà une vingtaine d'années, d'un « casse » de ma voiture. Quelques mois après le dépôt de ma plainte, j'ai reçu un courrier du procureur de la République m'informant du classement sans suite de celle-ci. Plus récemment -sans doute est-ce la loi des séries ?- j'ai subi trois autres « casses » en deux ans et demi. J'attends toujours des informations des services de police ou de justice sur les suites données à mes plaintes.
Les statistiques que vous nous donnez ne doivent pas encourager les victimes à déposer plainte de manière systématique. Il est vrai que, en ce qui me concerne, je ne me suis pas rendu au commissariat la troisième fois. N'ayant toujours pas de nouvelles des deux premières plaintes, je n'ai pas jugé utile de me déplacer une nouvelle fois.
A-t-on une idée précise de l'influence sur les statistiques du comportement de ceux qui en ont un peu marre de perdre leur temps à déposer des plaintes qui sont ensuite classées purement et simplement sans qu'ils en soient informés ? Certains nous dissuadent même parfois dans les commissariats de déposer plainte.
M. Patrice Bergougnoux - Il est difficile, par définition, de répondre à votre question. Cela dit, l'action conduite au cours des dernières années a justement consisté à faciliter les dépôts de plainte. Une disposition législative de 2000, par exemple, autorise ce dépôt dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie, quel que soit le lieu où l'infraction a été commise, ce qui n'était pas possible auparavant.
De même, le déploiement de la police de proximité avec la mise en place à travers le pays de 900 implantations immobilières nouvelles facilite le dépôt de plainte. Un ensemble de dispositions sont donc prises pour aller dans le sens que vous souhaitez.
En fait, deux problèmes se posent : d'une part, la possibilité offerte aux citoyens de déposer plainte et, d'autre part, l'élucidation de l'affaire soumise par ceux-ci à la police. En la matière, il est vrai que, s'agissant de la délinquance en général, le taux d'élucidation se situe entre 22 % et 23 %. Une part importante des affaires n'est donc pas résolue, les auteurs n'étant pas identifiés.
Si l'on entre dans le détail, on s'aperçoit que ce taux est beaucoup plus élevé pour les affaires criminelles graves, notamment pour les crimes où 65 % à 70 % des affaires sont élucidées, que pour les faits de petite et moyenne délinquance.
M. Christian Decharrière - Nous ne disposons pas d'enquêtes mesurant le taux de non-dépôt de plaintes pour des faits qualifiés pénalement de crimes ou de délits. En revanche, par certaines enquêtes de victimation, nous savons que près de 40 % des faits perçus comme délictuels par nos concitoyens ne donnent pas lieu à dépôt de plainte.
Cela dit, il faut être très prudent : on a tendance à faire des comparaisons entre les enquêtes de victimation et l'état statistique « 4001 ». Or, ils ne mesurent pas les mêmes choses. Les enquêtes de victimation intègrent notamment les menaces. Elles ne se préoccupent pas de savoir si les faits perçus comme étant une agression sont de nature délictuelle, criminelle ou contraventionnelle, voire non qualifiables pénalement. C'est très important. Il existe des distorsions fondamentales.
A travers les enquêtes d'opinion autour des enquêtes de victimation, nous savons que la première des raisons qui justifie l'absence de dépôt de plainte est que l'intéressé n'a pas estimé les faits suffisamment graves. Le fait que l'auteur ne sera pas retrouvé et l'absence de suites judiciaires ne vient qu'après.
M. le rapporteur s'est interrogé sur l'évaluation de M. Roché. Je me suis livré à un petit calcul. Si 15 % seulement des crimes et délits sont déclarés, cela signifie, compte tenu du fait que nous en avons enregistré environ 4 millions en 2001, qu'un peu plus 26 millions sont commis en France. Voilà qui dépasse très largement les conclusions de toutes les enquêtes de victimation réalisées jusqu'à présent, d'où l'intérêt d'affiner les chiffres.
M. le président - Il ne s'agissait que des mineurs.
M. Christian Decharrière - Je ne l'avais pas compris ainsi.
M. le rapporteur - Lors de nos différents déplacements tant en France qu'à l'étranger, nous avons été surpris par la grande imagination dont font preuve les délinquants pour contrecarrer, voire anticiper l'organisation de la police, s'agissant tant des horaires que des méthodes de détection et d'investigation. Qu'en pensez-vous ?
Toujours selon M. Roché, l'un des premiers facteurs qui déclenche le passage à l'acte pour un mineur est le sentiment de réussir, du « pas vu, pas pris ». L'organisation qui est la vôtre sur l'ensemble du territoire vous paraît-elle suffisante ? L'emplacement des commissariats, notamment, est-il bien adapté ?
M. Patrice Bergougnoux - Vous évoquez une question aussi vieille que l'humanité, à savoir l'adaptation de ceux qui commettent des actes de délinquance au dispositif de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Il y a une course permanente. C'est vrai tout particulièrement pour la criminalité organisée mais aussi pour la petite et moyenne délinquance qui perturbe le plus la vie de nos concitoyens et qui est finalement le plus mal ressentie par eux.
Notre dispositif est-il idéal ? Il serait présomptueux de ma part de vous répondre par l'affirmative. Vous ne me croiriez d'ailleurs pas. Nous avons tenté, à travers le déploiement de la police de proximité, de mieux répondre à cette nécessité d'occuper le terrain et d'être présent notamment dans les plages horaires où les besoins de sécurité ressentis sont les plus grands, c'est-à-dire notamment en soirée.
Par ailleurs, un nombre important mais probablement encore insuffisant de structures immobilières de police ont été mises en place pour servir de points d'appui aux équipes de policiers de proximité. J'évoquais tout à l'heure le chiffre de 900 implantations immobilières nouvelles de la police nationale au cours des deux dernières années.
Le souci d'adapter le dispositif de la police nationale aux différentes formes de délinquance rencontrées sur notre territoire est réel. Il faut bien évidemment prolonger cet effort et améliorer probablement encore les moyens tant matériels qu'humains mis à la disposition de la police de proximité afin de mieux répondre à ces besoins de sécurité, notamment dans les secteurs urbains sensibles.
M. Christian Decharrière - Effectivement, ont été créées ou sont en voie de l'être dans les 462 circonscriptions de sécurité publique 900 implantations décentralisées par rapport aux commissariats centraux, ce qui portera leur nombre à 1 700 lorsque tous ces projets seront concrétisés.
M. Patrice Bergougnoux - Il est vrai que la délinquance s'adapte au dispositif mis en place par la police et la gendarmerie. Je prendrai un exemple quelque peu éloigné des problèmes de sécurité au quotidien mais qui illustre bien cet aspect. Nous avons mis en oeuvre un plan lourd de sécurité pour permettre le bon déroulement de la mise en place de l'euro à travers un système de sécurisation des dispositifs de transport de fonds, des agences bancaires, des bureaux de poste et des caisses d'épargne. Durant cette période, les malfrats ont changé d'objectifs.
Nous avons vu baisser très sensiblement le nombre d'attaques de banques, de caisses d'épargne et de véhicules de transport de fonds alors que, dans la période précédant immédiatement la mise en place de l'euro, nous avions connu une certaine recrudescence de ce dernier type d'agressions. Le monde délinquant et criminel s'adapte donc effectivement aux moyens mis en oeuvre. Cela vaut aussi certainement pour les dispositifs de police de proximité au quotidien. C'est une course permanente entre les autorités, les services de sécurité et les délinquants.
M. le rapporteur - Le développement de la police de proximité, qui est souhaitable et même nécessaire, ne s'est-il pas fait au détriment de la police judiciaire ou d'investigation ? En un mot, n'a-t-on pas déshabillé Paul pour habiller Pierre ?
M. Patrice Bergougnoux - Les effectifs des Renseignements généraux, de la police judiciaire et de la DST ont été maintenus, voire renforcés depuis un an, notamment après les terribles événements du mois de septembre.
Nous avons enregistré 7 000 créations nettes d'emplois de policiers, qui ont permis, à hauteur de 5 000 environ, de renforcer les services de la sécurité publique afin d'assurer le déploiement de la police de proximité. Je ne dis pas que c'est suffisant. Le Gouvernement m'avait demandé d'établir une démarche stratégique pour la police nationale. Dans cette démarche, s'expriment des besoins nouveaux tant en effectifs qu'en moyens de tous ordres pour mener à son terme dans de bonnes conditions le déploiement de la police de proximité.
M. le président - Quelle action devrait être entreprise en priorité ? Nous entendons régulièrement toutes les statistiques et tous les éléments que vous nous donnez. Lorsque j'étais rapporteur du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, le ministre de l'intérieur les a, à son tour, repris.
Cependant, en tant que maire d'une commune de banlieue, j'entends très souvent dire que des citoyens qui ont appelé le commissariat se sont vu répondre qu'il ne pouvait pas intervenir faute d'effectifs. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Ces effectifs que vous annoncez sont évidemment sincères -je ne suppose pas un instant qu'ils ne le soient pas- ...
M. Patrice Bergougnoux - Regardez la loi de finances !
M. le président - Mais où passent-ils ? Quel est votre sentiment en tant que praticien ? Pensez-vous vraiment que nos effectifs sont employés comme il le faudrait ?
Par ailleurs, j'avais cru comprendre que, par rapport aux pays comparables au nôtre, nos effectifs de police étaient les plus nombreux.
M. Patrice Bergougnoux - Cette affirmation est totalement fausse.
M. le président - Vous me rassurez d'une certaine manière !
M. Patrice Bergougnoux - Je vous donnerai quelques indications approximatives car je n'ai pas les chiffres précis en tête. Nos effectifs ne sont pas les plus nombreux. Si nous additionnons ceux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la police municipale, nous sommes très en deçà de ceux de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et nous nous situons au milieu du tableau des quinze pays de l'Union.
Certains Etats ont majoritairement des polices locales, comme l'Allemagne. D'autres ont des polices ou des gendarmeries nationales, comme la France, l'Espagne et l'Italie. A cet égard, je tiens d'ailleurs à votre disposition une étude réalisée à mon initiative par le service de coopération de la police nationale qui a fait le tour des pays européens et qui corrobore mes propos.
M. Bernard Plasait - L'une de vos réponses me surprend beaucoup. Je voudrais être certain de l'avoir bien comprise. La police de proximité, avez-vous dit, a été créée sans retirer d'effectifs aux services de la police judiciaire. A Paris, par exemple...
M. Patrice Bergougnoux - La situation dans la capitale est quelque peu différente. Il a été en effet procédé à une profonde réorganisation des services de la préfecture de police. Ainsi, ont été regroupés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la « direction de la police urbaine de proximité » les commissariats d'arrondissement et les commissariats de quartier. Ces derniers, dans l'ancienne organisation, relevaient de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police.
Aujourd'hui, ils ne relèvent donc plus de cette dernière mais de la DPUP, la direction de la police urbaine de proximité. Pour autant, il ne s'agit pas là de suppression de moyens : ses missions sont toujours remplies, mais c'est désormais la police urbaine de proximité qui en assure une partie.
M. Bernard Plasait - Une partie des missions de la police judiciaire a donc été dévolue à la police de proximité ?
M. Patrice Bergougnoux - Absolument. Ainsi, les points dans lesquels les Parisiens ou les Franciliens qui viennent travailler à Paris et qui sont victimes de la délinquance peuvent déposer une plainte se sont considérablement multipliés.
Auparavant, les plaintes ne pouvaient être déposées que dans les commissariats de quartier. Désormais, elles pourront l'être également dans les commissariats d'arrondissement ou dans les bureaux de police de l'ex-sécurité publique.
M. Bernard Plasait - Dans ces conditions, si les policiers recueillent davantage de plaintes plus facilement, ils sont moins présents sur le terrain pour faire des investigations.
M. Patrice Bergougnoux - Non, car la police urbaine de proximité recueille les plaintes et mène aussi les investigations, bien évidemment.
M. Bernard Plasait - Chaque policier a-t-il alors davantage d'heures de travail ?
M. Patrice Bergougnoux - Mais non ! C'est l'organisation qui est différente.
M. Bernard Plasait - Pourtant, si à effectifs constants, la police de proximité est plus souvent sur le terrain pour recueillir des plaintes, elle est forcément moins disponible pour les investigations ; ou alors chaque policier travaille davantage.
M. Patrice Bergougnoux - Non, les policiers ne travaillent pas davantage ; ils travaillent différemment. A Paris, la répartition des tâches entre la police judiciaire et la police urbaine de proximité permet de répondre aux besoins de nos concitoyens. Cette nouvelle organisation de la préfecture de police a entraîné un travail différent pour les policiers. Elle a d'ailleurs été difficile à mettre en oeuvre parce que la préfecture de police avait le même fonctionnement depuis le début de son existence.
M. Bernard Plasait - C'est une longue histoire !
M. Patrice Bergougnoux - Néanmoins, tout s'est passé, je crois, dans de bonnes conditions.
M. Bernard Plasait - C'est ce qui importe. De votre point de vue, est-ce une réussite ?
M. Patrice Bergougnoux - Il ne m'appartient pas d'en juger. Il me semble que cette nouvelle organisation permet de mieux répondre aux besoins des Parisiens. Vous avez certainement en tête comme moi l'exemple de victimes se présentant dans un commissariat et renvoyées dans un autre qui ne les convoquait que le lendemain, voire le surlendemain, parce que le premier n'avait pas la compétence pour recueillir leurs plaintes.
Aujourd'hui, avec la mise en place de la police urbaine de proximité, il est possible de s'adresser à n'importe quel commissariat d'arrondissement ou de quartier pour déposer une plainte. Il s'agit donc d'une amélioration du service public « Police » : les gens peuvent désormais obtenir une réponse à leurs problèmes là où ils se présentent.
M. Bernard Plasait - Sans doute.
M. Jean-Jacques Hyest - Monsieur le directeur général, je suis un peu surpris de vos affirmations concernant les comparaisons européennes en matière d'effectifs de police.
M. Patrice Bergougnoux - Je vous transmettrai le document.
M. Jean-Jacques Hyest - J'ai eu l'occasion d'écrire un rapport fondé sur des éléments sérieux fournis par le ministère de l'intérieur ; si vos affirmations sont avérées, c'est que les chiffres du ministère de l'intérieur ont beaucoup changé ! La France se situe effectivement au-dessous de l'Espagne et de l'Italie -mais de très peu- mais ce n'est pas le cas par rapport à la Grande-Bretagne.
Par ailleurs, comme vous l'avez d'ailleurs dit d'une certaine manière, monsieur le directeur général, il est évident que la mise en place de la police de proximité implique que les délinquants qui sont désormais plus surveillés dans certains endroits vont faire leurs bêtises ailleurs. Or, les zones périurbaines situées en zones de gendarmerie n'ont pas bénéficié d'une augmentation des effectifs à due concurrence de la mise en place de la police de proximité en d'autres lieux.
En Seine-et-Marne par exemple, les statistiques concernant les zones de police pour 2001 sont comparables à la moyenne nationale. En revanche, on constate une « explosion » des chiffres dans les zones de gendarmerie proches des zones de police : il doit bien y avoir un rapport entre les deux. Il est donc extrêmement dangereux de ne prévoir la police de proximité que dans certains endroits et non partout.
Bien entendu, au-delà des comparaisons avec d'autres pays, la question qui demeure porte sur l'évolution des effectifs de police et de leur répartition en fonction non seulement des modifications de populations, mais aussi de certains éléments objectifs relatifs à la délinquance. De votre point de vue, y a-t-il des évolutions significatives du paysage entre les zones de la police et celles de la gendarmerie ? Les effectifs ont-ils augmenté plus particulièrement dans les vingt-six départements qui avaient été jugés les plus sensibles, ou ont-ils augmenté partout pour faire plaisir à tout le monde ?
M. Patrice Bergougnoux - Monsieur le sénateur, 75 % des faits de délinquance et de criminalité sont commis en zones de police et 25 % en zones de gendarmerie. Ce rapport est à peu près stable malgré les évolutions récentes que vous évoquez. Ces dernières ont d'ailleurs eu tendance à s'atténuer dans les zones de gendarmerie au cours du dernier trimestre 2001 et du début de l'année 2002, quoique de façon moins forte il est vrai que dans les zones de police, où la situation au début de cette année 2002 est en nette amélioration, sur le plan statistique bien sûr.
S'agissant de l'évolution des effectifs de la police nationale sous l'angle de la sécurité publique, on peut dire que la mise en place de la police de proximité a permis d'augmenter les moyens humains des circonscriptions concernées -lors de la première, de la deuxième ou de la troisième phase qui se déroule actuellement- de 8 % à 10 % par rapport au 1er janvier 1999.
Une fois ce renforcement des moyens de la sécurité publique achevé, il faudra évidemment en faire une évaluation et ajuster les effectifs par rapport au fonctionnement des circonscriptions de sécurité publique, pour permettre l'exercice dans de bonnes conditions de la police de proximité. Dans certaines circonscriptions en effet, afin de ne pas démultiplier les moyens humains, deux secteurs seulement ont été ouverts alors qu'il en faudrait trois pour être plus proche de la population. De ce point de vue, de nouveaux moyens seront probablement à déployer pour permettre une occupation du terrain qui soit encore plus satisfaisante qu'aujourd'hui.
En vous disant tout cela, monsieur le sénateur, je ne réponds pas à votre question concernant la situation des zones de gendarmerie, mais vous savez que ce n'est pas de ma compétence directe.
M. Jean-Jacques Hyest - Il devrait y avoir une coopération obligatoire entre la police et la gendarmerie pour aboutir à des solutions équilibrées.
M. Patrice Bergougnoux - Absolument.
M. le rapporteur - Quant aux brigades des mineurs, outre leur vocation à s'occuper des victimes, elles s'occupent aussi des délinquants. Est-ce vrai sur l'ensemble du territoire ?
M. Christian Decharrière - On dénombre 109 brigades des mineurs sur l'ensemble du territoire couvert par la sécurité publique. Il y a donc un certain nombre de circonscriptions où il n'y en a pas ; mais alors certains personnels, au sein des services d'investigation et de recherche, sont plus spécialisés en matière de traitement des problèmes relatifs aux mineurs.
Par ailleurs, il faut préciser que, parmi les 109 brigades, sept d'entre elles, sur la couronne parisienne, sont rattachées à la sûreté départementale et couvrent l'ensemble des circonscriptions du département.
Il ne faut donc pas rapporter strictement le nombre de brigades des mineurs aux 462 circonscriptions de sécurité publique puisque, d'une part, de nombreuses circonscriptions sont situées dans la couronne parisienne et que, d'autre part, sans créer de brigade des mineurs, on spécialise certains personnels sur ce type de questions.
M. Jean-François Humbert - Je crois avoir entendu voilà quelques semaines, à la fin du mois de mars ou au tout début du mois d'avril, un certain nombre d'informations indiquant une baisse de la criminalité en France. Si c'est bien le cas, une part importante de cette baisse est-elle due à la baisse de la criminalité des mineurs, et, si oui, laquelle ?
M. Patrice Bergougnoux - Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu, en 2001, une légère réduction de la part des mises en cause de mineurs dans la délinquance générale de l'ordre de 2 %. Cela dit, cette réduction n'est pas la cause de l'amélioration des statistiques de la délinquance au cours du deuxième semestre 2001, notamment du dernier trimestre, et de ce début d'année 2002.
A cet égard, la délinquance des mineurs «réitérants» ou multirécidivistes reste un problème entier et lourd pour la sécurité publique dans les années qui viennent. Il est nécessaire, de ce point de vue, de renforcer les moyens permettant -je l'ai évoqué assez lourdement tout à l'heure- d'éloigner temporairement du territoire sur lequel ils sévissent les jeunes connus comme multirécidivistes. Cela doit servir d'exemple pour les autres mais aussi pour eux-mêmes. C'est l'une des voies indispensables à suivre pour apporter de meilleures réponses aux problèmes de la délinquance dans les quartiers sensibles.
M. Bernard Plasait - Est-ce le fameux agrégat plutôt contesté « violences urbaines », qui regroupe à la fois les violences contre les personnes, les vols de voitures et les cambriolages, qui a tendance à diminuer ?
M. Patrice Bergougnoux - Il n'existe pas d'agrégat « violences urbaines » dans l'état statistique « 4001 » de la police. Le phénomène qu'on appelle « violences urbaines » ne correspond pas à une qualification pénale mais recouvre un ensemble de délits qui, eux, sont qualifiés pénalement. Ces « violences urbaines », telles qu'on les entend, représentent une part infime de la délinquance générale.
En ce qui concerne les faits de violence contre les personnes et qui, eux, constituent l'un des agrégats figurant à l'état statistique « 4001 » et correspondent à des qualifications pénales, on observe depuis plus de vingt ans une augmentation annuelle : c'est une tendance lourde. Cet agrégat, qui ne cesse de croître, représente aujourd'hui quelque 300.000 faits constatés, à rapporter à la délinquance générale, qui représente un peu plus de 4 millions de faits constatés. Il faut observer et lutter contre ce phénomène d'augmentation permanente, constaté depuis plus de vingt ans, quasiment depuis la création de la statistique de la police en 1972. A l'époque, le niveau de l'agrégat « violences contre les personnes » était de l'ordre de 120.000 faits constatés.
Voilà quelques observations à la fois sur les violences urbaines et sur les violences contre les personnes qui représentent le défi majeur pour nos services de sécurité dans les années qui viennent.
M. Laurent Béteille - On a beaucoup parlé des moyens en personnels ; en ce qui concerne le matériel -les véhicules et l'informatique par exemple-, estimez-vous être au niveau souhaité ou y a-t-il encore beaucoup de choses à faire ?
M. Patrice Bergougnoux - Il reste beaucoup à faire. Nous sommes en train de moderniser et de rénover le système de transmission et de communication de la police nationale : c'est en effet un système analogique obsolète, qui n'est pas crypté et donc pas protégé ; tout le monde peut, en se dotant de quelques moyens achetés « au coin de la rue », capter et écouter les communications de la police, celles d'un commissariat en Seine-et-Marne comme celles des forces de gendarmerie mobile ou de CRS qui viennent en renfort dans tel ou tel endroit.
M. Jean-Jacques Hyest - Parfois, le système ne fonctionne même plus !
M. Patrice Bergougnoux - Effectivement ! Le projet « ACROPOL » prévoit ainsi la mise en oeuvre d'un système de communication et de transmission numérique crypté, protégé, qui va permettre de donner à la police nationale des moyens de transmission sûrs et efficaces dans les années qui viennent. Nous allons procéder, à raison de douze départements par an, au déploiement de ce dispositif à travers le territoire. Celui-ci a commencé dans une douzaine de départements, notamment en région parisienne ; Paris est ainsi couvert depuis le 1er avril dernier. Le programme de couverture de l'ensemble du territoire national devrait s'achever vers 2007-2008. C'est un projet extrêmement coûteux : 450 millions de francs sont ainsi prévus dans le budget 2002 pour la mise en place du système.
S'agissant des moyens plus classiques de fonctionnement de la police nationale, il existe un besoin important de renouvellement et de renforcement des moyens automobiles. Les véhicules des policiers sont utilisés de façon très intensive et s'usent beaucoup plus rapidement que les véhicules utilisés dans d'autres métiers -sauf peut-être pour les VRP- ou par les particuliers. A cet égard, lors de la mise en place de la police de proximité, nous avons augmenté de façon importante -un millier de véhicules- le parc automobile de la police de sécurité publique.
Audition de Mme Marie-France PONELLE,
Avocate, responsable de l'antenne des
mineurs du barreau de Paris
(24 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons maintenant entendre Mme Marie-France Ponelle, avocate, responsable de l'antenne des mineurs du barreau de Paris.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment .)
Vous avez la parole, Maître.
Mme Marie-Françoise Ponelle - Au vu du peu de temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être très synthétique alors que la délinquance des mineurs est un sujet important. Ce sujet m'intéresse depuis que je suis avocate -cela fait plus de vingt-cinq ans- et, depuis lors, j'entends dire que cette délinquance est préoccupante, que les jeunes délinquants sont de plus en plus nombreux et violents.
Il va falloir d'abord trouver les causes de l'aggravation de la délinquance pour pouvoir, après, envisager les solutions de prévention et les sanctions adéquates, lorsque la prévention n'a pas été satisfaisante et que les enfants sont tombés dans cette dérive grave qu'est la délinquance « réitérante ».
Le constat actuel est très préoccupant : il est dû au désarroi et à la démission des familles ainsi qu'au retrait des éducateurs spécialisés. La justice, la police et l'école ont pris le relais de parents qui sont tout à fait désarmés devant l'agressivité et le manque de discipline de leurs enfants. Mais, quand un enfant n'a pas été habitué à ce qu'on lui fixe des règles, des limites, il est très difficile de faire marche arrière et d'arriver à le stabiliser. Par ailleurs, en faisant de faits divers très banaux, petits actes de délinquance ou petits délits, des faits de société, les médias ont aggravé la situation et le sentiment d'insécurité. Au demeurant, il est vrai qu'actuellement, dans les quartiers « chauds », les citoyens en ont « par-dessus la tête » des incivilités, de l'agressivité et de la violence des jeunes qui n'ont plus du tout de respect ; il y a un « ras-le-bol » complet.
Il faut absolument trouver des solutions à une situation qui dégénère. Contrairement à ce que beaucoup disent, on observe désormais au tribunal pour enfants une plus grande répression : les enfants sont de plus en plus sévèrement punis, avec des peines de prison, et les centres des jeunes détenus sont complètement débordés. Il est donc faux de dire que la justice des mineurs est laxiste et que les juges des enfants pensent beaucoup plus à l'éducatif qu'au répressif. Il existe actuellement une réponse judiciaire aux actes de délinquance et de nombreuses mesures répressives sont prises.
L'aggravation de la délinquance des mineurs n'est pas due à l'augmentation de la criminalité mais à l'accroissement des petits délits : les jeunes sont pénibles par leur violence et par toutes les incivilités qu'ils commettent. A ce propos, l'augmentation énorme des jeunes demandeurs d'asiles, de Yougoslavie d'abord puis de Roumanie, est à souligner. Il y a actuellement une recrudescence terrible de la délinquance de jeunes Roumains qui, au début, se sont attaqués aux horodateurs et qui commettent maintenant des délits plus graves en agressant des gens dans le métro ou dans l'autobus. Les tribunaux pour enfants ont du mal à apporter une réponse à la délinquance de ces mineurs qui arrivent en France en n'ayant ni papiers, ni parents, ni domicile. Ils sont victimes de réseaux mafieux criminels, « catapultés » par des adultes qui les utilisent. La justice des mineurs a donc beaucoup de mal à sortir d'affaires ces jeunes : ils quittent les foyers car ils n'ont pas été habitués à être enfermés, ils n'ont pas de scolarité car ils ne connaissent pas la langue, ils n'ont ni papiers ni référents parentaux. L'arrivée massive de ces jeunes est donc un facteur d'augmentation de la délinquance des mineurs dont on ne tient pas suffisamment compte.
Plus généralement, il faut étudier les causes réelles de cette augmentation pour trouver des solutions de prévention.
La première cause est la défaillance de l'autorité parentale. Il ne faut pas pour autant culpabiliser des parents qui, souvent dans une très grande précarité, éprouvent un grand désarroi devant l'agressivité et la violence de leurs enfants souvent livrés à eux-mêmes. Lorsque les parents n'inculquent pas les règles, les limites, à leurs enfants très jeunes et qu'ils ne commencent à se soucier d'eux que lorsqu'ils vont mal, il est souvent trop tard. Par la suite, la société a beaucoup de difficultés à apprendre le respect des règles à des enfants qui n'y ont pas été habitués dans leurs familles faibles ou laxistes. Pire encore, il y a des familles dans lesquelles on ne sait dialoguer que par la violence : victimes de l'indifférence, de coups, de maltraitance et d'abus sexuels, les enfants reproduisent à l'extérieur ce qu'ils vivent chez eux. De nombreux enfants délinquants ont ainsi, en même temps qu'un dossier de délinquance, un dossier d'assistance éducative tant leur vie, dans leur famille, est difficile et tant ils sont dans un mal-être qui entraîne un « mal-faire ». En effet, un jeune ne devient pas délinquant par hasard : je n'ai jamais rencontré de mineurs délinquants « réitérants » qui n'aient pas des problèmes psychologiques, sociaux ou familiaux.
Soutenir les familles qui sont dans un état pathologique est donc l'un des points les plus importants : il faut créer beaucoup plus d'internats, de lieux d'accueil, pour que les enfants qui vivent dans des milieux qui « fomentent » la délinquance ne puissent plus continuer à mal agir.
Par ailleurs, certains enfants ont à faire face à de nombreuses difficultés liées aux handicaps sociaux de leurs parents, tels que les problèmes d'immigration et de chômage. Complètement fascinés par la société de consommation, les enfants de la deuxième génération se révoltent, ne veulent plus respecter les modèles et les repères de leurs parents qui, souvent très démunis culturellement, sont complètement débordés et ont beaucoup de mal à faire observer des règles dans leur famille.
Il y aurait beaucoup à faire dans l'école. Les enfants y passent plus de temps que dans leur famille : c'est là où se révèlent leurs difficultés et où il est possible de les traiter ; c'est là qu'ils vont parler, qu'ils vont se plaindre, que l'on va remarquer leur fatigue, les traces de coups, les problèmes psychologiques. C'est à l'école que l'on doit, très tôt, dès le primaire, signaler qu'un enfant va mal. Il faut effectuer un signalement au parquet, qui, lui, alertera le juge des enfants, lequel ouvrira un dossier d'assistance éducative.
En France, souvent l'alerte est donnée quand il est beaucoup trop tard. Malgré les nombreuses réunions, les nombreux colloques et séminaires qui ont eu lieu sur le malaise de la jeunesse actuelle, on n'a pas eu suffisamment conscience de la nécessité de traiter alors qu'ils sont encore jeunes les enfants qui montrent des signes de déficience, par un absentéisme scolaire notamment.
L'absentéisme scolaire est en effet l'une des grandes causes de la délinquance des mineurs : ceux qui vivent dans des familles qui vont mal et qui se retrouvent dans des classes à niveau se sentent exclus et complètement dévalorisés. Seuls 20 % d'entre eux auront une qualification. A un âge où ils pourraient entrer dans la vie active, où ils pourraient gagner leur vie normalement, ils vont être exclus de la société, n'ayant ni formation ni qualification. Mais, comme la société de consommation les fascine, pour pouvoir acquérir les biens que tous les enfants du même âge désirent, ils vont entrer dans une vie souterraine de délinquance, avec le business, la drogue, le recel, les délits.
De ce point de vue, le manque de familles d'accueil, de lieux de vie et d'internats destinés aux enfants connaissant des difficultés sur les plans familial et scolaire est un problème grave. Je rencontre très souvent des jeunes qui commettent un petit délit ; le juge des enfants se rend compte que ce petit délit n'est qu'un appel au secours pour révéler la présence d'un profond mal-être. Il ouvre alors un dossier d'assistance éducative, mais n'arrive pas à trouver un lieu d'accueil, tant les moyens pour permettre aux juges de faire de l'éducatif vraiment efficace font cruellement défaut.
Pour les avocats comme pour les juges des enfants -avec qui j'en ai beaucoup parlé- il est extrêmement pénible de ne pas pouvoir donner de réponse individualisée aux problèmes des enfants en grande difficulté. Prenons le cas d'un gamin de moins de seize ans pour lequel le juge ne trouve pas de foyer d'accueil. Il n'est pas question de le mettre en détention : on sait alors que, sans structure familiale, sans soutien, il va repartir dans la nature et recommencer à être délinquant, parce qu'on ne lui aura pas donné le cadre nécessaire pour se reprendre et mener une vie normale. En définitive, faute de moyens suffisants, la justice des mineurs ne peut exister réellement ni être crédible.
Un autre aspect du problème me semble également
très grave : la population n'a plus aucune tolérance
vis-à-vis des enfants ; on a l'impression que, en France, la
société n'aime plus les enfants, qu'elle veut les exclure pour se
protéger de leur violence. Que les citoyens soient
exaspérés par le comportement de certains jeunes est
compréhensible, mais ils devraient en même temps remonter à
la source pour savoir pourquoi ces enfants ont ce comportement et comment on
peut le traiter. Les enfants ont besoin de protection et de moyens pour
s'insérer dans la société et pour devenir des citoyens
à part entière. Exclure les jeunes, les reléguer loin pour
ne plus être « ennuyés » par leurs actes
d'incivilités et de délinquance n'est certainement pas une bonne
façon de les intégrer dans la vie sociale. Cette espèce de
durcissement actuel de la société vis-à-vis des jeunes me
frappe beaucoup et me navre. En outre, on s'aperçoit que les enfants
n'ont plus de projets, n'ont plus d'idéologie
-c'est un mot
qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas forcément- n'ont plus de
spiritualité. Les élites, leurs parents les ont
déçus. Ils ne se passionnent plus pour rien. Finalement, leur
seule idéologie se résume à vouloir acquérir les
biens de la société de consommation. C'est très grave.
Je souhaite maintenant aborder rapidement le rôle des institutions -l'école, la police et la justice- qui me semble actuellement extrêmement confus.
J'ai déjà exprimé mon sentiment sur l'école. Il est absolument capital qu'elle ait non seulement un rôle de transmission des savoirs, mais aussi un rôle éducatif. Actuellement, les instituteurs qui ont des classes de trente élèves, dont beaucoup se trouvent en grande difficulté scolaire, ne peuvent certainement pas, en plus de leur rôle de transmission des savoirs, jouer un rôle social, de détecteur du mal-être des enfants. Il y a pourtant beaucoup de choses à faire.
Par ailleurs, dans une époque où tout le monde revendique le respect et la dignité, il est affolant de constater que les gamins ne savent plus ce que c'est que de respecter une autorité. Je suis frappée aussi par l'attitude de certains parents qui, convoqués devant le juge parce que leur enfant a insulté ou frappé l'instituteur, me disent : « Mais, maître, cet instituteur n'a vraiment que ce qu'il mérite ! Il n'a qu'à faire régner la discipline dans sa classe ; il est nul, tout le monde le sait ! » Au demeurant, il ne s'agit pas de culpabiliser les familles. Je suis sidérée de constater que bien des parents qui viennent nous voir à l'antenne des mineurs ou qui nous téléphonent ne savent pas du tout comment s'y prendre face à des enfants qui se dressent devant eux avec insolence. Ils sont complètement démunis. Il me semblerait donc nécessaire que soient organisées dans les écoles des réunions de prévention avec des magistrats et des avocats, pour expliquer aux familles en grande difficulté comment protéger les enfants qui donnent très jeunes des signes de mal-être -drogue, racket, violence.
Quant à la police, elle souffre d'être mal aimée, de ne pas être respectée et de voir son autorité bafouée par les jeunes. Quand on considère tous ces gamins qui passent devant le juge pour rébellion ou outrage à agent de la force publique, on prend conscience de la difficulté de communication et du manque de dialogue entre les jeunes et la police. On en arrive d'ailleurs à des dérives qui sont tout à fait répréhensibles. Dans ces conditions, la sanction, le rappel à la loi, ou une autre mesure, est absolument nécessaire, parce que les enfants ne peuvent pas faire n'importe quoi ; je n'ai d'ailleurs pas l'habitude d'être laxiste avec mes jeunes « clients ».
Il n'est pas question, bien sûr, de demander aux policiers d'être des éducateurs, des médiateurs ou de remplacer les parents dont l'autorité parentale est défaillante. Mais, pour que la police de proximité fasse un travail efficace et recueille l'adhésion des citoyens, les policiers doivent travailler davantage avec les acteurs de la prévention sociale et restaurer le dialogue avec les jeunes. Ainsi, ils devraient adopter d'autres méthodes d'interpellation et de contrôle d'identité : en effet, dans les quartiers où ils sont connus, les jeunes ressentent comme une profonde injustice le fait d'être contrôlés à répétition, d'une manière assez « cow-boy » ; dès lors, ils se « butent » et les policiers sont extrêmement meurtris de ne pas être reconnus. Chacun a son rôle, chacun doit remplir sa tâche et assumer ses responsabilités. Or, actuellement, il me semble que la confusion règne : les parents délèguent tout à la police, à la justice et à l'école.
Le problème de la justice des mineurs me touche beaucoup. J'entends proférer tellement d'erreurs à propos du vieux dilemme entre le répressif et l'éducatif. Cette espèce d'ambivalence maintient la justice dans un terrible immobilisme. Or l'éducatif ne peut pas aller sans répression : la sanction fait partie de l'éducatif.
Je suis tous les jours au tribunal pour enfants : aucun délit ne reste sans réponse ; la réponse peut-être judiciaire ou prendre la forme d'une médiation-réparation quand il s'agit d'un petit délit. D'ailleurs, en ce qui concerne les grands délits, je trouve que la répression est de plus en plus forte et que les juges sont de plus en plus enclins à répondre par la sanction. Il ne faut donc pas dire : « La justice des mineurs est inefficace et l'ordonnance de 1945 est périmée. Celle-ci était valable à l'époque parce que la situation était différente, mais il faudrait actuellement qu'elle soit complètement rénovée. » Au contraire, de nombreux pays nous envient cette ordonnance, dans laquelle tout est prévu.
Au demeurant, pour bien agir, il faut laisser les juges faire de l'éducatif parce que cela reste la meilleure prévention. Lorsqu'il y a un signalement au parquet d'un enfant qui va mal, pour cause d'absentéisme scolaire ou parce qu'il s'est fait remarquer par sa violence, par de petits délits, ou par des incivilités, le parquet va saisir le juge des enfants. Si celui-ci pense que la délinquance de cet enfant n'est qu'une espèce de manifestation de son profond mal-être, il va généralement ouvrir un dossier d'assistance éducative. C'est évidemment la meilleure manière de faire de la prévention. Le juge dispose en effet de tout un éventail de mesures qu'il peut ordonner -mesures d'investigation, mesures d'orientation éducative, bilan psychologique, bilan scolaire- pour trouver la meilleure manière d'aider l'enfant.
Malgré tout, je plaide très souvent des dossiers dans lesquels le jeune et sa famille n'ont jamais rencontré d'éducateur. Quelqu'un aurait pourtant dû se manifester auprès d'eux -le délit ayant été commis voilà un an et une mesure de liberté surveillée ayant été prise- et établir un rapport.
Actuellement, mille décisions attendent d'être exécutées dans la région parisienne C'est là le gros problème et le grand dysfonctionnement de la justice des mineurs. Ce ne sont donc pas les juges qui sont laxistes, ce sont les moyens qui sont mis à leur disposition qui sont inexistants. Par conséquent, une justice qui ne peut pas tenir ses engagements ne peut plus être crédible.
A mon sens, la condamnation de gamins à de lourdes peines, à de gros sursis avec mise à l'épreuve, est parfois tout à fait valable. Je dirige l'antenne des mineurs dans laquelle des avocats expliquent aux jeunes les sanctions qui leur sont infligées. S'agissant d'un sursis avec mise à l'épreuve, voici ce qui leur est dit : « La balle est dans ton camp : tu as des chances de ne pas aller en prison, on te fait une dernière faveur. Mais tu as des obligations à remplir : suivre une formation, aller en internat, avoir un suivi psychologique. Si tu ne remplis pas tes obligations, le juge des enfants, qui est aussi juge de l'application des peines, te convoquera et, à ce moment-là, ton sursis avec mise à l'épreuve sera révoqué et tu iras en prison. » C'est là un langage que les jeunes saisissent. Certains jeunes sont précoces : ils ont envie d'être responsabilisés, ils veulent agir en adultes, mais ils comprennent aussi qu'ils peuvent répondre juridiquement de leurs actes. D'autres jeunes ne respectent pas leurs obligations mais ne voient rien venir.
Or, les mesures de contrôle judiciaire actuelles sont insuffisantes parce qu'il y a trop peu de contrôleurs judiciaires. Je suis tous allée les voir ; ils me disent : « On n'y arrive pas ; il faudrait travailler beaucoup plus que jour et nuit pour pouvoir recevoir les jeunes, leur expliquer où ils en sont et s'assurer qu'ils suivent bien leur formation ou qu'ils vont bien voir un psychologue. »
S'agissant de jeunes en liberté surveillée préjudicielle, en sursis avec mise à l'épreuve, ou sous contrôle judiciaire, et bénéficiant de mesures d'assistance éducative, des rapports d'orientation éducative et d'investigation devraient être établis et figurer dans les dossiers : mais, souvent, il n'y a rien ! Quand nous plaidons de tels dossiers, nous ne connaissons même pas la situation du jeune et nous ne savons même pas si on lui a donné des chances pour qu'il puisse s'insérer, pour qu'il puisse faire des progrès comme il l'avait promis.
C'est cela, le vrai dysfonctionnement de la justice des mineurs. Certains estiment que c'est l'ordonnance de 1945 qui doit être rénovée. Ils dénoncent l'absence de sanction et l'impunité des jeunes délinquants car ils s'exaspèrent en voyant ces jeunes commettre délits sur délits, faire de courtes gardes à vue et ressortir systématiquement. Au contraire, je ne vois jamais de gamins qui commettent des délits sans qu'il y ait une réponse, judiciaire ou non. Ainsi, pour un acte de délinquance occasionnelle, la réponse est-elle la médiation-réparation. Il faut, à ce sujet, bien distinguer la délinquance occasionnelle de la délinquance « réitérante » et insister sur les mesures qui pourraient aider les jeunes à ne pas devenir des délinquants récidivistes.
Je le répète, il faut soutenir les familles, faire un gros travail à l'école et inciter la police à être mieux acceptée, mieux intégrée, mieux ressentie. Il faut également aider la justice des mineurs, aider les juges des enfants dont je ne peux que louer le dévouement et la perspicacité vis-à-vis des enfants, me félicitant tout autant des relations de collaboration qu'ils entretiennent avec les avocats.
S'agissant de la délinquance occasionnelle, j'estime que la réponse à ce type de délits ne doit pas être judiciaire. Certains enfants, qui ne trouvent pas de limites dans leurs familles, vont essayer de tester jusqu'où ils peuvent aller pour évaluer leur pouvoir. Quand ils ne sont pas « sécurisés » par des adultes, ils se « sécurisent » par une violence qui leur donne une toute-puissance. Ces jeunes « essayent » la violence et la délinquance pour voir jusqu'où la société les laissera aller. Pour ceux-là, je suis extrêmement favorable à la médiation-réparation.
Cette mesure a été instituée en 1993 mais reste, à mon sens, beaucoup trop « balbutiante ». Avec la médiation-réparation, le jeune délinquant passe devant le délégué du procureur ou un médiateur en compagnie de ses parents et de la victime qui demande réparation ; cette confrontation a pour objet d'essayer de trouver une solution telle que le jeune puisse réparer, à sa façon, avec ses parents, le préjudice subi par la victime. J'ai pu assister à des rencontres où le jeune prenait conscience de ce que sa victime avait subi un traumatisme ; où la victime prenait également conscience de ce que son jeune agresseur était, non l'affreux voyou diabolisé par les médias dont elle avait l'idée, mais un jeune en difficultés.
Sur le plan éducatif, c'est extrêmement important et cela devrait être encouragé, développé. Le système de la médiation-réparation a, me semble-t-il, beaucoup d'effet. Le jeune est confronté avec quelqu'un qui est en souffrance. On lui dit : « Te rends-tu compte de ce que la victime a subi ? Tu l'as fait tomber, tu l'as traumatisée et elle a dû obligée d'être soignée. Parce que tu lui as arraché son sac, elle n'ose plus sortir le soir, elle fait des cauchemars et elle n'arrive pas à retrouver son équilibre. » Tout cela se passe dans un endroit intime, où il est beaucoup plus facile de pouvoir dialoguer.
Il faut développer la médiation-réparation en permettant au jeune d'avoir un avocat, ce qui n'est pas prévu dans l'aide juridictionnelle. Le jeune doit comprendre son intérêt : ce système n'est pas une chausse-trappe ; au contraire, il peut être tout à fait à son avantage puisqu'il peut entraîner un classement sous conditions. Le mineur doit répondre à tout ce que le délégué du procureur ou le médiateur va ordonner : nettoyer des tags, écrire une lettre d'excuses, travailler pendant l'été pour pouvoir indemniser la victime, ce que je trouve très bien. Quand un jeune passe devant le tribunal, ses parents sont assurés au titre de la responsabilité civile, et c'est donc la compagnie d'assurance qui va indemniser la victime présente. Dans ce cas, pour l'enfant, il n'y a pas d'effet éducatif. En revanche, si on lui dit : « Tu as seize ans et tu peux très bien, comme l'année passée, livrer des pizzas. Mais au lieu de te payer une Mobylette, eh bien, tu donneras l'argent que tu vas gagner à la victime à qui tu as causé un préjudice », cela le responsabilise et lui donne l'impression d'être une personne à part entière, responsable de ses actes. La médiation-réparation est très importante pour traiter la délinquance occasionnelle, lorsque les parents et la victime donnent leur accord sur une telle mesure.
Avec la délinquance « réitérante », on entre dans le fameux débat de la sanction. La délinquance « réitérante » nécessite des moyens. Lors du grand débat sur les UEER, les unités à encadrement éducatif renforcé, créées par M. Toubon, j'avais été auditionnée à l'Assemblée nationale. J'étais tout à fait favorable à ces structures, fondées sur un encadrement renforcé, avec des éducateurs plus nombreux, et sur des contraintes plus lourdes. En effet, à l'évidence, ces jeunes délinquants « réitérants », sans foi ni loi et souvent extrêmement violents, ne restent pas dans des foyers où il n'y a que des contraintes et des limites. Il faut, dans le même temps, les rééduquer sans les exclure. La prison est bien sûr nécessaire pour arrêter cette espèce de spirale de la délinquance chez certains, mais elle ne peut être qu'une étape dans leur vie. Sinon, un jour ou l'autre, la société devra faire face à des jeunes qui, souvent, auront été encore plus désocialisés par leur séjour derrière les barreaux.
La prison est un lieu où un jeune n'apprend pas les règles de droit, n'apprend pas à se socialiser, pour devenir plus « civil », plus citoyen. Quand je rencontre les éducateurs et les médiateurs du centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis et qu'ils me racontent comment se passent les promenades, je vous assure que j'ai froid dans le dos ! A Fleury-Mérogis, il faut être le plus fort et le plus violent pour pouvoir résister ; ceux qui ne le sont pas ne sortent pas en promenade et restent dans leur lit.
A cet égard, les centres éducatifs renforcés, les CER, me semblent tout à fait adaptés. Je ne suis pas favorable aux centres fermés. Appelons les choses par leur nom : si un centre est vraiment fermé, je ne vois pas très bien la différence avec une prison adaptée pour les jeunes, avec -comme c'est actuellement envisagé- des petites structures mettant en oeuvre des projets éducatifs, des projets de traitement psychologique. Quelle différence peut-il y avoir entre ces petites structures carcérales pluridisciplinaires et les centres fermés ?
En revanche, il faut des centres « contenants » et non des centres dans lesquels on demande simplement au gamin : « As-tu envie de venir ? Adhères-tu à notre projet ? » Il y a des centres qui fonctionnent mais aussi beaucoup qui ne fonctionnent pas. Il faut, d'une part, beaucoup plus d'internats, de lieux de vie et de familles d'accueil, et, d'autre part, beaucoup plus d'imagination, pour créer des centres individualisés, avec un accueil chaleureux, avec un projet éducatif valable et des activités intéressantes encadrées par des éducateurs motivés. Mais, éducateur, c'est un métier épouvantable ; malheureusement, beaucoup, comme les parents, baissent les bras, car certains centres ne proposent absolument rien d'intéressant aux enfants et ceux-ci n'ont aucun espoir de s'en sortir et d'apprendre quelque chose. Il est vrai que, actuellement, il n'y a pas beaucoup de réponses pour les mineurs « réitérants » de moins de seize ans. La prison est possible, mais elle ne peut guère être qu'un endroit où le jeune réfléchit. Il faudrait qu'il soit pris en charge de manière pluridisciplinaire avec des psychologues, des éducateurs, des surveillants, des gens sensibilisés à la « subtilité » qu'exige l'approche de ces jeunes. Du point de vue de la société, la prison peut être utile : il y a des courts séjours en prison qui permettent de stopper cette espèce de « spirale infernale » de la violence dans laquelle le jeune fait tout et n'importe quoi, ne cessant de récidiver. La prison permet aussi aux éducateurs et aux psychologues d'entrer en contact avec ces jeunes -à l'extérieur, ils ne viennent jamais aux rendez-vous qu'on leur donne- et d'entamer un dialogue afin de préparer un projet éducatif. Parfois, les peines de prison, quand elles sont courtes, ne « désocialisent » donc pas trop le jeune. A contrario, il y a des petits délinquants que l'on revoit tout le temps, qui ne cessent de voler des voitures, par exemple. Lorsqu'ils ont plus de seize ans, on les envoie en prison : à leur retour dans la cité, ils sont un peu comme des caïds avec un galon supplémentaire. Le fait de dire : « Je sors de Fleury-Mérogis » leur donne du panache. Ce n'est donc pas cela qui va les socialiser.
Il faut traiter différemment la délinquance « réactionnelle » à un mal-être, qui est une délinquance occasionnelle, et la délinquance « réitérante ». Finalement, il n'y a que 20 % des jeunes délinquants qui passent au tribunal et qui sont inquiétants parce qu'ils récidivent. D'ailleurs, ce pourcentage comprend tous ces jeunes demandeurs d'asile qui « réitèrent » terriblement parce qu'ils sont complètement « catapultés » par des adultes qui les dirigent. Il faut créer des lieux beaucoup plus individualisés, beaucoup plus adaptés aux difficultés des jeunes. Il faut motiver des éducateurs. Il faut aussi qu'il y en ait beaucoup plus. Il faut enfin essayer de trouver les solutions les plus adéquates à chaque cas. Mais surtout, ne supprimons pas l'éducatif ! Comment voulez-vous que des êtres en devenir qui ne reçoivent que des sanctions puissent s'améliorer ? Ce n'est pas possible !
On ne peut pas dire que l'on va punir un gamin de quatorze ou quinze ans et en rester là, en l'abandonnant à son sort. L'éducation va avec la répression, mais c'est un long travail. Les juges des enfants doivent se pencher sur le devenir des jeunes qui leur sont confiés. Recourir aux comparutions immédiates, comme cela a été évoqué, et prendre des sanctions dans l'instant n'est pas travailler en ce sens. Un enfant de quinze ou seize ans est en pleine transformation et n'est pas du tout ce qu'il sera à dix-huit ans. On a vu des jeunes dont on désespérait, qui multipliaient les délits, changer complètement à l'approche de la majorité, grâce à une rencontre, à une copine, à un éducateur ou à un juge, et tourner le dos à la délinquance pour devenir des gens parfaitement honorables. On voit souvent de telles évolutions, et c'est cela qui est merveilleux quand on défend des enfants : de grandes espérances sont permises, car les jeunes peuvent changer totalement et, parmi ceux qui se trouvent très engagés dans la délinquance, un miracle se produit parfois, comme nous avons tous pu le constater.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Nous vous remercions de cet exposé plein de conviction et de passion, maître. Vous nous avez dit qu'il y a défaillance de la famille, beaucoup plus souvent involontaire que délibérée, d'où le rôle central de l'école. A cet égard, lors de nos visites sur le terrain, nous avons observé diverses situations : dans certains cas, la direction affirmait que les phénomènes de violence ou d'usage de drogue étaient extérieurs à l'établissement, afin de sauvegarder la renommée de celui-ci ; dans d'autres, elle affrontait les problèmes.
En outre, nous avons constaté qu'il existe des quartiers difficiles où les enseignants sont enclins à baisser les bras. En effet, ils signalent très souvent le « décrochage » scolaire d'un enfant, mais ensuite les décisions tardent à venir, puisque deux années peuvent parfois s'écouler. Durant ce laps de temps, bien entendu, le mineur ne rentre pas dans le droit chemin !
Par conséquent, du fait de la multiplicité des acteurs, le problème ne tient-il pas à l'absence d'un pilote et d'un « fil rouge » guidant l'action ?
Mme Marie-France Ponelle - Je pense pour ma part que la pluridisciplinarité est nécessaire ; on ne va pas demander à la fois à l'instituteur de soutenir les familles en difficulté, de gérer leurs problèmes financiers ou de logement et de résoudre les difficultés psychologiques de l'enfant. Ainsi, dans certains cas, des thérapies familiales sont nécessaires. Ces familles, qui doivent être très entourées, peuvent aussi avoir besoin de l'appui de conseillers économiques et familiaux. En tant que membres de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, nous rencontrons souvent des instituteurs, qui nous demandent comment faire des signalements quand des enfants leur semblent être victimes de maltraitance ou d'abus sexuels. Nous leur donnons les explications nécessaires, mais ils nous font alors part de leur désarroi : s'ils ne sont pas aidés par des assistantes sociales, des conseillers d'orientation ou des psychologues, que peuvent-ils faire devant trente gamins extrêmement violents, agressifs et insolents ? Ce n'est pas possible !
L'école a déjà la mission de transmettre le savoir et, pour mieux éduquer les enfants, les enseignants ont besoin d'aide. Une grande coordination est indispensable ; or, actuellement, chacun travaille de son côté, dans une grande confusion des responsabilités. Il faut agir dès le primaire, quand les enfants sont encore très jeunes, et donner des moyens à l'école, afin que les classes soient moins chargées et les assistantes sociales plus nombreuses. Beaucoup de parents sont de bonne volonté et voudraient faire davantage pour leurs enfants, sans savoir comment s'y prendre. Ils ont besoin de conseils et de rencontres avec des personnes capables de répondre à leurs questions. Une présence sur le terrain beaucoup plus importante est nécessaire.
Audition de M. Louis DUBOUCHET,
Directeur du cabinet Dubouchet et Berlioz
consultants,
et de M. Georges PELLEN,
Directeur associé du cabinet
d'audit CIRESE
(24 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons procéder maintenant à l'audition de MM. Dubouchet, directeur du cabinet Dubouchet et Berlioz consultants, et Pellen, directeur associé du cabinet d'audit CIRESE. Nous avons souhaité vous entendre, messieurs, parce que le cabinet CIRESE a récemment effectué une évaluation des dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse visant à la prise en charge des mineurs multirécidivistes ou en grande difficulté. Cette étude a été rendue publique voilà quelques semaines.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole, messieurs.
M. Georges Pellen - Nous avons en effet été sollicités par la direction de la PJJ pour procéder à une évaluation des dispositifs de prise en charge des mineurs délinquants : centres d'éducation renforcée, centres de placement immédiat et activités en milieu ouvert.
Nous serons assez modestes dans notre propos, de façon à ouvrir largement le débat. Nous nous sommes trouvés confrontés au fait qu'évaluer les dispositifs de prise en charge supposait d'engager une réflexion sur l'utilité éventuelle d'accroître le nombre des établissements : faut-il passer par exemple de cent à deux cents CER, de cinquante à cent CPI ?
Nous avons cherché à éclairer ce problème. La première conviction à laquelle nous avons abouti à partir de cette étude, c'est peut-être qu'il ne suffit pas de démultiplier les réponses et les structures, mais qu'il convient surtout de les articuler entre elles. L'un des axes essentiels de notre rapport vise à inciter les acteurs publics à mettre en cohérence et en corrélation les différentes réponses apportées en vue du traitement de la délinquance, en particulier en les inscrivant dans des dynamiques territoriales. Voici ce que je dirai en préambule : notre étude fait ressortir cette conviction forte que les réponses peuvent être fondées sur la cohérence et l'articulation entre eux des dispositifs.
Je ferai maintenant trois constats : en premier lieu, je relèverai des insuffisances observées en matière de traitement et de connaissance de la délinquance ; en deuxième lieu, j'évoquerai les grandes caractéristiques des différents types de prise en charge ; en troisième lieu, j'aborderai la question du positionnement stratégique de la PJJ et de ses potentialités.
S'agissant du premier constat, relatif à l'étude des phénomènes de délinquance, nous estimons que les problèmes sont dans l'ensemble très mal posés, parce que le discours sur l'évolution des questions de société est plus idéologique que réellement analytique. S'il est par exemple incontestable que la délinquance augmente chez les mineurs âgés de treize à quinze ans, cela nous a amenés à étudier pourquoi ceux-ci sont davantage portés aujourd'hui que voilà quelques années à commettre des actes de violence. Par ailleurs, nous avons observé qu'il s'agit moins d'une violence visant au profit que d'une violence de contestation de l'autorité. Il existe donc des formes d'évolution de la délinquance, et si nous cherchons à mieux les analyser, nous pouvons quitter la sphère idéologique, parfois trop passionnelle, pour essayer de déboucher sur une meilleure compréhension des phénomènes, du point de vue tant social qu'économique.
Il nous semble tout d'abord que, au-delà d'un débat statistique, il nous faudrait progresser vers une connaissance approfondie de l'évolution de la délinquance.
En outre, il existe un défaut de stratégie commune entre les différents acteurs des territoires, qu'il s'agisse de la police ou des éducateurs de la prévention spécialisée ou de la PJJ, ainsi qu'un manque de concertation entre les magistrats et ces derniers, ce qui ne permet pas de construire une représentation suffisamment partagée des phénomènes de délinquance. De surcroît, cela entraîne des lacunes en matière de coopération et de travail de mise en place des réponses : chacun doit rester dans son rôle, mais il faut, à partir des domaines de responsabilité de chaque corps, se pencher sur la complémentarité des solutions mises en oeuvre.
Enfin, lorsque nous avons effectué une analyse statistique, en préalable à notre évaluation, nous avons été contraints de constater que la police, les tribunaux et la PJJ procédaient selon des modalités distinctes dans ce domaine et que, finalement, il n'existait pas de nomenclature commune permettant de cerner le phénomène de la délinquance. On peut supposer que la manière de traiter les statistiques dépend beaucoup des injonctions institutionnelles, ce qui rend très difficile une appréciation objective des chiffres, les paramètres de collecte n'étant pas établis de façon concertée. Cela nuit à la connaissance de la délinquance.
Je dirai en conclusion, s'agissant du premier constat, que le traitement de la délinquance reste très lié à l'exclusion des jeunes de leur territoire, alors qu'il conviendrait certainement de le situer davantage sur celui-ci. A l'heure actuelle, police, justice, Education nationale et éducateurs de la prévention spécialisée ne se mobilisent pas suffisamment pour élaborer des réponses à l'échelon du territoire. On continue trop souvent à les institutionnaliser, c'est-à-dire que l'on écarte le jeune de l'endroit où il vit pour le placer en institution. Alors que la délinquance se développe de plus en plus au travers de phénomènes de groupes, on traite les problèmes surtout par le biais de mesures individuelles. Il y aurait lieu, nous semble-t-il, d'envisager des réponses plus collectives, à l'échelon des territoires, là où les difficultés se présentent.
S'agissant du deuxième constat, qui vise les types de prise en charge, nous avons connu, dans les années soixante-dix, une profonde crise de l'hébergement et de l'action éducative, dont nous ne sommes pas encore complètement sortis.
En effet, cette crise a laissé des traces dans la manière de gérer la prise en charge éducative. Il nous est apparu qu'il était important, dans ce domaine, de redonner du sens et de la cohérence à l'hébergement et à la fonction éducative. Cela repose sur un certain nombre d'éléments, tels que, par exemple, la capacité, pour les établissements, de travailler sur de vrais projets éducatifs et non pas sur des prises en charge occupationnelles : il s'agit non pas d'habiter des bâtiments, mais de créer de véritables groupes porteurs de projets pour les résidants.
Par ailleurs, au travers de la crise du modèle d'hébergement se jouent, de par les mutations professionnelles et les évolutions démographiques liées au secteur médico-social, de nombreuses questions relatives à la consistance des figures d'autorité. L'hébergement devrait certainement réaffirmer, à cet égard, les principes, mais aussi les modalités permettant à ces figures d'autorité de s'imposer aux jeunes. Il semble en effet que les réponses apportées sur ce point se soient affaiblies ces dernières années, et il y a donc lieu de redonner une structuration forte à la fonction éducative au sein de l'hébergement, afin que la prise en charge puisse être plus solide et plus riche.
En ce qui concerne le milieu ouvert, il me paraîtrait important de mettre en exergue un « fil rouge ». Trop de discontinuités se font jour dans la prise en charge des jeunes et dans le « suivi » de leurs parcours, et entre les décisions des magistrats ou des travailleurs sociaux, sur le territoire ou en institution. Cela aboutit à troubler très fortement le regard que le jeune peut porter sur son existence et son passé. On pourrait aussi évoquer la question du lien avec les familles, qui nous semble fondamentale dans la perspective des prises en charge.
En ce qui concerne les CPI, l'expérience des trois années écoulées démontre que le système est hybride. En effet, on veut engager dans l'urgence une évaluation et une orientation du jeune, alors que celui-ci se trouve dans une situation de crise et ne peut élaborer aucun projet. En outre, les CPI tendent à jouer un rôle de contention, à assurer une sorte d'incarcération provisoire, mais on ne veut pas le reconnaître et on continue d'entretenir une ambiguïté avec ce qui relève d'une volonté d'orienter, voire d'insérer. Il s'agit là de paradoxes qui perturbent la prise en charge éducative.
En ce qui concerne les CER, il est vrai que ce dispositif semble faire ses preuves, parce que se sont construits peu à peu des projets et des règles collectives permettant aux jeunes de structurer progressivement une vision d'eux-mêmes et de leur avenir. Il reste que, s'agissant de prises en charge courtes, d'une durée de deux à six mois, se pose souvent le problème de la sortie et de la prise en charge après le passage dans ces établissements.
On pourrait dire que les foyers, dans leur forme traditionnelle, sont victimes de la crise de l'hébergement que j'évoquais tout à l'heure. De plus, en ce qui concerne la PJJ, ils ont eu à se transformer en CPI ou en CER, sans avoir pu mettre en place de nouveaux projets, ce qui laisse souvent les équipes éducatives dans le désarroi. A cet égard, au sein du milieu ouvert, les centres d'action éducative tournés vers l'insertion sont assez riches en projets pédagogiques et entretiennent des relations avec différents partenaires, dont l'Education nationale. On peut regretter un manque de capitalisation ou de mutualisation des pédagogies mises en oeuvre dans ces différents centres. Il serait certainement possible d'identifier des modèles d'intervention et de prise en charge donnant du sens au parcours éducatif et pouvant permettre à des jeunes de réintégrer progressivement les dispositifs de droit commun.
Par conséquent, l'évaluation des dispositifs est en demi-teinte. Tant que l'on n'aura pas clarifié l'objectif visé par la prise en charge, à savoir la contention ou l'action éducative, l'ambiguïté subsistera et cela gênera très fortement le fonctionnement des institutions.
S'agissant du troisième constat, qui concerne le positionnement et les potentialités de la PJJ, j'indiquerai tout d'abord que les CER sont gérés, pour la plupart d'entre eux, par le secteur privé habilité, même si quelques CER ont été créés par la PJJ. Cela signifie peut-être que cette administration éprouve des difficultés à structurer des projets par l'intermédiaire de ses personnels, en raison notamment d'un recrutement insuffisant pendant de très nombreuses années et d'un manque de moyens évident. Devant la montée de la délinquance, la PJJ n'a pu se préparer de façon satisfaisante aux nouveaux défis de la prise en charge éducative.
Des efforts importants ont certes été récemment consentis, puisque mille éducateurs ont été recrutés en deux ans. Il s'agit de personnes sortant de l'université, disposant d'une bonne formation intellectuelle pour aborder les phénomènes de la délinquance et réfléchir aux modes de prise en charge éducative, mais manquant souvent de maturité humaine pour évoluer parmi des jeunes en situation de profonde rupture psychologique et sociale. La prise en charge s'en trouve par là même fragilisée.
Par ailleurs, un autre facteur de fragilisation des modes d'intervention de la PJJ tient au fait que la gestion des ressources humaines reste extrêmement centralisée. A l'heure actuelle, ni les régions ni les départements n'ont la faculté de composer les équipes animant les diverses structures. Les nominations, régies par les conventions collectives, sont décidées d'en haut, sans que les directeurs d'établissement ou les directeurs départementaux de la PJJ puissent évaluer les potentialités nécessaires au fonctionnement des différents dispositifs. Les équipes connaissent un turnover très rapide, ce qui nuit à la bonne collaboration des personnels et fragilise la mise en oeuvre des projets au sein des établissements. Il serait souhaitable de repenser les modes d'affectation, sans doute en s'orientant vers une départementalisation : c'est d'ailleurs l'une de nos recommandations.
On peut en outre juger que les parcours de formation seraient à revoir sur le fondement de l'évolution des formes de délinquance que j'ai évoquée. Nous avons également inscrit dans notre rapport la question suivante, qui, nous l'espérons, sera approfondie : comment favoriser une meilleure articulation, en tout cas une mutualisation, des ressources humaines entre le secteur public et le secteur privé ? Il existe aujourd'hui un cloisonnement qui devient intolérable au regard de la question sociale que représente la délinquance. La PJJ est dotée d'un dispositif de formation et de recrutement d'éducateurs ; le secteur habilité est très performant en matière d'innovation, comme peut aussi l'être la PJJ : comment décloisonner ces deux secteurs afin d'instaurer une mixité ? Il me semble que les parcours institutionnels pourraient alors s'enrichir mutuellement et que cela pourrait notamment déboucher sur des projets de prise en charge.
M. Louis Dubouchet - M.Pellen ayant traité les principaux points, mon propos sera très bref. Je travaille sur les questions de prévention spécialisée, avec des conseils généraux et des maires qui ne savent plus que faire devant une jeunesse qui, dans les cités, bouscule les animateurs. J'aborderai donc aussi bien la question de la sécurité dans l'espace public que celle de la délinquance réitérante.
En premier lieu -je travaille beaucoup avec les magistrats, le parquet et la police sur ces problèmes-, ce qui a changé, c'est non pas la nature des délits, mais la réactivité des jeunes dès lors qu'une institution s'impose à eux : le ton monte immédiatement. Les outils permettant de leur faire savoir qu'ils ont « franchi la ligne jaune » ou qu'ils vont subir une sanction doivent donc être renouvelés. Tout contrôle social ou éducatif est contesté.
Cela entraîne deux effets majeurs.
Tout d'abord, par manque de moyens, un certain nombre de forces éducatives, dont la PJJ, adoptent une stratégie d'évitement du risque de confrontation avec les jeunes. On s'adresse alors aux sujets les moins difficiles, en laissant de côté le noyau le plus dur. Dès que les mesures sont trop nombreuses, il y a un effet mécanique et l'on se contente de remplir son temps de travail en s'occupant des cas les moins lourds. Dans les CER, y compris dans ceux qui marchent bien, on a du mal à aller rechercher soi-même les enfants qui fuguent ; il est plus facile de téléphoner à la police, mais ce procédé est dévastateur au regard de la crédibilité du message subliminal qui est par ailleurs envoyé au jeune : « On te veut, on veut être avec toi, et si tu t'en vas, on va te chercher. »
Le second effet majeur est lié au fait que, la sanction n'étant pas administrée correctement, avec un début et une fin, la société inflige surtout une flétrissure aux jeunes. Ceux-ci supportent toute leur vie l'humiliation de n'avoir jamais pu obtenir de pardon. La rédemption est impossible, il n'arrive pas de moment où ils peuvent reprendre une existence sociale normale. J'en veux pour preuve les mesures de médiation-réparation qui ont été évoquées tout à l'heure, les travaux d'intérêt général postérieurs à la sentence, etc. : le contrôle de l'achèvement de ces derniers est très mal fait, et la sanction, qui n'a parfois jamais été exécutée, continue de peser.
En ce qui concerne les juges et le « fil rouge », il me semble que les magistrats que je rencontre sont certes talentueux, mais que l'on ne sait pas qui est le pilote. On se trouve dans un système de prescription et d'opération : un juge prescrit à la PJJ ou au secteur habilité d'exécuter une mesure ; dans les faits, il n'a pas les moyens d'assurer le suivi, et l'information ne remontera que si un problème particulier se pose. Le suivi du parcours du jeune est donc segmenté entre le juge, le SEAT -le service éducatif auprès du tribunal-, l'établissement d'accueil, etc. A cet égard, on constate que les magistrats du parquet voient revenir à plusieurs reprises dans leurs bureaux des jeunes dont ils connaissent peu l'histoire, faute de suivi par le tribunal.
En deuxième lieu, l'appareil judiciaire qui s'occupe des mineurs ne fait pas système : il est éclaté entre parquet, magistrats des enfants, PJJ et administration pénitentiaire, et il est vraiment nécessaire de proposer une unité d'organisation. Il me semble même qu'il conviendrait d'associer les juges à l'étude des questions d'équipement. En effet, ils n'ont pas participé à la mise en place des CER ou des CPI ; ils ont même manifesté de fortes réticences dans certaines régions, et les obliger à prendre part à une coordination départementale ou interdépartementale décidant du nombre de places d'hébergement nécessaires -placement immédiat, placement renforcé, etc.- représenterait un progrès. Jusqu'à présent, ils se montrent assez peu enclins à s'intéresser à ces questions, car cela les engagerait à être les pilotes de l'ensemble du système.
En troisième lieu, je pense que, pour les mineurs, il faut passer d'une obligation de résider à une obligation de faire. On constate que les lieux d'accueil qui fonctionnent bien à l'heure actuelle sont ceux où existe une activité forte, immédiatement proposée au jeune. Il ne s'agit pas d'ergoter, de prendre le temps de la réflexion, de se demander si l'on va consulter un psychologue : une activité débute dès le lendemain de l'arrivée du jeune. Elle doit présenter de l'intérêt, avoir un contenu réel et une utilité sociale, qu'il s'agisse par exemple d'action humanitaire ou d'entretien d'espaces verts. C'est un levier qui donne satisfaction, et je crois nécessaire de financer l'activité avant de financer la garde. Il faut que les juges prononcent des ordonnances de placement en ayant à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement d'éloigner le jeune de son milieu habituel, mais surtout de lui faire pratiquer une activité.
Il me semble aussi que les magistrats et les élus locaux doivent pouvoir réfléchir ensemble aux moyens d'inciter les adultes qui encadrent les jeunes -entraîneurs sportifs, directeurs de maison de jeunes, conseillers d'éducation en collège, etc.- à accepter le conflit éducatif avec ces derniers, avant qu'il ne faille en venir à une sanction pénale. Si l'on refuse d'entrer dans un conflit, on a peu de chances d'en sortir ! Or j'observe que, dans certaines villes, les personnels chargés de la voirie ou de l'entretien des espaces verts obéissent à l'injonction implicite d'éviter tout incident avec qui que ce soit. Par conséquent, ils n'exigent pas que l'on respecte leur travail, ils ne rappellent personne à l'ordre, ils changent de trottoir, voire d'horaire pour éviter de nettoyer un bac à sable quand il est occupé par des adolescents de treize ou quatorze ans, lesquels réagiraient mal si on leur demandait de sortir. Je crois donc que, avant d'en appeler à la responsabilité des familles et de menacer celles-ci de sanction, il importe de restaurer la fonction de représentant de l'autorité des professionnels qui travaillent dans l'espace public.
Par ailleurs, s'agissant des projets pédagogiques financés au titre de la politique de la ville ou des actions d'insertion de la PJJ et du secteur habilité, je relève que la partie a été gagnée, ces dernières années, pour ce qui concerne les conditions de sécurité matérielle : des extincteurs ont été installés partout, on veille à ne pas mettre en danger les enfants. Cependant, on ne pose pas d'exigences quant à la place de la sanction dans les actions éducatives. La sanction doit faire partie de l'éducation, sinon il manque un outil. A cet égard, on a beaucoup financé, sur fonds publics, des actions éducatives qui ne prévoyaient pas de mesures de sanction, si ce n'est l'exclusion d'une activité, par exemple l'interdiction d'entrer dans la piscine ou l'expulsion du gymnase.
Il me semble donc nécessaire de banaliser de nouveau la sanction au quotidien, simple et ordinaire. Pour cela, il faut exiger qu'elle soit inscrite dans les propositions éducatives financées par des deniers publics et prévoir les crédits nécessaires. En effet, les magistrats du parquet ou du siège ne prennent pas de mesures de réparation si elles ne sont pas financées. Dans ce cas, on ne trouvera de toute façon pas de services techniques des villes ou d'associations pour les faire exécuter.
Enfin, nous avons bien vu, au cours de notre voyage à l'intérieur de la PJJ et du mouvement associatif, qu'il manque un corps spécialisé pour s'occuper des mineurs délinquants réitérants. En fait, une même qualification, un même programme de formation initiale et continue permet de prendre en charge aussi bien un petit mongolien auquel il faut apprendre les formes et les couleurs qu'un mineur réitérant qui rejette la société. Une telle situation n'est pas satisfaisante. Dans presque tous les autres systèmes organisés, il existe des échelons de spécialité en fonction de la complexité des problèmes à aborder. Il me paraît nécessaire de créer un corps d'élite -n'ayons pas peur de ce mot-, dont les membres devront être capables à la fois de travailler avec les jeunes dans un domaine d'activité utile, de leur permettre de s'exprimer et de se confronter à eux.
En effet, la contention n'est possible que si les adultes sont en mesure de faire face aux jeunes qu'ils doivent garder. Or, au sein de la PJJ, ce sont plutôt les nouveaux recrutés qui sont affectés dans les lieux les plus difficiles. On a également connu cela dans l'Education nationale, où l'on s'est aperçu qu'accorder des primes aux enseignants acceptant d'exercer dans les zones d'éducation prioritaire ne donnait pas de résultats extraordinaires. On a alors cherché à réduire les effectifs, comme le fait la PJJ dans les CER, où l'on compte cinq éducateurs pour cinq ou six gamins. Cependant, à mon sens, vouloir des personnels en plus grand nombre pour faire la même chose avec moins d'enfants mène à une impasse ; il s'agit plutôt de procéder différemment, grâce à un corps de spécialistes disposant des outils indispensables et de financements en conséquence.
Par-dessus tout, il importe de prévoir une vraie gradation pour les professionnels. On évoquait tout à l'heure la motivation, mais pour donner envie à des personnels d'aller au contact de jeunes qui les rejettent, il faut que les enjeux soient réels. Or les gamins qui posent problème, ce sont non pas ceux qui acceptent d'être éduqués, mais ceux qui s'y refusent et résistent le plus longtemps possible : une gratification est nécessaire pour inciter des éducateurs à se consacrer à ce public. Cette dernière peut-être financière, mais cela ne va pas très loin ; elle doit surtout être morale, et donner aux intéressés le sentiment d'appartenir à un corps professionnel de valeur et d'être reconnus au titre de leur spécialisation.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous poserai trois questions, messieurs.
Tout d'abord, qui a commandité le rapport et qui l'a financé ? Si je vous interroge à ce sujet, c'est parce qu'un certain nombre de personnes nous ont affirmé -elles ne parlaient pas sous la foi du serment !- que, à l'origine, un autre rapport avait été rédigé mais n'avait pas été rendu public en raison de son pessimisme. Pouvez-vous infirmer ou confirmer l'existence de ce premier rapport ?
M. Georges Pellen - C'est bien la direction de la PJJ qui avait commandité notre rapport, à la suite d'un conseil de sécurité intérieure et en vue d'un autre devant se tenir en janvier 2002. En effet, pour le Gouvernement, la question était de prendre position sur l'accroissement éventuel du nombre de CPI et de CER. Le ministère de la justice souhaitait donc qu'un rapport d'évaluation soit établi sur la mise en place des dispositifs, notamment des CPI. En fait, le champ de l'étude a été élargi à l'ensemble des structures, à l'exception des SEAT.
Nous disposions de très peu de temps, puisque, ayant commencé notre travail le 20 mai, nous avons rendu un premier rapport le 7 juillet. Nous avons investi beaucoup de notre énergie dans cette tâche pour laquelle, compte tenu des enjeux, nous nous sommes rendus disponibles. Le rapport que nous vous livrons aujourd'hui ne renie en rien nos observations. Certes, nous avons eu des échanges avec la direction de la PJJ à propos des contenus d'évaluation et, de façon que les conclusions du rapport puissent être communicables, entendues et donc utiles, nous avons peaufiné une rédaction permettant de bien poser le cadre de l'analyse sans revenir pour autant sur les constats que nous avions pu faire. Ce point me paraît très clair.
M. Louis Dubouchet - A chaque fois que nous visitions un lieu d'hébergement, nous nous demandions ce qui pouvait donner envie à un jeune d'y rester. Neuf fois sur dix, nous avons eu le sentiment que, du fait du manque d'organisation ou de chaleur et de la stratégie d'évitement souvent adoptée par les personnels, rien ne pouvait inciter les jeunes à demeurer dans ces établissements. C'est un grand souci, et notre jugement sur ce point est sévère. C'est peut-être ce qui a suscité la rumeur selon laquelle il aurait été difficile de publier notre rapport en l'état.
Cela étant, nous avons oublié d'évoquer devant vous les dispositifs relais. Quand ils ne consistent pas simplement en la création d'une classe spécialisée accueillant un certain nombre d'élèves difficiles dont on souhaite se débarrasser, ils peuvent constituer une bonne réponse, par le biais de la mise en place d'une véritable équipe regroupant la commune, la PJJ et l'Education nationale. Cette équipe punit les gamins en leur expliquant, en vue d'une réintégration dans le circuit scolaire, le sens et les suites de la sanction. Toutefois, il faut souligner que quelques expérimentations et innovations à la marge ne font pas une politique publique de prise en charge des mineurs réitérants.
M. Georges Pellen - J'ajouterai que ce qui a fait débat, s'agissant du contenu de notre rapport, c'est que la PJJ, qui est une administration, se doit de répondre à la commande publique. Or c'est toute l'ambiguïté de son statut, et je crois que nous avons bien mis ce point en évidence : elle est tenue, par la commande publique, de créer des dispositifs, et en même temps on lui demande de nouer des relations avec des magistrats, de remplir des fonctions de conseil et d'élaborer des réponses avec des institutions qui ne s'inscrivent pas dans le même positionnement. Cela fait toute la complexité du problème, ainsi que l'enjeu de la présentation d'un rapport qui ne fustige pas la PJJ, mais qui aborde l'ensemble des questions fondamentales liées au traitement de la délinquance.
M. le rapporteur - Ne voyez aucune malignité dans la question que je vous ai posée !
M. Georges Pellen - Pas du tout !
M. le rapporteur - Notre seul souci est de bien connaître, pour bien proposer et, si possible, bien agir demain.
M. Georges Pellen - Tout à fait !
M. le rapporteur - Vos propos rejoignent un certain nombre de constats que nous avons établis.
Ma deuxième question aura trait aux moyens humains. Là aussi, nous avons relevé des situations paradoxales : des personnels se trouvent en surnombre dans certains établissements, tandis que des manques apparaissent dans d'autres. On nous a affirmé, en outre, qu'il existait une crise des vocations ; cette crise n'est-elle pas liée à une crise d'identité de la PJJ ? Vous avez parlé tout à l'heure de « corps d'élite » : or ne recrute-t-on pas aujourd'hui par défaut, si je puis dire, des personnes passant les concours d'entrée dans la fonction publique et rejoignant la PJJ quand ils ont échoué ailleurs ? Il faudrait alors véritablement en revenir à une orientation positive. Mais le métier d'éducateur est-il encore compatible avec la fonction publique telle que nous la connaissons actuellement ?
M. Georges Pellen - Un réel problème se pose dans ce secteur en terme de professionnalisation. Pendant près de quinze ans, on n'a guère mis en place de politique de recrutement construite devant la montée de la pauvreté, qui a engendré les phénomènes de délinquance que nous enregistrons. A l'heure actuelle, la PJJ n'a pas surmonté les effets de cette carence.
En outre, elle a créé mille postes en deux ans, en recrutant par voie de concours externes. Ce chiffre est très élevé, et l'appel d'air ainsi provoqué, eu égard à la crise de l'emploi, a pu amener des jeunes très diplômés à s'orienter vers les concours ouverts par la PJJ et à occuper des emplois pour lesquels ils étaient préparés sur le plan intellectuel, mais peut-être pas sur le plan professionnel. En effet, ils se trouvent confrontés à des jeunes en très grande difficulté, ce qui peut fragiliser leur positionnement.
De surcroît, le management est très centralisé. De notre point de vue, l'évaluation des besoins et des profils des candidats s'en trouve insuffisamment approfondie, d'où une gestion de l'emploi très fonctionnalisée, avec des processus d'affectation plutôt techniques et peu en rapport avec les dispositifs et les projets. Ce système n'offre d'ailleurs pas aux personnels une vision claire des parcours professionnels qui leur permettraient d'expérimenter, d'enrichir leur fonction et de la mettre en perspective. Il existe donc toute une problématique relative à la gestion des ressources humaines, sur laquelle la PJJ devrait à notre sens se pencher très rapidement.
M. le rapporteur - Ma troisième et dernière question portera sur l'absence de « fil rouge ». La PJJ devrait assumer le rôle de pilote, mais peut-elle le faire dans l'optique que vous préconisez, qui repose, si je vous ai bien compris, sur le partenariat et la proximité ?
M. Louis Dubouchet - Attention au partenariat, car le partenariat, c'est l'irresponsabilité organisée !
M. Georges Pellen - Il concerne la construction de la réponse.
M. Louis Dubouchet - S'agissant de l'action collective, de l'élaboration d'une politique locale et de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités locales, le partenariat est une démarche pertinente. En revanche, quand il s'agit d'aller à la rencontre de quelqu'un qui refuse d'écouter qui que ce soit, si personne ne s'engage, le partenariat ne produira aucun résultat.
Notre préconisation -nous rejoignons ici des intervenants que vous avez déjà auditionnés- est plutôt de mettre en place un système comportant un prescripteur et un prestataire. Il ne faut pas borner le rôle de la PJJ et des associations à la seule mise en oeuvre d'une ordonnance dont elles ne pourraient pas débattre avec le juge. Or, à l'heure actuelle, les modalités d'exécution peuvent être discutées si ce dernier le veut bien, mais cela n'est pas prévu de façon systématique.
L'idée est donc que juge et PJJ soient associés, à un échelon territorial qui reste à déterminer, pour évaluer la gravité de la situation et ajuster, en fonction de celle-ci, le type de mesure retenue. On devra alors savoir qui sera appelé en garantie si cette mesure est mal appliquée. Il me semble que le magistrat doit rester le pilote tout au long de l'exécution, quitte à prévoir éventuellement un copilotage.
En conclusion, le juge ne doit plus avoir à prendre son téléphone pour contacter trente directeurs d'établissement qui refuseront d'accueillir un jeune. L'exécution de l'ordonnance doit plutôt être confiée à l'unité départementale de la PJJ ou à une structure plus locale dans les départements très peuplés. C'est à cet échelon qu'il conviendra de réfléchir aux différentes étapes qui constituent le parcours du jeune.
S'agissant enfin des personnels, je pense qu'il faut abandonner l'idée fausse selon laquelle la PJJ peut garder et insérer. A mon avis, les centres fermés ou les nouvelles prisons pour mineurs, si l'on retient le modèle italien, doivent être gérés par l'administration pénitentiaire, dont c'est clairement la vocation. Ensuite, on tentera de bâtir un parcours d'insertion, mais la PJJ doit être libérée de l'injonction abusive que j'évoquais. Son rôle commence dès lors qu'un début de contrat a été passé. A cet égard, on constate que les CER fonctionnent bien, parce qu'il y a la menace de la prison et que l'on peut y être exigeant en matière d'activités.
Dans cette optique, rejoindre la PJJ deviendra un choix véritable : les personnes recrutées ne seront pas confrontées à des situations intenables.
M. Georges Pellen - C'est toute la question du recentrage sur la fonction éducative.
Audition du père Guy GILBERT,
Association Bergerie de
Faucon
(24 avril 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre Schosteck, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre le père Guy Gilbert, qui s'occupe depuis de nombreuses années d'adolescents en grande difficulté, notamment dans le cadre de l'association Bergerie de Faucon.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Vous avez la parole, mon père.
Père Guy Gilbert - Je suis un « vieux clou » de l'éducation surveillée, puisque j'ai quand même soixante-six ans. Je suis né à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Je suis entré au séminaire à l'âge de treize ans -cela remonte donc à cinquante-trois ans-, poussé par une vocation impérieuse. J'ai fait quinze ans de séminaire pour être ordonné prêtre à l'âge de trente ans. Je pensais vivre parmi mes bigotes, mes lapins, mes poules et mes cloches, dans une paroisse, parce que j'avais une vocation bucolique forte, et me voilà entouré depuis trente-six ans de sauvageons, de loubards et de jeunes en marge...
J'ai d'abord été prêtre du diocèse de La Rochelle, puis je suis parti faire la guerre en Algérie. C'est d'ailleurs là qu'est née ma vocation particulière, par la rencontre, dans une paroisse, d'un jeune qui mangeait dans la gamelle du chien, après le chien. Je l'ai accueilli une nuit dans mon presbytère, je l'ai gardé sept ans et il m'a amené ses copains : c'est ainsi que je suis devenu éducateur spécialisé. Juste après l'indépendance, j'ai passé cinq années extraordinaires en Algérie, parmi des jeunes pauvres mais d'une puissance prodigieuse, car ils savaient que désormais le pays était à eux. Malheureusement, il y a eu par la suite quelques « lézards », mais passons...
J'ai accompli là-bas un travail d'animateur pour lequel j'étais fait. La plupart des chrétiens étaient partis, et je n'allais pas confesser trois fois par jour les trois vieilles taupes qui étaient restées ! De plus, nous étions trois prêtres. Il est important de souligner que j'ai vécu pendant treize ans en pays musulman, à partir de 1957. J'ai servi pendant trois années atroces dans les commandos, comme infirmier pour prendre mes distances avec l'horreur, et j'ai fini ma théologie en Algérie. Je connais donc bien le monde maghrébin ; j'ai appris le Coran, tout en restant prêtre catholique jusqu'au bout des ongles, et comme je suis souvent confronté à une délinquance maghrébine très forte -j'en parlerai tout à l'heure-, le fait de connaître l'arabe et l'islam permet une rencontre très importante pour ces jeunes. Je le signale au passage.
Je suis rentré à Paris parce que tout explosait : mon groupe comptait trois cents jeunes musulmans et le mufti se bouffait les couilles de rage, en m'accusant de les convertir alors que je faisais le ramadan avec eux, etc. Je suis allé loin, mais monseigneur Duval, le cardinal-archevêque d'Alger, m'a dit que je devais partir, parce que tout cela risquait de mal se terminer. Il m'a confié au cardinal Marty, archevêque de Paris, et je suis rentré. Or le hasard, ou plutôt la providence, avait voulu qu'un prêtre de rue passe me voir à Blida dans mon presbytère et m'affirme : « Tu es prêtre pour la rue, toi mon pote ! » J'ai répondu que non, mais j'étais bel et bien prêtre de rue sans le savoir. Je me suis donc immédiatement installé dans le XIXe arrondissement pour me consacrer à un travail de rue que je vous expliquerai rapidement.
A cet instant, je tiens à te signaler, Jean-Pierre (l'orateur se tourne vers M. le président) , que je suis prêtre, mais aussi éducateur spécialisé diplômé. Je le précise, parce que parfois les autres éducateurs me prennent pour un charlot et me disent : « T'es juste un curé qui s'occupe de délinquants, mais t'es pas diplômé. » Je leur réponds : « Mon cul, je suis diplômé, mon pote. Si tu veux mon diplôme dans la gueule, le voilà ! » On peut être bon éducateur sans diplôme, mais la référence est importante.
C'était alors le foutoir. J'ai eu mon diplôme à 45 ans. C'était très dur. Quel fourre-tout incroyable ! Je me souviens, quand le psychologue de mes deux faisait une conférence sur les délinquants, je lui disais : « Mon pote, tu as certainement dû voir des délinquants en bandes dessinées ; il faut au moins cinq dictionnaires pour te comprendre ». C'était le vieux temps.
Je reprends mon parcours. J'arrive à Paris. J'ai vécu une aventure prodigieuse en tant qu'éducateur. Je suis maintenant président d'une association avec vingt équipiers. Mais je suis arrivé dans la capitale le cul nu avec le jeune que j'ai amené et qui s'est marié après. Nous étions cinq prêtres. Littéralement, nous cherchions des jeunes, des prostitués et des drogués, dans la rue, avenue Foch ou ailleurs.
Il s'agissait de jeunes de douze à treize ans, paumés, jetés de leur maison. Nous devions avoir une grosse moto pour attirer le client. Ils devaient probablement penser que nous étions des pédés parce que nous les invitions très vite à monter sur notre moto. Nous leur disions tout de suite qui nous étions. Les jeunes étaient les proies des pédophiles ou des policiers qui les cherchaient -c'est leur boulot- pour les jeter après et ça recommençait. Nous avions cinq permanences.
Cette rencontre fondamentale m'a permis de connaître la violence à fleur de peau des jeunes qui ne vivent que par des mots et des gestes violents. Elle m'a permis aussi de temps en temps d'envoyer une droite évangélique dans la gueule d'un mec pour freiner ses assauts. Vous avez vu Bayrou avec son geste d'anthologie ? On a trouvé ça absolument extraordinaire. Il a gagné 2 % dans les sondages. C'est dommage que Jospin n'ait pas pris une dérouillée par trois loubards. Cela aurait été superbe car il fait un peu de karaté. Passons !
J'ai donc rencontré la violence à l'état pur, moi qui ai été tant aimé par ma mère et mes quatorze frères et soeurs. Je me suis battu. « Tes mains sont faites pour bénir », me direz-vous. OK ! man. Mais, de temps en temps, quand il faut, il faut. J'ai rarement utilisé la violence mais elle peut être aussi une antidote. Quand on voit un môme traîner en justice un éducateur qui lui a griffé le nez en voulant le séparer d'un autre, c'est à se taper le derrière au plafond !
Un adulte digne de ce nom ne doit pas faire peur à son lardon mais, à un moment donné, il doit montrer qu'il est craint. Or, nous avons peur de nos jeunes maintenant. C'est un séisme fort, diffus, que tout le monde ressent.
Ce milieu ouvert a été une expérience extraordinaire, une rencontre fabuleuse. J'ai passé dix ans ainsi. Et puis est arrivée l'aventure de la Provence. Un éducateur qui vit vraiment avec les jeunes ne doit avoir aucun plan préétabli. C'est la dernière des conneries et c'est une façon méprisante de s'occuper d'eux. Mais vivre parmi les jeunes, c'est entendre leurs désirs et les écouter longuement.
Un jour, un jeune m'a dit : « Ecoute, Guy, c'est chouette ce que tu fais ; tu nous cherches dans la rue ; tu nous mets dans ta permanence ; huit jours après, on se casse ; ensuite, c'est les flics. La drogue est vendue à dix mètres de chez toi. » Elle est toujours vendue en toute impunité à dix mètres de ma porte dans le XIXè. Le dealer vient chercher sa came tous les soirs. C'est un renoi, un Africain. Vous voyez une dizaine de petits noirs qui arrivent. Vous savez d'ailleurs ce qu'ils gagnent en fonction des vêtements qu'ils portent. Je connais bien les jeunes : ils veulent toujours des marques. Ceux-là ont 2.000 à 3.000 francs de fringues sur eux et ils en changent souvent. Cela se passe devant ma porte mais de façon accrue maintenant.
« Achète une ruine loin de Paris, continue ce jeune, on la rebâtira de nos mains avec de vraies pierres. » J'ai eu le culot d'acheter cette ruine en 1974. (Le père Guy Gilbert montre une photographie.) Voilà ce qu'ils en on fait (Le père Guy Gilbert montre une seconde photographie) .
Ainsi, 250 loubards dits « irrécupérables » par des juges des enfants ont réussi ce tour de force en dix ans parce qu'ils avaient un projet et qu'ils en avaient marre des adultes qui se masturbent le cerveau pour savoir ce qui se passe dans leur petite tête blonde et décident de ce qu'il faut faire. J'ai écouté ce gosse et je lui ai dit : « Tu veux bâtir ? OK ! » Et voilà ce magnifique mas provençal.
Comment vivent-ils à l'intérieur ? (Le père Guy Gilbert montre quelques photographies de jeunes ou de lui-même.) Je vous montre ces photos parce qu'elles valent mieux que tous les discours et toutes les explications et pour vous dire que ce n'est pas mon oeuvre. Nous sommes partis de la réflexion d'un jeune.
Je ne prétends pas que cette aventure formidable est exemplaire mais elle est un référentiel très fort. Peu importe que ces jeunes partent en mer ou restaurent des châteaux, l'important est de leur faire faire quelque chose.
Je ne dis pas qu'il faut les exporter, les foutre dans un camp de concentration. Je dis simplement que ceux qui nous pètent les couilles, qui nous emmerdent et qui foutent un binz grave dans les quartiers sont de petits mômes. Les médias en rajoutant, on a l'impression que tout le quartier est sens dessus dessous. C'est faux. Je connais un jeune dans mon quartier qui, il n'y a pas longtemps, a cassé et brûlé, à lui tout seul, vingt-cinq bagnoles dans la nuit. Il a foutu en branle tous les commissariats du XIXème.
Ce milieu ouvert a été une aventure prodigieuse pour moi. Il faut connaître ces jeunes. Je me suis battu. J'ai perdu toutes mes dents. Il y a des moments très importants de connaissance, d'affrontement mais aussi d'éloignement. Pour certains jeunes, pas tous, l'éloignement est très important. Actuellement, on voudrait que tous les sauvageons se cassent. La lune est trop proche ; Mars serait une solution intéressante. Un éloignement pendant un temps est essentiel mais il faut que les ministres de la justice aient les couilles de le décider parce qu'ils en parlent depuis longtemps.
Et puis, je ne prends que huit jeunes, des cas lourds. Depuis trente ans, j'entends les ministres de la justice bramer au clair de lune : « Pour les cas lourds, il faut un adulte pour un jeune avec une mesure éloignement. » Mais ils ne le font pas ou ils ne peuvent pas le faire faute de moyens. La France est quand même le quatrième ou le cinquième pays le plus riche au monde mais elle n'arrive pas à gérer une société qui nous baise la gueule, qui nous fait chier.
Je prends l'exemple de Nasser qui vient d'arriver. Lui pour péter les couilles des gens dans la banlieue, il a été fort. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples. On me donne des jeunes dont plus personne ne veut. Ils ont seize ans et ont déjà fait quarante centres. Parce qu'ils pètent les couilles à tout le monde, on les jette. Nasser n'avait que sept petits délits au cul, c'est-à-dire sept agressions. Je m'en suis aperçu quand il est passé dernièrement devant le tribunal. Intéressant ! Le juge ne savait pas quoi faire. Nous jugeons avec nos yeux d'adultes.
On se souvient quand même des conneries qu'on a faites ; l'adolescent, non. C'est trop loin surtout quand il a déjà un périple énorme de délinquance. S'agissant de Nasser, il y a le dessous de l'iceberg que je connais. Mais si sept agressions ont été répertoriées, une vingtaine au moins ne l'ont jamais été. Vous savez très bien que les gens ne portent pas toujours plainte.
Oui, il faut un suivi. Ces jeunes me sont confiés à la sauvage. Vous voulez savoir comment ? Je reçois trois cents fax chaque année. Je ne prends que huit jeunes par an. Je suis le président de l'association, mais je veux voir les mômes moi-même. Il est arrivé que la PJJ ou la DDASS m'en amène un avec son sac. Une heure après, l'éducatrice se casse trop ravie. Quant au môme, là ou ailleurs... C'est comme ça. Elle me laisse juste un numéro de téléphone. Elle en avait ras-le-bol du coco ! OK ! Celui-là nous a fait chier mais il est sur la route maintenant.
Quel est le principe de la ferme ? Une socialisation par les bestioles. Elle peut aussi se faire par la mer. J'ai un ami qui est venu me voir en Provence. Lui, il est dans les bateaux. Les mecs en chient mais l'expérience est forte et elle m'a semblé bonne. Nous, nous avons choisi la socialisation par la nature. J'ai des racines paysannes par ma mère. J'adore les bestioles.
Le type m'est confié par le juge. Souvent, je le prends à Fleury-Mérogis et je l'amène directement à l'aéroport. Il monte avec moi. Je le fous dans les pattes du commandant de bord. Il ne me fera pas chier pendant une heure et quart. Je lui dis que le jeune vient de Fleury-Mérogis. OK ! man. Nous survolons la prison. Une heure et quart après, nous arrivons à Marignane. Après deux heures de route, nous sommes en pleine brousse. « Putain ! » me dit le gosse. Je lui précise que nous allons dans une ferme. Il me dit : « Ah bon ! Je déteste les paysans, ça pue. » Je lui réponds : « OK. » Il me dit : « Tu sais, moi je ne balaie jamais ; c'est pour les gonzesses. J'ai des lumbagos. » Je lui réponds : « On te soignera ; on a tout ce qu'il faut. »
Et puis, il regarde autour de lui : « Il y a des autruches ? » Je réponds : « Oui. » Il me dit : « Je pourrais aller les voir ? » Je lui réponds : « Bien sûr ! » Avec deux seaux, il a nourri les bêtes pendant une heure. Là, il fait attention, le coco, car c'est l'animal le plus dangereux que nous ayons. Il peut défigurer ou tuer quelqu'un. Je lui dis : « Tu as travaillé ? » Il me répond : « Non. »
L'attraction des bêtes est si extraordinaire. C'est pourquoi l'expérience n'a pas pris un poil blanc en vingt-huit ans. Ce sont les bêtes qui règlent notre vie. A sept heures et demie, ils sont debout, samedi et dimanche compris. Le coco qui ne voulait pas travailler va se farcir un travail 365 jours par an. Bizarrement, ces jeunes qui n'ont que des droits et aucun devoir deviennent très rapidement, par un système éducatif fort et ferme, d'excellents éducateurs.
Les loubards qui sont venus disent aux autres : « Mon pote, j'ai remarqué que tu pisses de neuf heures à neuf heures et demie. Tu pisses long ! A neuf heures et demie, tu chies mais alors très, très long. » Ils peuvent se mettre à cinq sur une vieille. Il faut un grand courage. Mais, là bas, ils ne se font pas de cadeaux.
Nous avons une grande rigueur, une grande fermeté, une grande proximité, une grande fraternité. Et puis, les 35 heures, je m'en tape. Il nous faudrait deux fois plus d'éducateurs qui sont, entre parenthèses, payés avec mes droits d'auteur. La DDASS ne nous donne que deux salaires.
Nous avons une petite structure de huit jeunes, une socialisation par le village. J'en ai bien étudié l'emplacement. Elle est située à sept kilomètres du village. Ils peuvent fuguer. Laissez-moi vous dire que sept kilomètres de montagne, ils n'aiment pas trop. Nous avons très peu de fugueurs. Nous animons les fêtes de village. J'organise des bals superbes. Il n'y en avait plus depuis longtemps.
Nous sommes très cotés là bas mais il a fallu beaucoup de temps, vingt-huit ans. C'est important parce que je ne veux pas faire vivre ces jeunes dans un camp de concentration avec des gens qui nous surveilleraient avec des jumelles et qui dormiraient avec leur fusil sous l'oreiller. Avec les paysans, nous avons connu des tas de choses. C'est très important pour nos jeunes. Si l'on veut les socialiser, il ne faut pas les mettre dans une bulle dont ils ne pourront pas sortir.
La prise en charge ? Elle est faite par la PJJ quand un délit a été commis ou par la DDASS lorsqu'ils sont paumés.
Comment sont recrutés ces jeunes ? Ce sont les pires. Ils ont commis deux ou trois vols avec violence. J'en ai eu un de treize ans qui était inculpé de tentative d'assassinat. Il était complètement vidé. Ce sont des jeunes « explosés » de treize à seize ans.
Quelles sont leurs caractéristiques ? Ils sont très violents, super paumés. Au niveau psychiatrique, il n'y a pas de lézard. Il y a beaucoup d'exclus qui ne se respectent pas. Comment voulez-vous dès lors qu'ils respectent les autres ? Nous leur apprenons à dire : « Tu es un être irremplaçable, mon pote. » Nous leur apprenons à s'aimer eux-mêmes.
Je reçois trois cents fax par an. Il y a une demande énorme. Je peux vous donner quelques caractéristiques. Les trois quarts sont maghrébins. La délinquance maghrébine est forte. Ce n'est pas à moi d'en expliquer les causes mais c'est peut-être tout un système politique qui n'a pas pris en compte l'intégration de ces jeunes. Ceux qui nous arrivent sont de beaux cocos.
Je note aussi, depuis trois ans, un nombre inquiétant de pédophiles. Ils sont pédophiles à quatorze ans, lorsqu'ils touchent le sexe de leur petit frère ou de leur petite soeur de trois ans. J'en ai eu un, laissez-moi vous dire que ça a été coton. Nous avons connu deux petites bavures avec les enfants de ceux qui viennent nous visiter. Il y en a eu d'autres après. C'est inquiétant. Evidemment, je n'ai pas besoin de dire qu'aucun centre n'a envie de recevoir un jeune pédophile. J'en ai un de douze ans qui avait violé un jeune de onze ans. Personne n'en voulait ; je l'ai pris.
Mon équipe est composée de vingt personnes. Quelles sont leurs qualités ? L'équilibre affectif, d'abord, c'est très important, puis une grande solidité et une grande énergie. Ils aiment donner du temps. Un jour, une inspectrice de la DDASS me disait : « Monsieur l'abbé, et les 35 heures ? » Je lui ai répondu : « Vous me parlez des 35 heures. Tous les jeunes que vous me donnez ont connu des éducateurs qui font les 35 heures. Ils passent. »
Sont-ils diplômés ? La plupart ne le sont pas. J'ai eu des adultes quasiment analphabètes qui avaient une puissance d'éducation remarquable. Les trois quarts veulent obtenir après le diplôme d'éducateur spécialisé. Laissez-moi vous dire qu'au bout de deux ans -ils ne restent pas plus- ils sont cassés mais heureux et prêts à affronter la vie.
C'est une véritable vocation pour moi. On ne peut pas être éducateur comme on est informaticien. Ceux avec qui je travaille sont à 100 % performants. Le mec qui triche ne reste pas longtemps. Et puis, ils sont passés chaque mois au crible par mes jeunes. Je leur dis : « Voilà Jean-Baptiste. Est-ce que ça va, oui ou non ? » Les jeunes disent ce qu'il a fait de bien au niveau du comportement et du travail. Ils le jugent ainsi que les éducateurs. Puis, vient le tour des autres éducateurs. C'est remarquable.
J'en ai mis quelquefois deux ou trois à la porte dans la minute qui suit non pas pour des délits graves mais parce qu'ils nous pétaient les couilles. On leur disait depuis trois mois que les jeunes commençaient à en avoir marre. Les jeunes parlent. Il faut certes parfois trier, mais quand la même chose se reproduit sans cesse, il faut agir.
L'ordonnance de 1945 est obsolète. Ecoutez l'histoire de Yann, douze ans et trois mois, qui m'a été confié par le juge des enfants de Lille. Dix fois, le juge a demandé au petit chéri de venir. Il n'a pas voulu. Nous sommes en démocratie. A douze ans et trois mois, on fait ce qu'on veut.
Enfin, avec sa mère et son frère, il arrive avec son paquetage, prêt à partir. Il me tient de grands discours. Ce môme commençait à me baver sur le haricot. J'ai fini par lui dire : « Tu commences à me faire chier, mon pote. Tu as commis je ne sais combien de cambriolages. Tu vas avec des mecs de seize ans qui profitent de toi. C'est toi qui faisais le guet et qui portais les sacs de cinquante kilos et tu es impuni. » Vous ne savez pas ce que m'a répondu le môme, un juriste distingué ? Il m'a dit : « Moi, monsieur, j'ai neuf mois à tirer. » Cela signifie qu'à douze ans et trois mois il peut vivre dans l'impunité totale. Je lui ai dit : « Et quand tu péteras la gueule à une vieille ? On ne pourra rien faire tant que tu n'auras pas treize ans. »
Je remarque, comme tout le monde, que la délinquance est de plus en plus le fait de jeunes. Dans l'une de mes circulaires, j'ai écrit : « De plus en plus jeunes, de plus en plus violents. » Qu'est-ce qu'on s'en fout que tout le monde le constate puisqu'on ne fait rien et que les jeunes de moins de treize bénéficient d'une impunité totale !
Je ne suis pas pour l'enfermement. Jacques Chirac, quand il était Premier ministre, m'avait demandé de siéger au Conseil national de prévention de la délinquance. J'ai gueulé ma race pendant deux ans dans cette instance en disant : « Il y a 7.000 mineurs en tôle pour des conneries. Arrêtez ça ! » Jacques a d'ailleurs fait une loi pour limiter la détention. Il y en a à peu près 700 maintenant. C'est un sacré retour de l'histoire. Tout le monde, droite et gauche, parle d'enfermement. Je ne citerai pas Le Pen qui veut enfermer tout le monde sauf lui, je pense. C'est intéressant.
N'oubliez pas l'histoire de Yann. Elle est très importante. Il faut avoir les couilles de faire une loi nouvelle pour dire que nous ne pouvons pas laisser ces petits gars qui sont excessivement dangereux ; ce sont de jeunes fauves en liberté. De plus, la bande de seize ans connaît bien la loi et va profiter de lui. Lui sera remis à sa mère puisque son père est parti et sortira deux heures après du commissariat.
Je remarque que de plus en plus d'éducateurs spécialisés refusent de se plonger dans la mêlée. Ce n'était pas évident il y a trente-deux ans ; ça ne l'est pas plus maintenant. Mais quel bien peut faire un homme, une équipe dans une cité ! Les flics comptabilisent les viols, les agressions, etc. OK ! Ils sont là pour ça. Mais les statistiques sont un peu pipées ; on leur fait dire ce qu'on veut, vous le savez très bien.
Cependant, on ne prend pas en compte la diminution du nombre de viols, de meurtres et de cambriolages due au travail de l'éducateur et de son équipe. Il y a une présence d'adultes à côté de celle du dealer. Ah ! l'image de l'adulte quand vous avez un père immigré chômeur. L'emblème de la paternité, c'est le mec qui a une BMW. Je le constate partout en banlieue ; c'est connu. Des mecs de dix-huit ou de vingt ans roulent en BMW et font leur putain de trafic de drogue qui empuantit les rapports. Voilà ce que je note depuis trente-deux ans.
La drogue empuantit formidablement les banlieues -entendez-vous ça ?- parce qu'on n'a pas su gérer le problème : 4 à 5 millions de jeunes fument et il y a tous ceux qui vendent 10 milliards d'anciens francs de drogue par an. C'est dingue.
On note de plus en plus un refus des éducateurs de rue. Je me souviens avoir parlé dans une église parce qu'il n'y avait pas de salle assez grande. Les éducateurs de rue étaient là avec des loubards. L'un d'entre eux a voulu prendre la parole. Un jeune a dit ceci : « Tu fermes ta gueule, l'éducateur. On te voit trois heures par jour dans ton bureau. Tu as peur de nous. L'éducateur ici, c'est le curé parce qu'il est là et qu'on peut sonner à sa porte même la nuit. Tu comprends ? »
Il y a un de ces foutoirs au niveau de la prise en charge : juge, éducateur. Le dernier môme que j'ai eu a vu quatre éducateurs ; il ne les connaît plus. Il faudrait quand même centraliser tout ça. Le môme est perdu. Moi, je m'en tape mais il ne faut pas qu'on me bave sur les rouleaux.
Il faut multiplier les suivis à la sortie de la tôle. Quelle carence ! Vous connaissez sans doute les statistiques. Nous qui sommes dans une société performante extraordinaire, il y a 70 % de récidivistes.
Il y a vingt ans, un type qui violait un gosse était condamné à un an de prison. Vous savez, à cette époque, violer un gosse... D'abord, celui-ci mentait. Souvenez-vous. La justice était alors très cool. Elle est implacable maintenant. Tant mieux ! Il sort et recommence. Là, il y a des attouchements. OK. Il recommence encore. Là, il a violé et tué. Il a été condamné à dix-huit ans de prison. Ce malade n'a eu aucun suivi. C'est vraiment à se taper le derrière au plafond. Là, la justice est criminelle.
Il faut un suivi. Moi je le fais avec les petits qui sont venus dans ma bergerie. J'en ai un qui est sorti après avoir fait douze ans de réclusion. Il a eu son mandat tous les mois. A sa sortie, nous n'aurions pas dû être là mais nous l'avons aidé financièrement pour trouver une chambre d'hôtel. C'est comme ça que je fais. C'est pourquoi je ne prends pas beaucoup de jeunes.
Quelle sanction ? J'en reviens à Nasser qui a commis sept agressions. Avec un autre, il a cassé, il n'y a pas longtemps, une bagnole dans notre bergerie à Faucon. Je ne suis pas juge. Au lieu de le faire avec le tracteur en deux heures, il a enlevé, avec une pelle et une pioche, durant deux jours, pendant ses loisirs, deux tonnes de fumier de sanglier et laissez-moi vous dire que ça cocotte. Il ne touchera plus aux bagnoles maintenant. Il faut une sanction.
Je joue aussi le jeu avec la juge. Les familles sont pauvres. Je lui dis vicieusement : « Donne-lui 700, 800 ou 1.000 francs d'amende. » Ils ont une paye. La DDASS nous verse 160 francs par mois. Excusez-moi, je parle en francs. L'euro, ce n'est pas mon truc. On peut leur donner jusqu'à 1 000 francs par mois grâce aux dons.
Nous valorisons le comportement et le travail. Toucher à leur thune est un bon système éducatif mais il n'y a pas que ça. Je puis vous assurer que lorsque la juge dit : « Mon pote, tu vas payer 2 000 francs », il y a 200 francs qui tombe chaque mois pour elle. Il a hâte que ça se termine. Je joue le jeu. Mais la plupart du temps, c'est évasif, on lui dit : « Ne recommence pas, mon petit chéri. Dégage, va chez ta mère ». Et ça recommence.
Pour terminer, je vous dirai simplement, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que les jeunes sont faits, non pas pour détruire, mais pour bâtir. S'ils détruisent, c'est que nous n'avons pas été aptes à les aider à construire avec leurs mains.
Par ailleurs, à Paris par exemple, il faut reconquérir les espaces. Les jeunes bouffent les espaces, y compris les espaces pour enfants, maintenant ! Ils mettent leurs pétards devant la gueule d'un gosse de deux ans. La première fois, le père va protester. Quand un mec lui dit « C'est toi qui dégages », eh bien, il dégage ! Ils ont conquis les espaces ; reconquérons-les : cela s'appelle être citoyen.
Apprenons-leur à se respecter d'abord. Ils ne nous respectent pas parce qu'on ne les a pas, quelque part, respectés et qu'on ne leur a pas appris le respect. Cela doit commencer tout petit, à la maison et à l'école ; tous les jours, avec le prof, étudier une petite phrase pendant deux minutes : « Ce qui est aux autres ne t'appartient pas », « Un vieillard, il faut le respecter doublement parce que c'est le maillon fragile de la vie ». Deux minutes tous les jours. J'ai appris cela petit, je me rappelle. Cela m'a laissé quelques traces.
Je suis favorable à l'enfermement des mineurs délinquants s'il est parfaitement étudié. On dénombre deux mille jeunes qui nous pètent vraiment les couilles et qui sont dangereux pour nous et pour eux-mêmes. Rendez-vous compte de l'effet dans les quartiers de la médiatisation infernale de certaines affaires, quand un mec brûle vingt-cinq voitures par exemple ?
C'est vous qui légiférez : vous avez une fonction importante dans le domaine politique, pour le bien du peuple. Alors, s'il ne faut surtout pas leur donner une espèce de « légion d'honneur » en les foutant en taule ou quelque chose d'assimilé, il y a effectivement des mineurs qui doivent d'urgence être enfermés. Je pense au petit Yann, qui est un vrai fauve en liberté. Faut-il attendre qu'il ait tué une vieille taupe de 85 ans, aidé de ses copains ? Parce que, évidemment, il faut toujours du courage pour attaquer une vieille...
A la ferme, il y a cinq portes, mais aucune serrure. C'est d'ailleurs extraordinaire : quand les jeunes arrivent -en général ce sont des poids lourds- et me demandent : « Il n'y a pas de serrures ? », je leur réponds : « Non, il y a des loquets. Tu peux casser quand tu le veux mon pote. Mais n'oublie pas que tu as du sursis. Tu es sorti de tôle, tu peux y retourner demain. »
C'est très important que l'éducateur soit fort face au juge. Il m'est arrivé, mesdames, messieurs les sénateurs, de dire à un juge à propos d'un jeune : « Je t'en supplie, monsieur le juge, mets-lui huit jours. » Le juge m'a répondu : « Non. D'ailleurs, vous, vous êtes bien opposé la détention des mineurs ? » Je lui ait dit : « Mais oui, mon frère ! Mais ce jeune est claustrophobe et il a commencé à attaquer. Tu ne sais pas ce que je sais : je t'en prie, enferme le huit jours ! » Il l'a fait. Jamais plus ce jeune, qui partait complètement en couilles, n'a touché les biens d'une personne.
De temps en temps, il n'y a que cela à faire. Pourtant, vous savez bien que je suis contre la détention des mineurs. J'ai assez gueulé ma race quand Jacques Chirac était Premier ministre pour qu'on arrête ça. Je souhaite que mes propos, ainsi que ceux des autres intervenants, ne restent pas à l'état de notes de commissions ou de sous-commissions. C'est bien de faire venir des gens pour vous dire des choses ; j'espère que vous nous écouterez, un peu.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Merci, mon père, de cet exposé. Notre souci est effectivement que le rapport de cette commission ne reste pas dans des tiroirs, qu'il ne soit pas sans suite. Nous voulons bien connaître pour, demain, bien agir.
Vous qui avez une grande expérience de près de quarante ans, pensez-vous que le comportement des jeunes a évolué par rapport à ce que vous avez connu -puisque vous avez notamment parlé de la forte délinquance maghrébine- quand vous étiez en Algérie ?
Père Guy Gilbert - Tout à fait. Mais, s'agissant de l'Algérie, Jean-Claude (l'orateur se tourne vers M. le rapporteur) , il faut laisser tomber les comparaisons : c'était une tout autre situation, j'étais respecté.
Deux choses ont évolué considérablement. La drogue a pris une emprise formidable sur les jeunes : il existe un marché parallèle énorme. Un gamin, à qui j'avais trouvé un stage, m'a dit : « Mais, curé, tu me prends pour une bille ! J'ai seize ans, je gagne 10.000 francs par mois nets d'impôt. Ton stage de 3.500 francs, tu peux te le foutre où je pense ! » Les dés sont pipés au départ.
Je constate depuis trente-deux ans une montée de violence énorme. Plus on descend dans l'échelle des âges, plus elle grandit. Auparavant, je les voyais venir à la permanence à vingt ans avec un pistolet Magnum. Maintenant, ils sont « enfouraillés » grave, à douze-treize ans. J'ai vu un jour dans la permanence un jeune de douze ans avec un truc suspect dans la poche. Il prétend que c'est un couteau à cran d'arrêt. On le fouille : il en avait quatre ! « Ben, au cas où on m'attaque ! » nous répond-il.
Tu vois, Jean-Claude, la violence est une mode. A Nancy, quarante loubards veulent faire la fête : ils brûlent des bagnoles. C'est très tendance actuellement. Eh bien, à Strasbourg, les jeunes se disent : « On va faire mieux. » Ils en brûlent cent.
Il y a un mois et demi, j'étais aux sports d'hiver. Quand ils ont vu mes gentils sauvageons arriver, les « perchmen », ils en bandaient de joie ! Ils avaient eu tellement d'histoires avec des gens qui se battaient à coups de bâtons pour passer les premiers !
Autre chic absolu aussi, des jeunes se mettent à douze dans des appartements qu'ils louent à deux : ils te foutent du rap à deux heures du matin. Les voisins, qui viennent à la montagne pour entendre le bruit des flocons de neige, protestent aussitôt. Malheur à eux, putain ! Protester parce qu'à deux heures du matin on met la sono à fond la caisse. D'où représailles, flics, etc. Cela s'est passé dans les Alpes du Sud. La violence s'exporte. Mais, dans ces situations, il ne s'agit pas de sauvageons ! Pour aller aux sports d'hiver, il faut du blé ! Non, ce sont des jeunes du commun. Alors, cela, ça doit s'arrêter. Que la violence soit une mode pour certains ne fait qu'amplifier ce qui n'en est pas une. Je comprends parfaitement la violence de certains, battus et enfermés comme des chiens. Etienne, par exemple, battu par sa belle-mère, qui lui jetait de temps en temps dans les WC où il dormait un peu de viande avariée qu'il devait manger devant elle. Tu sais, quand ces jeunes sortent de là, tu comprends et tu doutes. Etienne est à la ferme et cela marche d'ailleurs très bien. Mais on en chie. Il explose. Tu comprends mais tu gères.
Quand je vois les analyses de droite et de gauche actuellement, je bande de joie. Je me dis : « ça y est, ils ont tout vu, tout compris ! » Maintenant, il s'agit de foutre les finances et cadrer tout cela. L'élection présidentielle est importante : vous aurez une autoroute -enfin, j'espère- pour prendre des décisions. La crainte doit changer de camp. Je ne dis pas la peur : nous n'avons pas à avoir peur de nos jeunes et ils n'ont pas à avoir peur de nous. Mais quand ils commencent à passer au feu orange, il faut leur dire : « Mon pote, tu n'iras pas plus loin ! » Voilà tout ! C'est comme cela que nous passerons le relais.
M. le président - Merci infiniment de votre témoignage très utile. Comme l'a dit M. le rapporteur, il faudra faire en sorte que le sujet déborde un peu du cadre strict d'un rapport.
Père Guy Gilbert - Je vous fais confiance ! Sinon, je ne serais pas venu.
M. le président - Nous allons essayer !
Audition du docteur Michel BOURGAT,
Président de la
Fédération pour l'aide et le soutien aux victimes de la
violence
(FPASVV)
(30 avril 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT
M. Bernard Plasait, président - Nous allons entendre M. Michel Bourgat, Président de la Fédération pour l'aide et le soutien aux victimes de la violence.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur Bourgat, vous avez la parole.
M. Michel Bourgat - Je me présente à vous avec plusieurs expériences, celle d'un président d'une fédération de victimes de la délinquance juvénile, celle d'un médecin de quartier difficile, d'hôpital psychiatrique, et connaissant les exclus, celle d'un moniteur de sports considérés comme violents : les boxes pieds-poings, celle d'un chercheur autodidacte, auteur de textes et livres de vulgarisation, dont je me suis permis d'amener un exemplaire, enfin celle d'un adjoint au maire en charge de la prévention de la délinquance et de la citoyenneté de la jeunesse de la deuxième ville de France : Marseille.
Vous connaissez l'enjeu et les chiffres de la délinquance juvénile, il en est d'autres moins inquiétants qu'il convient de rappeler :
- 95 % des enfants et adolescents normaux ont tenté une fois au moins un transgression de règles ou de la loi républicaine ;
- 70 % de primo délinquants qualifiés ne reviennent jamais devant la justice, atteints d'une guérison « spontanée », imputable surtout à la nature humaine ;
- les 30 % de récidivistes, et surtout les 18 % de multirécidivistes, vont alors déclencher plus de 55 % des procédures des tribunaux d'enfants.
Ces « transgresseurs persistants », mot anglo-saxon, génèrent une réalité d'insécurité, amalgamant dans un sentiment d'insécurité d'autres jeunes non coupables. Le CNRS chiffre à 4.000 environ ces « prédateurs violents ». 65 % des jeunes majeurs incarcérés ont eu affaire aux tribunaux pour enfants.
Le profil psychologique de ces jeunes sombrant dans la violence et la transgression réitérée est connu :
- égocentrisme majeur, avec hypertrophie du moi ;
- absence d'affectivité et surmoi déstructuré désinhibant la satisfaction des besoins immédiats ;
- labilité et instabilité d'humeur maximales, induisant des passages rapides et imprévisibles à l'acte délictuel ;
- environnement familial particulier avec père absent, d'une façon ou d'une autre, et mère protectrice et laxiste.
Pendant longtemps, les filles furent très minoritaires ; elles rattrapent les garçons. La délinquance juvénile, d'abord urbaine, se déplace vers les campagnes. Les repères traditionnels s'estompent et l'exclusion scolaire est un facteur aggravant. Le milieu criminogène, subi ou choisi, est décrit comme une culture souterraine de violence dont les caractéristiques sont établies :
- absence de valeurs guides : travail, amour, respect, famille, solidarité... ;
- individualisme forcené érigé en méthode ;
- matérialisme exacerbé en corollaire ;
- modélisation de la fraude, de la tricherie et de la violence ;
- accès faussement justifié à la prospérité comme but suprême ;
- enfin, conditions économiques ou morales mettant les plus faibles en survie.
Ces sous-cultures ne se développent pas seulement dans la précarité et la pauvreté, et le dopage sportif est une illustration peu citée d'une sous-culture « riche ».
Les médias véhiculent une violence esthétisée, sans conséquences réelles visibles où le bien et le mal ne sont plus clairement indiqués, où les victimes sont systématiquement occultées et aseptisées, les jeux vidéo restant un modèle du genre.
Les flux migratoires des mineurs étrangers apportent aussi des particularités géographiques et ethniques et les différentes typologies de délinquance en sont nettement modifiées.
Ces sous-cultures sont le terreau des économies parallèles et de l'argent sale qui en découle.
Toute communauté démocratique est contrôlée par deux systèmes : les lois et les peines votées par les élus et devant être respectées par tous et les facteurs extra-pénaux du contrôle social. Ces derniers consolident le maillage social et l'autorégulation, voire l'auto surveillance des citoyens. Mouvements et associations de jeunesse, communautés religieuses, sport, culture, loisirs sont des exemples de ces facteurs de paix sociale émanant des citoyens eux-mêmes. Bien entendu, l'école et la famille participent à ces régulations. Les échanges et les débats intercommunautaires doivent être favorisés dans un espace qui doit rester républicain.
L'influence parentale a un rôle fondamental et les modifications récentes des milieux familiaux provoquent des bouleversements considérables dans les comportements.
L'influence des « pairs » devient capitale, voire prépondérante et les familles monoparentales, pouvant rester éducatives, faussent le rôle antique du père. Le rapport avec les institutions est donc bouleversé avec une désacralisation de la Loi et du sens social.
L'école de la République est en première ligne et subit de plein fouet les violences secondaires à ces mutations. Devenue simple lieu de vie, où la transmission du savoir n'est plus le but principal, l'incivilité s'y développe plus facilement qu'à l'époque du fameux sanctuaire culturel et républicain.
La police agit et tente, malgré les obstacles procéduriers qui l'inhibent, d'obtenir des résultats.
Le « maillon faible » se situe principalement au niveau d'une justice qui n'a ni moyens suffisants, ni textes adaptés à la réalité de la délinquance de 2002. La loi du 15 juin 2000 venant annihiler la tâche des policiers de terrain.
En ce qui concerne les lois des mineurs, il y en a deux :
- l'ordonnance du 2 février 1945, régissant la délinquance des mineurs ;
- la loi de 1958 concernant le mineur en danger, la prévention et la répression devant impérativement respecter les deux cadres juridiques.
L'ordonnance de 1945 fut souvent modifiée, mais jamais en profondeur. Son principe est admirable : privilégier l'éducatif sur le répressif ! Mais quel éducatif et quel répressif ?
C'est l'éducatif selon le « principe de réalité », et non selon le « principe de plaisir » qu'il faut choisir. Le « principe de réalité » implique une punition -et le mot est très important- à chaque transgression de règle. L'ordonnance n'en a pas eu les moyens, ni la volonté. Le mot « répressif » est mal choisi. C'est la punition éducative non humiliante, proportionnelle à l'âge et à l'acte qui doit être le choix logique du magistrat. Là encore, il existe un hiatus entre réalité et théorie.
De plus, le choix de l'éducatif à tout prix a eu pour conséquence de faire passer les victimes et les actes commis au second plan.
Nous sommes, en philosophie du droit, dans le « modèle de protection », focalisé uniquement sur le délinquant et opposé, philosophiquement, au « modèle de justice » qui ne considère, lui, que l'acte délictuel. En effet, le crime commis par un mineur de moins de 16 ans n'est pas jugé en cour d'assises. La procédure de flagrant délit des mineurs n'existe pas, remplacée par une étude psychologique refaite indéfiniment à chaque passage à l'acte.
La justice des mineurs, secrète, floue, et souvent orale, bafoue, certes au nom des bons sentiments, les principes du droit : ceux de Beccaria, préconisant la publicité des débats, l'origine législative des peines, leur proportionnalité et leur certitude selon les actes décrits par les textes en vigueur. En matière de crime aussi, le huis-clos est redouté par les victimes. Nous avons laissé une étude critique de l'ordonnance de 1945 à M. le président Larché lors d'une visite au Sénat en 1998. Je l'ai remise à votre disposition pour les détails. J'ai été aussi reçu par Mme Guigou et le ministère de l'intérieur en 1998, avec les mêmes propositions.
Le problème de la responsabilité pénale des mineurs est particulièrement épineux. Considéré comme « irréfragablement » irresponsable pénal, de la naissance à 13 ans, le mineur devient partiellement responsable grâce à l'arrêt Laboube, avec une excuse de minorité absolue entre 13 et 16 ans, puis relative entre 16 et 18 ans.
Il convient de re-préciser cette « irresponsabilité purement pénale » et de fixer un âge plancher. L'âge de 10 ans restant un choix admis par beaucoup, pour commencer à responsabiliser tout en restant éducatif. Actuellement, nous agissons trop tard et avec un arsenal pénal inadapté.
L'ordonnance du 2 février 1945 reste une référence si elle est appliquée à la lettre. Mais les modifications apportées en 1986, 1992, 1993, 1996 et 1998 ne corrigent pas complètement les insuffisances et nous avions émis des critiques dès 1997.
La suppression de la détention provisoire en matière correctionnelle pour les moins de 16 ans provoque, par exemple, plus de dérives qu'elle ne protège l'enfant coupable. Une détention aménagée pour les mineurs devient souhaitable.
Dès 1997, notre fédération de victimes rappelait quelques principes d'actions sur les mineurs :
- toujours donner une réponse judiciaire à un acte délinquant ;
- punir dès le premier délit, d'une façon adaptée à l'âge du mineur sans oublier l'acte ;
- punir d'une façon éducative non humiliante et selon le principe de réalité ;
- permettre enfin une rédemption et une réinsertion dans la société.
En dehors des réponses pénales désuètes proposées aux primo délinquants, on punit encore des mineurs récidivistes avec l'échelle de peines des majeurs divisée par deux ! La création d'une véritable échelle de peines adaptée aux mineurs permettrait de répondre bien plus tôt (et donc bien avant 13 ans) et d'une façon lisible et efficace à toutes les transgressions sans aboutir inexorablement à la prison par échec de l'échelle actuelle.
Du rappel à la loi jusqu'à la prison, en passant par la médiation-réparation et le travail d'intérêt général, un arsenal de réponses judicieuses arrêterait la spirale infernale vers la récidive.
L'ordonnance de 1945 restant efficace pour 70 % des primo délinquants, il convient de travailler en urgence sur la multirécidive et les réponses possibles et constitutionnelles à y apporter. La solution de l'internat non carcéral semble logique : nous en avons parlé dès 1996 !
On ne peut socialiser sans responsabiliser ! L'ordonnance du 2 février 1945, mal interprétée, déresponsabilise les mineurs coupables et n'a aucun effet de neutralisation, dans le sens criminologique du terme.
La contention physique momentanée, et en « phase aiguë », des multirécidivistes mineurs dans des structures fermées spécifiques non carcérales, contenant de 10 à 20 jeunes, permettrait un véritable travail psychologique individuel et une re-socialisation réelle, ces internats, à créer, pouvant par contre accueillir des interventions fréquentes de l'extérieur. Le travail en milieu ouvert pouvant aussi succéder à un résultat mesurable sur la conscience civique du mineur délinquant.
L'ordonnance du 2 février 1945 ignore les victimes et il conviendrait de leur prévoir une place plus valorisante dans la procédure.
Le phénomène de la multirécidive découle de carences éducatives manifestes de la part des parents comme de certaines institutions devenues impuissantes. « Nul n'est coupable que de son propre fait ». Parents et éducateurs en charge devraient pouvoir répondre de leurs erreurs éducatives et les négligences dont ils sont manifestement responsables. La mise sous tutelle des prestations sociales accordées à un mineur multirécidiviste doit être généralisée lorsqu'il y a détournement d'utilisation des fonds alloués pour les parents.
Le meilleur moyen de ne pas avoir de victimes est certainement d'éviter de « produire » des délinquants. Deux conditions sont impératives :
- cette prévention ne peut s'établir qu'avec la certitude d'une application sans faille des lois et des peines. Une justice efficace permet une police respectée et une régulation citoyenne optimum. Actuellement, la justice est le maillon faible à renforcer. Aucun travail de proximité ne peut se faire sans le préalable d'un ordre républicain inexorablement assuré ;
- c'est ensuite sur le « maillage social » et sur tous les facteurs du contrôle social que nous avons cités tout à l'heure qu'il convient d'agir. La loi de 1958, le travail des Conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD), les actions des contrats locaux de sécurité (CLS), l'éducation civique, l'urbanisme, la culture, les sports, la laïcité, la mise à niveau scolaire, tout doit concourir à éviter les transgressions tout en respectant les libertés individuelles. Là encore, une justice efficace est requise, et ce n'est pas le cas pour de multiples raisons techniques.
La prévention ne peut être qu'une coproduction de tous les acteurs sociaux et des collectivités locales dont ils dépendent, y compris d'ailleurs douane et fisc.
La collecte des données criminologiques doit être parfaite, synchronisée et diffusée à tous les niveaux de décision. Le rôle des CCPD est majeur et les CLS peuvent être, alors, les outils coordonnés par les maires (ce qui serait idéal mais n'est pas encore le cas), l'Etat restant toutefois garant de la légalité républicaine, de la police et de la justice.
La coordination des données et des actions nécessite une transversalité qui n'est pas encore dans les moeurs, mais qui pourrait exister entre communes, départements et régions. La prévention de nuit doit se préparer par des actions diurnes et les articulations entre services de police et services de prévention sont des nécessités incontournables.
L'action sur le tissu social ne doit pas être anarchique et les subventions doivent être validées après évaluation réaliste des résultats. Je connais, sur Marseille, l'éventail des dispositifs mis en place pour un contrôle plus ou moins efficace des situations délictuelles. Nous bénéficions d'un statut social particulièrement vivace et les phénomènes de bandes et de ghettoïsation sont moindres qu'ailleurs. Marseille reste une « ville laboratoire » en matière de prévention de la délinquance puisque nous y observons, sans débordement, les délinquances classiques et celles, plus récentes, des flux migratoires incontrôlés.
L'urbanisme doit être pensé pour éviter la relégation de populations concentrées dans des cités où elles sont exclues du tissu social. La médiation par l'intermédiaire des agents locaux de médiation sociale (ALMS) parfaitement formés vient s'inscrire ici, dans la relation des individus aux institutions et aux associations. Ces ALMS doivent s'appuyer sur un solide réseau de partenaires de terrain. Une politique de formation et d'emploi des jeunes doit permettre l'insertion naturelle ; elle est rarement mise en train et on avait noté que les zones franches ont eu un impact certain à ce niveau.
La formation d'un jeune commence à la naissance, avec des phases bien connues des pédopsychiatres. La prévention individuelle n'existe pas encore, elle devrait commencer dès la naissance et continuer à l'aide d'observatoires pour enfants en danger de délinquance, travaillant dans les crèches, les maternelles et les écoles. La composition de ces observatoires étant pluripartenariale : institutionnelle et civile. Chez les plus jeunes, livrés à la rue, il convient d'établir des références positives et une occupation du temps extrascolaire par des animations.
« Nul n'est censé ignorer la loi » dit-on, mais l'accès précoce au droit, l'instruction civile dès le plus jeune âge et l'incitation au respect et au dialogue républicain rendraient cette affirmation crédible. Le travail sur la citoyenneté de la jeunesse a donc beaucoup d'avenir (je dis ça parce que c'est aussi une de mes délégations). Le lien inter humain, dans toutes ses composantes, doit être travaillé, avec la création de lieux d'expression et de débats entre communautés et institutions.
En conclusion : « force à la loi » et « respect des individus », dans une société vraiment solidaire, sont les mamelles de la sécurité.
M. le président - Je vous remercie beaucoup. Je voulais simplement vous poser une question. Quand vous parliez tout à l'heure de l'internat, vous avez dit : « On ne peut socialiser sans responsabiliser ».
M. Michel Bourgat - En psychiatrie et en pédopsychiatrie, il faut dire que la loi du 2 février 1945, dans le texte et dans les faits, arrive à déresponsabiliser puisque le mineur est un irresponsable pénal et il a fallu qu'un arrêt, qui s'appelle l'arrêt Laboube, dise que pour condamner un jeune, il faut quand même qu'il ait compris le mal qu'il a fait. Donc, on a fait cet arrêt pour réintroduire de la responsabilité. Chez les multirécidivistes, dans les internats que nous souhaitons avec mon association, comment re-socialiser quelqu'un qui est encore irresponsable ? Il faut bien à un moment faire l'historique de son acte pour qu'il comprenne et à ce moment-là, une fois qu'il a compris, on peut le re-socialiser, et le plus vite possible.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - S'agissant de l'ordonnance de 1945, quelles évolutions vous semblent les plus nécessaires et les plus urgentes ?
M. Michel Bourgat - Je ne remets pas en cause l'esprit et la philosophie de l'ordonnance de 1945. Le problème vient d'un manque évident de moyens pour la justice, notamment la justice des mineurs. On punit les mineurs avec une échelle de peines totalement inadaptée, ce qui rend difficile l'action des magistrats. Ils ont souvent dit que je n'étais pas d'accord avec eux. Ils découvrent aujourd'hui que je me fais leur défenseur. L'échelle des peines devrait être adaptée à l'âge et à l'acte commis suivant des principes de pédopsychiatrie lisibles, non humiliants et efficaces. L'application de l'échelle de peines des majeurs divisée par deux donne souvent un résultat inverse au résultat attendu s'agissant de premiers délits ou de petits délits.
J'en viens maintenant au problème de la multirécidive qui constitue la pierre d'achoppement et qui a provoqué les événements actuels.
Le traitement de la multirécidive a été ignoré du fait de l'absence d'un instrument adapté aux mineurs. Il nécessite la création de centres fermés non carcéraux. Les mineurs ne doivent pas être dans les prisons. Combien de jeunes ces centres doivent-ils accueillir ? Le chiffre de dix à quinze, proposé par les spécialistes, me semble le seul valable. Quand on reçoit trois ou quatre multirécidivistes graves, comme c'est le cas dans les CER actuellement, on arrive momentanément à un consensus ; les éducateurs parviennent à faire plier les jeunes car ils aspirent à être rapidement dehors. Mais si l'on veut faire un vrai travail de resocialisation avec une analyse individuelle et une responsabilisation, il faut regrouper une quinzaine de personnes.
M. le rapporteur - L'ordonnance de 1945 évoque la prévention, l'éducation et la sanction. Evoque-t-elle suffisamment la réparation ?
M. Michel Bourgat - Il ne faut pas confondre la réparation et l'indemnisation des victimes, cela n'a aucun rapport. La réparation est un phénomène presque psychanalytique. Un jeune peut se réparer par une action qui va le laver, le remettre en selle et on peut même le concevoir dans le cadre d'un crime. Mais, vis-à-vis des victimes, le crime n'est pas réparable. On peut toujours imaginer la rédemption d'un jeune, il faut la souhaiter, mais la réparation est un acte personnel entre lui et la société et, à la limite, la victime n'y figure pas. Il arrive souvent que les victimes refusent la réparation, la justice ayant un système d'indemnisation que, personnellement, je ne compte pas dans la réparation.
Cependant, il faut être clair : quand le jeune a payé sa note, il faut le remettre en selle et les compteurs doivent repartir à zéro.
La victime ne pourra jamais accepter une réparation, ce n'est pas son rôle, mais la justice doit réparer pour la société.
M. le rapporteur - S'agissant de la responsabilité des parents, la suppression des allocations familiales vous semble-t-elle adaptée ?
M. Michel Bourgat - Je suis contre la suppression des allocations familiales. Cela consisterait à enfoncer dans l'eau des gens qui sont au bord de la noyade. En revanche, je suis pour une mise sous tutelle des allocations familiales. On observe dans certains milieux une utilisation aberrante des fonds alloués à l'éducation, comme l'achat de télévisions. Une mise sous tutelle permettrait de s'assurer que les sommes versées aux familles servent, par exemple, à réinsérer les jeunes en état de délinquance. Supprimer les allocations familiales à des familles qui vivent uniquement d'assistance dans ces milieux de sous-culture et de violence les pousserait encore plus vers les trafics parallèles.
M. le rapporteur - Le délai de réponse de la chaîne judiciaire vous semble-t-il adapté ?
M. Michel Bourgat - Tous les spécialistes de l'adolescence savent qu'un jeune vit dans l'immédiat et le virtuel. Il faut tout de suite lui montrer qu'il a dépassé la ligne jaune et donner une réponse le plus tôt possible. S'il n'y a pas de réponse, on court à la catastrophe et cela peut même avoir un effet pervers. Nous observons que 70 % des primo-délinquants s'en sortent bien, auquel cas l'ordonnance de 1945 est efficace, mais s'il y a une punition, alors que le jeune est en phase ascendante de récupération, elle peut être néfaste. Il faut immédiatement montrer avec une réponse compréhensible et surtout non humiliante que la société est la plus forte et que les barrières sont claires et nettes.
M. le président - Nous sommes face à une situation caractérisée par l'augmentation de la délinquance et un sentiment d'impunité et nous avons maintenant un véritable problème politique, à savoir quelle réponse doit donner la société à la demande des citoyens. Quelles sont, à votre avis, les mesures à prendre pour envoyer des signaux forts à l'opinion publique, aux citoyens et aux délinquants ?
M. Michel Bourgat - La prévention individuelle n'existe pas encore et je le regrette. L'enfant se construit par phases de trois ans : zéro - trois ans, trois - six ans, six - neuf ans. Il faut savoir que, même si l'on rate une étape, des passerelles sont possibles.
Les observatoires pour enfants en danger de délinquance ont une composition pluripartenariale, ils interviennent dans les écoles, ils font un travail de dépistage des jeunes qui semblent en dérive, mais il n'y a pas de stigmatisation.
J'ai travaillé sur l'individu et les facteurs qui lui font perdre son affectivité, le rendent égocentrique. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule Comment les enfants deviennent des assassins . J'ai travaillé sur le milieu criminogène, la fameuse culture souterraine de violence. Il faut l'éradiquer et, à ce titre, la lutte contre les trafics parallèles est très importante.
Nous vivons dans une culture de l'image et les médias jouent un rôle essentiel. L'aseptisation de la douleur et du danger, l'esthétisation de la violence aboutissent au fait qu'on la trouve belle avec des films comme Tueurs nés.
Je vais souvent dans les collèges et les lycées et je cite cet exemple : Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator 1 est le méchant ; dans Terminator 2, il est le gentil et le méchant, c'est le policier. A mon époque, on regardait Ivanhoé et les Sept mercenaires et on savait qui était le méchant.
Je ne réfute pas la violence, c'est un phénomène naturel qui doit être canalisé et ressenti de manière positive pour s'en sortir. Actuellement, les médias ne véhiculent plus cette image. Il faudrait demander au CSA de vérifier que les films ont un sens et ne nient pas les valeurs de la République.
L'absence de transmission des valeurs ne s'observe pas seulement dans les milieux où règnent la précarité et la pauvreté, on la relève également dans les milieux aisés.
En tant qu'élu, je ne peux pas toucher aux peines, j'applique les dispositions, mais je travaille sur le maillage social, j'essaye de redonner du sens, de la morale et je fais de l'instruction civique.
A Marseille, nous travaillons sur l'urbanisme. Nous n'avons pas de cités ghettos, notre ville est à portée du bonheur avec la mer et le ciel bleu !
Mme Nicole Borvo - Monsieur Bourgat, vous êtes adjoint au maire chargé de la prévention de la délinquance, avez-vous, à Marseille, des résultats tangibles de mesures qui marchent ?
M. Michel Bourgat - Si l'on prend comme critère le nombre de voitures brûlées par jour, Marseille est une ville relativement calme. Mais il y a une montée de la violence gratuite, notamment chez les plus jeunes, et nous n'avons pas plus que les autres la solution.
Marseille a la particularité d'être une ville portuaire, elle est située en face du Maghreb, son climat est agréable. Nous avons donc de nombreux jeunes en errance qui viennent de France et de l'étranger, arrivant parfois à Marseille dans des conditions effroyables.
En ce qui concerne la délinquance traditionnelle, nous avons un maillage social développé, une prévention de nuit, des services qui oeuvrent pour éviter l'exclusion scolaire, des activités sportives et culturelles et des communautés cultuelles vivantes regroupant les différentes religions au sein de « Marseille espérance ». Cet espace de parole, qui s'inscrit dans le cadre laïque républicain, donne de bons résultats car, sur le papier, nous devrions être dans une situation explosive : nous avons une population maghrébine en exclusion, un nombre de chômeurs élevé, beaucoup de passages de gens venant de l'extérieur et montrant des signes de richesse. Malgré tout cela, nos chiffres sont inférieurs à la moyenne nationale.
M. le président - Je vous remercie.
Audition de M. Claude NAOUR,
secrétaire général du
SN-FO-PJJ
et de M. Guy JOGUET,
secrétaire national,
éducateur au SEAT de Lyon
(30 avril 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT
M. Bernard Plasait, président -. Nous allons maintenant entendre M. Claude Naour, secrétaire général du SN-FO-PJJ, et M. Guy Joguet, secrétaire national.
( Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
M. Claude Naour - Si des éducateurs moins expérimentés sont affectés dans des centres difficiles, c'est-à-dire des CPI ou des CER, c'est, selon Force ouvrière, parce que les plus anciens sont particulièrement sensibles à la dégradation des conditions de travail. Il s'agit d'un problème dont la profession tout entière devrait se saisir. Les éducateurs les plus jeunes n'ont pas une situation familiale bien établie et son plus malléables pour l'administration. Ils n'ont pas le choix de leur affectation.
Nous sommes opposés aux CER en raison de l'éclatement des normes horaires. Les personnels travaillent trois mois d'affilée sous le prétexte de continuité éducative. Or ces cycles de trois mois de travail, trois mois de congé, ne correspondent pas aux attentes d'un salarié de la fonction publique. Les anciens ne veulent pas travailler ainsi.
Par ailleurs, on assiste à une féminisation importante, y compris dans ces structures où les jeunes sont en grande difficulté.
S'agissant des CPI, la notion de placement immédiat correspond à une préoccupation d'ordre public plus qu'à la construction d'un projet pédagogique pour les mineurs. Quel éducateur expérimenté peut accepter la mise à l'écart du jeune plutôt que son insertion sociale et professionnelle ? En ce qui concerne le recrutement, nous souhaitons des concours nationaux et égalitaires, ouverts à tous et accordant un statut.
J'en viens aux services éducatifs auprès du tribunal, les SEAT. L'arrêté de 1987 a créé un SEAT dans chaque tribunal pour enfants. La réforme actuelle, en supprimant les SEAT dans les petits tribunaux, constitue une régression. La protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats et les mineurs ont besoin d'un service éducatif existant réellement en tant que service au sein de chaque tribunal pour enfants. Le SEAT, s'il a un véritable directeur, est un facteur de reconnaissance de la PJJ, de lisibilité de son travail et de cohérence de son intervention.
M. Guy Joguet - En ce qui concerne les SEAT, mon appréciation est un peu différente : sous couvert de restructuration, il s'agit en fait de leur disparition.
Selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, les onze plus importants doivent rester, mais ce n'est pas ce qui se passe en réalité. A Lyon, par exemple, où nous sommes en restructuration, notre directeur départemental nous a expliqué que les SEAT ne conserveraient que certaines missions. L'exécution des décisions judiciaires, les condamnations et les peines seront territorialisées.
Il existait un arrêté stipulant qu'un SEAT devait être créé au sein de chaque tribunal pour enfants et nous nous sommes aperçus que l'administration ne l'avait pas appliqué. Il n'y avait donc pas égalité sur tout le territoire.
S'agissant des mesures éducatives pénales qui seront maintenant prises en charge par des éducateurs dans les CAE, notre point de vue est le suivant. A l'heure où l'insécurité et la délinquance sont mises en avant, on ne peut pas admettre que la prise en charge de certains mineurs en milieu ouvert à partir du tribunal soit abandonnée. Les jeunes venant dans un tribunal, même si cela se dégrade, ont le sentiment d'être dans un lieu particulier, ils ne sont pas dans un service au pied d'une tour. Ils ressentent la symbolique du lieu.
Par ailleurs, la Cour des comptes, établissant des comparaisons avec d'autres services, a officiellement affirmé que les principaux SEAT, notamment celui de Lyon, étaient rentables, s'agissant des permanences le week-end, de l'accueil, etc.
Nous sommes opposés à cette disparition qui est tout à fait regrettable. Le SEAT était un outil qui pouvait être amélioré, mais la direction de la PJJ en a décidé autrement.
M. Claude Naour - En ce qui concerne les 35 heures, elles n'ont pas été souhaitées par la grande majorité des personnels dans la mesure où elles n'étaient pas accompagnées des créations d'emplois nécessaires. Actuellement, elles ne peuvent être vécues que comme une remise en cause des acquis, surtout en termes de congés. On ressent comme une volonté de compliquer les relations de travail à travers un contrôle pointilliste des faits et gestes de chaque agent par la charte du travail. D'ailleurs, notre syndicat appelle les personnels à ne pas la contre-signer. Les 35 heures sont très mal vécues sur le terrain quels que soient les services, certains travaillent plus, d'autres moins, il n'y a pas d'équité.
S'agissant des mesures ordonnées, pour nous, seul le magistrat est ordonnateur et est à même d'établir une priorité dans le traitement des mesures qu'il prend. Ce n'est pas à l'éducateur de décider quelles mesures doivent être prises en priorité. Le rôle de l'administration n'est-il pas d'exécuter l'ensemble des mesures ordonnées ? La « mise sous le coude » de certains dossiers peut être assimilée à une ingérence de l'exécutif sur le judiciaire. Toutes les mesures doivent être vues en fonction de ce que dit le magistrat.
M. Guy Joguet - J'ajoute que la mise en attente de mesures prises au nom du peuple français est un déni de justice. Dans notre organisation, nous nous battons pour que la mission première de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire l'exécution des décisions judiciaires, soit réaffirmée. Le fait de mettre des mesures en attente est absolument inadmissible. Cette situation est dommageable pour ceux qui ont commis les délits et pour ceux qui les ont subis. Par ailleurs, les magistrats, qui ont tout loisir de contrecarrer cet arbitraire administratif, ne le font pas toujours malheureusement.
M. Claude Naour - Sur la question de savoir si nous sommes favorables aux centres éducatifs fermés, nous estimons que la mise à l'écart de la jeunesse en prison ou dans des structures fermées ne saurait être une solution aux problèmes d'emploi et de formation car elles sont à la base de la destruction du système éducatif. La PJJ ne saurait assurer des mesures carcérales. En revanche, elle peut s'inscrire dans la construction d'un projet éducatif d'insertion pour le mineur après son incarcération.
Les centres fermés ont historiquement fait faillite. Nous préconisons de reconstruire de véritables centres de formation professionnelle, débouchant sur l'apprentissage de vrais métiers.
La protection judiciaire de la jeunesse disposait d'un potentiel important de formations professionnelles, par exemple des ateliers qui permettaient aux jeunes de retrouver un équilibre. Or, depuis quelques années, on voit disparaître ces structures au profit de stages d'insertion qui ne débouchent sur rien.
Je viens de la région nantaise où il y a des ateliers de formation professionnelle. Il s'agit peut-être des derniers. Ils permettent à des jeunes, qui nous sont envoyés par les juges, de suivre une formation débouchant sur un CAP de coiffure, de métallerie ou de soudure. Nous travaillons en partenariat avec l'AFPA et ces adolescents trouvent rapidement une embauche. Si l'on donne aux jeunes un métier, si on sait les occuper et si les centres de jour jouent vraiment leur rôle, cela peut déboucher sur une insertion et un équilibre social normal.
A Saint-Nazaire, une vingtaine de jeunes qui sont passés par nos ateliers travaillent sur les chantiers navals. « Si nous n'avions pas eu cette formation », nous ont dit certains d'entre eux, « nous serions peut-être dans la rue ».
Il existe des secteurs où l'on manque de bras. Tous les jeunes n'obtiendront peut-être pas un CAP, mais ils auront au moins la possibilité d'apprendre un début de métier. Ils viendront tous les jours sur un lieu de travail et ce sera une resocialisation.
M. Guy Joguet - Le rôle de l'éducateur doit être identique à ce qu'il était hier et rester identique demain. L'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse est un fonctionnaire d'Etat qui dépend du ministère de la justice. Ces éléments sont liés. Ce n'est pas un éducateur de prévention. Le statut de la fonction publique d'Etat lui donne une neutralité et une indépendance qui font sa spécificité.
Conformément à l'ordonnance du 2 février 1945, l'engagement de la procédure pénale exige un délit, un mineur, un juge, un éducateur, donc une action éducative. Elle se résume à cela. Si elle n'est pas toujours appliquée, c'est un autre problème. L'éducateur de la PJJ, fonctionnaire d'Etat relevant du ministère de la justice, ne peut pas banaliser l'acte commis. Il faut conserver les quatre éléments majeurs : un délit, un mineur, un juge, un éducateur, donc une action éducative.
Voilà plus de vingt ans que je travaille au SEAT de Lyon. J'ai constaté, y compris dans les dernières années, que 50 % des mineurs qui me sont confiés par des magistrats n'ont pas récidivé au bout d'une année. La moitié des 50 % restants, soit 25 % du total, récidivent jusqu'à 18 ans. Ils savent qu'après cet âge --on le leur a bien expliqué, car cela fait partie de notre mission- ils n'auront plus affaire à la même juridiction. Ces deux catégories représentent 75 à 80 % des jeunes qui me sont confiés. Sur les 20 à 25 % restants, certains relèvent de la psychiatrie bien que leurs troubles ne soient pas assez lourds pour justifier un internement. Ce chiffre est en augmentation. Ces jeunes représentent un danger pour eux-mêmes et pour la société. Enfin, 5 à 12 % des jeunes récidivent. Cette catégorie est en légère augmentation. Globalement, ces chiffres ont peu évolué, mais les mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes.
En ce qui concerne le fonctionnement de la PJJ, nos préoccupations sont multiples. Comme la disparition pure et simple des SEAT semble l'indiquer, les mesures éducatives au pénal pourraient être territorialisées et prises plus près des élus que du ministère de la justice. C'est un choix politique.
Une telle disposition ne va pas dans le bon sens. Nous voulons rester un service public, déconcentré mais national, relevant du ministère de la justice, et dont la seule mission est l'exécution des décisions judiciaires. Nous souhaitons donc un recentrage de notre action sur la délinquance des mineurs. La protection, mission certes intéressante, peut être confiée à des personnes extérieures à la PJJ.
Comme semble le prouver le nombre des mesures en attente, notre administration essaie de devenir un contre-pouvoir à ce qu'elle appelle le pouvoir judiciaire. Mais elle se trompe, car il s'agit de l'autorité judiciaire. Elle prend un pouvoir administratif absolument inadmissible par rapport aux décisions judiciaires, et je ne parle pas des personnels. Nous n'allons pas dans le bon sens, je le répète. Les choses étaient simples. On les complique sans que je comprenne pourquoi. Le même constat vaut pour l'application des 35 heures.
M. le président - Pourquoi avez-vous tant insisté sur le fait que vous n'étiez pas des éducateurs de prévention ? Pourriez-vous préciser la façon dont vous concevez votre rôle ?
M. Guy Joguet - Nous intervenons lorsqu'un mineur a commis un délit et qu'il a été présenté à un juge, conformément à l'ordonnance du 2 février 1945. L'éducateur, dans le cadre de la liberté surveillée préjudicielle, est soit un bénévole, soit un délégué permanent à la liberté surveillée intervenant dans le cadre du service public de la PJJ. C'est la loi et elle est incontournable tant qu'elle n'est pas réformée. Nous souhaitons la conserver.
L'éducateur fait toujours référence au délit commis par le mineur. Il en discute avec lui, non pas dans le détail mais par rapport à son comportement et aux victimes. Nous n'avons pas le même travail d'éducation et de rééducation que les éducateurs de prévention. Notre action fait suite à un délit. C'est très important. Je comprends certes les souhaits des parties civiles, mais tel est le cadre de notre action.
M. le président - Je vous comprends mieux. Avez-vous le sentiment, dans la philosophie de l'ordonnance de 1945, que les jeunes sont bien suivis depuis les premiers signes, que l'on pourrait presque déceler en maternelle, jusqu'à l'âge de la majorité ? N'y a-t-il pas entre les différents acteurs -et votre rôle est éminent- des ruptures et des discontinuités préjudiciables à l'efficacité des dispositions que prend la République pour traiter ce problème ?
M. Guy Joguet - Votre question est très importante. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Les éducateurs du ministère de la justice chargés des mineurs délinquants interviennent en bout de chaîne. C'est là que réside leur spécificité.
Le travail réalisé en amont est conséquent et nous en tenons bien évidemment compte. Il faut veiller à la continuité du suivi. Toutefois, je le répète, nous intervenons malheureusement en bout de chaîne, après qu'un acte de délinquance, quel qu'il soit, a été commis.
Par ailleurs, l'absence d'action n'est pas toujours négative et des interventions suivies ne sont pas toujours positives. Je vous réponds en quelque sorte par la négative. Chaque cas est particulier. Le travail en amont est nécessaire. Après l'acte de délinquance, on retrouve la formule : un délit, un juge, un éducateur, donc une action éducative conduite avec les acteurs qui sont intervenus avant nous. Mais cette démarche n'est pas aussi schématique que la société le voudrait.
M. le président - Ma dernière question sera un peu brutale, et je vous prie de m'en excuser. Quel bilan dressez-vous de l'action de la PJJ sur les cinquante dernières années ? Des évolutions importantes se sont-elles produites ? D'autres sont-elles nécessaires ? Quels sont le principal succès et le principal échec de ce dispositif ?
M. Guy Joguet - L'un des succès indéniables de la protection judiciaire de la jeunesse est dû à l'action des anciens services de la liberté surveillée, conduite dans une autre période et dans un contexte différent. Je pense aux mesures de liberté surveillée préjudicielle avec incident à la liberté surveillée. Je ne ferai pas de commentaires sur la suppression de ce système à laquelle nous n'étions pas favorables. Peut-être faut-il créer des centres éducatifs fermés ? Je l'ignore. Il revient à chacun de prendre ses responsabilités.
Des incidents à la liberté surveillée, en dix ans, je n'en ai fait qu'un. Il a porté ses fruits. Ce jeune, je le vois toujours. Nous sommes presque devenus amis. C'est une parenthèse.
Le droit commun de la formation professionnelle n'est pas adapté aux mineurs délinquants en grandes difficultés. Ces jeunes ont aujourd'hui du mal à obtenir un diplôme et à réussir dans un travail. Nous les y aidons. C'est une des grandes réussites de la PJJ, qui est une exception française. La protection judiciaire de la jeunesse est une bonne institution, comme c'est sans doute le cas de nombreuses exceptions.
En revanche, nous ne parlons pas des personnels, bien que nous soyons là pour défendre leurs intérêts. Même si nous continuons à dépendre du ministère de la justice, on se tromperait, me semble-t-il, en nous confiant d'autres tâches, le fichage par exemple. On obtiendrait peut-être des résultats immédiats. Mais sans un travail à long terme sur la rééducation, qui exige beaucoup de personnels - et cela peut être discuté - je suis convaincu que nous ne réussirons pas. C'est mon avis de professionnel. C'est la raison pour laquelle je reste éducateur à la PJJ alors que j'aurais pu exercer un travail mieux rémunéré.
M. Claude Naour - Permettez-moi d'ajouter un mot sur la formation professionnelle, puisque c'est un secteur dans lequel j'ai beaucoup travaillé.
Dans ce domaine, la PJJ a suivi l'évolution. Voilà une quinzaine d'années, les jeunes passaient surtout des CAP. Des centres de formation étaient implantés sur tout le territoire. Progressivement, le niveau scolaire a baissé et la PJJ a suivi. Elle s'est mise à la portée des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés tellement bas qu'il faudrait relever le niveau, redonner confiance aux jeunes, leur permettre d'exercer une activité professionnelle.
En travaillant dans un atelier, ils prennent confiance en eux-mêmes, car ils agissent et prouvent quelque chose. D'autant que, il ne faut pas l'oublier, ils sont souvent les seuls dans leur famille à se lever le matin. Faire venir un jeune tous les matins à l'école ou au travail, c'est un acquis important, c'est un point de départ.
Il faut resocialiser ces jeunes, les « apprivoiser », si vous me permettez cette expression, pour pouvoir obtenir des résultats à long terme. Je dis bien à long terme, car eux voudraient que tout arrive tout de suite. Le travail, c'est immédiatement, sans même avoir de formation. Il faut les amener à prendre conscience qu'ils doivent suivre une formation, quel que soit le métier qu'ils souhaitent exercer, et que cela demande du temps.
M. le président - Je vous remercie.
Audition de Mme Nathalie CAILLON,
Secrétaire générale
de l'UNSA-SPJJ
et de M. Régis LEMIERRE,
membre du conseil syndical
de l'UNSA-SPJJ
(30 avril 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT
M. Bernard Plasait, président - Nous allons maintenant entendre Mme Nathalie Caillon, secrétaire général de l'UNSA-SPJJ et M. Régis Lemierre, membre du conseil syndical.
( Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre convocation. Comment expliquez-vous le fait que les éducateurs les moins expérimentés soient souvent confrontés aux jeunes les plus difficiles ? Quelles mesures préconisez-vous pour remédier à cette situation qui existe aussi, d'ailleurs, dans l'Education nationale ?
Mme Nathalie Caillon - Comme vous venez de le rappeler, cette situation n'est pas propre à la protection judiciaire de la jeunesse. Les règles qui prévalent dans la fonction publique -ancienneté, mutations, mouvement- font que ce sont souvent les éducateurs les moins expérimentés qui exercent sinon auprès des jeunes les plus difficiles, je ne saurais le dire, du moins dans les nouvelles structures.
Tout le monde s'accorde à reconnaître la difficulté d'exercer dans les structures d'hébergement. J'ai travaillé en hébergement pendant vingt-deux ans et jusque dans une période récente.
Pendant plusieurs années, la protection judiciaire de la jeunesse a connu un déficit de recrutement qui explique la situation actuelle. Ce n'est plus vrai depuis trois ans. Pendant très longtemps, les personnels les plus jeunes ont pu trouver des repères professionnels au contact de gens plus expérimentés, et appréhender des comportements difficiles tels que la violence, la souffrance, la douleur des jeunes avec un recul que l'expérience ne suffit certes pas à acquérir, mais qu'elle aide à concevoir.
Au fil du temps, les personnels disposant d'une certaine ancienneté se sont dirigés vers le milieu ouvert et les SEAT. Les jeunes éducateurs restèrent alors seuls dans les structures d'hébergement. Vous n'êtes pas sans savoir que, depuis quelque temps, un recrutement assez important de personnels éducatifs a été engagé. Cela renforce votre remarque puisque tous les nouveaux personnels sont nommés dans des structures nouvelles : CPI ou CER.
On peut le regretter, car le métier d'éducateur est difficile. Il s'apprend et on ne le connaît sûrement pas après deux années de formation dans les écoles de la protection judiciaire de la jeunesse.
On peut penser que le retour de personnels plus anciens dans ces structures permettrait de remédier à cette situation. Je pense que de nombreux personnels seraient prêts à le faire, mais il faudrait sans doute changer les données. On a tendance à instituer une échelle de valeur qui n'est peut-être pas la bonne, le bas de l'échelle étant l'hébergement et le haut les services éducatifs auprès du tribunal. Il conviendrait de réfléchir à des mesures incitatives qui, je le souligne, ne sont pas uniquement de nature indemnitaire ou, d'une manière plus générale, financière.
Je rencontre régulièrement des collègues qui ont vingt-cinq ou trente ans d'ancienneté. Ils peuvent avoir une vision différente de ce qu'est un groupe de jeunes et de ce qu'est la violence collective. Certains seraient prêts à revenir en structure d'hébergement, mais sous certaines conditions. En effet, exercer en hébergement, c'est accepter des horaires décalés, travailler le week-end. Or, passé un certain âge, et après avoir travaillé quinze ou vingt années dans ce système, on n'a plus très envie de continuer. On aspire, pour différentes raisons, à un rythme de vie plus régulier.
Cela dit, nous sommes persuadés que l'on peut trouver des moyens pour encourager ces personnes à retrouver leur place dans les structures d'hébergement. Peut-être conviendrait-il de moins les soumettre aux mauvais côtés qu'ils ont déjà connus pendant plusieurs années, ayant « fait leur temps » dans ce mode de prise en charge.
M. le rapporteur - Lors des visites que nous avons effectuées dans différents centres, nous avons constaté un paradoxe : d'une part, une crise du recrutement, voire des vocations, car pour un certain nombre de postes, cela relève de la vocation et, d'autre part, des personnels en surnombre dans certaines structures.
Pour faire face au manque d'effectifs, ne pourrait-on envisager d'autres formes de recrutement ? Je pense notamment à ce que l'on appelle la troisième voie avec la validation des acquis professionnels, même si ces personnes ne passent pas de concours. Dans le nord de la France, une cuisinière va sans doute devoir quitter sa fonction. On ne pourra pas renouveler son CDD, alors qu'elle remplit bien sa mission. Cette question dépasse le cadre de la PJJ et touche l'ensemble de la fonction publique. Quel est votre sentiment sur ce point ? Comment améliorer la situation ?
M. Régis Lemierre - Nous sommes favorables au projet de recrutement sur titres ou à la troisième voie. Cela permettrait d'employer des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui possèdent une maturité supérieure à celle des jeunes qui sortent de l'université avec une licence de psychologie ou de droit, voire une maîtrise ou un DEA. Ce serait un enrichissement pour la PJJ. Nous sommes donc ouverts à la diversification des modes de recrutement.
Nous n'avons aucune appréhension sur la troisième voie, car nous pensons qu'il s'agit, comme le recrutement sur titres, d'une bonne méthode. En revanche, nous sommes réservés sur les contrats à durée déterminée. Nous avons travaillé à la résorption des emplois précaires, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une loi. Les contractuels sont dotés d'un statut assez précaire et ces emplois sont moins bien gérés que les postes de titulaires.
Nous préconisons, depuis des années, la création de postes de titulaires-remplaçants. L'administration n'a créé que peu de postes de cette nature. Cette voie alternative nous paraît pourtant fiable. Elle a été développée dans l'Education nationale, au niveau du primaire. Ces personnels portent le nom de titulaires académiques. Alors qu'un instituteur peut être remplacé dès le deuxième jour de son absence par un titulaire académique, dans le secondaire, il faut parfois attendre des semaines avant qu'un maître auxiliaire ne remplace un professeur. La formule du contrat, plus souple, n'est pas toujours performante. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la création de postes de titulaires-remplaçants.
M. le rapporteur - Les titulaires-remplaçants devraient donc avoir une certaine polyvalence.
Mme Nathalie Caillon - Non ! Ces trois dernières années, j'ai été titulaire-remplaçante dans le cadre des éducateurs. Les agents techniques d'éducation sont encore assez rares.
Les éducateurs sont nommés dans les directions régionales, ou plus rarement départementales, et effectuent des remplacements sur le territoire d'une région. Nous avons souhaité l'extension de cette pratique. Nous avons demandé que des bilans soient dressés, car il s'agit de dispositifs assez récents, qui ne remontent qu'à sept ou huit ans. Il faut leur laisser le temps de s'étoffer. A l'heure actuelle, les bilans sont trop peu nombreux.
Les titulaires-remplaçants effectuent des remplacements dans tous les départements d'une région, en priorité en hébergement et dans les autres structures en cas d'urgence. Cela demande une certaine gymnastique en termes d'adaptation dans la mesure où l'éducateur peut travailler pendant trois semaines en hébergement, puis en milieu ouvert avant d'exercer dans un service éducatif auprès du tribunal ou en dispositif de jour. Il faut une complémentarité des connaissances, mais pas des compétences.
M. le rapporteur - En termes de fluidité d'organisation, comment s'est passée la mise en place des 35 heures dans les services de la PJJ ?
Mme Nathalie Caillon - Il y aurait beaucoup à dire sur ce qui s'est passé en amont, mais pour répondre à votre question, je me limiterai à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Nous sommes, vous le savez, la seule organisation de la PJJ à avoir signé l'accord-cadre. Nous avons essayé d'optimiser ce qui pouvait se passer. Nous espérions que cet accord porterait tous ses fruits le plus rapidement possible. Or, pour l'instant, nous restons un peu sur notre faim. Les commissions de suivi ne se réunissent pas toujours au rythme prévu. Des conclusions doivent certes être rendues, mais les expertises ne sont pas encore allées à leur terme. Des délais supplémentaires nous sont demandés. Il est très difficile de faire descendre les directives nationales sur le terrain. L'application de cette mesure est donc très disparate.
En fait, les situations sont très diverses, comme ont pu le constater les cabinets extérieurs chargés d'effectuer des états des lieux. Cinq mois après la signature de l'accord-cadre, cette diversité ne s'est pas amenuisée. Nous le regrettons, car notre signature était liée à un traitement équitable de tous les personnels, qu'ils travaillent à Lille ou à Marseille, c'est-à-dire aux deux extrémités du pays. Je n'ai rien contre Lille ni contre Marseille.
Le comité de suivi sur la réduction du temps de travail devait nous permettre de nous exprimer, en qualité d'organisation syndicale, sur la mise en oeuvre de cette mesure. Il ne s'est réuni que deux fois. Les réunions sont régulièrement reportées. En outre, son contenu est très flou dans la mesure où les informations qui remontent du terrain ne sont pas toujours suffisantes.
M. Régis Lemierre - Notre organisation est la seule à avoir signé l'accord-cadre. Nous avons fait preuve d'ouverture en nous inscrivant dans une approche réformiste. Nous avons demandé des créations d'emplois, comme la plupart des organisations de fonctionnaires. Le ministère a arbitré. En fait, nous avons signé un compromis pour aller de l'avant. Le suivi était donc très important. Or, la qualité de ce suivi est très médiocre et le contrat n'est pas rempli. Tel est le reproche que nous formulons.
Mme Nathalie Caillon - Une expertise devait évaluer le nombre d'emplois nouveaux nécessaire après la mise en place de la RTT. Pour l'instant, nous attendons les résultats.
M. le rapporteur - Il n'y a pas eu de bilans ?
Mme Nathalie Caillon - Des bilans sont en cours, mais ils prennent du retard. Le nombre de 1 300 créations d'emplois à la PJJ a été évoqué. Comme nous le disent nos collègues de terrain, on entend parler de moult créations d'emplois mais rien ne change.
Nous avons demandé à notre direction de nous communiquer la répartition des emplois nouveaux envisagés pour la transmettre à nos adhérents. Nous avons renouvelé cette demande à plusieurs reprises depuis deux ans. A l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse.
La commission de suivi sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail devait se saisir de cette question. Il est en effet très difficile de définir le nombre des créations d'emplois nécessaires à la suite de la diminution de la durée hebdomadaire de travail sans connaître les effectifs et l'organisation des services. C'est un exemple parmi d'autres.
Comme l'a indiqué M. Lemierre, nous sommes très déçus. Lorsque nous nous sommes engagés, nous pensions sincèrement que notre administration s'engageait également et que chacun respecterait sa part du contrat. Or, je le répète, cinq mois après la signature de l'accord-cadre, de nombreuses interrogations subsistent. Nous espérons que les réponses ne sont que différées et que ces retards n'hypothéqueront pas la suite du processus.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur la réforme des services éducatifs auprès des tribunaux ?
M. Régis Lemierre - Nous sommes opposés à cette réforme qui met en cause la « greffe éducative » que constitue l'arrêté instituant les services éducatifs auprès des tribunaux.
Les SEAT ont permis le développement d'une culture éducative dans les tribunaux. Cet aspect est très important. Un magistrat aussi qualifié qu'Alain Bruel, ex-président d'un tribunal pour enfant, auteur d'un excellent article dans la revue Esprit , déclare qu'il a appris son métier avec des éducateurs. Ces derniers lui ont montré comment les choses fonctionnaient sur le terrain, comment on tissait des liens sur le territoire. Alain Bruel a travaillé dans le cadre de la liberté surveillée.
Les SEAT, je vous le rappelle, sont nés de la fusion des services d'orientation éducative, qui assuraient des permanences dans les tribunaux, et des services de la liberté surveillée. Cette réforme a été conduite d'une manière très idéologique. L'administration avait un a priori sur ces services. Elle nous a dit vouloir conclure un accord avec l'UNSA, car nous étions influents - nous occupons la deuxième place en termes de représentativité à la PJJ. Nous avions en outre conclu une alliance avec l'Union syndicale des magistrats. Je me souviens, au cours d'une audience, être allé voir Mme Perdriolle pour la prévenir de la gravité de l'erreur qui se préparait.
Ces services étaient nécessaires. Les personnels ont besoin de savoir où ils vont. Avec la réforme, ils seront placés dans des centres d'action éducative chargés d'organiser des permanences au sein des tribunaux. La gestion administrative se fera à distance du tribunal, ce qui est une erreur. Seuls dix grands SEAT continueront à fonctionner et ils seront pour la plupart situés en région parisienne.
L'intérêt des SEAT réside dans leur proximité avec la juridiction. Nous avons toujours été favorables à ce que ces services soient gérés dans le cadre d'un projet départemental. La PJJ est présente au tribunal. Il y a donc bien un patron en la personne du directeur départemental de la PJJ.
La proximité permet une bonne connaissance des rouages et des mécanismes judiciaires, du parquet, des juges d'instruction, des juges des enfants. Les contacts quotidiens permettent une approche commune propice à l'expérience éducative. Je pourrais faire un parallèle avec la médecine régulatrice dans les hôpitaux. Un régulateur oriente les mineurs et donne un avis éducatif aux magistrats. Ces derniers peuvent alors prononcer des mesures, voire ordonner la détention provisoire.
Accompagné de Valéry Turcey, secrétaire général de l'USM, je suis allé voir Mme Perdriolle, qui a reconnu la pertinence de certains de nos arguments. En mars 2001, la réforme est passée sans que l'on ait tenu compte de nos avis, lesquels étaient pourtant appuyés par des organismes divers, notamment l'Union syndicale des magistrats et l'Association professionnelle des magistrats de la jeunesse.
Cette réforme n'étant pas achevée, elle peut encore être modulée. Rien n'est définitif. Les services ne sont pas cassés. Il reste des personnels disponibles. Il est encore temps de changer de cap.
M. le rapporteur - Nous avons constaté la présence d'un goulet d'étranglement dans l'exécution des mesures ordonnées par les juges. Comment s'effectue le tri entre les mesures estimées urgentes et les autres ? Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer cette situation ? Plus la mesure est appliquée rapidement, plus elle est efficace pour des jeunes qui éprouvent des difficultés à se projeter dans l'avenir et plus elle apporte une réponse sociale forte aux attentes du grand public.
Mme Nathalie Caillon - J'ignore comment s'effectue le tri des mesures. En fait, je ne pense pas qu'il y ait des règles. Le choix résulte de négociations ponctuelles entre la PJJ et les juridictions. On s'efforce, en fonction des informations que nous transmettent nos collègues, d'évaluer l'urgence de la mesure, même si, sur le principe, nous trouvons inacceptable que des mesures restent en attente.
Une mesure éducative doit être appliquée immédiatement, qu'il s'agisse d'un recueil de renseignements socio-éducatifs, d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté surveillée. C'est d'ailleurs l'esprit de l'ordonnance de 1945. La façon de choisir l'ordre des mesures n'est donc pas arrêtée.
J'évoquais tout à l'heure les commissions de suivi sur la réduction du temps de travail. Une autre commission, qui s'intéressera au milieu ouvert, s'attachera à définir des normes nouvelles pour les SEAT. Le nombre de mesures exercées par chaque éducateur est très fluctuant. Il peut aller de vingt à trente-cinq en fonction des régions. Jusqu'à présent, c'est le directeur du service ou, dans certains cas, le directeur départemental, qui décide du nombre de mesures suivies par l'éducateur. Lorsque ce dernier a atteint son quota, il s'arrête.
Les mesures en attente sont la plupart du temps bloquées dans les services. Les personnels se sentent donc coupables de la non-application d'un certain nombre de mesures. Toutefois, sauf à augmenter le nombre des personnels, je ne vois pas comment on pourrait corriger cette situation.
Un remède consisterait peut-être à interpeller les magistrats sur les décisions qu'ils prennent. Toutes les mesures sont-elles nécessaires ? La forme retenue est-elle la plus appropriée ? Mais lorsque la mesure est prise, il faut l'appliquer. S'il manque des éducateurs pour le faire, il faut accroître leur nombre. Les bilans que nous évoquions tout à l'heure nous apporteraient sans doute des éléments de réponse, mais nous ne les avons toujours pas.
M. le rapporteur - Si je vous comprends bien, les délais de réponse, parfois très longs, s'expliquent par un manque de moyens matériels ou humains. Vous avez parlé du nombre de dossiers que doivent traiter les juges. Des interventions en amont ne seraient-elles pas de nature à réduire cet encombrement ?
Mme Nathalie Caillon - Comme je l'ai indiqué, on pourrait interpeller les magistrats sur le bien-fondé de leurs décisions. Ce n'est pas facile pour un éducateur. C'est un peu moins délicat pour un directeur départemental. En tout état de cause, je ne suis pas persuadée que cela suffirait à résorber l'encombrement actuel.
Mme Lazerges et M. Balduyck, dans un rapport que vous n'êtes pas sans connaître, estiment nécessaire de créer 3 000 emplois à la PJJ. Tout à l'heure nous évoquions la création de 1 300 postes. Nous sommes loin du compte.
M. Régis Lemierre - Permettez-moi d'ajouter un mot sur l'articulation entre l'aide sociale à l'enfance et les tribunaux.
L'aide sociale à l'enfance traite de la protection administrative. On constate une judiciarisation excessive des mesures de protection administrative. Je ne veux pas mettre en cause les services des conseils généraux. Ils ont toutefois tendance, pour les prédélinquants, à se retourner vers les services de justice ou vers le juge des enfants. Les SEAT sont ainsi confrontés à des cas qui relèvent de la protection administrative. Il faut sur ce point engager un travail de fond avec les présidents de conseils généraux.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur les CPI et sur les CER ? Que pensez-vous de l'opportunité de créer des centres fermés et quelles pourraient être leurs déclinaisons ?
M. Régis Lemierre - Nous étions très mesurés sur le dossier relatif à la création des unités à encadrement renforcé. Nous déplorons qu'un long délai de latence se soit écoulé entre la création des UEER et celle des CER. Nous avions accepté ces dispositions sous réserve qu'elles soient pilotées et évaluées correctement. Or, de ce point de vue, nous constatons un déficit énorme de la part de notre administration et de notre direction.
La création des CPI a été décidée plus tard, lors d'un conseil de sécurité intérieure. Nous avions amendé le cahier des charges qui nous paraissait trop restrictif. Nous estimons en effet qu'il faut garder de la souplesse dans l'action éducative. Si vous verrouillez tout en instituant un règlement interne trop rigide, aucun enfant ne restera. Ou alors, il faut construire une prison !
La difficulté actuelle tient à un défaut de pilotage et d'évaluation. Il arrive que l'on ouvre un CPI avant de s'apercevoir que les bâtiments sont classés au registre des Monuments historiques. Il faut alors consulter un architecte accrédité et attendre six mois avant de pouvoir changer des fenêtres. Il arrive aussi que l'on ait les locaux sans disposer des personnels nécessaires.
Les CPI ont fait l'objet de résistances idéologiques de syndicats concurrents, si je puis dire. Notre syndicat, qui y était favorable, ne peut que déplorer les carences de notre administration en matière de pilotage et de création de ces structures.
Mme Nathalie Caillon - Nous sommes loin d'être persuadés, et c'est un doux euphémisme, que le bilan mitigé de la mise en oeuvre des CPI soit dû à l'esprit initial du projet. Il est lié à des contingences matérielles, comme l'indiquait mon collègue à l'instant. Nous restons convaincus que, si l'esprit premier, celui qui a présidé à notre travail sur le cahier des charges, avait prévalu, le bilan ne serait peut-être pas tout à fait le même.
M. Régis Lemierre - Par ailleurs, nous sommes opposés aux centres fermés. Cette opposition ne se justifie pas par un refus des sanctions. Certains mineurs doivent être mis provisoirement en dehors du système éducatif classique. Pour être clair, ils ont besoin d'être incarcérés. Nous sommes à l'aise sur ce sujet. L'action éducative ne peut pas tout faire.
Les centres fermés, dont je connais le fonctionnement pour avoir travaillé à Juvisy, ont fait l'objet d'un article de Cécile Prieur paru dans Le Monde. Le centre de Juvisy a été fermé par Alain Peyrefitte, alors garde des sceaux, à la demande de son directeur. Ce centre, en proie à une espèce de violence institutionnelle, « explosait ». On demandait aux éducateurs de contenir de jeunes délinquants sans leur donner les moyens spéciaux qui existent dans les maisons d'arrêt. La surveillance est un métier. Le travail dans la contrainte est particulier. En outre, les maisons d'arrêt peuvent compter sur des contrôles avec l'intervention du juge de l'application des peines ou avec les prétoires.
L'action éducative ne peut pas résoudre toutes les difficultés. A Juvisy, j'ai constaté que certains collègues, qui avaient de l'ancienneté, pratiquaient la violence institutionnelle. Il ne s'agissait pas de la petite claque qui peut parfois être salutaire. C'était une violence véritable, qui s'appuyait sur des leaders. Il s'agissait en fait d'un centre paracarcéral présentant les défauts d'un établissement carcéral -dont le fonctionnement doit être amélioré- avec une violence plus grande encore, car les relations n'étaient pas médiatisées comme elles peuvent l'être dans une prison.
Il faut rénover les quartiers des mineurs. Nous avons tous en mémoire l'incendie récent qui a coûté la vie à deux jeunes détenus. En premier lieu, il ne faut pas dépasser les prescriptions du cahier des charges.
Un très bon quartier des mineurs, comportant vingt places et doté de moyens, vient d'ouvrir à la maison d'arrêt de Nanterre. On y trouve des enseignants détachés de l'Education nationale, deux travailleurs sociaux à temps plein et des intervenants des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP. Néanmoins, si, comme c'est le cas dans certains établissements, ce quartier reçoit plus de mineurs qu'il n'est prévu dans le cahier des charges - les maisons d'arrêt ne sont pas soumises à un numerus clausus - il connaîtra des difficultés. Son organisation s'en trouvera bouleversée.
Un centre fermé présente des dangers. L'alternative réside dans la création de bons quartiers pour mineurs. Vous avez sans doute entendu parler d'un foyer du secteur associatif, Cheval pour tous, qui a fait l'objet d'articles parus dans la presse à la suite de l'incarcération de son directeur pour pédophilie. Ce foyer connaissait une grande violence institutionnelle. Il faut empêcher l'émergence de cette forme de violence, qui existe d'ailleurs parfois en maison d'arrêt. Mais dans ces dernières, des procédures permettent d'éviter qu'elle ne s'amplifie.
La création de centres fermés serait une erreur. En voulant faire mieux que la prison, on risque de faire pire. C'est le danger. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de notre part d'une position idéologique antisécuritaire. Les centres fermés constituent, pour nous, un contresens pédagogique.
Mme Nathalie Caillon - On peut être très bon dans le travail que l'on a choisi et pour lequel on a été formé et très mauvais dans celui que l'on n'a pas choisi et pour lequel on n'a pas été formé.
Il faut, certes, des structures « contenantes ». Nous vous avons fait part de notre position sur les CPI et sur les CER. L'enfermement ne relève pas de nos compétences. Comme l'ont démontré les expériences qui ont été conduites, nous sommes très mauvais dans ce genre d'exercice. En outre, ne l'oublions pas, ce n'est pas nous qui souffrons le plus, ce sont les jeunes. Pour que la prise en charge éducative soit efficace et donne des résultats intéressants pour les jeunes qui nous sont confiés, nous devons nous limiter à ce que nous savons faire. Si on nous oblige à exercer des tâches pour lesquelles nous ne sommes pas formés, le travail risque d'être mal fait.
M. Régis Lemierre - Un mineur placé dans un foyer peut, comme dans un CPI, faire l'objet d'un traitement rigoureux. Faisons respecter le règlement intérieur. S'il doit sortir, imposons-lui de rentrer à une heure donnée. Interdisons-lui de sortir si nous estimons qu'il ne doit pas sortir. Ne nous trompons pas de débat. Nous sommes favorables à la rigueur éducative. Le mineur peut aussi mettre en cause l'objectif du placement.
Enfin, vous pourrez constater, à la lecture du livre blanc de l'Union syndicale des magistrats, que certaines mesures ne sont pas respectées. Cela vaut aussi pour les majeurs. Lorsqu'on confie à la PJJ un mineur placé sous contrôle judiciaire, ou bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve s'il a été condamné, et que les mesures le concernant ne sont pas respectées sans pour autant être révoquées par le magistrat, comment voulez-vous que les éducateurs accomplissent leur travail ? La pratique judiciaire doit être en conformité avec les mesures qui sont ordonnées. Il s'agit là d'une difficulté réelle qui a été largement soulignée par l'Union syndicale des magistrats.
M. le rapporteur - Je voudrais revenir sur le patrimoine. Vous avez évoqué un certain nombre de monuments historiques dont on ne savait même pas si les portes ou les fenêtres fermaient... Est-ce à dire que la PJJ a acquis un patrimoine sans suffisamment se soucier de sa bonne utilisation ou de sa fonctionnalité ?
Mme Nathalie Caillon - Ce qui est certain, c'est que nous avons tous travaillé dans des structures qui abritaient, par exemple, un escalier classé : pour réparer la rampe, il fallait demander moult autorisations ; ou bien un arbre figurant sur je ne sais plus quelle carte, dont on ne pouvait pas scier la branche qui allait nous tomber sur la tête, ce qui nous contraignait à toute une gymnastique pour que les jeunes n'y passent pas ; ou encore un bâtiment dont la façade donnait sur je ne sais quel site, si bien qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quelle fenêtre... C'est cela que nous avons voulu dire.
Il est très agréable de travailler dans de tels endroits ; mais quelquefois, avec la population dont nous avons à nous occuper, ce n'est pas forcément le plus efficace, au quotidien.
Cela étant, j'ai trop peu d'informations pour pouvoir parler des achats qui ont été faits ; je constate simplement, pour y travailler quotidiennement, que ce n'est pas forcément le plus facile.
M. Régis Lemierre - Je peux parler des achats qui datent de la période où j'ai débuté, en 1975.
La PJJ a travaillé dans les fameux internats professionnels d'éducation surveillée ; ensuite sont venus les internats spéciaux d'éducation surveillée. Elle avait alors un patrimoine qui correspondait à la population qu'elle accueillait.
Mais la mode des grands internats a disparu, à juste raison d'ailleurs, et la PJJ a développé des unités très diversifiées, des petits foyers collectifs plus implantés dans la ville. Elle est sortie de l'ère de ces grands internats, mais elle a conservé ce patrimoine, un peu trop longtemps peut-être.
Comme ma collègue, je ne suis pas en mesure de parler des nouveaux achats, nous n'avons pas la compétence pour le faire. Mais il est certain que les vieux bâtiments ont été conservés trop longtemps et que l'on ne savait pas vraiment qu'en faire.
M. le rapporteur - Patrimoine et réalité ne vont pas toujours de pair !
J'évoquais tout à l'heure une crise des vocations, notamment chez les éducateurs. Quel est, selon vous, le rôle d'un éducateur aujourd'hui ?
M. Régis Lemierre - Si l'on prend la notion d'éducation dans son acception la plus large, sans la restreindre au sens qu'elle prend pour la justice, pour la PJJ, le rôle d'un éducateur, aujourd'hui, est d'assurer l'épanouissement du mineur et d'essayer de faire évoluer son comportement vers l'autonomie, de manière qu'il puisse devenir un adulte et qu'il aille vers un meilleur confort psychologique, vers une meilleure articulation avec son environnement. L'éducation, c'est induire par des actes et par du « faire-avec » -et non par de la parole : les éducateurs ne sont pas des psychanalystes- des comportements nouveaux qui permettent cette autonomisation du mineur.
Dans le champ de la justice, lorsque nous avons affaire à des mineurs qui sont en danger, notre rôle est de leur faire accepter la mesure, de leur permettre de « recoller » avec leur environnement familial si c'est possible, de réintégrer une scolarité, éventuellement d'avoir un emploi, d'entrer dans un processus de formation...
Si ce sont des délinquants, nous travaillons aussi sur l'acte et sur le rappel à la loi -l'intégration de la sanction prononcée par la juridiction est importante- ainsi que sur la réparation de l'acte. L'éducateur exerce sa mission sous mandat judiciaire, en liaison avec un juge d'instruction ou un juge des enfants, et il doit bien travailler sur cette culpabilité du mineur pour lui permettre d'évoluer et de changer de comportement. Certains mineurs n'ont pas conscience de ce qu'ils ont commis, quelle que soit la gravité de l'acte. L'éducateur a alors un rôle important à jouer, tant dans cette prise de conscience que dans la réparation de l'acte commis.
Ce que je viens d'énoncer est un peu général, c'est en quelque sorte le référentiel, qui peut ensuite se décliner sous de multiples formes : par une pratique, bien sûr, et peut-être par une pédagogie sans cesse renouvelée qui permette de s'adapter aux nouvelles populations de mineurs auxquelles nous nous adressons, qui ont énormément changé. Le patrimoine aurait dû changer, mais les méthodes pédagogiques aussi !
M. le rapporteur - Quelles mesures préconisez-vous pour améliorer aujourd'hui le fonctionnement de votre institution, la PJJ ?
Mme Nathalie Caillon - Cela fait déjà quelque temps que nous formulons des demandes très précises, très simples, mais apparemment très ambitieuses.
Nous souhaitons que notre administration se dote d'un projet national qui soit ensuite décliné à l'échelon des régions et des départements, puis que chaque structure soit dotée de projets de service. Un tel projet national devrait nécessairement être piloté et évalué par la direction de l'administration centrale. C'est là une demande très ancienne et récurrente de notre organisation syndicale, mais pour l'instant, malheureusement, elle n'est pas près d'aboutir : le projet n'existe pas et le pilotage guère plus.
Nous souhaiterions des dynamiques beaucoup plus fortes dans le sens de la rénovation du service public. Cela passe par des états des lieux, par des évaluations... Nous avons déjà évoqué quelques points en réponse à vos questions, nous pourrions en citer beaucoup d'autres.
Nous sommes sans arrêt abreuvés de circulaires définissant des mesures nouvelles sans que jamais le point soit fait sur les mesures anciennes, si bien que ceux qui travaillent sur le terrain ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Quelles doivent être leurs priorités ? Que traite-t-on maintenant différemment d'avant ? Pourquoi ces choses-là ? Que laisse-t-on tomber ? On n'en parle jamais ! Nous connaissons très peu de bilans, d'évaluations, nous connaissons très peu de mesures qui soient suivies jusqu'à leur terme, avec tout ce que cela comporte de mise à plat, d'évaluation en fin de mesure.
M. Régis Lemierre - L'administration a ouvert quantité de chantiers qui n'ont jamais été menés à leur terme. Chaque fois que nous posions une question, on nous répondait qu'il fallait expertiser, parce qu'on n'avait pas le temps. Nous avons l'impression d'une administration toujours dans l'urgence et qui n'a pas su piloter, comme pour les CPI et les CER.
Des rapports ont été commandés pour rénover les méthodes de l'administration centrale, notamment le rapport de M. Vacquin, sociologue des organisations bien connu. Nous n'en avons jamais eu communication, officiellement.
L'administration centrale a été fortement questionnée sur le cloisonnement de ses deux sous-directions, l'une qui travaille sur les méthodes de l'action éducative, l'autre sur la gestion des personnels. Il n'y a aucune véritable transversalité ou, plus exactement -car il ne faut pas non plus caricaturer-, il y en a très peu, et cela fait longtemps que cela dure. C'est une vraie difficulté.
Nous avons l'impression que nulle part dans l'administration il n'y a de pilote. Il faut un véritable projet -mais il n'existe pas, c'est vrai- pour que les personnels sachent quelles sont leurs missions, sachent où ils doivent aller. Ensuite, il faut y aller.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance syndicale ; il y en a toujours, même de la part des syndicats réformistes : le rôle des syndicats est quelquefois de résister, parce qu'ils sont mandatés par leurs personnels, comme, en politique, les élus sont mandatés. Vous m'objecterez que, selon la Constitution, tout mandat impératif est nul ; mais la situation des syndicats n'est pas la même.
Néanmoins, l'administration doit aller de l'avant. Si elle reste paralysée sur toute réforme, comme cela a été le cas ces dernières années, que se passe-t-il ? Les personnels en subissent les conséquences !
La PJJ, actuellement, est acculée. Elle n'est pas responsable de tous les maux ! D'ailleurs, le rapport Lazerges-Balduyck, qu'évoquait ma collègue, souligne les responsabilités multiples dans les carences du traitement de la délinquance juvénile, responsabilités aussi bien de l'Education nationale que de l'administration pénitentiaire et d'autres administrations.
Quoi qu'il en soit, si une adaptation aux réalités du monde actuel avait été conduite de manière plus sûre, à partir de projets bien ciblés, la PJJ n'en serait pas là, le dos au mur, en grande difficulté sur la question de la délinquance juvénile. Les personnels en souffrent et, sur ce point, nous nous interrogeons très fortement sur la responsabilité de notre administration centrale.
Mme Nathalie Caillon - Nous souhaiterions que soit créé un secteur de gestion des ressources humaines, et je parle bien de création ; nous souhaiterions que soient élaborés des projets ciblés ; nous souhaiterions qu'existe un accompagnement des personnels qui parte de l'administration centrale pour aller jusqu'à chaque individu, dans chaque structure, et que les choses soient conduites du début à la fin : que l'on cesse de lancer des chantiers dont nous ne voyons jamais la fin et dont nous faisons en quelque sorte les frais, car nous sommes traités de tous les mots de la terre.
M. le rapporteur - Si j'ai bien compris, cohérence et proximité !
M. Régis Lemierre - Il est un autre point auquel il faut également être attentif.
Vous avez rencontré les personnels de la PJJ, et vous savez que les forces existent. Certes, toutes ne sont pas représentées par les syndicats -tous les syndicats, même confédérés, n'ont pas vocation à représenter tous les personnels-, et les non-syndiqués sont nombreux. Mais vous avez pu constater que l'institution recèle des richesses importantes.
Pourtant, celles-ci n'apparaissent pas. Des articles sont publiés qui font état de difficultés relevant fondamentalement, à notre avis, de la gestion et de la responsabilité de la direction.
Or, si l'on veut construire avec un syndicalisme réformiste, il faut pouvoir contractualiser, il faut pouvoir baliser les réformes que l'on engage. Si l'on fait cela, on trouvera forcément un terrain d'accord avec les personnels. Mais il faut mener un dialogue social construit, ce qui n'a pas été le cas.
Mme Nathalie Caillon - Plus qu'un manque d'exploitation des richesses -qui, c'est clair, existent dans notre administration-, on constate un épuisement des personnels, lié précisément au manque de considération, de prise en compte de ces richesses-là, et qui les conduit très rapidement à démissionner, au sens figuré du terme, mais quelquefois aussi au sens propre.
J'ai toujours été étonnée de voir comment cette institution parvenait, en quatre ou cinq ans, à épuiser les personnes et comment celles-ci, alors qu'elles arrivaient pleines de bonne volonté, avec des idées très précises sur la tâche qu'elles avaient à accomplir, baissaient les bras.
M. le président - Madame, monsieur, je vous remercie. Si je vous comprends bien, il y a...
Mme Nathalie Caillon - ... du travail !
M. le président - ... beaucoup de gâchis que l'on pourrait éviter.
Mme Nathalie Caillon - Il y a beaucoup de choses à faire.
M. le président - Il faut donc s'y atteler !
Audition de M. Jean-Michel BOCQUET
et de M. Nicolas GINOUX,
conseillers
syndicaux de la CFDT interco-branche Justice
(30 avril 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT
M. Bernard Plasait, président - Nous allons à présent entendre MM. Jean-Michel Bocquet et Nicolas Ginoux, conseillers syndicaux de la CFDT interco-branche Justice.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Messieurs, comment expliquez-vous que les éducateurs les plus jeunes, les moins expérimentés, soient souvent mis devant les publics les plus difficiles ? Quelles pistes d'amélioration préconisez-vous ?
M. Jean-Michel Bocquet - Il faut d'abord souligner que, en règle générale, les anciens professionnels ont commencé leur carrière dans des centres aussi difficiles et ne passent qu'ensuite dans d'autres structures. Les raisons de ce changement ne sont pas forcément liées à la difficulté du travail. Cela peut être aussi parce que, dans ces centres, on travaille très tôt le matin et très tard le soir et que, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a une vie familiale, ces conditions de travail sont peu évidentes ; il est alors plus facile d'avoir des horaires de bureau que des horaires décalés.
Par ailleurs, lorsque ces anciens professionnels sont amenés à quitter ces lieux, étant donné les conditions de travail difficiles, personne ne veut y aller, si bien que les postes, notamment dans un certain nombre de foyers, sont donnés aux sortants d'école. De ce fait, ce sont les jeunes professionnels, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, qui sont affectés dans les endroits où les conditions de travail sont les plus difficiles, avec les jeunes les plus difficiles.
Sur ce point, la CFDT pense qu'il serait intéressant que, même si ce sont de jeunes professionnels, une dynamique puisse se construire autour de ces centres. Nous sommes un certain nombre de jeunes professionnels à ne pas avoir d'hostilité particulière à aller travailler dans des endroits difficiles. Ce qui nous manque, en revanche, c'est la possibilité de travailler avec une équipe soudée, construite, de travailler autour de projets communs, avec des projets de service qui soient clairs, avec du travail clair. Ce qui nous manque, c'est de savoir où nous allons, comment nous y allons, avec qui nous travaillons ; c'est que tout le monde aille dans le même sens, travaille dans la même dynamique...
M. Nicolas Ginoux - ... et se reconnaisse à travers le projet de service qui est en place.
Nous pensons aussi que, grâce, par exemple, à des cooptations, il serait peut-être possible de remobiliser les gens qui souhaiteraient travailler ensemble, parce qu'ils se connaissent ou ont déjà travaillé ensemble, et qui seraient partants pour créer des projets de service à l'intérieur de ces structures-là, des centres de placement immédiat, les CPI, ou des centres éducatifs renforcés, les CER, lesquels, à l'heure actuelle, existent en très petit nombre.
La CFDT estime que les CPI ont été créés dans l'urgence, peut-être en réponse à l'opinion publique, et que les conditions de recrutement qui ont accompagné leur mise en place n'ont pas été suffisamment réfléchies.
Ainsi, pour amener des effectifs dans les centres de placement immédiat, il a été procédé à des recrutements exceptionnels de nouveaux éducateurs ayant déjà une formation préalable dans les métiers, disons, de l'éducation ; mais, à la sortie de leur formation, ils ont eu la possibilité de choisir autre chose, d'aller dans des milieux ouverts, si bien que les places dans les centres de placement immédiat ou les centres éducatifs renforcés sont restées vacantes.
M. Jean-Michel Bocquet - Toujours à propos des centres de placement immédiat et des centres éducatifs renforcés, des cahiers des charges assez clairs et précis ont été rédigés. Or, on sait aujourd'hui que les centres qui ont été ouverts ne répondent pas aux cahiers des charges et qu'un certain nombre de difficultés proviennent de là. Certes, ce sont de jeunes professionnels -mais ils amènent aussi un dynamisme, une nouvelle manière de travailler, de nouveaux projets...- ; cependant, nous nous posons la question de savoir si l'administration ne contribue pas à les mettre en difficulté du fait que les cahiers des charges ne sont pas respectés, que le nombre d'éducateurs n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas forcément tous les personnels... Car il ne manque pas seulement des éducateurs : il manque parfois des cuisiniers, il manque aussi des lingers...
C'est, je pense, de la responsabilité de l'administration que de ne pas mettre ces jeunes professionnels encore plus en difficulté, compte tenu des conditions de travail.
M. le rapporteur - Lorsque nous nous sommes rendus dans les différents centres, sur le terrain, nous avons effectivement constaté une crise de recrutement, mais nous avons aussi rencontré des situations paradoxales dans lesquelles le personnel était en surnombre !
L'une des manières d'améliorer la situation ne serait-elle pas de recruter d'une autre manière, soit par la troisième voie, soit par le biais de recrutements de type contractuel, même s'il est clair que cela ne doit pas devenir le mode de recrutement principal ?
M. Nicolas Ginoux - Certains centres de placement immédiat ont recruté des éducateurs contractuels, mais leurs contrats ne sont pas signés, et nous avons l'exemple, dans le département des Yvelines, de contractuels qui n'ont jamais pu prendre leurs fonctions !
Pour ce qui est de la troisième voie, nous sommes tout à fait pour que des gens qui ont déjà une expérience soient recrutés afin de devenir des professionnels.
Nous proposons aussi que leur soit dispensée une formation qui leur permette de prendre de la distance par rapport au terrain -puisque ce sont des personnels de terrain qui sont « pressentis », dirons-nous-, et que ce soit une formation validante. Le fait d'avoir dix ou quinze années de terrain ne met pas forcément à même de travailler avec des mineurs en difficulté et en l'occurrence, puisqu'il s'agit des centres de placement immédiat, avec des mineurs délinquants.
M. Jean-Michel Bocquet - Le recrutement par la troisième voie est effectivement une revendication de la CFDT depuis maintenant un certain nombre d'années. Au-delà même de la PJJ, il doit se développer dans l'ensemble de la fonction publique, à la condition toutefois que, en particulier dans les métiers d'éducateur ou d'agent technique d'éducation, les personnes recrutées soient formées notamment à prendre du recul, à se décentrer de ce qu'elles pourront rencontrer au quotidien, dans le travail, et qu'elles bénéficient d'apports théoriques assez précis.
Le terrain n'apporte pas tout, notamment dans les professions éducatives. Il faut, je dirai, un savant dosage entre l'expérience de terrain et la capacité à conceptualiser, à réfléchir, à poser et à réfléchir l'action.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur la réforme des services éducatifs auprès des tribunaux, les SEAT ?
M. Jean-Michel Bocquet - La CFDT la juge de manière assez négative.
Elle a été menée, me semble-t-il, sans que soient prises en compte un certain nombre de réalités de terrain et, je pense, en évitant de rencontrer les professionnels et d'entendre les difficultés propres à ces services.
Les éducateurs en poste dans un SEAT -nous pouvons en parler, puisque c'est notre cas- font tout un travail relationnel qui porte sur l'échange qu'il peut y avoir entre un magistrat et un éducateur ou entre le parquet et la PJJ, un travail qui vise à rendre la justice et le fonctionnement des tribunaux un peu plus humains, de façon que ce ne soit pas une machine qui déroule une procédure, mais qu'il s'agisse bien du traitement d'une personne, d'une personnalité. Ce travail-là, je pense, n'a pas été suffisamment pris en compte dans la réforme proposée.
Aujourd'hui, nous avons l'impression de revenir en arrière, de revenir à ce qui existait auparavant. Les délégués à la liberté surveillée seront tout seuls, sans équipe, sans accompagnement, sans pouvoir poser en équipe les difficultés qu'ils rencontrent. Il faut également savoir que, dans les SEAT, le travail se fait dans l'urgence, dans la rapidité. Si l'on n'a pas la possibilité, à un moment donné, de se poser, de réfléchir ce que l'on fait, si l'on est uniquement dans l'urgence, on finit par ne plus très bien savoir quel métier on fait : est-on là seulement pour « traiter », ou bien est-on là aussi pour accompagner et rendre humaine la machine judiciaire ? Celle-ci, à mon avis, est aujourd'hui de plus en plus déshumanisée : on « traite ». On traite de la procédure, on traite du papier, on ne traite pas forcément de l'humain et du mineur, en l'occurrence.
M. Nicolas Ginoux - Les éducateurs en poste dans un SEAT mais qui ont la chance de travailler également sur le milieu ouvert, c'est-à-dire à l'extérieur du tribunal, peuvent aussi apporter aux magistrats leur connaissance des difficultés, qu'elles soient sociales ou autres, des quartiers dans lesquels ils exercent. Cela permet souvent aux magistrats de relativiser la complexité des situations auxquelles ils sont confrontés, et cela les aide dans les décisions qu'ils ont à prendre.
Il est important de conserver cet apport, qui relativise, comme le disait mon collègue, la procédure, ou du moins la rend un peu plus humaine.
M. Jean-Michel Bocquet - Les disparités sont énormes, sur le territoire français, entre un très gros SEAT, par exemple dans la région parisienne ou dans une très grande ville de province, et celui d'une ville de taille moyenne du centre de la France. On ne sait pas vraiment si, dans une certaine mesure, l'éducateur fait le même métier ou non.
Ces spécificités locales n'ont pas été forcément prises en compte dans la réforme, et il reste important, même dans les tout petits tribunaux de grande instance où existait un SEAT auparavant, que des éducateurs soient présents pour pouvoir, parfois, poser une action, pouvoir aussi rappeler la force de l'ordonnance de 1945, qui est de croire en l'éducabilité des mineurs. La présence d'un ou de plusieurs éducateurs au tribunal renforce cette volonté d'éduquer les mineurs avant tout chose.
M. Nicolas Ginoux - Le travail en équipe est important également au sein d'un SEAT, car il permet de donner des réponses cohérentes, des réponses à discuter. Il peut aussi permettre d'éviter des rapprochements par trop..., enfin, des rapprochements entre magistrats et éducateurs.
Les éducateurs sont entre les deux, entre le pouvoir décisionnel et le pouvoir de proposition. L'équipe est un garde-fou par rapport à une trop grande proximité, par rapport, pour en revenir aux délégués de la liberté surveillée, aux dérives qu'on a pu connaître dans le passé.
M. le rapporteur - Comment se sont mises en place les 35 heures dans vos services ?
M. Jean-Michel Bocquet - Nous reprendrons les positions de la CFDT sur le sujet, et, au-delà de la PJJ, la CFDT a toujours été très claire sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Pour ce qui est de la PJJ, notre reproche essentiel est que tout s'est fait en urgence, rapidement, et, d'après nous, au prix d'un certain nombre de passages en force.
La CFDT a toujours souhaité négocier non seulement sur la réduction du temps de travail, mais avant toute chose sur l'aménagement du temps de travail et sur l'aménagement du travail fait par les éducateurs. On ne pouvait pas réfléchir à la réduction du temps de travail sans envisager de création d'emploi ; en revanche, on peut se demander comment aménager le temps de travail en s'interrogeant sur la possibilité de travailler autrement. Or cette réflexion a été totalement absente, tout s'est fait quasiment sans négociation et a été passé en force et dans l'urgence, puisque les premières notes sur la RTT concernant les services que nous ayons vues passer datent du mois d'août. Quatre mois pour mettre en place un aménagement et une réduction du temps de travail, cela me paraît un peu court !
Compte tenu de l'état de la PJJ sur la question des personnels, nous nous interrogeons et nous dénonçons l'absence de recrutement lié à cet aménagement et à cette réduction du temps de travail.
M. Nicolas Ginoux - Je voudrais également souligner qu'il n'y a pas eu de diminution des prises en charge.
Comme vous le savez, à la PJJ, du moins en milieu ouvert et dans les SEAT, nous travaillons sur un nombre de mesures prédéterminé. Or, la réduction du temps de travail s'est faite sans aucune réduction du nombre de mesures, c'est-à-dire du nombre de mineurs pris en charge, et, bien entendu, sans les recrutements qui auraient dû l'accompagner. On nous demande donc, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui, de travailler moins en conservant le même nombre de mesures, c'est-à-dire le même nombre de jeunes, de familles, et, en fin de compte, la même charge de travail. Nous n'avons pas vraiment l'impression d'une réduction très probante du temps de travail ; nous avons plutôt l'impression d'une réduction du temps consacré aux mineurs et à leurs familles, ce qui peut être préjudiciable.
M. Jean-Michel Bocquet - Particulièrement à la PJJ, il aurait fallu réfléchir sur ce qu'est le travail des éducateurs et sur les moyens qui nous permettraient d'essayer de le conduire autrement. Il aurait fallu se demander comment rendre la PJJ plus proche de certaines de ses missions plutôt que de raisonner de manière purement comptable, comme cela a été fait, et de nous dire : « Voilà, vous avez tant de jours de congé, il faut passer aux 35 heures, nous vous laissons vos congés et vous passez à 37,10 heures pour les milieux ouverts, à 38 heures et quelques pour les directions départementales... » Cette gestion comptable ne correspond ni à notre métier ni aux nécessités du travail et de la réalité.
Sans doute que, plus tard, on reviendra sur un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne les mesures en attente ; mais toute cette dimension du travail de l'éducateur et des difficultés que nous avons à travailler avec les mineurs dans le contexte actuel n'a pas du tout été prise en compte.
M. le rapporteur - On s'aperçoit que les délais d'exécution des mesures de justice sont extrêmement longs et que certaines, très souvent, ne sont pas exécutées ou sont exécutées très tardivement.
Comment s'effectue le tri de ces mesures ? Quelles sont les priorités définies ? Quelles mesures préconiseriez-vous pour essayer d'améliorer cette situation ? Car une mesure n'est efficace que si elle est appliquée très rapidement.
M. Nicolas Ginoux - Nous sommes tout à fait d'accord sur ce dernier point : il est certain que, lorsque des mesures sont prises puis mises sur liste d'attente et exercées deux ans, voire trois ans après la décision de justice - je pense à des sursis-mises à l'épreuve -, on peut se demander si elles ont vraiment lieu d'être et s'interroger sur leur utilité et sur le travail qui peut être fait.
Les mesures de ce type sont nombreuses sur les listes d'attente. Il faut prendre en compte le temps d'une mesure. Ainsi, par exemple pour une liberté surveillée préjudicielle ordonnée lorsqu'il a quatorze ans, le mineur sera jugé à dix-sept ans : il y a donc trois ans de mesure. Ce sont des éducateurs qui travaillent avec ces jeunes, pendant des durées qui vont généralement de un à trois ans ; le turn-over est donc relativement restreint.
Quant aux préconisations, il faudrait effectivement qu'il y ait suffisamment de personnel pour que ces mesures, cela nous paraît aller de soi, soient exercées et qu'elles aient du sens.
M. Jean-Michel Bocquet - Il ne s'agit pas de se demander quelle doit être la priorité dans le suivi d'un mineur : un mineur pour lequel une mesure a été prononcée doit être suivi, et doit être suivi rapidement, nous sommes d'accord sur ce point.
Le raisonnement doit être retourné. Il faut se demander pourquoi ces mesures sont en liste d'attente. Le bon raisonnement est là !
La situation s'explique par un certain nombre de problèmes : par le manque de personnel, c'est évident ; mais aussi par les délais de justice, qui dépendent non pas de la protection judiciaire de la jeunesse, mais de l'audiencement des dossiers, du moment où ils seront jugés. Un passage au tribunal pour enfants peut prendre deux ou trois ans. Or, pendant les deux ou trois ans où nous suivons un mineur, nous n'en prenons pas un autre !
Par ailleurs, quel sens cela a-t-il de voir un mineur qui a commis des faits à seize ans être jugé à dix-neuf ans et faire l'objet d'une mesure que nous suivrons lorsqu'il aura vingt ans ?
Certaines choses relèvent donc non pas de la protection judiciaire de la jeunesse, mais des délais de justice. Cependant, s'il faut raccourcir ceux-ci, il ne faut pas non plus qu'ils soient inexistants, puisque la justice des mineurs a la spécificité de laisser au mineur le temps d'évoluer. Il y a donc un juste milieu à trouver entre une attente de trois ans et une comparution immédiate.
A raisonner ainsi, on retourne la question, qui devient : pourquoi y a-t-il autant de mesures en attente ?
M. le rapporteur - Quel est votre sentiment sur les CPI et sur les CER ?
On parle beaucoup aujourd'hui des centres éducatifs fermés. Quelle est votre opinion sur ce type d'établissements ?
M. Nicolas Ginoux - Nous sommes bien entendu contre les centres fermés, et notre opinion est certainement assez répandue.
Pour nous, il n'existe à l'heure actuelle qu'une sorte de privation de liberté : la détention provisoire. Comment, dès lors, peut-on enfermer des mineurs s'ils ne sont pas condamnés ? Sous quelle forme ? Quels délais ? Quelle représentation ? Quelles garanties auront les mineurs s'ils peuvent être placés ? Cette question nous préoccupe ! Comment placera-t-on des mineurs sous ordonnance provisoire de placement avec interdiction de sortie ? Quels sont les délais de garantie face à la juridiction ?
Quant au travail en centre fermé, nous constatons là aussi le risque d'un retour en arrière. Nous n'avons pas vécu les centres fermés, notre génération est venue après. Mais s'ils ont été fermés, c'est qu'il se passait beaucoup de choses à l'intérieur, qu'il y avait de la violence, que les mineurs en sortaient avec des taux de récidive assez importants. Nous nous demandons donc quel est le but de l'enfermement des mineurs, ou alors, sous quelle forme les enfermer. Je crois que la question est là.
M. Jean-Michel Bocquet - Il y a un raisonnement à tenir à propos de ces centres fermés.
La privation de liberté, c'est la prison. Pourquoi, à un moment donné, doit-on définir des politiques particulières aux mineurs ? Ou bien ils entrent dans le droit commun des majeurs, ou bien on leur reconnaît une spécificité qui doit être à leur avantage, notamment celle que pose aujourd'hui la loi, à savoir l'éducabilité de ces mineurs.
Nous, nous croyons à l'éducabilité des mineurs, ce point est clair.
Aujourd'hui, on sait déjà qu'un certain nombre de dérives existent, nous les avons rencontrées au quotidien, dans notre travail. Ainsi, dans une affaire mixte, dans laquelle sont impliqués un mineur et des majeurs, le mineur est présenté auprès d'un juge des enfants, un mandat de dépôt est demandé, et il se trouve placé en détention provisoire. Les majeurs de la même affaire passent dans le cadre d'une comparution immédiate. Or, en comparution immédiate, les majeurs sortent avec des sursis simples. Cela signifie donc que, dans la réalité des tribunaux, aujourd'hui, on est déjà plus répressif, plus dur avec les mineurs qu'on ne l'est avec les majeurs.
Ensuite, si effectivement il faut enfermer les mineurs la seule chose qui existe et qui, en tout cas, nous paraisse concevable, c'est la prison ; à cette nuance près que les prisons doivent être des établissements spécifiques aux mineurs, avec des prises en charges spécifiques aux mineurs. Il faut faire attention aussi à ne pas incarcérer ces mineurs comme ça, à tout bout de champ !
Une question sous-tend tout cela, et c'est surtout celle-là qu'il faut poser : si l'on peut concevoir d'enfermer un mineur, parce que les faits sont suffisamment graves pour le justifier, qu'en fait-on après ? Que fait-on à sa sortie de prison ?
On sait que la détention, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs, n'a de sens que si, à l'intérieur, on travaille pour préparer la sortie. Or le discours que l'on entend aujourd'hui, c'est que l'on va placer ces mineurs dans des centres fermés. Oui, mais on ne va pas les y placer toute leur vie ! Il faudra bien, à un moment ou à un autre, les insérer dans la société, les remettre dans le chemin d'une vie ordinaire. Et cela n'est possible que s'ils sont à l'extérieur de la prison, s'ils se rendent compte de ce qu'est la société dans laquelle nous vivons. Ce n'est possible que si des gens sont capables, à un moment donné, de leur renvoyer ce que c'est que la loi, de leur renvoyer aussi comment ils vivent et de leur montrer qu'ils sont capables de le faire sans être enfermés.
Il peut y avoir une parenthèse, à un moment donné, quand les faits sont graves ; il n'empêche que le travail restera à faire à la sortie. Aujourd'hui, ce débat n'est pas du tout posé.
On peut parler des centres fermés, on sait ce que cela a donné : des expériences ont été tentées dans le passé auxquelles un terme a été mis parce qu'il se passait des choses extrêmement graves à l'intérieur. On ne peut pas non plus demander à un éducateur de jouer le rôle de surveillant de prison, nous ne sommes pas là pour remplir cette tâche et nous n'y sommes pas formés ! Nous sommes formés pour éduquer les mineurs, pour les accompagner, pour leur rappeler un certain nombre de choses, et ce dans un cadre ordinaire de vie.
M. Nicolas Ginoux - Sinon, nous aurions choisi de travailler à l'administration pénitentiaire ! Il y a des éducateurs qui travaillent en incarcération, qui travaillent en milieu ouvert aussi. Pour la plupart, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont choisi de travailler avec des mineurs dans la société, non avec des mineurs enfermés. C'est une question sinon de conviction, du moins de choix, mais également de formation. Nous avons été formés pendant deux ans à prendre en charge des mineurs dans la société, certes au travers de l'incarcération pour les missions qui sont par exemple celles du SEAT, mais en tout cas pour travailler avec des mineurs, j'allais dire « libres ».
M. le rapporteur - Quel est le rôle d'un éducateur aujourd'hui ?
M. Nicolas Ginoux - Le rôle d'un éducateur est de replacer le mineur à l'intérieur du lien social.
Nous avons un travail de partenariat, un travail de resocialisation, un travail visant à redonner confiance, à replacer d'abord les mineurs dans le droit commun au travers des institutions qui sont destinées à les prendre en charge, et ce, quels que soient les faits qu'ils aient commis. C'est donc tout un travail de partenariat, de réinsertion sociale et scolaire.
Le rôle d'un éducateur justice, aujourd'hui, est de dire à certains mineurs qu'ils n'avaient pas le droit de commettre certains faits. Aujourd'hui, c'est particulièrement clair au tribunal, nous sommes parmi les seuls adultes à pouvoir dire en face à un mineur : « Ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de le faire. » C'est important ; c'est un devoir que nous avons du fait de notre métier, mais que tout le monde devrait avoir -disons que cela relève d'une certaine citoyenneté-, le devoir de dire à des enfants, à des mineurs : « Vous n'avez pas le droit de faire cela. »
Aujourd'hui, nous sommes donc parmi les seuls, les derniers en bout de chaîne, à dire à ces jeunes-là : « Ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de le faire. » A nous ensuite de travailler l'« après » de ce passage, devant la juridiction, en l'occurrence, et d'essayer de faire réintégrer le mineur dans le droit commun, c'est-à-dire dans une société, d'essayer de lui faire entendre aussi que la société a certaines règles, qu'il se doit de les respecter, qu'en retour la société le respectera aussi.
Car il est important qu'il y ait une réciproque. Aujourd'hui, des mineurs souffrent d'un certain manque de réciprocité et se demandent pourquoi respecter les règles de la société si, en contrepartie on ne les respecte pas eux-mêmes. Je crois que l'on peut entendre ce discours.
Le travail de l'éducateur est donc de replacer le mineur dans notre société, de l'aider aussi à se positionner par rapport à certaines choses, à des actes.
M. Jean-Michel Bocquet - Notre principal métier, c'est vrai, est d'accompagner un mineur et sa famille. Nous les accompagnons dans leur quotidien, nous essayons de faire qu'ils comprennent, tout simplement, dans quelle société et dans quel endroit ils vivent.
Aujourd'hui, nous travaillons énormément avec des populations qui ne parlent pas ou n'écrivent pas le français, qui ne comprennent pas forcément comment fonctionnent la société française ou la République française. Je sais, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, que nous sommes peut-être les seuls à avoir un jour expliqué simplement à ces gens ce qui se passait, comment cela marchait, les seuls à leur dire que la loi française autorise ceci, mais pas cela.
Mais nous ne le leur disons pas en leur faisant une leçon de morale ou en leur assenant qu'ils n'y comprennent rien, que ce sont de mauvais parents, qu'on va leur supprimer les allocations familiales... Nous ne sommes pas dans ce type de discours. Nous sommes là pour essayer de comprendre pourquoi ils sont en difficulté, que ce soit le mineur ou sa famille, et pour leur réexpliquer afin qu'ils comprennent.
Aujourd'hui, certaines familles ne comprennent pas comment fonctionne l'orientation de leur enfant, ne comprennent pas ce qui se passe dans la justice française... Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qui se passe.
Nous sommes peut-être les seuls à leur dire comment cela fonctionne, à les accompagner, à les soutenir, à tolérer qu'il puisse y avoir un dérapage à un moment donné tout en restant présents pour les accompagner et essayer de faire qu'ils s'en sortent, qu'ils s'insèrent dans la société française, et qu'ils s'y insèrent le mieux possible, dans le respect de la loi.
Nous sommes peut-être les seuls aussi à pouvoir dire un certain nombre de choses aux mineurs, à leur redonner confiance et, en même temps, à leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci ou cela, mais que nous les aiderons à ne pas recommencer. Nous ne sommes ni en train de les punir, au sens péjoratif du terme -nous ne disons pas : « Vous avez fait cela, c'est terminé ! »-, ni non plus dans un leurre éducatif qui nous ferait croire que tout est beau, tout est merveilleux, que les mineurs n'ont rien fait. Ce n'est pas vrai, les mineurs commettent des actes de délinquance. Nous ne sommes pas dans ce leurre-là non plus. Nous essayons de mesurer les deux !
Le rôle de l'éducateur est essentiellement celui-là : un rôle de lien. C'est parfois simple ; il peut s'agir, au tribunal, de négocier qu'un mineur puisse avoir un sandwich à midi alors qu'il est sous main de justice. Cela fait partie des choses que nous faisons, des choses qu'il nous paraît important de faire : dire que, quoi qu'il ait commis, on n'a pas le droit de priver un mineur de nourriture.
Nous faisons du lien au milieu de tout cela et, malheureusement, ai-je envie de dire, nous, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, sommes peut-être aujourd'hui les seuls, avec d'autres éducateurs tels, par exemple, les éducateurs de prévention, à pouvoir encore le faire.
On fonctionne aujourd'hui sur un défaut de lien avec ces mineurs : on a peur des mineurs. Nous, nous les avons tous les jours dans nos bureaux. Je n'ai jamais eu peur en allant au travail, je n'ai jamais eu peur en entrant dans mon bureau, et pourtant, nous travaillons avec des mineurs qui sont extrêmement compliqués.
M. le rapporteur - Que préconiseriez-vous pour améliorer le fonctionnement de la PJJ ?
M. Nicolas Ginoux - La chose la plus importante à nos yeux, nous sommes assez clairs sur ce point, c'est que l'ordonnance de 1945 ne soit pas réformée. Elle contient un panel de mesures suffisant qui, si elles étaient appliquées, pourraient apporter aujourd'hui des solutions à la délinquance des mineurs, mais aussi aider les mineurs en danger, puisque, je le rappelle, nous ne prenons pas seulement des mineurs délinquants en charge.
M. Jean-Michel Bocquet - La CFDT demande aussi à pouvoir travailler dans la continuité de ce qui a été fait. La protection judiciaire de la jeunesse et l'éducation surveillée, qui l'a précédée, ont une histoire. Des choses ont été tentées, certaines ont réussi, d'autres moins, voire n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, tous les six mois, nous devons faire autrement. Je veux bien que nous fassions autrement, mais, encore une fois, cela ne vient pas forcément de nous, ce n'est pas nous qui décidons de tenter autre chose, quelque chose de nouveau. Cela descend, c'est toujours descendant, de l'administration vers nous : « Voilà, vous êtes éducateurs, et vous devez faire autrement. » C'est là un mode de fonctionnement que la CFDT dénonce.
Nous demandons une déconcentration de l'organisation, actuellement très centralisée, de la protection judiciaire de la jeunesse -ce qui ne veut pas dire que nous demandons que ce ne soit pas une administration d'Etat. Nous demandons que les directeurs régionaux et départementaux aient de réelles responsabilités, qu'ils soient porteurs d'une réelle politique départementale ; notamment -et c'est là que cela devient intéressant- qu'un partenariat soit mis en place avec l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Au demeurant, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, préconise un renforcement du partenariat entre la PJJ et l'ASE.
Ce sont des choses qu'il faut faire et qui sont possibles si des spécificités locales sont reconnues.
Le corollaire d'une telle organisation serait que cette administration déconcentrée fonctionne sur le mode du contractuel : l'administration ne pourra pas être réformée sans l'appui des personnels.
Il y a des syndicats réformateurs à la protection judiciaire de la jeunesse, et la CFDT en fait partie. Nous voudrions construire avec l'administration, nous voudrions avancer, nous voudrions faire des propositions, nous voudrions pouvoir être entendus, nous voudrions que ces choses-là soient votées, négociées, qu'un certain nombre de personnels les portent avec l'administration. Or, aujourd'hui, nous sommes toujours dans une relation de face à face qui ne correspond pas à ce que voudrait faire la CFDT.
Pour fonctionner sur un mode contractuel, il faut de la déconcentration : cela ne peut pas se faire au seul échelon national, parce que la réalité de la région parisienne n'est pas celle de la région Centre non plus que celle du Nord - Pas-de-Calais, ne serait-ce que du fait des spécificités culturelles importantes.
Nous insistons aussi sur la nécessité de pouvoir, à un moment donné, procéder à une évaluation précise de ce qui a été fait et mis en place, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Des réformes ont été lancées dont nous n'avons jamais vu le bout, dont nous n'avons jamais eu l'évaluation. Les évolutions sont si rapides qu'on n'a même pas le temps de faire l'évaluation du projet précédent. Au bout d'un moment, nous, éducateurs de terrain, ne savons plus ce que nous devons faire !
Dans le même ordre d'idée, nous voudrions que la protection judiciaire de la jeunesse ait une réelle politique de ressources humaines. Je sais bien que c'est très compliqué à mettre en place dans la fonction publique. Il n'empêche que la CFDT demande une politique de ressources humaines, et cela rejoint l'idée que nous avancions au début de notre intervention d'une cooptation dans les endroits difficiles, afin de pouvoir travailler, parce que des gens motivés travailleront. Or une motivation est portée par toute une équipe. Qu'on ne raisonne pas uniquement sur « une personne, un poste », car ce sont aussi des équipes qui travaillent ensemble !
Pour toutes ces raisons et, en particulier, compte tenu des difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain ou dans les lieux où nous travaillons, compte tenu également des spécificités régionales et locales, il faut que la protection judiciaire de la jeunesse ait une politique de ressources humaines.
Il faut également -mais la réflexion est en cours- repenser un certain nombre de choses dans la formation des éducateurs, des agents techniques d'éducation, les ATE, etc.
Le premier point qu'il faudrait revoir, c'est que, aujourd'hui, les directeurs, les éducateurs, les ATE, reçoivent des formations séparées. Or, quand nous travaillons, c'est forcément avec un directeur, avec un ATE, avec un éducateur.
Il faudrait aussi que la PJJ s'ouvre à certaines autres formations, puisque nous sommes amenés à travailler en partenariat avec un éducateur de prévention, un éducateur de l'ASE, un éducateur d'un foyer associatif. Nous ne faisons pas les mêmes métiers, c'est sûr. La PJJ a la spécificité de s'occuper d'ados et de pré-ados qui sont des mineurs sous main de justice, placés par un juge des enfants. Même si nous ne travaillons pas sur un volet administratif, comme le fait l'ASE, il n'empêche que nous travaillons avec ces gens-là et que nous ne nous connaissons pas forcément, nous ne nous comprenons pas forcément, alors que nous sommes collègues et que nous sommes là pour travailler ensemble.
Enfin, je voudrais souligner que, lorsqu'on travaille en milieu ouvert, on crée des réseaux : à la mission locale, avec l'espace territorial, etc. Le jour où l'on s'en va, ce réseau de travail ne continue pas forcément d'exister, parce qu'il est porté par une personne et non par une volonté globale. Il est donc important de nous ouvrir.
M. le président - Peut-on reformuler votre position en disant que, dans une administration qui est très riche de ressources humaines, où les personnes sont nombreuses à avoir une vraie vocation, à avoir envie d'être au service de cette jeunesse, une part importante du gâchis pourrait être évitée si, d'une part, un pilotage national avec évaluation était mis en place, de telle manière que chacun des agents comprenne mieux dans quel contexte général il agit et, d'autre part, si la décentralisation ou la déconcentration étaient plus marquées ?
M. Jean-Michel Bocquet - Le terme de « gâchis » me dérange quelque peu.
M. le président - Disons « gaspillage » !
M. Jean-Michel Bocquet - Cette administration recèle de grandes richesses, et elle fonctionne. Aujourd'hui, les éducateurs qui travaillent, et qui travaillent bien, qui sortent des mineurs de leurs difficultés, sont nombreux.
On pourrait faire mieux, c'est vrai, notamment par une politique de déconcentration et par une valorisation du métier exercé. Certaines réformes, notamment la loi sur la présomption d'innocence, ont marqué des avancées.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont parfois l'impression de n'être pas entendus dans leur volonté, très réelle, d'aider ces mineurs. Nous sommes de moins en moins dans le leurre éducatif du tout-éducatif merveilleux qui résoudra tout : plus personne ne tient vraiment ce raisonnement, à la protection judiciaire.
On doit améliorer les choses, on peut les faire autrement, mais il faudra inévitablement travailler sur un mode contractuel pour que les personnels se voient réellement reconnus dans le métier qu'ils exercent. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur la protection judiciaire de la jeunesse, c'est qu'elle ne fonctionne pas, que, comme vous le disiez un peu, c'est un gâchis... Ce n'est pas tout à fait comme cela, et il est un peu caricatural de présenter les choses ainsi.
M. le président - Messieurs, je vous remercie.
Audition de Mme Claude BEUZELIN,
secrétaire générale
du SNPES-PJJ-FSU
et de M. Roland CECCOTI-RICCI
membre du bureau national
du SNPES-PJJ-FSU
(30 avril 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT
M. Bernard Plasait, président - Nous allons à présent entendre Mme Claude Beuzelin, secrétaire générale du SNPES-PJJ-FSU, accompagnée de M. Roland Ceccoti-Ricci, membre du bureau national du SNPES-PJJ-FSU.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Ma première question concerne les éducateurs.
Lorsque l'on fait le tour des différents centres en France, on constate que les éducateurs les plus jeunes sont souvent ceux qui sont confrontés aux situations les plus difficiles. C'est vrai dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est malheureusement vrai également dans d'autres domaines de la fonction publique. Qu'en pensez-vous ? Comment peut-on essayer d'améliorer la situation ?
Mme Claude Beuzelin - J'aurais aimé, en préalable, vous présenter notre analyse de la délinquance des mineurs et, plus globalement, de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour répondre à la délinquance des mineurs, il est nécessaire d'en analyser les causes. Elles sont multifactorielles, elles l'ont toujours été, mais il est important de le rappeler aujourd'hui.
Il y a d'abord de fortes inégalités sociales, qui sont économiques, mais aussi spatiales et géographiques. Certaines populations ouvrières ou d'origine étrangère sont exclues du monde du travail, les enfants et les adolescents de ces familles sont également victimes d'exclusion et ces personnes se sentent abandonnées.
On ne peut pas isoler le contexte social quand on veut répondre à la question de la délinquance des mineurs. Si on le fait, on apporte des réponses souvent très répressives et on bascule dans une grande intolérance à l'égard de ces jeunes avec des dispositifs proches de la tolérance zéro ou allant jusqu'à la comparution immédiate ou le flagrant délit ou les centres fermés. Or nous savons, par notre pratique professionnelle, par l'histoire des institutions et des sciences humaines, que cela aboutit à des impasses.
Par ailleurs, je tiens à souligner que l'on ne peut pas dissocier les mineurs en danger des mineurs qui ont commis des délits. Les professionnels ont appris qu'il n'y a pas deux catégories de jeunes. Si tous les mineurs en danger ne deviennent pas des mineurs délinquants, on constate que 90 % des mineurs délinquants ont été des mineurs en danger. Il est donc nécessaire d'assurer une continuité dans la prise en charge des uns et des autres. Cette continuité doit avoir lieu dans l'espace éducatif. Nous sommes favorables à ce que la protection judiciaire de la jeunesse ait, à ce titre, une double compétence et qu'elle puisse intervenir aussi bien au civil qu'au pénal. Aujourd'hui, la PJJ intervient essentiellement au pénal et on s'aperçoit que l'on s'attache à l'acte commis sans intégrer la dimension familiale et personnelle du jeune.
La réponse à la délinquance doit également s'inscrire dans un cadre plus large. Il est nécessaire de développer une prévention spécialisée ayant pour but d'éviter la marginalisation et l'exclusion et de créer un lien social. Il convient de consolider les mesures éducatives en milieu ouvert, les jeunes gardant un lien direct avec leur environnement familial et social. Les mesures de placement doivent être des mesures éducatives s'inscrivant dans la durée. La décision est prise par l'instance judiciaire, mais la PJJ doit en être le maître d'oeuvre.
Pourquoi ne trouve-t-on aujourd'hui que des jeunes professionnels dans les CPI, les CER et l'ensemble des foyers de la PJJ ? Entre 1985 et 1997, le recrutement a été presque totalement interrompu et on a assisté pendant dix ans à une baisse du nombre des personnels. C'est seulement en 1998 que nous avons récupéré nos effectifs. Cette situation a entraîné la fermeture d'un certain nombre d'établissements, l'arrêt de la transmission de l'expérience entre les générations et une profonde désorganisation de l'institution. Les sollicitations devenant plus fortes, le recrutement a repris depuis peu avec l'embauche de 1.300 personnes. Toutefois, cela ne signifie pas que 1.300 professionnels de plus sont sur le terrain, car il y a des périodes de formation.
Par ailleurs, les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse font souvent l'objet d'une double mesure, c'est-à-dire une ordonnance de placement et une prise en charge en milieu ouvert. En effet, la confrontation permanente des jeunes et des adultes crée des tensions vis-à-vis des adultes qui les encadrent. Ces situations conflictuelles sont souvent dues aux conditions dans lesquelles sont effectués les placements.
La décision est prise en cinq minutes sans que les parents y soient associés et sans que le sens et les raisons du placement soient expliqués, si ce n'est qu'il s'agit d'une alternative à l'incarcération. On dit au jeune : je ne te mets pas en prison, je te mets dans un foyer. On donne au placement non pas une dimension éducative, mais une dimension de sanction et cela crée de fortes tensions. On regroupe dans les foyers des jeunes ayant le même parcours, le même comportement. On ne cherche plus à créer des groupes sur lesquels on puisse travailler, composés de jeunes ayant des problématiques différentes. Ils vont s'identifier les uns aux autres et cela va générer des situations explosives.
A notre avis, il faut redonner au placement une dimension éducative et en expliquer les raisons. Le mineur délinquant est en danger dans sa famille et dans son environnement, mais il met en danger les autres. Tout cela doit être clairement dit et on ne doit pas instrumentaliser les lieux de placement de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. le président. Nous avons parlé des difficultés de recrutement. Ne pourrait-on améliorer la situation par d'autres moyens que le concours, la troisième voie ou les contrats ?
Mme Claude Beuzelin - Notre syndicat, depuis plus de vingt ans, est favorable à la troisième voie. Les professionnels acquièrent par l'expérience des connaissances qui doivent être valorisées. Toutefois, une formation est nécessaire. La validation des acquis ne doit en aucun cas la remettre en cause.
En revanche, nous sommes hostiles à l'embauche de contractuels. En tant que syndicat, nous sommes opposés à tous les emplois précaires dans la fonction publique et, malheureusement, il y en a beaucoup. Nous considérons que le métier d'éducateur s'apprend et nous sommes favorables à une formation avant la prise de fonctions.
M. le président - Quel jugement portez-vous sur la réforme des services éducatifs auprès des tribunaux ?
Mme Claude Beuzelin - Cette réforme s'est inscrite dans la réforme plus globale de la réorganisation des services de la PJJ.
Sur le fond, nous avons toujours été opposés à la création de services au sein des tribunaux, mais nous ne sommes pas opposés au fait que des éducateurs travaillent dans les tribunaux.
Nous estimons que tous les services doivent être en liaison directe avec les services départementaux et en cohérence avec la politique départementale.
Les SEAT ont été décidés et créés quatre ans ou cinq ans après l'abandon des services de liberté surveillée, alors que la réforme n'était pas encore entrée en application. Les services éducatifs auprès des tribunaux ont souvent enclenché les mêmes dynamiques que les anciens services de liberté surveillée.
Par ailleurs, il est essentiel, à nos yeux, qu'au sein du tribunal, des éducateurs assurent les missions dévolues à la permanence éducative, c'est-à-dire le recueil de renseignements socio-éducatifs, ou l'accueil dans le cadre du civil ou du pénal.
La présence d'éducateurs au sein du tribunal nous paraît importante. L'articulation entre l'éducatif et le judiciaire est essentielle. Cela suppose des échanges et des rencontres. Il faut aussi encourager la collaboration avec l'ensemble des services et avec les CAE, même si le tribunal reste un lieu central. Lorsque l'articulation fonctionne bien à ce niveau, elle peut rayonner. C'est la raison pour laquelle nous estimons nécessaire de maintenir des éducateurs, même s'il n'existe pas de service. Il s'agit en fait d'éducateurs rattachés à un CAE.
M. le rapporteur - Comment les 35 heures ont-elles été mises en oeuvre ?
Mme Claude Beuzelin - Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ne travaillent pas 35 heures. Lors des négociations qui ont eu lieu au ministère de la justice, les congés spécifiques de cette administration ont été remis en cause. Je parle bien des congés spécifiques et pas des congés annuels. Auparavant, tous les personnels bénéficiaient des mêmes congés. Avec les 35 heures, tout ou partie des congés spécifiques - la situation varie avec les services - ont été transformés en jours de RTT.
Néanmoins, on constate une diminution des heures de travail en hébergement, dans les services du milieu ouvert et dans les services éducatifs. Cela dit, la réduction du temps de travail ne s'est pas accompagnée d'une diminution de la charge de travail dans la mesure où la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé et de créer des emplois et d'alléger la charge de travail des services.
La mise en place des 35 heures a donc suscité beaucoup de désarroi et de mécontentement, voire d'écoeurement. Les personnels l'ont d'ailleurs manifesté par un mouvement de grève assez long. Aujourd'hui, on leur demande de travailler davantage dans un cadre horaire réduit, ce qui n'est pas propice au développement d'un climat serein.
M. le rapporteur - Lors des visites que nous avons effectuées dans les différents centres et tribunaux, nous avons constaté que l'exécution des mesures prononcées par les magistrats soulève des difficultés et exige parfois des délais très longs. Les mesures sont donc triées en fonction de priorités qui sont plus ou moins bien définies. Quel est votre sentiment sur ce point et comment pourrait-on améliorer cette situation ?
Mme Claude Beuzelin - En ce qui nous concerne, il n'y a pas de tri à faire. Lorsque des mesures sont en attente, cela signifie que la charge de travail des services est supérieure aux possibilités des personnels.
Nous pensons que la première mesure déposée doit être la première appliquée. Ce n'est pas aux personnels des services éducatifs de trier les mesures. Si un magistrat sait qu'un service est surchargé, c'est à lui que revient la responsabilité de ne pas lui envoyer de nouvelles mesures à traiter, car il sait qu'elles ne seront pas exécutées. Mais ce n'est pas toujours possible.
Nous sommes, je le répète, opposés à l'organisation d'un tri des mesures. Nous préconisons un renforcement des moyens des services pour éviter que des mesures restent en attente.
Les mesures en attente soulèvent une double question : l'exécution des décisions judiciaires d'une part et les conditions d'intervention des éducateurs d'autre part.
Lorsqu'elle intervient après un délai de deux ou trois mois, l'équipe éducative est confrontée à une situation qui s'est quelquefois beaucoup dégradée. Parfois, le sens même de l'intervention n'est plus bien perçu. Une décision judiciaire provoque une forte émotion chez les personnes intéressées. Trois ou quatre mois après, le sens de l'intervention est plus difficile à percevoir, il n'y a plus ni l'impact de la décision judiciaire, ni la parole du juge. Le temps qui s'écoule entre la décision et l'intervention de l'équipe éducative est bien évidemment très dommageable au suivi et à l'accompagnement du mineur et de sa famille.
M. le rapporteur - Cette situation est essentiellement due à un manque de places et de moyens humains. A combien évaluez-vous les besoins en personnels ?
Mme Claude Beuzelin - Selon nos évaluations, on recense environ 4.000 mesures en attente. Un éducateur suit en moyenne vingt mesures, je vous laisse le soin de faire le calcul. En outre, il faut tenir compte du fait qu'un éducateur intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des psychologues, des assistants sociaux.
Il convient également de renforcer d'autres secteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment ceux qui sont en charge de l'insertion professionnelle.
Il s'agit d'un aspect fondamental. Nous avons affaire à des jeunes qui sont bien souvent exclus et de l'école et des dispositifs de droit commun de formation en alternance, par exemple les trajets d'accès à l'emploi, les TRACE. Nous devons, pour les aider à reprendre pied dans des dispositifs classiques, travailler avec eux sur l'insertion et sur la question scolaire s'ils ont plus de seize ans. S'ils ont moins de seize ans, nous rappelons à l'Education nationale la nature de sa mission. Il convient donc de développer les capacités des centres de jour qui sont des lieux de prise en charge, d'insertion et de formation.
Dans ce domaine, des retards conséquents se sont accumulés. Les besoins sont très importants. La direction de la PJJ a décidé, cette année, d'en faire sa priorité. Mais les retards sont tels qu'il faudra des années pour les résorber.
S'agissant de l'hébergement, permettez-moi de souligner que, sur les trente-cinq créations de CPI annoncées, une vingtaine sont en fait des transformations de foyers d'action éducative, FAE, en CPI. Il n'y a donc pas trente-cinq structures nouvelles.
En outre, à côté des CPI et des CER, nous avons besoin d'autres formes de structures collectives d'hébergement : hébergement diversifié, placement familial, par exemple. Nous devons imaginer des modes d'hébergement, développer tout un ensemble de solutions.
M. le rapporteur - Quel jugement portez-vous sur les CPI et sur les CER d'une part, sur la création éventuelle de centres fermés d'autre part ?
Mme Claude Beuzelin - Nous avons demandé le renforcement des structures d'hébergement. En revanche, nous avons dénoncé, et cette critique est toujours d'actualité, la généralisation de l'éloignement et de la rupture prévue dans le cahier des charges de ces structures.
Il faut étendre les possibilités de placement sous contrôle judiciaire. Les jeunes sont soumis à une obligation de résidence. Il faut donc disposer des équipes nécessaires pour maintenir le jeune dans la structure. L'objectif recherché, c'est l'alternative à l'incarcération, l'accueil dans l'urgence.
Les CER n'assurent pas l'accueil immédiat. Ils organisent des prises en charge sur un temps très court et forment des groupes. La constitution de groupes crée une dynamique plus favorable au suivi des jeunes. Le travail est ainsi plus facile dans les CER qu'il ne l'est dans les CPI.
On envoie en priorité dans ces centres les jeunes qui ont commis des délits, qui troublent l'ordre public. On a spécialisé ces foyers dans l'accueil d'un public particulier. Aujourd'hui, la durée de la prise en charge est très courte, ce qui ne permet pas de construire une continuité éducative. Il s'agit là d'une difficulté majeure.
Ces foyers sont réputés accueillir les jeunes les plus difficiles, les plus « réitérants », les plus rétifs à l'éducation. On les a spécialisés à outrance en stigmatisant les jeunes. Dans ces foyers, la prise en charge est de trois mois, délai qui ne permet pas de résoudre tous les problèmes. En conséquence, il est souvent nécessaire de poursuivre la prise en charge en hébergement. On amorce la démarche, mais on s'aperçoit qu'on ne parvient pas à obtenir des placements dans le secteur habilité. Cette situation est due à la très forte stigmatisation de ces publics, stigmatisation qui est un facteur de rejet.
J'en viens aux centres fermés. En 1979, le ministre de la justice, Alain Peyrefitte, a décidé de supprimer les centres fermés, car ils généraient de la violence - entre les jeunes eux-mêmes et entre les jeunes et les adultes - et des caïdats. Ces centres n'avaient pas permis de réduire le nombre de mineurs incarcérés, et surtout, ils n'avaient en rien résolu leurs problèmes.
De nombreux personnels, qui sont toujours en activité, ont connu les centres fermés et les dégâts qui en sont résultés. Nous ne sommes pas les seuls à affirmer qu'une telle disposition est inefficace, vouée à l'impasse et à l'échec. En tout état de cause, ce n'est pas ainsi que l'on remédiera aux difficultés que connaissent les mineurs.
M. le rapporteur - La PJJ, comme d'autres institutions, connaît des difficultés. Quelles dispositions préconisez-vous pour y remédier ?
Mme Claude Beuzelin - Nos propositions sont multiples et je ne pourrai pas toutes les énumérer. Je n'en développerai qu'une. Cette institution doit retrouver son autonomie dans la mise en oeuvre des mesures éducatives. C'est fondamental.
La PJJ est chargée de mettre en oeuvre les décisions judiciaires. Il est indispensable de repenser et de redéfinir l'articulation entre le judiciaire et l'éducatif. Cette articulation est battue en brèche depuis plusieurs années. Elle est remise en cause par l'emballement de la machine judiciaire : multiplication des procédures, sollicitations et pressions exercées sur l'institution elle-même. Elle est aussi remise en cause par une volonté de visibilité et de rapidité qui s'oppose à la construction de projets éducatifs précis pour les mineurs.
On ne peut pas continuer à instrumentaliser cette institution, ses services et ses professionnels. Pour remplir pleinement sa mission éducative, elle doit disposer de moyens supplémentaires. Il est nécessaire de laisser aux services compétents la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures. C'est la seule garantie pour préserver la mission éducative de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. le président - Je vous remercie.
Audition de M. Jean-Louis DAUMAS,
directeur du centre pénitentiaire
de Caen
(15 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre pénitentiaire de Caen.
( M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment. )
Vous avez la parole.
M. Jean-Louis Daumas - Je vous remercie, messieurs les sénateurs, de recevoir un directeur de prison. Les occasions ne sont pas si fréquentes pour un professionnel de l'administration pénitentiaire de s'exprimer devant des parlementaires sur une question aussi délicate.
J'imagine que ma présence devant vous aujourd'hui ne s'explique pas par la fonction que j'occupe actuellement puisque le centre pénitentiaire de Caen, que j'ai l'honneur et la chance de diriger actuellement, est un établissement pour de très longues peines. En règle générale, il ne détient pas de détenus mineurs ni même de jeunes majeurs. Certains détenus ont pu commettre les actes qui les ont conduits en prison alors qu'ils étaient mineurs, mais leur nombre reste marginal.
En revanche, à trois reprises, avant cette fonction, j'ai croisé ou accompagné des mineurs qui étaient en grande difficulté.
De 1978 à 1985, j'ai travaillé dans un service de la protection judiciaire de la jeunesse dans les Hauts-de-Seine, à la Cité du Port de Gennevilliers, dans le service de milieu ouvert et d'hébergement situé à Villeneuve-la-Garenne, où j'ai eu la charge de mineurs délinquants, tantôt en milieu ouvert, tantôt en hébergement.
De 1989 à 1994, j'ai dirigé le centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, qui hébergeait à l'époque 420 jeunes garçons âgés de 13 à 20 ans, dont une centaine de mineurs de 13 à 18 ans.
Enfin, de 1994 à 1998, j'ai eu en charge la trop grosse maison d'arrêt de Loos dans le Nord, qui hébergeait 1 200 détenus pour 575 places théoriques. Il n'est pas inutile de le rappeler à des sénateurs, tout en soulignant l'aide importante que nous a apportée le rapport qui a été élaboré par vous-mêmes, messieurs les sénateurs. La maison d'arrêt comprenait également un quartier de jeunes garçons mineurs, dont l'effectif oscillait entre 20 et 30 en permanence.
Pendant ces trois périodes, j'ai eu l'occasion de travailler avec ces jeunes, soit en milieu ouvert, soit, plus souvent par la suite, en milieu fermé.
Aujourd'hui, la société civile dans son ensemble, ainsi que les hommes politiques qui la représentent, constatent que nous sommes dans la logique du tout ou rien au regard de ces mineurs. Au cours des récents débats télévisés, les prises de position d'un certain nombre de professionnels, dans les domaines tant de la justice, notamment des syndicats de magistrats, que de l'éducation ou de la protection judiciaire de la jeunesse, confortent ce constat.
La logique du tout ou rien, c'est le tout fermé ou le tout ouvert, autrement dit la prison sans l'éducation ou l'éducation sans la contrainte. Bien entendu, je ne veux pas dire que j'ai dirigé pendant cinq ans la plus grosse prison de jeunes de ce pays sans avoir tenté de faire de l'action éducative. Cependant, la logique du tout ou rien constitue bien la faille principale d'un système qui ne conçoit l'enfermement qu'en termes de contenant et de châtiment. Il ne prévoit l'éducation que si le mineur y adhère. Si ce dernier se soustrait à l'action éducative actée par le juge des enfants, de quels moyens d'éducation dispose-t-il ?
Je suis bien placé pour vous en parler. Certes, il y a une vingtaine d'années, les difficultés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'élu des Hauts-de-Seine ici présent connaît bien la situation. Quels étaient les moyens à l'époque pour exécuter une mesure de liberté surveillée présententielle, préjudicielle, une liberté surveillée après jugement, ou une simple mesure d'action éducative au bénéfice d'un mineur qui s'y soustrayait ? Je rendais compte au juge, provoquant un incident à la liberté surveillée, et le juge prononçait un ordre d'incarcération. Encore fallait-il d'ailleurs « mettre la main » sur le mineur, ce qui demandait parfois du temps, un certain nombre de jours, voire de semaines, pendant lesquels le mineur continuait de causer de graves préjudices à autrui ainsi qu'à lui-même. On ne le dit pas assez.
Aujourd'hui, il y a un peu plus de 800 mineurs dans les prisons françaises. Il n'y en a jamais eu autant.
Mon propos ici ne tend en aucune manière à minorer l'excellent travail, tout à fait indispensable et auquel j'ai participé, qui est conduit en milieu ouvert dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse ou au sein du secteur associatif habilité. Il s'agit non pas d'opposer le milieu fermé au milieu ouvert, mais de montrer que le travail qui est conduit en milieu ouvert ne se suffit pas à lui-même et que d'autres voies sont à envisager pour un certain nombre de jeunes en grande difficulté.
La question de fond est de savoir si le travail est possible avec un mineur au sein d'une institution contenante.
Hier soir encore, j'entendais à la télévision une juge des enfants, Mme de Maximy, vice-présidente d'une grande association, ainsi que des syndicalistes de la protection judiciaire de la jeunesse, dire en substance qu'au fond, la privation de liberté chez ces jeunes serait intrinsèquement criminogène et porteuse de désinsertion sociale. Ce serait aussi, selon eux, un obstacle à tout travail éducatif avec le jeune, c'est-à-dire à toute possibilité d'évolution pouvant le conduire à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des adultes.
Certes, ces avis ont été exprimés au cours d'interviews courtes ne permettant pas aux intervenants de les développer. Mais il me paraît tout de même un peu fort d'entendre des professionnels des milieux judiciaires ou de l'éducation dire : « On sait ce que les institutions contenantes ont produit par le passé. » Ce qui s'est produit dans le passé doit-il obérer ce qu'on pourrait construire de nouveau avec ces jeunes ? Oui, disent-ils, car la privation de liberté serait criminogène intrinsèquement. Je dirai à cet égard que c'est un lieu commun qui a été utilisé de la même manière au regard de détenus majeurs.
Pour ma part, je ne crois pas ce que soit la privation de liberté qui soit intrinsèquement criminogène. Comme vos collègues du Sénat et de l'Assemblée nationale l'ont indiqué dans deux rapports fort pertinents l'année dernière, je pense que ce sont plutôt les conditions de mise en oeuvre de la privation de liberté qui peuvent être criminogènes, a fortiori pour des mineurs, qui sont des personnes en devenir, en évolution. Ce qui est criminogène, à mon sens, c'est précisément de ne pas agir avec le mineur, de ne pas chercher à interrompre le processus de destruction à l'encontre de lui-même et des autres.
Lorsque d'autres pistes ont échoué, le temps contenant est une occasion privilégiée de faire avec le jeune une « révision de vie », c'est-à-dire d'engager avec lui un travail dynamique destiné à favoriser à terme l'intégration de la loi, c'est-à-dire le pacte social qui fait que nous pouvons vivre ensemble dans la paix civile et dans le respect de nos différences.
J'observe que ceux qui décrètent qu'une structure contenante empêcherait le travail dynamique ne se sont pas, ou rarement, donné la peine de venir constater en milieu fermé, comme vous l'avez fait vous-mêmes, messieurs les sénateurs, si ce travail dynamique est possible ou non. Ils se contentent de jeter des oukases, de rayer d'un trait de plume l'espace éducatif qui pourrait exister en prison.
Personnellement, je conteste cette approche ; je prétends même l'inverse, et je pense que le champ éducatif a tout à fait sa place dans un lieu contenant, sous réserve évidemment qu'un certain nombre de conditions soient remplies.
Il faut construire un système nouveau introduisant de la contention dans l'éducatif et de l'éducatif dans l'enfermement. Je ne crains pas d'utiliser ce mot d'enfermement, contrairement à certains. Actuellement, les structures éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas dans ce schéma, à l'exception de certaines d'entre elles qui se situent sur un versant un peu plus contenant. Je pense aux centres d'éducation renforcée, aux centres de placement immédiat, dont je respecte le travail. D'ailleurs, les professionnels de la justice et de l'éducation leur reconnaissent un certain nombre d'avancées significatives. Mais si le jeune se soustrait à la structure et s'il n'y a pas de contention, le travail éducatif est immédiatement malmené.
Inversement, dans les quartiers de mineurs en détention, l'encadrement humain de surveillants a été multiplié par trois depuis cinq ans par les gardes des sceaux successifs -M. Toubon d'abord, puis Mmes Guigou et Lebranchu- de manière à ne pas interrompre la prise en charge par les surveillants aux moments de grande tension, notamment les week-end et en fin de journée. Mais il ne s'agit pas là d'une présence éducative. Les surveillants qui assurent l'accompagnement de ces mineurs n'ont reçu qu'une formation complémentaire très modeste. Ils ne sont pas les interlocuteurs privilégiés du mineur.
De même, les travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire, notamment les conseillers d'insertion et de probation, n'interviennent pas de manière dynamique. Ils n'assurent pas un accompagnement quotidien, au plus près des mineurs. Je me souviens que, lorsque j'étais éducateur en préfecture, à la protection judiciaire de la jeunesse, il fallait assurer une présence éducative dès le réveil du gamin.
Nous sommes toujours, soit dans un système éducatif où la contention n'existe pas, soit dans un système de contention où le volet éducatif est insuffisant.
Comment peut-on avancer ? Le point qui est fondamental à mes yeux et qui doit constituer un signe fort en direction des hommes politiques est la nécessité d'introduire la mixité culturelle. Cessons de classer, d'un côté, ceux qui éduquent dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse et au sein du secteur associatif habilité et, de l'autre, ceux qui seraient le bras armé de la répression, y compris dans le cadre de l'ordonnance de 1945.
Le quotidien Le Monde a publié une synthèse d'une partie de vos travaux. Vous indiquez que l'ordonnance de 1945, qui a été toilettée plusieurs fois, n'empêche absolument pas le juge pénal d'ordonner des mesures répressives. Il n'y en a même jamais eu autant depuis quelques années.
Mais le problème réside tout de même bien dans l'absence de mixité culturelle, dans l'alternative unique « contention ou éducation. » La réponse n'est pas dans le développement exponentiel des quartiers de mineurs, comme certains le prônent. Elle n'est pas non plus dans le statu quo de structures strictement éducatives. Il importe de s'orienter vers des lieux qui soient adaptés à la contention des mineurs réputés les plus difficiles, les plus violents.
Je suis intimement convaincu qu'il reste une grande place pour effectuer un travail en milieu fermé, sans le faire au détriment du milieu ouvert. Mais, pour les jeunes les plus difficiles, les plus violents, les plus abîmés, en plus grande souffrance, il faut introduire la mixité culturelle dans les établissements, accompagner l'action pénitentiaire de celle de la protection judiciaire de la jeunesse, avec l'intervention de deux types de personnels, des surveillants et des éducateurs. Les surveillants n'ont pas à faire le travail de l'éducateur. Les éducateurs n'ont pas à faire le travail des surveillants. Il y a de la place pour les deux métiers. Ce sont deux métiers de la République. Dans son rapport sur l'état des prisons, le Sénat a commencé à battre en brèche les idées reçues, caricaturales et misérabilistes, sur le métier de la surveillance. A titre personnel, je vous en remercie.
Quelle forme juridique pourrait prendre cette mixité culturelle ? A l'heure actuelle, nous sommes engoncés dans les statuts. La fonction publique est éminemment protectrice pour ses salariés -je ne m'en plains évidemment pas. Cela étant, n'existe-t-il pas d'autres formes de gestion des ressources humaines, du recrutement, de la formation, du déroulement de carrière, afin de mobiliser des gens sur des projets de mixité culturelle ?
Il faudrait se creuser la tête. Nous ne sommes tout de même pas « condamnés », soit à travailler immuablement dans ce qui existe aujourd'hui, soit à faire table rase de l'existant.
Actuellement, les échafaudages de statuts, de filières, sont tels qu'on ne peut toucher à un seul morceau de l'édifice. Des structures éducatives ou contenantes, des quartiers des mineurs risquent de se trouver paralysés par des départs normaux en fin de carrière ou des absences pour motifs divers. Il ne s'agit pas de mettre à mal le statut de la fonction publique, les organisations syndicales s'y opposeraient. Il s'agit de chercher une façon de fédérer et de réunir les intervenants dans le cadre de la mixité culturelle.
Le législateur a inventé les groupements d'intérêt public, les GIP, voilà quelques années. Cette formule juridique est sous-utilisée. Ne pourrait-on imaginer que le législateur crée une agence dont le projet serait précisément la prise en charge des mineurs les plus difficiles ?
Pour quoi faire ? La mixité culturelle ne suffit pas. Le contenu relève des politiques publiques. Personnellement, je ne crains pas de vous dire que les politiques publiques sont insuffisamment mobilisées. Elles ne touchent pas seulement à la justice, aux services pénitentiaires et à la protection judiciaire de la jeunesse. Elles concernent aussi les services de santé. Ces mineurs nécessitent souvent des soins médicaux très lourds. Les collègues de la protection judiciaire de la jeunesse les désignent d'ailleurs sous l'expression un peu bizarre de « border line ». Je sais, pour les avoir fréquentés, que, si ce sont des délinquants, voire des criminels, ce sont aussi des individus en grande souffrance. C'est pourquoi il est impératif de mobiliser davantage les politiques de santé publique, et ce de manière plus directive. Quand l'Etat veut être directif, il sait l'être.
De même, il importe de mobiliser davantage les moyens de l'Education nationale et de la formation professionnelle. Vous avez parlé de discrimination positive suivant le schéma des zones d'éducation prioritaire. A cet égard, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas un technicien dans ce domaine.
Deux autres axes sont également tout à fait importants. L'un concerne les directions départementales de la jeunesse et des sports. Je pose la question suivante : que seraient les lieux contenants sans l'accès aux politiques publiques de la jeunesse et des sports ?
L'autre axe, auquel on ne pense généralement pas, a trait aux politiques d'accès à la culture. L'accès à la culture est une condition indispensable pour que les jeunes dont nous parlons puissent nous rejoindre.
Pour conclure sur le concept de mixité culturelle, j'indique que, depuis 1978, je n'ai eu de cesse, au service du ministère de la justice et de la République, de passer de l'éducatif à la contention. Lorsque j'ai intégré l'administration pénitentiaire, c'était comme si j'avais déclaré la guerre à mes collègues de la protection judiciaire de la jeunesse de Villeneuve-la-Garenne. A l'inverse, lorsqu'il m'arrive de louer auprès de mes collègues de l'administration pénitentiaire le réel travail accompli par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment par ceux qui contiennent les jeunes les plus difficiles -ce qu'on ne dit pas assez-, mes collègues me considèrent avec une moue de travers.
Il importe que les parlementaires fassent passer la mixité culturelle dans la réalité. Appelez ces structures comme vous voulez. Je ne veux pas employer des termes souvent empreints d'idéologie. Mais j'insiste sur la nécessité d'une prise en charge éducative de telles structures dès la première heure du matin, lorsque la porte de la chambre ou de la cellule s'ouvre. C'est une première condition de la mixité culturelle.
La deuxième consiste, je le répète, à mobiliser toutes les politiques publiques concernées.
Enfin, la question de savoir si le lieu de la mixité culturelle doit relever de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire en développant les prisons pour mineurs n'est pas mon propos. Il appartient au législateur de trancher en la matière. Je dis simplement qu'à l'heure actuelle, il y a une sous-utilisation de certains modes de gestion du service public. Nous n'en avons qu'une version verticale, cloisonnée et compartimentée. Un GIP, une agence, un établissement public pourraient créer des établissements spécifiquement habilités à prendre en charge les mineurs auteurs des infractions les plus graves.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je reviens sur le concept de mixité culturelle. Lors de ses différentes visites sur le terrain, la commission d'enquête a effectivement constaté la multiplicité des acteurs, ainsi qu'un manque de coordination. Qui pourrait être en quelque sorte le pilote ou bien le fil rouge dans ce concept ? Pour mobiliser, il faut qu'il y ait un chef, un pilote, quelqu'un qui coordonne l'ensemble.
M. Jean-Louis Daumas - Si vous parlez de pilotage de politiques publiques au niveau national, je vous ai déjà répondu en partie. On pourrait très bien imaginer la création d'une structure, d'un établissement public, d'un GIP, dont le responsable serait nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. De quelle culture le responsable doit-il venir ? C'est difficile à déterminer.
Si vous choisissez des structures contenantes, à mon avis il est impératif que le pilote soit issu de l'administration pénitentiaire. J'ajoute, non pas pour me dérober mais parce que je crois à la mixité culturelle, qu'il faut prévoir un copilote. En effet, pourquoi faudrait-il toujours choisir les uns au détriment des autres ? Pourquoi retomber dans le schéma classique « ou l'un ou l'autre » ?
Votre question, qui me prend un peu au dépourvu, illustre bien la situation que j'ai évoquée dans mon intervention : pourquoi faut-il choisir de manière aussi brutale ? Vous savez peut-être que, depuis quelques années, certains directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont plus issus de la filière éducative. Ils sont deux ou trois à venir de l'administration pénitentiaire, et je crois savoir que cela ne se passe pas plus mal. On pourrait imaginer aussi que des directeurs de prison soient issus de la filière éducative. Je viens moi-même de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. le rapporteur - Vous venez d'utiliser les termes de « structure contenante ». Que pensez-vous des projets de centres fermés qui sont souvent évoqués ?
M. Jean-Louis Daumas - J'observe d'abord que les centres fermés existent déjà. Il s'agit des centres éducatifs renforcés, les CER, et des centres de placement immédiat, les CPI. Certains fonctionnent bien, d'autres moins bien, même s'ils sont très peu fermés.
Je me demande si ces « lieux » -je cherche le terme approprié pour ne pas choquer- sont toujours pensés correctement pour contenir les jeunes concernés. En effet, si l'on veut contenir ces jeunes, il faut envisager les moyens non seulement humains, mais aussi physiques. Très récemment, un reportage télévisé sur un CER abordait le problème de la fugue des jeunes qui se soustraient à l'action éducative. Il faut appeler un chat un chat. Si les centres ont vocation à être fermés, alors ils sont fermés. Ce sont des lieux contenants, des quartiers mineurs d'établissements pénitentiaires, avec des garanties éducatives. Vous ne me ferez pas bouger d'un centimètre sur ce point.
Personnellement, je suis plutôt pour des structures qui dépendraient de l'administration pénitentiaire, avec une filière éducative qui serait beaucoup plus représentée qu'elle ne l'est actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans les demi-mesures à tel point que l'on peut se demander si nous ne conduisons pas des politiques par défaut. Ces centres sont-ils aussi fermés que vous voulez bien le dire ?
D'autre part, soyons pragmatiques. Vous croyez à des politiques publiques. Pour connaître les deux institutions de la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire, je suis en mesure de vous dire que, hormis les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires, vous ne trouverez pas dans ce pays des structures susceptibles d'être équipées ou outillées correctement dans un délai raisonnable pour accueillir ces jeunes.
Donc, ne nous berçons pas d'illusions. La création de centres éducatifs renforcés ou fermés va prendre au bas mot dix-huit mois ou deux ans. Mme Guigou avait ordonné la mise en route d'un programme de 4 000 places de prison supplémentaires. Je peux vous dire que l'on n'en voit pas la couleur pour l'instant. Regardons donc la vérité en face et continuons à poursuivre le travail de ressources humaines qui a été enclenché dans les quartiers des mineurs pour empêcher le retour de la barbarie que des juges de l'application des peines et des professionnels de la justice ont dénoncée à Fleury-Mérogis, voilà quatre ans. A l'époque, les jeunes se faisaient taillader sur les cours de promenade ou dans certains lieux coupe-gorge.
Les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale ont réclamé des quartiers des mineurs qui ne soient pas une « humiliation pour la République », mais bien des quartiers des mineurs détenus dans le respect des principes de la Déclaration des droits de l'homme.
Il faut donc qu'ensemble, nous y mettions les moyens en ressources humaines avec le souci constant de la mixité culturelle. Aujourd'hui, les surveillants exerçant dans les quartiers des mineurs sont des fonctionnaires admirables, qui travaillent avec des jeunes en grande souffrance, qui sont confrontés à la violence verbale, à un rapport de force permanent. C'est en mettant, en face de ces jeunes, des acteurs déterminés, des hommes « debout », qui présentent un certain nombre de garanties, que l'on parvient à contenir ces jeunes. Mais il faut aussi amener la mixité culturelle.
Donc, je le répète, pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, je ne crois pas, contrairement à l'avis d'une partie de la classe politique, que les centres fermés puissent devenir opérationnels dans un délai qui soit raisonnable aux yeux de nos concitoyens.
Vous avez des outils législatifs à votre disposition.
Peut-être une loi de finances rectificative constituerait-elle une voie rapide pour faire en sorte que les efforts qui ont été développés dans les quartiers des mineurs soient poursuivis ?
Peut-être faudrait-il se donner les moyens de reprendre le projet de loi pénitentiaire qui est dans les cartons ? Une première lecture avait été envisagée au Sénat. Ce texte pourrait comporter un volet pour les mineurs. Il y a là un débat politique majeur.
Par ailleurs, on dit manquer de places. Mais j'observe que les prisons françaises comptent tout de même 800 gamins. Y a-t-il une vocation à en avoir davantage ? Je l'ignore. Interrogez les magistrats.
Mais, d'ores et déjà, attelez-vous à la mixité culturelle, car l'essentiel des critiques de nos concitoyens porte sur le « ou tout l'un, ou tout l'autre », et c'est de cela qu'il faut précisément sortir.
M. Bernard Plasait - Votre idée d'une prison pour mineurs, qui serait différente des structures que nous connaissons à l'heure actuelle et qui n'opposerait pas les surveillants et les éducateurs, mais assurerait au contraire la mixité, me paraît tout à fait intéressante à étudier.
Chacun voudrait à la fois améliorer les conditions de détention, notamment en réduisant la promiscuité, et imaginer une prison idéale. Dans le système actuel, il y a, d'un côté, la prison qui assure la punition et la contention, de l'autre, le traitement en milieu ouvert qui, à certains moments, se révèle insatisfaisant puisqu'il faudrait pouvoir contenir, isoler, enfermer.
Il ressort d'un certain nombre d'auditions effectuées par la commission d'enquête que, si la prison comme ultime recours est nécessaire, elle présente sans doute l'inconvénient du manque de souplesse. Le magistrat condamne pour un temps donné à la prison. Par ailleurs, le milieu ouvert ne permet pas la contention. D'où l'idée d'un centre semi-fermé qui a été exposée devant notre commission d'enquête. Il s'agit d'un système souple fondé sur la possibilité d'effectuer des allers et retours entre la filière éducative et, lorsque c'est nécessaire, l'enfermement pour un temps donné, lequel peut être cassé plus facilement qu'une condamnation à la prison afin de retourner en milieu plus ouvert.
Cette idée de souplesse vous paraît-elle bonne et réalisable ? Dans une telle hypothèse, l'enfermement relèverait-il de l'administration pénitentiaire ?
M. Jean-Louis Daumas - Cette souplesse me semble évidemment tout à fait pertinente. Elle me rappelle le dispositif que le législateur a inventé voilà quelques années. Fondé sur le principe de l'ajournement de la peine, il prévoit que la juridiction, qui convoque un majeur ou un mineur pour un délit, ne se prononce pas sur le fond, mais fixe rendez-vous quelques mois plus tard au prévenu, à charge pour ce dernier de faire ses preuves d'ici là. Vous voyez bien l'intérêt de la souplesse qui est encore plus grand chez une personne en devenir. Les choses ne sont pas figées. Nous touchons ici à la définition de l'éducation, c'est-à-dire essentiellement de la souplesse, du mouvement et de la dynamique.
Cela étant, ne nous privons pas de ce qui existe. Notre pays souffre de la maladie de l'empilement des textes. Il crée de l'outil législatif sans l'utiliser, sans voir qu'il existe déjà.
Je serai concret : les centres de semi-liberté ont plus de cinquante ans. Ils sont sous-utilisés. Pourquoi les mineurs n'y ont-ils pas accès ? Rien ne l'interdit dans la loi. Outre la souplesse, ils présentent l'intérêt non négligeable de leur petite taille et de leur effectif réduit. Je vous invite à visiter le centre de semi-liberté d'Haubourdin, dans l'agglomération lilloise. Il s'agit d'un établissement pénitentiaire qui compte 30 places. Il se prête très bien à la mixité culturelle. Pourquoi n'y aurait-il pas dans ce lieu une présence éducative de la protection judiciaire de la jeunesse à côté de celle des surveillants ? Je voudrais qu'on m'explique le tabou idéologique qui s'y opposerait.
Par ailleurs, la création des centres pour peines aménagées, les CPA, qui constituent une nouvelle catégorie de prison, vient d'être publiée au Journal officiel. Ces centres relèvent de l'administration pénitentiaire. Ils ont été créés pour des courtes peines pour les majeurs. On pourrait très bien en faire bénéficier les mineurs qui sont condamnés la plupart du temps à des peines courtes.
Le chef d'orchestre, vous l'avez : c'est le juge de l'application des peines, qui est compétent à l'égard des mineurs. Les formules existent, qu'il s'agisse de la semi-liberté, de l'obligation de remplir un travail d'intérêt général, de l'éventuelle suspension ou du fractionnement des peines, ou bien des permissions de sortir.
Pourquoi chercher ailleurs ce qui existe déjà dans notre arsenal législatif ? Pourquoi refaire travailler le législateur ? Il suffirait que le garde des sceaux donne une orientation de politique pénale aux parquets généraux en leur recommandant d'utiliser plus complètement les centres de semi-liberté ou les CPA. Il n'y a que deux CPA sur le territoire, mais peut-être est-ce une bonne formule ? Ni le code pénal ni le code de procédure pénale n'indiquent que tous ces outils ne doivent pas être utilisés à l'égard des mineurs. S'il suffit de toiletter les dispositifs, ce n'est pas le plus compliqué.
M. le rapporteur - On ne peut pas utiliser ces aménagements pour les jeunes qui sont en détention provisoire et qui représentent 80 % des jeunes incarcérés.
M. Jean-Louis Daumas - C'est vrai. Mais la détention dite provisoire a tendance à être de moins en moins provisoire dans notre pays.
Cela étant, la détention provisoire ne permet pas d'introduire de souplesse, à moins que le juge d'instruction ou le juge des enfants ne décide, si l'infraction est correctionnelle, de suspendre l'incarcération provisoire. Mais, dans ce cas, quelles garanties la société a-t-elle ? Où le gamin va-t-il aller ? Il n'ira pas dans un CPA ni dans un centre de semi-liberté puisque la détention provisoire aura été suspendue.
Sur ce point, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Mais je constate que les mineurs condamnés sont de plus en plus nombreux. Vous dites, monsieur le rapporteur, qu'il y a seulement 20 % de condamnés mineurs en France. Ce pourcentage est tout de même beaucoup plus élevé qu'il y a dix ans.
Pour les jeunes qui sont condamnés, je le répète, il y a deux outils qui sont notoirement sous-utilisés, les centres de semi-liberté et les nouveaux CPA. Les centres éducatifs fermés ne sont pas pour demain. C'est ce qui apparaîtra quand le garde des sceaux devra rentrer dans une politique d'acquisition foncière et de construction de ces centres.
Ne nous privons pas d'outils que la République possède déjà. Ne soyons pas aveugles. Je vous souffle la piste des centres de semi-liberté et des mesures pénales existantes qui sont sous-utilisées à l'égard des mineurs, comme si on répugnait à leur appliquer les dispositions du code pénal. Mais en quoi le code pénal serait-il un outil déstructurant au regard de ces mineurs ? La semi-liberté, la libération conditionnelle, le chantier extérieur, ne sont-ils pas des mesures éducatives ? Que sont-ils alors ?
M. le rapporteur - Comment est assurée la continuité de l'action éducative à la sortie de prison ? Le passage du témoin entre les travailleurs sociaux pénitentiaires et la protection judiciaire de la jeunesse se passe-t-il dans de bonnes conditions ? Y a-t-il des améliorations à apporter dans ce domaine ?
M. Jean-Louis Daumas - Là encore, le succès des politiques publiques dépend souvent de la qualité des acteurs et de leur bonne volonté réciproque à travailler ensemble. Entre les services départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux de l'administration pénitentiaire, je considère, pour ma part, que cela ne se passe pas si mal.
Il faudrait institutionnaliser les commissions départementales de suivi de l'incarcération du mineur que j'ai mises en place avec mes collègues à Fleury-Mérogis en 1990. Elles sont destinées à réunir autour d'une même table les travailleurs sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux de la prison, le juge des enfants et le juge de l'application des peines quand le mineur est condamné, ainsi que l'administration pénitentiaire incarnée par les surveillants chargés des quartiers des mineurs. Ces commissions fonctionnent dans tous les lieux comprenant des quartiers des mineurs, à condition de veiller à leur bon fonctionnement.
S'agissant du suivi en milieu ouvert, la plupart des mesures exécutées par les travailleurs sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenant des dispositions pénales. Les mesures de liberté surveillée, voire de contrôle judiciaire se substituent progressivement aux mesures civiles d'action éducative en milieu ouvert, l'AEMO. Je n'ai donc pas de photographie sur le suivi des mesures après la détention. Le suivi repose largement sur la volonté des deux administrations à travailler ensemble.
M. le président - Merci, monsieur le directeur. Vos propos étaient tout à fait intéressants.
Audition de M. Serge TISSERON,
psychologue
(15 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons à présent entendre M. Serge Tisseron, psychologue, auteur d'un ouvrage intitulé « Enfants sous influence. Les écrans rendent-ils les jeunes violents » ?
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. Serge Tisseron - Les relations qui peuvent exister entre les images de violence et les comportements violents, notamment la délinquance des mineurs et des adolescents, est une question cruciale.
Je suis également directeur de recherche à Paris X, mais c'est en tant que psychiatre et psychanalyste que je me suis intéressé à cette question, notamment en remarquant le grand désarroi que pouvaient manifester des enfants, des adolescents, voire des adultes, par rapport à des images qui les avaient bousculés, malmenés.
Dans ce travail avec des enfants et des adultes en consultation individuelle, il m'est apparu que ces bouleversements étaient liés très souvent à l'histoire personnelle des patients. J'ai longtemps privilégié la relation entre le choc provoqué par les médias violents et l'histoire personnelle avec l'environnement proche.
Puis cette approche s'est révélée insuffisante dans la mesure où j'ai pu constater, lors de faits divers, que les jeunes, qui se réclament d'images, adoptent des comportements violents en groupe en général. Il m'a donc paru extrêmement important de compléter cette première approche clinique individuelle par une approche plus collective, plus sociologique, qui a fait l'objet d'un soutien des ministères de la famille, de l'Education nationale et de la culture.
Grâce à ces trois ministères, j'ai pu mener une recherche sur une période de trois ans, de 1997 à 2000, dans la banlieue sud de Paris, sur des enfants appartenant aux couches socioprofessionnelles représentatives de la situation en France.
J'ai choisi des enfants de onze à treize ans parce qu'il me semble que c'est un âge charnière où les enfants parlent facilement des images. C'est en même temps un âge où ils ont quitté la petite enfance, où ils ont acquis une autonomie et où leurs comportements de groupe sont très importants.
Je vous ferai part rapidement des résultats de cette recherche, puis de mes réflexions sur les conséquences à en tirer quant à la politique qui pourrait être menée en matière d'images et de délinquance des mineurs.
Les résultats de cette recherche comportent deux aspects : le premier tend à observer les réactions individuelles des enfants face aux images violentes. Après avoir montré des images violentes ou neutres à des enfants, chacun d'eux était pris en entretien individuel. Le second aspect est consacré aux réponses de groupe face à la violence des images.
Les résultats individuels ont montré que les enfants qui ont vu des images violentes ont des émotions très nombreuses et très déplaisantes.
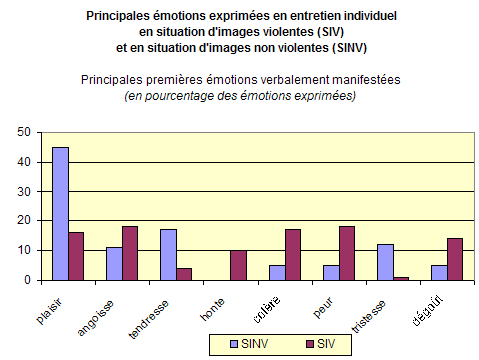
Ce transparent illustre le fait qu'en situation d'image non violente, les enfants éprouvent surtout du plaisir, alors qu'en situation d'image violente, ce sont les émotions désagréables qui priment, telles que l'angoisse, la peur, la colère ou le dégoût.
Les enfants qui ont vu des images violentes ne se contentent pas de rester sous l'effet du choc. Dès qu'on leur propose un interlocuteur, ils s'efforcent d'utiliser ce dernier pour « retomber sur leurs pieds », autrement dit pour retrouver leurs repères.
L'étude des moyens qu'ils utilisent pour « retomber sur leurs pieds » est intéressante, car elle permet de tirer des conclusions importantes sur ce que pourrait être une politique d'éducation aux médias. Ces moyens sont au nombre de trois :
- Un certain nombre d'enfants se mettent à parler et se révèlent beaucoup plus bavards quand on leur montre des images violentes que lorsqu'ils voient des images neutres.
- D'autres enfants se construisent un petit scénario intérieur. Ils ne vont pas forcément en dire grand chose, mais on peut repérer ce petit scénario intérieur si on les invite à dessiner, à photographier ou à construire eux-mêmes des images. Dans le petit scénario qu'ils mettent en scène, ils imaginent que les images qu'ils ont vues auraient pu se dérouler autrement et même, s'ils avaient été confrontés aux mêmes situations, qu'ils auraient pu agir autrement.
- Enfin, certains enfants ne parlent pratiquement pas de ce qu'ils ont vu, ne s'imaginent pas un scénario intérieur. En revanche, ils ont des manifestations non verbales. Ils bougent, s'agitent sur leur siège et prennent des mimiques. Il est très important de remarquer que ces enfants ont besoin de passer d'abord par des manifestations corporelles qui seront acceptées par un interlocuteur pour pouvoir ensuite commencer à parler de l'impact des images sur eux.
La première idée importante à distinguer, c'est que les images violentes provoquent un stress émotionnel. Ce stress émotionnel ne provoque pas forcément un traumatisme, à condition que l'enfant puisse être invité à gérer ce qui se passe en lui.
Quant aux résultats collectifs, ils montrent qu'il y a une très grande différence entre les garçons et les filles. Cette différence, qui nous met sur la voie pour mesurer l'importance de l'impact des images sur la dynamique des groupes, apparaît sur le second transparent, « Première représentation d'actes exprimée en fonction du sexe ».
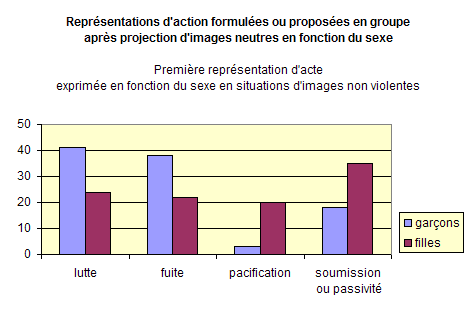
Il n'y a aucune différence entre les représentations d'action proposées par les garçons et les filles en situation d'images violentes.
Les filles ont eu des attitudes différentes de celles des garçons tout au long de la recherche.
Première différence importante, elles parlent beaucoup plus que les garçons lorsqu'elles ont vu des images violentes, ce qui n'étonne pas, car elles ont une plus grande aptitude au langage à onze-treize ans que les garçons. Cependant, elles n'utilisent cette aptitude au langage que s'il y a une nécessité. Le stress des images violentes produit cette nécessité.
Deuxième différence importante, les filles attendent beaucoup plus du groupe, dont elles utilisent davantage les possibilités que les garçons. C'est normal : encore une fois, elles utilisent mieux et plus le langage que les garçons. Dès lors, si elles sont en groupe, elles vont se précipiter sur leurs copines ou leurs copains pour échanger leurs impressions sur les images vues et elles retombent donc sur leurs pieds par le langage.
Troisième différence importante, si on montre des images non violentes à des garçons et à des filles de onze-treize ans et qu'on invite ensuite le groupe à imaginer des scénarios pour des jeux de rôles qu'ils représenteront comme au théâtre, on s'aperçoit que les filles proposent beaucoup plus de scénarios de pacification et de soumission ou de passivité alors que les garçons proposent beaucoup plus de scénarios de lutte et de fuite.
Il est très important de noter que cette situation ne se retrouve que lorsque les images proposées aux enfants sont des images non violentes. Lorsqu'il s'agit d'images violentes, la distinction s'efface complètement : on constate alors que garçons et filles proposent le même nombre de scénarios de lutte et de fuite.
Comment interpréter les résultats de cette recherche sur les comportements collectifs des garçons et des filles ?
Cette recherche fait apparaître que les attitudes de pacification - attitudes diplomatiques, tendance à chercher des compromis et à arrondir les angles ... - ne sont pas innées chez les filles de onze-treize ans. Ce sont des attitudes apprises, auxquelles elles renoncent sous l'effet du stress des images violentes.
Cela met en évidence un très grave problème : les images violentes conduisent les groupes d'enfants - et peut-être aussi d'adultes - à organiser leurs relations de telle façon que les éléments potentiellement pacificateurs renoncent à leur aptitude pacificatrice et serrent leurs liens avec les autres membres du groupe afin que les leaders émotionnels, ceux qui sont toujours partisans des comportements les plus violents, des agressions ou des attitudes d'attaque, aient le champ libre.
En résumé, cette recherche montre donc que les images violentes malmènent les enfants, qu'elles provoquent chez eux un stress émotionnel et qu'ils ont besoin d'interlocuteurs pour gérer ce stress. En outre, elle ne tranche pas la question de savoir si les images violentes engagent les groupes à adopter des comportements violents mais elle révèle en tout cas que, si tel était le cas, les éléments modérateurs, qui existent dans tout groupe, renonceraient à leur rôle modérateur sous l'effet des images violentes.
Il me paraît important de tirer les conséquences de ces résultats, notamment au regard des politiques de prévention.
Je préciserai d'abord que cette recherche est très différente de la recherche, dont on parle beaucoup ces derniers temps, menée aux Etats-Unis par Creg Anderson.
Ce dernier a suivi pendant dix-sept ans des enfants et montré que ceux qui avaient été les plus grands consommateurs de télévision - plus de quatre heures par jour - devenaient des adolescents puis des adultes davantage portés à résoudre les problèmes de la vie quotidienne en recourant à des comportements violents.
Cette recherche est importante parce que c'est la première fois que des enfants sont suivis sur dix-sept ans. C'est aussi la première recherche à sortir de son champ des paramètres qui n'avaient jamais été isolés auparavant : elle est uniquement axée sur des enfants blancs et elle sort aussi l'influence du milieu socioprofessionnel comme l'influence éventuelle de la séparation des couples, de la séparation des enfants de leurs parents ou des violences familiales. C'est donc une recherche tout à fait crédible.
Cependant, elle soulève beaucoup de problèmes parce qu'elle ne dit pas, premièrement, pourquoi certains enfants regardent plus que d'autres la télévision, deuxièmement, pourquoi, parmi les enfants qui regardent plus que d'autres la télévision, certains seulement deviendront plus violents.
Je veux attirer votre attention sur le fait que la recherche personnelle que j'ai menée entre 1997 et 2000 permet de poser des repères parce qu'elle permet de comprendre comment on passe du choc émotionnel aux comportements violents.
Quand un enfant stressé émotionnellement s'engagera-t-il éventuellement dans des comportements violents ? Quand il n'aura pas trouvé d'interlocuteur pour mettre des mots, des gestes ou, s'il est petit, des dessins sur l'impact émotionnel qu'ont eu sur lui les images.
A partir de ma recherche comme de celle de Creg Anderson, on peut envisager deux politiques tout à fait différentes de prévention de l'impact des images violentes sur les enfants et sur les adolescents.
La première de ces politiques consiste à réduire l'impact des images violentes en réduisant, tout simplement, leur consommation.
On peut autoritairement imposer dans les familles que les enfants ne regardent pas la télévision plus d'une heure. Cela paraît cependant assez utopique. Nombre d'enfants rentrent de l'école avant que leurs parents ne rentrent eux-mêmes et ils allument la télévision ; nombre de parents laissent l'enfant regarder la télévision tout simplement parce que l'appartement est trop petit pour que l'enfant puisse être envoyé dans sa chambre ; peut-être l'enfant a-t-il de toute façon sa propre télévision dans sa chambre...
On peut décider de réduire la violence dans les programmes télévisuels, mais vous savez comme moi que nous sommes dans une société libérale et, quand bien même une telle décision serait prise, encore faudrait-il prévoir quelles peines infliger aux chaînes qui transgresseraient la règle. Aujourd'hui, les consignes du CSA, y compris pour les programmes en prime time, ne sont pas respectées et le CSA est d'autant plus démuni que les chaînes peuvent facilement amortir les amendes avec des écrans publicitaires.
Réduire la consommation d'images violentes est évidemment une réponse possible, mais elle est difficile à organiser.
Reste une autre réponse : permettre aux enfants qui voient des images violentes, notamment à la télévision, de porter un regard différent sur ces images et sur ce qu'ils éprouvent face à ces images, c'est-à-dire leur permettre de prendre de la distance par rapport à ces images.
La recherche que j'ai menée à fait ressortir un élément important : les enfants et les adolescents ont spontanément le désir de prendre cette distance. Ils en ont le désir parce que les images violentes les malmènent beaucoup. Quand ils sont en groupe invités à imiter les images violentes qu'ils ont vues, ce n'est jamais la recherche du plaisir qui les engagent à le faire : ce sont d'abord le stress, l'angoisse, la colère, le dégoût.
Les enfants demandent à être aidés pour gérer leur stress émotionnel. J'en vois la preuve dans l'extraordinaire succès que remportent aujourd'hui les making off, qui expliquent comment les images sont faites. Je dis d'ailleurs depuis vingt ans que chaînes de télévision et publicitaires devraient fabriquer des making off sur les feuilletons et les publicités télévisés. Les enfants ont une grande curiosité dans ce domaine.
Un enfant angoissé, terrorisé par des images ne se demande pas, surtout s'il est petit, ce que le réalisateur a voulu dire. Il se demande comment les images ont été faites, et quand il grandit et devient adolescent, il continue à se poser la même question.
Aujourd'hui, les making off ne sont pas fabriqués par les chaînes publiques, à la demande de l'Etat et dans un but d'éducation aux médias ; ils sont fabriqués par les marchands d'images parce qu'il y a une demande des enfants et des adolescents, et, si vous achetez Gladiator ou Buffy et les vampires en DVD, vous trouverez un making off.
On tient donc là, grâce à la recherche dont j'ai parlé, une voie importante. Les enfants ne sont pas démunis de moyens pour gérer le stress émotionnel des images et pour éviter que ce stress émotionnel ne les engage dans des comportements délinquants de groupe, mais il faut les aider.
Il faut les aider en leur proposant des interlocuteurs, dans la famille, dans l'Education nationale, dans le secteur associatif, puis en leur permettant d'utiliser les moyens dont les uns et les autres disposent spontanément.
Certains ont besoin de passer par les mots. Les interlocuteurs devront parler avec eux, leur demander comment ils ont reçu les images et ce qu'ils ont éprouvé, partir des émotions.
Les interlocuteurs devront également les inviter à fabriquer leurs images.
Heureusement, il y a depuis quelques années des enseignants de base sensibles à la question : ils essaient de fabriquer des images avec les enfants pour leur permettre de gérer l'impact émotionnel des images qu'ils voient à la télévision, au cinéma ou sur les panneaux publicitaires.
Certains enfants ayant besoin de passer par le jeu, par les mimiques, par le corps, il faudrait aussi prévoir des lieux - secteur associatif, Education nationale - dans lesquels des adultes inviteraient les enfants qui en ont besoin à jouer ce qu'ils ont vécu. Les enfants pourraient alors mieux se fabriquer leurs petits scénarios personnels, commenceraient à mieux parler et à prendre de la distance par rapport aux images.
Nous sommes à un moment crucial : l'ensemble des chercheurs reconnaît aujourd'hui que les images violentes ont un impact sur la violence des jeunes mais, dans le domaine de l'éducation aux médias, tout reste à faire. Il est donc urgent à mon avis que le politique impose des décisions.
Il faut que les chaînes de télévision fabriquent des making off, qui soient mis à la disposition des enseignants, et il devrait y avoir des émissions de télévision d'éducation aux médias.
Il faut que l'Education nationale organise l'éducation aux médias à partir non pas des oeuvres d'art mais des images qui se présentent spontanément aux jeunes dans la vie. Les jeunes n'ont pas envie de comprendre comment Léonard de Vinci a fabriqué la Joconde. Ils veulent savoir comment a été fabriquée la dernière pub pour Levi's, qui est en effet « vachement » impressionnante : on voit un garçon et une fille courir et traverser des murs.
Il faut donc que l'éducation aux médias dans le cadre de l'Education nationale s'inspire des images que les enfants voient tous les jours.
Puis, il faut évidemment engager les parents à s'intéresser beaucoup plus à ce qui intéresse leurs enfants et à dialoguer avec eux davantage qu'ils ne le font aujourd'hui.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous dites qu'il est nécessaire pour les enfants de prendre du recul par rapport aux images violentes qu'ils reçoivent, ce qui implique qu'elles leur soient expliquées. Ce devrait en effet être le rôle de la famille, mais, très souvent, celle-ci est défaillante dans ce domaine.
Reste donc l'Education nationale, à laquelle on demande déjà beaucoup. Comment vos propositions peuvent-elles se décliner dans son cadre ?
M. Serge Tisseron - L'éducation aux médias devrait être organisée par des personnes spécialement formées, qui pourraient être issues non seulement du milieu de l'Education nationale elle-même mais aussi du secteur associatif. Il n'est en tout cas pas question de demander aux enseignants en poste, qui ont la vocation de pédagogue, d'organiser l'éducation aux médias.
Première raison, cela ne correspond pas à la vocation de la plupart d'entre eux. Deuxième raison - mais, heureusement, les choses changent -, les personnes qui se destinaient à l'Education nationale avaient traditionnellement une relation privilégiée au langage et à la transmission par le langage. En général, ils n'aimaient pas les images. Or, on ne peut demander à des partisans du langage et à des adversaires de l'image de dispenser l'éducation aux médias. Ce serait « casse-gueule » à tout coup.
Je dis que les choses changent. En effet, de plus en plus de jeunes profs jouent aux jeux vidéo. Ils ont grandi dans une autre culture et leur relation aux images est différente. Il faudra cependant de vingt-cinq à trente ans pour que les choses aient suffisamment changé, pour qu'il soit envisageable que des enseignants dont la vocation est l'Education nationale s'engagent éventuellement dans l'éducation aux médias.
Il faut donc un personnel différent, spécialement formé à ces questions et sensible aux trois aspects sous lesquels le stress émotionnel des images est géré par les enfants.
Ce personnel devra donc être sensible à l'utilisation du langage mais aussi à l'utilisation des images. Il devra pouvoir inviter les jeunes à fabriquer des images, notamment avec des appareils numériques, lesquels ne coûtent plus très cher et permettent de se passer de pellicule, avec des logiciels de traitement d'images ou avec du papier collé, le travail avec le papier collé apprenant énormément sur la fabrication des images.
Il devra en outre être sensibilisé à la dynamique de groupe puisqu'il y a malheureusement des enfants qui ne peuvent commencer à parler des images que si on leur laisse d'abord la liberté de bouger, de se passer la main dans les cheveux, de rouler des mécaniques comme le cacique ou le héros du film, de se donner pour jouer des bourrades comme les personnages du film. Ces enfants aussi doivent avoir la chance de gérer le stress émotionnel lié aux images.
Pour ces deux grandes raisons -d'une part, la nécessité d'une triple formation pour sensibiliser à l'utilisation du langage, à la création des images et aux jeux de rôles, d'autre part, le fait que le personnel enseignant actuel ait surtout une vocation éducative- il faut, à mon avis, un personnel formé dans un secteur autonome.
L'Education nationale a en revanche une particularité exceptionnelle : elle touche tous les enfants.
L'éducation aux médias devrait donc être faite dans les locaux de l'Education nationale et à des horaires intégrés dans son planning, ce qui l'obligerait à accepter que des personnes formées dans une autre filière - qui ne lui échapperait d'ailleurs pas nécessairement mais qui serait parallèle à l'actuelle filière des maîtres - interviennent dans son cadre.
Un tel système devrait en tout cas être mis en place à l'essai dans des endroits réputés difficiles.
Dans mon ouvrage « Enfants sous influence. Les écrans rendent-ils les jeunes violents ? », je proposais même que, dans les secteurs où les images semblent être souvent reprises par des bandes qui s'en réclament, de véritables sas soient instaurés dans les établissements scolaires.
Dans certaines banlieues, les parents partent au travail à six heures du matin. Ils lèvent auparavant leurs enfants ou ceux-ci se réveillent parce qu'ils entendent du bruit. Les enfants prennent leur petit déjeuner, puis que font-ils jusqu'à huit heures ? Ils regardent la télévision seuls. Or les programmes du matin ne sont pas soft. Ces enfants emmagasinent donc des émotions vives, intenses ; ils deviennent des piles électriques et, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils sont totalement impropres à quelque apprentissage que ce soit. Les enseignants n'ont pas prise sur eux, rien ne passe.
J'avais donc proposé l'instauration de sas de « décompression » : des éducateurs spécialisés accueilleraient à leur arrivée à l'école les enfants pendant une heure, inviteraient ceux qui le peuvent à parler de ce qu'ils ont vu ou à fabriquer des images et, surtout, proposeraient à ceux qui ont besoin de passer par le corps de jouer, de mettre en scène, de représenter comme au théâtre ce qu'ils ont éprouvé. Ainsi, aucun enfant ne serait laissé de côté.
Il est en tout cas très important de ne pas considérer l'éducation aux médias du seul point de vue du langage. Si elle devait uniquement utiliser le langage, elle laisserait de côté la moitié, voire, dans certaines régions, les deux tiers des enfants, car certains n'ont pas d'emblée la maîtrise du langage. Il faut d'abord leur permettre de passer par le corps ou, éventuellement, par des images. C'est une réalité qui a longtemps été sous-estimée dans notre culture et qui est aujourd'hui mieux connue.
Je crois donc indispensable que l'éducation aux images retienne trois aspects, à savoir les jeux de rôles, la fabrication d'images et, bien sûr, le langage, et soit confiée à un corps enseignant spécialisé intervenant dans les locaux de l'Education nationale et dans ses horaires, ma préférence allant au matin, à l'arrivée des enfants.
M. le rapporteur - Quelle serait la tranche d'âge prioritaire ?
M. Serge Tisseron - Toutes les tranches d'âge peuvent bénéficier de l'éducation aux images. Si j'ai fait porter ma recherche sur les onze-treize ans, c'est parce que les enfants commencent alors à parler facilement. La dynamique de groupe est aussi plus importante à cet âge que chez les petits, qui continuent à être pris dans leur famille. Mais, à mon avis, l'éducation aux images - ce ne sera évidemment pas la même - est une nécessité dès la maternelle. C'est une nécessité pour les adolescents, et même pour les adultes, par le biais d'émissions de télévision : « réception en famille recommandée » pourrait être la consigne du CSA.
Cependant, s'il fallait cibler au départ une catégorie d'âge, je retiendrai les onze-treize ans, soit les classes de début de collège.
M. le rapporteur - Les enfants sont soumis à un flot d'images tant de faits réels que de fiction. Cette distinction est-elle pertinente et influe-t-elle sur leur comportement ?
M. Serge Tisseron - On se rattachait traditionnellement à la distinction entre images d'actualité et images de fiction pour tenter de structurer les enfants. Il y a encore quinze ou vingt ans, des psychanalystes recommandaient de bien expliquer aux enfants que les personnages souffrent et meurent pour de faux dans un western, pour de vrai dans les actualités.
Ces catégories sont brouillées et elles le seront de plus en plus.
Aujourd'hui, on sait que les scènes d'amour les plus réussies des fictions sont souvent celles dans lesquelles une véritable idylle avait lieu entre l'acteur et l'actrice. Pendant longtemps, on a ignoré ces choses. Maintenant, on les découvre presque en temps réel : cela paraît dans le journal. De la même manière, quand des scènes de haine sont très réussie au cinéma, on apprend souvent que des haines réelles existaient entre les acteurs, comme dans Le Trésor de la Sierra Madre , qui est un exemple célèbre.
On sait aussi que les actualités sont fabriquées, qu'elles ne montrent qu'un aspect des choses, qu'elles peuvent même parfois être complètement mensongères, induire en erreur ou colporter des rumeurs.
Il est maintenant question que l'AFP fabrique, lorsqu'elle ne dispose pas d'images pour certains événements, des images virtuelles.
Au moment du parachutage des troupes américaines en Afghanistan, on a vu un mélange d'images du service des armées américain, d'images de synthèse très bien faites et d'images d'origine non indiquée, provenant probablement de reporters indépendants.
La distinction traditionnelle entre réalité et fiction s'efface donc de plus en plus, mais il me semble que, de toute façon, les spectateurs n'ont jamais vraiment fait la différence.
Aussi difficile à comprendre que cela puisse paraître, toutes les enquêtes faites à ce sujet ont montré que les spectateurs se guident toujours, que les images soient de fiction ou d'actualité, sur des événements qu'ils ont ou auraient pu eux-mêmes vivre. Les fictions les invitent à faire de la psychologie - ils diront par exemple que, eux, ils auraient agi autrement que l'héroïne - et, inversement, les images d'actualité ne les intéressent vraiment que si elles les renvoient à une expérience personnelle.
En fait, la distinction actualité/fiction craque de tous les côtés.
Elle craque d'abord du côté de la constitution des images, qui seront de plus en plus mélangées. Il y aura de plus en plus de films de fiction dans lesquels les personnages feront l'amour pour de vrai ou, pourquoi pas ? seront maltraités pour de vrai. Cela se faisait déjà traditionnellement au cinéma. On peut imaginer que cela se fera de plus en plus facilement, et les acteurs le diront alors qu'ils ne le disaient pas auparavant. Sur Arte, dans un film qui lui était consacré, Leni Riefenstahl racontait qu'elle avait été maltraitée par les réalisateurs avec lesquels elle avait tourné comme actrice au point de s'être retrouvée à l'hôpital après certaines scènes ! A l'époque, le spectateur l'ignorait. Aujourd'hui, il le sait et, dans le même temps, il sait que les actualités intègrent des images de synthèse.
Elle craque ensuite du côté des réactions du spectateur, lequel, on le sait, ne s'intéresse aux images qui si elles l'interpellent parce qu'elles le renvoient à sa propre vie et qu'il y trouve des repères qui résonnent avec les repères de son existence réelle.
Cela signifie que la distinction actualité/fiction ne se résout pas au seul cadre de présentation des images. Pour ma part, je crois que trois cadres interviennent toujours dans la constitution de cette distinction.
Le premier cadre est le cadre de présentation des images : on nous dit de quoi il s'agit, actualité ou fiction, et on est bien obligé de le croire. On peut être induit en erreur.
Le deuxième cadre est le cadre familial. Je vois des enfants que leurs parents ont complètement induits en erreur autour de certains spectacles d'images. Ils ont pris des actualités pour de la fiction ou de la fiction pour des actualités. Les parents ont, par exemple, des réactions émotionnelles si fortes devant certains programmes de fiction que l'enfant croit que c'est « du vrai » pour eux et cela devient « du vrai » pour lui.
Le troisième cadre est, évidemment, un cadre psychique : les spectateurs doivent avoir la capacité de prendre de la distance par rapport aux images.
Pour en revenir à l'éducation aux images, je pense donc qu'elle doit complètement abandonner la distinction actualité/fiction pour permettre aux enfants de prendre de la distance par rapport à toutes les images, quelle que soit leur provenance, ce qui signifie que le travail doit se faire sur des images de fiction, sur des images de publicité et sur des images d'actualité.
Une mesure me paraît devoir être prise de toute urgence par le législateur : toutes les images présentées dans les actualités télévisées devraient être indexées. Il ne suffit pas que le présentateur annonce que des images du service des armées américain vont nous être montrées si, pendant les trois minutes suivantes, les images ne sont pas indexées. Si vous zappez à la dixième seconde, vous les regarderez pendant deux minutes cinquante sans savoir qu'elles proviennent du service des armées américain, et, si le présentateur ne répète pas leur provenance ou si vous zappez avant, vous aurez « gobé » ces images comme étant des images indépendantes.
Il faut donc absolument que toutes les images soient visuellement indexées, car il est capital qu'il n'y ait jamais dans les actualités télévisées d'images dont on ne connaisse l'origine. Les images de synthèse seront de mieux en mieux faites : il faut que la mention « images de synthèse » soit inscrite en gros et que leur provenance soit précisée. « Images de synthèse du service des armées américain », ce n'est pas la même chose qu' « images de synthèse Microsoft » ou « images de synthèse du service des armées français ».
Le citoyen ne sera pas responsable face aux images, c'est-à-dire capable de s'informer et de communiquer, s'il n'est pas d'abord invité à reconnaître la provenance de toutes les images qu'il voit.
On m'objectera que, très vite, beaucoup de gens cesseront de regarder l'indexation. Certes, mais le fait que la provenance soit indiquée montrera qu'il est utile de la connaître. Ce sera, là encore, un encouragement à parler dans les familles de la provenance des images, de leur signification et de leur effet sur les uns et les autres.
M. le rapporteur - C'est tout à fait vrai lorsque la famille peut assumer cette mission, mais ce n'est pas toujours le cas dans les populations qui nous occupent.
M. Serge Tisseron - Malheureusement, beaucoup de familles ne sont pas en mesure de soutenir ce travail. C'est pourquoi il doit être fait par le biais d'émissions d'éducation aux médias et par l'Education nationale.
Je ne suis pas politique, je suis thérapeute ; je vois des enfants et des familles. Je suis donc, c'est vrai, très porté sur la famille. Par rapport à vous, je le suis peut-être même un peu trop, mais, pour moi, il y a la famille, il y a l'Education nationale et le secteur associatif, et il y a les chaînes de télévision. L'effort doit porter dans ces trois directions.
M. le président - Je vous remercie, monsieur Tisseron.
Audition de M. André-Michel
VENTRE,
secrétaire général du syndicat des commissaires
et hauts fonctionnaires de la police nationale
(15 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons à présent entendre M. André-Michel Ventre, secrétaire général du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. André-Michel Ventre - Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez demandé à m'entendre pour que je vous livre la réflexion du syndicat que j'ai l'honneur de diriger sur la délinquance des mineurs. S'agissant d'une réflexion plus que d'un témoignage, je ne puis être assuré, bien qu'ayant prêté serment, de dire la vérité !
La complexité du problème de la délinquance des mineurs disqualifie toute approche simpliste qui ferait l'économie d'une réflexion axée sur la prévention, sur l'éducation et sur la réinsertion, nécessaire de notre point de vue, au profit d'une répression-élimination qui, par nature, ne peut être que limitée dans le temps et donc inefficace.
Dans la bouche d'un policier, cela peut étonner !
La démarche qui doit prévaloir est donc complexe, car le diagnostic doit être, ici comme ailleurs, complet, lucide et, surtout, réaliste. Les stratégies doivent être connectées à ce diagnostic. Les moyens à dégager, qui peuvent être considérables, n'en seront que plus pertinents.
La première partie de mon propos portera sur le diagnostic que nous dressons ; dans une seconde partie, j'aborderai les solutions - même si j'ai quelque peine à utiliser ce mot, car je veux rester modeste - que nous proposons pour éventuellement parvenir à lutter contre la délinquance des mineurs.
Faute d'avoir jamais réellement cherché à identifier, derrière une représentation abstraite et dogmatique de la délinquance, les différents profils de délinquants produits par des situations et des facteurs pourtant discernables, le modèle français de la prévention sociale s'est privé de la capacité de concevoir et de mettre en oeuvre des programmes ciblés sur des situations et des publics à risque.
Je reviendrai souvent sur la démarche entreprise par Sebastian Roché, sociologue réputé - qui a d'ailleurs connu une évolution intéressante puisque, en 1993, il nous accusait, nous policiers, de nous attacher à un fantasme plus qu'à une réalité lorsque nous dénoncions la délinquance des mineurs - qui a conduit, et il faut le saluer, une enquête très précise sur la délinquance auto-déclarée des mineurs en utilisant la technique de l'enquête de victimation, enquête qui permet de dégager les causes principales de la délinquance des mineurs, de dresser son portrait et, surtout, d'évaluer son niveau d'importance, élément qui manque aux policiers comme à d'autres.
Un des enseignements majeurs de cette enquête réside dans le fait suivant : l'absence de supervision parentale et la frustration scolaire sont les causes premières de la délinquance juvénile.
Quiconque réfléchit aux moyens de prévenir ou de contenir la délinquance juvénile doit avoir à l'esprit qu'elle régresse toujours lorsque, d'une part, les parents remplissent leur rôle et leurs fonctions éducatives, en contrôlant l'emploi du temps comme les efforts scolaires de leurs enfants et en faisant assimiler à ceux-ci les codes moraux et sociaux, et lorsque, d'autre part, l'école est pour l'enfant non pas un lieu de frustration mais un facteur d'épanouissement.
Si les causes objectives et individuelles de la délinquance des mineurs peuvent être cernées avec peu d'audace, son volume, ses contours et ses conséquences sont encore méconnus ou - c'est, de notre point de vue, plus grave - contestés.
Pourtant, elle influe sur toutes les composantes de l'insécurité : policiers, magistrats, travailleurs sociaux, tous le constatent, les jeunes délinquants pèsent simultanément sur la délinquance, sur les violences urbaines, sur l'économie souterraine, sur les incivilités et - aspect peut-être le plus important pour nos concitoyens - sur la tranquillité publique, et donc sur le sentiment d'insécurité.
Souvent rassemblés en groupes informels dans les halls et parties communes des immeubles, responsables de tags et de dégradations, fauteurs de troubles et de nuisances, les jeunes délinquants « saturent » en incivilités les quartiers d'habitat social, qui sont leur royaume. Ils s'en approprient indûment certains espaces qu'ils marquent de leur empreinte.
Leurs bandes bruyantes et perturbatrices utilisent les transports en commun, autres vecteurs de l'insécurité et du sentiment d'insécurité, et envahissent les centres commerciaux.
Ils déambulent en bandes dans les rue commerçantes des centres-villes où ils utilisent la technique du « vol à l'étourneau », qui permet de voler en toute sécurité, car il est alors extrêmement difficile pour la victime et pour les services de police de procéder à l'identification, essentielle dans notre droit, de l'auteur principal.
Ils inquiètent donc par leur comportement et par leurs actes la population, qu'elle en soit témoin ou victime.
De 1990 à 2000, le poids des mineurs dans les statistiques de la délinquance a -c'est une certitude- doublé, de même que le volume des condamnations pénales les sanctionnant, qui a peut-être même connu une augmentation un peu plus forte. Nous évaluons ainsi l'augmentation des condamnations criminelles à 131 %.
C'est cependant à l'occasion des manifestations éruptives, plus ou moins spontanées et anti-institutionnelles, de violence urbaine que la population souffre le plus des effets de la délinquance des mineurs. Circonstance aggravante et même dramatique, c'est la population des quartiers en difficulté, déjà victime de l'exclusion ou d'une situation sociale dégradée, qui, le plus souvent, est la victime des violences urbaines.
Les mineurs sont particulièrement actifs dans le domaine de la délinquance de voie publique -leur pourcentage d'implication dans ce type de délinquance était de plus de 51 % en 2000- qui, par son effet de masse et parce qu'elle atteint nos concitoyens dans leur vie quotidienne, est celle qui nourrit le plus le sentiment d'insécurité.
Un des sommets en la matière est atteint dans la rubrique des vols avec violence, très importants pour caractériser le contexte criminogène au cours des deux dernières décennies car ils matérialisent le retour de la violence dans notre société : dans cette rubrique, les mineurs s'arrogent 47 % des infractions. C'est considérable.
Ils maintiennent leur leadership dans le domaine des violences urbaines avec les incendies volontaires de biens publics -58 %- ou de biens privés -43 %-, laissant donc, dans ce domaine encore, leur empreinte sur les statistiques.
En matière de délinquance sexuelle, et c'est une nouveauté, en tout cas pour la police qui a porté un regard particulier sur cette rubrique, nous assistons à une véritable explosion : de 1995 à 2000, l'accroissement a été de 25 % pour les viols -rubrique criminelle- et de 84 % pour les agressions sexuelles -rubrique délictuelle.
Cette activité débordante trouve aussi sa traduction dans le volume des condamnations pénales, puisque, de 1994 à 1998, nous sommes passés de 17.342 à 33.299 condamnations. Je citerai peu de chiffres, mais ceux-là sont parlants !
Ces condamnations dénotent par ailleurs une plus grande gravité de la délinquance des mineurs. Nous sommes ainsi passés de 206 condamnations pour crimes à 476, soit, je le disais, 131 % d'augmentation.
Cependant, si l'on en croit Sebastian Roché, la réalité est bien plus inquiétante.
Son étude, basée sur les déclarations des mineurs qu'il a eu l'audace d'interviewer, fait en effet apparaître qu'une faible part de leur activité est découverte par la police : à peine 2 % des délits les moins graves et à peine 7,5 % des délits les plus graves ! C'est non pas la police mais un sociologue qui parle là.
Cette étude, qui s'appuie sur une enquête poussée auprès de larges populations de mineurs, dévoile donc, de manière assez spectaculaire, l'importance du problème.
Elle révèle que, pour les délits les plus graves, les plus jeunes délinquants, dans la tranche de treize à quatorze ans, ont une plus grande capacité que leurs aînés à échapper à l'attention des forces de l'ordre puisqu'ils ne sont que 5,4 % à se faire prendre, alors que pour les grands -ceux qui ont de dix-sept à dix-huit ans, puisque, au-delà, ce ne sont plus des mineurs- le taux est de près de 11 %. On assiste, pour les actes les moins graves, à une inversion de ce phénomène.
L'autre phénomène révélé par l'étude est l'hyperactivité d'un petit nombre de jeunes délinquants qui se comportent comme des super-prédateurs dans un espace limité. Nous les appelons, dans notre jargon policier, les « noyaux durs ».
Les trois quarts des mineurs délinquants commettent un délit une fois et s'en tiennent là, même s'ils ne sont pas découverts : ce sont des primodélinquants qui restent à jamais des primodélinquants.
Une petite frange, unanimement évaluée à 5 %, est en revanche responsable de 50 % des petits délits, de 86 % des délits graves et de 95 % des trafics divers, notamment de cannabis et d'objets volés, qui alimentent l'économie souterraine, ce qui est -pardonnez-moi ce jeu de mot- proprement stupéfiant.
C'est ce petit noyau d'individus qui exercera sa tyrannie sur le plus grand nombre : il déstabilisera les classes, empoisonnera la vie du quartier, le fera basculer dans la violence urbaine pour finalement aboutir à instaurer une règle différente sur un espace qui n'aura plus rien de républicain.
Autre donnée importante, l'âge moyen de l'entrée en délinquance a été observé. On peut retenir le classement suivant : avant onze ans, on commence par des dégradations légères ; juste après douze ans, on poursuit par des vols à l'étalage ; avant treize ans, on commet des dégradations sur des bâtiments publics ; entre treize et quatorze ans, avec un peu plus d'audace, on se lance dans le « caillassage » de tout ce qui passe, voitures de police, de pompiers ou de médecin, car ce n'est pas une contestation de l'ordre public établi, c'est une contestation pure et simple ; à quinze ans, on se livre aux divers trafics que je viens de citer ; à seize ans, on passe aux vols de voiture et à la vente de drogue douce, cannabis notamment. C'est aussi à seize ans que, dans la majorité des cas, commence la consommation de drogues dures.
Selon Sebastian Roché, l'enchaînement est logique puisqu'il y a dans cette marche vers la criminalité la trace d'une démarche exploratoire propre à l'adolescence, fondée sur l'évaluation de la résistance de cibles souvent placées sous la protection des adultes, qu'ils représentent l'Etat ou soient de simples victimes civiles.
L'entrée en délinquance est donc plus précoce de génération en génération et l'on peut vérifier que la sortie est de plus en plus tardive, d'où l'extrême importance du problème de la délinquance des mineurs, laquelle ne saurait être prise comme la manifestation d'une crise existentielle lors de la période cruciale de la l'adolescence. Des facteurs propres à l'adolescence expliquent qu'elle commence à cet âge, mais l'enkystement dans la délinquance se poursuit au-delà. Si au lieu d'être une éducation à la vie en collectivité, l'adolescence est une éducation à la délinquance, il est évident que la sortie de la délinquance sera, si elle intervient un jour, beaucoup plus tardive.
De la même manière, les constatations effectuées font apparaître une délinquance plus spécialisée et plus violente, mais si une particularité devait plus qu'une autre être signalée, ce serait la sorte de fringale de consommation qui possède les jeunes délinquants. Cette particularité réduit d'ailleurs à néant l'hypothèse, à laquelle nous n'adhérons bien évidemment pas, selon laquelle le passage à l'acte serait un acte militant exprimé contre une société à combattre politiquement. On peut d'ailleurs s'interroger sur la conscience politique des mineurs délinquants.
C'est une découverte de M. Lapeyronnie, professeur et chercheur à l'université de Bordeaux : le consumérisme est une cause avérée du passage à l'acte.
Autre constatation nécessaire, les victimes de la délinquance des mineurs, notamment de la violence, appartiennent à l'environnement immédiat de ceux-ci : il y a une sorte de communautarisme de la délinquance. Ce sont les populations des cités, les enseignants, les forces de l'ordre, les personnels médicaux et de secours mais aussi, et on l'oublie trop souvent, les mineurs eux-mêmes qui sont les principales victimes de cette délinquance.
Le meilleur exemple - ou le pire - nous est fourni par les règlements de comptes perpétrés par des mineurs pour la conquête de l'autorité sur les quartiers où se déroulent les trafics liés à la délinquance. Le nombre de mineurs victimes de règlements de comptes ne cessent d'augmenter et je regrette que l'Etat, au sens général du terme, ne se préoccupe pas véritablement de ce problème.
Quant aux viols collectifs que l'on qualifie de l'expression imagée de « tournantes », ils ont aussi pour victimes de jeunes mineures.
La violence devient ainsi un univers obligé pour des mineurs emprisonnés dans un espace dont il leur est impossible de s'évader : les cités.
Que faire ?
Le constat que je viens de vous livrer est forcément incomplet. Je ne prétends pas à l'exhaustivité quant aux causes de la délinquance des mineurs. Je vous présente une photographie de ce que nous, policiers, constatons. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que ce constat demeure - peut-être vais-je vous choquer - pour partie angélique. C'est ce à quoi nous pousse Sebastian Roché puisque, nous dit-il, nous ne connaissons qu'une très faible partie de la réalité de la délinquance des mineurs, car la majorité des mineurs délinquants nous échappent et échappent à notre attention. Sans chercher d'excuses, je ferai devant vous cette constatation : en cette matière comme en d'autres, la perception du réel est très difficile.
Petite digression à ce propos : c'est dans ce domaine que les outils d'investigation et d'évaluation nous sont les plus comptés et je voudrais vous suggérer de peser de toute votre autorité pour imposer à l'Etat l'utilisation d'une technique fort répandue dans les pays tant anglo-saxons que latins - l'Espagne en use, pour son plus grand bien, sans modération -, je veux parler des enquêtes de victimation. Ces formes de sondages permettent en effet d'appréhender, de manière peut-être pas très précise mais en tout cas suffisante, la réalité d'un problème et, surtout, de mesurer les évolutions.
C'est de la méthode plus que des résultats, dont nous supposions depuis longtemps la réalité, que je veux parler ici. Il faut sans cesse vérifier les données objectives d'un problème pour lui apporter une solution pertinente à l'aide de moyens nécessaires et efficaces. De ce point de vue, l'enquête de victimation est un excellent outil.
Un exemple concret nous est donné par les Etats-Unis, où le FBI conduit chaque année une enquête de victimation qui a pour vocation de compléter l'étude statistique des faits constatés. Les conclusions de l'enquête menée sur l'année 2000 sont remarquables, surtout pour nous Français. Elles remettent en effet en cause des lieux communs, des idées toutes faites et trop facilement répandues, par exemple sur les conséquences de la répression.
Cette enquête de victimation a montré que les populations et minorités ethniques dites stigmatisées par la répression sont au contraire celles que la répression rassure le plus. Ainsi, le FBI a relevé qu'en 2000 68 % des femmes noires dénonçaient les faits dont elles étaient victimes alors qu'elles n'étaient que 58 % en 1999 et moins de 50 % en 1998 à le faire, ce qui signifie qu'une action de répression menée sur le long terme accroît la confiance des populations défavorisées dans l'Etat.
Le Washington Post , rapportant les résultats de cette enquête de victimation, écrivait qu'un cercle vertueux, par opposition au cercle vicieux, avait été initié : les populations plus confiantes portent davantage plainte, ce qui donne à la police, qui a connaissance de plus de délits, les chances d'en élucider davantage, ce qui accroît le sentiment de confiance des populations dans son action, ce qui les encourage à toujours plus fréquemment porter plainte, et l'effet boule de neige se poursuit.
L'important est de mesurer les choses et de les appréhender. Faute de les avoir appréhendées dans le passé, nous avons souvent erré dans la recherche de solutions efficaces. Ensuite, il faut abandonner l'idée qu'une solution miracle existe. Un problème aussi complexe ne peut avoir de solution unique.
C'est pourquoi les solutions que nous proposons sont souvent le fruit d'un mixage entre prévention et répression. On ne peut pas agir en termes ou de prévention seulement ou de répression seulement. Il faut pratiquer l'une et l'autre en trouvant un point d'équilibre, lequel doit d'ailleurs varier dans le temps. Il faut en effet sans cesse nous adapter aux évolutions que nous découvrons, réalité qui constitue aussi une découverte pour la police nationale française, qui a tendance à se complaire - ce n'est ni de l'autocritique ni du masochisme - dans les situations figées.
Dans le domaine de la délinquance des mineurs, les données de base doivent inspirer une action de prévention afin de déceler dès le plus jeune âge les signes d'une prédisposition à la violence et à la déviance.
Des recherches de longue haleine en criminologie ont été effectuées au Canada. Il s'agissait d'étudier les différents parcours de socialisation de jeunes appartenant à des classes homogènes choisies dans le milieu scolaire. L'observation d'un grand nombre d'enfants, depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'âge adulte et au-delà, a mis en relief, sur toute la période d'examen, la stabilité des comportements agressifs chez un pourcentage extrêmement réduit de sujets. Dès leur plus jeune âge, certains enfants bousculent leurs camarades de jeux, s'agitent, crient sans raison et s'en prennent aux adultes à la moindre contrariété. A l'adolescence, 70 % de ces jeunes commettent des actes de violence et de délinquance.
Ces études ont permis de conduire divers programmes de prévention dont les résultats sont encourageants. Mais les actions menées doivent guider plus fermement la justice lorsqu'elle intervient légitimement après une infraction. La sphère judiciaire doit en effet apporter systématiquement une réponse à toutes les manifestations de primo-délinquance, traiter toutes les manifestations de réitération de l'activité délinquante et sanctionner très fermement les multirécidivistes.
A cet égard, il convient de développer un éventail de réponses pénales adaptées à toutes les catégories de délinquants. L'existence d'une seule catégorie de réponse - par exemple des rappels à la loi ou bien la prison - serait à la fois inefficace - cela a déjà été vérifié - et surtout contre-productive.
Pour les cas les moins graves, il est souhaitable d'appliquer des procédures alternatives aux poursuites. Il faut étendre la possibilité de placements éducatifs, aussi bien en externat qu'en internat, et ne pas hésiter à recourir aux peines alternatives, comme le travail d'intérêt général ou l'obligation de réparer lorsque la nature des infractions et le préjudice qu'elles provoquent le justifient.
En revanche, il est important de traiter avec fermeté le cas des multirécidivistes, des hyperactifs, qui constituent les noyaux durs à dissoudre. Le développement de structures réellement fermées s'impose.
Il convient de territorialiser les réponses judiciaires en recourant aux groupes de traitement local de la délinquance. Ces structures mêlant police et justice permettent de traiter en profondeur les problèmes spécifiques qui peuvent se poser dans un espace donné. Cette pratique vise à concentrer temporairement les efforts de la police, de la justice et de leurs partenaires locaux sur un territoire urbain où les problèmes d'insécurité sont portés à leur paroxysme.
Enfin, il faut en terminer avec quelques tabous.
Il nous semble nécessaire de revenir sur le régime actuel de la détention provisoire des mineurs afin de conserver tout son crédit à cette mesure. Mais elle doit alors s'appuyer sur un réseau d'établissements spécialisés de petites dimensions où le jeune délinquant est réellement et globalement pris en charge sur les plans psychologique, éducatif, social et médical.
Autre tabou à évacuer : l'interdiction de recourir à l'incarcération, y compris à l'encontre des individus les plus dangereux. L'incarcération est pourtant une réponse justifiée ; il faut donc y recourir -même pour les mineurs- en cas de nécessité. Car aucune société -de la plus simple à la plus complexe- ne peut faire l'économie de l'enfermement. Je reconnais néanmoins que nos prisons sont inacceptables. Nous pourrions y remédier en construisant des prisons plus modernes.
Il faut mixer les différents outils que sont la prévention, l'éducation, la dissuasion, l'instruction et la répression, tout en gardant à l'esprit que l'objectif premier est la réinsertion, seul moyen d'éviter la récidive. Or l'absence de réinsertion désespère le policier que je suis.
Au cours de mes études, j'ai appris que notre droit pénal reposait sur le programme du Conseil national de la résistance, produit en 1944-1945. Ce programme décrivait explicitement la réinsertion sociale comme le meilleur moyen de lutte contre la délinquance et la criminalité. Or, à la vérité, je dois dire que je cherche désespérément dans l'évolution du système et la pratique de l'Etat, la trace de quelque mécanique ou procédure prouvant que cette réinsertion a été recherchée à un moment donné entre 1945 et aujourd'hui.
Le poids de la délinquance des jeunes est lourd. Il augmente chaque année dans des proportions qui donnent plus d'acuité au problème qu'il illustre. Les statistiques, et les enquêtes encore trop peu nombreuses, sont là pour le montrer. Nos concitoyens s'inquiètent de l'absence de réponse de l'Etat en la matière, et notamment de l'impunité dont bénéficient les mineurs délinquants, lesquels savent qu'ils ne risquent rien ou presque rien. Ils en éprouvent un sentiment d'impunité, qui s'apparente à une certitude, qui n'a d'égal que le sentiment d'incompréhension qui les envahit lors de leur premier passage devant un tribunal à leur majorité. Là, ils deviennent des majeurs multirécidivistes. Ce qui s'abat sur leur tête relève de l'apocalypse. La société, la nation et surtout l'Etat doivent s'atteler d'urgence à la résolution de la question de la délinquance des mineurs, dans les termes que je viens de vous livrer.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Monsieur, vous avez fait référence à Sébastian Roché, que nous avons entendu. Il a effectivement réalisé un travail de recherche remarquable. Vous avez même utilisé cette expression : « Si l'on en croit Sébastian Roché ». Cela me surprend de la part d'un policier. Est-ce à dire que la police, au sens le plus large du terme, ne dispose pas d'informations suffisantes ou suffisamment précises sur l'état de la délinquance et doive se référer à l'étude de Sébastian Roché ? Quel système pourrait-on mettre en place pour améliorer les données statistiques -dont vous disposez ou vous ne disposez pas- et pour permettre -en termes d'organisation- un meilleur traitement policier de la délinquance ?
M. André-Michel Ventre - Je répondrai en deux temps à votre question sur Sébastian Roché, monsieur le sénateur.
Vous m'interrogez sur le sens de l'expression que j'ai employée : « Si l'on en croit Sébastian Roché. ». Les policiers sont des fonctionnaires de l'Etat soumis à quelques devoirs, notamment celui de réserve. Souvent, ce sont les syndicats -j'en suis l'illustration aujourd'hui- qui s'expriment au nom de la police nationale car celle-ci ne communique pas ou très peu. Quand elle s'exprime, c'est sur le mode très particulier qu'utilise l'Etat, c'est-à-dire la langue de bois ou parler pour ne rien dire.
Les syndicats de police, notamment le SCHFPN -Je ferai un peu d'auto glorification- ont étudié depuis fort longtemps les mouvements liés à la délinquance qui sont responsables de son apparition et de son explosion dans notre pays. Ils ont présenté leurs interprétations et proposé quelques solutions mais le jugement porté sur leur démarche a toujours été très négatif. Nous avons toujours été stigmatisés, par les uns ou pas les autres, comme étant inutilement catastrophistes, alarmistes, voire politisés.
C'est pourquoi nous nous réfugions aujourd'hui très volontiers derrière des voix beaucoup plus acceptables que la nôtre pour porter notre analyse. Lorsque j'ai écrit avec Alain Bauer que vous connaissez sans doute, un petit Que sais-je sur les polices en France, j'ai choisi de me réfugier derrière sa voix. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas été crédible ; je n'aurais même pas trouvé d'éditeur pour livrer la description de l'appareil de production de sécurité intérieure de notre pays. Aujourd'hui, nous préférons donc mêler notre voix à celle des universitaires, des chercheurs, voire à des voix complètement iconoclastes pour porter une réflexion que nous estimons importante. Il en va de l'intérêt de la nation de connaître la réalité des choses.
Sur la deuxième partie de ma réponse, je dirai simplement que Sébastian Roché a raison et j'attache une grande importance à son jugement. En effet, en 1993-1994, nous avons publié une réflexion sous le sigle : « Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale ».
En réalité, ce travail a été produit par Richard Bousquet, alors secrétaire national. Ce livre parfaitement aride est une compilation d'analyses conduites par le syndicat des commissaires sur l'insécurité. Le titre de cette analyse sur la délinquance des mineurs était : « La cité interdite ? » et non : « La cité interdite ! ». Ce n'était pas une affirmation, c'était une question. Nous avons été « étrillés », notamment par Sébastian Roché en 1994-1995. Or sept ans après, il nous donne raison. Nous avons le tort d'avoir eu raison trop tôt. Nous sommes satisfaits, non pas d'avoir eu raison, mais d'avoir eu une réflexion pertinente, fondée sur une analyse du réel qui s'imposait à tous.
J'en viens à la troisième partie de ma réponse générale.
Nous regrettons de ne pas disposer en France d'outils de mesure suffisamment efficaces pour aller au plus profond de la connaissance du réel. Je regrette même à certains égards - compte tenu de la violence de mes propos, peut-être ne faudrait-il pas retenir ce que je vais dire - de ne pas être américain. J'ai eu l'occasion de me rendre à Washington plusieurs fois, notamment dans les locaux du national institute of justice. Dans une très grande salle se trouvent des rayonnages concernant presque tout ce qui peut être produit sur les statistiques de police dans les cinquante Etats des Etats-Unis. Des CD ROM contenant toutes les données peuvent être remis gratuitement à ceux qui le désirent. Même depuis la France, les personnes qui ne veulent pas se déplacer ont la possibilité d'aller sur un site Internet et de prendre connaissance de tout ce qui est produit en matière de constatation et d'analyse sur la criminalité.
Ces données peuvent émaner de toutes les polices -elles sont très nombreuses aux Etats-Unis- , des agences fédérales, des universités, des sociologues, des auteurs individuels, des communautés, des représentants des communautés, etc. Il est possible de conduire toutes les recherches désirées. Vous comprendriez plus aisément mes propos si je vous avais apporté le recueil statistique des faits constatés aux Etats-Unis. Ce document comporte à peu près toutes les données dont un policier peut rêver. Il nous reste donc en France beaucoup de choses à faire.
Je terminerai en évoquant le jugement émis sur nos statistiques. Il est partial, parcellaire et parfaitement imprécis. En revanche, ce jugement n'est pas inutile car il permet de dégager les grandes tendances prévisibles sur de longues périodes. Grâce à cet outil maintenant bien connu, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être démentis, que la délinquance de notre pays - pas seulement la délinquance des jeunes - est marquée par un retour de la violence physique. L'existence de ce phénomène fait de l'insécurité la question primordiale de notre société aujourd'hui.
En l'espace de dix ans, le nombre des victimes d'infractions qui portent atteinte à l'intégrité ont quadruplé. Vous imaginez aisément l'impact que cette réalité peut avoir sur la population. Selon l'analyse -peut-être insuffisamment scientifique- que nous avons réalisée avec Alain Bauer, la France a dépassé les Etats-Unis sur le chapitre de la montée de la violence. On nous objecte systématiquement qu'il est impossible de comparer ce qui n'est pas comparable. Malheureusement, la comparaison est tout à fait possible et les rubriques portant sur les infractions à caractère de violence sont à peu près identiques. Même si les meurtres et les homicides volontaires sont moins nombreux en France qu'aux Etats-Unis, la courbe s'est inversée pour le reste.
Ce phénomène de retour à la violence concerne tous les pays d'Europe.
M. le rapporteur - Vous parlez de la nécessité, dans certains cas, d'incarcérer des jeunes ou de les mettre dans une structure « réellement fermée ». Qu'entendez-vous par ce terme ? Quelles pourraient être, en plus de la prison, cette structure ou ces structures réellement fermées ?
M. André-Michel Ventre - Un internat, par vocation, n'est pas une prison. Il est possible d'en sortir le week-end ou de bénéficier de permissions. La prison ne connaît pas le même régime. Une structure réellement fermée est une structure de laquelle on ne sort pas tant qu'on n'en a pas la permission.
M. le rapporteur - Qui pourrait ou qui devrait gérer ces structures ?
M. André-Michel Ventre - Cette compétence ne doit certainement pas revenir aux policiers. Elle devrait sans doute être exercée par l'administration et les fonctionnaires qui y seraient affectés. Cette administration pourrait être rattachée à l'Education nationale ou aux affaires sociales. Pour faire un peu de proximité, on pourrait sérieusement envisager de donner aux régions, aux départements et aux communes des compétences en la matière. L'Angleterre a adopté un tel système et constitue - avec le Canada - un merveilleux laboratoire. Il est regrettable que l'on se moque trop souvent de ces pays.
M. le rapporteur - Il est curieux que vous ne citiez pas la PJJ.
M. André-Michel Ventre - Je fais peut-être un blocage involontaire. Il convient d'accepter les objectifs qui sont donnés. Il ne faut pas vouloir - cela vaut pour la police nationale - faire les choses comme si on était propriétaire de la mission confiée. Chacun doit se remettre en cause. Si vous voulez me le faire dire, je vous dirai -je peux me tromper- que la PJJ ne me semble pas être une structure capable de se remettre en cause et, en tout cas, susceptible d'accepter des influences extérieures.
M. le rapporteur - Dans le domaine législatif, quelles améliorations pourrait-on envisager concernant le traitement de la délinquance des mineurs ?
M. André-Michel Ven tre - Un lieu commun consiste à vouloir réformer l'ordonnance de 1945. Avant d'envisager le remplacement de ce texte par un autre en constatant qu'il est obsolète, il faudrait peut-être essayer de l'appliquer. Certains policiers, notamment des commissaires de police, souhaitent la réforme, voire l'abandon de l'ordonnance de 1945 au profit d'un texte beaucoup plus simple, plus coercitif et plus efficace.
D'autres policiers - en nombre à peu près égal - estiment que l'ordonnance est devenue très complexe du fait des rajouts incessants qui ont été opérés ces dernières années. Ils pensent néanmoins que l'on a perdu l'habitude de l'appliquer. Cela vaut d'ailleurs à peu près pour tous les textes de loi en France. Certes, les magistrats tentent de l'appliquer mais avec les moyens qui leur sont donnés. Vous ne pouvez pas respecter les prescriptions d'un texte si vous n'avez pas les moyens nécessaires à leur application. Ainsi, Seulement 1 % des faits constatés ayant donné lieu à rédaction d'une procédure contre personne dénommée aboutit à une condamnation exécutée. Cela vous donne à peu près la mesure du problème posé. Cette statistique émane de l'union syndicale des magistrats qui est crédible dans cette analyse.
La France est un pays merveilleux car c'est un pays où l'on transige sur l'application de la loi... Dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis, on transige sur le quantum de la peine, on ne transige pas sur la loi. En France, parce que les lois ne sont pas appliquées, nous pouvons dire que nous transigeons sur l'application de la loi. L'ordonnance de 1945 obéit à cette logique et n'est pas appliquée.
Pardonnez-moi d'être violent sur ce thème de l'application de la loi mais c'est un phénomène qui excède le problème de la délinquance des mineurs. Chaque année, on enregistre dans ce pays 2,5 millions de vols. Si 70 000 condamnations sont prononcées, 20 000 seulement seront exécutées. Nous pouvons dès lors affirmer que le vol est dépénalisé, non pas du fait de la loi mais du fait de la non-application de la loi. Un Que sais-je écrit par un magistrat et par un commissaire de police et intitulé Le vol en fait une démonstration particulièrement étayée. Les voix mêlées de la police et de la magistrature donnent un peu de crédibilité à mon affirmation.
M. le rapporteur - Face à la situation que l'on connaît en matière de délinquance des mineurs, qu'est-ce qui démotive le plus les policiers aujourd'hui ?
M. André-Michel Ventre - On ne peut pas parler de démotivation des policiers. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que je suis choqué, ennuyé, et même agacé que l'on parle de « démotivation des policiers ». Le métier de policier est un métier si particulier qu'il faut être motivé à la fois pour choisir de l'exercer mais également pour continuer à accomplir les tâches qu'il exige. Je peux vous assurer que les policiers sont motivés. D'ailleurs, une des principales raisons qui les ont conduit à descendre dans la rue au mois de novembre dernier, c'est la rage qu'ils éprouvaient à être mis dans une situation d'incapacité à faire leur métier. Pour un policier, la démotivation est un sentiment très fugace, qui n'est pas encore un sentiment pérenne. En revanche, les policiers sont en colère -comme les magistrats même s'ils l'expriment autrement- de voir que leur tâche, leur investissement n'a aucun sens et ne produit aucun effet.
M. Bernard Plasait - Ma première question concerne le cliché - c'est aussi un syndrome important - de ce délinquant arrêté qui retourne dans son quartier avant que le policier ne revienne dans le sien. Les magistrats, à qui l'on a souvent soumis le problème, retournent le compliment à la police et posent ainsi la question de son efficacité. Je souhaite vous soumettre ce problème car les magistrats s'interrogent sur l'efficacité de la police à la fois en termes de nombre d'interpellations et de qualité des dossiers qui, selon eux, ne permettent pas de véritables poursuites.
Ma deuxième question concerne la police de proximité. On nous a beaucoup dit que la police de proximité avait bien des avantages mais qu'elle présentait aussi des inconvénients. Parce qu'elle a été faite à effectifs constants, elle aurait ainsi déshabillé Paul pour habiller Jacques et aurait un peu dépouillé la police d'investigation, diminuant ainsi son efficacité.
J'aimerais connaître votre sentiment sur ces deux questions qui sont liées.
Ma troisième question vise simplement à obtenir une information. Vous avez parlé tout à l'heure d'une enquête de victimation aux Etats-Unis, montrant le cercle vertueux introduit par une politique de répression menée et soutenue sur une longue période. Pourriez-vous nous donner les références de cette enquête ?
M. André-Michel Ventre - S'agissant des références de l'enquête, vous trouverez l'article concerné dans la tribune du commissaire de police du mois de septembre 2001 sous le titre Vent d'Ouest parce que les Etats-Unis sont situés à l'Ouest de la France et que le vent apporte les informations depuis les Etats-Unis. Vous pouvez également vous référer, sur le site Internet du Washington Post, au numéro du 16 juillet 2001. Les gens ont davantage déposé plainte, ce qui était un bon signe. Dans un premier temps, on a interprété ces chiffres comme le signe très mauvais d'une augmentation de la délinquance puisque nos statistiques sont fondées - ici comme aux Etats-Unis - sur les faits constatés, c'est-à-dire en réalité sur les faits dénoncés par les victimes. Un nombre plus important de dépôts de plainte pourrait signifier que la délinquance est en augmentation.
En réalité, l'enquête de victimation a montré que cette augmentation avait une autre cause : les victimes ont cru davantage que leurs affaires pourraient être résolues par la police, ce qui est tout à fait différent. Cette explication a été confirmée par le fait que le taux de réussite augmentait en même temps que le taux des dépôts de plainte.
J'en reviendrai tout à l'heure à la question de la police de proximité.
S'agissant de la première question, je connais très bien l'argument qui a été évoqué. Pourquoi nier que les policiers puissent commettre des erreurs procédurales et livrer un travail imparfait. Les procédures transmises à la justice n'étant pas toujours parfaites, la justice est parfois contrainte de ne pas en tenir compte et de ne pas condamner. Mais cela n'intéresse qu'un très faible pourcentage d'affaires. Les pratiques et leur évolution étant ce qu'elles sont, les procédures se font de plus en plus sous l'oeil vigilant des parquets ou, le cas échéant, des juges d'instruction. En général, les fautes procédurales sont constatées non pas dans le cadre de l'information judiciaire mais dans celui des enquêtes de flagrant délit, dans le traitement direct. On peut donc affirmer que la responsabilité de l'imperfection du travail est partagée entre les policiers et les parquets.
Cela étant, je tiens à vous dire, messieurs les parlementaires, que les prescriptions de la loi s'alourdissent de réforme en réforme. Dans un laps de temps limité, il devient de plus en plus difficile de ne pas chuter et trébucher sur une disposition à appliquer. Prenons un exemple un peu caricatural. Si l'enquête de flagrant délit commence le vendredi soir, l'officier de police judiciaire doit sacrifier son week-end et sa famille. Par ailleurs, il est pressuré par un parquet qui lui indique que le juge d'instruction ne pourra pas venir au palais de justice le dimanche matin pour recevoir les personnes interpellées et déférées. La contraction des délais d'enquête conduit forcément à commettre des erreurs qui -j'en suis bien conscient- sont parfaitement regrettables.
Pendant quinze ans, j'ai été à la tête de la sûreté urbaine à Marseille, à Fort de France, à Versailles, à Grenoble. J'ai fait de la police judiciaire pendant toutes ces années. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais choisi ce métier. Dans ma carrière, il y a trace d'erreurs monumentales dues à la fois au temps qui m'était imparti et à la fatigue. Car si la garde à vue est très pénible pour le gardé à vue, elle l'est encore plus pour l'officier de police judiciaire, qui doit conduire sa procédure dans le même temps. Le nombre d'actes ne cesse d'augmenter de réforme en réforme. De ce fait, même les plus chevronnés des officiers de police judiciaire peuvent trébucher sur une disposition.
Venons-en à la police de proximité. Si le concept est excellent, nous avons cependant échoué en France pour plusieurs raisons.
Premièrement, nous avons voulu que cette police de proximité produise des effets positifs immédiatement. Au Québec, la mise en place de la police communautaire à Laval a été planifiée sur quinze ans. Au bout de quatre ou cinq ans, l'administration du budget du Québec a voulu accélérer les choses. On a voulu mener en un an des évolutions qui auraient dû être échelonnées sur dix ans. Après quelques mois, la sûreté générale du Québec a souhaité revenir au tableau de marche qui avait été défini initialement. Vouloir aller trop vite était contre-productif.
Deuxièmement, la sûreté générale du Québec a recruté massivement 30 % de fonctionnaires supplémentaires. En France, les recrutements ont été opérés non pas à effectifs constants mais à effectifs déclinants. Il suffit de lire chaque année le bleu du projet de loi de finances pour comprendre que les effectifs des corps actifs de la police nationale diminuent peu à peu. Sur 129 000 fonctionnaires de police, dont 105 000 appartiennent aux corps actifs de la police nationale, nous perdons chaque année 100 à 150 gardiens, officiers ou commissaires. Si les effectifs ont globalement augmenté, c'est en raison du recrutement des adjoints de sécurité qui n'est qu'un trompe l'oeil.
Troisièmement, la police de proximité requiert un haut degré de professionnalisme. Or, nous l'avons mise en place avec les adjoints de sécurité, ce qui était une erreur. En 1998, nous avons dénoncé cette erreur mais nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a notamment reproché de faire de la politique alors que nous livrions uniquement à l'époque un jugement de technicien.
Quatrièmement, nous manquons de moyens budgétaires. S'agissant de l'implantation des commissariats, la police de proximité doit obéir à un principe simple : il faut mettre des policiers là où sont constatés les problèmes. A Laval, par exemple, on a déplacé des commissariats. Il est inutile d'implanter un commissariat central au milieu de la ville où il ne se passe rien alors que ce commissariat central - qui portera peut-être alors mal son nom ! - doit être établi dans les banlieues. C'est à l'endroit où se posent les problèmes que l'on doit pouvoir visualiser la présence policière. Or nous n'avons pas eu les moyens de déplacer les commissariats. Nous n'avons d'ailleurs toujours pas les moyens de rénover les commissariats vétustes. Il suffit de visiter quelques commissariats pour comprendre que certaines de nos implantations devraient être fermées si l'on appliquait le droit du travail.
On pourrait énumérer à l'infini les raisons qui ont conduit à l'échec de la police de proximité ; pourtant le policier que je suis exprime un jugement très positif sur ce concept. Malheureusement, la déclinaison que nous en avons faite, nous français, est pitoyable. On ne pouvait aller qu'à l'échec.
M. Bernard Plasait - La capacité de la police d'investigation n'a-t-elle pas plutôt diminué du fait de cette réforme ?
M. André-Michel Ventre - Sa capacité a diminué du fait de l'augmentation des prescriptions de la loi. C'est d'ailleurs une des choses que nous avons voulu dire en novembre dernier à propos de la loi sur la protection de la présomption d'innocence. Il nous apparaît que le législateur - pardonnez-moi si je vous blesse - s'est arrêté en trop bon chemin. Il fallait aller au bout de la logique.
M. Jean Pradel, professeur de droit à Poitiers, ancien juge d'instruction, dit qu'une procédure pénale est caractérisée par le jeu d'équilibre entre les parties. Ce jeu d'équilibre, consacré par les textes, a été rompu par la réforme de la loi sur la protection de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les prescriptions qui ont été ajoutées ont accru la charge de travail des policiers. Mécaniquement, à partir du moment où vous prescrivez davantage d'obligations aux policiers, vous diminuez leur capacité opérationnelle.
Vous avez raison de dire que la police de proximité a peut-être été un frein à l'essor de cette police d'investigation. Mais en réalité, c'est une incompréhensible prescription de la loi du 21 janvier 1995, la LOPS, loi d'orientation et de programmation pour la sécurité, qui a diminué le potentiel de l'investigation et de la recherche dans ce pays. Dans sa partie consacrant la réforme des corps et carrières de la police nationale, la LOPS a voulu que les corps de commissaires de police et d'officiers de police soient diminués. De 1995 à 2002, nous sommes passés de 19 000 officiers de police judiciaire à un peu moins de 14 000. Cela a entraîné des conséquences inévitables : les commissaires de police ont ainsi perdu en sept ans 400 de leurs effectifs. Aujourd'hui, certains services sont privés de chef de service.
Je voudrais également citer la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Quand vous diminuez le temps de travail sans diminuer le travail, il manque la variable d'ajustement.
Pour bien vous éclairer, je vous donne une indication qui se trouve dans le Que sais-je sur les polices en France. Grosso modo, la mission de Police secours coûte à la police nationale 7 millions d'heures-fonctionnaires dans une année. Or, chaque année, nous devons rendre à l'ensemble des gardiens de la paix de la sécurité publique - à peu près 68 000 - le même nombre d'heures. Nous faisons là de la cavalerie.
En même temps -vous n'êtes pas obligés de me suivre en ce raisonnement- 37 000 agents de l'Etat de la gendarmerie et de la police - y compris la gendarmerie mobile et les CRS - sont utilisés à 20 % de leur potentiel, selon le rapport Hyest-Carraz, rapport postérieur à un rapport beaucoup plus important cosigné par la gendarmerie et la police nationale.
J'en ai terminé avec l'exposé des dysfonctionnements de la police nationale.
M. le président - Nous vous remercions.
M. André-Michel Ventre - Je vous remercie à mon tour de m'avoir écouté avec patience.
M. le président - Avec intérêt !
Audition de M. Alexandre
JARDIN,
écrivain
(15 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Shosteck, président - Nous allons à présent entendre M. Alexandre Jardin, écrivain, qui a fondé l'association « Lire et faire lire » dont le but est d'encourager la lecture chez les élèves que celle-ci rebute. Au cours de ces derniers mois, vous avez animé, monsieur, un groupe de réflexion intitulé « Relais civique », et qui s'est notamment intéressé aux questions de violence scolaire. Cela nous intéresse bien évidemment au plus haut point pour nos travaux.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. Alexandre Jardin - Les remarques que je souhaite faire ici sont des remarques d'ordre pratique. Rien ne serait plus dangereux que de laisser croire aux français que des lois et des changements de structures auront des effets autres que minimes. Tout ce que je vais aborder concernera des changements de pratiques.
D'abord, nous mènerons notre réflexion sur la prévention. Ensuite, nous nous intéresserons au traitement du plus grand nombre. Enfin, notre étude s'attachera au traitement du noyau dur, c'est-à-dire des multirécidivistes.
En matière de prévention, je préconise le développement d'une pratique extrêmement simple. Il s'agit d'augmenter le lexique dont disposent les enfants de notre population. Toutes les études montrent qu'il y a une corrélation étroite entre la violence et la pauvreté du lexique. D'une part, un jeune qui a 400 mots ne commet pas les mêmes actes qu'un jeune qui en a 1500 à sa disposition. D'autre part, un jeune qui dispose de beaucoup de mots est un jeune qui réussit mieux. Il y a très peu de premiers de la classe dans les commissariats le samedi soir.
L'action que j'ai entreprise depuis maintenant deux ans est la meilleure stratégie susceptible d'être appliquée massivement. Elle consiste à appliquer à très grande échelle une expérience locale qui a fonctionné pendant quinze ans à Brest et qui a été menée par l'office des retraités de Brest. Ces jeunes retraités sont venus lire des histoires aux enfants le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à tour de rôle, pour leur transmettre le plaisir de la lecture et créer une habitude de lecture. Le lien intergénérationnel est le moyen de prévention le plus efficace. Outre le fait qu'il ne coûte rien, il a totalement fait disparaître l'échec scolaire dans les établissements qui l'ont appliqué. Cela suppose que le protocole soit respecté, c'est-à-dire que la lecture ait bien lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pour créer une habitude.
Nous avons décidé d'étendre cette pratique au niveau national en créant un partenariat entre mon association « Le relais civique », la Ligue française de l'enseignement et l'UNAF, l'union nationale des associations familiales afin de disposer de bureaux et de relais dans l'ensemble des départements. Nous avons demandé à des sponsors privés de financer notre bureau central et à France Télécom de financer un système permettant la création d'un numéro d'appel national.
Je me suis ensuite tourné vers 130 écrivains -dont vous connaissez les noms- qui ont apporté leur soutien pour médiatiser cette opération.
A la fin de la deuxième année, ce système est déjà appliqué dans 87 départements, soit une couverture quasi nationale, dans 13 000 écoles faisant appel à au moins 5 000 bénévoles. Il est difficile de connaître les chiffres exacts car les retraités ne remplissent pas leur feuille de présence. On sait néanmoins qu'il y a en ce moment un taux de croissance fantastique parce que les retraités ont envie de voir des enfants et souhaitent intervenir. Aussi, si nous parions à très grande échelle sur le lien intergénérationnel -pour un coût ridicule-, nous pouvons faire disparaître notre échec scolaire.
Je parle bien d'une pratique très simple, qui n'a pas de coût, qui ne suppose aucune loi, aucun changement administratif et qui nécessiterait la création de 200 emplois pour régler l'échec scolaire. Je me permets d'être aussi affirmatif car je m'appuie sur une étude réalisée par l'université de Bretagne. L'expérimentation ayant duré quinze ans, nous bénéficions d'une distance suffisante. Je souhaite vivement que ce programme soit appliqué dans toutes les écoles primaires françaises et les grandes sections de maternelle dès la rentrée prochaine.
Les écrivains français sont prêts à se mobiliser et à lancer une grande campagne pour trouver entre 80 000 et 100 000 bénévoles, ce qui est tout à fait envisageable. Il ne faudrait pas lancer une généralisation en face d'une administration qui n'aurait pas été préparée. Or toutes les inspections d'académie travaillent avec nous depuis deux ans. Le plus petit inspecteur d'académie milite aujourd'hui avec nous. La machine est donc prête à la généralisation pour régler le problème de l'échec scolaire. L'expérience de Brest nous a montré plusieurs choses.
Premièrement, on a pu constater la disparition de l'échec scolaire.
Deuxièmement, l'expérience à eu un effet d'intégration extraordinaire sur les enfants issus de l'immigration. L'activité a lieu en tous petits groupes de trois ou quatre petits enfants. Au bout d'un moment, ils s'adoptent réciproquement, et la lectrice devient mamie Jacqueline. Il est indispensable que les enfants des cités aient une mamie Jacqueline. Il faut que le visage de la France soit mamie Jacqueline et non pas un CRS.
De façon très concrète, ce programme s'adresse aux enfants des grandes sections de maternelle jusqu'à la fin du primaire. L'expérience a montré que le lien intergénérationnel ne marche plus lorsque les enfants sont au collège. En classe de sixième, ils s'identifient aux plus grands. Ils ne veulent pas être vus avec une mamie car ils auraient l'air d'être petits.
Troisièmement, j'ai été extrêmement intéressé de constater que les écoles qui appliquent le programme ont un taux d'emprunt dans les bibliothèques tout à fait stupéfiant. Les enfants ayant bénéficié de cette expérience n'ont pas du tout le même lexique. Quand on crée une habitude de lecture tout au long de l'école primaire, on permet aux enfants d'avoir des mots. Et quand on a des mots, on ne tape pas.
Ce programme est le meilleur outil de prévention que mon association « Relais civique » ait repéré. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour passer à l'échelon national.
Le deuxième point concerne le traitement du plus grand nombre.
Mon association a réuni un groupe composé d'inspecteurs généraux de l'Education nationale et de syndicalistes. Pendant six mois, nous nous sommes rendus dans les collèges qui avaient réglé leur problème de violence pour comprendre quelle méthode ils avaient adoptée. Ce n'est pas leur discours qui nous a intéressés, c'est leur pratique. Nous en avons tiré une charte en douze points que je vous ai apportée. Elle a été publiée par l'Express au mois de mars et reprend point par point la conduite à tenir. Mais la diffusion des ces bonnes pratiques connaît un obstacle : le milieu enseignant est naturellement rétif à ce qui vient du haut. Il est difficile d'importer dans un collège des pratiques qui viennent d'ailleurs. Pour résoudre ce problème, nous avons cherché qui avait les bonnes pratiques afin de les diffuser.
Un fonctionnaire de Versailles a eu l'intelligence d'adopter une stratégie des bonnes pratiques reposant sur l'utilisation des crises. Cela fait l'objet du onzième point de notre charte. Si vous téléphonez à un collège en indiquant la marche à suivre en douze points, on vous raccroche au nez. En revanche, si vous attendez qu'il y ait une grave crise, à ce moment-là, on peut envoyer des groupes d'appui composés de personnels rattachés aux collèges : infirmières, ATOS, etc. Ceux-ci sont formés à la mise en place, sous forme de fiches techniques, des outils que j'ai répertoriés dans ma charte. C'est lorsqu'il y a une crise que l'on peut les diffuser très rapidement.
Je vais maintenant étudier ces différents outils.
Le premier outil est très simple. Il faut à tout prix traiter de façon spécifique le noyau dur des enfants qui sèment vraiment le trouble. Actuellement, que se passe-t-il ? Quand un enfant à moins de seize ans, on le renvoie de l'établissement. Or l'obligation légale de le scolariser fait que cet élève -appelé le « mistigri »- ira d'un établissement à un autre.
Pour ne pas laisser la situation empirer, nous nous sommes tournés vers une expérience qui a lieu depuis des années à Ajaccio et qu'il faudrait à tout prix généraliser au niveau national. La FALEP, l'antenne locale de la Ligue de l'enseignement, a signé une convention avec un collège : lorsque un enfant a commis un acte très grave, il est exclu pour une période de trois semaines ou un mois mais il reste sous statut scolaire et est pris en charge de façon individuelle. Il ne faut pas faire de ces enfants des chats sauvages sous peine de voir leur situation s'aggraver. Sur environ 600 élèves, on compte un noyau dur d'une quinzaine d'élèves pénibles.
Il convient de préciser qu'ils ne sèment pas le trouble en même temps. Une expérience a montré que le suivi individuel pendant trois semaines ou un mois permettait au jeune de sortir de son rôle. Un travail de recomposition et d'appui familial est réalisé afin d'organiser le retour de l'élève dans le cursus scolaire. Pour cela, plusieurs sessions sont parfois nécessaires mais, in fine, la réintégration est obtenue dans plus de 50 % des cas, ce qui est un bon chiffre.
Le deuxième outil est peut-être celui qui m'a le plus enthousiasmé. Il s'agit d'un dispositif qui a été créé en 1991 par Lionel Jospin : « Ecole ouverte ». Il permet d'ouvrir les collèges le samedi, le mercredi après-midi et pendant les petites vacances scolaires. Ce système permet d'utiliser les bâtiments pour faire du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs et des activités qui intéressent les jeunes. Pendant qu'ils sont à l'école ouverte, les jeunes ne sont pas dans un Franprix ou dans leur cage d'escalier. Surtout, cela a des effets indirects incroyables de réappropriation du collège. En effet, les enfants qui participent à l'école ouverte n'ont pas du tout le même comportement avec leurs enseignants le lundi. Ces stratégies indirectes leur donnent un lieu et du temps.
A ma grande horreur, j'ai constaté que l'« Ecole ouverte » n'est appliquée que dans un quart des établissements de ZEP et REP en France. Or pour régler l'essentiel des problèmes de délinquance, il faut stratégiquement s'appuyer sur les lieux de cohérence que sont les collèges plutôt que d'aller distribuer de l'argent partout. Le dispositif « Ecole ouverte » doit être généralisé au minimum à l'ensemble des établissements en ZEP et REP. Je dis « au minimum » car tout le monde est conscient que cette classification ne regroupe plus grand chose. En effet, une très grande quantité d'établissements en zone banale connaissent des situations de crise.
Pourquoi le système ne fonctionne-t-il pas dans les trois quarts des établissements ?
La première raison est très simple. Les participants à l'« Ecole ouverte » sont payés de façon scandaleuse. Ils sont payés 9,45 euros net par heure alors que les enseignants qui font de la formation permanente sont payés entre 32 et 37 euros par heure. L'écart de paiement est beaucoup trop fort. Veut-on des voitures qui flambent ou un système « Ecole ouverte » qui fonctionne ? Il y a un vrai choix collectif à faire.
J'en viens à la deuxième raison. La surcharge administrative que l'on impose aux principaux basculant en « Ecole ouverte » est délirante ; le diable est toujours dans le détail. Leur charge de travail administratif augmente en moyenne de 25 %. J'ai ouvert les placards pour voir ce qu'ils contenaient. J'y ai trouvé des fiches de paie à n'en plus finir, des formulaires délirants. Il est inadmissible, par exemple, que le travail de fiches de paie incombe aux principaux de collège. Je trouve extraordinaire qu'il y en ait autant qui le fassent ! Il y a vraiment des gens qui ont la République chevillée au corps et qui sont des militants de l'éducation populaire !
Il faut à tout prix revoir le système par bassin de ZEP et prévoir au minimum un gestionnaire pour soulager les principaux de collège de ce travail administratif, qui est énorme.
Ensuite, il faut mettre en place une vraie stratégie de diffusion. Actuellement, l'institution somnole avec un taux de croissance de 2,3 % par an. La meilleure stratégie consisterait à s'appuyer sur les établissements qui sont très militants pour l'« Ecole ouverte ». Dans chaque zone, la charge de la diffusion devrait revenir aux établissements. Les meilleurs prosélytes sont les praticiens.
Vous trouverez les autres points de la charte dans le document que je laisse à votre disposition.
Venons-en au traitement spécifique des multirécidivistes.
Je ferai juste une remarque d'ordre général.
On entend un peu partout que le Gouvernement a l'intention de créer des centres éducatifs renforcés ou fermés. Le « Relais civique » a mené une étude très intéressante à Chicago. Le patron de la police à Chicago nous a fait remarquer que la violence était un problème complexe ne pouvant pas être réglé par une approche unique. Il nous a conseillé d'adopter plusieurs stratégies, parfois contradictoires, afin de répondre à la diversité du genre humain. Car un système aura des effets sur certains enfants mais se révèlera inefficace sur d'autres.
Donc, si nous voulons que nos centres éducatifs fermés ou renforcés soient efficaces, ils doivent être variés. Il faut appliquer des protocoles différents. Il ne faut pas qu'un môme sur qui une expérimentation a échoué soit renvoyé dans les mêmes tuyaux ; il faut essayer autre chose.
L'association JET -Jeunes en équipes de travail- obtient de bons résultats, il faut l'écouter. Elle a de bons protocoles. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire du JET partout, cela signifie que leur modèle doit être étendu. Ce modèle doit devenir l'une des réponses.
Ma terreur, c'est que le Gouvernement s'enfonce tête baissée dans un modèle. Ce serait une folie pour notre pays. Cela me semblerait parfaitement déraisonnable.
Vous avez peut-être observé que le mot « protocole » revient dans tous mes propos. Ce qui me semble important, ce sont les pratiques. L'opération « Ecole ouverte » est une pratique, ce que l'association JET fait est une pratique. Pour aller plus loin et pour nourrir les travaux de commissions comme la vôtre, je publie un livre qui sort aujourd'hui pour que l'on crée en France une agence des pratiques. Je ne veux plus que le gouvernement de mon pays travaille en amateur. Je veux que l'on ait un outil de recherche et développement des pratiques, un outil d'évaluation. Je ne veux plus que l'on ait des effets d'annonce qui reposent sur des intentions alors qu'il y a tellement d'expérimentations évaluées.
Si l'on veut passer à un état de démocratie, si l'on veut que notre gouvernement ait un effet non marginal, il va falloir que l'on travaille avant tout les pratiques. La personne qui me précédait évoquait la « police de proximité » ; cela ne veut rien dire, ce qui est important, ce sont les pratiques que ces gens vont faire.
Au Relais civique, nous avons engagé une étude sur ce qu'il faudrait faire faire à la police de proximité. Qui a les bons protocoles ? Nous avons trouvé une diversité incroyable d'approches à travers le monde. J'aimerais que la France s'appuie sur les travaux d'une agence des pratiques. J'aimerais, en matière de police de proximité, que l'on enrichisse les pratiques des policiers qui en seront chargés, parce qu'il existe une foule d'expériences efficaces. Je vais vous en citer une qui fonctionne à Chicago. Pourquoi obtiennent-ils des chiffres aussi bons à Chicago ? Tout simplement parce qu'ils ont 42 programmes de ce type. Ils pratiquent la multithérapie.
L'un des programmes que j'ai trouvé intéressant, par exemple, consiste à demander aux policiers du quartier, au début de l'année scolaire, de sonner aux portes des immeubles pour organiser une réunion -cela s'appelle le « school bus program »- destiné à organiser un planning par immeuble afin de savoir qui accompagnera les enfants à l'école et qui viendra les chercher -puisque nous habitons au même endroit, nous avons intérêt à nous entraider.
L'intérêt premier, c'est que le flic de quartier discute avec les parents de la chose qui est la plus précieuse au monde pour eux. Donc le lien qui se tisse lors de la constitution de ces groupes est extrêmement précieux. Le deuxième intérêt, c'est que cela augmente le nombre d'adultes responsables dans la vie des enfants ; c'est très important. Le troisième intérêt, c'est que cela augmente le nombre d'adultes qui connaissent les enfants dans la rue.
Ce sont des stratégies indirectes. Nous en avons repéré des dizaines. J'aimerais que l'on passe au stade professionnel. Chez Peugeot, ils ont des centres de recherche et développement ! J'aimerais que notre police nationale puisse s'appuyer sur ces travaux évalués et quantifiés. Je suis convaincu, si on refait une grande loi sur la sécurité, avec un grand conseil national sur la sécurité, que l'on va travailler sur les « tuyaux », sur les lois et les structures ... et on va désespérer les Français.
J'espère que vous défendrez notre approche fondée sur les pratiques, qui me semble être la seule qui soit raisonnable.
Monsieur le président, je me permets de vous laisser un exemplaire de notre charte. Je voudrais ajouter, au cas où le principe d'une agence des pratiques vous intéresserait, qu'elle a de fortes chances de voir le jour. En effet, je souhaite qu'elle soit pilotée par un directoire de grands patrons de médias. J'ai déjà l'accord de sept poids lourds et, au rythme où vont mes travaux, je pense qu'ils seront une douzaine à la fin de la semaine prochaine. La force de frappe médiatique de cette institution rendra sa création probable. Je ne vois pas un gouvernement lui dire non !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Pour en revenir aux expériences que vous avez menées dans différents établissements avec l'opération « Lire et faire lire », quelle a été l'attitude de la communauté éducative en général et de l'Education nationale en particulier ?
M. Alexandre Jardin - Elle a été excellente. Nous avons pris la précaution de choisir comme opérateur principal la Ligue française de l'enseignement. Quand vous voulez diffuser une bonne pratique, il faut vous adresser à des gens culturellement voisins du monde que vous voulez approcher. La Ligue française de l'enseignement est en symbiose avec le monde enseignant. Ce n'était pas la secte Moon ... cela a été primordial.
La deuxième approche a consisté à créer un comité de soutien d'écrivains, le mouvement des écrivains français. Cela devenait très difficile de ne pas être pour.
Ce sont des approches indirectes. Quand on veut parler à des Japonais, il faut parler japonais ; il faut parler la langue de la culture d'un groupe, sinon on réveille des résistances.
Par ailleurs, j'ai tout de même rencontré quelques difficultés, principalement avec de très hauts fonctionnaires qui ne voulaient pas déroger à certaines coutumes à l'intérieur de l'Education nationale. J'ai fait sauter ces verrous administratifs d'une façon un peu sauvage par du lobbying médiatique, en me faisant inviter dans des émissions de télévision -je l'avoue. Je pense qu'aucun grand mouvement de réforme ne peut se passer d'un lobbying médiatique dans notre pays. Quand vous avez une bonne pratique, je crois qu'il faut un bon lobbying médiatique pour passer. C'est ce que nous avons appliqué. J'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à rencontrer l'assemblée des recteurs ; j'ai dû utiliser la menace lors d'une invitation chez Drucker. Cela a été efficace.
Ensuite, les gens de terrain règlent des problèmes de terrain, donc ils comprennent quand on vient les aider. Aujourd'hui, nos meilleurs militants pour le programme « Lire et faire lire » sont les inspecteurs d'académie. D'ailleurs, à mon énorme surprise, compte tenu des bêtises que l'on peut lire dans la presse, le « mammouth » n'existe pas. Sur le terrain, dans les départements, vous pouvez vous appuyer sur le corps des inspecteurs d'académie, vous pouvez leur demander de très grands changements. Ce sont des gens de terrain tout à fait responsables et efficaces, qui gèrent parfois des situations ingérables. La qualité de ces personnels m'a vraiment impressionné.
Effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des réticences, mais les périodes de crise ont ceci de bon qu'elles rendent les gens moins sûrs de leurs certitudes, ils sont plus prêts à réfléchir.
Puis nous avons été voir en amont les syndicats enseignants ; cela leur a beaucoup plu que le programme soit piloté par la Ligue française de l'enseignement et soutenu par les écrivains français. Je pense donc que nous ne rencontrerons pas d'obstacle majeur, d'autant plus que nos bénévoles sont hors du marché du travail. Ce sont des retraités et c'est fondamental. Ce programme me semble donc viable à très grande échelle. Pour ma part, je m'arrêterai lorsque 80 000 ou 100 000 écoles françaises y participeront. Alors, je crois que nous aurons vraiment fait avancer les problèmes de violence, mais pas tout de suite : il faut accompagner les élèves sur des années, tout au long du primaire.
M. le rapporteur - Je voudrais revenir sur le système dit « Ecole ouverte » puisque vous nous avez indiqué que seul un quart des établissements le pratiquait, ce qui est en effet loin d'être satisfaisant. Les collectivités locales, qui ont des compétences issues des lois de décentralisation, n'auraient-elles pas un rôle à jouer ? Certaines mesures de soutien, notamment de type contractuel, pourraient être mises en place avec les collectivités locales et pourraient être apportées par les enseignants, voire par des personnes extérieures. Nous l'avons mis en place en Rhône-Alpes avec le « Permis de réussir » et cela marche très bien.
M. Alexandre Jardin - J'y suis ultra-favorable, mais il faut que l'impulsion vienne du haut, quitte à sonner le rassemblement des collectivités territoriales pour faire ce que vous dites. Cependant, le taux de croissance actuel ne va pas. Je crois qu'il faut s'appuyer sur le système « Ecole ouverte » parce que vous avez beaucoup plus de chances de réussir à étendre un système qui est déjà acclimaté au sein d'une institution plutôt que de faire prendre une greffe extérieure. Vous avez déjà les militants au sein même de l'organisation ; vous avez des équipes qui savent vraiment ce que c'est et qui y sont extraordinairement favorables. En effet, la quasi-totalité des établissements qui sont devenus « Ecole ouverte » ont connu une baisse de la violence. Tout cela n'a rien de théorique ; la vie concrète des enseignants est devenue parfois très agréable.
Ces outils me semblent franchement solides, vraiment.
En ce qui concerne le traitement spécifique du noyau dur des « emmerdeurs » à l'intérieur d'un collège, mes conversations avec la direction de la Ligue française de l'enseignement me permettent de dire qu'ils seraient prêts à faire partie d'un tour de table de grandes associations nationales si les pouvoirs publics leur proposaient un accord-cadre pour étendre l'expérimentation d'Ajaccio, qui fonctionne déjà dans deux autres départements, à l'ensemble des départements. Il faut que les principaux de collège puissent exclure temporairement les enfants sans qu'ils sortent du système scolaire. Il faut leur offrir cet outil. Cela aurait un coût parfaitement négligeable par rapport à l'ampleur des dégâts qu'un noyau dur peut provoquer. Cela a marché dans 50 % des cas, je trouve que c'est déjà pas mal. S'agissant de l'autre moitié des élèves pour qui cela a échoué, cette organisation a tout de même permis au collège de respirer, de ne pas se retrouver le lundi matin avec un gosse qui donne une claque à un enseignant.
M. le rapporteur - Vous venez d'aborder le problème du collège, j'ai une question beaucoup plus large à vous poser concernant le collège unique : cette structure est-elle encore adaptée ?
M. Alexandre Jardin - Non !
M. le rapporteur - Vous venez de nous dire qu'il faut faire du sur mesure, je crois que ce n'est pas la meilleure structure pour y parvenir.
M. Alexandre Jardin - La plupart des acteurs de terrain savent que ce n'est pas une structure adaptée.
Dans la charte, vous verrez un certain nombre de pratiques qui se sont développées et qui m'ont semblé très efficaces au sein du collège unique. Fondamentalement, si on veut réduire la masse de la délinquance juvénile, il faut mettre plus d'enfants en succès. Un enfant en succès est un enfant qui cogne moins.
Comment font ces gens pour les mettre en succès ? Par exemple, un principe très simple a été appliqué. Si vous faites une classe qui est ressentie par les enfants comme une classe poubelle, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous allez en faire des fous furieux qui vont être extrêmement emmerdants à l'intérieur du collège. Si on ne vous avait laissé aucun avenir, vous seriez vous-mêmes devenu des gens assez pénibles.
Donc que font-ils ? Par exemple, certains collèges très créatifs ont installé une classe de sixième à effectif réduit et à pédagogie adaptée - ils ont donc cassé le dogme du collège unique. Moins d'élèves, d'autres méthodes : ils appliquent par exemple en cours de français les techniques de l'enseignement du français langue étrangère. Toute l'astuce, c'est que l'équipe enseignante est la même que pour la classe de sixième classique. Ainsi, en cours d'année, un gosse qui marche bien peut basculer dans la sixième classique. C'est beaucoup plus facile pour lui parce qu'il conserve les mêmes enseignants. Cette pratique a un très faible coût. Cette méthode montre que les gosses qui sont dans la sixième à effectif réduit ne sont pas dans un système barré. Or, c'est essentiel pour que l'on n'en fasse pas des fous furieux.
Ensuite, les collèges les plus inventifs que j'ai croisés ont développé des classes dites de « découverte des métiers » pour des élèves de quatrième et de troisième. En gros, ils ont allégé les programmes à la carte pour se recentrer sur ce qui était vital. Ils ont fait cela pour lutter contre la désertion sauvage des gamins. Nous avons un énorme problème, qui nourrit la délinquance des mineurs, de gosses qui disparaissent du système en cours d'année. Pour lutter contre cela, ils ont fait des classes de découverte des métiers en se recentrant sur les fondamentaux et en envoyant les élèves découvrir des métiers en faisant des stages.
L'intérêt est double. Tout d'abord, on garde le môme à l'école. On lui permet de poursuivre un apprentissage, même réduit. Ensuite, il n'est pas dans la rue. Il est occupé. Il découvre effectivement des métiers. Or je crois que l'objectif du collège est de donner un destin à chacun. L'intérêt de notre système, c'est que tout le monde puisse trouver sa place.
Or les collèges qui pratiquent cela sont parfaitement hors la loi. Dieu merci ! il y a des gens courageux. Il faut prévoir ce type de classe. Il faut pouvoir répondre à l'extraordinaire diversité des cas que le collège doit assumer.
Je crois qu'il serait stupide de lancer une guerre sur des slogans pour ou contre le collège unique parce que tout le monde va s'affronter. Si on part sur des pratiques, on ne va pas s'affronter ; les enseignants sont des professionnels qui ont le souci des enfants. Je crois qu'ils peuvent parfaitement comprendre cela.
Ma charte est remplie de pratiques de ce genre.
M. le rapporteur - Donner un peu d'air n'implique pas obligatoirement une modification du cadre législatif.
M. Alexandre Jardin - Il y a quelque chose, mais cela va devenir une guerre de religion en France. Les élèves de quatrième et de troisième ont souvent moins de quatorze ans et on n'a pas le droit de les envoyer en entreprise. Comment font les collèges ? Ils organisent de pseudo stages de découverte à statut scolaire. Il s'agit non pas de revenir sur des choses aussi fondamentales mais de créer des souplesses pour que la loi ne se retourne pas contre des enfants...
M. Bernard Plasait - Et contre des enseignants !
M. Alexandre Jardin - ... et par voie de conséquence, évidemment, contre les enseignants. Il ne faut pas que cette loi qui a été pensée à l'origine de façon généreuse et protectrice devienne hostile aux enfants.
Je crois que les aménagements ponctuels peuvent être conduits sous la responsabilité des équipes éducatives. Ce ne sont pas des négriers, ce sont des enseignants ; ce ne sont pas des fous, ce sont des gens grosso modo responsables. Il faut leur faire confiance pour accompagner ce genre d'aménagements. Sinon, on va continuer à se faire très plaisir avec l'idée du collège unique, mais cela ne marche pas. Les êtres humains sont différents. Finalement, tout le monde n'est peut-être pas fait sur le même moule ... il est peut-être temps de s'en rendre compte !
Dans la charte, vous trouverez non pas mes idées, mais leur pratique.
Mme Michèle André, vice-présidente - Quels sont les deux autres départements qui ont adopté le système mis en place à Ajaccio ?
M. Alexandre Jardin - Je ne les ai plus en tête, mais vous obtiendrez immédiatement la réponse en téléphonant à la Ligue française de l'enseignement, rue Récamier.
Mme Michèle André, vice-présidente - Quel type d'association prend en charge le suivi des jeunes qui sont temporairement exclus du système scolaire ?
M. Alexandre Jardin - C'est la FALEP elle-même qui a signé une convention avec un collège. Cette convention pourrait d'ailleurs servir de convention type puisqu'elle a au moins le mérite d'avoir été validée par des gens de terrain.
Principalement, la stratégie est simple. Il faut un temps pour que le môme souffle lorsqu'il y a eu un dérapage grave. Il faut que quelque chose se passe. Surtout, l'idée est toute simple, le protocole également, il faut que le môme sorte d'une logique de groupe pour passer à une logique de suivi individuel. Il faut qu'il sorte de son rôle et qu'il se trouve en face d'un adulte référent pour le moment où il va revenir dans le collège. Cela consiste à remettre un adulte référent dans la vie de ces gamins.
Après, on peut leur faire faire une foule de choses. La FALEP fait travailler les enfants dans un atelier de réparation de motos. Mais ce n'est qu'un prétexte ; ce qui est important, c'est que les horaires sont très rigoureux ; si le môme ne vient pas, on va le chercher dans sa chambre, c'est-à-dire que l'on a un suivi d'individu à individu.
Finalement, tous les collèges qui ont réglé leurs problèmes de violence ont compris qu'il fallait arrêter la spirale qui consistait à ne plus s'occuper des mômes qui posaient des problèmes. Plus un môme fait chier, plus il faut s'en occuper ! C'est tout simple.
Par exemple, tous les collèges qui ont vraiment réglé leurs problèmes -c'est un point de la charte- appliquent le principe d'exclusion-inclusion. Quand on vire un môme de cours, on ne doit pas le laisser traîner dans la cour ou dans les couloirs : il est tout de suite pris en charge par un emploi-jeune ou par quelqu'un et il fait ses leçons ; il est pris en charge dans une toute petite structure, c'est-à-dire qu'il passe d'un groupe de trente élèves à un groupe de quatre ou cinq. On resserre l'étau des adultes. Ces pratiques me semblent être efficaces.
M. Bernard Plasait - Je voulais faire une réflexion parce que je suis passionné par ce que vous nous dites, par les idées que vous exprimez et par les perspectives que vous ouvrez. Pour revenir aux expériences que vous avez citées telles que l'Ecole ouverte ou les classes de découverte des métiers, vous avez tout à fait raison, il faut aller dans ce sens. Il faut davantage de souplesse pour permettre à toutes les bonnes volontés de devenir efficaces, de s'exprimer, de pouvoir être « exploitées », au bon sens du terme. Cela veut dire qu'il faut redécouvrir de la souplesse dans un pays qui est perclus de rigidité, dans lequel il y a une surréglementation ; j'allais dire qu'il faudrait avoir la possibilité de réintroduire le risque dans les comportements...
M. Alexandre Jardin - Et la possibilité d'expérimentation.
M. Bernard Plasait - ... et même le risque tout court. Comme le dit Jacques Darmon dans son dernier livre, ce sont les ravages du principe de précaution. Si on avait appliqué le principe de précaution dès l'origine, l'homme des cavernes ne serait jamais sorti de sa grotte ! Or nous avons un système qui est terriblement étouffant, dans lequel un enseignant qui veut emmener sa classe à l'extérieur est obligé de respecter tellement de normes et de règlements que cela devient souvent impossible ou que c'est si contraignant qu'il finit par y renoncer.
Il faudrait réintroduire de la souplesse et le goût du risque, la possibilité du risque. Accepter qu'il puisse y avoir de l'expérimentation, c'est aussi accepter parfois que cela ne se passe pas très bien.
M. Alexandre Jardin - Oui, accepter l'échec. Je suis évidemment d'accord, sinon il n'y a pas de créativité dans un pays.
Mais tout ce que j'ai évoqué me semble possible à appliquer, pour un coût finalement marginal. Ce que j'ai découvert en travaillant sur les collèges qui résolvaient leurs problèmes, c'est que nos problèmes de délinquance juvénile peuvent être réglés et qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent. Bien sûr, il faut un peu d'argent, mais ce n'est pas crucial, ce sont vraiment des problèmes de pratiques.
Le programme « Lire et faire lire » a un coût parfaitement marginal par rapport à l'enjeu. On pourrait s'appuyer sur des masses de bénévoles, cela pourrait être un vrai mouvement populaire de réconciliation de la société avec son école. Ce qui est frappant dans les écoles qui pratiquent « Lire et faire lire », c'est que c'est une activité extraordinairement joyeuse. Pourquoi les retraités viennent-ils ? Ils viennent se faire plaisir ! Ils ont les petits sur les genoux. Il y a un vrai besoin chez les jeunes retraités de vivre avec des enfants ; les familles sont éclatées géographiquement et les jeunes retraités souffrent bien souvent de ne pas voir suffisamment leurs petits-enfants. Je crois donc que la piste du lien intergénérationnel est énorme. Si on réussit à faire de la France un peuple de lecteurs, nous n'aurons pas les mêmes problèmes de délinquance. Cela peut sembler utopique...
M. Bernard Plasait - C'est une belle utopie.
Mme Michèle André, vice-présidente - C'est très bien.
M. Alexandre Jardin - ... mais aujourd'hui ce n'est plus une utopie : ce mouvement fonctionne dans 87 départements. Donc je ne vois pas pourquoi on échouerait. Il n'y a aucune raison.
M. Bernard Plasait - Mais nous n'échouerons pas. Je peux même vous dire pourquoi : c'est parce qu'il ne faut pas que nous échouions !
M. Alexandre Jardin - Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix !
En tout cas, je sais que les écrivains français sont parfaitement prêts à s'engager dans un mouvement de médiatisation massive pour recruter ces troupes-là.
M. le rapporteur - Je voudrais revenir sur la méthode. Vous avez adopté une méthode « par le haut » ; vous pouvez vaincre les corporatismes parce que vous vous appelez Alexandre Jardin et que vous pouvez aller chez Drucker. Tout le monde ne peut pas vaincre la cohabitation perverse du corporatisme des caméras. A partir de là, on ne peut plus rien faire. N'y a-t-il pas une autre méthode, « par le bas », c'est-à-dire au niveau du terrain, de l'établissement, pour peu que l'on ait tracé un cadre législatif suffisamment adapté pour permettre ces expériences ?
M. Alexandre Jardin - Si, mais pour libérer, pour diffuser des pratiques, il faudra que « le haut » ne l'empêche pas.
C'est effectivement plus facile quand on est écrivain et qu'on a des millions de lecteurs, c'est pour cela que je veux mettre au directoire de l'Agence des pratiques une douzaine de médias fondamentaux de notre pays. S'ils ne sont pas partie prenante du système, ils ne le défendront pas forcément. Il faut maintenant faire jouer un rôle vraiment positif à nos médias, mais ils ne le joueront vraiment que s'ils sont intégrés au processus. C'est le pari de ce que j'essaie de construire en ce moment, exactement pour les raisons que vous venez d'indiquer.
Pourquoi ai-je une démarche qui est fondée sur les pratiques ? Quoi qu'il arrive aux prochaines élections, la droite ou la gauche passera à 52 % ou à 54 %. La majorité sera toujours marginale. Aussi, en France, dès qu'on nous dit qu'on va changer les structures et les grandes lois, en réalité les corporations descendent dans la rue, on redescend à 32 % et plus personne n'est courageux ! Alors que si on raisonne à partir des pratiques, on peut fédérer les Français.
Je crois qu'on peut fédérer sur des pratiques. « Lire et faire lire » est défendu par des conseils généraux de droite et de gauche sur tout le territoire parce que c'est une pratique.Si on veut passer à travers les corporations, il faut le faire sur des pratiques. Sinon, nous verrons ce que deviendront à l'automne tous les grands discours républicains quand les corporations seront descendues dans la rue. On connaît le scénario ! Alors que si on part sur des pratiques, on peut peut-être fédérer. C'est vraiment ma conviction.
L'Ecole ouverte, ce n'est pas une idée de droite ou de gauche, c'est un outil qui marche, même si cela vient de Lionel Jospin. C'est un outil qui a fait ses preuves, c'est la seule chose qui m'intéresse. Dans l'urgence où nous sommes aujourd'hui, il faut prendre les outils qui marchent, d'où qu'ils viennent. Le reste ne me semble pas raisonnable.
M. le rapporteur - Pour peu qu'on les ait expérimentés.
M. Alexandre Jardin - Mais la France a expérimenté beaucoup de choses. Je suis très heureux que vous ayez vu les gens de JET ; ce sont des gens exemplaires.
M. le rapporteur - Absolument !
M. Alexandre Jardin - Pour moi, ce sont des hurons, mais des gens exemplaires ... et efficaces !
M. le président - Nous vous remercions, monsieur Jardin .
Audition de M. Damien MULLIEZ,
Chef de l'inspection
des services
de la protection judiciaire de la
jeunesse
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Damien Mulliez, chef de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur Mulliez, pourriez-vous nous présenter l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse ? Comment est-elle organisée ? Quel est son programme de travail ? Combien d'inspecteurs employez-vous ? Comment deviennent-ils inspecteurs ? Avez-vous les moyens suffisants pour contrôler régulièrement l'ensemble des services qui sont placés sous votre contrôle ? Comment le travail de votre inspection s'articule-t-il avec celui de l'inspection générale des services judiciaires ? Enfin, estimez-vous que vous disposez d'une indépendance suffisante ?
M. Damien Mulliez - Lorsque j'ai pris mes fonctions de chef de l'inspection de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse voilà trois ans, je souhaitais modifier profondément cette inspection qui à l'époque était mal repérée. Ses procédures étaient mal connues. Ses missions, très personnalisées, fonctionnaient sous le sceau du secret. Les rapports n'étaient pas communiqués et les suites restaient assez confidentielles.
Par ailleurs, dans le domaine du travail social, les professionnels et les services sont réticents à tout ce qui est contrôle et évaluation de leur action, particulièrement sur le plan financier. Ils considèrent parfois comme incongrue l'intervention de contrôleurs et d'inspecteurs dans leur action éducative.
C'est une culture du travail social contre laquelle il nous faut lutter pour deux raisons. D'abord, les fonds publics sont à contrôler. D'autre part, le contrôle vaut reconnaissance de l'action des travailleurs sociaux qui ne bénéficient pas d'une réputation particulièrement valorisée dans l'opinion publique. Les contrôler est aussi un moyen de faire mieux connaître leur travail.
Tel a été l'objectif du travail que je mène depuis trois ans. L'administration de la protection judiciaire de la jeunesse m'avait donné une lettre de mission pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Cette démarche constituait alors un virage au sein de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de contrôle.
Le cadre de notre activité est déterminé par deux axes : d'une part, la loi et les règlements et, d'autre part, la lettre de mission.
L'organisation générale du contrôle des services de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur public comme du secteur habilité, est complexe. Elle est structurée en pyramide.
L'inspection générale des services judiciaires a compétence pour tous les services du ministère de la justice, donc également pour les services de la protection judiciaire de la jeunesse, mais elle intervient peu, sinon dans des affaires extrêmement sensibles. Ainsi, dans l'affaire du centre « cheval pour tous » qui a été récemment médiatisée, c'est l'inspection générale des services judiciaires qui est intervenue avec l'appui technique de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le service d'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, est un service qui est rattaché directement à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Je prends donc mes ordres auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Mais des missions de contrôle sont dévolues également aux directeurs régionaux et aux directeurs départementaux. Il convient de garder ce point à l'esprit lorsqu'on appréhende la question des moyens de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. De même, il existe à l'échelon territorial une mosaïque de contrôles qui peuvent être exercés, notamment par le ministère de l'Education nationale, le ministère des affaires sociales, le préfet et les conseils généraux. La loi du 2 février 2002 relative aux services exerçant une action sociale et médico-sociale prévoit la création d'un conseil national de l'évaluation et l'obligation pour les services de procéder à une évaluation interne.
Par conséquent, l'organisation générale du contrôle devient compliquée et nécessiterait au minimum une réflexion globale sur l'inspection et le contrôle de l'ensemble des services qui exercent des missions d'éducation spécialisée.
Force est de constater sur les territoires, par exemple, que les directeurs départementaux et les directeurs régionaux ne coordonnent pas leurs interventions de contrôle avec les conseils généraux et les services préfectoraux, si bien que les services peuvent voir arriver deux, voire trois contrôles successifs non coordonnés. C'est là une difficulté importante.
Le service de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse que je dirige a pour mission d'effectuer des contrôles administratifs, pédagogiques et financiers sur les services du secteur public, du secteur associatif habilité et les directions territoriales. Il s'agit au total de 15 directions régionales, 100 directions départementales, environ 400 services du secteur public et 1.100 établissements du secteur associatif habilité.
L'effectif d'inspecteurs passera de 3 en 1999 à 8 en septembre 2002, ce qui est une évolution significative.
Les objectifs de ma première mission étant considérés comme atteints, j'ai reçu récemment une nouvelle lettre de mission chargeant l'inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse de coordonner et capitaliser les outils de contrôle, afin de jouer en quelque sorte un rôle de ressource méthodologique auprès des directions territoriales, pour constituer une référence de contrôle qui traverse toute la chaîne hiérarchique de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ma nouvelle mission consistera non seulement à effectuer les contrôles habituels mais aussi à coordonner et constituer une boîte à outils et des référentiels de contrôle qui seront mis à la disposition de l'ensemble de nos services.
Les objectifs qui étaient fixés par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse il y a trois ans étaient les suivants : il s'agissait en premier lieu d'apporter une contribution plus importante à la réflexion générale sur l'évolution de la protection judiciaire de la jeunesse, particulièrement en développant une activité dans le domaine de l'évaluation.
A ce titre, nous avons mené pendant ces trois années trois études spécifiques portant, la première, sur l'organisation du temps de travail dans 15 établissements recevant des mineurs en hébergement, la seconde, sur l'organisation du travail dans 20 services de milieu ouvert. Enfin, nous menons actuellement une étude de recherche d'indicateurs sur des risques de crise et de blocage d'établissements en particulier à la suite d'actes de violence commis par des mineurs dans leurs murs.
Le second objectif visait l'établissement d'un projet de service abordant en particulier la méthodologie de l'inspection, c'est-à-dire la définition d'un référentiel méthodologique de contrôle. Ce projet de service a été déposé en octobre 2001. Il fait l'objet aujourd'hui d'une publication dans, l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse et auprès des fédérations d'associations, toujours dans le souci de garantir une lisibilité du contrôle, de le rendre public et de constituer un référentiel de contrôle. J'insiste sur le fait que nous évoluons dans un contexte culturel hostile à tout contrôle, nécessitant une vigilance de tous les instants.
Les objectifs de ma nouvelle lettre de mission visaient donc à capitaliser les acquis, à constituer des référentiels méthodologiques pour l'ensemble de l'institution et à faire des propositions plus particulières sur les procédures de saisine et de suivi des inspections sur l'évaluation de leur mise en oeuvre.
J'aborderai d'emblée la question de l'indépendance. Je dispose objectivement depuis trois ans d'une réelle indépendance dans la mise en oeuvre des objectifs qui m'ont été donnés. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse me fixait des objectifs à atteindre et il m'appartenait de mettre les moyens en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Je dispose donc aujourd'hui d'une indépendance certaine quant à la manière de mener les missions.
Nous avons instauré une dimension contradictoire dans ces inspections. Dorénavant, tout document, tout écrit, est adressé aux personnes concernées qui nous font part de leurs observations écrites, lesquelles sont intégralement mises en regard de nos observations dans le document final. C'est le document final qui est transmis à la protection judiciaire de la jeunesse et non pas le document d'origine.
Nous avons mis en place un certain nombre de procédures qui ont été acceptées par l'actuelle direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles nous permettent de travailler avec une réelle autonomie professionnelle, sinon d'indépendance puisque nous recevons nos ordres.
Cela étant, le statut actuel de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse implique que cette marge d'autonomie, voire d'indépendance, dépend essentiellement de la confiance que le directeur accorde à son service. Si, demain, un directeur estimait que notre fonctionnement sur un mode contradictoire ne lui convenait pas, je serais tenu d'appliquer ses instructions. Tel est le statut de ce service.
Aujourd'hui, une réflexion est menée par l'inspection que je dirige et la direction autour de la notion de contrôle. Une inspection a-t-elle sa place dans une direction ? Cette interrogation rejoint une réflexion plus large sur la question de savoir si l'organisation des inspections du ministère de la justice permet un travail effectif de contrôle auprès des différents services et les professionnels.
Le ministère de la justice dispose de quatre inspections : l'inspection générale des services judiciaires, l'inspection de l'administration pénitentiaire, l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse et la mission des greffes qui exerce des contrôles auprès des greffes. Depuis 1990, le souhait de voir une inspection générale du ministère de la justice a été régulièrement exprimé sans se concrétiser, n'étant pas une question prioritaire au regard du contexte et des échéances politiques. Il nous semble souhaitable aujourd'hui que l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse ne soit plus rattachée directement à la direction et qu'elle soit extérieure.
Cela étant, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est une direction qui gère encore des services et qui se doit de mettre en oeuvre une politique. Il apparaît indispensable de conserver en son sein un organe, un outil de contrôle, d'évaluation interne de la mise en oeuvre et du suivi des politiques. Il s'agit d'instaurer une ligne fonctionnelle qui permette d'accompagner lesdites politiques, de mesurer les écarts, mais aussi le caractère opérationnel des choix politiques effectués. C'est en quelque sorte un circuit d'aller et retour.
L'inspection essaie de développer actuellement cette dimension bien que cette dernière semble relever davantage d'un organe politique. L'inspection, pour sa part, devrait être rattachée à un outil extérieur de contrôle général du ministère de la justice. Tel est l'état de nos réflexions à ce jour sur le travail de l'inspection.
S'agissant de l'élaboration du programme, je vous indique que nous avons abandonné l'idée de programmation. Je m'explique : lorsque j'ai pris la direction de l'inspection avec un effectif de trois inspecteurs, parler de programme relevait de la gageure. Dès qu'une urgence se présentait, le programme était arrêté et trois ans plus tard nous n'avions toujours pas réalisé le programme.
J'ai alors décidé, sur ma propre initiative, de mettre fin au principe de la programmation et d'établir des règles différentes. Nous intervenons à la demande de la direction. Nous disposons d'une relative autonomie pour faire des propositions d'études transversales sur un bon nombre de services, plutôt que de mener des inspections générales service par service.
Par exemple, à la suite d'une inspection classique, nous avons proposé à la direction d'étudier la question de l'organisation du temps de travail des personnels et de l'articulation entre l'organisation du temps de travail et la prise en charge des mineurs en hébergement. Cette approche nous a permis de travailler avec 20 services plutôt que 1+1+1 et de recourir à un mode participatif. Les professionnels ont accepté de rentrer dans cette dimension de travail et d'ouvrir leur emploi du temps quotidien, ce qui n'était pas gagné d'avance. Nous avons pu ainsi conduire un véritable travail de réflexion avec les professionnels, introduisant une autre dimension dans nos travaux.
Cela étant, je maintiens que le programme relève de la gageure encore aujourd'hui, même avec un effectif accru en septembre prochain. A titre d'exemple, j'ai testé les travaux qui ont été faits depuis trois ans. Nous avons eu deux inspections communes avec l'IGAS et l'IGSJ notamment, en particulier sur la question du placement et sur l'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance dans les Alpes-Maritimes. Nous avons effectué 12 contrôles d'actions financées par le fonds social européen, en vérifiant l'éligibilité des actions ainsi que l'utilisation des fonds. Dans certains cas, nous avons été amenés à rendre des ordres de reversement, mais d'une manière générale, les programmes étaient plutôt bien menés. Trois établissements du secteur associatif on pu être inspectés et 10 établissements du secteur public. Trois inspections ont été essentiellement financières, ce qui représente un axe fort aujourd'hui.
Chaque fois que nous menons une inspection, les trois aspects, financier, administratif et pédagogique sont menés de front. Il n'est pas question de nous limiter à une évaluation de l'action pédagogique, mais bien à un moment donné d'évaluer l'investissement et le travail rendu. Il ne s'agit pas du « retour sur investissement » mais presque. Un investissement en fonds publics doit trouver une réponse dans la mise en oeuvre d'une politique et de l'action éducative.
C'est une mission qui reste très difficile à mener dans le champ du travail social. Elle requiert beaucoup d'explications. Elle commence toutefois à entrer dans les moeurs.
L'étude que nous menons actuellement porte sur les indicateurs de crise. A la suite de l'interruption du fonctionnement de certains services ayant connu des violences, il nous est apparu inutile de chercher uniquement à stigmatiser des comportements professionnels. Il nous paraît essentiel aujourd'hui d'essayer de repérer les causes de la fragilité qui se manifeste à certains moments dans des services et de se doter des outils de contrôle de gestion pédagogique, comme on se doterait d'outils de contrôle de gestion. C'est dans cet esprit que nous souhaitons travailler.
Mais le nombre d'inspections dans le secteur associatif habilité est insuffisant : trois inspections en trois ans, c'est extrêmement peu compte tenu du rapport entre le nombre de services dans le secteur public et dans le secteur habilité.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse avait souhaité mettre l'accent sur ces services afin de répondre à la pression d'une demande politique forte qui est intervenue voilà cinq ans et qui s'est renforcée depuis. Cette pression n'a pas toujours existé auparavant et il a fallu remettre en route la protection judiciaire de la jeunesse pour répondre à cette demande.
Je formulerai un dernier constat au regard de l'élaboration d'un programme : je ne peux que regretter que l'urgence soit devenue le mode de fonctionnement classique et permanent. Ce que vivent aujourd'hui, et j'y reviendrai tout à l'heure, les magistrats et les services éducatifs est en train de nous toucher, nous, au sein de l'administration, notamment de l'inspection. Nous avons le sentiment de ne plus agir que dans l'urgence, c'est-à-dire qu'une mission communiquée aujourd'hui doit être effectuée pour demain. Les missions arrivent à l'improviste. Bien sûr, elles font partie de notre travail et nous nous préparons à devoir intervenir dans l'urgence. Mais l'urgence et l'immédiat semblent devenir un mode fonctionnement qui nuit au travail de réflexion. Nous mettons donc en place des méthodes de travail en nous attachant à les respecter pour éviter d'être trop perturbés par ce fonctionnement dans l'urgence.
Quelle est la composition de l'inspection ? J'ai mentionné les effectifs d'inspecteurs. L'objectif est de diversifier les recrutements. Nous avons établi des fiches de postes, avec l'indication des compétences que nous recherchons. Les fiches ont été constituées en collaboration avec l'ensemble du service et validées par la direction. Les recrutements sont destinés à assurer des fonctions de contrôles financiers, administratifs et pédagogiques.
Actuellement, l'inspection est composée de deux anciens directeurs départementaux qui ont été éducateurs et directeurs de service. L'un d'eux a occupé la fonction de directeur de service du secteur associatif habilité. Il a des connaissances pointues en matière de gestion, notamment dans le secteur associatif.
En septembre, l'inspection comprendra également trois directeurs de service qui ont exercé dans les différents types de services de la protection judiciaire de la jeunesse et qui ont également occupé des fonctions d'adjoint dans des directions territoriales ou dans des lieux de formation. Nous recruterons également un attaché principal qui a une expérience dans d'autres administrations, ainsi que dans une direction départementale et une direction régionale. Mon objectif est de recruter à moyen terme un second attaché, spécialiste en gestion, ainsi qu'un magistrat qui arrivera en septembre. Ayant déjà travaillé dans une organisation non gouvernementale, il a une connaissance du fonctionnement du secteur associatif.
Tels sont les moyens dont nous disposons actuellement.
Ces moyens sont-ils suffisants pour contrôler l'ensemble des directions départementales et leurs services ? Certainement pas. Mais je n'irai pas jusqu'à réclamer des moyens pour réaliser l'inspection transversale dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui couvre près de 2 000 structures.
En revanche, plusieurs réflexions sont à mener. Il s'agit d'abord d'évaluer la masse de travail à effectuer compte tenu du nombre de structures susceptibles d'être inspectées. Ensuite, il s'agit de déterminer comment on peut articuler les missions de contrôle des directeurs territoriaux avec celles des autres institutions locales, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale -les DDASS-, les préfets, les conseils généraux et les commissions régionales des oeuvres sanitaires et sociales qui sont désormais chargées de valider les services de la protection judiciaire de la jeunesse en application de la loi du 2 février 2002. Comment articuler ces missions de contrôle avec celles de l'administration centrale ? Enfin, qu'attend-on exactement d'une mission d'inspection ?
Je relève que les missions que nous avons effectuées, par exemple avec l'IGAS et L'IGSJ ces trois dernières années, sont essentiellement des missions d'études. Les demandes qui sont adressées aux inspections visent de plus en plus à préparer et argumenter des politiques. Même si elles restent centrées sur le contrôle administratif pur et sur la manière de servir des professionnels, la demande d'un outil d'évaluation est croissante.
Dans ces conditions, quelle dimension convient-il de donner à ces inspections ?
La déconcentration des services et la réforme de l'Etat est aussi une dimension à prendre en compte dans une réflexion sur l'inspection.
Enfin, il importe de se pencher sur la réorganisation de la fonction d'inspection d'une manière générale au sein du ministère de la justice.
Il me paraîtrait préférable de commencer par mener l'ensemble de ces réflexions sur l'organisation du travail avant de demander une accumulation de moyens.
A propos de l'indépendance, j'ajoute un dernier élément qui vient encore renforcer notre souhait de voir se constituer une inspection générale. La protection judiciaire de la jeunesse étant une petite administration, tous les personnels de l'inspection sont connus et connaissent beaucoup de monde au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'ensuit un contexte de travail parfois particulier qui réclame, notamment de ma part, une grande vigilance au regard des questions de méthodes et de déontologie. Le positionnement de l'inspection est parfois difficile dans un milieu où des personnes se rencontrent quotidiennement depuis des années et ont pris des habitudes, notamment de tutoiement, dans une culture qui facilite ce type de relations.
C'est peut-être l'indépendance la plus difficile à gagner à travers des choix méthodologiques. Nous nous efforçons d'y parvenir.
M. le président - Vous avez dit tout à l'heure que parmi les personnels dont vous pouvez disposer et qui contribuent à l'inspection, figurent les directeurs régionaux. Dans quelle mesure un directeur régional n'est-il pas trop impliqué pour pourvoir en quelque sorte « s'auditer » lui-même ?
M. Damien Mulliez - J'ai dû commettre un lapsus. Nous n'avons pas de directeurs régionaux. Nous avons des directeurs départementaux. En revanche, les directeurs régionaux ont des missions de contrôle au sein de leur propre région, tout comme les directeurs départementaux.
M. le président - Cela va de soi. Dès lors que l'on dirige un service, on doit déontologiquement s'interroger.
M. Damien Mulliez - Tout à fait.
M. le président - Personnellement, je dirige une mairie. Je m'interroge en permanence pour savoir si mes services fonctionnent bien. Au sein des missions d'inspection, c'est évidemment plus compliqué, mais il semble difficile de s'inspecter soi-même.
M. Damien Mulliez - Oui, je pense que c'est difficile de s'inspecter soi-même. En revanche, il est absolument nécessaire de se doter d'outils politiques d'évaluation. C'est pour cela que j'ai le sentiment qu'une inspection comme celle que je dirige est un peu entre deux chaises à l'heure actuelle. Elle est tiraillée. Certains d'entre nous doivent faire des choix. S'il devait y avoir un jour une inspection extérieure et un outil politique de contrôle et d'évaluation, quelle profession serons-nous appelés à exercer ?
M. le président - Au cours de nos visites sur place et de nos entretiens, il est apparu que certains établissements sont sous-occupés. Tel ou tel établissement prévu pour huit jeunes en accueille cinq, chacun semble se satisfaire de ce résultat. Certes, moins il y a de jeunes et mieux ils sont encadrés. Mais au regard de l'utilité de la dépense publique, on peut aussi s'interroger. Vos travaux d'inspection portent-ils sur cet aspect ? Quel est votre sentiment à ce sujet ?
M. Damien Mulliez - C'est là une réelle difficulté qui se pose à la protection judiciaire de la jeunesse. Si nous avions un sentiment à exprimer à ce sujet, je dirais que la question des méthodes de travail est aujourd'hui prioritaire pour travailler dans cette institution.
Le contexte de travail a considérablement changé. Il se dit dans le milieu que les anciens n'ont pas laissé d'héritage technique aux jeunes et que la transmission des savoir-faire ne s'est pas faite. Pour ma part, je n'en suis pas convaincu. Comme dans tout le domaine social, la prise en charge des jeunes qui nous sont adressés représente une vraie difficulté. Elle est en plein évolution et, de ce fait, la question des outils méthodologiques est devenue centrale. Ce n'est pas parce que les gens sont éducateurs qu'ils sont techniquement immédiatement opérationnels. Les populations que nous recevons ont énormément changé. Leurs stratégies mêmes se sont transformées. Nous avons affaire à des populations qui sont vivantes. On a parfois tendance à les réifier en estimant qu'il faut les placer dans tel type d'établissement pour que la prise en charge fonctionne. Ce n'est pas le cas. Les populations nouvelles ont des stratégies dans notre direction. C'est pourquoi les méthodes de travail et les outils techniques doivent indiscutablement être revus aujourd'hui.
On est parfois tenté de dire que si les établissements ne sont pas pleins, c'est que le personnel ne fait pas son travail. Ce serait aller trop vite en besogne. Force est de constater que ces mineurs qui sont accueillis dans les services du secteur public ont tous un parcours antérieur dans le secteur associatif habilité. C'est ce que démontre un travail de recherche d'indicateurs que nous avons mené sur un CPI. Tous ces jeunes ont été exclus à un moment ou à un autre de ces services. Les magistrats l'ont accepté. Ils ont donné des mainlevées et ont confié ces mineurs aux services du secteur public qui en viennent à exploser, comme cela a explosé ailleurs.
L'ensemble du secteur du travail social doit s'interroger sur ses outils techniques et méthodologiques. Nous sommes en difficulté technique pour travailler avec une partie de cette population. Nous recevons un certain nombre de mineurs qui sont très installés dans des réseaux économiques. Ils vivent avec des moyens que nous n'imaginons pas. Un jeune de 14 ans qui fait le guet pour une équipe ou qui sert de relais, peut gagner plusieurs centaines de francs par jour. Lorsqu'il arrive dans des services éducatifs et d'insertion, il faut réussir à le convaincre de l'intérêt de rester dans ce type de prise en charge. La question est centrale.
Sur le fait que les mineurs restent ou pas, je n'aurai pas d'autres arguments que ceux-là. Ce sont ceux que j'aurais envie de travailler et de développer.
M. le président - Je vous livre en vrac les autres questions que nous souhaitions vous poser. Quelle est l'appréciation que vous-même avez été amené à porter sur le fonctionnement des services, sur les relations entre la protection judiciaire de la jeunesse et les magistrats, sur les moyens financiers et sur les profils des personnels ? Pourquoi les vacances de poste paraissent-elles aussi durables ? Que pensez-vous du fonctionnement des services éducatifs auprès du tribunal pour enfants, les SEAT ? Les centres de placement immédiat, les centres éducatifs renforcés vont paraissent-ils bien adaptés ? Ne faut-il pas changer ces structures ? Vos services sont-ils en mesure d'effectuer un contrôle financier et pédagogique sur les établissements du secteur associatif ? Question redoutable, vos observations et recommandations sont-elles suivies d'effet ? Avez-vous des exemples à donner de réussites et, hélas, d'échecs ? Dans les rapports de l'inspection des cinq dernières années, des critiques ont été émises à l'égard de certains magistrats. En ont-ils connaissance et une suite y est-elle apportée ? Enfin, quelles sont les améliorations qui vous paraissent de nature à faciliter le travail de la protection judiciaire de la jeunesse et à la rendre plus efficace ?
M. Damien Mulliez - Vastes questions ! Je n'y apporterai que des réponses que je veux humbles et cadrées uniquement sur les inspections que nous avons pu mener.
En premier lieu, s'agissant des relations entre les magistrats et le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, force est de constater une dégradation au cours de ces dernières années. A cet égard, il convient de distinguer les relations entre, d'une part, les magistrats et les services du secteur public et, d'autre part, les magistrats et les directeurs territoriaux.
Dans le domaine de la prise en charge des mineurs, les magistrats tiennent clairement des propos très durs à l'égard de la capacité de la protection judiciaire de la jeunesse à prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés. Ils stigmatisent des refus de prise en charge de la part d'établissements en sous-effectif ou en crise régulière, des listes d'attente et des délais trop longs de prise en charge. C'est l'incapacité de prendre toute mesure qui est mise en cause.
En revanche, dans le domaine de l'application des politiques publiques, les relations avec les directeurs territoriaux sont meilleures. L'appréciation que portent les magistrats sur les directeurs territoriaux dans leur rôle de mise en oeuvre de politiques publiques est plutôt positive.
Réciproquement, les services de la protection judiciaire de la jeunesse émettent également des critiques assez sévères à l'encontre des magistrats. Nos services considèrent qu'un certain nombre de magistrats prennent des positions qui sont de nature à casser techniquement le travail éducatif, notamment dans les cas de mineurs confiés sans audience, de services qui ne sont pas entendus par les juges, de décisions en matière de contrôle judiciaire, ou de sursis avec mise à l'épreuve, qui vont à l'encontre des textes. Alors que l'éducateur a mené tout un travail sur le mineur en lui disant : « Si tu ne respectes pas le contrôle judiciaire, tu risques de te retrouver en détention », le magistrat déclare au moment de l'audience qu'il décide de ne pas révoquer le contrôle judiciaire. Il en résulte une incohérence complète. S'il s'agissait d'adultes, cela me dérangerait moins. Ce qui me crée une difficulté dans ce genre de relation, quelle que soit la responsabilité des uns et des autres, c'est que cette incohérence suscite l'incompréhension du mineur et entraîne rapidement une toute puissance de l'adolescent qui a remarqué les failles et s'y engouffre aussitôt. Tous les conflits de ce type aboutissent à un espace de toute puissance des adolescents, ce qui est extrêmement préjudiciable.
Il ne s'agit pas d'une situation de conflit généralisé. Néanmoins, elle est préoccupante. Dans certains services, les critiques sont parfois très violentes. Je n'oublie pas cependant, et je pense que mes collègues magistrats le savent, que bon nombre de mineurs qui arrivent dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse ont effectué de multiples passages dans d'autres services qui ne font pas l'objet des mêmes critiques. Sans doute la dimension des représentants de l'Etat des services de la protection judiciaire de la jeunesse facilite la critique.
L'analyse que nous en faisons est la suivante : il y a une dimension institutionnelle et historique extrêmement importante. A l'origine, il a fallu créer la protection judiciaire de la jeunesse en la détachant de son ancienne appartenance à l'administration pénitentiaire. Les juges pour enfant ont dû se créer une identité au sein d'un corps où l'on disait « justice des mineurs, justice mineure ». Cet état d'esprit a duré extrêmement longtemps.
Obligatoirement, les magistrats et les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ont en quelque sorte fusionné. A l'époque, un juge disait « mon délégué à la liberté surveillée » et le délégué à la liberté surveillée disait « mon juge ». Le juge notait le délégué à la liberté surveillée.
Progressivement, la protection judiciaire de la jeunesse s'est constituée comme une administration avec des politiques publiques et des axes prioritaires. Les parquets sont intervenus et ont occupé une place extrêmement importante auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, s'agissant en particulier de ce qu'on a appelé la troisième voie et du traitement en temps réel qui a monopolisé une grande part de l'action des SEAT.
Lors de l'émergence des politiques publiques, les juges des enfants sont limités à une activité juridictionnelle, alors que la protection judiciaire de la jeunesse recevait des instructions pour s'investir dans les politiques publiques. Les magistrats pour enfants étaient extrêmement réticents, comme tous les magistrats du siège d'ailleurs, à s'impliquer dans ces politiques publiques, au nom de leur indépendance, ce qui peut s'entendre d'ailleurs. Le parquet, lui, investissait massivement dans ce domaine. Les champs d'intervention se sont trouvés complètement déplacés. C'est sans doute pourquoi les parquets se montrent moins critiques à l'égard des services de la protection judiciaire de la jeunesse que ne le sont les magistrats du siège.
La protection judiciaire de la jeunesse a dû appliquer des programmes politiques. Il ne faut pas se dissimuler l'importance de cet élément du débat. Les magistrats ne se sentent pas tenus par des orientations politiques, qui en elles-mêmes sont légitimes. En revanche, la protection judiciaire de la jeunesse se doit d'appliquer ces orientations parce qu'elle est une administration. Il y a là deux logiques qui, au premier abord, ne peuvent pas cohabiter. Cependant, il va falloir qu'elles s'articulent. C'est la nouvelle dimension de la protection judiciaire de la jeunesse. Le fait que la protection judiciaire de la jeunesse soit au centre des débats politiques et des décisions politiques, le fait que ce soit un conseil de sécurité intérieure qui ait décidé de la création de nouvelles structures au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, tout cela est éminemment nouveau.
De 1958 à 1990, la protection judiciaire de la jeunesse n'avait quasiment pas d'orientation politique autre que celle qui était fixée par sa direction ou par le ministère de la justice. La préoccupation politique à l'égard de la prise en charge des mineurs n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Maintenant, des glissements se sont produits et certains magistrats reprochent à la protection judiciaire de la jeunesse de ne pas résister à tel ou tel type de demande en matière de répression. La protection judiciaire de la jeunesse n'a pas à résister ou à ne pas résister. Elle a la possibilité d'argumenter et de débattre dans la phase préalable à la mise en oeuvre, mais une fois que la décision politique est prise, la protection judiciaire de la jeunesse est tenue de l'appliquer. Le rôle des magistrats est de faire appliquer les textes votés, c'est-à-dire la loi. La rencontre de ces deux logiques différentes provoque un certain nombre de conflits.
Un dernier élément contribue à instaurer une situation conflictuelle, qui n'est pas propre au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse : il s'agit de l'urgence dans laquelle les professionnels sont appelés à travailler. Je veux alerter sur ce problème.
En effet, le travail des magistrats pour enfants, des parquetiers de mineurs et des services prenant en charge des mineurs est dominé par la notion d'immédiat. L'urgence domine. On a le sentiment qu'aujourd'hui la réponse prévaut sur le contenu de la réponse et que le bon professionnel est celui qui répond. A la limite, au regard de l'opinion, ce qu'il répond importe moins que le fait qu'il ait répondu. Ce phénomène est assez grave de mon point de vue, parce qu'il tend à figer la pensée et à disqualifier l'action même d'éduquer. Chacun sait que l'éducation, ne serait-ce que celle de nos propres enfants, n'est pas une action immédiate. L'action éducative demande du temps, de la répétition, de la présence et ne peut s'inscrire dans l'immédiateté.
Une décision qui est prise aujourd'hui à l'égard d'un délinquant ne va pas le changer demain en un jeune inséré dans la société et ayant intégré toutes les valeurs de la République. Il va falloir du temps pour atteindre ce résultat. Bien entendu, la rapidité de la réponse sur les plans technique et pédagogique est essentielle pour un adolescent délinquant, mais elle ne doit pas nuire à un travail à plus long terme.
Or un certain nombre de professionnels voient leur action éducative au sens classique du terme disqualifiée au profit d'une réponse sans cesse plus rapide et privilégiant le spectaculaire par rapport au fond. Il s'agit moins de répondre au mineur que de faire face à une demande extérieure qui est tout aussi légitime. Quand le juge applique la loi au nom du peuple français, il doit tenir compte de ce contexte.
M. le président - Votre réflexion rejoint la question suivante que je me pose au fil des travaux de la commission d'enquête : quelle est la validité des stages de trois mois dans les centres éducatifs renforcés ?
M. Damien Mulliez - Paradoxalement, je considère que le centre éducatif renforcé est la meilleure réponse qui existe aujourd'hui, parce qu'il garantit d'une durée effective de prise en charge. Même si elle n'est que de trois mois, elle est effective, à présence quasi constante et dans des activités partagées. C'est une condition qui me paraît essentielle et incontournable dans le cadre de l'éducation d'un adolescent. Cette condition n'est pas remplie dans le fonctionnement d'un établissement classique d'hébergement à plus long terme, voire de plusieurs années, où l'organisation du temps des professionnels repose sur le fractionnement plutôt que sur la continuité.
La prise en charge de trois mois dans le cadre des centres éducatifs renforcés a été pensée également comme une période de recadrage pour permettre au délinquant de réintégrer ensuite des prises en charge plus classiques. Mais c'est là où nous rencontrons une difficulté. En effet, au terme de la période de trois mois, plus personne ne veut prendre en charge les jeunes issus de ces stages.
A cet égard, il y a lieu de s'interroger sur l'organisation du travail social aujourd'hui et sur le positionnement des professionnels. Ceux qui refusent de recevoir ces mineurs agissent comme s'ils pensaient que de toute façon ces adolescents ne peuvent pas changer, comme s'ils ne croyaient plus à la capacité de changer la trajectoire d'un jeune délinquant. Cette attitude touche la totalité des services qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine, au-delà de la protection judiciaire de la jeunesse.
Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos : pourquoi les services du secteur associatif ont-ils les mêmes difficultés que nous à recruter des professionnels qualifiés ? Certains conseils généraux vont même jusqu'à offrir des bourses d'études à certains éducateurs contre l'engagement de ces derniers de venir travailler dans leur service comme éducateurs spécialisés. En réalité, les éducateurs spécialisés privilégient le secteur du handicap, des instituts de rééducation. Ils ne s'orientent plus facilement vers des maisons d'enfants à caractère social ou des établissements hébergeant des adolescents, en raison de l'image inquiétante de violence qui est attachée à ces établissements, rendant tout travail impossible.
Que nous rapportent les centres éducatifs renforcés ? Ce sont précisément les stages qui y sont effectués qui devraient nous inciter à entamer une réflexion sur la manière d'organiser nos services. Qu'est-ce qui fait que les CER fonctionnent ? Leur fonctionnement s'appuie sur un projet. Des professionnels se voient assigner des objectifs dans le cadre d'un cahier des charges, mais ils disposent d'une autonomie pour déterminer les moyens de les atteindre. Ils sont d'abord chargés d'élaborer un projet qui doit être validé par un comité de pilotage. Ensuite, ils ont une certaine marge de manoeuvre pour recruter les personnels, en fonction non pas d'un profil ou de parcours types, mais des objectifs, du projet et des jeunes qui sont accueillis.
Dans le secteur public, les conditions de recrutement ne nous permettent pas de travailler sur ce modèle-là. Les discussions internes à la protection judiciaire de la jeunesse évoquent régulièrement les notions d'expérimentation et de projet. En effet, si l'on veut demander à des professionnels de remplir une mission extrêmement complexe, mais pas impossible, qui consiste à la fois à garantir la paix publique et à permettre à des adolescents impliqués dans des circuits délinquants depuis des années de retrouver les repères qui leur manquent, il importe de valoriser ces personnels, de leur donner une marge d'autonomie. Plus on détermine ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, plus on contribue à les discréditer.
S'agissant des moyens financiers, je m'exprimerai en me référant aux inspections qui sont effectuées actuellement et en précisant que mon point de vue se trouve limité par la connaissance que j'ai du terrain.
Ces dernières années, la protection judiciaire de la jeunesse a connu une augmentation considérable de ses moyens. C'est là une avancée qui, sans aucun doute, doit se poursuivre, compte tenu de l'importance de la commande publique.
Cela étant, au regard des constats, la question des moyens telle qu'elle est posée me paraît moins prioritaire que la nécessité de définir les finalités et les objectifs que l'on se donne, afin de ne pas reproduire le schéma selon lequel on reste en l'état et on réclame de plus en plus de moyens. Redéfinir les finalités, retravailler sur des projets, tel est le sens du projet de conférence unique de programmation et de la loi organique du 1er août 2001 qui a introduit l'obligation de travailler sur des objectifs. Ainsi, la reconduction des moyens ne sera plus quasi automatique, mais fondée sur l'évaluation des résultats, des programmes et des objectifs. Cette logique est incontournable dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse, comme dans l'ensemble de l'administration et dans l'Etat. C'est, à mes yeux, un point central de la réforme de l'Etat
Il s'ensuivra pour nos services une obligation de transparence. C'est un fait nouveau. Jusque là, les services éducatifs ne donnaient pas d'information sur ce qu'ils faisaient puisque personne ne le demandait. Aujourd'hui, ils font l'objet d'une demande très forte à cet égard et ils vont devoir trouver des outils pour y répondre.
Sur la question du profil des personnels, j'ai constaté que les nombreux jeunes professionnels que je côtoie n'ont pas un potentiel inférieur au mien ou à ceux de mes collègues en début de carrière au même âge. Il n'y a pas une génération qui serait perdue et des anciens qui auraient tout le savoir. Il n'y a pas un profil intemporel du bon éducateur. Les éducateurs d'aujourd'hui véhiculent les valeurs de la génération à laquelle ils appartiennent. A la question de savoir s'ils sont moins bons ou moins motivés, je réponds qu'une étude effectuée en 1996 montre que les jeunes éducateurs sont tous motivés et appartiennent à peu près au même type de milieu que les éducateurs des générations précédentes. Ils se situent donc sensiblement dans le même schéma.
Il convient plutôt de s'interroger sur l'évolution du contexte social. Il est indéniable qu'aujourd'hui, on n'éduque pas les adolescents de la même façon qu'autrefois. Ce ne sont pas les mêmes adolescents. Ils n'ont pas les mêmes références. Leur environnement social est différent.
Il appartient sans doute aux instances hiérarchiques de définir les finalités : quelles compétences, quelle technicité, quelle qualification attend-on des professionnels dans le travail social ? Ne convient-il pas de passer d'une définition traditionnelle de l'éducateur largement fondée sur l'expérience à la définition d'un professionnel correspondant à une articulation juste entre l'expérience et la qualification ? Telle est la question centrale aujourd'hui.
M. le président - Je vous remercie de vos explications très utiles qui nous ont permis d'aborder l'essentiel.
M. Damien Mulliez - Pensant que je n'aurais pas le temps de traiter tous les points, je me suis permis de vous laisser un texte contenant les propositions.
M. le président - Je vous en remercie infiniment.
Audition de M. Jean-Luc
SALADIN,
Médecin
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre maintenant M. Jean-Luc Saladin, médecin.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur, vous avez la parole.
M. Jean-Luc Saladin - L'exposé que je vais vous faire est le résultat de l'intuition d'un médecin de famille. C'est à force de voir des jeunes abîmés dans leur développement, des familles en souffrance majeure face à un mur invisible contre lequel elles butent que l'intuition m'est venue : ces jeunes ont toutes les caractéristiques des patients ayant perdu les fonctions hébergées par la partie antérieure de notre cerveau, les aires préfrontales, fondant la différence entre l'homme et le singe.
Il existe une analogie évidente entre le comportement de ces jeunes et celui des vieux déments frontaux créés par milliers dans les accidents de la circulation. En cas de décélération importante, il arrive souvent que les liens unissant la partie antérieure du cerveau au reste de l'organe soient détruits, créant une lobotomie traumatique. Cette analogie se retrouve également chez les patients qui ont eu une tumeur dans les aires préfrontales ou une rupture d'anévrisme.
L'intuition d'un sémiologiste dans son cabinet, voilà sept ou huit ans, sera confortée par ce que la science découvrira grâce aux progrès extraordinaires des neurosciences, une révolution qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Je me suis dit un jour : ces jeunes drogués sont des frontaux.
Les causes principales de l'augmentation des problèmes psychocomportementaux observés dans la jeunesse sont à mon sens : premièrement, l'écoute excessive de musiques contenant des basses fréquences, deuxièmement, la télévision, troisièmement, les images à connotation sexuelle, quatrièmement, le stress lié à la sur-motorisation et cinquièmement, le cannabis.
Les musiques utilisant de grandes quantités de basses fréquences provoqueraient des difficultés pour l'apprentissage car on sait qu'une stimulation à un cycle par seconde agit sur l'hippocampe. Cette partie du cerveau se trouve à l'intérieur du lobe temporal et correspond au vieux cortex observé chez les mammifères qui ont disparu. Il s'agit d'un relais obligé du processus de mémorisation.
Cette stimulation à un cycle par seconde entraîne une dépression à long terme dans le montage : lorsque l'on introduit un signal à l'entrée, on récupère un signal diminué à la sortie si le système a été influencé par une basse fréquence. Il s'agit là d'un phénomène dont on a tout lieu de penser qu'il correspond à une impossibilité de stocker des informations en mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire se déposant à partir de l'hippocampe sur le néo-cortex et constituant la culture, la mémoire des choses qui ont du sens.
Le néo-cortex joue un rôle modérateur sur le cerveau primitif qui héberge les comportements violents -Mulkez et Malenka 1992, Neurosciences de Purves chez Deboeck, page 450.
Bianchi en 1900 entreprend des expériences sur un chien : il lui enlève tout le cortex, le chien survit mais n'est plus qu'une boule d'agressivité envers son entourage. Actuellement, les neuroscientifiques sont tout à fait d'accord pour admettre que le néo-cortex joue un rôle modulateur sur le cerveau instinctif se trouvant dans les noyaux centraux.
En ce qui concerne la télévision, deux études montrent un lien indiscutable avec la violence. La première a été publiée par B.S. Centerwall du département de psychiatrie de l'université de Washington dans le journal de l'association des médecins américains en juin 1992. En étudiant pendant quarante ans l'évolution des homicides aux USA, au Canada et en Afrique du Sud, il conclut que la télévision est responsable d'un doublement des homicides en vingt-cinq ans. L'enfant apprend d'abord par imitation. A quatorze mois, 65 % des enfants qui ont vu un film vidéo expliquant le fonctionnement d'un jouet sont capables de l'utiliser contre seulement 20 % des enfants n'ayant pas vu le film. C'est dire la puissance de la pédagogie par imitation. Si vous désirez approfondir cette question, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Pierre Changeux, intitulé L'homme de vérité , page 196. Incapables de distinguer la réalité de la fiction, les enfants enregistrent les images, en particulier les images violentes dont l'impact est très puissant. Un tiers des sujets emprisonnés pour agression admettent avoir imité des gestes observés à la télévision.
On a noté au Canada, entre 1973 et 1975, une augmentation de 160 % des agressions physiques entre enfants de CP et de CE1, à la suite de l'introduction de la télévision dans une petite ville jusque-là isolée.
La seconde étude réalisée par Jeffrey Johnson de l'Institut psychiatrique de New-York, publiée le 29 mars 2002, dans la revue Sciences montre également un lien entre la télévision et la violence. Il a suivi 707 familles pendant dix-sept ans. Parmi les jeunes qui regardaient la télévision plus de trois heures par jour, à quatorze ans 41 % ont eu des problèmes de violence contre 8 % pour ceux qui la regardaient moins d'une heure.
En isolant la variable télévision, c'est-à-dire en tenant compte du niveau des revenus, du climat de violence dans la famille, de l'ambiance dans le quartier, des diplômes des parents, des antécédents psychiatriques, le facteur déterminant reste le nombre d'heures passées devant le récepteur et le niveau de violence est proportionnel à ce nombre d'heures.
On pense qu'il y a d'abord imprégnation, puis désensibilisation, désinhibition et enfin imitation. Pour mémoire, en 1988, une année de télévision en France représente 670 meurtres, 15 viols, 848 bagarres, 419 fusillades, 11 hold-up, 8 suicides et je ne parle pas des cassettes vidéo qui sont plus performantes dans ce domaine.
J'en viens à l'excès d'images à connotation sexuelle à la télévision, au cinéma, sur Internet, dans la mode et dans la publicité.
Une étude française de Serge Stoléru sur la cartographie cérébrale du désir sexuel masculin, publiée chez Odile Jacob, Université de tous les savoirs, Le cerveau, le langage, la science, volume V, pages 113 et suivantes, apporte des éléments intéressants. Au fur et à mesure que les stimuli sexuels augmentent : film neutre, film humoristique, photo de femmes au travail, photo de mannequins, photo de jeunes femmes nues, film sexuel, on constate une libération de testostérone dont on sait qu'elle est l'hormone de l'agressivité -je vous renvoie à l'ouvrage de Pierre Karli, intitulé Le cerveau et la liberté- on observe également une diminution de l'activité des aires préfrontales qui freinent les pulsions et permettent de dire non aux instincts et commencent à entrer en action à l'âge de sept ans. Les anciens, dans leur sagesse, disaient que l'âge de raison commence à sept ans. Les neurosciences aujourd'hui nous montrent que les anciens voyaient juste car la myélinisation, c'est-à-dire les câbles reliant des aires préfrontales au reste du cerveau se met en place à partir de sept ans.
Sous stimuli sexuels, on voit par imagerie fonctionnelle une extinction des aires préfrontales. Beaucoup de meurtriers sont de très grands consommateurs de films pornographiques, c'est une notion bien connue en criminologie. Les stimuli sexuels majeurs sont ubiquitaires et n'épargnent personne, ni les enfants, ni les adolescents encore immatures. Actuellement, la campagne de publicité pour les sous-vêtements féminins sur les abris-bus est-elle faite seulement pour attirer les clientes ?
Quant au stress qui vient du bruit, de la sédentarité par la sur-motorisation, il aboutit lui aussi à des troubles de la mémorisation, laquelle empêchant la constitution d'une culture, façonne un cerveau qui est renvoyé à ses fonctions primitives. L'usage immodéré de moteurs aboutit à des conflits sensoriels. Rappelons que 50 % des trajets automobiles font moins de quatre kilomètres et qu'en France, seuls 4 % des enfants vont à l'école à bicyclette, selon Roland Jouvent, Université de tous les savoirs, Le cerveau, le langage, la science , volume V.
La possibilité de mettre en jeu la kinesthésie place le cerveau en dissonance, en conflit sensoriel.
Je vous décrirai l'expérience suivante. On place dans un hamac sur un manège deux rats cérébrolésés. Le premier peut toucher le sol avec ses pattes, le second ne le peut pas. Le manège tourne et les rats sont soumis aux mêmes stimuli , par exemple des sons qui les intéressent. On s'aperçoit que celui dont les pattes bougent guérit et pas celui dont les pattes sont immobiles. Cela nous renvoie à l'importance du mouvement chez l'homme. Les Romains disaient : vita in motu , la vie est dans le mouvement.
Redonner au jeune l'espace et l'usage de ses muscles au lieu de l'empêcher de s'en servir par des scooters, des voitures, des transports en commun est fondamental et permet les échanges sociaux et intergénérationnels. Or, les modèles animaux et humains montrent que l'ontogenèse complète de l'acteur social ne peut se faire que s'il y a des contacts parents enfants suffisants et même sur trois générations : grands-parents, parents, enfants. Je vous renvoie à un ouvrage qui n'est pas scientifique mais qui donne à penser sur le sujet : Sa majesté des mouches de William Golding.
Le baromètre santé 1997-1998 montre que les jeunes de dix à dix-neuf ans qui ont le moins d'activité physique souffrent d'un mal-être avec prise d'alcool, de cannabis et troubles du comportement. D'autres études montrent que l'habitude d'avoir une activité physique quand on est jeune détermine la poursuite d'une telle activité à l'âge adulte et cette habitude se transmettra aux enfants.
J'aborderai enfin le problème du cannabis.
L'augmentation de la délinquance juvénile au cours des dix dernières années est parallèle au doublement de l'usage du cannabis. En même temps, on constate un rajeunissement important de l'âge de la première prise, environ quinze ans. On compte cinq millions d'usagers, 35 % des Français auraient expérimenté le cannabis à seize ans contre 6 % en moyenne chez les jeunes Européens. Une étude de Friedmann, publiée dans le journal des addictions en 2001, conclut à la corrélation entre la délinquance et le cannabis, même si elle ne peut affirmer la causalité. Une étude récente d'Arseneault, publiée en 2000 dans les archives de psychiatrie montre une augmentation importante de la délinquance chez les fumeurs de cannabis : 961 jeunes nés dans une ville de Nouvelle-Zélande entre avril 1972 et mars 1973 ont été observés. Par rapport aux sujets témoins, on note un risque de délinquance violente de 1,9 pour ceux qui sont dépendants de l'alcool, 3,8 pour ceux qui sont dépendants du cannabis et 2,5 pour ceux qui ont des troubles psychotiques ; 20 % des jeunes entrent dans une des trois catégories et sont responsables de plus de la moitié des actes de violence ; lorsqu'ils entrent dans deux catégories, le risque de violence passe de 8 à 18.
Des constatations analogues ont été faites en Scandinavie, aux Etats-Unis et en Israël. Selon le rapport de l'INSERM de décembre 2001, page 136 : l'usage régulier de cannabis multiplie le risque de schizophrénie par quatre. On sait aussi que l'injection de cannabis chez l'animal provoque une appétence pour l'alcool -Gallatte, European journal of pharmacology , rapport parlementaire de M. Cabal, n° 259. On sait également que l'usage du cannabis mène très souvent à un délire de persécution de type paranoïaque, lequel est générateur d'agressivité défensive. Beaucoup d'actes de violence chez les jeunes ne sont, dans le vécu délirant du sujet, qu'un comportement défensif.
Le cannabis reste très longtemps dans le corps et continue à agir après la disparition de l'effet hédonique. Le temps d'élimination est de quinze jours pour 80 % de la substance et de trois mois pour le reste.
Cette constatation peut être illustrée de la façon suivante. Si on donne du cannabis à une souris, puis une substance chassant la substance de ses neurones, celle-ci fait un syndrome de manque comme une souris à laquelle on a donné de l'héroïne. Il en reste suffisamment dans le corps pour que l'on parle de drogue et non de drogue douce et ses effets sont d'autant plus difficiles à apprécier qu'elle est longue à disparaître.
Il existe chez les usagers du cannabis des flash-back , c'est-à-dire des relargages du cannabis contenu dans les tissus jusqu'à trois semaines après la dernière prise. Ces relargages aboutissent à mettre le sujet dans le même état que s'il avait fumé. Vous pouvez imaginer les conséquences sur la conduite automobile ou sur les postes de travail à risques. Il est ainsi fait mention d'un jeune ayant agressé son ami avec un couteau et ayant un fort taux de cannabis dans le sang, alors qu'il n'avait pas fumé depuis trois semaines.
Lorsque les parties antérieures du cerveau, les aires préfrontales, qui nous séparent nettement des singes et sont les plus volumineuses ne fonctionnent pas, le sujet devient incapable de projection dans l'avenir et d'accès à l'altérité, c'est-à-dire d'intérêt réel pour les autres. Il est prisonnier du présent, il ne peut plus prendre d'initiative et ne peut plus résister à ses instincts de l'instant, alors que son intelligence reste intacte. Je vous renvoie à l'ouvrage de Antonio Damasio, intitulé L'erreur de Descartes . Or diverses études, en particulier la thèse du Suédois Lundquist, intitulée Cognitive disfunctions in chronic cannabis users observed during treatment , publiée en 1995 montre que sous cannabis, il y a une diminution des fonctions hébergées dans les aires préfrontales. Les explorations par imagerie cérébrale confirment le phénomène.
Les principaux symptômes observés chez les sujets aux aires préfrontales déficientes sont les suivants : troubles de la mémoire à l'encodage et au décodage, anosognosie -le patient n'a pas conscience de son trouble, il va bien, ce sont les autres qui vont mal- aprosodie -perte de la chanson du langage- apragmatisme, distractibilité -son attention est attirée par le moindre élément sensoriel qui entre dans son champ- désinhibition, en particulier sexuelle, langage appauvri, appétence pour l'alcool et les drogues, gloutonnerie, désinhibition sphinctérienne dans les lieux publics, irritabilité, violence, désinhibition verbale, négligence physique, oscillations de l'humeur, apathie, perte d'élan vital, perte de l'autoactivation, comportement d'utilisation -le sujet ne peut s'empêcher de toucher ce qu'il voit devant lui, beaucoup de vols correspondent sans doute à des comportements d'utilisation- aimantation du regard -il fixe des yeux sans pouvoir détourner le regard- comportement d'imitation -quand vous parlez avec lui, le sujet ne peut s'empêcher de faire exactement les mêmes gestes que vous.
Cela pose le problème du non-passage du frontal par immaturité, la frontalisation se terminant vers quarante ans. Le jeune sera frontal parce que son système nerveux est immature, mais il va le rester parce que le relais chimique le maintiendra dans cet état. C'est la maladie neuropsychique que la société subit. Une étude montre que si l'on fume avant l'âge de dix-sept ans, il y a une réduction de la taille du cerveau et par conséquent une altération de l'attention.
J'ai actuellement deux jeunes patients qui ont été des délinquants majeurs : l'un va mieux et travaille, l'autre est encore un peu oscillant. Il a fumé de la colle depuis l'âge de douze ans, a grandi dans une banlieue difficile en vivant dans la rue. Il a cassé à peu près tout ce qui pouvait être cassé dans son quartier. Lorsqu'il est sorti de sa maladie, un jour il a été contrôlé par des policiers, ils lui ont expliqué ce qu'il avait fait dans sa jeunesse et il m'a dit : c'est incroyable, je n'en garde aucun souvenir. Comme il n'y a pas d'encodage, il ne reste aucune trace du passé.
Par ailleurs, il m'a expliqué que dans son milieu, leur devise est la suivante : « mon copain, c'est ma poche et ma femme, c'est la came ». Il n'y a pas de relations humaines, d'altérité, de rapports de confiance. La seule chose qui compte, c'est l'argent et le plaisir, c'est la came. Ce n'est pas la peine de s'embarrasser d'une femme.
Pour vous montrer de façon plus crue l'état de désespérance dans lequel vivent ces jeunes, je vous citerai encore ces propos : « Chez les "enculés", il n'y a pas de doublure, on est entre "enculés". » Cela signifie qu'il n'y a pas de pitié, on ne se pardonne rien et si je peux t'avoir, je t'aurai.
En conclusion, je rappellerai qu'en arrivant au baccalauréat, le jeune a passé plus de temps devant la télévision qu'à l'école. Les parents sont en présence des enfants en moyenne une heure par jour. Les Français regardent la télévision environ trois heures par jour. On estime à trente minutes le dialogue parents enfants mensuel, c'est-à-dire une minute de dialogue par jour. Les jeunes Français écoutent de la musique avec des basses fréquences six à sept heures par jour si l'on tient compte des restaurants, des magasins, des centres commerciaux, de la voiture, des baladeurs, etc. Par ailleurs, 99 % des adolescents ont eu une proposition de drogue, cinq millions ont fumé du cannabis.
Devant ces constatations, la puissance publique aurait au moins, nous semble-t-il, le devoir de mettre en garde les citoyens en leur demandant d'appliquer le principe de précaution dans le domaine du bon usage de notre système nerveux. Il est temps que l'homme, en particulier le petit humain, respecte le mode d'emploi de lui-même que la connaissance est en train de faire émerger sous nos yeux grâce à la science. Il est temps de fonder une hygiène du système nerveux.
Le mélange de tous les facteurs que j'ai décrits aboutit à la constitution de comportements relevant de la psychiatrie. Le rajeunissement des jeunes concernés doit attirer notre attention sur le fait que nous sommes peut-être en train de faire naître des sujets dont les comportements demain seront pires que ceux d'aujourd'hui.
L'intégration ne pourra être réussie que si nous nous débarrassons du cannabis. Je vous renvoie à un auteur majeur sur les problèmes de violence, le professeur Pierre Karli qui enseigne à Strasbourg. Il a consacré sa vie à l'étude des comportements violents et de l'agressivité, il a publié chez Odile Jacob Le cerveau et la liberté et surtout récemment La violence et l'agression chez l'homme .
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - En ce qui concerne le cannabis, comment expliquez-vous la grande permissivité dans ce domaine ? Certaines femmes et certains hommes publics affirment qu'il n'est pas dangereux de fumer un joint : ce qui serait dangereux, ce sont les impuretés.
M. Jean-Luc Saladin - J'ai eu l'occasion de m'en entretenir en face à face avec une des personnes auxquelles vous pensez. Le ton a franchement changé depuis la publication du rapport de l'INSERM indiquant que le risque de schizophrénie est multiplié par quatre sous cannabis. Cette personne éminente me confiait dans les couloirs que ce n'était pas bon mais il y a les impératifs électoraux !
Dans ce domaine, la science avance très vite. Nous avons fait un pointage : quatre articles scientifiques sur le cannabis sont publiés chaque jour dans la presse mondiale.
La difficulté à évaluer la nocivité du cannabis l'a fait bénéficier jusqu'à maintenant du statut de drogue douce, mais il y a des pays où ce n'est plus le cas. Un document sur la prévention du cannabis circule en Scandinavie. Les gens qui connaissent bien le sujet ne tiennent plus le même discours.
Quant à savoir ce que la puissance publique doit faire, je n'en sais rien. La ligne dure choisie par la France se révèlera peut-être un jour la bonne. A force d'être en retard, on découvrira qu'on était en avance. Ce ne serait pas la première fois.
M. le rapporteur - Ne fait-on pas une erreur sémantique en appelant le cannabis « drogue douce », alors qu'il s'agit d'une drogue lente ?
M. Jean-Luc Saladin - Les experts sont unanimes sur ce point. Il existe peu de molécules ayant une durée de vie aussi longue et continuant à agir en profondeur. Les responsables actuels qui parlent du cannabis fumaient en mai 68 un joint qui était à 3 %. Aujourd'hui, on a affaire à des populations qui fument jusqu'à dix joints par jour à 30 %. Il y a des effets de quantité.
M. le président - A-t-on une idée de la population concernée par la consommation régulière de cannabis ?
M. Jean-Luc Saladin - On estime qu'il y a cinq millions d'usagers. Mme Marie Choquet, que vous recevez cet après-midi, est une spécialiste de ces questions.
Certains pensent que la consommation dans les banlieues est sous-estimée. Un adolescent sous cannabis ne devrait même pas entrer dans une école car il est comme un magnétophone dont la tête de lecture ne serait plus sur la bande. Il ne captera rien de ce qui sera enseigné.
Au XIIIème siècle, un responsable musulman rendant la justice comme on le faisait à l'époque disait : « Si vous fumez du cannabis, commencez par arrêter pendant un mois, puis reposez-vous un mois et venez me voir après, sinon ce n'est pas la peine. »
Comme les Suédois, je crois que la prochaine étape importante pour l'humanité est d'arriver à s'affranchir de la tyrannie du circuit de la récompense. Nous avons dans le cerveau un circuit qui, lorsqu'il est activé, entraîne plaisir et satisfaction. L'humanité est une énorme cohorte d'esclaves de cette zone qui est le nucleus accumbens . Quand les masses tyrannisées par le nucleus accumbens en seront libérées, nous irons nettement mieux. J'ai bon espoir car la science avance à vitesse phénoménale. L'homme aura bientôt son mode d'emploi. Quand on examine tout cela à la lumière des grands mythes de l'humanité, on s'aperçoit que la tyrannie du plaisir a asservi des masses entières. La simple prise de conscience du phénomène aboutit à un éclaircissement.
Dans ma pratique quotidienne de petit médecin d'une petite sous-préfecture, je vois un ou deux cannabiques par jour et je dépiste des familles en grande souffrance. Je vous citerai le cas d'un professeur d'éducation physique dont le fils cannabique est agressif. Il n'ose pas en parler parce qu'il a honte : il est obligé de circuler dans sa maison en rasant les murs car dès qu'il a le dos tourné, son fils lui tombe dessus pour le frapper.
J'ai constaté que lorsqu'on explique simplement les choses aux cannabiques, on obtient un effet. Quand ils comprennent, ils arbitrent en faveur d'une solution rationnelle.
Il est dommage que les jeunes fument du cannabis en croyant cette pratique inoffensive. La République a le devoir de les mettre en garde. Une simple information a très rapidement des effets bénéfiques.
M. le président - Que pensez-vous de l'ecstasy ?
M. Jean-Luc Saladin - Il n'y a pas de débat sur l'ecstasy. Sa nocivité est avérée, même les plus permissifs le condamnent. Les neurones sont détruits sans espoir de repousse. Cela aboutit à des syndromes dépressifs majeurs. Il convient de mettre en garde les jeunes.
M. le président - Quelle politique de santé publique faut-il mettre en place pour que les jeunes consomment moins de psychotropes ?
M. Jean-Luc Saladin - L'expérience scandinave montre qu'une information bien menée a des effets extraordinaires. Des ouvrages bien documentés sur le sujet circulant à grande échelle suffiraient. Des tentatives ont été faites avec des ouvrages comme Drogue savoir plus . Tout était dit mais avec peu de force. Il suffirait d'accentuer les mises en garde pour que l'on ait un bon document.
En outre, une information bien faite dans le cadre de l'Education nationale, peut-être à la fin du cycle primaire et en sixième, deux années consécutives à raison de quatre heures dans l'année, aurait des effets très bénéfiques pour les jeunes qui n'ont pas de problèmes psychiatriques préalables. Certains relèveront toujours de la psychiatrie pure. On dit que le cannabis aime la schizophrénie et que la schizophrénie aime le cannabis. Tout le monde est d'accord pour affirmer qu'un schizophrène fumant du cannabis a moins d'espoir de guérison qu'un schizophrène n'en fumant pas. J'ai vu des schizophrènes arrêter de fumer et s'améliorer de façon incroyable.
Faut-il légiférer ? Je ne sais pas. Il me semble qu'une bonne information suffirait et quand on voit la puissance des médias, ils pourraient peut-être aller dans le sens d'une mise en garde.
Par ailleurs, j'en reviens au problème de la sur-motorisation des villes. La France a un grand retard dans le domaine des équipements cyclables. L'activité et la convivialité générées par le déplacement démotorisé ont des effets sociaux majeurs. En Hollande, les jeunes fument moins de cannabis que chez nous. En outre, il y a à l'heure actuelle une explosion de l'obésité dans les pays développés. Le seul pays qui échappe à ce phénomène est la Hollande. Or là-bas, dans certaines villes, 90 % des enfants vont à l'école à bicyclette. Cette petite activité physique les protège de l'obésité, les oblige à avoir des relations sociales avec leur voisinage, favorise la fraternité et évite le clivage entre ceux qui ont une voiture et ceux qui n'en ont pas.
M. le président - Monsieur Saladin, nous vous remercions.
Audition de M. Jean-Pierre CHARTIER,
Directeur de
l'école de psychologues praticiens
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre maintenant M. Jean-Pierre Chartier, directeur de l'école de psychologues praticiens.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur, vous avez la parole.
M. Jean-Pierre Chartier - J'essaierai non pas d'apporter des réponses à un problème aussi complexe, mais je formulerai un certain nombre de réflexions que je me suis faites depuis 1973.
Si depuis dix ans je dirige l'école de psychologues praticiens à Paris et à Lyon, auparavant je m'occupais de délinquants. J'avais eu l'opportunité en 1973 d'ouvrir un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile pour mineurs et jeunes majeurs délinquants. Je m'étais aperçu assez rapidement que la barrière de l'âge de la majorité à vingt et un ans ou à dix-huit ans était insuffisante dans les cas les plus graves et, chose assez rare, j'avais obtenu la possibilité de prolonger mon action jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Pour y parvenir, il fallait déposer un dossier à l'aide sociale à l'enfance et avoir commencé les soins avant dix-huit ans.
Je suis resté vingt ans dans cette structure et cette expérience me permet d'avancer quelques réflexions sur les différentes politiques menées sur ce qui apparaît aujourd'hui comme une nouveauté et qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'explosion de la délinquance.
Il ne faut pas oublier qu'entre 1940 et 1945 -les conditions étaient particulières, nous en conviendrons- la délinquance juvénile avait triplé. Heureusement, nous n'en sommes pas là. En revanche, il existe un rajeunissement de la population des délinquants : il s'agit aujourd'hui d'enfants de douze à treize ans qui commettent des délits que commettaient voilà dix ans les jeunes de dix-sept à dix-huit ans.
Que s'est-il produit pour que l'on assiste à un rajeunissement de la délinquance et à des agressions de plus en plus violentes ?
Il existe de nombreuses études sociologiques, en particulier aux Etats-Unis, sur lesquelles je serai assez critique. Pourquoi ? Des cohortes d'enfants violents sont suivies pendant des dizaines d'années et nous avons souvent l'impression, en lisant les conclusions de ces études, que la montagne accouche d'une souris.
Je vous donnerai un exemple. Une recherche a été menée en Amérique du Nord, sous la direction de Richard Tremblay, le directeur de l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Pendant vingt ans, il a suivi un millier de jeunes Américains du Nord, 700 à 800 jeunes Finlandais, Israéliens et Polonais - allez savoir pourquoi. Tous étaient étiquetés violents à l'école maternelle.
Ses conclusions ont été les suivantes. Plus le comportement violent apparaît tôt, plus il a de chance de se pérenniser -on le savait déjà, maintenant c'est scientifique. L'âge de la mère au moment de la conception de l'enfant entre en ligne de compte : plus la mère est jeune, plus il y a de risque. Dans 57 % des cas, les couples étaient désunis. Enfin, la mère percevait l'aide sociale.
J'ai souvent l'impression en lisant les travaux des sociologues qu'on peut les résumer ainsi : il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Je ne dis pas que tout cela n'est pas vrai, mais est-ce utile ? Il faudrait interdire le divorce et supprimer l'aide sociale pour faire disparaître la violence.
Des travaux ont été menés récemment en France. Le dernier en date a été commandé par le ministère de la ville, il a été réalisé par un collectif d'auteurs et publié aux éditions scientifiques françaises en 2000.
Marie Choquet, l'épidémiologiste indiscutable des problèmes de l'adolescence, a une analyse plus fine que celle dont je viens de parler. Elle montre que doit être pris en considération non pas le statut matrimonial des gens mais l'ambiance à l'intérieur de la famille, les éventuels antécédents psychopathologiques des parents, c'est-à-dire la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie.
Elle évoque un autre facteur que l'on pourrait discuter : la sévérité des enseignants. Je suppose qu'elle veut parler de l'exclusion des enfants de l'école en cas d'absence. Ce n'est sans doute pas la solution.
Enfin, elle avance une idée que je n'avais jamais rencontrée auparavant : le sport intensif serait un facteur de risque dans le développement de la violence. Elle parle de huit heures et plus par semaine, ce qui n'est pas extraordinaire : on vit dans une société de compétition et il faut tuer l'autre. Je ne m'arrêterai pas davantage sur ces données sociologiques, n'étant pas sociologue moi-même.
En 1980, j'avais initié à titre personnel une réflexion sur ces sujets que j'ai qualifiés de « incasables ». Tout le monde comprend ce que cela signifie : ce sont des sujets qui, quoi qu'on fasse, n'iront jamais bien.
J'avais essayé d'associer l'Education nationale à la protection judiciaire de la jeunesse qui s'appelait alors l'éducation surveillée -vous remarquerez que depuis 1990, l'éducation est passée à la trappe et que l'on a insisté sur la protection judiciaire- et le secteur psychiatrique. Nous nous réunissions tous les mois et nous avons découvert assez rapidement que les « incasables » étaient les mêmes pour tout le monde, simplement ils changeaient de lieu ou de modalité de prise en charge et nous nous retrouvions toujours devant les mêmes impasses. C'était en 1980, je trouve un peu extraordinaire que l'on s'en étonne aujourd'hui.
L'Education nationale nous disait : « Nous traitons le problème en interne, mais nous ne voulons pas que l'on en parle à l'extérieur. » Cela a bien changé. La protection judiciaire de la jeunesse nous disait : « Vous avez raison, mais cela représente 10 % des jeunes qui nous sont confiés et nous avons décidé de faire la part du feu. ». Le secteur psychiatrique disait : « Ces gens ne sont pas fous comme on est normalement fou. Ils ne sont ni schizophrènes, ni paranoïaques. Nous ne savons pas comment faire avec eux. ». Il est vrai que la psychiatrisation de ces sujets n'est pas une bonne réponse, ne serait-ce que parce qu'elle les déresponsabilise. Vous prenez un sujet de cet acabit, vous le placez dans un hôpital et vous obtenez Vol au-dessus d'un nid de coucous . Il commencera par rançonner les débiles parce que c'est facile, puis il déprimera les dépressifs et poussera les schizophrènes à la toxicomanie en faisant le casse de la pharmacie.
Telles sont les réponses que j'ai eues à l'époque de la part des partenaires sociaux.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?
La délinquance classique existera toujours. Durkheim disait au début du siècle qu'il n'y a pas de société sans délinquance et sans crime. Nous sommes d'accord. C'est une délinquance liée à l'acte. Le sujet, pour des tas de raisons, se met en marge d'un système de fonctionnement social, en particulier en marge du travail salarié, parce qu'il y est profondément allergique ; il décide de gagner sa vie autrement et il devient délinquant. Cette délinquance traditionnelle a toujours existé et nous ne sommes pas prêts de la voir disparaître.
Quand j'ai sorti voilà quelques années un livre intitulé : Les Adolescents difficiles , j'ai eu la surprise de recevoir le coup de fil de deux garçons qui souhaitaient m'inviter à dîner pour discuter de ce que j'avançais dans cet ouvrage. Je leur ai demandé si nous étions collègues, ils m'ont répondu qu'ils étaient spécialistes ! J'étais plus jeune qu'aujourd'hui, donc plus fou, aussi m'y suis-je rendu. Je me suis retrouvé avec deux types qui avaient passé quinze ans dans toutes les centrales de France et de Navarre qui reprenaient des passages précis du livre, en argumentant fort intelligemment. Ce dîner de « spécialistes » a été très sympathique et je ne les ai plus revus. L'un des deux s'était parfaitement réinséré puisqu'il était devenu journaliste au Canard enchaîné . Quant à l'autre, il était dans des affaires qui l'amenaient à se déplacer souvent en Amérique latine ; je n'en avais pas demandé davantage.
Quelques mois après cette rencontre un peu étonnante, j'ai reçu un ouvrage au titre énigmatique : Je m'appelle reviens , de Alexandre Dumal, aux éditions de Nulle part ! Cette personne s'était offert le luxe de publier son histoire à compte d'auteur. C'était un délinquant traditionnel. Son livre commençait ainsi : « Mes parents étaient pauvres. Moi-même je suis né pauvre et, comme les aristocrates, je n'ai jamais supporté le travail. »
Pourquoi vous dis-je cela ? Cette délinquance est connue depuis longtemps, le code pénal a été fait pour elle. Si ces gens contestent les modalités d'application du code, ils ne contestent pas le principe de la justice rétributive. Ils vont discuter : « je n'aurais pas dû prendre 5 ans, j'aurais dû prendre 2 ans, etc. », mais ils ont intégré la notion de sanction.
Ce n'est pas du tout le cas de ceux dont je vais parler maintenant et que j'appelle « les délinquants par absence d'être ». C'est parce qu'il y a une montée en puissance de ces jeunes que nos dispositifs éducatifs, de soins et même législatifs se trouvent désarmés. Pourquoi ? Regardons comment cela se passe. Dans les transports en commun : « T'as pas une cigarette ? », il n'a pas de cigarette donc je le plante avec mon cran d'arrêt. Nous n'avons jamais connu antérieurement une telle facilité à passer à l'acte meurtrier. « Comment qu'il m'a regardé celui-là ! », c'est la même chose.
Pour en arriver là, on est obligé d'en déduire que ces jeunes n'ont pas construit de représentation humaine de l'autre. Si on a une représentation de l'autre en tant qu'être humain, on ne peut pas se comporter ainsi. Or ils n'ont pas construit une représentation humaine de l'autre précisément parce qu'ils n'ont pas de représentation d'eux-mêmes. Comme le disait mon regretté ami Jacques Sellos, fondateur du centre de recherches de l'éducation surveillée de Vaucresson dans les années cinquante, ces gens sont comme des vampires. Non pas qu'ils vous sucent le sang -encore que, en s'occupant d'eux, on perde beaucoup de sa substance- mais parce que, lorsqu'ils passent devant un miroir, aucune image ne se reflète. On a affaire à une délinquance par absence d'être. Bien évidemment, toutes sortes de facteurs ont pu concourir à cette impossibilité de s'identifier à un être humain, au fait qu'ils soient restés bloqués dans le processus d'humanisation.
Qu'est-ce qui va les faire devenir quelqu'un, au minimum quelque chose ? Vous le savez, c'est le moi-fringue, toutes sortes de signes empruntés à la société de consommation, comme le blouson ou les chaussures Untel, indispensables pour essayer d'apparaître. Il faut ajouter les voitures, mais certaines marques bien précises -pas n'importe lesquelles bien sûr !- et puis les délits, qui vont être pour eux le moyen de se constituer une identité. Chose tragique dans notre culture contemporaine -si on peut encore l'appeler ainsi- où tous les rites qui permettaient d'initier ou d'intégrer les jeunes adolescents au monde adulte ont disparu -l'un des derniers étant le service militaire, quoi qu'on en dise-, le seul rite qui subsiste aujourd'hui est un rite négatif, à savoir la prison.
La récidive de ces jeunes est inévitable. Le mot récidive n'a pas de sens pour eux, je l'ai expliqué dans un livre intitulé : L'Adolescent, le psychanalyste et l'institution , ils n'ont pas construit le temps chronologique dans lequel nous nous mouvons. Quand on n'est pas dans un temps chronologique, l'acte et sa conséquence ne sont pas reliés. Cela ne peut pas leur servir d'expérience ou de leçon. Tant qu'on n'aura pas compris cela, on n'avancera pas !
C'est pour cela que l'on est complètement en porte-à-faux avec les prétoires. Le délinquant classique a compris cela ; l'autre ne peut pas le comprendre : à chaque fois, c'est une injustice supplémentaire qui le rend encore plus furieux ; on lui en veut, on lui a fait de méchantes choses et en plus il n'y est pour rien. C'est vraiment quelque chose de vécu, ce n'est pas une défense un peu débile qu'ils pourraient adopter. Pour ces sujets qui sont dans un temps non chronologique, dans une sorte de temps circulaire qui n'est pas structuré, qui n'ont pas d'histoire -on ne peut pas travailler sur leur histoire, c'est bien le problème- la récidive n'a aucune signification, elle est inévitable.
Je sais bien que je ne rassure personne en disant cela ! Cela veut dire qu'il faut travailler en amont. J'ai défini le fonctionnement de ces jeunes par trois « d », ils sont dans le déni, le défi et le délit.
Le déni est un mécanisme de défense inconscient très fort que Freud a mis en évidence en 1927 à propos des perversions sexuelles, c'est-à-dire l'impossibilité d'intégrer une partie de la réalité. Tout en ayant un psychisme « sain », le sujet n'est pas psychotique au sens du psychiatre, il y a une partie de la réalité qu'il ne peut pas intégrer. Freud le démontre chez les pervers, pour qui l'absence de pénis chez la femme, en particulier chez la mère, n'est pas intégrable. Ce n'est pas le problème des délinquants qui nous occupent, encore que parfois, nous le savons, leur conduite puisse être associée à des perversions sexuelles -je ne citerai pas Dutroux !
Le déni porte sur deux choses -et c'est fondamental. D'une part, il porte sur l'implication dans les actes délictueux, c'est-à-dire que ces sujets sont foncièrement convaincus de n'y être pour rien ! Une partie d'eux sait et une partie ne veut pas le savoir. Inconsciemment, ils sont innocents. A tel point qu'ils arrivent dans certains cas à en convaincre les autres et que l'on a pu voir des comités de soutien faire libérer des individus dont la suite a montré qu'ils étaient coupables. Donc, ils ne sont pas dans leurs actes délictueux.
D'autre part, le déni porte sur les conséquences possibles de leurs actes. Ces sujets ne les prennent jamais en compte, ce qui rend leur comportement imprévisible. Normalement, tout un chacun, lorsqu'il est historicisé, quand il est inscrit dans un temps chronologique, va penser à la suite : qu'est-ce qui pourrait se produire si je... Chez eux ce n'est même pas une question, ils sont dans une sorte de présent suspendu. Il n'y a pas de passé - ils ne veulent pas le regarder parce qu'il n'est pas simple - et il n'y a pas de futur ; le futur n'existe pas.
Ce n'est pas une question d'intelligence, j'y insiste. Les plus intelligents fonctionnent comme cela. On passait récemment à la télévision un documentaire sur Jacques Mesrine. On peut dire de lui tout ce que l'on veut, mais il faut reconnaître qu'il était particulièrement intelligent. Or il s'est retrouvé enfermé au Canada dans un pénitencier, l'unité spéciale de correction, que je connais bien puisque j'y envoie des stagiaires chaque année.
Au Canada, il existe une gamme extraordinaire de structures dont on ferait bien de s'inspirer, de l'hôpital-prison Philippe Pinel, où les délinquants sont traités comme des patients, à l'unité centrale de correction, qui est l'extrême inverse, dans laquelle les conditions de vie sont vraiment épouvantables - pour ceux qui l'ont vu, c'est le pénitencier du Silence des agneaux , avec des coursives dans toutes les pièces et des gardiens armés de fusils braquant en permanence les détenus.
Mesrine est donc incarcéré avec une peine de 138 ans, 6 mois et 15 jours de prison comme on sait le faire outre-Atlantique. Il arrive à s'en échapper - il est le seul ! Que fait-il ? Imaginons-nous dans sa situation ! Alors qu'il était promis à une vie misérable et dramatique dans ce pénitencier, il revient l'attaquer avec un complice !
C'est pour vous dire qu'il s'agit non pas d'un problème d'intelligence mais du déni des conséquences possibles des actes. Jamais ils ne les prendront en considération, de la même façon qu'ils ne se sentent pas impliqués dans ce qu'ils ont fait. D'où l'absence de culpabilité, etc.
Tout cela n'est pas très rassurant, c'est vrai. Mais, face à cela, on a fait une politique angéliste, il faut bien le dire. Cela a commencé dans les années soixante-dix quand on a écrit dans un texte célèbre que, la famille étant le milieu naturel de l'enfant, il conviendra de l'y maintenir le plus possible. C'est bien, nous sommes d'accord sur le fond ; parallèlement, il faudrait s'interroger sur ces familles, non pas qu'il faille briser les liens, mais il faudrait quand même réfléchir à cette question. On a donc fermé les internats en disant que c'était le passé et que cela ne convenait plus. On a surenchéri avec la loi de 1989 sur les maltraitances. Bien sûr, il faut agir sur les maltraitances, sur les abus sexuels - d'ailleurs, il n'y a quasiment plus que cela dans les prétoires - mais en même temps on a restauré la délation comme système citoyen, il fallait dénoncer quelqu'un dès que l'on avait un soupçon, etc. Je ne vais par revenir là-dessus, il y a toujours des effets pervers dans les lois, c'est vrai. En 1990, « l'éducation surveillée » est devenue « la protection judiciaire de la jeunesse ». Cela veut tout de même dire quelque chose ! Encore plus près de nous, en 1992, la fameuse Charte des droits de l'enfant me paraît être, d'un point de vue psychologique, la plus grande aberration de nos temps modernes.
Je suis particulièrement réactionnaire en disant cela, me direz-vous. Certainement, je réagis parce que je considère que tout ce qui diminue l'écart nécessaire entre l'enfant et l'adulte, entre les sexes aussi d'ailleurs, la différence nécessaire pour se positionner et se situer, crée de la confusion et génère à terme des conflits et des impasses pour la croissance psychique d'un être humain. Il n'était pas difficile d'appeler la Charte des droits de l'enfant la Charte des devoirs des parents en gardant le même texte, n'en déplaise à Mme Brisset. Le contenu n'est pas mauvais, mais il faut dire que ce sont les parents qui sont obligés de se comporter d'une certaine manière et non pas les enfants qui ont des droits ! Où va-t-on comme cela ! Pour un psychologue, c'est une aberration. Je sais bien que peu le disent, c'est pourquoi je profite de ma présence devant vous pour le faire !
Faut-il rouvrir des maisons de correction, puisque cette question est à l'ordre du jour et figure dans tous les programmes ? Premièrement, il faut se demander pourquoi elles ont fermé. Faisons un bref rappel historique sur ces établissements. Le Peletier de Saint-Fargeau, magistrat, qui est d'ailleurs devenu président de l'assemblée constituante en 1791, a le premier demandé, avec Mirabeau, la création de maisons d'amélioration pour les mineurs. Il a été assassiné la veille de l'exécution de Louis XVI par un royaliste. C'est le marquis de Sade, qui avait été libéré de la Bastille, qui fera son oraison funèbre ! On ne trouve guère cela dans les livres d'histoire... Puis Frédéric-Auguste Demetz, magistrat éclairé, décide au XIXème siècle de créer les colonies agricoles et paternelles, toujours avec l'idée qu'à la campagne les troubles du comportement se soignent, par la vertu de l'air, etc. Le mythe a toujours existé ! Ces colonies vont bien fonctionner pendant un temps, puis l'Etat se déchargera sur le privé, sur les oeuvres, comme cela s'est toujours fait dans le secteur de l'enfance inadaptée. Vers 1936, Alexis Danan, journaliste, déclenche une campagne de presse considérable et décrit des bagnes pour enfants vétustes, des surveillants brutaux et alcooliques, l'attitude moyenâgeuse du personnel. La plupart vont fermer tant et si bien qu'en 1945 il ne reste que quelques établissements spécialisés dans ce qui va devenir « l'éducation surveillée », qui sera enfin détachée de la pénitentiaire. Il faut bien voir que tout cela est récent. Ces maisons vont fermer successivement. La dernière expérience a été faite par le docteur Roumajon, psychiatre au quartier des mineurs à Fresnes, qui va obtenir l'ouverture d'un établissement spécialisé psychiatrique et éducatif. Cette institution va fonctionner pendant quatre ans et cela se terminera par une émeute des pensionnaires et du personnel.
La première chose que j'ai envie de dire est la suivante : si on veut faire quelque chose, il faut déjà étudier ce qui n'a pas fonctionné dans les structures qui ont fermé. Si on veut une réponse, on sait très bien laquelle.
En vingt ans de travail avec les jeunes psychopathes et autres, j'ai appris qu'il fallait faire autrement que ce qui avait déjà été fait. Si nous faisons la même chose, pourquoi aurions-nous des résultats différents ? C'est une question de bon sens. Or le problème avec eux c'est qu'ils nous poussent à l'ingéniosité. Il faut trouver des réponses. Il est évident qu'il ne suffit pas de calquer tout ce qui s'est fait aux Etats-Unis ces dernières années -tolérance zéro, couvre-feu ; on n'a pas pensé une seule chose « à la française » dans ces mesures. Tout cela a donné des résultats, c'est vrai, mais il faut voir aussi l'inflation du nombre de prisonniers. Cela s'est traduit par des incarcérations massives. Si on est prêt à le faire, pourquoi pas.
De la même façon, on a dit qu'on allait créer des structures éducatives renforcées où les jeunes resteraient trois mois. De deux choses l'une, ou les gens qui travaillent dans ces structures sont des saints, c'est Dieu le père qui dirige l'établissement et il faut lui donner une auréole ; ou alors s'imaginer qu'en trois mois on peut réparer tout ce qui ne s'est pas construit chez ces jeunes -il me faudrait une heure ou deux pour vous expliquer comment ils en sont arrivés là psychologiquement- c'est du délire ! Il est évident que les choses ne peuvent se concevoir que sur de longues durées, parce qu'il s'agit d'un travail de restauration de l'humain chez quelqu'un qui n'a pas été suffisamment humanisé. La preuve en est son aptitude à donner et à se donner la mort avec une facilité déconcertante, que l'on ne rencontre pas normalement chez l'être humain.
Il faut donc du temps et des structures différenciées. Si on crée un établissement de cette nature, il faudra prévoir le passage dans d'autres types de structures qui permettront à terme une réintégration sociale, quand on se sera assuré de l'adaptation et de la disparition de la dangerosité des sujets.
Penser qu'un court séjour dans une structure fermée peut régler les problèmes de délinquance est à mon avis aussi stupide que d'affirmer comme Rousseau que l'enfant naît naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Comme chacun le sait, Rousseau n'avait pas élevé ses enfants - il les avait confiés à l'assistance publique - sinon il n'aurait jamais dit cela, ceux qui en ont témoigneront avec moi !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Nous vous remercions, monsieur, de cet exposé très intéressant. Comment expliquez-vous l'augmentation importante du nombre des « incasables », ou du moins le sentiment de leur augmentation ? Que fait-on des incasables -vous avez commencé à répondre ?
M. Jean-Pierre Chartier - Quand j'ai ouvert mon service en 1973, dans le quatorzième arrondissement de Paris, je me suis aperçu au bout d'un certain temps que l'on m'envoyait les personnes en échec de toutes les structures qui existaient, qu'il s'agisse des internats de rééducation, des foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, de la psychiatrie -ces jeunes ne se plaisent pas en psychiatrie et c'est réciproque ! Donc tous ces jeunes se retrouvent à la rue. Ce qui est dramatique, c'est que les plus difficiles, et donc les plus dangereux, sont dehors. Nous avions l'avantage d'être une structure mobile qui n'avait pas à les héberger. Ils venaient chez nous et nous nous déplacions pour les rencontrer où ils étaient, ce qui n'était pas toujours facile parce qu'il fallait les suivre à la trace, si l'on peut dire.
Je ne suis pas convaincu qu'il y ait tellement plus de sujets incasables aujourd'hui, simplement ils sont beaucoup plus visibles. Ils ont été médiatisés. Pour ce qui est de l'histoire des voitures brûlées, nous assistons maintenant à une compétition entre les quartiers.
Il faut ajouter l'économie souterraine qui n'existait pas encore vraiment à l'époque. Le grand risque est que la forme de délinquance que j'ai essayée très brièvement de vous présenter, très différente de la forme classique, revienne à la première. Au bout d'un certain temps passé en déshérence et en absence d'être, certains sujets se trouvent une place et une identité dans la délinquance traditionnelle, dans le braquage et le cambriolage, l'économie souterraine étant en quelque sorte le moyen de s'intégrer dans ce milieu.
Il ne faut pas négliger les trafics de drogues. En général, quand une cité est calme, il faut s'inquiéter, parce que cela signifie que les gros bonnets de la drogue ont fait taire les petits délinquants, parce qu'ils en ont besoin pour le business. Quand cela explose, ce n'est pas mauvais signe parce que cela veut dire qu'il y a des querelles entre les gangs.
La bande de jeunes a toujours existé, rappelez-vous le film West Side Story , ou les blousons noirs des années cinquante. Mais les bandes avaient une fonction socialisante, ne serait-ce que par identification aux héros, aux chefs. Quelque chose se jouait. Il y avait une hiérarchie : le chef, le sous-chef, celui qui voulait s'intégrer...
Maintenant ce ne sont plus des bandes, ce sont des mafias, c'est-à-dire que l'on se réunit pour des coups, pour du business. Il n'y a plus les liens affectifs : demain, je peux être avec un autre. C'est une histoire d'économie. Cet aspect s'est ajouté. Tout cela aussi est très déstructurant et peut sans doute expliquer l'augmentation. Ils ne sont pas sots, ils ont bien compris que plus ils étaient mineurs, moins ils étaient poursuivis. C'est pour cela que l'on enrôle très vite les petits frères pour remplir des fonctions et se garder à couvert. C'est un système mafieux. C'est vrai qu'en trente ans on a laissé se développer dans beaucoup de cités un système mafieux, dont on connaît ou non le responsable : cela peut être l'adjoint au maire, l'animateur socioculturel, allez savoir !
M. le rapporteur - Vous nous avez dit que ces jeunes avaient une notion du temps toute relative et qu'ils avaient des difficultés à se projeter dans l'avenir. Les délais dans lesquels les sanctions sont prises ne sont-ils pas trop longs et difficilement ressentis par ces jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans le lendemain ?
M. Jean-Pierre Chartier - Dans le cas de la comparution immédiate, on pourrait croire qu'ils vont intégrer plus facilement la réponse. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas suffisant.
Tout le monde sait que les peines sont plus lourdes en comparution immédiate, le magistrat ayant moins le temps de réfléchir et étant sous le coup de l'émotion. Pour eux, de toute manière, comme ils ne relient pas leur acte et ce qui leur arrive, c'est toujours une injustice. Je n'ai entendu que des gars me dire : c'est dégueulasse, on cherche à m'enfoncer, je voulais m'en sortir et voilà ce qui m'arrive. C'est terrible ! Tant qu'on n'a pas modifié en profondeur leur façon de percevoir le monde, de se construire une histoire, de s'inscrire dans le temps, tout glisse sur eux comme sur les plumes d'un canard, les sanctions pénales ne font que renforcer leur rage et leur révolte.
L'une de mes étudiantes avait fait son mémoire de fin d'études sur la perception du temps chez des adolescents délinquants d'un centre de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle s'est rendu compte que ceux qui ne récidivaient plus, qui sortaient de la délinquance, s'étaient construit une histoire personnelle et étaient capables d'en parler. Les autres continuaient.
Comment ? Ils s'étaient construit une histoire autour d'un personnage qui avait joué un rôle central dans le temps avec eux. Autrement dit, c'est de l'investissement humain dans le temps.
M. Bernard Plasait - Certes, certaines solutions ne sont pas bonnes, ou insuffisantes, notamment parce qu'elles ont des effets pervers. Enfermer quelqu'un qui sera plus déstructuré encore à la sortie de son enfermement parce qu'il n'aura rien compris et que cela le rendra encore plus enragé, on comprend que cela ne soit pas satisfaisant.
Il n'en demeure pas moins, en imaginant une prise en charge sur le long terme accompagnée d'un important suivi, que vous n'êtes pas assuré de garder dans le milieu ouvert au sein duquel vous organisez l'éducation les éléments très perturbateurs pour la société que sont les « prédateurs violents », ces 5 % d'une classe d'âge qui sont responsables de près de 50 % des délits.
Or la demande politique à laquelle nous avons à répondre est justement de mettre hors d'état de nuire ceux qui pourrissent littéralement la vie des quartiers. Nous sommes donc bien obligés de disposer de structures fermées, même pour de brefs séjours.
Selon vous, serait-il possible d'imaginer un système suffisamment souple pour réaliser à la fois l'éducation, mais aussi la contention quand elle est nécessaire, c'est-à-dire un suivi sur le modèle médical qui permet de passer avec une certaine souplesse des soins intensifs aux soins normaux ou à la cure ?
Vous semble t-il envisageable, au moins dans certains cas, d'appliquer un régime de semi-liberté dans lequel l'aspect éducatif serait pris en charge en milieu ouvert pendant la journée tandis que le gardiennage de nuit aurait lieu en prison ?
M. Jean-Pierre Chartier - J'abonde dans votre sens, c'est-à-dire que je ne pense pas non plus qu'on leur rende service en les laissant aller jusqu'au bout de leurs pulsions. Ils sont aussi conscients de leur dangerosité.
Je me souviens d'un garçon de 20 ans qui était en hôpital psychiatrique. Il avait étranglé une femme qu'il ne connaissait pas en la laissant à moitié morte après avoir commis une succession de délits de plus en plus graves - introduire des armes dans le service, etc. Le chef de service n'en voulait plus et il avait été transféré dans un autre hôpital. On m'a demandé d'aller le voir. Il m'a dit qu'il allait tuer une infirmière ou assassiner le psychiatre, qu'il ne supportait plus la psychiatrie et qu'il voulait aller en prison. Il m'a expliqué qu'il était psychiatrisé depuis l'âge de 14 ans parce qu'il avait poignardé un camarade. Or un acte qui sort de l'ordinaire n'est pas obligatoirement pathologique. Si je l'avais rencontré à l'époque, je lui aurais dit qu'il n'était pas fou, qu'il était un garçon dangereux qu'il fallait punir mais pas mettre en psychiatrie. Je lui ai dit que, s'il continuait à faire des crimes de fou, il était normal qu'il soit en psychiatrie et que, pour aller en prison, il fallait qu'il agisse différemment. La semaine suivante, le surveillant général m'apprenait qu'il était en prison après avoir braqué une banque et qu'ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé ! Moi, je savais...
Donc il y a bien des moments où l'aspect contenant est nécessaire, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la personne. Le fait d'agir sans culpabilité apparente n'empêche pas une culpabilité inconsciente de s'accumuler chez ces sujets, ce qui les conduit en général à des actes auto-agressifs : ils finissent par se flinguer ou par se faire descendre.
Cet aspect contenant ne doit cependant pas déboucher sur la liberté totale. Sinon cela signifie qu'en trois mois nous sommes capables de changer la personnalité de quelqu'un. Il y a un travail éducatif à réaliser, il faut faire passer les normes qui n'ont pas été intégrées par ces jeunes. Il faut reconnaître qu'ils sont souvent dans des milieux dans lesquels il y a des anti-normes. L'économie souterraine sert aussi à faire vivre les familles. Je me souviens d'un père qui me disait : « J'en ai marre d'aller chercher sans arrêt mon fils au commissariat, si au moins ça me rapportait. » Quand on a entendu cela, on a compris ! Il ne faut pas négliger cela. Je ne le dis pas pour jeter la pierre, mais il faut savoir qu'ils sont dans une ambiance de ce type.
A partir de là, il faudrait prévoir des structures tout en leur donnant l'espoir d'en sortir pour aller successivement dans d'autres structures dans lesquelles il y aurait davantage de liberté, de responsabilité et d'autonomie. C'est un projet beaucoup plus important que celui qui consiste à dire que l'on va bloquer ces jeunes pendant trois mois quelque part, puis que l'on trouvera une solution - on ne sait pas très bien laquelle. Ils vont revenir dans leur cité, et cela va recommencer...
Je ne crois pas aux miracles. L'argent qui a été dépensé ces dernières années a servi toutes sortes de mythes : on va faire des terrains de sport, il faut rénover l'habitat. Tout cela n'est pas mauvais, mais on voit bien que cela ne change rien sur le fond. D'ailleurs, la première chose qu'ils détruisent, c'est le local socioculturel que l'on vient d'aménager. C'est pour vous dire que la situation est quand même grave.
J'ai parlé de la première caractéristique - le déni. La deuxième caractéristique est le défi, c'est-à-dire qu'ils sont dans le défi à toute forme d'autorité. Tout ce qui représente l'organisation sociale - la police, bien sûr, mais aussi les pompiers qui se font caillasser ou les chauffeurs de bus qui se font agresser - est l'objet d'une attaque, d'un défi dans lequel ils s'imaginent qu'ils vont se trouver dans une situation de toute puissance.
Il faut reprendre tout ce qui a été raté dans l'humanisation du sujet, il faut reprendre tout le processus, à la fois sur le plan éducatif et psychologique. L'erreur serait de faire l'un ou l'autre sans concilier les deux. C'est ce que nous avions essayé de faire dans notre service. Cependant, l'agrément du ministère de la justice que je demandais nous avait été refusé, sous prétexte que nous étions trop spécialisés, qu'il y avait trop de psys dans notre équipe ! Or les jeunes qu'on nous envoyait venaient de chez eux ! Après, ils m'ont proposé l'agrément mais je l'ai refusé. Les magistrats m'adressaient les cas par l'aide sociale à l'enfance et j'avais par ailleurs la sécurité sociale. Nous demandions un minimum d'acceptation aux jeunes qu'ils nous envoyaient. De surcroît, comme nous étions en ambulatoire, nous n'aurions pas pu faire autrement. Ceux qui n'étaient pas d'accord pour que l'on s'occupe d'eux, c'est-à-dire que l'on se voie chaque semaine, étaient renvoyés au magistrat pour qu'il leur trouve autre chose. Si j'avais eu l'agrément justice, j'aurais été obligé de les garder.
M. le président - Docteur, nous vous remercions.
Audition de M. Pierre BERTON,
Directeur
général du Centre national d'études et de formation
de
la protection judiciaire de la jeunesse
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons à présent entendre M. Pierre Berton, directeur général du Centre national d'études et de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. Pierre Berton - Je vais tout d'abord me présenter. Je suis un vieil éducateur puisque je suis entré dans l'éducation surveillée en 1964. J'ai travaillé d'abord comme éducateur, j'ai dirigé des foyers, je suis resté dans un établissement pendant près de treize ans. J'ai dirigé le seul centre fermé qui n'ait jamais existé et j'ai procédé à son élargissement. J'ai ensuite, dans les années quatre-vingt, dirigé le département du Val-de-Marne. J'ai eu la chance de travailler pendant trois ans auprès de Gilbert Bonnemaison et de Marc Bécam au Conseil national de prévention de la délinquance où j'ai essayé de mener à un autre niveau des politiques de prévention, de prise en charge et de partenariat. Je suis revenu à l'éducation surveillée auprès du directeur en 1988, puis j'ai eu en charge la région d'Ile-de-France. J'ai été appelé au cabinet du ministère de la ville pendant un an en 1992, j'y ai travaillé sur les questions de justice et de police en relation avec la DIV, qui était à l'époque dirigée par M. Delarue. J'ai fait une incursion dans le secteur associatif puisque j'ai dirigé l'association AIDES d'Ile-de-France pendant quatre ans. Il s'agit également d'exclusion, par la maladie, par les choix de vie. Ils rencontraient à l'époque des difficultés par rapport aux questions de toxicomanie, de recouvrement de l'épidémie, de pauvreté, des banlieues, ce qui correspondait plus à mon travail. On m'a confié ensuite pendant deux ans la direction régionale de l'outre-mer. Enfin, je dirige le CNFE depuis le mois de septembre 2000.
Je le souligne parce que c'est la première fois, il a fallu attendre que l'éducation surveillée ait cinquante-cinq ans et moi aussi pour qu'un professionnel puisse être en charge de l'école professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse... C'est un challenge difficile.
Le CNFE est actuellement à Vaucresson. L'école a été créée en 1952, elle était chargée à la fois de la formation initiale, de la recherche -en liaison avec le CNRS- et de la formation continue. Dans l'esprit du Ve Plan, l'école d'Etat d'éducateurs de Savigny a été créée en 1963. Elle a même à un moment donné été dédoublée avec Toulouse. C'était une période de développement, avec cent vingt recrutements annuels. On passe alors des centres d'observation et des internats à une diversification, à la mise en place de la prise en charge en milieu naturel et dans les foyers, ainsi qu'à la restructuration du dispositif.
En matière de recrutement, vous l'avez sans doute remarqué, l'un de nos problèmes est la sinusoïde. On vient de recruter mille éducateurs alors qu'on n'en avait pas recruté pendant dix ans et, dans les cinq ans à venir, mille vont sans doute partir. Nous n'arrivons pas à avoir un plan régulier de recrutement qui nous permette une montée en charge convenablement dimensionnée que nous puissions absorber. Nous faisons face à des à-coups quand, de temps en temps, nous sommes sur le devant de la scène. C'est une vraie difficulté. En deux ans, l'institution a dû faire face à un tiers d'éducateurs supplémentaire ; il faut maintenant deux à trois ans pour les absorber, pour calmer le jeu, pour que les professionnels soient capables d'assurer les prises en charge. Or nous sommes évidemment attendus tout de suite.
Il y a eu ensuite une période pendant laquelle les recrutements étaient régionalisés et la formation centralisée des éducateurs supprimée. Puis, en 1988, comme il n'y avait toujours pas beaucoup de recrutements, nous avons donné l'école de Savigny à la pénitentiaire et nous nous sommes repliés sur le centre de Vaucresson qui n'est pas fait pour cela : il comprend soixante-dix chambres, quelques salles de formation, car il était conçu pour la recherche et la formation continue nationale. Lorsque de nouveaux recrutements ont eu lieu, nous avons été obligés de passer des conventions avec l'INGEP de Marly. Aujourd'hui, nous occupons en permanence cet établissement pour la formation des éducateurs. Par ailleurs, depuis 1992, il existe un projet de délocalisation à Roubaix qui traîne pour diverses raisons.
Aujourd'hui, nous n'avons pas l'instrument qui permettrait vraiment de recomposer l'institution et de préparer l'avenir. Les éducateurs sont formés à Marly, les professeurs techniques à un endroit, les agents techniques à un autre, nous sommes obligés de louer des locaux. C'est difficile et trop compartimenté par rapport à ce que nous pourrions faire si nous disposions de l'instrument de formation dont nous avons besoin.
Pourquoi faut-il un instrument de formation puisque, d'après le rapport Lazerges-Balduyck, il suffit de recruter des éducateurs spécialisés et de leur donner une petite formation complémentaire ? Si c'était le cas, on le saurait puisque c'est possible depuis 1988. Mais quel intérêt auraient-ils à rejoindre la protection judiciaire de la jeunesse où les premiers postes sont difficiles, dans des situations de prise en charge résidentielle alors qu'ils sont formés pour le handicap et qu'ils vont travailler directement en milieu ouvert ? En outre, le nombre de postes que l'Etat paye aux IRTS ne suffit même pas à remplacer les professionnels du secteur associatif qui vont partir, si vous regardez le plan des cinq ans à venir. Même s'il convient de revenir sur ce plan, parce qu'il faut développer parallèlement le secteur associatif et le secteur public, cela ne résout pas le problème.
Ce n'est pas le même métier que l'éducation dans le handicap. Si nous faisons notre métier, si nous nous consacrons aux grands adolescents délinquants et en grande difficulté, nous intervenons à des stades dépassés. Nous faisons de la rééducation et non pas de l'éducation. C'est bien la difficulté, ce qui fait le coeur du métier, c'est-à-dire que nous devons déconstruire, permettre des régressions, et reconstruire dans des moments où tout est encore possible, parce que l'adolescence est un moment où on peut encore tout rejouer, mais dans des stades dépassés par rapport à des acquisitions qui ont été ratées. C'est un métier compliqué, difficile, dans lequel on n'a pas de baguette magique et qui connaît des limites. Le plus grand danger serait de penser que l'on peut tout faire tout le temps dans les stratégies que nous sommes capables de remplir.
Aujourd'hui, le CNFE a en charge la formation continue et la formation initiale, avec l'aide de onze pôles territoriaux -dont deux petits pôles que je viens de créer à la Réunion et en Guyane-Antilles puisque ces régions étaient abandonnées-, de l'ensemble des catégories de personnels, ainsi que les études et la recherche. En dehors de notre bibliothèque, qui appartient au CNRS, nous n'avons plus de recherche directe. Une des conséquences, c'est que nous ne faisons plus de recherche sur notre travail pédagogique. Nous avons des difficultés à accompagner le travail d'une recherche qui en démontre le bien-fondé ou non. Certains chercheurs s'intéressent à ce que nous faisons, mais on n'établit pas du jour au lendemain le contact avec les jeunes et avec l'équipe d'un établissement. Nous sommes donc en train d'essayer de reconstituer en interne une capacité de recherche pédagogique afin de pouvoir étayer le travail de formation.
Environ cent trente personnes travaillent à l'heure actuelle sur l'ensemble des sites. Les formateurs sont issus des corps professionnels. Ils viennent exercer un autre métier et on les met aussi en formation puisque la transmission se produit en fait sur le terrain. L'école permet de comprendre pour agir, elle éclaire, elle donne l'ensemble des enseignements, elle retravaille sur la pédagogie, mais la professionnalisation est un processus qui se fait avec des aller et retour, c'est une formation pour adultes rémunérée qui se fait dans l'alternance entre le terrain et l'école. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est très difficile d'accueillir d'un seul coup un grand nombre de stagiaires.
La situation actuelle est la suivante : le centre demande depuis les années soixante à devenir un établissement public, afin de pouvoir se gérer -la démarche est en cours, j'espère qu'elle aboutira-, il aurait dû être délocalisé parce qu'il n'a pas la structure correspondant à la tâche qui lui revient. Or c'est important parce que, je le rappelle, dans les dix années qui viennent, nous devrons remplacer environ 50 % des directeurs, 50 % des professeurs techniques, 50% des psychologues et nous allons perdre dans trois ou quatre ans les mille éducateurs que nous venons de recruter !
Le problème est très difficile, j'y insiste, du fait du système national de gestion des ressources humaines. On voit bien que vous nous attendez sur notre capacité à nous occuper des jeunes qui ne peuvent pas rester dans leur milieu familial et naturel. Or, majoritairement, nous nous consacrons aux jeunes qui peuvent rester chez eux. Nous essayons de procéder à leur insertion en nous occupant d'eux, éventuellement de leur famille, des partenaires, quelquefois en mettant en place des substituts aux dispositifs de droit commun quand ils ne peuvent pas y accéder valablement. On a cru très longtemps qu'il suffisait d'y accéder mais, s'ils ne sont pas en état de le faire, ils peuvent les traverser comme autrefois les emplois. Dans mon foyer, quand ils quittaient un employeur, ils en trouvaient un autre le lendemain, mais ils n'étaient pas plus aptes pour autant à en bénéficier.
Donc vous nous attendez sur une capacité qui est à chaque fois dévolue aux derniers arrivés. L'augmentation des postes les fait partir automatiquement dans un système national. Nous sommes confrontés à une injonction paradoxale, nous sommes dans la schizophrénie permanente ! Les éducateurs qui ont pu, à un moment donné, s'occuper des jeunes qui vous préoccupent sont tous en milieu naturel, dans les équipes de milieu ouvert dans lesquelles ils font un excellent travail. Ils permettent d'ailleurs de maintenir certains jeunes en milieu naturel et de ne pas créer de rupture quand elle est inutile.
La dernière opération, qui a consisté à recruter par concours exceptionnel et à ouvrir les CPI et les CER à des personnels qui étaient en formation, est une gageure. Dans certains centres, les trois quarts des personnels sont stagiaires. Ils sont donc en apprentissage la moitié du temps.
Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il faut modifier le recrutement. La nouvelle génération comprend notamment des jeunes issus de l'immigration qui ont leur propre parcours et qui s'en sont sortis. C'est une génération qui recommence à être exigeante. Si nous avons un peu de temps, nous pouvons arriver à gérer la part qui nous revient et que nous savons faire de jeunes qui ne peuvent pas rester dans leur milieu naturel, hors de l'enfermement physique.
Pourquoi, comment ? C'est la question essentielle qui doit aussi nous rendre modestes et limiter notre champ et nos capacités. Au début de ma vie professionnelle, j'ai passé cinq ans avec des jeunes qui sortaient de prison. Je n'ai gagné avec eux que le jour où ils ont accepté de ne pas sortir un week-end parce que je le leur avais demandé alors que la porte n'était pas fermée. L'exigence que l'on peut poser et que l'on gagne est celle que le sujet a investie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en prison.
J'entendais évoquer la situation des jeunes incasables. Il n'y a pas de jeunes incasables, il n'y a que des jeunes qui deviennent difficiles au fur et à mesure que les réponses apportées sont mauvaises. Une étude avait été réalisée à Vaucresson sur des jeunes ayant comparu devant une cour d'assise ; ils n'avaient fait l'objet que de mesures pénales : admonestation, liberté surveillée. On n'avait jamais étudié à fond leur problématique.
Cela ne veut pas dire qu'il faut une réponse immédiate. Nous nous sommes plaints il y a quelques années du fait que la police ne signale pas les délits au moment où ils se produisaient. On découvrait au tribunal que certains jeunes avaient déjà été arrêtés trois ou quatre fois. Effectivement, on était passé à coté. On a travaillé avec la police et on a expliqué qu'un jeune devait être signalé pour prendre en compte son acte, mettre en oeuvre une mesure de réparation si c'est nécessaire et étudier sa situation de façon à engager un processus éducatif. Evidemment, cela a provoqué une augmentation des chiffres de la délinquance. Ce n'est bien sûr pas la seule raison. Nous répondons à des cas individuels alors que le phénomène est collectif, comme mon prédécesseur l'a très bien expliqué.
Soyons modestes ! Environ un jeune sur dix a affaire à la protection sociale, un jeune sur cent au juge des enfants. Il y a un juge des enfants pour 40.000 jeunes âgés de zéro à dix-huit ans, c'est-à-dire qu'il a en permanence environ 400 dossiers à gérer. Il y a deux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour 10.000 jeunes de zéro à dix-huit ans. Voilà ! On peut donner une mission impossible ; on peut aussi demander à cette profession de faire son travail. Suivant ce qu'on lui demandera, on aura des réactions très diverses. Bien sûr, nous travaillons aussi, heureusement, avec le secteur associatif.
Quelquefois, on a pu entendre déclarer que le ministère de la justice allait prendre en charge la délinquance des mineurs. Non ! On prend en charge des mineurs délinquants ou qui ne se sont pas fait prendre. Heureusement que l'assistance éducative existe depuis 1958 : on peut aussi s'occuper de ceux qui ne se sont pas fait prendre si leur situation familiale et sociale est tellement dégradée que l'intervention de la protection sociale ne suffit pas. On s'occupe de jeunes qui ont le bonheur ou le malheur d'arriver devant le juge des enfants et qui nous sont confiés individuellement. On ne traite pas de la délinquance !
Le fait de s'occuper correctement de ces jeunes nous autorise à participer aux politiques publiques, tel était le sens de mon travail au Conseil national de la prévention, pour mener des politiques pour toute la chaîne antérieure. Après on nous les confie et effectivement il faudrait qu'on s'en occupe bien, c'est sûr, mais on ne résout pas la question de la délinquance. On règle les problèmes individuellement.
Comment peut-on résoudre les problèmes de certains de ces jeunes ? Il y a un généraliste, qui est la prise en charge en milieu naturel pour tous ceux qui peuvent rester chez eux. Si ce généraliste ne peut pas s'appuyer sur des prises en charge résidentielles, c'est-à-dire sur des foyers mais aussi sur des outils de rupture comme les CER, encore faut-il qu'il y ait un avant et un après, un centre de jour, des logements, des familles d'accueil. Si le milieu ouvert ne peut pas s'appuyer sur des prises en charge résidentielles, sur des prises en charge substitutives aux dispositifs d'insertion de droit commun, il est ultra-limité. Il est d'autant plus limité qu'il faut tenir compte de la vie des cités face aux stratégies que l'on peut mener en milieu ouvert.
Nous avons cru pouvoir dire, avec Gilbert Bonnemaison et l'ensemble des maires, quelle que soit leur tendance politique : arrêtons d'être dans le balancier entre prévention et répression sans jamais savoir où mettre le curseur. Faisons des politiques de répression, de prévention quand elles sont nécessaires, mais aussi des politiques de solidarité -troisième élément du triptyque que nous avons oublié- et essayons d'avancer !
Si ces mesures n'avaient pas été prises, si les maires ne s'en étaient pas préoccupés, ne s'y étaient pas investis, la situation aurait été grave.
Il faut cependant garder à l'esprit que pendant cette même période le nombre de chômeurs est passé de 1 million à 3 millions. L'échec se situe ici. En effet, pendant que l'on s'efforçait d'agir, tous ces jeunes des cités sont restés à la porte du travail. Finalement, les politiques de la ville qui se sont centrées sur le maintien de ces populations dans leurs ghettos sont des échecs. Ces populations se sont organisées pour survivre. Dans les milieux ouverts que j'ai connus voilà vingt ans, lorsqu'un gamin ramenait de l'argent ou un blouson, il recevait une volée. Maintenant, on ramasse l'argent et on continue à vivre. Ces populations n'ont plus besoin de nous.
Nous sommes confrontés à une dimension collective qui relève d'une politique autre que celle de la protection judiciaire de la jeunesse ou de la ville telle qu'elle a pu être pratiquée ces dernières années. Elle relève d'un autre type de sursaut. Nous sommes face à des jeunes qui sont non plus en situation de conjoncture d'adolescence, de crise d'adolescence, mais en rupture avec le monde actuel.
C'est pour cette raison que les CER fonctionnent. Ils n'ont pas de murs car ce ne sont pas des centres fermés. Mais ils ont des hommes. Cinq hommes pour cinq jeunes, c'est un investissement important. Le CER fonctionne parce qu'il comprend un groupe qui est formé d'adultes et de jeunes. On n'échappe pas au rétablissement de la relation entre les jeunes et les adultes. La dynamique de groupe s'exprime au travers des activités fortes qui sont menées collectivement.
Malheureusement, s'il n'y a rien après le séjour en CER, ce dernier s'intercalera entre deux séjours en prison.
La question forte qui se pose à nous est de savoir comment se positionner, au sein du secteur public et du secteur associatif pour prendre en charge à long terme ces jeunes qui ne peuvent pas rester dans leur milieu naturel parce qu'ils n'ont aucune chance d'y évoluer et que la rupture est nécessaire. Au lieu de les exclure des établissements pour leur comportement, comment réussir à gérer un parcours avec le soutien des juges des enfants qui soit meilleur que celui qui existe aujourd'hui. C'est là l'autre volet important.
Comparé à un gros dispositif de protection sociale, le petit filet de sécurité que constitue la protection judiciaire n'a de chances de fonctionner que s'il est signifié, c'est-à-dire si le juge reçoit effectivement le jeune et lui dit « C'est moi qui te place ». Lorsque, au cours d'une inspection en foyer, à ma question « Qui t'a placé ? » j'entends le jeune me répondre « C'est mon éducateur », je me dis que cela ne fonctionnera pas.
En revanche, nous devons reconnaître qu'à certains moments les actes et la situation à tous égards du jeune font qu'il va forcément en prison, voire à l'hôpital psychiatrique. On ne peut malheureusement pas échapper à ces mesures. Aujourd'hui, près de 1 000 jeunes sont en prison en permanence.
Je mène depuis vingt ans un combat dans les centres de détention où j'ai fait entrer les opérations dites « prévention été ». A l'évidence, on sent que le secteur pénitentiaire s'organise pour prendre en charge ces 1.000 jeunes de façon décente et sans les mélanger avec les jeunes adultes sous prétexte de les faire tenir tranquilles. On sait à quel prix ils se tiennent tranquilles. Ils sortent de la prison pires qu'ils n'y sont entrés !
On a le droit de mettre les jeunes en prison. On peut débattre de l'âge, mais on a le droit d'interrompre un parcours de délinquance. Le pire de tout pour un délinquant c'est de ne pas avoir de réponse. L'absence de réponse suscite de l'angoisse et l'angoisse créée de la réitération. Il ne s'agit pas de recommander la tolérance zéro car elle n'est destinée qu'à ceux qui se font prendre. La question n'est pas là. Mais les éducateurs ont pendant longtemps négligé l'importance de la réponse. Dans les années 1988, nous avions préparé une réforme de l'ordonnance de 1945, que nous n'avons pas pu faire passer en raison de l'opposition des juges et des éducateurs.
Nous nous battons pour ces jeunes dont nous nous occupons. Ce sont des êtres en devenir, qui manifestent leurs difficultés de différentes manières en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont vécu. Certains se suicident. On ne parle pas de cette première cause de mortalité des jeunes aujourd'hui, après les accidents de mobylette. Ces jeunes-là, on n'en parle pas car ils ne touchent qu'à eux-mêmes. D'autres se réfugient dans la toxicomanie, notamment le shit . C'est une vraie question qui vient heurter tous nos efforts. Nous savons qu'elle atteint le libre arbitre mais qu'on ne peut la laisser sans réponse. En outre, ces jeunes sont confrontés au problème des mafias et à tous les phénomènes qui ont été expliqués.
Souvent, tous ces jeunes s'expriment dans l'agressivité et le délit. J'ai eu parfois beaucoup plus de difficultés avec des jeunes en assistance éducative, qui n'avaient pas été capables d'agressivité et de délit, qu'avec des jeunes délinquants.
Le pire de tout serait de revenir en arrière en ne traitant que des délinquants entre eux. L'ordonnance de 1958 a été essentielle pour nous. Lorsque j'ai passé le concours de recrutement en 1964 au centre d'observation de Savigny, les jeunes sur place demandaient aux nouveaux arrivants : « Qu'est-ce que tu as fait ? ». En fonction de la réponse, l'arrivant découvrait les caïds, le secret et la hiérarchie, comme s'il était en prison. Il a fallu attendre les années soixante-dix pour entendre les jeunes poser la question suivante « Pourquoi tu es là ? ». Les arrivants répondent : « Parce que je ne peux pas vivre chez moi, cela ne va pas avec mes parents, et puis j'ai fait des conneries. »
Il est essentiel que le jeune ait la possibilité d'investir son placement et qu'il considère sa prise en charge comme quelque chose qui lui est nécessaire. A l'évidence, il ne s'agit pas de demander son accord car dans ce cas seuls ceux qui sont d'accord viennent. Que fait-on des autres ? S'il y avait un agrément de protection judiciaire de la jeunesse, il faudrait s'occuper également de ceux qui ne le veulent pas !
Pour permettre au jeune d'investir son placement, il faut accomplir un travail psychologique, éducatif, vivre avec lui, avoir une activité avec lui. Si vous mettez tous les délinquants ensemble, ils ne vont pas se socialiser, de même que si vous rassemblez les imbéciles dans la même classe, ils ne deviennent pas intelligents. Les résultats se remportent peu à peu.
Nous sommes parfois dans la nécessité de les punir et d'arrêter des dispositifs contraignants. Il m'est arrivé de voir sortir trop tôt un jeune criminel. Il n'avait pas eu le temps d'intégrer son crime, de s'en rendre compte d'autant que la prison ne possédait ni psychologue, ni psychiatre. Il n'existait pas d'intervention socioéducative. Le jeune réitérait.
Il y a des nécessités de contrainte, mais il faut offrir une alternative au jeune au moyen du dispositif de la protection judiciaire. Il importe que le juge pour enfants puisse dire au jeune « Je pourrais te mettre en prison ». La rapidité de la réponse à l'adolescent ne doit pas empêcher de consacrer du temps au travail éducatif et exclure d'autres possibilités. Si l'on classe l'affaire, tout est fini.
La réforme que nous avions préparée prévoyait que le jeune qui avait commis un délit ou qui avait une situation personnelle difficile soit placé sous protection judiciaire et que le juge des enfants, qui est le seul juge à ne jamais être déchargé de la décision qu'il prend, suive l'évolution du jeune et la gère, en délinquance comme en assistance éducative, sans retourner systématiquement au tribunal, parce que le processus est extrêmement lourd. C'est pour cela qu'autrefois les juges fermaient le dossier de délinquance pour ouvrir un dossier d'assistance éducative. Mais ce faisant, ils dépossédaient le jeune de son acte. Ce dernier restant avec son acte sur les bras sans savoir quoi en faire, réitérait.
Il faut donc apporter des réponses en intégrant la réparation à l'action éducative. Je le répète, un juge doit pouvoir dire à un jeune « Je pourrais te mettre en prison mais je vais choisir d'essayer autre chose. Je te reverrai dans quelques mois au tribunal pour te juger. A ce moment-là, je pourrai encore te mettre en prison ».
On dit, à tort, qu'il est impossible de mettre les jeunes âgés de 13 à 16 ans en prison. Certes, on ne peut pas les mettre en détention préventive en matière délictuelle, mais le tribunal peut décider de les mettre en prison. Pourquoi ne le fait-on pas ? Pourquoi le suivi de ces jeunes est-il insuffisant ? Les juges sont débordés aujourd'hui en raison du nombre excessif de situations d'assistance éducative qui leur sont signalées parce que les dispositifs de protection sociale ne fonctionnent pas suffisamment.
On n'a pas su faire le travail social communautaire. Dans les dispositifs existants, la plupart des travailleurs sociaux passent leur temps à remplir des dossiers pour ouvrir des droits et à discuter des dossiers dans de grandes commissions, plutôt que d'en parler avec les intéressés. Je suis désolé d'avoir à faire ce constat mais c'est ainsi que le travail social s'effectue aujourd'hui.
Autre problème : le jeune dépend de l'Etat pour sa toxicomanie, de la région pour sa formation professionnelle, du département pour sa prévention spécialisée et, éventuellement, de sa commune pour le reste. Qui décide de la recomposition de l'ensemble de cette politique ? Ce n'est pas un saucisson.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Lors du tour de France qui a été effectué par la commission d'enquête dans les centres CER et CPI, le sentiment qui a prévalu est celui d'une crise de vocation. Est-elle réelle ou n'est-ce qu'une impression ? Un éducateur intègre-t-il cette filière par vocation ou pour la carrière ?
M. Pierre Berton - Il y a une crise de recrutement. Au début de ma carrière, on rentrait dans la profession soit muni du baccalauréat ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé -à l'époque, le diplôme d'Etat pouvait se préparer sans le baccalauréat-, soit au terme d'un stage contractuel ne nécessitant pas le baccalauréat. Par la suite, le baccalauréat a souvent été réclamé. On était dans une situation où on rentrait dans la profession, soit avec le baccalauréat, soit avec le diplôme d'Etat. Cela n'avait pas de sens.
Pour éviter de recruter simplement des jeunes sortant de faculté, il a été décidé de recruter au niveau bac + 2, de façon très large, en équivalence du diplôme d'Etat. Les titulaires du diplôme d'Etat recevaient un an de formation - mais je vous le répète, ceux-là ne sont pas rentrés dans la profession et ils n'y viendront pas ! Les titulaires d'un bac + 2 très large doivent suivre une formation de deux ans. Cette formation existe toujours, bien que je sois en train de la transformer complètement.
Malheureusement, le chômage et l'absence d'une politique de recrutement ont conduit à placarder des affiches dans les facultés de droit. Pour y recruter des étudiants. Autrefois, le concours comportait une batterie de tests d'élimination, puis une mise en situation de quinze jours dans un établissement et, après seulement, une épreuve écrite et une épreuve orale. Aujourd'hui, le concours de la fonction publique, dans un souci d'égalité, se résume à une épreuve écrite. Se trouvent éliminés tous ceux qui pourraient pratiquer avec les adolescents. Les personnels dont on avait besoin n'ont pas été recrutés, non pas qu'ils n'existent pas mais parce qu'on a engagé des personnes qui sont souvent loin des jeunes et qui sont là en attendant, ou faute de mieux.
On voit qu'il y a un vrai problème de recrutement. Je fonde des espoirs sur la réforme de l'année dernière des équivalences, afin de diversifier le recrutement en direction, soit de bacheliers ayant deux ans d'expérience professionnelle, soit de jeunes non titulaires du baccalauréat mais possédant des expériences professionnelles, ou enfin de diplômés qu'on ira chercher ailleurs qu'à la faculté de droit.
M. le président - La même difficulté se rencontre dans de nombreux secteurs de la fonction publique, notamment à l'échelon territorial.
M. Pierre Berton - Bien sûr, et pourtant le potentiel existe. Mais il y a des limites, sauf à faire de la protection judiciaire de la jeunesse une institution énorme !
M. le président - Je vous remercie, Monsieur Berton.
Audition de Mme Marie CHOQUET,
Psychologue,
épidémiologiste et directeur de recherche à
l'INSERM
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre Mme Marie Choquet, psychologue, épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM, qui s'est particulièrement intéressée à l'étude épidémiologique de la santé des jeunes entre 11 et 20 ans.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Madame, nous vous écoutons.
Mme Marie Choquet - Avant d'aborder le fond du sujet, je voudrais préciser le cadre de mes recherches. J'ai en effet développé à l'INSERM un axe de recherches à partir de la santé des jeunes entre 11 et 20 ans. La définition retenue pour la santé est celle de l'OMS, c'est-à-dire la santé physique, sociale et mentale. Je me suis pour ma part intéressée à la santé mentale et sociale.
L'épidémiologie est une méthode scientifique qui permet de mesurer la prévalence des problèmes dans une population donnée. A cette fin, sont tirés au sort des échantillons représentatifs de la population que l'on souhaite étudier. La représentativité de l'échantillonnage est un point important qui est au centre de notre méthodologie. Parallèlement à la définition des problèmes et à l'étude des prévalences, sont analysés les facteurs associés qui peuvent à terme expliquer certains comportements, même si, en matière de santé mentale et sociale, il faut toujours rester prudent dans ses conclusions.
Un des outils de la méthodologie épidémiologique permet de classer les facteurs par ordre d'importance, ce qui est impossible lorsque l'on fait une enquête transversale, c'est-à-dire une photographie, à un moment donné, d'une population. On peut ainsi savoir si tel facteur est associé à tel type de comportement et surtout si tel facteur est plus associé que tel autre. C'est un point important, non pas nécessairement pour tout comprendre, mais en tout cas pour savoir si, par exemple, les facteurs sociaux pèsent plus que les facteurs familiaux, relationnels ou scolaires, et ainsi pouvoir faire de la prévention.
Il n'y a donc pas de notion de causalité dans le type de recherches que je mène. On parlera de facteurs de risques, c'est-à-dire qui auront une influence, de populations à risques et de conduites à risques. C'est le sens statistique qui nous intéresse plus qu'une explication que d'autres sciences pourraient être à même d'apporter.
J'ai d'abord étudié la population dite générale. La méthode épidémiologique se fonde en effet sur la comparaison entre populations, entre modes de faire, ce que l'on appelle l'évaluation. On va donc comparer la population que l'on souhaite étudier à une autre qui ne présente pas les mêmes risques, ce qui permettra de mettre en évidence les particularités de la première.
La population juvénile française est scolarisée jusqu'à l'âge de 16 ans, voire 18 ans, puisque le taux de scolarisation à cet âge est de plus de 80 %. Donc, plus le temps passe, plus les populations scolaires sont de bonnes populations de référence pour étudier des populations particulières.
La population générale des adolescents se caractérise par une grande diversité démographique -50 % de filles, 50 % de garçons- ainsi que par une diversité sociale et ethnique. On oublie parfois que les jeunes sont les enfants des adultes qui composent notre société. Cette diversité se retrouve également dans les modes de vie. On a défini trois lieux de vie essentiels pour l'enfant et l'adolescent : la famille, l'école, les loisirs.
Plus de 70 % des jeunes de la population globale vivent dans une famille unie, c'est-à-dire avec leur mère et leur père ; 25 à 30 % environ vivent dans une famille désunie, soit par divorce, soit par décès. Il est à noter que la proportion de jeunes vivant dans une famille où l'un des parents est décédé a plutôt diminué alors que la proportion de jeunes vivant dans une famille désunie a plutôt augmenté. Plus de 95 % des adolescents de la population générale vivent avec leurs parents, soit mariés, soit divorcés. Enfin, un jeune sur quatre vit dans une famille de trois enfants et plus.
Lorsqu'on les interroge, les jeunes, globalement, se déclarent contents de leur famille. Ils disent que leurs parents s'intéressent à eux, qu'ils sont des interlocuteurs en cas de difficultés. Bien sûr, dans cette population générale, c'est parmi les jeunes les plus en difficulté que l'on retrouvera ceux qui disent que leurs parents ne s'intéressent pas à eux, ne les aiment pas, sont hostiles et qu'ils ne se confient pas à leurs parents en cas de problème. Mais, dans l'ensemble, la relation entre parents et enfants est bonne.
D'ailleurs, lorsque l'on met en parallèle les réponses à des questions du même type -se sentent-ils heureux à l'école, s'y sentent-ils intégrés ?- on constate que les enfants déclarent se sentir moins bien à l'école qu'en famille, et ce mécontentement par rapport à la scolarité a plutôt tendance à s'accroître. En ce qui concerne le bien-être à l'école, il y a toutefois une différence entre les sexes qui va également jouer sur le mode de vie ou en famille : les filles s'intègrent mieux scolairement que les garçons alors que ces derniers se sentent mieux en famille que les filles.
Par ailleurs, on est surpris du taux élevé de jeunes qui ont déjà redoublé. Plus de la moitié des jeunes ont connu un redoublement durant leur scolarité, le risque de redoubler augmentant sensiblement avec l'âge. Ce taux de redoublement élevé ne semble pas en soi complètement anodin.
En ce qui concerne les troubles du comportement, nous avons étudié la consommation de drogues, la violence, la dépressivité, les tentatives de suicide, l'absentéisme scolaire ainsi que les conduites alimentaires.
La consommation de drogues, de cannabis et de tabac en particulier, a fortement augmenté, voire explosé durant les sept dernières années. C'est également le cas d'autres troubles tels que la dépressivité et les tentatives de suicide, dont on parle moins, et cela n'est pas tout à fait indépendant du fait que certains troubles sont plus masculins et d'autres plus féminins.
La consommation de drogues -alcool, tabac, cannabis et autres substances- associées les unes aux autres est un comportement plutôt de type masculin. La dépressivité, les tentatives de suicide, les troubles du comportement alimentaire, la violence directe et indirecte sur soi-même affectent davantage les filles. Dans l'ensemble, les filles vivent l'adolescence plus douloureusement que les garçons.
Si l'on peut parler d'une explosion des comportements liés à la consommation de drogues ou à la dépressivité au cours des sept dernières années, en revanche, les résultats obtenus en ce qui concerne la violence, qu'il s'agisse de la violence exercée sur autrui ou sur soi, ne permettent pas d'affirmer qu'il y a eu une augmentation en ce domaine, dans la mesure où nous ne posons pas nécessairement aujourd'hui les questions que nous posions au départ de cette enquête. Nous avons en tout cas constaté une recrudescence très forte des tentatives de suicide.
Que peut-on dire des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse ? Il s'agit d'une population repérée par l'institution judiciaire, au même titre que les suicidants sont repérés par l'institution hospitalière et, de ce fait, à hauts risques.
On y trouve plus de garçons que de filles. La moyenne d'âge est moins élevée qu'on ne pourrait le supposer au regard de la tranche d'âge considérée, qui se situe entre 14 et 21 ans, puisqu'elle est de 16 ans et demi et non de 17 ans et demi. Une proportion importante de ces jeunes est d'origine étrangère.
En ce qui concerne les caractéristiques familiales, à la différence de la population générale, ces jeunes appartiennent plutôt à des familles désunies puisque, toutes proportions gardées, on y trouve deux fois plus de jeunes dont les parents sont séparés ou divorcés et trois fois plus de jeunes dont l'un des parents est décédé. Par ailleurs, ces jeunes ont une fratrie très importante puisque trois fois plus de jeunes qu'en population générale ont une fratrie d'au moins quatre enfants.
Le point sur lequel ces jeunes se différencient le plus de la population générale est la scolarité. Ils se caractérisent par une grande déscolarisation. Ainsi, 20 % des jeunes de moins de 16 ans ne sont plus scolarisés, alors que le taux est proche de zéro en population générale ; le taux de déscolarisation est de 55 % parmi les 16-17 ans, alors qu'il est de 5 % en population générale ; il est de 81 % parmi les 18-21 ans, contre 12 % en population générale.
Cette déscolarisation importante est également précoce puisque l'âge moyen de déscolarisation est de 15 ans et demi, soit six mois avant la fin de la scolarité obligatoire.
C'est un point qui me paraît essentiel et sur lequel il faut réfléchir davantage. Peut-être a-t-on là manqué quelque chose ?
Peu de ces jeunes travaillent mais 69 % d'entre eux ont suivi des stages, ce qui traduit une volonté de s'investir, mais, en même temps, les stages d'insertion, c'est également vrai en population générale ainsi que d'autres études l'ont montré, débouchent plus souvent sur d'autres stages que sur un emploi. C'est là une des caractéristiques de ces jeunes que l'on ne retrouve pas dans les redoublants multiples puisqu'ils sont souvent déscolarisés avant d'avoir eu le temps de redoubler.
Une autre caractéristique de cette population est la violence multiple exercée sur soi et sur les autres, et cela est particulièrement vrai pour les filles. Ainsi, 61 % des garçons et 45 % des filles ont eu un accident au cours de l'année écoulée, 24 % des garçons et 15 % des filles en ayant eu plusieurs. En population générale, ce taux est deux fois moins élevé s'agissant des garçons et trois fois moins élevé s'agissant des filles.
En ce qui concerne les tentatives de suicide, les études ont montré que les jeunes qui sont violents envers eux-mêmes le sont envers autrui et ont eux-mêmes subi des violences. On est dans un climat de violence générale qui n'épargne personne. Durant leur vie, 12 % des garçons et 49 % des filles ont déjà fait une tentative de suicide. En population générale, le taux est de 5 % pour les garçons et de 8 % pour les filles. La différence est donc extrêmement importante.
Il en est de même de la violence sexuelle subie. Là encore, 6 % des garçons et 34 % des filles de la population PJJ ont été victimes de violences sexuelles, contre respectivement 2 % et 6 % en population générale. L'écart entre la population générale et cette population PJJ est d'autant plus important chez les filles que celles-ci ne constituent qu'un quart de la population PJJ.
La première violence sexuelle subie l'a été en moyenne à l'âge de 12 ans et nous avions montré dans une autre étude que les jeunes déscolarisés avaient souvent été victimes de violences sexuelles. Il y a donc bien une liaison, même indirecte, entre la violence subie et la déscolarisation médiatisée par une dévalorisation de soi.
Sans que ce chiffre soit nécessairement à inscrire au chapitre des violences, j'indique par ailleurs que 21 % des filles ont déjà été enceintes et que la moyenne d'âge se situe à 16 ans et demi, ce qui n'est pas du tout le cas en population générale.
Les troubles de conduite alimentaire sont une autre forme de violence que l'on s'inflige à soi-même. Ces troubles qui affectent plus les filles que les garçons sont trois fois plus nombreux chez les jeunes PJJ que chez les jeunes de la population générale.
En dehors de ces violences multiples, qui sont souvent associées, on retrouve des délits en chaîne -racket, consommation de stupéfiants, divers comportements déviants et illicites- dont on sait qu'ils vont à terme influer sur la santé et, de fait, nuire à l'intégration scolaire et sociale. Toutes proportions gardées et de façon très étonnante, ces délits sont plus le fait des filles que des garçons.
A cela, s'ajoutent ce que l'on a appelé les transgressions quotidiennes qui, si elles ne constituent pas des délits, ne se rencontrent pas dans les mêmes proportions chez la population générale. Ainsi, 77 % des garçons et 83 % des filles fument au moins un demi paquet de cigarettes par jour, contre 8 % et 10 % dans la population générale. Plus d'un quart de ces jeunes ont déjà fugué, ce qui est beaucoup plus rare en population générale.
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, le taux de prise en charge médicale est relativement élevé. Ainsi, l'hypothèse que l'on a démentie est que les jeunes sont en difficulté parce qu'ils manquent de soins. Toutes nos recherches contredisent cette hypothèse puisque les jeunes qui vont mal consultent beaucoup plus que les autres et que plus ils vont mal plus ils consultent. Le nombre de consultations auprès des médecins généralistes est d'environ 4 par an alors que la moyenne en population générale est de 1,5 à 2 consultations par an. Ils consultent également certains professionnels spécifiques tels que les psychologues, les psychiatres, les éducateurs. Que le taux de consultation chez les jeunes qui vont mal soit élevé ne nous surprend pas, mais que le fait d'intervenir ne porte pas ses fruits, en tout cas au regard des données que l'on possède, est plus préoccupant. C'est là une question qui n'est pas résolue.
Egalement étonnant est le fait que ces jeunes ont des loisirs comme les autres. Ils font du sport, ils sortent avec leurs copains et ont un mode de vie qui est assez comparable à celui des jeunes de leur âge. Nous l'avons constaté en ce qui concerne les suicidants, dont les modes de vie sont proches de ceux des autres jeunes, ce qui les rend d'ailleurs difficilement repérables. On s'attend à ce que ces jeunes soient en retrait, isolés ; ce n'est absolument pas le cas. Ils ne se sentent pas bien mais ils font comme s'ils étaient des jeunes ordinaires. Il faut travailler sur ce point qui, après tout, est positif puisqu'ils ont envie de vivre comme les autres même s'ils ont beaucoup de troubles ou des comportements à risques.
En conclusion, il est intéressant de noter que, si 5 % des jeunes d'une population générale peuvent être considérés comme risquant fortement d'être placés sous mandat judiciaire, seulement 0,5 % d'entre eux sont réellement pris en charge. Cette population générale à risques concerne les jeunes qui ont volé plusieurs fois, qui ont consommé des drogues, pratiqué le racket ou qui se sont montrés très violents. Qu'est-ce qui différencie, au sein de cette population à risques, ceux qui seraient susceptibles d'être placés sous contrôle de la justice de ceux qui le sont effectivement ? Ce sont essentiellement des facteurs sociaux. Si les jeunes qui ont des comportements graves et répétés sont en difficulté personnelle, ils ne sont pas pour autant socialement défavorisés. Les jeunes placés sous contrôle judiciaire sont souvent issus de milieux sociaux défavorisés et sont souvent d'origine ou de nationalité étrangère.
En revanche, sur tous les autres points étudiés -grande violence, consommation de tabac et d'alcool, tentative de suicide- à l'intérieur d'une population scolaire, les jeunes susceptibles d'être placés sous mandat judiciaire présentent strictement les mêmes caractéristiques que ceux qui le sont réellement. Cela signifie que les jeunes susceptibles d'être pris en charge par la justice sont déjà potentiellement présents dans les écoles et qu'ils passent probablement inaperçus. Mais le risque de déscolarisation est important. Je me pose donc la question suivante : la prévention de cette désocialisation que va comporter la prise en charge judiciaire ne peut-elle pas être entreprise au niveau des établissements scolaires ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Derrière le problème de la déscolarisation qui, nous avez-vous dit, madame, se produit vers 15 ans et demi, n'y a-t-il pas le problème du collège unique dont le rôle est normalement de favoriser la socialisation et qui écarte un certain nombre de jeunes en situation de décrochage scolaire ?
Mme Marie Choquet - Je précise que les jeunes en déscolarisation précoce représentent la moitié des jeunes de la PJJ et non pas l'ensemble. Ils étaient certainement au collège et non pas au lycée.
On ne devient pas déviant du jour au lendemain. Le processus est parfois relativement lent. On ne devient pas consommateur de drogues dures du jour au lendemain. On passe par le tabac, l'alcool, le cannabis. Il va y avoir à un moment une rupture scolaire. Ce qui semble caractériser ces jeunes, c'est qu'ils n'aimaient pas l'école, étaient souvent absents et, à un moment, ont décroché.
Des études ont montré qu'un jeune qui est en difficulté scolaire, qui est absentéiste, qui consomme des drogues, a plus de risques de quitter l'école s'il est issu d'un milieu socialement défavorisé et en particulier s'il est d'origine étrangère. Les autres vont être tenus par leur famille, vont être accrochés au système scolaire jusqu'à ce que la difficulté passe, d'une certaine façon. La culture de la scolarité -c'est une hypothèse sociologique qui semble fondée- est beaucoup plus importante dans les milieux français que dans les milieux étrangers, en particulier vis-à-vis des garçons, qui sont beaucoup plus difficiles à tenir en matière scolaire que les filles.
Par rapport au collègue unique, je pense que pourrait être favorisée la mise en place de systèmes de veille scolaire. Un jeune qui commence à être absent dès le collège, ce n'est pas bon signe. Un jeune qui consomme du tabac à 12 ou 13 ans, c'est bien plus mauvais signe que s'il le fait à 17 ou 18 ans. Face à un jeune qui adopte des comportements de déscolarisation avant l'âge de 13, 14 ou 15 ans, l'école doit se poser des questions et chercher à comprendre ce qui motive de tels comportements.
Certains jeunes, parce qu'ils sont déjà gros consommateurs de produits illicites, ne sont plus capables de fournir l'effort nécessaire pour aller régulièrement à l'école. D'autres, on le voit pour les filles qui sont considérées comme des mamans bis , sont obligés de rester à la maison pour s'occuper de leurs petits frères et soeurs. En matière de déscolarisation, surtout au collègue, l'école doit savoir pourquoi et à quel moment le jeune est absent. Tenir à cette scolarité avant l'âge de 16 ans me semble un point essentiel.
M. le rapporteur - Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour mener à bien votre enquête dans les structures de la PJJ ?
Mme Marie Choquet - Oui. Les épidémiologistes ont toujours l'art de montrer, dans leurs enquêtes, les dysfonctionnements institutionnels. Lorsqu'on réalise une enquête en milieu scolaire par exemple, c'est avec l'autorisation de l'administration centrale. Les recteurs ainsi que les établissements tirés au sort sont prévenus mais l'on se rend compte que l'information ne passe pas toujours très bien, qu'il y a des résistances.
Nous avons nettement perçu ces résistances à l'occasion de cette enquête menée au sein des structures de la PJJ, qui a pourtant été préparée pendant deux ans au niveau de l'administration centrale et a été menée à la demande de la PJJ elle-même. Une fois sur le terrain, et compte tenu de la très grande diversité qui le caractérise, on a constaté que les choses n'étaient pas aussi simples qu'on pouvait le penser et que la règle n'était pas toujours respectée. Le taux de réponse aux enquêtes postales, qui sont les plus mauvaises que l'on puisse imaginer, même si elles sont par ailleurs très pratiques, est généralement de 30 %. Nous, à une enquête réalisée à partir de l'institution, nous avons obtenu un taux de réponse de 17 %, c'est-à-dire inférieur aux plus bas taux généralement enregistrés.
Cette enquête épidémiologique se heurtait à deux obstacles.
D'une part, on s'adressait directement au jeune en lui demandant ce qu'il pensait de sa santé, ce qui était assez mal ressenti, dans la mesure où les corps intermédiaires estiment que l'information leur appartient. Malheureusement, l'épidémiologie ne fait pas du tout confiance aux corps intermédiaires. Ainsi, ce ne sont jamais les médecins que l'on interroge sur la santé des personnes parce que, pour nous, la meilleure source d'information est le sujet lui-même. En l'espèce, deux cultures se sont entrecroisées et nous n'avons peut-être pas suffisamment tenu compte de cette différence dans la mise en route de l'enquête.
D'autre part, nous nous sommes aperçus que les jeunes figuraient plusieurs fois dans le listing de la PJJ, les noms étant orthographiés de façon différente. Un grand nombre d'entre eux avaient également déménagé, ce que la PJJ ignorait, à notre étonnement, s'agissant d'une population a priori prise en charge par l'institution judiciaire.
En tout cas, cette enquête n'a pas recueilli l'adhésion des éducateurs. Sans doute n'avons-nous pas été suffisamment convaincants. Le taux de réponse est d'environ 20 %. Nous avons noté que les réponses concernaient la population en moins grande difficulté, c'est-à-dire plutôt les filles, les jeunes, les scolaires, puisque nous avions une définition exacte de la population qui aurait dû faire partie de cet échantillon. Cela nous conduit à dire que nous avons des chiffres planchers sur les difficultés. Si l'on constate déjà une différence très importante entre la population générale et la population PJJ sur un certain nombre de points, on peut supposer que, dans la réalité, cette différence est encore plus importante, ce qui n'est pas franchement fait pour nous rassurer.
M. le rapporteur - Quelles suites ont été données par la PJJ au constat très sévère que vous aviez fait en 1998 ?
Mme Marie Choquet - Je compare cette enquête à celle que nous avions effectuée en milieu scolaire entre 1970 et 1975. La véritable collaboration avec l'Education nationale a commencé vingt ans après... En ce qui concerne l'enquête effectuée auprès de la PJJ en 1998, les vingt années ne sont pas encore écoulées. Nous n'avons pas vu d'effets immédiats de cette enquête. Si la PJJ en tient compte, l'objectif sera atteint. Je pense qu'il aurait été souhaitable de compléter et d'approfondir ces analyses mais cela aurait nécessité une collaboration plus importante.
Lorsqu'on réalise des enquêtes qui ne font pas partie de la culture institutionnelle, c'est le cas des enquêtes épidémiologiques, un certain délai est nécessaire pour que les choses s'améliorent. Donc, j'attends.
M. le rapporteur - La formation des personnels de la PJJ vous semble-t-elle bien adaptée au problème du traitement des jeunes ?
Mme Marie Choquet - Les problèmes psychologiques voire psychiatriques de ces jeunes, et plus généralement leurs problèmes de santé, ont rarement été pris en compte et il y a, à ce niveau, une révolution culturelle à mener. Lorsqu'en 1993 les enquêtes effectuées auprès de la population générale nous ont amenés à dire que le fait qu'un jeune aille mal était lié non pas au niveau culturel ou social de sa famille mais à la qualité relationnelle entre les personnes dans sa famille ou à l'école, j'ai cru qu'on allait se faire tuer.
Dire que les facteurs sociaux n'expliquent pas tout ne faisait pas partie de la culture institutionnelle. La PJJ a beaucoup travaillé sur cette différence sociale. Certes, elle récupère parmi les jeunes qui vont mal ceux qui, en plus, sont socialement défavorisés mais le fait d'être socialement défavorisés n'est pas le facteur explicatif de leurs troubles. S'il y a association chez ces jeunes de difficultés sociales et psychiques, les unes ne sont pas l'explication des autres.
On a essayé de démontrer comment se faisait l'enchaînement de la prise en charge. Par exemple, les jeunes déprimés qui sont issus de milieux socialement favorisés, qui n'ont pas de problèmes scolaires, ont beaucoup moins de risques d'être pris en charge que ceux qui, aussi déprimés, sont issus de milieux socialement défavorisés. Le système de prise en charge s'est donc beaucoup axé sur des variables sociables alors que la pathologie ou les difficultés n'étaient pas d'ordre social. C'est à l'intérieur d'un groupe en difficulté que la différence va s'accentuer.
J'ai essayé de lutter contre le misérabilisme en montrant que c'est non pas parce qu'ils sont socialement défavorisés que ces jeunes ne vont pas bien mais parce qu'ils ont des difficultés relationnelles avec leur famille ou à l'école. La pathologie mentale des parents est un point essentiel qui se retrouvera quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent, même si les modes d'expression de cette pathologie peuvent être différents d'une classe sociale à une autre.
Si, ensuite, on n'est sensible qu'aux différences sociales, on va intervenir sur ces groupes qui sont en difficulté uniquement à l'intérieur d'un groupe social. Tel est le problème qui se pose aujourd'hui. Toutes les enquêtes que nous avons effectuées montrent que, quel que soit le type de prise en charge considéré, le modèle retenu est toujours le même. En travaillant sur l'infirmerie scolaire, notamment, nous nous sommes aperçus qu'aux jeunes en difficulté qui s'adressaient à l'infirmerie s'ajoutaient les jeunes en difficulté sociale. La dimension sociale va d'autant plus jouer à la PJJ que cela fait partie de sa philosophie. Elle a très longtemps, me semble-t-il, retenu comme facteur explicatif les difficultés sociales et s'y est donc particulièrement intéressée.
M. Bernard Plasait - Pensez-vous qu'un système alternatif à la filière unique jusqu'à l'âge de 16 ans, offrant des possibilités de préorientation professionnelle vers l'âge de 14 ans, serait de nature à empêcher ou en tout cas à atténuer un certain nombre de comportements déviants ?
Mme Marie Choquet - J'ai cherché à savoir si les résultats que nous avions obtenus étaient cohérents par rapport à ceux que l'on trouve à l'étranger. Dans les systèmes nordiques, par exemple, la différenciation scolaire n'intervient qu'après 16 ans. Ayant comparé les taux de difficultés des populations françaises et ceux des populations ayant un système scolaire complètement différent du nôtre, je ne suis pas sûre qu'un autre mode scolaire aurait changé les choses. Ce qui me paraît plus important, c'est l'attention que doit porter l'école aux jeunes en difficulté. D'autres systèmes fonctionneraient sans doute aussi bien mais il me semble que l'essentiel de l'explication n'est pas là. Le plus préoccupant est que, lorsqu'un jeune est absentéiste ou a des problèmes familiaux, l'école ne soit pas suffisamment informée et que les modes d'action ne soient pas adaptés à la gravité des cas.
M. Patrice Gélard - J'aimerais que vous nous précisiez certains chiffres en particulier concernant le pourcentage des jeunes suicidaires dans la population globale -le taux de 5 % que vous avez cité me paraît énorme - et le pourcentage des jeunes ayant subi des agressions sexuelles.
Mme Marie Choquet - Ce chiffre est exact : 5 % des garçons en population générale ont fait une tentative de suicide. Je me félicite que vous releviez ce chiffre qui est effectivement énorme. D'ailleurs, entre 1993 et 1999, c'est-à-dire entre les deux enquêtes que nous avons menées sur un échantillon représentatif national, le nombre des tentatives de suicide a augmenté, en particulier chez les filles ; 0,9 % des filles d'une population scolaire ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie, même si la mortalité est heureusement bien plus basse, environ 1 pour 10 000. Mais on sait qu'un tiers des suicidants récidivent. C'est donc un problème crucial de société auquel on ne prête pas suffisamment attention.
Certes, ces jeunes ne nuisent qu'à eux-mêmes. Ils ne mettent pas en cause l'ordre social et, s'ils font des tentatives de suicide, ils n'en meurent pas. Ils sont parfois hospitalisés et sont remis dans le circuit cahin-caha. Ces pourcentages me paraissent très élevés et j'aimerais que l'on porte à ce problème au moins autant d'attention que l'on en accorde à d'autres comportements, certes à juste titre, mais le déséquilibre m'étonne.
Je précise également que 6 % des filles en population générale ont été victimes de violences sexuelles et 1 % ont été victimes de viols.
M. Patrice Gélard - En population générale, ces chiffres me semblent extrêmement importants !
Mme Marie Choquet - En population PJJ, on avoisine les 40 %.
En 1993, ces résultats concernant la population générale et qui figuraient dans le rapport sont passés complètement inaperçus. On s'est jeté sur tout ce qui concernait la drogue en négligeant ces aspects-là.
M. Patrice Gélard - Ces pourcentages tiennent-ils compte du nombre d'agressions ou simplement des personnes qui en sont victimes ?
Mme Marie Choquet - Non, ce ne sont pas les actes qui sont pris en compte, c'est la personne. C'est le nombre de personnes qui ont subi au moins une fois une violence sexuelle.
M. Patrice Gélard - Le type d'habitat a-t-il une influence sur l'ensemble des comportements ?
Mme Marie Choquet - On dispose de peu de données sur ce sujet. On sait si un jeune habite en ville ou à la campagne, s'il habite ou non chez ses parents et avec qui il vit. Une fois ajustées un certain nombre de variables sociales -le fait de vivre en ville ou à la campagne est fortement déterminé par des variables sociales- on n'observe aucun lien entre les troubles et les types d'habitat.
En revanche, ainsi que nous l'a très clairement montré une enquête que nous avions effectuée auprès de jeunes prisonniers, ce qui différencie le plus la population en grande difficulté de la population dite ordinaire, c'est le fait de ne pas habiter avec ses parents. Le fait de ne pas vivre avec ses parents, qu'ils soient séparés ou non, est un des facteurs de risques le plus important. Les jeunes qui habitent chez leurs grands-parents, chez un autre membre de la famille ou qui ont été adoptés sont ceux qui sont le plus en difficulté. On ne sait pas si c'est la cause ou l'effet, car les situations sont complexes mais en tout cas on constate que la famille unie ou recomposée est globalement un facteur protecteur.
M. Patrice Gélard. Vous avez évoqué le redoublement. Actuellement, on ne peut redoubler que certaines classes. Quels effets cette réforme a-t-elle eus selon vous ?
Mme Marie Choquet - Nous tirons au sort des échantillons à partir des statistiques nationales sur l'ensemble des établissements et des classes et non en fonction des taux de redoublement. Nous avons quand même été étonnés que le taux de redoublement n'ait pas diminué. Cela signifie qu'il y a peut-être une différence entre la théorie et la pratique. Pour nous, c'est un facteur de risques très important quel que soit l'âge, surtout les redoublements multiples, qui concernent ceux qui ont redoublé au moins deux fois qui, heureusement, ne sont pas majoritaires.
Toutefois, nous nous demandons si c'est le redoublement ou le manque de préparation à ce redoublement qui est facteur de risques. Pour un jeune, les éléments de stabilité dans un monde instable sont très importants. Il change d'enseignants, d'établissement. La famille et les copains apparaissent comme deux points d'ancrage assez forts et le fait de devoir quitter sa famille ou ses copains est très perturbateur. Est-ce pour cette raison que le redoublement multiple apparaît comme un facteur de risques ?
On voit bien que les difficultés familiales sont des facteurs de risques. Mais, une fois que l'on a dit cela, on n'a pas beaucoup avancé dans l'action. Notre attitude consiste à dire : lorsque vous voyez qu'un enfant va mal, que sa famille est en difficulté, pourquoi n'essayez-vous pas d'intervenir auprès de ce jeune plutôt que de rejeter toute la responsabilité sur ses parents ? En ce qui concerne le redoublement, ne faudrait-il pas intervenir auprès des jeunes qui redoublent pour leur apporter un soutien qui apparaît à ce moment-là indispensable. Nos résultats sont souvent utilisés pour mettre en évidence les facteurs de risques mais non comme moyens d'intervention.
M. Patrice Gélard - Le redoublement est-il subi comme une sanction ? Dans les familles extrêmement mobiles, telles que les familles de militaires, retrouve-t-on des phénomènes comme ceux que vous venez de décrire ?
Mme Marie Choquet - Je ne peux rien en dire dans la mesure où je n'ai pas étudié spécifiquement les redoublements dans certains types de famille. C'est pour moi un indicateur relativement grossier mais qui mériterait certainement d'être mieux analysé.
M. le président - Madame, nous vous remercions.
Audition de M. Daniel HOEFFEL,
Premier
vice-président de l'Association des maires de France
(22 mai
2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre maintenant M. Daniel Hoeffel, premier vice-président de l'Association des maires de France.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur le vice-président, vous avez la parole.
M. Daniel Hoeffel - J'interviens aujourd'hui en lieu et place de M. Jean-Paul Delevoye pour vous présenter le point de vue de l'Association des maires de France sur les problèmes de délinquance des mineurs.
J'aborderai successivement trois sujets : premièrement, la participation des maires au fonctionnement de la justice, deuxièmement, les couvre-feux et, troisièmement, l'attitude des maires à l'égard du renforcement éventuel de leurs pouvoirs en matière de police. J'évoquerai également rapidement le point de vue de notre association sur la politique de la ville et la politique de prévention.
La participation des maires au fonctionnement de la justice s'effectue sous différentes formes : d'abord à travers les contrats locaux de sécurité où le maire est un co-signataire important, ensuite par la création des maisons de justice et du droit et enfin par la confirmation du rôle des communes dans l'offre de travaux d'intérêt général qui contribuent à la prévention en matière de délinquance des mineurs.
S'agissant des contrats locaux de sécurité, le parquet a pris des engagements consistant à participer à la réflexion et à la sensibilisation, à échanger des informations sur les procédures dans lesquelles sont mis en cause les délinquants mineurs et à développer des mesures alternatives à la prison.
L'institution de délégués du procureur ou la désignation de magistrats référents pour nouer le dialogue avec le maire -c'est un point important- s'inscrit dans cette nouvelle démarche de rapprochement entre les différents acteurs et mérite que l'on y porte une appréciation positive.
La création des maisons de justice et du droit ou des antennes de justice constitue une forme de justice caractérisée par la proximité qui, en l'occurrence, est vraiment importante, fondée sur la médiation pénale et sur la réparation.
Dans le cadre des contrats locaux de sécurité, ont été mis en place sous des appellations diverses des dispositifs où les maires, en présence du procureur ou du parquet, peuvent recourir à la médiation et convoquer les parents. C'est donc un élément qui permet la participation d'un certain nombre d'acteurs, dont les maires, à une procédure de résorption de la délinquance.
S'agissant des couvre-feux qui, lorsqu'ils ont été instaurés, ont déclenché un certain nombre de polémiques, nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir porter une appréciation définitive. Le nombre d'enfants de moins de treize ans reconduits dans le cadre de ces mesures n'est qu'un aspect secondaire de ce dispositif qui est un signal envoyé aux parents afin de les responsabiliser. Il faudra attendre l'été prochain pour voir ce que les maires qui ont eu recours à ce couvre-feu tirent de leur propre expérience et de celle de leurs collègues.
Ces mesures de couvre-feu étaient généralement assorties d'un volet prévention faisant intervenir à côté des policiers, des correspondants de nuit, par exemple. C'est l'ensemble du dispositif qui devra être examiné après l'été prochain pour que l'on puisse éventuellement en dégager des conclusions plus générales.
On peut aussi penser que les maires ayant usé de leur pouvoir de police dans ce sens ont également voulu, à travers cette mesure, envoyer un signal aux pouvoirs publics pour qu'ils modifient ou adaptent l'ordonnance de 1945. Ce pourrait être un travail intéressant à réaliser au vu des conclusions pratiques que l'on pourra en tirer.
J'en viens maintenant au renforcement des pouvoirs de police du maire.
Selon les entretiens que nous avons eus et les travaux réalisés par l'Association des maires de France, il ne nous paraît pas nécessaire de renforcer ces pouvoirs qui donnent déjà compétence aux maires pour prendre par arrêté toute décision relative à la tranquillité publique. Il s'agit plus d'un problème de moyens et de concrétisation d'un certain nombre de mesures que d'un problème de textes qu'il faudrait adapter.
Le maire doit-il disposer de pouvoirs lui permettant de s'appuyer, en dehors de la police municipale, sur les forces de la police nationale et de la gendarmerie ou même d'avoir autorité sur celles-ci, par exemple à travers une police territoriale de proximité ? Sur le terrain et dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les maires arrivent souvent à orienter l'emploi des forces de police.
A l'heure actuelle, les maires sont très partagés sur ce sujet. Certains sont partisans d'une nouvelle étape à franchir en matière de décentralisation des pouvoirs de police, d'autres au contraire considèrent que cette responsabilité relève essentiellement de l'Etat.
Enfin, je terminerai par la politique de prévention et la politique de la ville.
La politique de prévention au sein des contrats de ville est difficile à évaluer compte tenu de la diversité des actions engagées et des acteurs qui y concourent, qu'il s'agisse de l'Etat, des communes ou de leurs groupements, des conseils généraux, de la prévention spécialisée comme de la protection de l'enfance, des associations et des bailleurs sociaux.
L'Association des maires de France considère comme positives les orientations suivantes.
Premièrement, la recherche d'une cohérence et d'une complémentarité entre les actions de prévention, les actions de sécurité au sein des contrats locaux de sécurité et des conseils communaux de prévention et de délinquance est un gage d'efficacité.
Deuxièmement, la politique de la ville est désormais conduite à l'échelle de l'agglomération, c'est de plus en plus nécessaire, l'élaboration d'une politique de prévention gagne en efficacité dès lors qu'elle s'esquisse et se met en oeuvre dans un périmètre intercommunal.
Troisièmement, le développement de la médiation, au travers notamment des emplois-jeunes, est un élément important pour la réussite des projets de prévention.
Quatrièmement, la mise en oeuvre d'actions spécifiques telles que les opérations vacances ou les délégués du médiateur de la République peut être considérée comme une retombée positive.
En revanche, deux sujets méritent d'être approfondis et l'Association des maires de France réserve son opinion pour le moment.
Il s'agit d'abord du soutien aux agents et aux professionnels qui participent à la politique de prévention. Il faudrait développer leur formation et envisager l'élaboration d'un statut pour les agents locaux de médiation, les bénévoles associatifs, les correspondants de nuit et les adultes relais. Il convient de ne pas se précipiter, sous peine de provoquer des comparaisons qui pourraient nous entraîner dans un engrenage. Le problème est évoqué, il faut y réfléchir.
Il s'agit ensuite, dans le cadre du droit à l'expérimentation, du transfert aux villes sous forme de contrats, des compétences en matière d'action sociale et de prévention spécialisée.
Voilà, monsieur le président, les quelques réflexions que je pouvais faire au nom de l'Association des maires de France. Le bilan de certaines actions, comme le couvre-feu, serait prématuré. Sur d'autres plans, des questions sont posées, mais les maires de France sont décidés à assumer, dans un contexte clarifié, toutes les responsabilités leur incombant en tant qu'acteurs parmi d'autres de tout ce qui concerne la prévention en général et celle des mineurs en particulier.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Quel bilan tirez-vous des contrats locaux de sécurité ? Ont-ils eu un effet positif en matière de délinquance des mineurs ?
M. Daniel Hoeffel - Leur création est relativement récente, mais il apparaît clairement que le fait pour les différents acteurs concernés d'être liés par voie contractuelle et donc associés à une action de prévention, est un point positif.
M. le rapporteur - Du fait de l'augmentation du nombre des actes commis par des mineurs délinquants, les tribunaux sont engorgés et les réponses sont trop tardives. Or nous avons vu, notamment en Grande-Bretagne et en Hollande, des initiatives visant à sortir de la chaîne judiciaire un certain nombre de délits et à les faire traiter par la police ou des organismes locaux de type associatif. Vous semblerait-il intéressant de mettre en place dans notre pays de telles mesures avec la participation des collectivités locales, notamment en matière de médiation et de réparation ?
M. Daniel Hoeffel - La lisibilité d'une action dépend beaucoup de la brièveté des délais qui séparent l'acte de délinquance de la sanction. Tout délai qui se prolonge donne le sentiment d'une impunité et constitue un encouragement à la récidive.
Quels sont les moyens pour essayer d'y remédier ? J'ai organisé voilà six semaines dans mon département, au nom de l'Association des maires de France, un colloque où tous les acteurs : justice, police, gendarmerie, administration, collectivité étaient présents. Il existe incontestablement un problème de moyens à mettre à la disposition de la justice pour lui permettre de réduire d'une manière sensible les délais de réponse, afin d'arriver à une meilleure lisibilité de la sanction.
Toutefois, ce qui est valable en Grande-Bretagne où les mentalités et les traditions judiciaires sont différentes des nôtres peut-il être valable en France ? Je suis dubitatif. En élaborant un nouveau système, ne risque-t-on pas de créer une structure supplémentaire à côté des autres ? Je ne crois pas que l'on puisse scinder notre système judiciaire. Le temps de la mise en oeuvre et le manque de moyens seraient considérables. Or il s'agit d'un problème auquel il faut apporter des réponses pratiques dans des délais rapides.
M. le rapporteur - Les travaux d'intérêt général sont-ils souvent utilisés et les municipalités sont-elles suffisamment associées à ce type de mesure ?
M. Daniel Hoeffel - Les travaux d'intérêt général passent pour l'essentiel par les communes et les mouvements associatifs. Tout ce qui peut éviter aux jeunes délinquants de faire un stage en prison doit être favorisé. Je pense que l'on devrait davantage faire appel aux communes pour développer ces travaux d'intérêt général. Il y a du travail dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. Les travaux d'intérêt général apportent des réponses au fléau de la délinquance.
M. Simon Sutour - Vous avez évoqué les arrêtés couvre-feu, mais vous n'avez pas parlé des arrêtés anti-mendicité. J'aimerais connaître sur ce sujet le point de vue de l'Association des maires de France ou éventuellement le vôtre.
M. Daniel Hoeffel - L'Association des maires de France n'a pas pris de position officielle, par conséquent je vous ferai part de mes réflexions personnelles.
Les maires qui ont eu recours à ces arrêtés anti-mendicité, comme ceux qui ont pris les arrêtés couvre-feu, recherchent tout moyen susceptible de préserver une certaine tranquillité dans leur commune. Un arrêté anti-mendicité, s'il n'est pas assorti de moyens pratiques permettant en tout lieu de le faire respecter, n'est pas une mesure miracle. Il faudrait « enlever » les jeunes de la rue en responsabilisant les parents, mais nous savons combien c'est difficile. Les arrêtés anti-mendicité ne constituent pas une mesure susceptible d'apporter des résultats positifs. On risque de déplacer le problème d'une commune vers une autre et de transférer le fléau au voisin.
M. le président - Nous vous remercions.
Audition de Mme Dominique
FIGHIERA-CASTEUX,
Présidente de la Fédération nationale
des assesseurs près le tribunal pour enfants
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre maintenant Mme Dominique Fighiera-Casteux, présidente de la Fédération nationale des assesseurs près le tribunal pour enfants.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Madame, vous avez la parole.
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Voici quel sera le plan de mon intervention : en introduction, je vous présenterai brièvement les assesseurs ; en première partie, je vous relaterai notre expérience auprès des tribunaux pour enfants et en particulier la mienne dans les établissements scolaires ; en deuxième partie, je formulerai quelques réflexions sur l'ordonnance de 1945 et en troisième partie, j'avancerai des propositions concrètes.
Les assesseurs des tribunaux pour enfants sont des échevins, des juges civils, ce ne sont pas des magistrats professionnels. Issus de la société civile, nous sommes choisis en fonction de l'intérêt que nous portons aux questions de l'enfance et nous représentons toutes les catégories professionnelles.
Je m'appuie sur une double expérience.
D'une part, je suis assesseur depuis douze ans, j'en suis à mon troisième mandat et j'ai collaboré à une réflexion menée au sein de la fédération avec mes collègues des autres tribunaux pour enfants. D'autre part, j'ai acquis une expérience personnelle en faisant pendant trois ans des conférences sur la justice des mineurs dans des lycées et des collèges et cette année, pour la première fois, dans des écoles primaires.
Dans 80 % des cas, ce sont les mineurs eux-mêmes qui sont victimes des infractions commises par les mineurs. Ils sont donc les mieux placés pour parler de la façon dont ils vivent cette poussée de la délinquance et pour nous dire ce qu'ils attendent de nous pour les protéger.
J'en viens à l'expérience que j'ai acquise auprès des tribunaux pour enfants.
La première question est celle de la montée de la violence que l'on ne peut nier dans les affaires qui occupent aujourd'hui les tribunaux pour enfants. Les assesseurs sont de plus en plus souvent confrontés à des audiences criminelles, c'est-à-dire à des crimes commis par des jeunes de moins de seize ans.
Pendant les dix premières années de ma fonction au tribunal pour enfants de Nice, je n'ai eu connaissance d'aucune audience criminelle. Depuis deux ans, nous en avons plusieurs par an. Mes collègues des autres régions sont dans le même cas. Aussi, en juin 2001, la fédération a envoyé à ses adhérents un questionnaire sur les audiences criminelles.
Les réponses ont été les suivantes. Il faut plus de solennité pour les audiences criminelles qui ne peuvent être glissées entre deux autres audiences. Une préparation est nécessaire pour les assesseurs. Il faut peut-être envisager une réunion avec le président du tribunal pour enfants, comme cela se fait pour les jurés dans les cours d'assises.
Cependant, le constat le plus terrible est l'âge moyen des victimes : treize ans pour les viols, quatorze ans pour les meurtres. Par exemple, au tribunal de Lille, le fait incriminé était un meurtre : le mineur au moment des faits était âgé de treize ans et demi, le jugement a été prononcé à quatorze ans et demi, la victime avait treize ans.
Ces audiences sont très lourdes pour les assesseurs qui, pour la plupart, ne sont pas juristes. Je tiens pour mes collègues une permanence téléphonique hebdomadaire. La majorité des appels portent sur ce sujet car, après de telles affaires, nous avons besoin de parler pour essayer d'évacuer notre stress. A part cette fédération, nous avons très peu de contacts entre nous.
Il a été question, dans le projet de réforme de l'ordonnance de 1945, présenté en 1990, de supprimer la cour d'assises des mineurs et de renvoyer tous les crimes devant une formation spéciale du tribunal pour enfants qui serait composée de deux juges des enfants et de trois assesseurs. Si ce changement devait voir le jour, il faudrait bien entendu prévoir une réforme du statut des assesseurs.
S'agissant de ma propre expérience au tribunal pour enfants, j'ai l'habitude de consigner mes audiences dans un cahier. Le matin ou la veille de l'audience, les assesseurs sont autorisés à consulter les dossiers qui seront présentés et je prends des notes. J'ai conservé tous mes cahiers et je peux donc vous présenter concrètement une audience de janvier 1990 et une audience de janvier 2002.
En dix ans, ces audiences ont considérablement évolué. En janvier 1990, sur cinq dossiers et sept jeunes prévenus, les infractions poursuivies étaient des vols de mobylettes. La peine maximale qui avait été prononcée était deux mois avec sursis pour vol en réunion ; six jeunes prévenus n'ont plus jamais fait parler d'eux.
En janvier 2002, sur dix -huit dossiers et vingt-cinq prévenus, il y avait deux détenus. Les faits poursuivis étaient les suivants : vol avec violence, extorsion de fonds avec séquestration, agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et en réunion, violence sur éducatrice, dégradation de biens en réunion avec incendie et violence sur agent de la force publique. La peine la plus grave qui avait été prononcée était six mois fermes assortis de six mois de sursis avec mise à l'épreuve. Ces exemples parlent d'eux-mêmes. Il est trop tôt pour envisager l'avenir des vingt-cinq jeunes qui ont comparu en janvier 2002. Depuis, nous avons les CER qui permettent une rupture de trois mois avec le milieu, mais comme ces centres ne sont pas fermés, les risques de fugue persistent.
J'en viens à mon expérience auprès de ce qu'il est convenu d'appeler la « belle jeunesse ».
J'ai très vite compris que je verrai la plupart de ces élèves à la barre comme victimes et non comme auteurs de crimes : victimes de rackets dès la sixième, jolies adolescentes victimes de « tournantes ».
L'intérêt de ces contacts est de voir comment les jeunes vivent au quotidien cette justice des mineurs élaborée et appliquée par les adultes, comment ils ressentent la délinquance observée et expliquée par des adultes. Je ne donne pas une conférence magistrale, j'anime un débat à partir de l'actualité : un cas de racket dans un collège voisin, une émission de télévision. Ce sont les élèves qui orientent la discussion. Les mêmes remarques reviennent quelles que soient les classes : « Cela ne sert à rien de porter plainte. Dans le quartier, il y a des voleurs et des drogués, on les connaît mais personne ne fait rien. »
Les jeunes ne comprennent pas la sévérité en cas d'atteinte aux biens, par exemple pour les tags qu'ils trouvent beaux. En revanche, ils sont sévères quand il s'agit d'une atteinte aux personnes. La plupart d'entre eux seraient prêts à rétablir la peine de mort pour les assassinats d'enfants. Ils sont très sévères avec les mauvais parents. Ils ont peur des bandes, du racket, des vols avec violence et des viols. Les filles ne portent plus de jupes.
Dans une école primaire, une institutrice signale le comportement très violent d'un élève de CM1 dont le père est détenu et qui n'accepte pas que sa mère ait déjà un nouveau compagnon. Peut-on prévoir des mesures de prévention pour cet enfant ? Faut-il souligner, une fois de plus, l'importance des parents et de la scolarité comme premier facteur de la délinquance ?
Je vous ferai part maintenant du sentiment de mes collègues assesseurs sur l'ordonnance de 1945.
Les assesseurs sont très attachés à ce texte, il constitue d'ailleurs pour certains la première formation demandée. Contrairement à ce qui lui est reproché, il ne date pas puisqu'il a subi de nombreuses modifications, les dernières ayant été apportées par la loi du 15 juin 2000 sur l'audition du mineur.
L'assesseur n'intervient qu'au niveau du tribunal pour enfants pour les délits et les crimes commis par les moins de seize ans. A ce stade de la procédure, il peut apporter quelques remarques sur le fonctionnement des audiences : audiences surchargées qui comportent parfois vingt dossiers et plus, audiences trop féminisées avec parfois uniquement des femmes alors que nous avons affaire, la plupart du temps, à des jeunes en manque d'images paternelles, dysfonctionnement dans l'exécution des peines -les équipes de la PJJ sont débordées-, dysfonctionnement au niveau du SEAT -les rapports de personnalités arrivent parfois trop tard-, trop de jugements par défaut -de nombreux jeunes ne se présentent pas à l'audience, comment les obliger à comparaître, faut-il recourir au mandat d'amener ?-, pas assez de mesures de réparation, ni de travaux d'intérêt général, faute de postes.
Les assesseurs ont demandé l'accès au dossier d'action éducative pour avoir une meilleure connaissance du dossier pénal. Ils ne sont pas informés en retour des décisions prises. Le tribunal pour enfants est rarement saisi d'un incident en liberté surveillée ou d'une révocation du sursis.
Par ailleurs, il serait intéressant d'user plus souvent de la possibilité de demander au mineur de sortir quand l'exposé de sa vie familiale est trop éprouvant. Nous avons parfois des mineurs qui reviennent régulièrement devant le tribunal. Le jeune entend pour la dixième fois qu'il a été placé dès sa naissance, que ses parents ne se sont jamais occupés de lui ou, par exemple, que sa mère a contracté le sida en faisant le trottoir, que son père est alcoolique et bat tous ses enfants. C'est très dur pour le jeune et il est très difficile, dans ces conditions, de se construire une personnalité. Il faut demander à la défense de ne pas trop en rajouter dans ce registre pour influencer le tribunal.
J'en viens enfin à nos propositions.
Il convient de ne pas négliger l'apport de la criminologie dans l'étude de la délinquance des mineurs. Raymond Gassin, l'éminent criminologue, a distingué deux catégories de mineurs délinquants : le délinquant ordinaire et le super-délinquant ou prédateur violent qui apparaît depuis quelques années.
Pour le délinquant ordinaire, l'adolescent en crise qui attire l'attention en faisant un faux pas parce qu'il est en souffrance, l'ordonnance de 1945 est parfaitement adaptée. Elle permet de comprendre le geste qui restera dans la plupart des cas un geste isolé : 70 % des primo délinquants ne récidivent pas.
Les incivilités, à notre avis, ne doivent pas rester impunies mais on pourrait les sortir du droit pénal. Cela désengorgerait les tribunaux où les magistrats pourraient consacrer leur temps à des infractions plus graves. On pourrait imaginer des réparations civiles en faisant appel à des juges civils, pourquoi pas les assesseurs des tribunaux pour enfants ? Ils seraient placés sous l'autorité du maire, premier magistrat de la commune et au coeur même de la vie de la cité, l'essentiel étant de marquer un coup d'arrêt, de faire comprendre la faute et de susciter le respect de la victime et l'implication directe des parents. Je pense, par exemple, à des pétards dans une boîte à lettres ou à des tags sur l'hôtel de ville.
Pour les autres délits commis par ces délinquants ordinaires : le vol à l'arraché sur des personnes âgées ou le racket sur les plus jeunes, qui sont les délits les plus odieux parce qu'ils sont une preuve de lâcheté ou de bêtise, on pourrait appliquer de façon plus sévère l'ordonnance de 1945. Je fais référence à l'article 22 qui permet l'exécution immédiate de la sanction.
Il y a deux ans, au tribunal pour enfants de Nice, nous avons appliqué cet article 22 lors d'un cas de racket dans un établissement scolaire. Il fallait marquer un coup d'arrêt. Quand nous avons été sûrs d'avoir repéré les deux racketteurs qui s'étaient attaqués à un enfant de sixième, nous avons prononcé à leur encontre une peine d'emprisonnement ferme avec exécution immédiate et détention à la barre. Le parquet, les avocats, la famille ont poussé de grands cris, mais la Cour de cassation a confirmé la possibilité pour un tribunal pour enfants de prononcer l'exécution immédiate de la sanction. Le racket a instantanément cessé dans l'établissement. La notion d'exemple est importante chez les jeunes.
J'en viens aux super-délinquants ou prédateurs violents.
Les faits pris dans l'actualité ne manquent pas pour démontrer que ces mineurs présentent un réel danger pour la société et notamment pour les autres mineurs qu'il convient de protéger. Je citerai : les vols à la portière commis par des bandes organisées et toujours avec violence -à la différence des vols à l'arraché et du racket les gains sont très importants- les viols collectifs souvent accompagnés d'actes de barbarie, les trafics de drogue organisés en réseaux. Les bandes peuvent être très agressives envers les autres jeunes. Il existe également des bandes anti-institutions et nous avons même entendu parler d'une bande anti-flics.
Par ailleurs, où classer les cas psychiatriques ? Il est nécessaire d'avoir des structures alliant la médecine et la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour ces prédateurs violents, les mesures éducatives paraissent inadaptées et une réforme de quelques articles de l'ordonnance de 1945 serait possible. Par exemple, à l'article 20-2, nous proposons qu'entre seize et dix-huit ans, le mineur poursuivi pour un crime commis à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans soit condamné comme majeur et non, à titre exceptionnel, comme c'est le cas. En effet, le tribunal pour enfants et la cour d'assises ont la possibilité d'écarter l'excuse de minorité. Elle pourrait être appliquée d'office dès qu'il s'agit d'un crime commis à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans.
S'agissant de l'article 131-31 du code pénal, il est vrai que l'on pratique déjà l'interdiction de séjour pour certains mineurs, mais par l'intermédiaire du sursis avec mise à l'épreuve ou l'interdiction de fréquenter certains lieux. Nous pensons que l'application de l'interdiction de séjour, en tant que mesure complémentaire, renforcerait ces dispositions. Si le sursis avec mise à l'épreuve n'est pas respecté, il entraîne rarement la révocation de la mesure, sauf si le mineur commet une autre infraction provoquant une nouvelle parution. Par conséquent, l'application de la mesure complémentaire d'interdiction de séjour permettrait de donner plus de poids à la sanction.
En conclusion, je dirai que les assesseurs, représentants de la société civile et soumis à la pression de l'actualité, ne jugent pas le jour de l'audience un phénomène de société, une bande de prédateurs violents mais souvent un jeune seul avec son histoire. Il s'agit parfois d'une telle misère morale, physique et intellectuelle que juger devient très difficile. Heureusement, il y a la collégialité.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Comment devient-on assesseur ? Vous dispense-t-on une formation et si oui, est-elle adaptée et efficace ?
Mme Dominique Fighiera-Casteux - A l'inverse des jurés auxquels on nous assimile souvent, nous sommes volontaires. Nous présentons notre candidature au président du tribunal de grande instance de notre lieu de domicile qui transmet le dossier à la cour d'appel. Nous sommes ensuite nommés par arrêté du garde des sceaux pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Au départ, on pensait qu'il n'était pas nécessaire de donner une formation aux assesseurs. Or, depuis la multiplication des audiences criminelles, nombre de nos collègues qui n'ont pas de formation juridique en demandent une et, depuis quatre ans, grâce à la fédération et au soutien du ministère, l'Ecole nationale de la magistrature nous dispense une formation à raison d'une session par an. Cette formation se fait par région. Par exemple, dans le grand Sud, on regroupe plusieurs tribunaux et la session a lieu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
M. le rapporteur - N'êtes-vous pas tentés trop souvent de suivre les juges professionnels ?
Mme Dominique Fighiera-Casteux - S'agissant des questions de procédure, les assesseurs qui n'ont pas de connaissances juridiques sont encadrés par le magistrat présidant l'audience, mais pendant le délibéré, nous avons trois voix égales et nous pouvons donner un avis comme les jurés.
M. le rapporteur - Quelles seraient, selon vous, les mesures à prendre en priorité pour améliorer la justice des mineurs ?
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Nous constatons aujourd'hui que nous avons affaire à deux catégories de mineurs délinquants.
L'ordonnance est tout à fait adaptée en ce qui concerne les délinquants ordinaires. Même s'ils commettent un acte grave, ils sont « rééducables ». Cela ne signifie pas qu'il faut écarter toute sanction. Souvent, le jeune qui a passé un mois en détention nous dit : « J'ai compris, je ne veux plus retourner en prison ». Parfois, heureusement, des mesures éducatives, un placement, un travail d'intérêt général va lui faire comprendre qu'il doit avoir des règles de vie, comme se lever le matin.
En revanche, pour les délinquants persistants, il faudra trouver d'autres mesures, notamment pour protéger les autres. Il n'est pas normal que des jeunes filles de seize ou dix-sept ans répondent lors d'un questionnaire que leur première peur, c'est le viol. Il faut protéger ces filles et ces garçons qui ont envie de sortir, de s'amuser et qui sont terrorisés par des bandes violentes.
Il convient également de protéger nos institutions. Il n'y a pas de raison que les policiers se fassent « caillasser » et que les enseignants se fassent insulter. Nous formulons des propositions, le législateur doit prendre des mesures.
M. le rapporteur - La justice qui est rendue vous paraît-elle bien comprise par les jeunes ou bien ont-ils des difficultés à comprendre les sanctions qui sont prononcées contre eux ?
Mme Dominique Fighiera-Casteux - J'ai conservé un petit dessin qui me semble significatif. On y voit le président du tribunal demander au jeune : « Qu'as-tu à dire pour ta défense ? » et celui-ci lui répondre : « Rien, c'est bien fait ! » Quand on en est là, c'est déjà presque gagné. Le prévenu accepte la sanction, il a compris.
D'ailleurs, les jeunes comprennent très tôt, je le vois dans les établissements scolaires. J'ai été émerveillée par les questions que posent des petits de CM1. Ils comprennent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ils ont déjà la notion du bien et du mal. Quand le jeune dit : « c'est bien fait », accepte sa punition, je peux dire que la partie est gagnée. En revanche, quand on a affaire aux « prédateurs violents », je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Tout à l'heure, j'entendais M. le Vice-Président de l'association des maires parler de la prévention. Depuis 1981, on a mis en place plusieurs contrats de prévention. La prévention est adaptée aux jeunes délinquants ordinaires. Cependant, si vous proposez à une bande de jeunes qui gagne 5000 à 6000 francs par jour en pratiquant le vol à l'arraché, comme cela se fait dans le midi, d'aller jouer à la « baballe », je ne crois pas que cela soit adapté.
M. Patrice Gélard - Je connais bien votre fonction, madame, parce que ma femme a été pendant dix ans assesseur au tribunal pour enfants. Elle est désolée de ne plus l'être parce qu'elle a été élue conseiller municipal ; il est peut-être dommage de perdre ses fonctions dans ces cas-là.
Je regrette également que les hommes soient peu nombreux parmi les assesseurs. Il est fréquent que le président, les deux assesseurs, l'avocat et le procureur du tribunal pour enfants soient des femmes.
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Tout à fait !
M. Patrice Gélard - Que peut-on faire pour améliorer le recrutement masculin ? C'est pourtant une fonction magnifique, que je trouve tout à fait remarquable.
J'émets un doute sur la formation que vous souhaitez. Justement, la « naïveté » juridique des assesseurs me paraît nécessaire. Ils apportent l'élément d'équité, la procédure étant l'affaire du président. Si on les forme trop, on va en faire des juristes ; ils vont devenir des éléments professionnels. Or je ne crois pas que ce soit souhaitable.
En revanche, la création de vos associations me semble très importante. C'est en leur sein -au Havre, l'association a justement été créée par ma femme voilà deux ans- à l'occasion des congrès et des réunions périodiques que vous organisez avec les tribunaux voisins que peut se donner la formation nécessaire, plutôt que par la cour d'appel.
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Vous avez parfaitement raison. Je peux vous indiquer que l'incompatibilité électorale a été supprimée ; votre épouse peut donc à nouveau postuler.
M. Patrice Gélard - Je vais le lui annoncer ce soir, elle sera enchantée !
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Je déplore que la justice des mineurs soit bien souvent uniquement une affaire de femmes. Lorsque les fonctions de greffier, de substitut des mineurs, d'assesseur, de président et d'avocat sont occupées par des femmes, c'est déplorable parce qu'en face se trouvent ces jeunes...
M. Patrice Gélard - De un mètre quatre-vingts !
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Tout à fait ! Un jour, par hasard, deux de mes collègues assesseurs se sont trouvés dans un tribunal composé uniquement d'hommes. Ils ont remarqué une grande différence dans la tenue de l'audience. Vous le savez, tous les tribunaux pour enfants connaissent un noyau dur d'enfants qui deviennent délinquants vers 14 ans et qui sont régulièrement poursuivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Ces jeunes, se trouvant en face d'un tribunal uniquement masculin, n'ont pas eu la même attitude.
Cependant, pour ce qui est des assesseurs, la parité est respectée.
M. Patrice Gélard - Mais ils sont moins disponibles.
Mme Dominique Fighiera-Casteux - C'est le problème des assesseurs puisque ce ne sont pas des juges professionnels. Ce sont souvent les retraités ou les mères de famille qui sont disponibles. Il faut dire que les mères apportent beaucoup, elles sont d'un grand secours ; elles ont un jugement, une vue de la délinquance et de la justice des mineurs tout à fait enrichissants. Il faut aussi l'éventail le plus large possible de professionnels. Pendant un certain temps, il y avait une majorité d'enseignants, mais ils n'ont peut-être plus envie, avec la charge très lourde qui est la leur, de se retrouver devant des jeunes le mercredi quand ils sont en congé. Mais la parité est tout à fait respectée, il y a même un peu plus d'hommes.
M. Patrice Gélard - Mais pas forcément dans les formations de jugement.
Mme Dominique Fighiera-Casteux - C'est vrai ! Avant, le tribunal pour enfants tenait une audience par semaine. En ce moment, en raison des audiences supplémentaires, il est fait appel aux assesseurs disponibles, c'est-à-dire aux mères au foyer et aux retraités.
Je voudrais enfin appeler votre attention sur un sujet qui touche la délinquance des mineurs, même s'il s'agit d'une délinquance subie : je veux parler de la mendicité pratiquée avec des bébés et des enfants en bas âge, qui est particulièrement odieuse.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président - En effet !
Mme Dominique Fighiera-Casteux - Le nouveau code pénal a supprimé le délit de mendicité, la force publique se trouve donc dépourvue. En revanche, il a ajouté le délit de mise en danger d'autrui. Or on peut affirmer, des médecins pourraient le faire, que ces enfants sont en danger.
Ils sont morveux et leurs yeux coulent, signes d'allergies. Ils ne peuvent pas rester au niveau des pots d'échappement toute la journée sans conséquences. Je viens de voir un bébé sur le Boulevard Saint-Michel, il semblait mort ! Ces enfants sont drogués : vous ne connaissez pas d'enfant qui reste assis pendant trois heures sans bouger. Quand ils sont un peu plus grands, âgés de deux à trois ans, ils sont assis sur le trottoir et il peut se produire une déformation du squelette. En outre, essayez de repérer les fausses mères ! C'est toujours la même femme mais le bébé change. Tous les matins, ils sont distribués !
S'il est un domaine où le maire doit prendre un arrêté de santé publique, c'est bien celui-là, en attendant une loi.
Je vous prie de m'excuser d'avoir abordé cette question qui est un peu en dehors du sujet, mais il s'agit d'une violence inadmissible faite aux enfants.
M. le président - Vous avez très bien fait, madame, nous vous remercions.
Audition de Mme Andréanne
SACAZE,
Vice-présidente de la conférence des
bâtonniers
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, président
M. Jean-Pierre Schosteck - Nous allons à présent entendre Mme Andréanne Sacaze, vice-présidente de la conférence des bâtonniers.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Mme Andréanne Sacaze - Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame, messieurs les sénateurs, je tiens, préalablement à mon intervention, à vous remercier pour l'honneur qui est fait à la conférence des bâtonniers d'être auditionnée par votre commission d'enquête sur la délinquance des mineurs.
Les avocats en effet sont confrontés chaque jour aux deux aspects de l'insécurité et de la délinquance des mineurs, puisqu'ils assurent la défense tant des enfants victimes que des enfants délinquants, au centre du débat judiciaire d'abord, mais aussi en amont, lorsque des mesures sont prises en matière de placement ou d'assistance éducative en milieu ouvert. J'espère que nous pourrons ainsi apporter, par notre modeste contribution, quelque chose à la réflexion globale qui est la vôtre.
Le débat sur la délinquance des mineurs est trop important pour l'avenir de notre société pour être escamoté. Or nous entendons et nous lisons ça et là des statistiques, des prises de position quasi-caricaturales du style « il faut les enfermer », comme si nous étions dans l'incapacité ensemble de réfléchir sérieusement et sans oeillères sur les causes et les moyens d'y remédier.
Je ne suis pas une adepte des statistiques et je ne souhaite pas vous abreuver de chiffres dont je n'ai qu'une connaissance parcellaire et, partant, incomplète. En revanche, il me semble qu'il convient, pour traiter le problème de la délinquance juvénile, de rechercher les causes et d'examiner les moyens mis à notre disposition pour enrayer le phénomène, afin de déterminer si ces moyens sont suffisants et, à défaut, d'envisager par des idées nouvelles d'autres possibilités, d'autres outils plus adaptés aux enfants de nos jours.
Pour ce qui est des causes, la délinquance est un phénomène général de transgression de la loi et de l'ordre social. C'est un ensemble dont la délinquance des mineurs est un élément aux caractères parfois identiques, mais qui est reconnu par l'ordonnance du 2 février 1945 comme un phénomène spécifique et devant être traité comme tel.
Parallèlement, nous observons une peur croissante de la population, amplifiée par les médias qui ne cessent de mettre en exergue la « violence », mot attrape-tout, mais qui ne parlent jamais des enfants calmes et sans problème qui n'intéressent apparemment personne, alors qu'ils représentent 95 % de la population juvénile.
Cela pose à mon sens un premier devoir : celui d'informer correctement sur la réalité de la délinquance juvénile, car de la justesse des propos sur cette réalité dépendra la pertinence des réponses à y apporter. Le second devoir est d'utiliser les mots justes pour parler de cette délinquance spécifique, car le mot inadapté crée lui aussi un accroissement du sentiment de peur et d'insécurité de nos concitoyens.
A titre d'exemple, il convient de ne pas pratiquer l'amalgame entre incivilité et délinquance, groupe de jeunes et bande délinquante organisée, injure verbale et agression physique, incendie d'une ou deux voitures et émeute. Ces simples références permettent de comprendre que la violence prend des formes variées qui n'ont pas les mêmes motivations, qui nécessitent par conséquent des réponses adaptées et elles aussi variées. Par exemple, le fait de cracher dans la rue, de déambuler sur une mobylette bruyante, est-ce une incivilité ou une violence ? Selon le ressenti des victimes, le lieu, l'ethnie, le milieu social, vous ne trouverez pas la même réponse et donc pas la même définition.
En clair, il me semble indispensable, à l'avenir, de définir par des mots justes et appropriés chaque acte, afin d'éviter les amalgames et de bien différencier chacun d'entre eux, pour permettre la mesure la mieux adaptée, c'est-à-dire une réponse juste qui pourra être comprise, admise et respectée. A mon sens, c'est l'un des problèmes que rencontre aujourd'hui la justice lorsqu'elle répond à ces actes de délinquance.
Après les mots, les responsabilités ; quelles sont les causes de l'augmentation de la délinquance des jeunes adolescents ? Elles sont très larges et il ne faut pas simplifier outrageusement la réalité. Tout n'est pas lié à l'insertion économique et aux valeurs républicaines et familiales qui, effectivement, s'étiolent quelque peu.
N'étant ni sociologue ni psychologue, je me garderai d'entrer véritablement dans une analyse pour laquelle je suis incompétente. Le bon sens me conduit toutefois à constater qu'en effet les familles se désagrègent. La multiplication des divorces est une réalité, qui conduit très fréquemment à un effacement de la fonction paternelle. Le plus souvent, la mère garde l'enfant auprès d'elle, et ce dernier, pour peu que le père soit éloigné de lui, volontairement ou involontairement, n'a plus le repère de la fonction sociale du père. En effet, le chômage, le manque d'argent, le désespoir de certains parents leur font oublier l'éducation quotidienne de leurs enfants. L'instruction civique a été passée à la trappe pendant des années sans doute à tort, car une phrase de morale ou de civisme commentée chaque jour marque l'esprit d'un enfant et lui donne des bases qu'il véhiculera par la suite.
Cependant, il existe d'autres phénomènes. Je pense par exemple à une urbanisation sans âme, sans repères, sans chaleur, où l'on vit mal les uns sur les autres et, compte tenu du chômage des parents, de la démission du système scolaire parfois ou de son inadaptation, avec peu d'espoir d'en sortir. Ce manque de projets et d'espoir rend envieux, aigri et provoque à mon sens le rejet de celui qui a la chance de posséder, qui devient alors le centre de la haine et de l'agressivité.
Ne s'agit-il pas alors pour ces jeunes enfants -j'utilise sciemment ce terme parce que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier- de traduire leurs propres craintes, leurs peurs personnelles et le sentiment confus, inexprimé, de leur échec ?
L'échec scolaire, tout d'abord, car souvent les pratiques pédagogiques ne sont pas adaptées à ces enfants désocialisés et devraient être revues. L'échec familial, ensuite, face à des parents déresponsabilisés faute de réussir à gérer leurs propres difficultés. L'échec du message transmis par les pouvoirs publics qui ne parlent plus qu'en termes sécuritaires et caricaturaux, comme si nous étions paralysés dans notre réflexion pour trouver enfin les moyens de répondre à la désespérance réelle de notre jeunesse, qui a si peu d'espoir, rappelons-le, que le suicide est la première cause de mortalité des mineurs. L'échec des adultes, enfin, qui ne montrent pas l'exemple et qui sont en grande partie responsables de l'incompréhension du discours qu'ils véhiculent par rapport à leurs propres comportements.
A titre d'exemple, lorsqu'une catégorie socioprofessionnelle saccage une préfecture, enferme un directeur d'entreprise, on parle dans les médias de revendications politiques. Pourtant, c'est de la violence d'adultes caractérisée qui me paraît inadmissible. Lorsqu'il s'agit d'incendie de voiture ou de caillassage des services de police par des adolescents qui passent plus de temps dans la rue qu'à l'école, on évoque alors des comportements déviants intolérables qui doivent cesser. Comment le jeune adolescent peut-il trouver ses repères et se structurer face, là encore, à un langage et à une réponse différents selon les personnes qui sont concernées par la déviance ?
Enfin, les adultes composant notre société doivent se remettre en cause. Avons-nous apporté à nos enfants ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous ? N'existe-t-il pas une forme de démission collective, c'est-à-dire que nous avons oublié l'essentiel : apprendre à nos enfants à se respecter, à respecter autrui, les biens et la loi ? Nous sommes-nous donné les moyens durant ces décennies pour ce faire ?
J'évoquerai les moyens juridiques, tout d'abord, avec l'ordonnance du 2 février 1945, qui avait pour objectif, après la Libération, de poser les fondements de la justice pénale des mineurs. Le principe directeur était que l'enfant restait éducable et de fait était affirmée la primauté de la mesure éducative sur la peine, cette dernière devenant plus exceptionnelle. C'est pourquoi l'on exige une enquête de personnalité avant de juger un mineur.
Cette ordonnance est aujourd'hui critiquée et d'aucuns souhaitent la remettre en cause. La conférence des bâtonniers a réfléchi sur ce thème et organise le 4 juillet prochain un colloque auquel participeront des gens de terrain pour expliquer leurs difficultés et tenter de raisonner objectivement sur ce texte qui, à bien des égards, avait été remarquablement pensé et orchestré.
Car, en définitive, ce texte apporte un panel de solutions, tant du point de vue éducatif par les mesures d'AEMO, de liberté surveillée, de contrôle judiciaire, de placement en milieu ouvert, semi-fermé ou fermé, que du point de vue répressif par la diversité des peines - remise à parent, admonestation, blâme, amende, prison avec sursis, peine d'emprisonnement ferme, travail d'intérêt général. Tout y est pour permettre aux services socio-éducatifs et aux juges de procéder par étape, de suivre l'enfant dans son parcours difficile et de le sanctionner quand il dépasse les limites tolérables, c'est-à-dire lorsqu'il bouleverse de façon délibérée l'ordre social.
Malheureusement, les moyens matériels n'ont pas suivi. Les mesures éducatives sont mises en place avec un tel décalage dans le temps par manque de travailleurs sociaux qu'elles finissent par être incomprises et, partant, qu'elles n'ont plus l'impact qui leur était assigné. Les sanctions sont tellement tardives qu'un enfant peut être jugé trois ans après les faits, il est parfois même devenu majeur. Ne parlons pas de l'application des peines, qui sont mises en place, dans le cadre des sursis avec mise à l'épreuve par exemple, douze à dix-huit mois après le prononcé de la peine ! Les victimes ne comprennent pas ce décalage et se désespèrent d'obtenir réparation, ce qui conduit au refus de dépôt de plainte, considéré comme inutile.
Il existe à cet égard un problème réel d'adéquation de la réponse aux actes dans l'immédiateté, qui crée chez les jeunes un sentiment d'impunité néfaste pour leur devenir et qui amplifie la peur de nos concitoyens.
Ce n'est donc pas la réforme de l'ordonnance de 1945 qui est nécessaire ; c'est l'augmentation des moyens de sa mise en oeuvre et sans doute également la recherche d'une complémentarité dans les méthodes et d'une cohésion entre les services qui s'occupent des enfants, mais aussi le réapprentissage de la responsabilité pour les parents.
Quelques idées peuvent être signalées. M. Philippe Chaillou, président de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Paris, indiquait dans Libération , le 15 février 2002 : « Le constat que nous partageons est la massification de la délinquance des mineurs. En soi, cette massification devrait proscrire la réponse pénale actuelle qui ne participe que d'un refoulement social du problème qui ne pourra que faire retour à encore plus de violence. Cette massification doit être prise au contraire comme un symptôme majeur de nos dysfonctionnements sociaux et comme le révélateur du malaise de notre civilisation. Vouloir contre toute évidence réduire cette massification à une somme de dysfonctionnements individuels n'appelant que des réponses pénales individuelles risque de nous conduire à de sérieuses déconvenues. » Je partage pour ma part cette analyse.
S'il ne faut pas négliger la réponse individuelle, encore faut-il l'adapter. Ne pourrait-on pas envisager de scinder les actes en plusieurs catégories ? Par exemple, les phénomènes de bande, les trafics en tous genres, les crimes -je pense aux viols collectifs de mineurs par des mineurs qui sont de plus en plus fréquents dans les cités- relèveraient exclusivement, bien évidemment, du judiciaire. En revanche, les incivilités pourraient relever de l'Education nationale, de la responsabilité du département, des municipalités, avec des organismes qui auraient sensiblement les mêmes fonctions que les délégués des procureurs, qui ne sanctionnent pas mais qui rappellent avec fermeté la loi, le respect de l'autre et de ses biens.
Tous les actes antisociaux des mineurs ne méritent pas à mon sens une judiciarisation massive. Tous les actes doivent trouver une réponse, mais pas obligatoirement dans le judiciaire. Comme le précisait M. Chaillou, on a le sentiment de brasser du papier pour rien, sans véritable prise sur les gamins, tout simplement par manque de solutions concrètes.
Il est vrai que la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas les moyens matériels de ses interventions, que les institutions en amont n'ont pas plus de moyens pour mettre en oeuvre efficacement une politique éducative.
En outre, lorsque le juge se trouve confronté à un multirécidiviste, que doit-il mettre en place. La prison ? On y pense tout de suite, je ne vous ferai pas l'outrage de vous rappeler tout ce qui a pu être écrit sur les prisons, sur les quartiers de mineurs qui n'existent parfois même pas et dans quelles conditions quand ils existent ! La prison n'est donc pas la solution miracle. Elle ne doit intervenir qu'après des échecs réitérés, à défaut d'autres placements et dans les cas de délinquance extrêmement graves.
Les centres éducatifs renforcés, qui existent déjà, pourraient être une solution, à condition de ne pas se cantonner à un programme de trois à six mois. Cette durée, pour un enfant ancré dans la délinquance, me semble trop brève. En outre, l'absence de structure destinée à accueillir le mineur lorsqu'il sort de ce système m'inquiète. Là encore, ne faudrait-il pas solliciter de l'Education nationale une adaptation de ses méthodes à ces jeunes longtemps déscolarisés ?
Les centres de placement immédiat sont à mes yeux une bonne formule, car ils permettent de réagir dans l'urgence, sous le contrôle d'un juge, de dresser un audit pour préparer le programme éducatif adapté au mineur concerné, de bien préciser au mineur, car cela est important, les raisons de son placement et le cadre légal et administratif dans lequel il va évoluer pour une durée de un à trois mois, mais aussi de garantir -et c'est essentiel pour un enfant- la cohérence de la prise en charge, par référence à la décision de justice.
Mais la difficulté se présente après, là encore lors de la sortie. Quelle structure d'accueil ? Cela supposera sans doute le développement des centres d'accueil départementaux et régionaux et une cohésion me semble-t-il nécessaire par des comités de pilotage entre les juridictions, les services sociaux, la protection judiciaire de la jeunesse, les représentants des municipalités et des pouvoirs territoriaux, et ce afin de coordonner la prise en charge des mineurs.
Les discours qui sont tenus actuellement tendent à proposer la mise en place d'une comparution immédiate des mineurs, conformément à celle qui existe pour les majeurs. Les avocats sont partagés sur cette mesure. Certains pensent que les dysfonctionnements existants pour les majeurs, à savoir une défense bâclée, des victimes non informées ou n'ayant pas le temps matériel de se constituer se retrouveront de la même manière dans la justice d'urgence des mineurs. D'autres estiment que, pour les incivilités ou les délits très mineurs, tels que le vol à l'étalage dans un supermarché, la réponse immédiate pourrait être une bonne chose.
Il ne m'appartient pas de trancher, car là n'est pas mon rôle, mais il est alors une certitude : il sera nécessaire en amont de mettre en place un système pour que le dossier relatif à la personnalité de l'enfant arrive complet. Cela suppose par exemple que, dans chaque commissariat ou gendarmerie, une assistante sociale soit chargée de recevoir l'enfant avant même son audition ou après celle-ci afin d'obtenir les renseignements nécessaires et de dresser un rapport à l'attention du juge. L'efficacité serait double : d'une part, le dossier étant complet, l'enfant pourrait être jugé rapidement ; d'autre part, le juge pourrait éventuellement prendre des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert pour les autres enfants de la famille s'il ressort de l'enquête que celle-ci est en déshérence, désocialisée et partant dangereuse pour les mineurs sains qui restent encore en son sein et qu'il faut protéger.
Il faut également songer à l'enfant victime d'autres enfants. Il mérite notre attention et force est de constater que, s'il est respecté dans les mots, il ne l'est guère dans les faits. J'en veux pour preuve que l'enfant fautif va être assisté d'un avocat dès la première heure de son interpellation par les services de police ou de gendarmerie alors que l'enfant victime, lui, n'est pas assisté. Pourtant, il porte tout le poids de sa détresse et un soutien lui serait bien utile, d'autant plus qu'il est souvent confronté à l'auteur qui conteste et qu'il doit alors se positionner en victime, ce qui n'est pas une démarche spontanée de la part de l'enfant. Cette remarque vaut pour la confrontation de l'enfant victime à un auteur adulte, mais il m'apparaissait normal ici de la réitérer.
Les avocats sont donc parfaitement conscients des réalités, car ils travaillent au coeur de celles-ci. Vous l'aurez compris, ils sont hostiles à un tout sécuritaire qui irait à l'encontre du but recherché. Avant tout, ils estiment qu'il faut repenser la manière de traiter le problème sans oeillères, sans carences de langage, et admettre que durant des décennies la société dans son ensemble n'a pas su organiser sa propre défense.
S'il faut préciser le langage et augmenter les moyens, il faut aussi responsabiliser les parents, ce qui suppose un apprentissage du civisme. J'ai envie de dire avec une pointe d'humour que les médias, au lieu de faire du loft, pourraient participer à cette éducation tant l'on sait que la défaillance parentale alimente la délinquance. Il faut utiliser ensuite pleinement les moyens qui sont déjà mis en place par l'ordonnance de 1945, et retrouver une cohésion sociale, un respect de la loi pour tout ce qui donnera à la lutte contre la délinquance des mineurs toute sa légitimité.
Vous m'accorderez que c'est un vaste programme, car nous devons tous ensemble repenser nos propres comportements. Comme le dit sans ambages Malek Boutih, président de SOS racisme, il ne faut pas avoir peur de regarder en face l'ombre de l'humanité -cette ombre, c'est une violence exacerbée et insupportable dans certains cas- et ne pas tout renvoyer au social. Il est cependant dangereux de croire que les sanctions multipliées résoudront les problèmes. Il faut déculpabiliser la société face à cette délinquance, il faut aussi la rassurer sur les moyens à mettre en oeuvre.
Quels moyens complémentaires pourrions-nous vous donner, nous les avocats ? Peut-être en amont conviendrait-il de dissocier la fonction de juge de celle de protecteur de l'enfant. J'entends par-là que le juge des enfants, tout à la fois protecteur de l'enfant en danger et sanctionnateur de l'enfant déviant ne peut être partout à la fois. Au surplus, ces fonctions sollicitent une approche et un état d'esprit différents. Si ces deux fonctions étaient dissociées, chaque juge aurait plus de temps à consacrer à l'enfant lui-même et pourrait s'investir à plus long terme.
Peut-être, toujours en amont, faudrait-il instaurer des liens plus étroits entre l'Education nationale et les juges des enfants, afin de créer un dialogue fructueux sur un programme éducatif de réinsertion scolaire adapté à chaque enfant.
Il serait également souhaitable, par l'entrée de la médiation, de mieux expliquer les mesures de placement, qui sont souvent incomprises tant par les parents que par les enfants. J'y suis extrêmement favorable pour ma part, car je constate cette incompréhension sur le terrain, y compris de la part de ceux qui sont maltraités par leurs parents et qui ne comprennent pas qu'on les retire de ce milieu social qu'ils aiment malgré tout.
Au stade de la sanction, il faut bien distinguer le récidiviste du primaire et utiliser selon moi plus souvent le médiateur pénal pour les délits mineurs ou les incivilités, ce qui permet de mettre en présence l'auteur et la victime et de créer un contact en dehors de toute violence.
J'ai entendu hier sur France Info que le Gouvernement envisageait la création d'un SAVU, c'est-à-dire si j'ai bien compris d'un SAMU pour les victimes de la violence. C'est certainement une approche positive pour permettre aux victimes de s'extérioriser, de panser leurs plaies et d'être orientées juridiquement vers des solutions adaptées à leurs problèmes. Cela va supposer un investissement massif de la part de notre profession et, même si je n'ai pas eu le temps de solliciter leur avis, je reste persuadée que la conférence des bâtonniers s'emploiera à apporter son aide à ce type de mesures.
Il s'agit de multiplier les consultations dans le cadre des CDAD 9 ( * ) et des CDAJ 10 ( * ) pour, là encore, apporter un soutien logistique tant aux parents désemparés face à l'attitude de leurs enfants qu'aux victimes des agissements déviants. Les avocats se sont beaucoup investis à ce titre et continueront, soyez-en assurés, de le faire.
Nous avons, à travers tous les barreaux, mis en place des formations pour les avocats des mineurs, ce qui nous permet de répondre à la demande. Mais encore faut-il, pardonnez-moi de le dire ici, que cette fonction soit reconnue financièrement à travers l'aide juridictionnelle, ce qui n'est pas encore le cas.
En clair, la crise d'aujourd'hui, quitte à paraître optimistes, nous semble être une bonne opportunité pour réfléchir et pour modifier ou adapter nos comportements à cette situation nouvelle.
Je suis prête à répondre aux questions de votre commission.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Existe-t-il des différences dans le fait d'être avocat de mineurs ou d'adultes ? Si oui, quelles sont-elles ?
Mme Andréanne Sacaze - La réponse est « oui ».
L'enfant n'a pas le même discernement que l'adulte. Tout d'abord, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes mots avec un mineur qu'avec un majeur. Ensuite, les enfants délinquants sont souvent déscolarisés, en rupture totale avec la société, et ils ne comprennent pas le langage que nous tenons. L'approche langagière est tout à fait différente. Nous devons utiliser des mots simples, que des parents normalement constitués et éducateurs doivent tenir à l'égard de leurs propres enfants.
Nous sommes aussi la première personne qu'ils rencontrent avant la sanction. Il est important de leur expliquer qu'ils vont être responsabilisés et que, si la sanction intervient, c'est parce qu'ils ont commis une faute. Ainsi ils arrivent devant le juge avec un état d'esprit différent, ils ont une meilleure approche de la discussion qui va avoir lieu et de la sanction qui sera prononcée à leur encontre.
Nous n'essayons pas, en tant qu'avocat, de les déresponsabiliser, contrairement à ce que nous pouvons lire dans la presse. Les avocats sont parfaitement responsables et comprennent très bien qu'ils ne sont pas là pour approuver le comportement déviant d'un mineur, mais bien au contraire pour lui faire comprendre que ses fautes ne sont pas tolérables et qu'il faut qu'il accepte la sanction, qu'il accepte de rentrer dans le moule social s'il veut devenir un jour un adulte responsable.
Vous comprenez bien que nous n'avons pas ce même dialogue avec un adulte qui a déjà une expérience de la vie, avec lequel il est plus aisé d'aller à l'essentiel. Il faut tout de même que nous ayons une approche à la fois psychologique, sociologique et juridique. C'est pour cela que nous avons formé des avocats spécialement destinés aux mineurs. C'était pour nous une nécessité.
M. le rapporteur - Quelle est la part des avocats commis d'office en ce qui concerne les mineurs ?
Mme Andréanne Sacaze - Très honnêtement, je ne peux pas répondre précisément parce que je ne connais pas les statistiques. Cependant, je peux dire que, dans la majeure partie des cas, les avocats travaillent au titre de la commission d'office et de l'aide juridictionnelle. Très peu de parents demandent l'assistance d'un avocat pour leur enfant.
M. le rapporteur - Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre la délinquance et les incivilités, et que ces dernières pourraient être traitées autrement que de façon judiciaire. A quoi pensez-vous ?
Mme Andréanne Sacaze - Je pensais avoir suggéré une réponse. J'ai fait référence au délégué du procureur. Ces personnes ont souvent été policier, gendarme, donc elles connaissent la loi et ont tenté de la faire respecter du mieux qu'elles pouvaient pendant leurs fonctions. Je pense que l'on pourrait trouver, parmi les personnes civiles, au sein même des municipalités, sous le contrôle du procureur de la République, par exemple, de manière à assurer une cohérence dans l'action pénale locale et à éviter une trop grande diversification, une personne qui serait investie du pouvoir de recevoir les mineurs fautifs afin de leur faire une leçon de morale, ce que l'on appelle un rappel à la loi. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans la vie civile.
Certains maires, dont le maire d'Orléans, ont pris des dispositions pour que les mineurs traînant dans les rues fort tardivement soient renvoyés dans leurs foyers. Ce type de mesure a pu choquer. Pour ma part, j'ai approuvé la décision du Conseil d'Etat qui l'autorisait. Sous l'impulsion des maires, il y a peut-être des mesures à trouver ; des membres de la société civile, éventuellement sous le contrôle des parquets, dans le cadre par exemple des contrats locaux de sécurité, pourraient trouver une solution pour faire ce rappel à la loi.
Vous m'accorderez que le fait de taguer une maison n'est vraiment pas bien, nous sommes bien d'accord. Pour autant, cela mérite-t-il une sanction judiciaire pour un enfant qui le fait pour la première fois et qui dit d'ailleurs qu'il voulait s'amuser, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il doit peut-être lui rappeler qu'il faut respecter le bien d'autrui.
Donc des personnes civiles formées, assermentées pour ce faire, cela va de soi, pourraient être l'équivalent des délégués de procureurs hors cadre judiciaire, sous le contrôle d'une politique générale pénale afin de ne pas trop dissocier toutes les politiques municipales.
M. Jean-Jacques Hyest - Ce sont toujours des infractions pénales.
Mme Andréanne Sacaze - Nous sommes d'accord !
M. Jean-Jacques Hyest - Pour moi, les incivilités sont des infractions pénales. Il faut le rappeler parce qu'autrement le flou règne. C'est la loi qui a dit que certaines choses étaient pénalement répréhensibles, qu'il s'agisse de contraventions ou de délits.
Mme Andréanne Sacaze - Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest - Il est peut-être nécessaire de le rappeler à certains moments. Il y a aussi souvent la réparation.
M. Patrice Gélard - Et voilà !
Mme Andréanne Sacaze - Justement !
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président - Pour ce qui est du rappel à la loi et de la leçon de morale, franchement, veuillez m'excuser, mais, s'il n'y en a pas eu régulièrement comme vous le disiez, cela m'étonnerait que le fait de passer une demi-heure ou trois quarts d'heure avec quelqu'un, quel qu'il soit, ait un effet.
Mme Andréanne Sacaze - Pour les primaires, si !
M. Jean-Jacques Hyest - Je pense que la réparation est très importante. Si on a tagué, on doit nettoyer.
Mme Andréanne Sacaze - Nous sommes d'accord !
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président - Certes, pour de petites infractions -je ne dis pas « incivilités » - telles que le vol à l'étalage -quel gamin n'a pas été tenté un jour par un disque !- il n'est sans doute pas nécessaire de déclencher la bombe atomique judiciaire. Il faut peut-être trouver des sanctions et des mesures de réparation adaptées.
Mme Andréanne Sacaze - Monsieur le sénateur, un exemple nous est donné par la justice espagnole. Un article est paru dans Le Point sur un magistrat d'Andalousie qui, lorsqu'il est saisi de problèmes de cette nature, exige comme sanction la réparation. Cela me paraît être une très bonne solution.
Effectivement, quand l'enfant doit utiliser « l'huile de coude », si vous me permettez cette familiarité, pour effacer son tag, il comprend. Nous sommes bien d'accord.
Mon propos ne visait pas à les déresponsabiliser, mais à indiquer que le fait de tout judiciariser n'était peut-être pas nécessaire et qu'il convenait en revanche de trouver la solution adaptée pour la compréhension du mineur.
M. Patrice Gélard - Je voudrais faire la remarque suivante : ce n'est pas possible ! Au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, le travail forcé n'existe pas.
Mme Andréanne Sacaze - Nous sommes d'accord. Nous essayons ensemble de trouver des solutions. Je ne dis pas que notre droit, dans l'immédiat, soit adapté aux solutions éventuellement nouvelles que nous pourrions trouver. Je ne dis pas que ce que nous évoquons est possible aujourd'hui. Il est clair que cela entraînera sans doute des modifications législatives et des adaptations du droit européen.
Audition de M. Guillaume MARIGNAN,
éducateur
sportif
(22 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. le président - Nous allons à présent entendre M. Guillaume Marignan, éducateur sportif et actuellement formateur en éducation sportive.
(M. le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. le président - Monsieur Marignan, pourriez-vous commencer par un bref exposé liminaire ?
M. Guillaume Marignan - Je me présente tout d'abord : j'ai trente-cinq ans. Educateur sportif depuis une quinzaine d'années, j'ai près de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'animation, des tout petits jusqu'aux plus grands.
J'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur de la réinsertion avec le tribunal de grande instance de Créteil et de participer, entre 1995 et 1997, à des actions pilotes dans la région d'Ile-de-France. Cette activité m'a amené à intervenir également dans le domaine de la sécurité. J'ai été recruté dans un hypermarché de dix mille mètres carrés pour apporter un autre regard sur la gestion des conflits à l'intérieur de l'établissement. Après avoir rempli la fonction de conseiller de sécurité pendant deux ans, j'ai pris la responsabilité du service pendant les deux années qui ont suivi.
Ayant appris récemment par les médias qu'une commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs avait été mise en place, je me suis permis de prendre contact avec M. Patrice Gélard qui m'a indiqué que je serais convoqué. A ma connaissance, je suis donc le premier éducateur sportif à être entendu par votre commission.
M. le président - Tout à fait.
M. Guillaume Marignan - Les activités physiques en général ont fait l'objet de dérives réelles dues au développement du sport professionnel et aux médias.
Il me paraît important de préciser tout d'abord les quatre besoins fondamentaux auxquels répond l'activité physique en général : besoin d'être sollicité physiquement pour un développement sain et harmonieux, besoin de vivre des expériences motrices qui sont la base de tout développement intellectuel, besoin d'être sollicité et encouragé pour l'élaboration de l'identité et de l'image de soi et, enfin, besoin de jouer avec d'autres pour acquérir les compétences requises afin de maîtriser les problèmes relationnels.
Je rappelle également les finalités de la pratique sportive : elle doit être ouverte à tous, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir d'exclus de l'activité sportive, ni de la compétition, ni de la performance.
A cette fin, l'éducateur sportif qui intervient sur différents publics, notamment sur les plus jeunes et en particulier les mineurs, doit se fixer comme impératifs le développement des connaissances d'ordre psychomoteur, la maîtrise de l'affectivité -notamment apprendre au jeune à surmonter la peur et à savoir prendre des risques-, la conquête de la socialisation, autrement dit savoir être autonome, savoir travailler seul, savoir prendre des responsabilités et coopérer avec les autres, apprendre à être membre d'une équipe.
L'éducateur sportif doit également travailler sur les compétences d'ordre méthodologique dont le rappel est fondamental. Il s'agit d'apprendre aux enfants à classer, ranger, observer, s'adapter, analyser, coder et décoder. Dans les activités diverses, il est demandé aux enfants en permanence de comprendre les choses. L'éducateur sportif effectue un travail éducatif de fond auprès des jeunes enfants.
Enfin, il doit apprendre aux enfants à se situer dans l'espace et dans le temps.
L'éducateur sportif est appelé à travailler en permanence sur tous ces aspects. Il ne suffit pas de sortir un ballon. Les éducateurs sportifs doivent apprendre aux enfants à respecter certaines règles, notamment arriver à l'heure, ne pas venir en tenue de sport mais passer au vestiaire pour se changer. Il appartient à l'éducateur sportif de faire intégrer les règles par l'ensemble des enfants ou des adolescents.
En ce moment, nous mettons énormément l'accent sur l'esprit sportif qui réclame des qualités de courtoisie, d'intégrité, de loyauté et de respect qui se perdent aujourd'hui. Il est impératif de retrouver ces valeurs parce que j'ai le sentiment que nous allons dans le mur.
Les valeurs éducatives véhiculées par le sport reposent sur le fair play , l'accomplissement harmonieux de la personnalité, le dépassement de soi, la solidarité, l'esprit d'équipe, le don de soi, la générosité, le respect des règles établies et de l'adversaire et la maîtrise de l'agressivité et de la violence. Ces valeurs sont fondamentales.
Quand j'entends dire que l'on met en place des actions pour lutter contre la violence dans le sport, je suis ébahi, atterré. Il ne s'agit pas de lutter contre la violence. Tout simplement la violence ne doit pas exister dans le sport et si elle est présente, cela signifie qu'il y a un problème, que les éducateurs n'ont vraisemblablement pas été formés pour y mettre fin au plus vite. Il faut savoir dire non à un enfant ou à un adolescent. Le « oui...mais...on verra plus tard ... » est ingérable. Si les sanctions ne tombent pas, le problème s'aggrave.
Il me semble qu'on est allé trop loin aujourd'hui et c'est pour exprimer ce sentiment que je souhaitais rencontrer M. Gélard.
Je tiens à souligner certains éléments qui me paraissent très importants au regard du sport.
Tout d'abord, l'école ne donne pas assez de place au sport. Je rappelle l'expérience pédagogique de Vanves qui a été menée de 1950 à 1959 par le docteur Max Fourestier. Elle visait à réorganiser complètement la semaine scolaire en réservant une place accrue à l'éducation physique et à l'hygiène corporelle. Le rapport entre le temps consacré aux exercices physiques et celui dévolu aux disciplines intellectuelles était de 1 sur 1, voire de 3 sur 4, contre 1 sur 4 à l'heure actuelle. Les programmes de mathématiques et de français étaient allégés au profit d'une pratique sportive accrue.
L'expérience a donné des résultats spectaculaires. Le développement morphophysiologique des enfants a eu des conséquence sur leur état de santé. Ils n'étaient plus malades. Les grippes étaient rares. Ils gagnaient en taille et en force et se sentaient valorisés. On a constaté également une diminution de l'absentéisme. Des corps sains ont révélé des têtes très saines. Les résultats scolaires se sont améliorés. Le taux de réussite au certificat d'études était de 84 %, contre 78 % pour les élèves d'une classe témoin, alors que l'expérience touchait des enfants en relative difficulté scolaire.
Je m'étonne qu'aujourd'hui encore des élèves ont cours de 8 heures à midi, pour reprendre de 13 h 30 jusqu'à 18 h 30, avec deux heures et demie de sport par semaine. C'est terrible.
S'ajoutent à cela des conditions de pratique sportive qui dépassent l'entendement. Les élèves sont parfois dans l'impossibilité de se doucher après l'exercice physique. Ils s'essuient rapidement avec une serviette, se rhabillent et enchaînent avec deux heures de mathématiques. Ils ne sont pas en état de travailler.
Lorsque les jeunes sur le terrain me disent « J'ai encore cours, je finis à 18 h 30 », je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi l'Education nationale ne peut pas faire un effort pour essayer de mettre en place un nouveau format qui permettrait à chaque enfant et adolescent de travailler dans des activités autres que les disciplines intellectuelles. Je ne songe pas obligatoirement au sport. Ce pourrait être la musique, le théâtre, le dessin. Les domaines sont innombrables. En pratiquant les activités de leur choix, les élèves seraient motivés, tout comme les professeurs.
Un tel format mettrait en valeur les enfants et permettrait, à mon avis, de diminuer éventuellement les problèmes que connaissent actuellement certains établissements.
Ensuite, il est à noter qu'aujourd'hui, le sport est un outil qui est utilisé dans toutes les pratiques associatives de quartier. On sort toujours un ballon, que ce soit de basket, de football, etc. Mais je m'interroge sur le niveau de formation des animateurs et des titulaires des emplois-jeunes qui sont recrutés par les associations et les structures des quartiers pour encadrer le sport. Possèdent-ils réellement les compétences requises pour encadrer une activité sportive ?
Dans 85 ou 90 % des cas, la réponse est non. Ils ne sont pas formés pour cela. Ils prennent un poste d'emploi-jeune et, du jour au lendemain, ils se mettent à encadrer les activités sportives.
Parce qu'ils sont nés dans le quartier, qu'ils ont vingt et un ou vingt-deux ans, qu'il s'appellent Pierre, Paul, Jacques, Mohamed, Karim ou Neima, seraient-ils autorisés à encadrer les plus jeunes ? C'est faire fausse route que de penser cela. Non pas qu'ils n'en soient pas capables et certains le sont à l'évidence, mais il faut valider leurs capacités à travers des formations, sanctionnées par un examen. On ne peut pas continuer à les envoyer sur le terrain pour encadrer des plus jeunes sans les faire accompagner en permanence par un tuteur, sans prévoir une structure à leur écoute le soir pour leur permettre de relater le vécu de la journée et exposer les problèmes rencontrés.
Personnellement, je trouve le fonctionnement actuel malheureux. Je ne me permettrais pas de faire du théâtre parce que je n'ai pas été formé dans ce domaine. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont été formés pour encadrer des jeunes dans des activités traditionnelles se permettent d'encadrer des activités sportives. A l'université, il serait inconcevable d'autoriser un professeur de mathématiques de changer de matière et d'enseigner le droit ou inversement. En revanche, le cadre éducatif le permet et c'est dangereux à mon avis.
Je prends souvent l'image suivante : si vous cueillez sur un arbre un fruit qui n'est ni beau ni bon, le problème provient non pas du fruit mais de celui qui a planté la graine. Si après l'arrosage, les bourgeons qui apparaissent ne sont pas très beaux, les fleurs qui éclosent ne sont pas très belles, les fruits ne peuvent pas être bons, puisque les bourgeons n'étaient déjà pas beaux au départ.
De même, je n'en veux pas aux jeunes qui ne sont pas forcément compétents pour encadrer, mais à ceux qui les ont recrutés systématiquement, aux structures qui n'ont pas prévu les encadrements nécessaires pour les accompagner, à ceux qui ont décidé de mettre en place le dispositif des emplois-jeunes sans avoir à aucun moment envisagé l'implantation d'une cellule de veille pour se tenir informés de la situation sur le terrain.
Je connais de nombreux titulaires d'emplois-jeunes qui ont passé trois ans sur un site alors qu'ils n'ont toujours pas reçu la moindre formation. C'est non seulement inacceptable de la part des décideurs en la matière, mais c'est irrespectueux à l'égard des jeunes qui occupent ces emplois. En outre, on peut imaginer les conséquences de leur inexpérience sur l'encadrement des plus jeunes. Quel discours éducatif tiendront-ils ? Comment géreront-ils des situations conflictuelles ? On ne leur a pas apporté de moyens de réponse.
J'ajoute que les « animateurs éducateurs » -et je mets ce titre entre guillemets- se trouvent eux-mêmes en situation d'échec. C'est faire une grosse erreur que de penser qu'ils seront à même d'aider des plus jeunes à sortir d'une situation d'échec pour les mettre en situation de réussite.
Aujourd'hui le métier « d'animateur éducateur » subit un gros effet de mode. Chacun ici en a certainement conscience. L'animateur éducateur est dehors, en compagnie de jeunes ; il prend un café avec eux. C'est bien, mais sa fonction ne se limite pas simplement à cela. Je répète régulièrement aux jeunes qui travaillent sur les quartiers qu'ils doivent se montrer attentifs et qu'ils ont un devoir de résultat.
Je vais même plus loin. Lors de mes interventions de plus en plus fréquentes en formation sur le terrain, j'ai eu l'occasion de travailler avec des petits de cinq ou six ans en milieu rural, au Parc d'Anxtot. J'ai dû lancer un cri d'alarme, notamment en direction des parents, car leurs enfants de cinq ou six ans parlaient comme les gamins des quartiers. Il a fallu que j'en recadre deux ou trois. Recadrer des petits de cet âge laisse une impression bizarre. J'ai dû avertir les parents : « Si vous laissez votre fils continuer comme cela, dans cinq ans, ce sera ingérable pour nous. Mais ce le sera avant pour vous ». Les parents m'ont répondu : « C'est déjà ingérable. Il a tapé sur l'instituteur avant hier ». Cela peut prêter à sourire mais c'est la réalité de terrain, et ce, en milieu rural.
J'insiste sur la nécessité de la formation. Je constate que le niveau général des futurs animateurs-éducateurs, ou éducatrices, est insuffisant à l'entrée de la formation. Ils ont souvent quitté un cursus scolaire assez tôt, vers 16 ans, et s'improvisent soudain « animateurs éducateurs ». Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il y a un vrai risque.
Je m'interroge sur l'évolution des années à venir. Si le niveau des intervenants n'augmente pas, il n'y aura pas d'issue. Les mauvais fruits vont continuer à sortir chaque année sans qu'on ne fasse rien. Je demande aux jardiniers responsables de l'ensemble des arbres de faire quelque chose au plus vite. Il me paraissait important de faire part de mes inquiétudes à votre commission d'enquête.
Aujourd'hui, l'accent porte un peu trop sur la quantité au détriment de la qualité. A propos de qualité, des sanctions sont-elles prises à l'égard des structures qui ont effectué des recrutements au titre des emplois-jeunes sans avoir dispensé aucune formation à ces jeunes après trois ou quatre ans d'exercice ? Si oui, quelles sont les sanctions ? En réalité, je sais bien qu'elles sont inexistantes car aucun contrôle n'est exercé et les directions régionales et départementales du ministère de la jeunesse et des sports sont dans l'incapacité de suivre la totalité des structures qui ont créé des emplois-jeunes.
J'ai été également consterné de constater que la majorité des emplois-jeunes ont été pris par l'Education nationale et certaines institutions ou collectivités. Je ne comprends pas que de telles structures s'attribuent des emplois-jeunes qui, selon moi, ne répondent pas à cette finalité. Les moyens existent et on les a laissés dans la nature. Pourquoi les jeunes ont-ils occupé ces postes ? Tout simplement parce qu'il leur a fallu gagner 6 000 francs par mois pour vivre. Dès qu'ils ont une alternative, ils sortent du dispositif.
Au surplus, les formateurs qui ont accompli un bon travail de suivi et de tutorat éprouvent un fort sentiment de consternation lorsqu'ils voient partir de la structure des jeunes qu'ils ont formés pendant trois ans, qui commençaient à être complètement autonomes, bien intégrés, vraiment opérationnels, et à même d'apporter des résultats.Je m'inquiète pour la suite, parce que je ne sais pas où en est le dispositif emplois-jeunes. Cela me paraît un peu affolant. Les collectivités et associations qui ont des emplois-jeunes s'inquiètent pour l'avenir.
J'en viens au sport en général et au travail associatif. J'ai eu la chance d'être président de club pendant plus de dix ans et je me suis retiré simplement l'année dernière. Je me suis aperçu -et c'est toujours d'actualité- qu'un jeune a une plus grande valeur « marchande » et j'emploie à dessein ce terme fort, lorsqu'il est issu d'un quartier sensible plutôt que d'une zone incluse au grand projet de ville, GPV , ou bien lorsqu'il pratique le football plutôt que le badminton.
Il en va de même pour les associations. L'association qui se situe dans un bon quartier est susceptible de recevoir des subventions beaucoup plus élevées que celle qui est implantée dans tel autre quartier. Malheureusement trop souvent à mon goût, les subventions sont attribuées sur des critères totalement subjectifs. Je ne comprends pas cela. Toute forme de discrimination dans le milieu éducatif est à bannir. On doit y mettre un terme.
Les décideurs, qu'ils soient élus, présidents d'associations, etc. ne montrent pas l'exemple. Lors d'une réunion en mairie voilà quelques mois, j'ai dit qu'au regard des dérives actuelles, le monde des adultes d'une façon générale ne montrait pas l'exemple. Si l'on ne montre pas l'exemple aux jeunes, il est difficile d'espérer un retour « propre » de leur part. Ils s'adressent aux adultes avec agressivité, dégoût et pessimisme. En revanche, si l'on prend le soin de parler avec eux, l'on s'aperçoit qu'ils ont des envies comme tout le monde mais qu' a priori ils ne se sentent pas écoutés.
Je trouve incroyable qu'un jeune vaille plus cher qu'un autre. Pour moi, un jeune est un jeune, un habitant est un habitant. Tous sont égaux. Lorsque des dispositifs sont mis en place par l'Etat, pourquoi les collectivités locales ne prennent-elles pas le relais pour accompagner les associations et les jeunes qui se situent dans d'autres quartiers ?
Lors d'une réunion d'association, des parents se sont étonnés du fait que leur fils ne soit pas admis à participer à tel dispositif de l'association. La raison invoquée par l'association était qu'ils n'habitaient pas le bon quartier. Les parents ont alors répliqué : « Nous allons donc inviter notre fils à casser, pour que le quartier change de registre et obtienne des subventions. Est-ce cela qu'il faut faire ? » Que voulez-vous que le président d'association dise ! Le dilemme est terrible car on ne peut rien faire.
Par ailleurs, l'utilisation des subventions par les associations devrait faire l'objet d'un contrôle plus strict. J'aimerais que la notion de non-cumul qui est évoquée à propos des mandats électifs s'applique également aux subventions attribuées aux associations, parce que je peux vous assurer qu'on va très loin. Les sommes en jeu sont énormes. Il faut empêcher les dérives.
Certaines associations, vous en connaissez sûrement, sont à la limite de la gestion de fait lorsque des postes des collectivités locales sont détachés sur la structure. C'est tout à fait dangereux, surtout si le poste occupé en l'occurrence est un poste de responsabilité. Je ne sais pas où est la liberté associative, où elle commence ni où elle s'arrête. Il me paraît impératif que les élus aient connaissance du coût par jeune, par jour, par activité, pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Voici un exemple en matière d'interprétation des chiffres. Prenons l'hypothèse d'une structure de quartier qui pourrait être une association sportive. Du lundi au samedi, elle accueille vingt même jeunes qui participent à toutes les activités mises en place.
Il y a trois façons de présenter le bilan : la version la plus honnête serait d'écrire : « Vingt mêmes jeunes ont participé à toutes les activités proposées du lundi au samedi ». Cette phrase indique que les jeunes en question sont en contact régulier avec la structure et qu'un vrai travail éducatif de fond est mis en place par l'équipe pédagogique.
La deuxième version, plus brève, permet à la structure de se mettre en valeur : « On a touché 120 jeunes par semaine ». Cette présentation laisse entendre que vingt jeunes différents sont venus pendant six jours, soit un total de 120 jeunes sur une semaine. Mais ce n'est pas la réalité de terrain.
Enfin, la troisième version se lirait ainsi : « Vingt jeunes issus de cinq familles ont participé à toutes les activités proposées du lundi au samedi ». Un responsable d'association m'a confié que s'il présentait un tel bilan, l'association serait contrainte de fermer ses portes. Il existe des associations où la famille est présente au grand complet, du petit de six ans jusqu'au grand frère de quatorze ans. Mais si l'association communique ces chiffres, la collectivité s'indigne : « Nous avons monté une structure de quartier avec des subventions allouées extraordinaires et vous êtes en train de nous dire qu'on touche cinq familles sur le quartier ! ».
Si les audits recueillaient les vrais chiffres, les décisions prises seraient différentes. Les conseillers ou les agents qui sont chargés de collecter les chiffres n'ont pas l'expérience de terrain et le recul nécessaires pour être à même de faire le constat suivant : « Ce n'est pas vrai ; j'y suis tous les matins ; les gamins sont les mêmes ».
Je pense qu'il faut se montrer attentif à ces questions car le discours politique tenu aujourd'hui finit par être erroné. Les élus ne disposant pas des bons chiffres, le dispositif qu'ils mettent en place n'est pas le bon non plus. Faut-il instituer une cellule dans chaque département ? Faut-il croiser les chiffres venant de la ville, du département et de la région ? Il est impératif de faire preuve de vigilance car les sommes en jeu sont astronomiques.
Je souligne une autre réalité de terrain. Il arrive fréquemment que les membres des comités directeurs des associations se croisent. Ainsi, une espèce de chaîne se met en place à l'intérieur de laquelle chacun est solidaire de l'autre association. Le directeur rémunéré par une structure est également membre du comité directeur d'une autre structure. Lorsque de tels croisements se généralisent, ce sont les mêmes personnes qui donnent leur avis sur les attributions de subventions. Imaginez les dérives qui peuvent en résulter ! Tout cela est dangereux.
C'est pour cette raison que j'ai indiqué, dans le document que je vous remets, la phrase suivante : « Les élus doivent avoir connaissance des vrais chiffres ; il en va de l'intérêt collectif. »
Par ailleurs, on parle de tolérance zéro actuellement. On tend de plus en plus vers cela. J'y suis favorable. Lorsque je travaillais sur le terrain, je ne renonçais jamais. Je suis pour la tolérance zéro, à condition que le monde des adultes montre l'exemple : élus, forces de police, gendarmerie, magistrats, médias, etc.
Lorsque je travaillais dans le secteur de la sécurité, je constatais que le délinquant restait en liberté alors que j'estimais que son délit était tout de même assez grave pour justifier de faire quelque chose. Or, pour traiter le cas du jeune, on s'en tenait à un rappel à la loi. Ce n'était pas sérieux. Un jour je me suis rendu au tribunal où j'ai dit : « Je suis venu pour voir, parce que je ne comprends pas. J'ai des dossiers avec vingt rappels à la loi pour la même personne. Je voudrais savoir à partir de quand intervient la sanction ». J'ai suscité des réactions, mais j'ai tenu à dire que, venant du milieu éducatif, je ne pouvais pas comprendre cela.
Après cela, j'ai géré les choses à ma façon. Dans l'hypermarché de 10.000 mètres carrés dont je m'occupais, les jeunes dits difficiles ne rentraient plus dans le magasin parce que je leur en avais interdit l'accès. Je n'en avais certes pas le droit. C'était illégal, mais ils ne rentraient pas. Pour entrer, ils devaient m'en demander l'autorisation. Lorsqu'ils demandaient à me voir en m'indiquant qu'ils aimeraient bien entrer dans le magasin pour faire des courses, je répondais : « Oui, à telle condition ». Ils s'engageaient à respecter les conditions. Tout se passait bien dès lors qu'il y avait un peu d'échanges entre nous.
Pour qu'elle prenne tout son sens, la sanction ne doit pas tomber sans explication. A mon avis, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Avoir une fibre éducative et sportive facilite la compréhension de ces questions auxquelles je suis très attentif. Mais les dérives existent.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie, Monsieur Marignan, de cet exposé plein de réalisme.
M. Guillaume Marignan - J'ai essayé d'être clair.
M. le rapporteur - Vous l'avez été, en particulier sur les vertus éducatives, que nous partageons, du sport, qui est aujourd'hui une discipline mineure parce que considérée à tort comme mineure par l'Education nationale. Mais cela est un autre problème. Nous n'allons pas ouvrir le débat.
M. Guillaume Marignan - C'est une discipline mineure aussi si l'on se réfère aux moyens du ministère. Le budget n'est pas en rapport avec les besoins sociaux et il est bien inférieur à celui de ceux qui font de la musique.
M. le rapporteur - Le budget des sports de la France est l'équivalent du budget de la Haute Savoie, soit 3 milliards de francs.
M. Guillaume Marignan - Bien sûr, mais par rapport à celui de la culture, il est encore bien inférieur.
M. le rapporteur - En revanche, vous avez dit qu'il ne devrait pas y avoir de violence dans le sport. Or, force est de constater que cela existe tout de même. Il y a des phénomènes de violence, soit sur les stades soit à l'extérieur des stades. C'est le cas dans mon département. Que peut-on faire pour essayer de les réduire ?
D'autre part, un certain nombre d'intervenants dont un ce matin, ainsi que Sébastian Roché, affirment que le sport pratiqué à trop haute dose et de façon intensive, soit plus de huit heures par semaine, peut être générateur de violence. Cette remarque s'appuie-t-elle sur des statistiques ?
M. Guillaume Marignan - Il s'agit probablement de la catharsis de l'agressivité qui peut s'exprimer à travers le sport, c'est-à-dire qu'à un moment, des gens libèrent brusquement des pulsions qu'ils ont en eux.
M. le rapporteur - Je n'en connais pas les causes mais il nous a été affirmé, et M. Roché qui, en matière de délinquance fait référence, nous l'a confirmé, qu'à partir d'une dose trop élevée, le sport engendre des phénomènes d'agressivité. Est-ce lié, là encore, aux médias et à certains comportements auxquels les jeunes s'identifient ? Il est vrai que lors de certains matches, alors que l'on se trouve devant le récepteur de télévision, on a parfois envie de descendre dans l'arène.
M. Guillaume Marignan - La violence constitue le grand débat actuel.
Pour ma part, je pratique une activité qui est dérivée du football américain -en termes d'agressivité, de combativité je sais ce que c'est-, qui s'appelle le flag football. Ce sport a ceci de particulier qu'il se pratique sans contact et avec l'autoarbitrage. Les résultats de l'autoarbitrage sont probants. Malheureusement, au bout d'un moment, le jeu peut susciter une tension qui engendre des problèmes de violence parce que c'est toute notre société qui est ainsi aujourd'hui.
Parfois les images à la télévision posent problème et il vaudrait mieux cesser de la regarder. Tous les enfants et adolescents regardent les images ainsi véhiculées. Un adulte responsable est capable de faire la différence avec la réalité. Un jeune aujourd'hui n'en est pas toujours capable.
La montée en puissance de la violence s'explique aussi par l'existence d'enjeux dans certaines disciplines. Tout petits, des jeunes s'imaginent gagner plus tard 500 000 francs par mois s'ils réussissent, ce que leurs parents ne cessent de leur rappeler. Les éducateurs subissent la pression de l'exigence des résultats et il arrive un moment où des dérives se produisent. Ce n'est pas le cas partout et c'est heureux, parce que sinon on ne s'en sortirait pas.
S'agissant de la violence dans les stades imputable aux supporters, je trouve parfois surprenant que les clubs ne soient pas davantage sanctionnés. Quand on voit ce qui se passe, avec les nombreuses banderoles, je ne comprends pas qu'on ne prenne pas les sanctions qui s'imposent.
Je pense aux sanctions lourdes telles que l'interdiction d'accès au stade pour plusieurs matches. Il y a bien des solutions. Les présidents de clubs sont responsables en ce domaine. D'ailleurs, les solutions surgissent chaque fois qu'il y a une véritable prise de conscience. La Grande-Bretagne était démunie face au hooliganisme, lorsque l'Union européenne de football association, l'UEFA, a pris la lourde sanction : plus de club anglais en Coupe d'Europe. Il a bien fallu que les Anglais s'adaptent.
Aujourd'hui, si vous vous promenez le samedi ou le dimanche matin le long des stades de football, vous entendrez sur le terrain et sur le bord de la touche des choses pas bien jolies. Ce ne sont pas des exemples pour les petits qui jouent à côté. Je ne comprends pas, d'ailleurs, que dans les cas-là les capitaines d'équipe et l'arbitre n'exigent pas d'arrêter le match. Il faut qu'à un moment des décisions fortes et courageuses soient prises. Ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut savoir annuler une rencontre et dire : « On va faire un rapport à la ligue régionale de football ». C'est de cette façon qu'on trouvera des solutions.
Quand je travaillais à Paris, entre 1995 et 1997, on m'a expliqué que, lors de certains matches de football, en Seine-Saint-Denis, pour des moins de quinze ans -donc des enfants, des préadolescents- des parents de l'équipe adverse se plaçaient derrière le gardien de but et l'insultaient. En tant qu'éducateur, j'aurais arrêté la rencontre. Il m'a été répondu : « Non, ce n'est pas possible ». Moi, j'aurais arrêté la rencontre et envoyé un rapport à la ligue de football dès le lendemain. Les gars se seraient mis au garde à vous. J'emploie ces termes-là parce que si l'on ne sait pas l'arrêter, le processus devient dangereux.
Aujourd'hui, les dérives nous amènent loin, et déjà un peu trop loin pour faire machine arrière.
De plus, on dit qu'on lutte contre la violence. Je m'interroge : pourquoi dire « lutter contre » ? La violence, c'est déjà négatif. Lutter, cela veut dire qu'on se bat. N'y a-t-il pas moyen de trouver une autre expression ? Ne peut-on travailler d'une autre façon ?
Le football, par exemple, est en train de mettre en place de superbes dispositifs à ce effet.
M. le rapporteur - Prévoit-il un dispositif pour empêcher M. Tapie, pourquoi ne pas le citer, de dire à propos d'un match retour opposant Marseille à Auxerre : « Il va falloir que les gars d'Auxerre mettent des protège-tibias renforcés ». Dès lors que l'on tolère cela dans la bouche d'un responsable, ancien ministre...
M. Guillaume Marignan - Tout à fait. Ce sont, là encore, les dérives actuelles de la société, c'est-à-dire que des adultes responsables s'autorisent en permanence des dérapages de langage qui ont des effets redoutables sur les enfants.
Les petits de six ans avec lesquels je travaille emploient parfois des mots qui me contraignent à les reprendre ou à réclamer une formule de politesse. Je leur demande de ne pas employer d'argot et de faire des phrases entières avec un sujet, un verbe et un complément. J'estime que si on commence comme cela dès cet âge, cela va poser problème dans cinq ans. J'alerte alors les parents. Dans certains cas, je me rapproche de l'instituteur. Mon rôle éducatif se situe là aussi.
Plus personne n'est responsable. Imaginez que vous placiez sur un même rang formant une belle ligne l'Education nationale, la police, la gendarmerie, les collectivités, les parents, les présidents d'associations, les éducateurs sportifs, et que vous disiez : « A mon signal, vous avancez. Plus vous allez loin, plus vous estimez avoir une part de responsabilité en pourcentage dans l'éducation des enfants. » Que verriez-vous ? Aujourd'hui, quand on donne le signal, plus personne n'avance. Tout le monde se regarde et l'on découvre que personne ne se sent responsable.
Je prétends qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est notre devoir à tous. Ce n'est pas uniquement de la faute des parents. Ce ne peut pas être que de la faute de l'école. Ce serait trop facile de dire cela. Il faut revenir à des valeurs fondamentales.
Je cite un autre exemple qui sort un peu du débat. Est-ce un bel exemple de voir des agents de la police nationale, aux fenêtres baissées d'une voiture, les manches de chemise remontées, lunettes de soleil sur le nez, en plein été, en train de regarder les jeunes filles marcher en jupe ? Moi je peux vous assurer que si j'ai un contrôle de police de ce genre à trois heures du matin, je me rends immédiatement chez l'officier de permanence. Il est hors de question que je l'accepte !
J'ai été confronté à des incidents lorsque je travaillais dans le domaine de la sécurité. Certains de mes agents ont été insultés par les forces de police. Je peux vous assurer qu'on est allé loin.
De même, j'ai eu un problème qui n'avait rien à voir avec les enfants, mais qui était lié à des comportements et des attitudes. Nous devons être exemplaires à cet égard. Le problème concernait des gens du voyage qui se trouvaient sur un parking. J'ai alors demandé une intervention de la police. Les policiers sont arrivés avec un véhicule banalisé. L'un d'entre eux est sorti en survêtement, à peine habillé ; un autre n'était pas en tenue ; quant au troisième, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Evidemment, le contrôle n'a pas eu lieu. A mon retour, j'ai appelé un des lieutenants au téléphone et je lui ai demandé s'il s'agissait des forces de police ou d'une bande de troubadours égarés dans une voiture de service. Il m'a répondu que le problème serait réglé. Une heure après, il m'appelait pour me dire : « Monsieur Marignan, c'est la première et la dernière fois que ce type d'incident arrive ».
Ces comportements ôtent de la crédibilité. Pour les éducateurs, c'est la même chose. Par rapport aux enfants, les éducateurs sont des référents. Ils doivent faire attention et montrer l'exemple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur certains quartiers avec des jeunes dits du quartier peut poser un problème. Quelle image les jeunes peuvent-ils avoir de ces grands frères lorsqu'ils savent ce qu'ils ont fait au même âge qu'eux, pendant dix ou quinze ans ?
Aujourd'hui, nous avons un problème de formation. Les gens qui encadrent les futurs éducateurs devraient commencer par travailler sur le terrain. Or, ils sont dans des bureaux à écrire des rapports ou à organiser des réunions où l'on perd son temps. Ils ont souvent fait mai 68, ils ont apporté beaucoup de choses à cette époque, mais aujourd'hui, ils forment des personnes pour travailler dans les quartiers, alors qu'ils ne connaissent pas les jeunes qui y vivent. C'est dangereux.
J'interviens dans des formations avec des animateurs de la ville. Souvent, ils arrivent en retard et ne s'excusent même pas.
Il faut retrouver des valeurs simples, comme le respect mutuel et l'échange. Le sport est à mon sens capable de véhiculer ces valeurs, malgré les dérives que l'on observe avec la télévision et l'argent.
Les valeurs éducatives se perdent, les éducateurs avec lesquels je travaille sont démobilisés. Quand nous proposons un projet, il n'est jamais retenu, alors que, s'il vient d'en haut, il faut à tout prix le faire aboutir. Par ailleurs, on nous impose des résultats sur la quantité et non plus sur la qualité.
S'il vous plaît, Mesdames, Messieurs, soyez à l'écoute et confiez les responsabilités aux gens qui ont travaillé sur le terrain et qui connaissent les réalités. En matière d'éducation, c'est sur le long terme que l'on obtient des résultats, ce n'est pas en deux mois. Quand vous travaillez avec un jeune délinquant de seize ans, vous êtes avec lui tous les jours pendant six heures.
J'ai parlé de ces problèmes avec un responsables d'académie qui m'a dit : « Prenez des aides éducateurs . » Je lui ai répondu : « Ont-ils été formés pour cela ? »
Il ne fallait pas leur donner ce nom d' « aide éducateur » car, dans 75 % des cas, ils finissent surveillants. A un moment donné, pour résoudre le problème du chômage, on a mis en place le dispositif des emplois-jeunes, mais il faut être vigilant, certains sont capables de faire du bon travail, ont des compétences, d'autres non. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne prends pas d'emplois-jeunes dans mon association. Je leur réponds que le seul tuteur personnel, c'est moi, et que je ne suis pas disponible pour les encadrer.
M. le président - Nous vous remercions.
Audition de M. Philippe JEAMMET, professeur de
pédopsychiatrie
et chef du service de psychiatrie de l'adolescent et
du jeune adulte
à l'Institut mutualiste Montsouris
(29 mai
2002)
Présidence de M. Bernard PLAISAIT, Vice-président
M. Bernard Plaisait, président - Nous allons entendre M. Philippe Jeammet, professeur de pédopsychiatrie et chef du service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris. Il est également responsable du deuxième intersecteur infanto-juvénile de Paris.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. Jeammet, vous avez la parole.
M. Philippe Jeammet - La délinquance des jeunes me préoccupe depuis longtemps. Je dirige ce qui a été le premier service de psychiatrie d'adolescents. Il a été créé par mon prédécesseur et maître, le professeur Flavigny qui s'est beaucoup impliqué dans le milieu ouvert.
Le thème n'est pas nouveau puisque la terminologie utilisée dans les années soixante était pratiquement la même que la nôtre.
Par rapport à la délinquance juvénile, mon point de vue est individuel : c'est celui d'un psychiatre qui s'efforce de comprendre le fonctionnement psychique de ces jeunes et ce qui en découle sur le plan de la réponse thérapeutique ou éducative.
Comportement antisocial, la délinquance est une notion assez relative dont la perception varie selon les sociétés. Cet aspect relève plutôt de la sociologie.
C'est vrai que la délinquance n'a pas de définition en psychiatrie. Ces jeunes qui souffrent de troubles du comportement vont plus ou moins rentrer dans certaines catégories psychiatriques dont la plus classique est celle de psychopathe. Fondée au début du siècle par Kurt Schneider, elle traduit le fait que ces jeunes gens particulièrement impulsifs ont des difficultés à se contrôler. Non seulement ils ont la capacité de s'attaquer aux biens et aux personnes, mais ils ont également la capacité de retourner leur agressivité contre eux-mêmes. La fréquence des automutilations et des comportements suicidaires, notamment quand on limite leur agressivité à l'égard des autres, avait déjà été notée.
Cette notion - qui demeure - ne nous est pas tellement utile à l'heure actuelle. En effet, la délinquance telle que nous la voyons de nos jours recouvre une gamme de comportements extrêmement divers reposant sur des personnalités elles-mêmes extrêmement diverses avec un continuum entre le normal et le pathologique. Cela pose évidemment beaucoup de problèmes : on préfèrerait une frontière nette mais ce n'est pas possible dans ce domaine.
Il y a une continuité avec des extrêmes. Nous sommes en présence de sujets dont le côté pathologique apparaît clairement. Que signifie pour nous le côté pathologique ? Il s'agit de personnes enfermées dans un comportement dont elles ont plus ou moins conscience - même si elles ne se l'avouent pas - qu'il n'est pas normal, en tout cas qu'il les met en difficulté. Ce comportement, elles sont contraintes de le répéter avec une possibilité de choix assez limitée. Moins le choix est important, plus la contrainte à répéter le comportement est lourde et plus on est dans l'ordre de la pathologie.
Parmi ces contraintes interviennent des facteurs d'ordre biologique avec des spécificités génétiques qui provoquent chez certains sujets des tendances impulsives ou agressives naturellement plus marquées que chez d'autres. Quel que soit le poids de ces gènes, leur expressivité - il faut le savoir - sera naturellement conditionnée par la réponse de l'environnement. Ce qui définit la pathologie, c'est donc la contrainte à la répétition.
Nous sommes en présence de toute une gamme de comportements. La notion de psychopathe est presque un diagnostic a posteriori . On dit de quelqu'un qu'il est psychopathe quand il est enfermé depuis déjà un certain nombre d'années dans les attitudes délictueuses et impulsives.
A côté de ces comportements, un certain nombre de sujets sont capables de répondre par la violence à toute contrariété, à toute frustration, ce qui pose un problème de limite avec la psychose, ces troubles assez graves de relation avec la réalité souvent conditionnés par les spécificités biologiques de la dimension génétique.
Il y a indéniablement des jeunes qui n'ont pas suivi ce parcours classique du psychopathe et qui sont quand même contraints, en présence d'une émotion importante, d'y répondre par un passage à l'acte. Il semble qu'il leur soit impossible d'élaborer leur émotion autrement que par une décharge d'ordre moteur et souvent agressive, à tel point qu'il y a lieu de s'interroger - avec toute la prudence qui s'impose - sur l'utilisation de certains psychotropes, notamment des neuroleptiques chez des sujets mineurs de douze ou treize ans. Nous disposons maintenant de psychotropes beaucoup plus efficaces dont les effets secondaires sont moindres pour des jeunes qui sont en train de se fracasser contre le mur des adultes... qu'ils endommagent au passage tout en s'endommageant eux-mêmes grandement. On ne peut pas les contenir s'ils n'ont pas le moyen de remédier à cette force qui les dépasse et peut hypothéquer leur avenir en se traduisant par des comportements délictueux. Cela concerne seulement une minorité.
Il existe toute une gamme de comportements dont les formes les plus graves posent la question d'une sorte d'équivalent psychotique quasi-hallucinatoire : quand l'halluciné entend une voix et ne peut pas se contrôler, on sait que cela correspond à des troubles d'ordre psychotique.
Ces sujets, qui rentrent dans des comportements délinquants recouvrant tout un spectre de psychopathologies, de la psychopathie, voire la psychose jusqu'à la normalité, présentent un certain nombre de caractéristiques qu'il me paraît important de prendre en compte. Tous ont une incapacité d'attendre qui est fondamentale. En effet, sans attente, il est impossible d'avoir un minimum de liberté de choix et d'apporter une réponse adaptée à la situation.
Cette capacité d'attendre repose avant tout sur la confiance de l'enfant dans son environnement. Un enfant commence à attendre dès les deux premières années de sa vie. Or, ce qui lui permet d'attendre, c'est la fiabilité de son entourage. Quand l'enfant perçoit un signe avant-coureur répondant à sa demande d'être nourri, son esprit se calme. L'expérience ne fera que renforcer cette perception. Il se crée alors le sentiment très profond d'une adéquation entre ses besoins et la réponse de son environnement, adéquation qui lui procure une sorte de tranquillité et de confiance.
D'autres au contraire, soit pour des raisons de tempérament plus réactif, soit pour des raisons d'interaction, ont le sentiment que leur environnement est imprévisible, donc générateur d'insécurité. Sentant son impuissance à provoquer une réponse adéquate de son environnement, l'enfant va devenir particulièrement attentif à ce dernier. Cette dépendance - à des degrés divers, certes - à l'égard de l'environnement va notamment se refléter dans des réactions face aux situations de séparation. Or, les délinquants, on le sait, tolèrent très mal les séparations.
Le moment du coucher illustre la façon dont l'enfant réagit à la séparation. Certains trouvent en eux les ressources intérieures pour remplacer l'entourage, par exemple en rêvant ou en suçant leur pouce. Cette potentialité est nourrie par la qualité de la relation avec l'environnement qui a sécurisé l'enfant. L'éducateur ou le parent qui a réussi est celui dont on n'a plus besoin : il n'est pas nécessaire de s'agripper à lui.
A l'inverse, plus on est dépendant de cet environnement, plus on va avoir besoin de le contrôler en miroir. Malheureusement, les êtres humains ne contrôlent pas les autres par le plaisir partagé, lequel conduit au bout d'un moment à la séparation. Le contrôle s'effectue par l'insatisfaction dont les grandes modalités sont les plaintes corporelles et les caprices, qui deviendront progressivement des conduites d'opposition. Apeuré par le départ de sa mère, l'enfant va se plaindre ou faire des caprices pour l'obliger à s'occuper de lui. En même temps, il échappe aux autres puisque, quoi qu'on fasse, cela ne va jamais.
Les délinquants sont, toutes proportions gardées, dans des situations comparables à celles de ces enfants : relative insécurité intérieure et extrême dépendance à leur environnement. Ils n'ont confiance ni en eux, ni dans les autres. Cela se voit à la façon dont ils accusent les autres de leur propre comportement : si je réagis ainsi, c'est la faute d'un tel ! Ils apparaissent comme des marionnettes auxquelles il suffit de ne pas dire bonjour pour déclencher tel ou tel comportement. Cette extrême dépendance à l'environnement est le signe paradoxal d'une grande vulnérabilité intérieure. Contenus, ces caïds se montrent volontiers apeurés, phobiques et commettent de fréquentes tentatives de suicide.
Toute cette problématique est importante, sauf à se tromper sur la force de ces sujets. Ils font peur pour ne pas avoir peur. Craignant d'être jugés par les autres, ils font en sorte de provoquer leur réaction.
Prenons l'exemple très révélateur de ces jeunes qui ont un rat sur l'épaule. Ce rat, ils l'ont apprivoisé, ils l'ont nourri depuis toujours. Si le malheureux animal se retrouvait face à ses congénères, il n'aurait pas la moindre chance de survie ! Eh bien, la vulnérabilité de ce rat qui fait pourtant peur aux passants est un bon reflet de la vulnérabilité de ces jeunes.
C'est cette vulnérabilité qui les rend particulièrement dangereux par rapport à toute mesure d'approche. Ils sont pris dans un dilemme : si on ne les regarde pas, ils se sentent méprisés et abandonnés. Et si on commence à s'occuper d'eux, ils se sentent épiés, colonisés, envahis sans se rendre compte que c'est parce qu'ils sont très en attente des autres qu'on leur « prend la tête ». Ils ne vont pas supporter la moindre infidélité de la part de ceux dont ils se sentent affectivement dépendants. Le seul fait d'avoir besoin d'eux est ressenti comme un signe d'aliénation. Cette problématique de l'aliénation, fondamentale chez ces sujets, va se traduire par des manifestations diverses selon les cas.
La conséquence, c'est que ces sujets, qui n'ont pas d'image très nette d'eux-mêmes, vont être hypersensibles à l'image qu'on va leur renvoyer d'eux. C'est la raison pour laquelle il faut bien différencier la répression, la punition, la sanction et l'humiliation. Ces jeunes sont des exemples particulièrement pertinents pour mesurer les effets du faux débat entre la compréhension - sous-entendu le laisser-faire - et l'autorité. Il importe de se souvenir que ces jeunes ne pourront se construire eux-mêmes que si on leur pose des limites. Il y a toute une éducation à la limite.
Poser des limites en présence d'un comportement inadéquat, c'est très différent de l'attitude qui consiste à profiter de l'occasion pour porter un jugement de valeur sur une personne. Il est important de faire comprendre à celle-ci qu'elle ne se réduit pas à ce comportement et qu'elle peut en adopter un autre. Si la limite fixée peut être frustrante sur le moment, elle ne laisse pas de trace. En revanche, le jugement porté sur la personne crée une haine et une blessure qui sont difficiles à surmonter.
Cette vulnérabilité à l'environnement, cette épaisseur intérieure n'ont rien à voir avec l'intelligence. L'insécurité intérieure de ces personnes ne leur laisse pas le temps d'utiliser leurs facultés intellectuelles pour réfléchir à la situation. Dans ces conditions, la mesure éducative va privilégier la compréhension par l'environnement de la personnalité de ces sujets.
Il appartiendra aux éducateurs de pratiquer toute une stratégie de la limite qui est préférable à celle de la punition mais qui passe néanmoins par la punition. Il va leur falloir s'intéresser à la personnalité sous-jacente, c'est-à-dire trouver les moyens de valoriser les compétences et les atouts pour redonner à chacun la possibilité de se développer dans un rôle actif.
Pour poser ces limites, il importe d'être toujours complémentaires, d'être plusieurs à s'occuper de ces sujets pour éviter une relation duelle. Quand une mère est enferrée face à la série de caprices de son enfant, ce qui peut la sauver, c'est l'arrivée d'un tiers qui calme la situation, car il n'est pas dans la même situation de dépendance affective.
Les êtres humains qui se sentent très dépendants d'une personne ont du mal à apporter la démonstration de ce qu'ils ont reçu d'elle. C'est l'exemple bien connu des enfants qui font preuve à l'extérieur du savoir-vivre qu'ils feignent d'ignorer au sein de leur propre famille. Il nous faut repenser à cette question des tiers car ces jeunes, qui ont certes besoin d'un entourage familial, ont aussi besoin d'une distance par rapport à une trop grande dépendance affective.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait bon de revaloriser la séparation. Bien préparée, elle serait ressentie non comme une sanction mais comme un moyen permettant au sujet de s'approprier son apprentissage, sa réussite, alors qu'exposé au regard parental, il se sent tenu de répondre à son exigence.
Pour sortir de cette trop grande imbrication entre parents et adolescents, je me suis prononcé depuis quelques années en faveur de la réouverture des internats. Bien conçus, ils peuvent être un garde-fou contre certains dérapages. J'en ai vraiment l'exemple.
Je souligne donc à la fois l'importance du facteur de la vulnérabilité et la nécessité de savoir utiliser avant qu'il ne soit trop tard un milieu différencié dans lequel plusieurs acteurs interviennent.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous avez bien démontré la rapidité du passage de l'émotion à l'acte chez ces jeunes. Vous avez souligné le rôle du facteur génétique et la grande vulnérabilité par rapport à l'environnement.
Ces jeunes ne sont-ils pas aussi dépendants d'autres éléments tels que la drogue ou l'alcool ? Considérez-vous qu'il s'agit d'éléments aggravants ?
M. Philippe Jeammet - Bien sûr qu'ils vont l'être ! Ce sont souvent ces sujets dépendants de leur environnement qui vont être des candidats privilégiés pour passer d'une dépendance - en l'occurrence une dépendance affective - à une autre.
Tous ces sujets ont fréquemment la phobie des émotions. Aux émotions, ils vont substituer des recherches de sensation. Alors que l'émotion vous submerge de l'intérieur, la sensation donne l'impression d'exister, de communiquer avec l'extérieur tout en se contrôlant. Or ceux qui sont dans l'insécurité ont une peur panique de l'émotion qu'ils vivent comme une sorte de reddition aux autres.
Cette sensation, ils vont la rechercher de façon privilégiée dans les conduites à risques avec la recherche des effets psychotropes que provoquent les drogues. Bien sûr, les réactions vont être extrêmement différentes selon les individus qui n'ont pas les mêmes facultés de dégradation. Il y a un lien très direct entre la dépendance à l'environnement, l'insécurité intérieure et le recours à ce qu'on pense maîtriser - la drogue - alors qu'on va tomber sous son emprise.
M. le rapporteur - D'après votre expérience, y a-t-il plus de jeunes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques que par le passé ?
M. Philippe Jeammet - Rien ne permet de le dire et cela me paraît très peu vraisemblable. J'aurais même plutôt une vision contraire. Cette génération est beaucoup plus épanouie que les précédentes. Le poids de l'inhibition à tous les niveaux, ajouté à une sorte d'écrasement des capacités à communiquer du fait du travail précoce - sans parler des guerres - a laminé les générations antérieures.
Je ne crois pas que les jeunes souffrent plus - on voit moins d'inhibition - mais leur moyen d'exprimer leur mal-être a changé avec l'évolution de la société. Ils sont en quelque sorte le miroir grossissant de notre comportement. C'est non la réalité du malaise, mais sa forme d'expression qui a changé.
La sécurité intérieure donne une sorte de filtre qui permet de supporter les autres. Face à un regard dérangeant, par exemple, on en imagine un autre qui, lui, sera bienveillant.
Le manque de sécurité intérieure des sujets les plus fragiles va les rendre beaucoup plus sensibles à ce que leur renvoie l'environnement. Ils seront des révélateurs extrêmement sensibles de l'évolution de la société. C'est ainsi que l'irrespect est devenu un mode d'expression des jeunes, qui est amplifié par le poids de l'image.
Ces jeunes, fragiles, tolèrent très mal le flottement ou la dépression des adultes, qui les renvoie à leur propre vulnérabilité. Cette angoisse provoque en général une flambée plutôt qu'un apitoiement.
M. le rapporteur - On nous a beaucoup dit que la France manquait de structures d'accueil pour ces jeunes au point de devoir parfois les envoyer en Belgique. Qu'en pensez-vous ?
M. Philippe Jeammet - Les structures d'accueil belges auxquelles vous faites allusion concernent des troubles psychologiques bien particuliers, des psychoses infantiles pour lesquelles nous manquons en effet de structures.
Pour les jeunes difficiles, nous avons la chance d'avoir en France un tissu social et associatif très fort par rapport à d'autres pays. La gamme de structures est extrêmement étoffée et diversifiée. Ce qui est difficile, c'est l'organisation.
On m'a confié en Ile-de-France la responsabilité d'une structure expérimentale qui est mixte, santé-justice. Il s'agit surtout de travailler avec l'encadrement de ces jeunes pour les aider à sortir d'une situation d'impasse.
L'une des tâches de ces cinq dernières années a été de rassembler l'ensemble des structures consacrées à ces jeunes en Ile-de-France. Pas un ministère n'en a la responsabilité !
Nous avons recensé sur un CD-rom la totalité des structures qui existent en Ile-de-France. Elles sont au nombre de vingt-neuf, qui vont du sport à la santé en passant par la justice. Eh bien, il n'y a pas moyen de regrouper l'ensemble ! Il arrive - nous l'avons appris - qu'une commune cherche une structure à l'autre bout du département faute de savoir qu'il en existe une semblable à côté.
Nous avons la chance de disposer en France d'une multitude de structures. Cette chance, n'allons pas la gâcher par une conception étroite de la régionalisation. Des jeunes de la région parisienne ont besoin d'être accueillis dans des structures avec des équipes compétentes à une distance raisonnable de leur domicile, ce qui ne signifie pas l'exil ! Pour changer de région, il nous a fallu rompre des agréments. On a dû fermer certaines structures qui n'avaient pas un taux de remplissage correct à l'échelon local.
Or il faut faire attention. Il y a un savoir-faire. On ne s'improvise pas du jour au lendemain éducateur en milieu fermé, sauf à s'exposer à de lourdes déceptions. Pour éviter l'affrontement direct, l'internat exige des personnalités charismatiques.
Les structures existent. Encore faut-il les mettre en liaison et insister sur la nécessité de coopération pour préserver ce capital. Après, on verra où sont les lacunes.
J'incite à jouer énormément la carte de cette prévention secondaire. Je ne mésestime pas les difficultés. Les structures ne sont pas organisées de façon très adaptée. Ces sujets vulnérables et dépendants de leur image sont exposés à la tentation d'être grands dans l'échec à défaut de l'être dans la réussite. Quand ils sentent qu'ils ont déçu, ils s'emballent dans un processus destructeur. Si on n'est pas sûr de réussir, on peut toujours être sûr d'échouer. L'exemple du bac est à cet égard révélateur. Au moment de l'adolescence, le fait de pouvoir dire non procure un soulagement immédiat.
Il y a donc toute une action préventive à conduire avant que l'image soit trop détériorée, avant que le jeune soit trop marginalisé, notamment dans sa scolarité. Il faut un autre regard. Il faut que quelqu'un se sente responsable de ces jeunes qu'on expulse vite de l'école et dont les parents sont débordés.
M. Laurent Béteille - Ces jeunes sont-ils accessibles à une sanction ? Ont-ils le même rapport à la sanction que les adultes ?
M. Philippe Jeammet - Je ne connais personne qui ne soit pas sensible à la sanction. Ils sont hypersensibles à la sanction parce que, très vite, elle prend un caractère vexatoire. Ils la ressentent quasiment comme une atteinte à leur intégrité, à leur territoire. Ce décalage entre l'intentionnalité de l'adulte et le vécu de l'adolescent peut être dramatique. Pour être compréhensible, la sanction doit intervenir en référence à une loi qui s'applique à tout le monde, tout en étant explicitée et mise en oeuvre de façon personnalisée.
La plupart de ces jeunes n'ont pas confiance en eux car ils ont vécu dans des milieux non fiables qui les ont laissés tomber après les avoir adorés. L'illusion de contact, suivie d'une déception, est désastreuse pour l'enfant. Il vivra la sanction comme une nouvelle illustration des caprices des adultes. Il aura beaucoup de mal à comprendre que la sanction ne le vise pas, lui.
Il y a toute une pédagogie de la sanction. En réponse à votre question, pour être sensibles à la sanction, ils sont hypersensibles ! On peut sanctionner fermement sans humilier. Comme dans les films de cow-boys, les jeunes ont besoin d'une relation personnalisée. La sanction peut être prononcée par un juge mais il faut qu'à un moment donné, l'éducateur fasse un travail pédagogique.
M. le président - Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
Audition de M. Denis ROBERT-CHARRERAU,
Procureur
près le tribunal de grande instance d'Annecy
(29 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous accueillons maintenant M. Denis Robert-Charrerau, procureur près le tribunal de grande instance d'Annecy.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Monsieur Robert-Charrerau, vous avez la parole.
M. Denis Robert-Charrerau - En préambule, je voudrais évoquer deux idées concernant la délinquance des mineurs qui me paraissent aussi largement erronées qu'elles sont largement répandues. En illustration à mon propos, je citerai quelques chiffres très limités empruntés au département de la Haute-Savoie.
On entend souvent dire qu'en matière de délinquance des mineurs, le taux de récidive est considérable. En 2001, le commissariat d'Annecy a interpellé 314 mineurs ; 286 l'ont été une seule fois et 28 à plusieurs reprises. Sur ces 28, 18 ont été interpellés à deux reprises, 3 à trois reprises, 4 à quatre reprises, 2 à six reprises et le dernier à sept reprises. Il convient donc de moduler l'idée selon laquelle se sont toujours les mêmes mineurs délinquants qui sont interpellés. On a tendance à ne retenir que les échecs et à oublier les réussites.
En outre, il est souvent fait état de l'impunité judiciaire. Après interpellation, tous les mineurs délinquants seraient remis en liberté sans suite judiciaire.
Le département de la Haute-Savoie, qui compte 640 000 habitants, me paraît assez proche de la moyenne nationale sur le plan statistique. La délinquance des mineurs y atteint 19,5 %, contre 21 % au niveau national. En l'an 2000, 1 268 mineurs ont été interpellés en Haute-Savoie. Sur ce chiffre, 786 ont été jugés, soit par le tribunal pour enfants, soit par le juge pour enfants ; 276 ont été convoqués devant le délégué du procureur et seulement 202 n'ont pas connu de suite judiciaire. Encore faut-il préciser que sur ces 202 mineurs interpellés, il est apparu qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas commis d'infraction. L'idée de l'impunité judiciaire est donc à tempérer.
La véritable impunité réside dans le fait que seulement 20 % des affaires sont solutionnées. L'institution judiciaire au nom de laquelle je m'exprime ne peut donc agir que sur celles-la. C'est une vraie faiblesse de notre société à laquelle il importe de remédier.
Je voudrais maintenant développer certaines idées concernant, d'une part, la procédure pénale applicable aux mineurs et, d'autre part, les foyers et l'incarcération.
Il a été mis en place dans l'institution judiciaire, au fil des années, une procédure rapide pour juger les majeurs que l'on appelle le traitement en temps réel, de telle sorte que les majeurs soient jugés dans un délai relativement court allant de deux à trois mois dans bien des tribunaux.
En revanche, en matière de mineurs, les délais sont beaucoup plus longs, et cela mérite, à mon sens, réflexion et modification.
Il faut bien comprendre que lorsqu'un mineur est interpellé trois possibilités existent pour le faire sanctionner. Il s'agit, premièrement, du tribunal pour enfants, composé d'un juge et de deux assesseurs, deuxièmement, du juge des enfants, qui statue en chambre du conseil, et, enfin, du délégué du procureur, formule relativement récente qui a été mise en place dans la quasi-totalité des tribunaux.
Le tribunal pour enfants est réservé aux affaires importantes, le juge des enfants connaît d'affaires moins importantes ; quant au délégué du procureur, il est délégué pour les petites affaires.
Or, autant pour le délégué du procureur il s'agit d'une procédure simple, rapide avec des délais courts puisque la personne est convoquée dans les deux mois, autant - et c'est un peu paradoxal - pour les affaires les plus graves qui ressortissent au tribunal pour enfants, la procédure est beaucoup plus longue, ce qui sans doute correspond à des nécessité de procédure.
Je crois, pour ma part, qu'il faut envisager de raccourcir ces délais pour les affaires les plus importantes qui, je le répète, sont traitées trop lentement. A cet égard, une tentative a été faite auprès du juge des enfants statuant en chambre du conseil prévoyant une telle procédure rapide. D'ailleurs, celle-ci est contenue dans la loi du 1 er juillet 1996 qui a été mise en place pour essayer d'accélérer le cours du jugement des petites et moyennes affaires.
Cette disposition législative ne s'est pas, selon moi, révélée très efficace car il faut bien comprendre que cela demandait aussi l'aval du juge des enfants. C'est pourtant quelque chose qui, à mes yeux, devrait être revu.
Il est vrai que la notion de procédure rapide a souvent mauvaise presse parmi les avocats, voire parfois parmi certains juges, et je crois qu'il serait normal qu'il appartienne au parquet d'opérer un choix procédural essentiel entre le circuit ordinaire et le circuit court.
Pour les affaires importantes, les affaires graves, il existe à l'encontre des majeurs une procédure qui a parfois été décriée et dont le nom est « comparution immédiate », autrement dit la possibilité, lorsqu'un majeur est interpellé, de le faire juger dans un délai extrêmement court. Or une telle procédure n'existe pas pour les mineurs.
Il est vrai qu'il existe des spécificités en matière de mineurs. Ainsi, on a toujours expliqué qu'il fallait d'abord observer le comportement du mineur avant de le juger et on a souvent dit, peut-être à juste titre, que les procédures rapides étaient intentatoires aux libertés individuelles et aux droits de la défense.
Cela étant, je crois tout de même qu'il est possible de mettre en place un dispositif rapide pour les multirécidivistes ou pour les personnes qui n'ont aucun domicile fixe ; je pense ici, notamment, à des délinquants qui arrivent de Yougoslavie ou d'autres pays de l'Est, notamment en Haute Savoie -mais cela est également vrai dans d'autres départements- commettant une dizaine de cambriolages par jour et cela pendant pas mal de journées. Or le jour où ils sont interpellés ils n'ont aucune résidence, on ne sait pas exactement quelle est leur identité. C'est pourquoi on les place dans un foyer, même s'il est courant que le lendemain, voire deux heures après leur placement, ils ont disparu. On est donc contraint de juger ces personnes en leur absence, de prononcer un jugement par défaut.
Dès lors, il est clair, selon moi, que l'efficacité de l'institution judiciaire est à revoir, d'autant que l'on n'est même pas certain, je le répète, de l'identité réelle de ces individus.
Quand des jeunes, dans certaines cités, créent des perturbations extrêmement fortes, l'opinion publique, comme celle des élus locaux, est très pressante. Ils nous disent : « réagissez, faite en sorte que ce mineur qui crée des perturbations importantes dans ce quartier soit sanctionné et éloigné de ce quartier ».
Par conséquent, seule une procédure rapide, du style de la comparution immédiate, serait, selon moi, de nature à permettre un tel éloignement. Bien entendu, je précise que cette procédure devrait être aménagée au droit des mineurs, car il n'est pas toujours facile de réunir le tribunal pour enfants comprenant un magistrat et deux assesseurs civils ; mais on pourrait concevoir un délai de détention avant le jugement de quinze jours, par exemple, avec la comparution dans un délai de quinze jours à un mois. Cela permettrait une réaction forte et vigoureuse de la société, qui a le droit de se défendre face à certains comportements. Il est clair qu'une telle procédure devrait être mise en place avec beaucoup de prudence et qu'elle devrait être réservée aux cas les plus graves mais aussi, heureusement, les moins nombreux.
Autre difficulté concernant la procédure pénale concernant les mineurs délinquants : ceux-ci sont jugés soit par le tribunal pour enfants pour les affaires les plus graves, soit par le juge des enfants pour les faits moins importants. Il ne faut pas oublier que le fait de juger une affaire devant le tribunal pour enfants est une affaire complexe, lourde. En effet, à l'audience, il faut convoquer le mineur délinquant, sa famille, les personnes civilement responsables ; par ailleurs, les avocats et les parties civiles sont présents. En outre, s'agissant de mineurs, il est normal que nous leur consacrions du temps, de telle sorte qu'en une matinée et en une après-midi ne peut être jugé qu'un nombre relativement limité de dossiers. Or multiplier les audiences en fonction des moyens en personnels et en matériels n'est actuellement pas possible. Il convient donc, à mon avis, d'utiliser l'autre procédure, à savoir la voie du juge des enfants siégeant en chambre du conseil, procédure qui permet de gérer beaucoup de dossiers et en termes de flux d'augmenter le nombre de jugements donc de diminuer le stock des affaires à juger et, par conséquent, de raccourcir les délais. C'est là une nécessité.
Le problème dans ces procédures est que le juge des enfants siégeant en chambre du conseil a des pouvoirs assez limités : il peut infliger une mesure d'admonestation, une mesure de remise à parent, une mesure de protection judiciaire, un placement en établissement ou une dispense de peine, c'est-à-dire des sanctions pour l'essentiel symboliques et dont le caractère « sanctionnateur » n'est pas très fort.
Il conviendrait, à mes yeux, que le juge des enfants dans son audience de cabinet puisse prononcer, à l'instar de ce que fait le tribunal pour enfants, des peines d'amende ou de travail d'intérêt général. Pour ma part, j'y serais plutôt favorable.
En ce qui concerne les majeurs, un juge unique peut prononcer de courtes peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à cinq années sans que cela ne choque plus personne aujourd'hui. Dès lors, ne pourrait-on envisager que le juge des enfants en audience de cabinet puisse de la même façon infliger de courtes peines d'emprisonnement ? Il s'agirait là, me semble-t-il, d'une amélioration du système.
Autre difficulté : il nous est souvent reproché par rapport aux mineurs une absence de réaction judiciaire. Cela tient en grande partie au fait que pour juger des mineurs le huis clos est obligatoire dans les salles d'audience. De même, il y a interdiction absolue de publier le nom des personnes condamnées s'agissant des mineurs, de telle sorte que la presse ne fait jamais état de condamnations concernant les mineurs au tribunal pour enfants, ce qui peut laisser à penser qu'il y a impunité totale concernant les mineurs. En effet, il n'est pas rare d'entendre des responsables locaux nous demander si tel ou tel mineur a oui ou non été jugé. Certes, il l'a été mais dans la confidentialité telle que le prévoit la loi. Il y a là, je l'avoue, une difficulté que je ne sais comment résoudre ; je pose la question.
Il est vrai que cette disposition créant la confidentialité représente une protection importante pour les mineurs, mais elle a l'inconvénient de priver la société d'une connaissance du travail effectué par la justice, la police et la gendarmerie, et cela est un peu dommage. Il y a là - on l'a bien vu ces temps-ci -une sorte de rupture du consensus, un malentendu entre nos concitoyens et l'institution judiciaire. Ainsi, on nous reproche de ne rien faire, ce qui est souvent inexact.
Autre nécessité procédurale dont il a été souvent débattu : faut-il oui ou non instaurer la possibilité d'incarcérer des mineurs de moins de seize ans pour des délits ? Pour ma part, je serais plutôt enclin à le penser s'agissant de mineurs se situant dans la tranche d'âge des 14, 15 et 16 ans. Bien sûr, cela n'est pas satisfaisant en soi, mais, compte tenu de la montée très forte de certains comportements extrêmement violents de nature à créer des perturbations, il est nécessaire d'éloigner ce mineur délinquant de son environnement. Or, aujourd'hui, seule l'incarcération permet cet éloignement. Enfin, dernier élément du point de vue procédural : il est évident que toute réforme de procédure nécessite des moyens, notamment pour les parquets - je suis bien placé pour le savoir. En effet, les magistrats du parquet sont en général peu nombreux, alors que le jugement des mineurs exige plus de temps que celui des majeurs. Il faut donc, si l'on veut être efficace, renforcer les moyens des parquets, car, si je prends l'exemple de la Haute Savoie, il n'y a même pas un magistrat à temps complet pour traiter la majorité des affaires concernant les mineurs de ce département. Cela n'est pas admissible.
J'aimerais aussi m'exprimer quelques instants sur la prison, les foyers et les établissements fermés. La société a le droit de se protéger ; cela, je crois, n'est contesté par personne aujourd'hui. Certes, nous rêvons tous d'une société sans prison, surtout pour les mineurs et, à cet égard, je voulais rappeler ce que disait un sénateur et non des moindres, Victor Hugo, dont on fête le bicentenaire de la naissance cette année, à savoir qu'il suffirait d'ouvrir des écoles pour supprimer des prisons. L'idée était belle, généreuse, elle a été mise en oeuvre, mais, hélas ! elle n'a pas tout à fait réussi. On a ouvert des écoles, mais on n'a pas supprimé les prisons, et je crois, malheureusement, que cela correspond à une nécessité dans notre société.
Il est vrai que les prisons ou les quartiers de mineurs tels qu'ils existent actuellement dans notre pays ne sont, à mes yeux, aucunement satisfaisants, certains fonctionnements ou certains locaux étant parfaitement indignes de notre société. Il faut donc les revoir de fond en comble.
Bien sûr, une prison pour mineurs, cela doit comporter des murs d'enceinte et des barreaux aux fenêtres pour que le mineur ne puisse sortir, mais cela doit aussi être un lieu où l'on doit facilement pouvoir entrer pour y pratiquer l'enseignement, le sport ou d'autres activités de loisirs. Ce n'est pas le cas actuellement, où l'on appelle pompeusement « quartier des mineurs » un bout de prison plus ou moins isolé alors qu'en fait il s'agit souvent de quatre ou cinq cellules qui ne se différencient nullement du quartier des majeurs.
Pour ma part, il doit s'agir de lieux géographiquement bien distincts, avec des modes de fonctionnement différents, même si en la matière il ne faut pas faire preuve de trop d'angélisme. C'est ainsi qu'à la maison d'arrêt de Chambéry, l'an dernier, le quartier où s'est produite une révolte était celui des mineurs et non celui des majeurs. Il s'agit donc de lieux tout à fait difficiles à tenir et il faut en être complètement conscient.
A côté de l'incarcération, il est nécessaire d'avoir recours à des établissements que l'on appelle des foyers, même si c'est très souvent une difficulté quotidienne pour le juge, car trouver un foyer pour un mineur délinquant à cinq heures du soir ressemble à une gageure. En effet, les foyers sont organisés de telle sorte qu'ils s'arrogent le droit d'ouvrir ou de ne pas ouvrir leurs portes. En fait, ils sélectionnent les mineurs qu'ils veulent bien recevoir et l'on pourrait presque parler à ce sujet d'un profil type auquel correspond assez peu le mineur délinquant difficile et violent.
Il faut noter qu'il n'est pas rare dans un département comme le mien qu'après avoir placé un mineur un peu difficile dans un foyer, ce mineur, dans l'heure qui suit ou le lendemain, disparaisse, ce qui bien sûr empêche tout travail éducatif.
Il est donc nécessaire, selon moi, d'envisager la création de structures plus fermées interdisant la possibilité pour le mineur délinquant de sortir, ce qui sur le plan de l'architecture comporterait évidemment un mur d'enceinte - qui est toujours mal vu pour un mineur - ainsi que des barreaux aux fenêtres, mais pour l'instant on n'a rien inventé d'autre. On serait ainsi assuré que le mineur qui, à vingt heures ou à vingt-trois heures est dans sa chambre, sera également présent le lendemain matin à sept heures. On pourrait d'ailleurs envisager que l'administration pénitentiaire assure la partie surveillance car les personnels éducatifs ne souhaitent pas exercer ce rôle de contrainte.
Il faut donc concevoir des établissements qui, tout en empêchant les mineurs de sortir à l'extérieur, permettent à l'extérieur d'entrer facilement dans l'établissement, afin que les éducateurs, les instituteurs, les professeurs de sport ou les groupes de contact puissent facilement oeuvrer. On pourrait ainsi très bien concevoir une barrière s'ouvrant dans un sens et pas dans l'autre. J'ai entendu dire qu'il existait en Espagne des structures de cette nature, où les différents quartiers sont symbolisés par des couleurs allant du bleu sombre au bleu ciel au fur et à mesure que l'on approche de la sortie, avec un régime adapté à chaque échelon. Cela permet aussi, en cas de problème, de faire marche arrière.
Je voudrais également insister sur les lacunes concernant les mineurs souffrant de troubles psychiatriques importants, ce qui est souvent le cas pour les multirécidivistes. Or il n'existe quasiment aucun lieu pour recevoir ces mineurs : l'hôpital n'en veut pas, les foyers non plus. Reste la prison, ce qui crée un gros problème pour eux-mêmes et pour leur environnement, car ces mineurs sont susceptibles de mettre en échec une équipe éducative.
Par conséquent, il est urgent, me semble-t-il, de créer un certain nombre de lieux, de centres plus ou moins rattachés aux hôpitaux publics où les mineurs souffrant de problèmes psychiatriques puissent avoir leur place.
Je souhaiterais, enfin, faire deux ou trois réflexions.
Premièrement, il me semble qu'il faut faire attention à ne pas trop stigmatiser une génération, celle des jeunes d'aujourd'hui. J'entends souvent dire, quand une affaire n'est pas solutionnée : « c'est sûrement un mineur qui a fait le coup ». Or ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut et il faut se méfier d'une société qui chercherait par trop à opposer une génération à une autre. C'est peut-être la première fois dans notre histoire que quatre générations cohabitent, et il ne faudrait pas que la génération la plus âgée rejette tous les maux sur la plus jeune. Il font donc cesser de stigmatiser systématiquement les mineurs, car il y a là un danger.
Deuxième réflexion, assez banale, il faut le dire, mais que je rappelle pour mémoire : les premières victimes de la délinquance des mineurs fréquentent les quartiers difficiles. Je pense au racket ou à d'autres violences. Par conséquent, les mineurs ne sont pas seulement auteurs, et dans les transports, par exemple, ce sont souvent eux les premières victimes, de même que dans les établissements scolaires ou aux abords de ceux-ci. Nous devons donc agir aussi pour que les mineurs soient protégés, c'est important.
Troisième réflexion, il faut éviter de tout judiciariser. Ainsi, il n'est pas normal que des procédures soient intentées pour des bagarres relativement anonymes ayant lieu dans des cours de récréation. Il convient de rappeler toutes les institutions à la nécessité de réagir. Il existe un pouvoir disciplinaire interne à l'Education nationale, de même que dans les immeubles à travers les offices d'HLM. Il faut que ce pouvoir disciplinaire soit effectivement utilisé et ce n'est qu'en cas de difficultés sérieuses qu'il convient de saisir l'institution judiciaire.
Enfin, je terminerai mon propos en citant Hésiode qui, au VIIIème avant J.-C., écrivait dans Les Travaux et les Jours : « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents . »
C'est dire qu'il ne faut pas désespérer de notre jeunesse, la génération à venir n'est pas pire que la nôtre !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Vous nous avez dit qu'environ 20 % des affaires étaient élucidées. Y a-t-il moyen de faire mieux ?
M. Denis Robert-Charrerau - C'est un problème difficile, monsieur le rapporteur, et je serai peut-être encore plus sévère que vous sur le diagnostic. En effet, dans les 20 % d'affaires solutionnées, il faut bien voir que certaines d'entre elles le sont quasi systématiquement -je pense aux chèques sans provision ou à l'abandon de famille.
Bien sûr, il est vrai qu'en cas de vol d'un autoradio dans la rue en l'absence de témoins le travail est extrêmement difficile. Dès lors, comment faire ? Il faut, à mon avis, des effectifs supplémentaires ainsi qu'une volonté politique de donner des moyens à la police judiciaire, qui se sent parfois oubliée. En effet, c'est la police judiciaire qui est chargée du travail de longue haleine dans les enquêtes, alors que les policiers sont moins nombreux aujourd'hui qu'il y a dix ans.
Se pose ensuite le problème des moyens juridiques accrus donnés à la police et à la gendarmerie ; mais cela, bien évidemment, porte atteinte aux libertés de nos concitoyens. Dans ce domaine, une décision politique est donc tout à fait nécessaire. Tel est l'objet de la réforme de la procédure pénale : faut-il donner des pouvoirs accrus aux services de police et de gendarmerie ou, au contraire, doit -on accorder plus de droits à nos concitoyens pour accroître la liberté individuelle de chacun ? Il y a là un équilibre à trouver en fonction de l'état de notre démocratie qu'il appartient aux hommes politiques, donc aux parlementaires, de trouver.
M. le rapporteur - Que pouvez-vous nous dire de la réparation, monsieur le procureur ? Est-ce une mesure efficace ?
M. Denis Robert-Charrerau - Il s'agit là d'une bonne mesure, monsieur le rapporteur, mais qui est relativement complexe à mettre en oeuvre. En effet, en matière judiciaire, comme dans tous les domaines, on a tendance à privilégier les procédures les plus simples qui sont aussi les plus rapides.
Les mesures de réparation, elles, demandent du temps pour les magistrats ainsi que des moyens pour les personnels, pour les éducateurs et de ce fait elles sont, selon moi, insuffisamment utilisées.
Ce que je vais dire va peut-être vous paraître contradictoire -il s'agit là d'une sanction qui reçoit l'adhésion à la fois de l'opinion publique et des élus locaux dans les comités de surveillance et dans les CLS- mais il est vrai que ces mesures s'adressent à des mineurs à peu près « convenables ». C'est un peu comme pour le travail d'intérêt général : lorsque le mineur condamné doit se présenter à neuf heures du matin au service technique de la mairie de tel endroit, évidemment, s'il n'arrive qu'à onze heures, les élus nous disent : « c'est bien beau le travail d'intérêt général ou la mesure de réparation mais les services techniques commencent à en avoir assez ! »
Par conséquent, il faut presque un délinquant idéal pour que la mesure de réparation puisse fonctionner. Ce n'est donc pas la panacée, même si cela mérite sans aucun doute d'être encore développé.
M. le rapporteur - Vous avez parlé de la possibilité, dans des structures un peu plus fermées, d'une certaine perméabilité de l'extérieur vers l'intérieur permettant aux éducateurs ainsi qu'aux services associatifs ou sportifs de pénétrer dans ces lieux.
Ne pourrait-on envisager d'utiliser ceux que j'appellerai les « papis » et les « mamies », c'est-à-dire les retraités et les préretraités, qui pourraient apporter aux mineurs délinquants l'affection dont ceux-ci ont sans doute manqué ?
M. Denis Robert-Charrerau. L'idée me paraît en effet intéressante, monsieur le rapporteur, concernant surtout les mineurs très déstructurés qui viennent de familles où ils n'ont connu de la part ni de leurs parents ni de leurs grands-parents les relations affectives nécessaires à leur épanouissement. S'agissant de bénévoles ayant bénéficié d'une brève formation de manière à ne pas être trop facilement manipulés par certains mineurs, cela paraît être un plus et, pour ma part, j'y serais plutôt favorable.
Cela dit, la difficulté pourrait venir de leur cohabitation avec les professionnels du monde éducatif, car ces derniers ont souvent tendance à exclure les bénévoles ; mais le problème n'est pas insurmontable, car il est bien évident que ces bénévoles auront une motivation très forte et qu'ils pourront apporter quelque chose. Nous avons besoin de gens ayant du charisme et qui fassent en sorte que les mineurs s'identifient plus facilement aux adultes.
M. le rapporteur - Concernant des mineurs appartenant à certaines communautés étrangères telles que les gens du voyage, nous avons pu voir qu'il était très difficile d'apporter une réponse adaptée, efficace. Selon vous, quels moyens pourrait-on mettre en place pour améliorer la situation ?
M. Denis Robert-Charrerau - C'est un peu l'ambiguïté du droit pénal, monsieur le rapporteur, qui a été construit en 1945 sur l'idée d'une certaine générosité. Il faut dire que cela fonctionne bien pour beaucoup de mineurs, car nombre de ceux qui sont interpellés une fois ne reviennent pas. Statistiquement, c'est le plus grand nombre.
Cela dit, bien entendu, il existe des délinquants tout à fait rebelles à la mesure éducative, ne nous faisons pas d'illusion. Certains même sont utilisés et connaissent parfaitement la réglementation. C'est ainsi que l'on voit très souvent dans les tribunaux - cela nous heurte un peu et nous agace, nous, magistrats - des mineurs qui nous rappellent les règles concernant la garde à vue ou la détention et qui nous disent avec un certain toupet qu'on ne peut rien contre eux puisqu'ils ont moins de 16 ans !
Or il faut bien voir que les adultes qui sont derrière ces jeunes, et qui parfois les utilisent, ont également cette connaissance. Dans ce cas, il n'est plus possible d'être dans la réaction éducative et je pense qu'il faut effectivement trouver une réaction plus vigoureuse. A cet égard, les centres fermés, offrant la possibilité de retirer pour un temps le mineur du milieu où il se trouve me paraissent adaptés. C'est, je crois, une nécessité.
En effet, à l'heure actuelle, ces mineurs bénéficient d'une véritable impunité. On a essayé le foyer, mais, dans l'heure qui suit son placement, le mineur, après avoir pris sa douche, fugue, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément pour déplaire à l'équipe éducative qui s'en trouve soulagée.
Mme Nicole Borvo - Personnellement, je ne crois pas qu'il faille renoncer à l'éducation, quels que soient les actes commis, car après la sanction viendra le temps de la réinsertion.
Vous avez dit que dans certains cas - encore faut-il savoir lesquels -la prison était une solution même si ce n'est pas la panacée.
Quant à la réparation, vous avez souligné qu'elle n'est pas assez utilisée. Pour ma part, je pense qu'il conviendrait d'approfondir la réflexion dans ce domaine, car, après une incarcération en centre fermé qui va durer un certain temps, que va-t-il se passer pour le mineur délinquant ? Il faut, je crois, inventer des choses nouvelles.
Ainsi, ne serait-il pas envisageable de combiner des sortes d'internats permettant de tenir les jeunes à l'écart de leur lieu d'origine ou de leur lieu de délinquance avec des mesures de réparation, par exemple, sous forme de travail d'intérêt général ? Ce serait là, me semble-t-il, une solution satisfaisante.
M. Denis Robert-Charrerau - Peut-être me suis-je mal exprimé, madame la sénatrice, car ma position n'est sans doute pas très différente de la vôtre, à savoir que la prison pour les mineurs est en soi un échec, c'est évident, même si c'est peut-être un échec nécessaire.
Il faut tout de même reconnaître qu'on y a recours de manière relativement limitée. Par ailleurs, il est clair que l'incarcération du mineur ne peut intervenir que pour une durée très courte.
C'est souvent ce que je dis à l'extérieur : « s'il faut mettre un mineur en prison, il faut faire en sorte qu'il soit meilleur en sortant que lorsqu'il y est entré, sinon cela ne sert à rien ! »
Il faut bien voir que la demande d'incarcération est très forte dans notre société, et le parquet, à cet égard, est considéré comme n'étant pas assez repressif. Or, pour ce qui me concerne, je rappelle toujours que la prison n'est pas la panacée, que la sortie doit être préparée et que, quoi qu'il en soit, l'incarcération doit être de courte durée.
Personnellement, je serais plutôt favorable à ce que l'on supprime la prison pour les mineurs en mettant en place des établissements fermés possédant une structure plus éducative que celles qui existent actuellement. Reste, bien sûr, à construire de tels établissements, mais il est vrai qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les juges n'ont souvent pas le choix : c'est la prison ou la liberté, il n'existe pas de sanction intermédiaire véritable en 2002.
M. le président - La commission vous remercie, monsieur le procureur.
Audition de M. Malek BOUTIH,
président de
SOS racisme
(29 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, rapporteur
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous allons entendre M. Malek Boutih, président de SOS racisme.
( Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment .)
Monsieur Boutih, vous avez la parole.
M. Malek Boutih - Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne suis pas un spécialiste de la délinquance, même si peu ou prou SOS racisme a toujours été confronté dans son action de terrain aux problèmes que rencontre la jeunesse en particulier. En effet notre association aborde la question du combat anti-raciste dans toutes ses dimensions et nous sommes toujours attentifs aux enjeux touchant à la jeunesse car c'est elle qui est porteuse de ce qui se dessine dans l'avenir.
La première chose que je voudrais dire est que la liaison entre jeunes immigrés ou issus de l'immigration et délinquance est un vieux thème car, autant que je m'en souvienne, avant même que je commence à militer, on avait déjà la réputation - vous me permettrez l'expression - d'être des délinquants. La liaison entre immigration et délinquance a donc toujours existé et c'est pourquoi on doit la traiter avec délicatesse et intelligence si possible.
Cela étant dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en tant que président de SOS racisme, plus que l'acte délictuel en tant que tel c'est la montée de la délinquance dans les rapports sociaux. En effet, depuis le début des années quatre-vingt-dix, j'ai pu constater une montée en puissance des rapports de violence au sein de cités ou de quartiers, rapports de violence qui me sont apparus, à moi qui ai vécu dans ces cités, comme ayant pris une autre tournure, une autre ampleur et une autre force que ce que l'on connaissait dans les années quatre-vingts ou avant.
Quand on vit dans les quartiers populaires, par nature on est dans des rapports sociaux quotidiens qui n'ont pas obligatoirement la même forme que dans les autres quartiers. On traîne plus dans les rues que dans les autres quartiers, d'abord parce qu'on aime ça et parce qu'on n'aime pas être enfermé ou parce qu'on n'a pas un encadrement de loisirs ou d'activités adapté, et ce pour plusieurs raisons d'ailleurs : ce n'est pas forcément parce que nos parents n'ont pas les moyens financiers ; parfois c'est simplement parce que ce n'est pas dans nos traditions ; même quand certains loisirs sont gratuits, on n'y va pas parce que ce n'est pas notre truc.
On a donc, à partir de cette vie dans la rue, dans les rapports sociaux avec notre voisinage, dans les types de population qui se croisent de gens modestes qui n'ont pas tous de hauts niveaux d'éducation, qui n'ont pas tous des langages « hyper châtiés », des rapports qui sont toujours plus tendus qu'ailleurs. Il en a toujours été ainsi dans les milieux populaires.
Il est vrai qu'on a aussi toujours trouvé dans ces quartiers des délinquants mais, pendant longtemps, il était évident à travers des classes d'âge que j'ai moi-même fréquentées que ces délinquants étaient des jeunes qui avaient fait le choix de passer une certaine « ligne jaune » et, qui dans le trafic, qui dans tel ou tel acte, qui à cause de son caractère violent, se trouvaient ainsi classés parmi les délinquants.
En général, il y avait bien sûr un rapprochement : on vivait dans le même quartier, on pouvait se croiser mais, en même temps, il y avait une distance. Il y avait toujours une bande que l'on reconnaissait comme étant « les voyous » et gare à nous si nos parents nous surprenaient à les fréquenter. On se faisait réprimander et, même socialement, entre nous les jeunes, il y avait une différence.
Par conséquent, même s'il pouvait y avoir certains actes délictuels, ceux-ci étaient ponctuels et n'imprégnaient pas la vie quotidienne dans les quartiers. Or, à partir des années quatre-vingt-dix, il me semble que cette frontière est devenue plus ou moins floue, les rapports de violence sont devenus de plus en plus difficiles, de plus en plus omniprésents, de plus en plus quotidiens dans toute une partie de la population, en particulier chez les jeunes.
On pourrait trouver beaucoup d'explications dans ce domaine. Personnellement, j'ai pu constater cette montée de la violence à travers une expérience que j'ai menée dans un quartier de l'Essonne, qui s'appelle le quartier des Grandes Bornes dans la ville de Grigny.
J'avais choisi ce quartier d'abord parce que ce n'était pas le mien, ce qui facilitait un travail associatif objectif et aussi parce que c'est un quartier enclavé où l'on trouve différents types de populations : beaucoup de populations de couleur bien évidemment - et non pas étrangères, je tiens à le préciser, car beaucoup de jeunes sont Français tout en étant d'origine antillaise, africaine ou maghrébine, notamment.
Il m'a semblé assez frappant, dès les premiers jours de cette expérience, que quelque chose s'était déréglé dans les quartiers. En effet, quand on y vit au quotidien, on éprouve un sentiment très fort d'enfermement en partie réel. Il s'agit d'un enfermement psychologique ou sévit une violence d'abord marquée par le langage.
Ce qui m'a frappé, c'est cette violence verbale omniprésente, totalement gratuite. Ce n'est pas le lieu ici de faire un lexique des termes employés mais, pour prendre un exemple, il existe mille façons de dire « bonjour » à quelqu'un, dont certaines peuvent être extrêmement grossières pour quiconque n'y est pas habitué. Il s'agit donc là de rapports où l'on fait de la violence une sorte de norme quotidienne des rapports sociaux.
Par ailleurs, la violence en termes d'agression physique n'est pas le fait de tout le monde. Là encore, cela concerne des petits groupes interchangeables qui constituent autant de noyaux durs de la violence. Aujourd'hui ce sont ces six-là, demain ce sera ces sept-là et après-demain il y en aura huit autres, etc. qui commettront des agressions. D'ailleurs, quand, pour une raison ou pour une autre, un jeune est éloigné de son quartier, il y a tout de suite quelqu'un qui prend sa place comme caïd.
Il y a donc aussi une sorte d'effet trompeur de tous ces petits groupes qui terrorisent la population. Je le sais pour l'avoir vécu pendant près de trois années dans le quartier des Grandes Bornes.
Par conséquent, le fait pour un jeune du quartier d'être éloigné se traduit rarement par une baisse de tension ou par la disparition des phénomènes que j'ai pu observer. J'ajouterai même que dans certains cas nous avons été surpris de découvrir que celui qui arrivait derrière était pire que celui qui l'avait précédé.
Le deuxième élément concerne le type de population qui vit dans les quartiers. Ici les transformations ont été très profondes puisque les quartiers populaires sont devenus des ghettos. Là encore, les causes sont multiples. J'emploie le terme de « ghettos » au sens où les populations qui y vivent sont des populations en échec dans la vie sociale et économique.
Cela se traduit évidemment par la présence de plus en plus de gens de couleur et de moins en moins de population blanche. La population blanche qui s'y trouve est extrêmement marginalisée et parfois même associée au groupe dominant.
Je discutais l'autre jour avec un jeune de ces quartiers qui m'interpellait en tant que président de SOS racisme. Il me demandait si je ne parlais que des noirs et des arabes car lui-même se sentait comme eux. Je lui ai répondu qu'effectivement il était -permettez-moi l'expression- « assimilé bougnoule », c'est-à-dire qu'il était en fait assimilé au groupe dans lequel il vivait. Je lui ai expliqué que cela serait moins flagrant s'il faisait un petit effort, je voulais parler de son crâne rasé, de son survêtement, etc.
Quoi qu'il en soit, la présence massive de populations de couleur immigrées est un phénomène important psychologiquement pour ces familles car l'effet d'enfermement est très fort même si elles ont « les moyens » d'accéder à un statut social plus élevé qui leur permettrait de vivre dans d'autres quartiers plus intermédiaires.
Enfin, j'évoquerai un dernier élément qui m'a paru extrêmement frappant : la montée en puissance de ce que l'on appelle l'économie parallèle et qui est en fait structurée centralement par le trafic de drogue, principalement par le trafic de cannabis. Cette drogue est, selon moi, la manne financière la plus massive compte tenu de l'explosion de la consommation de cannabis en France.
Personnellement, j'ai toujours connu ce phénomène depuis que je suis tout petit. Je savais qu'il y avait un trafic de cannabis, etc., mais son ampleur est devenue démesurée à partir du moment où, dans les lycées et les universités, dans toutes les soirées où l'on danse, la jeunesse française s'est mise à consommer du cannabis. Bien sûr, tous les jeunes français n'en consomment pas mais les études montrent qu'ils sont à peu près un sur deux à en consommer, ce qui représente quand même une masse importante et donc un marché financier considérable.
Par conséquent, parallèlement aux éléments d'enfermement, de ghettoïsation et de marginalisation, tous ces sentiments qui peuvent exister autour des identités, s'est structuré un trafic qui a fait naître des trafiquants qui ont compris que la cité était le lieu dans lequel le trafic pouvait s'organiser.
Après tout, quand on y réfléchit bien, on peut se demander comment un marché qui doit représenter plusieurs centaines de millions d'euros peut être laissé entre les mains de petits voyous de quartier. La réponse tient, je crois, à la notion de territoire, concernant cette drogue-là particulièrement car cela représente de grosses quantités de marchandises. En outre, il faut être accessible à tout le monde et il faut donc pouvoir se livrer à ce trafic en toute tranquillité. C'est ainsi que la notion de quartier est devenue pour les trafiquants très importante.
Il s'agit là de phénomènes qui sont lents à se mettre en place mais l'idée d'avoir un sanctuaire pour pouvoir organiser le trafic est devenue primordiale. Or, pour constituer ce sanctuaire, il est évident qu'il fallait créer une sorte de dynamique excluant tout ce qui est positif dans ce quartier et en intégrant au sein de ce dernier tout ce qu'il peut y avoir de négatif. C'est ce que j'appelle une sorte de « deal informel » qui s'est constitué entre ces quartiers. Je dit « informel » car, bien sûr, personne n'a rien décidé, mais l'idée était celle-ci : « on fait ce que l'on veut dans notre quartier et, en contrepartie, on ne demande rien à l'extérieur ».
Cela correspond à l'émergence dans les banlieues d'un discours cryptopolitique qui utilise n'importe quel phénomène social pour faire admettre par tout le monde l'idée selon laquelle hors du quartier point de salut.
Dans la réalité, un tel discours était tout à fait perceptible. Ainsi, quand des associations comme la nôtre essayaient d'intervenir dans les quartiers, elles s'entendaient dire : « vous êtes très psychologues et on adore ce que vous dites mais rien ne vaut l'argent. En dernière analyse, je peux militer un ou deux ans avec vous et faire des choses mais c'est quand même mieux d'avoir une carte bleue bien remplie ou un paquet de billets dans sa poche. Par conséquent, je fais ce que je veux et je ne demande rien à personne ! »
L'idée était donc que les rapports de forces étaient utiles et, ce qu'il faut dire, c'est que c'était souvent vrai. En effet beaucoup d'interlocuteurs institutionnels étaient plus sensibles aux rapports de forces physiques et violents qu'à un discours associatif, et j'ai pu moi-même constater que ce que les jeunes appellent le « coup de pression » à la mairie fonctionnait mille fois mieux qu'une pétition.
Or qu'est-ce que le « coup de pression » ? Cela consiste à aller bousculer les agents qui sont à l'entrée de la mairie pour défoncer la porte du bureau du maire en disant : « je vais tout casser, je vais tout brûler, etc., je suis un fou et, si je ne peux pas partir en vacances, si je n'ai pas un local ou un appartement, ou si ma « meuf » n'en a pas -j'en passe et des meilleures- je vais tout casser ! » Le pire c'est que, souvent, on leur donnait raison.
Je crois donc qu'il y a eu une sorte d'abandon de ces quartiers non pas officiellement mais dans les faits. Combien de fois ai-je entendu des maires qui, au moment où des voitures flambaient, disaient aux jeunes : « avec tout ce que j'ai fait pour vous ! » Cela sous-entendait que les actes commis par ces jeunes étaient le fait de gens qui n'étaient pas exactement comme les autres.
Enfin, je crois que ce qui était dominant chez beaucoup des interlocuteurs du plus haut jusqu'au plus bas niveau, c'était de dire qu'il y avait un tel sac de noeuds, une telle quantité de problèmes qu'il valait mieux ne pas y mettre le petit doigt si l'on ne voulait pas se faire manger !
Ce mode de gestion a fait ses preuves et s'est donc imposé contre tous les autres rapports. A partir de là, une sorte de phénomène crypto-politique d'ordre social et des valeurs se sont instaurés, qui étaient la violence, le rapport de force comme outils pour s'en sortir dans la vie. Tout le monde n'est pas dans cette logique, mais la majorité des jeunes qui vivent dans les banlieues, qui refusent cette logique ne sont pas pour autant des éléments modérateurs, pour la simple raison que le seul moyen de la refuser, c'est de se cacher, de se protéger.
On va à l'école, on mène ses activités, on revient dans le quartier en attendant, un jour, d'en partir parce que c'est le seul projet possible. Lorsque vous organisez un débat dans n'importe quel quartier, n'y assistent que ceux qui n'en ont rien à « foutre », quand ce ne sont pas ceux qui viennent pour casser la réunion parce que ça les fait « chier » que quelque chose se passe.
Les autres se foutent de leur quartier. Ils peuvent en parler à la fac, au lycée mais, dans leur quartier, ils n'ont plus envie de le faire parce qu'ils ne croient plus à une quelconque forme de régulation citoyenne, civique ou politique. Ils pensent que tous les projets, les investissements, les discours qui sont faits passent, alors que la réalité des rapports de force demeure et que, si quelqu'un, au sein du quartier, ose remettre en question l'ordre social de violence, il sera lui-même exposé sans que quiconque le protège, ce qui est une réalité maintes fois prouvée. Jamais l'épreuve de force politique n'a été instituée dans les quartiers pour imposer ceux qui sont pour la justice, pour le droit, pour la citoyenneté, etc. parce que, paradoxalement, ce sont aussi ceux qui parfois contestent.
Ainsi, le maire avec qui je travaillais préférait avoir affaire à un dealer qu'au président d'une association qui avait son mot à dire sur les grands projets urbains, sur l'intérêt éventuel d'un centre commercial pour sauver une banlieue, ce qui est plus gênant. Il est facile de comprendre pourquoi c'est plus gênant que de céder une fausse maison des jeunes à un dealer qui va pouvoir y faire ce qu'il veut. D'autres intérêts, d'autres rapports de force sont en jeu.
Voilà la logique qui, à mon avis, s'est instaurée et qui a créé une culture dans les banlieues en rupture avec celle des années quatre-vingt. La jeunesse des années quatre-vingt avait des reproches à formuler, elle avait des combats à mener contre l'injustice, contre le racisme et elle l'a fait sous différentes formes. Il y avait des périodes de violence dans les années quatre-vingt, dont il est assez intéressant d'analyser la nature.
Dans les années quatre-vingt, lorsque des « émeutes », des actions de violence se produisaient, le lendemain, de façon très étonnante, une association ou une coordination prenaient naissance dans le quartier. Passé le moment de tension, il y avait une volonté de construire. Aujourd'hui, en tout cas dans tous les quartiers que j'ai suivis où ont eu lieu des grandes « émeutes », des violences importantes, les choses sont en général pires le lendemain. Et de cette violence naît rarement quelque chose. Cette violence qui détruit n'a pas d'autre sens que de créer un no man's land . Brûler une école, casser les boîtes aux lettres de son propre immeuble ou les vitres du hall d'entrée où l'on traîne et où, par conséquent, on aura froid l'hiver n'ont pas de sens économique.
Il existe un comportement de dégradation qui vise collectivement à créer un climat de destruction et qui entérine ce partage de la société entre ceux qui sont dans le ghetto et ceux qui sont en dehors. A l'intérieur du ghetto, il y a ceux qui en profitent, qui, de toute façon, ne sont pas sensibles aux discours sur le long et le moyen terme parce qu'ils vivent comme dans le film A bout de souffle : vivre vite et mourir jeune. C'est en tout cas le mythe qu'ils se construisent.
Cette génération est baignée dans les médias. J'ai récemment lu que la durée moyenne qu'un jeune passait chaque jour à regarder la télévision était de deux ou trois heures ; dans les quartiers, cette durée doit avoisiner six ou sept heures. Je connais plein de jeunes qui passent des week-ends entiers devant la télévision.
Ce monde virtuel est leur référent. Tout est artificiel, rien n'a de lendemain et, de toute façon, tout est « zappé ». Cela peut expliquer que des jeunes pris en flagrant délit, en train de commettre des actes extrêmement graves ne comprennent même pas pourquoi on les arrête. En effet, pour eux, ce qu'ils ont fait à un moment est oublié l'instant d'après. « Je ne suis plus sur M 6, je suis sur France 2 ; pourquoi me parle-t-on encore de M 6 ? », se disent-ils. Il n'y a plus de structuration, plus de projection.
Le plus terrible, ce ne sont ni les actes, ni les acteurs eux-mêmes. Le plus terrible est d'ordre idéologique. C'est cette destructuration sociale, cette déconscientisation politique et citoyenne très profonde qui atteint ces quartiers qui expliquent que, désormais, les jeunes générations reproduisent d'emblée le modèle mis en place dans le ghetto.
Dès leur plus jeune âge, certains gosses apprennent, à travers leur environnement, des normes qui ne sont pas celles de la société, qui sont des normes de marginalité et d'échec. Ces gosses grandissent avec l'idée que ça ne sert à rien de travailler à l'école parce que, de toute façon, on est cuit d'avance. Ils connaissent le « business », ils connaissent l'argent alors qu'ils ne devraient pas le connaître.
D'ailleurs, on entend souvent dans les quartiers, notamment chez les adolescents violents, des discours sur les plus jeunes, qui peuvent se résumer ainsi : « Nous, on n'est pas très sages, c'est vrai, mais ceux qui viennent après sont terribles ». Et il est exact que chaque génération amène une hausse du niveau de violence.
En l'état actuel des choses, on peut dire que la prochaine étape décisive sera l'utilisation d'armes à feu de manière plus systématique qu'aujourd'hui. Il y a, bien sûr, une circulation des armes à feu dans les banlieues. J'ai vu, ici ou là, des armes de guerre mais il ne faut rien exagérer, on ne se tire pas quotidiennement dessus à coup de pistolet. Toutefois, cela peut devenir vrai dans un très proche avenir. Il suffira d'un acte très médiatisé et cela a déjà commencé avec la guerre des gangs.
Il est très important de prendre en compte cette dimension psychologique et politique des quartiers, qui explique en partie pourquoi les débats et les solutions proposées en matière de délinquance, en particulier celle des mineurs, échouent. Ce problème des banlieues n'est pas aussi facile à régler qu'un problème de technique judiciaire. On ne le règlera pas non plus d'un coup de menton. Mon expérience m'a montré, je le dis en toute objectivité, que la solution ne relève pas de l'autoritarisme.
Il est nécessaire de remettre des points très clairs d'autorité autour de la notion de ce qui est délictuel ou non, de ce qui est autorisé ou non. Il est nécessaire de traiter la délinquance en profondeur, de sanctionner les actes quand ils méritent d'être sanctionnés, à tous les niveaux et à tous les âges. Mais il faut trouver des sanctions adaptées, comme on le fait dans l'éducation de ses propres enfants.
Toutefois, il y a quelque chose en plus à trouver si l'on ne veut pas que tout ce travail soit inutile. Le travail sera fait, qu'il le soit par la police, la justice ou l'ensemble des partenaires, car tout le monde veut mettre fin à la violence et personne n'a démissionné. Mais quelque chose inquiète tous les acteurs de cette réalité sociale, qui se demandent comment l'on peut arrêter le processus et ne pas être pris toujours dans la même logique.
Là, on voit à quel point la reconquête républicaine de ces quartiers est importante, non pas seulement une reconquête militaire mais une reconquête politique. Il faut redonner de l'espoir, inverser un processus et il me paraît indispensable de s'appuyer sur les populations pour isoler les acteurs qui trouvent leur intérêt dans cette logique de violence.
Il faut beaucoup se méfier des apparences, notamment des réunions d'élus, des reportages où l'on voit des honnêtes gens dire : « Mais que fait la police ? ». Dans les quartiers, les choses sont beaucoup plus difficiles. Ceux-là mêmes qui peuvent émettre un vote extrémiste au moment des élections, être les premiers à signer des pétitions, à interpeller les élus en disant qu'on les abandonne, ont parfois un discours compréhensif et un petit doigt dans les dispositifs. Si l'on faisait une perquisition dans tous les appartements de ces quartiers, on s'apercevrait qu'il n'y a pas que chez les voyous que l'on trouve des objets volés. Quelque part a été entérinée l'idée que l'on est dans un fonctionnement dual, qu'il y a une logique à ce qui est en train de se passer.
C'est tout cela qu'il faut préciser. Il est très important d'ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut à tout prix cesser de penser que certains quartiers vont être réhabilités un jour. Il faut recréer une égalité, recréer la diversité raciale, qui est un grand tabou en France.
Je suis en tout cas certain qu'une politique qui vise à rétablir une certaine sécurité, à faire régresser la violence, en particulier chez les mineurs, à remettre de l'ordre au sens policier mais aussi au sens social, est une politique qui demande un investissement de tous les corps d'Etat, une mobilisation de l'ensemble de la société et des moyens financiers importants. Elle nécessite un projet, une vision.
Cela me paraît important, non pas parce qu'en tant que président de SOS Racisme j'ai une fibre sociale développée mais simplement parce que c'est une question d'efficacité. Il me semble, je l'ai d'ailleurs constaté dans mes rencontres avec les policiers, notamment sur le terrain syndical, que cet avis est largement partagé. Cet investissement massif est nécessaire si l'on veut briser la dynamique, le ressort qui s'est mis en place et qui a créé un destin différent pour les habitants des centres villes et ceux des périphéries.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Je vous remercie pour cet exposé sur les causes de la violence dans les quartiers, dont vous nous avez dit qu'elle avait explosé depuis les années quatre-vingt-dix mais surtout qu'elle avait changé de nature. Certains quartiers sont devenus des ghettos et un certain nombre de jeunes se « foutent » de leur propre quartier.
Les solutions ne sont pas simples à mettre en oeuvre parce que le problème est lui-même complexe. Elles ne se résumeront pas à des mesures de type militaire, dites-vous, même si vous êtes très sévère avec la police dans votre livre, en affirmant qu'elle n'aime pas trop se tuer au travail et aller la nuit dans les quartiers dangereux.
Si nous sommes d'accord sur l'analyse et la philosophie, j'aimerais néanmoins savoir quelles pistes peuvent être, selon vous, explorées et quelles solutions peuvent être concrètement mises en place pour améliorer la situation.
M. Malek Boutih - Il n'est pas facile de répondre à votre question. Je n'ai pas de baguette magique ni la science infuse. Il faut déjà que chacun fasse son travail. Les solutions en matière éducative, policière, en matière d'urbanisme, d'encadrement de la jeunesse, de traitement des parents, d'accompagnement social existent déjà. Beaucoup d'expériences extrêmement positives ont montré des résultats probants mais l'on est dans un pays où les expériences sociales, pédagogiques, sécuritaires ne trouvent jamais de débouché à l'échelle nationale. Il faudrait donc peut-être recenser les choses qui sont bien faites par des professionnels compétents.
Plusieurs questions me paraissent cruciales. Il faut d'abord se donner un objectif qui ne peut pas se résumer à un discours sur la délinquance. Le discours politique dans sa responsabilité ne peut pas uniquement consister à dire : voilà comment on va s'attaquer à la délinquance. Car, ainsi, on ne fait qu'amplifier le principe extraordinaire selon lequel plus les gens sont méritants moins l'on s'occupe d'eux et plus l'on s'occupe de ceux qui sont dans la marge. Il est important dans le contexte que je vous ai décrit de ces quartiers d'avoir un discours pour les autres, notamment pour leur expliquer le travail qui est mené en matière de lutte contre la violence et l'insécurité. Je fais partie des acteurs dans le débat public qui essaient de tenir un discours, non pas de responsabilité mais de conscientisation politique d'une partie de la jeunesse sur son intérêt dans le combat contre la violence et la délinquance.
Le fait que les pouvoirs publics sont contraints d'amplifier le phénomène selon lequel ce sont toujours ceux qui « déconnent » dont on s'occupe explique la dérégulation dans les quartiers. Si vous êtes un jeune en marge dans votre comportement, votre santé, votre scolarité - c'est-à-dire quand tout est foutu - c'est alors qu'on s'occupe de vous. Sinon, il n'y a aucune présence autour de vous, aucune attention à votre égard, et comme vous n'avez pas de carte bleue, vous n'êtes rien, parce que tout le reste est accessible par carte bleue ou par Internet.
Dans la société actuelle, il n'y a plus d'interlocuteur. C'est pourquoi le discours reste néanmoins important. Le poids des mots et des explications est essentiel, d'où l'idée d'un projet.
Que veut-on aujourd'hui ? Veut-on protéger les centres villes, les parties saines, les campagnes, nos belles stations de ski de la « merde » des banlieues ? Ou veut-on effectivement permettre à cinq millions ou six millions de personnes qui habitent dans ces quartiers d'avoir une vie normale ? « Normale », cela ne veut pas dire le bonheur ni des HLM à Neuilly. Tout le monde se fiche d'avoir des HLM à Neuilly, ce n'est pas le problème. Vivre normalement, cela veut dire ne pas avoir le sentiment, quand on entre dans cette zone, qu'on est ailleurs.
Ce projet consiste également à se donner des objectifs très concrets, à oser dire qu'un grand nombre de cités vont disparaître et qu'il va falloir reloger les gens qui, comme les autres, habiteront dans des villes ou autour des villes mais dans d'autres conditions. Il faudra expliquer aux autres qu'ils auront de nouveaux voisins. Il faudra que la société accepte une forme de métissage. C'est un élément important.
Le phénomène de délinquance des mineurs existe dans de nombreux pays mais chaque pays a ses spécificités. Un des dangers pour la société française, c'est qu'il y ait une jonction entre ces phénomènes de violence et le sentiment d'exclusion raciale, que l'on soit confronté à un phénomène politique et non plus seulement de délinquance où s'entremêleront des éléments délinquants et des éléments politiques, ce que l'on connaît à l'échelle internationale.
Ce phénomène ne s'est pas développé chez nous parce que, dans les quartiers, on trouve encore des générations qui ont bénéficié de la République. Ce sont d'abord les immigrés eux-mêmes, qui savent ce que la France leur a apporté ainsi qu'à leurs enfants, qui ont bénéficié de l'éducation, de l'accès aux soins, etc.
Mais les générations humaines sont ainsi : ceux qui profitent, dès le début de leur vie, de ce qui a été acquis par les autres ne continuent pas à dire merci. Aujourd'hui, par exemple, on ne parlerait plus aux Français du formidable acquis qu'a représenté l'acquisition d'une salle de bain dans chaque appartement. Tout le monde considère que c'est même le minimum alors que cela fait à peine trente ans qu'il y a des salles de bain dans tous les foyers français. On observe un peu le même phénomène chez les jeunes générations, qui n'ont pas le même rapport que les plus anciennes à l'égard d'un certain nombre d'acquis républicains.
Mais ces générations anciennes sont encore présentes et ce sont des points d'appui importants dont il faut se servir. Sinon les jeunes générations vont s'enfermer, car elles ont une conscience politique beaucoup moins nette que leurs aînés. Leur culture, cela est d'ailleurs conforme à l'évolution globale de la société, est une sorte de « gloubi boulga » de ce qui passe à la télévision ou de ce qui se dit dans la rue et qui aboutit à la construction de discours aberrants autour de leur identité ethnique et de leur identité sociale et à l'adhésion à des discours très marginalisants.
L'attaque frontale contre les ghettos, leur destruction, la reconstruction de logements, la recréation d'une unité et le mélange des populations me paraissent importants. Bien sûr, on se retrouvera nécessairement dans des débats très compliqués.
Ce n'est pas un hasard si, en France, la discrimination raciale dans le marché privé du logement est considérée comme normale. Il est exceptionnel qu'un propriétaire, personne morale ou physique, soit condamné pour discrimination raciale. Il est de notoriété publique, lorsque vous êtes une personne de couleur, quel que soit le montant de vos revenus, que vous n'avez pas accès à un certain nombre de quartiers. Les agents immobiliers, qui connaissent les réalités, ont le courage de vous dire franchement : « Il est inutile de déposer un dossier, je ne vous trouverai rien, les propriétaires ne veulent pas de vous . » Personne n'est condamné et un véritable apartheid se met en place de cette manière.
Le logement social, au lieu d'être un moyen de tirer la sonnette d'alarme, n'a fait qu'amplifier le phénomène de « ghettoisation ». Au lieu d'interpeller les pouvoirs publics en attirant leur attention sur le fait que de plus en plus de demandes émanent de personnes qui pourraient habiter ailleurs, il a mis en place son propre mode d'organisation ethnique, car cela sert certains intérêts économiques. De manière un peu caricaturale, on peut dire que les personnes de couleur occupent les plus vieux quartiers, une population plus blanche, donc plus stable, occupant les nouvelles constructions.
Depuis trois ans, SOS Racisme, avec l'Union nationale des HLM et divers organismes HLM, mène un combat qui, pour l'instant, ressemble plutôt à un dialogue de sourds parce que ces organismes se refusent même à reconnaître la réalité de la concentration ethnique dans les quartiers, alors que c'est un problème qu'il me paraît important de traiter.
Une autre question tout aussi taboue est celle de l'économie parallèle et du trafic de cannabis. On n'en parle pas et lorsqu'on le fait, on se retrouve face à des gens qui, mille preuves à l'appui, vous expliquent que cela n'existe pas.
S'agissant du cannabis, je n'ai pas autorité pour m'exprimer sur l'aspect sanitaire de cette question et, de toute façon, c'est pour moi un faux débat. Si la prohibition de l'alcool a permis à une mafia très organisée de s'implanter dans un pays comme les Etats-Unis, le risque est grand de voir le même phénomène se produire en France. Peut-être faudrait-il agir avant qu'il ne soit trop tard ? Il serait quand même dommage que, dans dix ou quinze ans, la France en arrive à changer de politique sur ce terrain mais ait laissé faire des groupes qui auront pris pendant ce temps une telle puissance qu'ils diversifieront leurs activités criminelles. Il est encore temps aujourd'hui de leur couper les cordons de la bourse.
M. Bernard Plasait - Faudrait-il, selon vous, aller vers la dépénalisation ou pensez-vous à autre chose ?
M. Malek Boutih - La dépénalisation serait la pire des situations. D'un côté, on ferait tomber l'interdit moral sur la santé et, de l'autre, on laisserait subsister le trafic. La solution est donc évidemment la légalisation et la création d'un marché officiel tenu par l'Etat pour les consommateurs, ce qui ferait peut-être des revenus complémentaires pour s'attaquer à tout ce vaste chantier. Je ne suis pas un spécialiste de la question mais il me semble qu'elle ne peut pas être traitée comme elle l'a été dans les années soixante-dix. Le problème du cannabis n'est pas de savoir si c'est « cool » ou non de fumer. Le problème est le danger démocratique que représente actuellement ce marché. C'est une question très importante, une question politique taboue mais qu'il faut aborder.
Vous m'avez demandé quelles pistes pouvaient être explorées pour enrayer ces phénomènes de violence et de délinquance. Tout d'abord, une action coordonnée de reconquête sociale et policière du territoire à tous les niveaux est indispensable.
On devrait quadriller un quartier selon l'idée qu'un jeune ne doit pouvoir échapper à aucun des dispositifs, qu'il s'agisse de dispositifs policiers ou judiciaires, dans le cas d'un délinquant, d'un perturbateur ou d'une personne qui pratique la violence, ou qu'il s'agisse de dispositifs sociaux, éducatifs ou culturels.
Cette stratégie est indispensable parce que l'on voit bien les difficultés qu'ont les policiers à travailler dans ces zones. Il est quand même problématique, lorsque la police doit arrêter un petit voyou, de devoir faire appel à vingt-cinq hommes du RAID, tout simplement parce que, par les effets que je viens de décrire, se créent des solidarités complètement artificielles qui font que la police est confrontée, à ce moment-là, à cent ou cent cinquante jeunes.
Je ne doute pas de la volonté de l'actuel ministre de l'intérieur ni de la volonté de ceux qui l'ont précédé ou qui risquent de lui succéder mais il faut aussi voir les choses en face. Est-on vraiment prêt à prendre le risque de déclencher des émeutes, des affrontements physiques violents, à chaque arrestation dans les quartiers ? Il est nécessaire de trouver des solutions pour éviter que n'existe cette fausse solidarité et pour briser l'effet de meute.
Si l'on veut recréer de la responsabilité individuelle, ce qui est le grand problème, il faut donner le sentiment que chacun sera traité individuellement et que l'idée que tout le monde sera traité en groupe, que ce soit positivement ou négativement, a disparu. Désormais, ce sont des individus qui seront confrontés à la société. Il peut y avoir des groupes, des communautés, scolaires ou autres, mais ils devront être organisés dans le cadre de la démocratie. Il ne doit plus y avoir de bande.
Il est donc important de mener ce travail de reconquête de manière permanente et généralisée. Rien ne serait pire que de pratiquer une politique de saucissonnage en disant : on va commencer par quelques quartiers, puis, lorsqu'on aura le budget suffisant, on continuera. Il doit s'agir d'une action globale et massive tous azimuts.
Notre pays, par ses richesses, par l'expérience importante dont il est porteur, par sa machine administrative est capable de mener une telle action. L'école par exemple, quoi qu'on ait dit sur la crise qu'elle traverse, est une des rares choses qui ait résisté dans les banlieues. C'est un rempart et un très bon point d'appui pour les politiques qui pourraient être menées.
Enfin, il me paraît important d'aider les jeunes qui sont en voie de s'en sortir à aller plus loin, de sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés et de laisser une chance à ceux qui sont entre ces deux mondes et qui représentent les cas les plus difficiles.
Le débat sur l'enfermement des mineurs vise cette catégorie de jeunes. Doit-on prendre le risque de s'enfermer dans une logique qui les place ad vitam aeternam dans une éventuelle marginalité, ou doit-on leur laisser une chance ? Je pense qu'on doit leur laisser constamment une chance mais cette chance doit être parfaitement décrite. Elle doit se traduire par des actes, par un suivi très précis et par des engagements. Il faut donc reconstruire des politiques pénales à l'égard des jeunes.
La politique pénale telle que je l'ai vécue en tant que responsable associatif est relativement simple. Vue par les jeunes, c'est une succession de petites « emmerdes » et, un jour, c'est une grosse « emmerde ». Rien ne fait peur et surtout pas les sanctions intermédiaires parce qu'ils attendent la grosse sanction, qui sera le gros pépin, mais ils l'acceptent. Quand vous vous sentez complètement perdu, quand vous vivez dans une famille de pauvres, d'un certain point de vue, vous faites de la délinquance comme d'autres jouent au loto. Au loto, le risque que vous prenez, c'est de gagner. Là, le risque que vous prenez, c'est de perdre.
Lorsque, dans un quartier, un jeune décède de mort violente et que l'on discute avec les autres en leur disant : « tu vois ce que tu risques », on se rend compte que ces jeunes mesurent parfaitement ce risque. Pour eux, c'est la norme, c'est comme à la télé.
Il ne faut donc pas compter sur la peur du gros bâton. Il faut un suivi très serré pour les uns et des sanctions très fortes pour les autres. L'idée est que chacun doit se dire qu'individuellement il ne pourra pas échapper à l'un ou à l'autre de ces dispositifs. Dès la première fois où l'on est pris, l'alternative est la suivante : soit on tombe pour très longtemps, soit on veut s'en sortir mais il va falloir donner des gages de sa volonté de s'en sortir.
Tous les gosses doivent avoir une chance mais cette chance doit être très cadrée et exprimée très clairement dès le début pour que ce ne soit pas une fausse chance. Une partie du discours qui consiste à dire que l'on va laisser une chance de réinsertion aux jeunes recouvre en réalité une politique d'abandon de ces jeunes, parce qu'au fond c'est tellement difficile de s'occuper d'eux, de trouver des encadrants, des éducateurs.
Le fameux débat sur les centres fermés, c'est bien sympathique mais le problème c'est que, dans toutes les villes où il sera proposé de mettre en place ces centres, les habitants déposeront des pétitions parce qu'ils n'en voudront pas. C'est ainsi que la machine s'enraye parce qu'à chaque fois qu'on trouve une solution on se heurte à un nouveau blocage, d'où la nécessité de bien recentrer les choses et de mettre en place une mécanique extrêmement claire.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Dans votre livre La France aux Français ? Chiche ! , vous faites le constat qu'à Fleury-Mérogis les blancs sont minoritaires. Est-ce à dire que les acteurs de la police, de la justice et, d'une manière générale, les pouvoirs publics et les hommes politiques veulent stigmatiser telle catégorie de jeunes ? Ou existe-t-il une délinquance plus forte dans une certaine catégorie de jeunes issus de cultures différentes ?
M. Malek Boutih - Il y a une surdélinquance chez une catégorie de jeunes mais la raison n'est pas d'ordre culturel. La cause, c'est le ghetto. Ces jeunes, parce qu'ils sont enfermés dans un ghetto, ou qu'ils s'y sentent enfermés, ont une mentalité, des outils et des résistances psychologiques moins solides que n'en ont les autres. Ils n'ont pas la même vision que la société et sont donc plus sensibles à certains arguments. C'est une réalité et tout le monde en joue.
Imaginez que vous soyez un jeune qui habite la cité des Tarterets. Vous n'êtes pas un voyou, vous êtes un jeune comme les autres qui suit ses études. Mais au lieu d'aller au même lycée que vos copains, vous vous retrouvez dans un autre établissement où il n'y a pas beaucoup de jeunes des Tarterets. On commence à vous connaître, à savoir d'où vous venez et vos nouveaux copains, après vous avoir demandé s'il y avait du shit aux Tarterets, souhaitent savoir si vous pouvez leur en ramener. Quand vous n'allez jamais au café, lorsque vos copains de lycée y vont, parce que cela coûte trop cher, quand vous ne partez jamais en week-end pour la même raison, que vous n'allez jamais au cinéma lorsque vous avez rendez-vous avec une copine parce qu'une place coûte près de 10 euros, etc. et que vous pouvez gagner un peu d'argent discrètement, la tentation est grande.
Les autres aussi vous poussent à cela. Je ne dis pas que la responsabilité morale leur incombe, mais vous êtes dans une logique où vous vous dites que, là, est peut-être votre place. Vous êtes le mec de la cité qui est au lycée, c'est donc à vous de ramener le shit. D'ailleurs, beaucoup de jeunes des quartiers qui sont dans des voies de réussite scolaire font aujourd'hui du trafic de cannabis. Ils ne le font pas obligatoirement parce qu'ils en ont besoin mais parce qu'ils se disent que c'est leur rôle.
A terme, cela leur coûte souvent cher parce qu'un jour ou l'autre il y a un problème et que c'est déstructurant de faire ses études en étant trafiquant, même s'il s'agit d'un petit trafic. A ce moment-là, vous n'êtes déjà plus dans une logique d'effort ; vous n'en êtes plus à vous dire : « même si j'en bave aujourd'hui, demain, je m'en sortirai ». Vous n'êtes même pas dans une logique de révolte qui vous permettrait de vous surpasser, qui vous conduirait à devenir avocat, par exemple, pour combattre l'injustice. Non, vous êtes entre les deux et, rapidement, l'argent vous aspirant, vous basculez et, alors que vous aviez tout pour réussir votre bac, vous vous retrouvez en échec.
Beaucoup de raisons expliquent pourquoi il y a plus de « bronzés » que de blancs dans les centres de jeunes détenus, mais ce ne sont pas des éléments culturels ; ce ne sont pas des sourates du Coran ni leurs parents qui les poussent. Il faut même faire très attention dans les discours lorsqu'on insiste sur la responsabilité des parents. Que se passe-t-il lorsqu'on a des parents très sévères dans les quartiers ? En dernier ressort, quand ils n'en peuvent plus, ils mettent le gosse à la porte, donc à la rue. Les services sociaux ne peuvent pas s'occuper de ces enfants qui se retrouvent à la rue.
Par ailleurs, dans les familles d'immigrés, les enfants prennent très vite le pouvoir. Déjà, d'une manière générale en France, le rapport au savoir a tendance à s'inverser en raison des modifications technologiques, des nouveaux rapports urbains, et les jeunes générations ont parfois une meilleure connaissance que leurs parents de la société. Alors, chez les immigrés, imaginez !...
Dans ma propre famille, à l'âge de sept ans, je remplissais tous les papiers. Mon père signait le carnet scolaire sans savoir ce qu'il contenait et quand il me demandait mes notes, selon les trimestres, je lui montrais la colonne représentant la moyenne de la classe plutôt que ma propre moyenne.
Beaucoup de choses échappent aux parents, qu'il faudra peut-être aider. C'est une réalité qui a un sens politique. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, non pas seulement parce que j'ai un sens moral très aigu, mais parce que je pense qu'il existe actuellement un vrai danger de destruction pour toutes ces générations.
Je n'ai pas envie que les enfants d'immigrés, qui constituent ce que j'appelle la nouvelle génération de Français, deviennent les noirs américains de notre société, qui ne soient bons qu'à faire du sport ou des films et, pour le reste, passage par la case « prison ». Je sais que la vie est dure, que la société est dure, qu'il y a beaucoup d'injustice. Mais je ne crois pas que les comportements de violence aident à s'en sortir. A l'inverse, ces comportements structurent, organisent la violence et l'implantent définitivement dans la société. Il y a là une particularité qui s'appuie sur des ressorts politiques et des ressorts d'exclusion très importants et il est nécessaire d'avoir un discours très spécifique sur cette question.
M. Bernard Plasait - Je vous remercie pour la qualité vraiment exceptionnelle de votre propos. Vos dernières remarques en particulier m'ont beaucoup intéressé. Dans votre livre, vous demandez qu'il soit exigé des enfants d'immigrés les mêmes choses que vis-à-vis de tous les autres Français. Cela vous conduit-il à refuser absolument l'idée de discrimination positive ? Est-ce qu'au contraire vous pensez, comme l'écrivait récemment Yazid Sabeg, dans Le Figaro , qu'il faut faire de la discrimination positive ou même, comme Guy Sorman, qu'il faut faire de la discrimination positive sans le dire ? Pensez-vous que cela pourrait apporter en France un début de solution, même si cette discrimination n'était mise en place que pour une durée limitée ?
M. Malek Boutih - Il faut d'abord s'appuyer sur la tradition de notre pays et cesser de regarder du côté des autres nations. Quand on dit « discrimination positive », on pense à la politique américaine d' affirmative action . Or la France et les Etats-Unis ne sont pas des sociétés comparables. Elles n'ont pas les mêmes rapports ni les mêmes structurations. Il ne faut pas oublier que les Etats-Unis ont été un pays officiellement ségrégatif jusqu'au début des années soixante, que la population noire est le fruit d'une histoire très particulière, qui est celle de l'esclavage et que ce pays est fondé sur une forme de communautarisme.
Je suis complètement opposé à toute idée de quota sous une forme ou sous une autre. Si j'étais un peu provocateur, ce que je suis parfois, comme vous l'avez remarqué à propos du titre de mon livre, je dirais : pourquoi se contenter de 10 % dans une administration ou dans une rédaction et ne pas demander 50 % ou 100 % ? Comment la couleur des gens peut-elle se mesurer en pourcentage ? Cette idée de quotas est inapplicable et étrangère à l'esprit républicain.
La tradition française se fonde sur la notion d'égalité de tous les citoyens et ne doit pas prendre en compte des éléments spécifiques dans la vie quotidienne, dans les rapports juridiques, politiques, culturels qu'ont les citoyens au sein de la nation. Ce discours doit rester central, il doit rester celui de la responsabilité politique, publique, à tous les niveaux et faire partie de l'éducation dès le plus jeune âge. Cette notion d'égalité n'a jamais empêché la République d'avoir des pratiques inégalitaires ou promotionnelles quand elle souhaitait créer des conditions de modification du corps social en France et ce depuis la Révolution française.
Par exemple, quand Napoléon a créé les lycées en France, c'est parce qu'il souhaitait faire émerger, à terme, de nouvelles classes dirigeantes qui ne soient pas seulement issues de l'aristocratie mais qui soient des classes dirigeantes républicaines. Ces classes étaient ouvertes aux enfants de la bourgeoisie, aux fils des industriels mais elles n'accueillaient pas les enfants de la paysannerie, dont on ne s'occupait pas.
Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place une politique de promotion de la nouvelle génération de Français. Mais cette politique n'aura de sens que si l'on engage une réflexion collective sur ce qu'est l'identité nationale française. Se demander « qu'est-ce qu'être Français aujourd'hui ? », c'est se poser la question « qu'est-ce que la France ? ».
Il y a bien sûr les éléments structurels, républicains, mais il est nécessaire de dire autre chose, de dire que la France est diverse comme elle l'a toujours été. Il ne faut pas être trop théoricien. Il y a eu d'autres vagues d'immigration en France qui, toutes, ont trouvé le même chemin.
Une de mes analyses est que les enfants de l'immigration maghrébine se sont presque francisés plus vite que ceux d'autres populations immigrées venues pourtant d'Europe. Mais en réalité une différence quand même demeure. Le non-dit de la tradition française, c'est qu'auparavant les immigrés se fondaient dans la population, on ne les reconnaissait pas. Or, lorsqu'on n'explique pas aux gens ce que sont ces processus, que l'on n'assume pas cette diversité, une sorte de hiatus se produit autour du mot « intégration », hiatus d'ailleurs très intéressant.
En effet, le mot « intégration », pour la majorité de la population, signifie que petit à petit les immigrés vont disparaître, se fondre. Or cette population pense qu'il y a de plus en plus d'immigrés. Non, il y a de plus en plus de gens de couleur, aux cheveux crépus, qui en réalité sont des citoyens français.
De ce point de vue, une partie du vote extrémiste ou des comportements de crispation n'est pas seulement exprimée contre les voyous, même si ce n'est pas dit explicitement. Simplement, les gens ont les « boules » en voyant le mec qui conduit le bus ou celui qui est derrière le guichet de la sécurité sociale.
Un ami qui a récemment passé le concours de l'ENA m'a raconté que, lors de son stage à la préfecture de Marseille, ayant été placé pendant six mois au service de l'état-civil, il avait reçu une délégation de signature du préfet pour les passeports. Son nom « Moustapha X » figurait donc sur les passeports. Le dernier jour du stage, il est convoqué par le préfet, qui, après les félicitations d'usage, lui montre un carton dans lequel se trouvent tous les passeports renvoyés par ceux qui ne voulaient pas qu'ils soient signés par un Arabe.
Vous voyez que la réussite aussi provoque des réactions de crispation. Un énarque, ce n'est pas un voyou ! Ces réactions sont dues au fait qu'il n'y a pas eu de discours clair sur l'identité nationale et sur les conséquences de ces processus. Il ne faut pas prendre les gens pour plus imbéciles qu'ils ne le sont. Ils savent bien qu'il n'y a pas que des Zidane. Il faut également parler de la vie quotidienne. L'erreur serait de nier l'un ou l'autre de ces aspects ou de parler de n'importe quoi.
Ainsi, notre pays n'a pas à battre sa coulpe, il doit assumer son histoire. Quand on arrive dans une maison ou dans une famille, on doit tout assumer, les aspects négatifs comme les aspects positifs. A titre personnel, j'assume toute l'histoire de mon pays, y compris la guerre d'Algérie, et pourtant mon père a mené cette guerre du côté du FLN. Je ne suis pas favorable à ce qu'on aille devant un tribunal. Une histoire est faite de réussites et d'échecs, et c'est en retenant toutes les leçons qu'on avance. Ce débat doit donc avoir lieu et, une fois qu'il aura clarifié la place de chacun dans le pays et la construction commune d'une identité, on pourra sans difficulté mener des politiques promotionnelles pendant une certaine période, dans des administrations ou des entreprises publiques, car l'Etat doit jouer un rôle moteur en ce domaine.
Je me souviens d'un débat qui a eu lieu au ministère des affaires sociales sur la loi relative à la lutte contre les discriminations pour lequel étaient réunis des représentants du patronat, des syndicats, etc. Alors qu'il était question de lutter contre la discrimination, lorsqu'on regardait la composition du cabinet ministériel, on s'apercevait qu'il y avait des progrès à faire... Dans beaucoup d'endroits où je me rends, y compris le ministère des affaires sociales, je constate que les gens de couleur arrivent très tôt et qu'ils sont là pour faire le ménage.
Une dynamique, une pédagogie sont nécessaires mais il faut d'abord clarifier le fond. Il faut créer une dynamique dans certains secteurs. On a commencé à le faire dans la police mais je crois qu'en matière de médias le service public a une responsabilité plus importante. Je suis prêt à parier, si l'on faisait une étude, que ce n'est peut-être pas dans le service public de la télévision que cette nouvelle génération est le plus représentée.
On peut imaginer de créer une politique inégalitaire non pas seulement par l'apparition physique de quotas. A propos de la reconquête des quartiers, j'ai parlé de l'enjeu éducatif. On peut peut-être accepter de temps en temps de sacrifier la sacro-sainte égalité au sein de l'école dans certaines zones en y investissant beaucoup de moyens, en ouvrant des classes de vingt élèves au maximum, par exemple. N'en tirons pas une leçon, n'en faisons pas tout de suite un grand débat national. Lorsqu'on aura agi là où c'est nécessaire, on pourra se demander si c'est bien pour le pays tout entier mais c'est un autre débat.
Certains pensent que notre pays vit une décadence historique. Je pense au contraire que la République, par sa spécificité politique et sociale en tant que mode d'organisation d'un pays, fait qu'à l'épreuve de la mondialisation nous sommes probablement les seuls qui soyons capables d'inventer un modèle cohérent dans un monde en mouvement et d'en faire une force pour notre pays, dans sa dynamique sociale, culturelle, économique, politique et même de sécurité, à l'échelle internationale. C'est donc une tout autre vision qu'il faudrait développer avant que puisse émerger un certain niveau politique.
M. le président - Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition de M. Renaud TROUVÉ,
pharmacologue
(29 mai 2002)
Présidence de M. Bernard PLASAIT, Vice-président
M. Bernard Plasait, président - Nous accueillons maintenant M. Renaud Trouvé, pharmacologue et spécialiste des questions de toxicologie.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
Docteur, nous avons souhaité vous entendre, car nos auditions et déplacements nous ont montré que les jeunes délinquants étaient souvent dans un état sanitaire déplorable et, notamment, qu'ils étaient fréquemment dépendants du cannabis. Il nous a paru important d'approfondir cette question.
Je vous donne donc la parole, docteur, pour un exposé liminaire qui sera sans doute suivi de nombreuses questions.
M. Renaud Trouvé. Avant d'en venir à la question du cannabis, je souhaiterais évoquer de manière plus générale les problèmes de délinquance et de toxicomanie.
Tout d'abord, comment devient-on délinquant ? Vu sous l'angle de la toxicomanie, on le devient tout simplement par non-respect de la loi de 1970, qui est toujours en vigueur, par les consignes laxistes données par certains gardes des sceaux quant à l'application de cette loi, quand il y a défaut de suivi, en cas d'interpellation d'un toxicomane et d'injonction thérapeutique par un juge.
Au cours des dernières années, beaucoup de gens ont protesté en disant qu'il ne fallait pas emprisonner ceux qui consommaient du cannabis. Il est toutefois prévu par la loi que ces personnes doivent se soumettre à un contrôle thérapeutique, ce qui est rarement le cas. En effet, l'articulation entre justice et médecine n'existe pas ou est d'un laxisme total. Il est d'ailleurs surprenant que, dans d'autres domaines, on arrive à suivre parfaitement certaines affaires judiciaires jusqu'à leur épilogue et jusqu'au paiement du dernier centime de l'amende infligée et que l'on n'arrive pas à suivre la trace d'un délinquant qui s'est adressé à un médecin. Il y a là un dysfonctionnement. Soit dit en passant, c'est le début d'un engrenage qui entraînera les gens vers ces états potentiellement de délinquance et de délabrement social et sanitaire.
Au cours de ces dernières années, beaucoup de voix se sont élevées pour demander l'abolition de la loi de 1970. C'est un aspect paradoxal de la question puisque, hormis durant une très courte période où Albin Chalandon était garde des sceaux, cette loi n'a jamais été vraiment appliquée sur le fond et encore moins respectée dans la forme. Faut-il revoir cette loi ? Nous en reparlerons mais encore faudrait-il simplement qu'elle soit appliquée. Peut-être peut-on, plus de trente ans après son adoption, envisager de la toiletter.
Que consomment les délinquants dans ce pays ?
Il existe des consommations très disparates et très variées de haschich et de ses dérivés, donc de cannabis, consommations qui, du point de vue de la santé publique, posent un problème de fond.
La consommation de tabac peut être considérée en France comme en forte augmentation et potentiellement catastrophique pour la santé publique. Une étude récente a montré que les effets de la consommation du tabac par les jeunes femmes commençaient à se faire sentir de façon évidente. C'est une question qui doit interpeller le corps médical.
La consommation d'héroïne est tout à fait sous-estimée. Certains affirment qu'elle concernerait 100 000 à 150 000 personnes. A l'heure actuelle, il semble plutôt que près de 300 000 personnes soient concernées.
La consommation et le trafic, puisque les deux aspects sont toujours très proches, de produits comme l'ecstasy et les amphétamines sont une autre forme de délinquance qui est apparue brutalement sur le sol français -dieu sait si nous avions alerté les autorités politiques, notamment les parlementaires, voilà cinq ou six ans, sur ce danger. Cette apparition brutale est due au fait que les Britanniques, qui avaient chez eux 1,5 million de consommateurs ont commencé à se fâcher. La solution de facilité fut évidemment d'aller faire chez le voisin le trafic qu'il devenait difficile de faire sur le territoire habituel.
Le niveau de consommation de cocaïne est plus élevé qu'on ne l'admet généralement. Il suffit de se promener dans certains quartiers du nord de Paris ou de la banlieue Nord pour constater à la fois l'énervement des populations, le délabrement des toxicomanes et le nombre important de consommateurs.
Un certain nombre d'autres drogues circulent qui font partie d'un trafic de fond accompagnant toutes les substances dont je viens de vous parler.
Comment entre-t-on dans la délinquance et la toxicomanie ? En dehors des aspects sociaux et culturels auxquels il ne faut pas prêter toutes les vertus ni toutes les culpabilités, il est évident que certains quartiers sont préférentiellement des lieux de drogues et de délinquance, des lieux d'approvisionnement, un peu moins des lieux de consommation.
L'entrée en toxicomanie peut se faire de diverses façons : par les amis et les fréquentations ; par - c'est aujourd'hui un grand problème - l'école, le collège, le lycée - je ne parle pas de l'université ou des grandes écoles, car, là, c'est bien souvent trop tard ; par la famille, car nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème éducatif à travers l'attitude des parents qui font preuve de permissivité à l'égard de consommation de certains produits ou, à tout le moins, minimisent le risque sanitaire de cette consommation ; par le milieu sportif, car il ne faut pas oublier que la toxicomanie et le dopage sont deux choses extrêmement voisines qui s'imbriquent malheureusement quelquefois dans la carrière de certains athlètes même du meilleur niveau ; enfin, cette entrée en toxicomanie peut se faire à travers des fréquentations carcérales ou autres.
Bien sûr, nous avons deux types de délinquance : la première, qui est simplement liée à l'usage ; la seconde, qui est liée aux trafics et qui est plus grave, car elle fait vivre des réseaux constitués. Grâce aux revenus considérables qu'elle permet d'accumuler, elle finance d'autres activités du type achat ou trafic d'armes et autres actes délictueux.
On ne peut qu'être étonnés de la non-intervention de la République dans certains endroits. Même le fisc ne se soucie apparemment pas du train de vie de certains jeunes de vingt à vingt-cinq ans qui circulent dans des voitures comme celle qui a défrayé la chronique voilà quelques jours. Pour ma part, si j'oubliais de déclarer mes revenus, je suis persuadé que le fisc saurait me retrouver ! Il y a de toute évidence un laxisme face à cette économie souterraine alimentée par une multitude d'actes délictueux.
Je partage l'opinion de mon prédécesseur à cette place. Le tout-répression ne fonctionnera pas pour la simple raison que les résultats seront proportionnels aux forces en place sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que tout progrès sera le bienvenu, surtout compte tenu des activités dérivées. J'ai fait la triste expérience d'échanges à coup d'armes à feu voilà quinze ans aux Etats-Unis alors que je sortais de l'hôpital. Ce genre d'affaire jusque-là rare dans notre pays commence à apparaître chez nous et devrait nous inciter à reprendre en main certains problèmes.
Si la faillite du système éducatif en matière d'instruction n'est pas clairement établie, elle est indéniable en matière d'éducation. Je le dis nettement et je sais que je ne suis pas le seul à le penser : je regrette l'époque où la journée à l'école primaire commençait par la phrase de morale prononcée devant le tableau. La référence peut paraître ridicule mais c'est à ce moment-là que se forme le discernement des futurs adolescents et adultes. En outre, faute de pouvoir s'appuyer sur l'école, les parents n'ont pas retrouvé leurs repères.
Quant à l'information dans les écoles, collèges et lycées sur la toxicomanie dans une optique préventive au cours des dix dernières années, il n'y a vraiment pas lieu d'en tirer gloire. La semaine dernière encore, une professeur de sciences biologiques en terminale me disait : « Monsieur Trouvé, le petit livre qui a été publié avec l'argent de la République est d'un niveau lamentable et c'est un scandale ! ».
Le spécialiste que je suis partage ce point de vue. Et je m'étonne qu'on continue à solliciter les mêmes spécialistes qui continuent à écrire les mêmes âneries ! A dire vrai, je ne m'en étonne même plus, car je sais que cette situation est liée à un mode de fonctionnement : alors que les responsables se succèdent, les administratifs restent en place. Messieurs, balayage ! Pour changer de politique, il faut changer les gens !
Je fais un parallèle avec la situation que j'ai connue aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années. Si je pense, comme mon prédécesseur, que les structures sociales y sont extrêmement différentes, je sais aussi, en tant que pharmacologue, que la diffusion d'un certain nombre de produits sur une population humaine parvient toujours aux mêmes résultats.
Je m'étonnais de la permissivité de la société américaine des années quatre-vingt à l'égard de la consommation d'alcool et de cannabis. Pour avoir longuement discuté avec quelques-uns des jeunes qui étaient mes élèves à l'université, je me suis aperçu à quel point il leur était difficile non seulement de savoir ce qu'était la loi mais aussi de discerner le bien du mal, y compris pour eux-mêmes, pour le respect de leur équilibre et de leur libre arbitre que la consommation de certaines substances fait très souvent disparaître. Donc, si la répression est une technique, la formation et l'éducation comptent aussi.
Je le dis très clairement, je ne profite pas de la tribune pour régler mes comptes. Vous vous souvenez très certainement du rapport de M. Roques, qui est l'un de mes collègues de la faculté de pharmacie. A la demande du secrétaire d'Etat à la santé, M. Kouchner, il avait rédigé une analyse scientifique destinée à « comparer la dangerosité des drogues ». Peut-être savez-vous que peu de temps après, quelques scientifiques de bon aloi lui ont répondu dans les colonnes du Figaro .
J'ai en main copie de la lettre qu'il leur a envoyée. Je vais vous lire un passage qui interpelle : « Cannabis et conduite des véhicules », signé par M. Roques.
« Les effets comportementaux du cannabis, en particulier la somnolence et le ralentissement des comportements moteurs, ont conduit à étudier leur retentissement en termes de conduite des véhicules. Les résultats sont difficiles à interpréter du fait de l'association pratiquement constante chez les conducteurs responsables d'accidents pour lesquels les examens ont été exigés de plusieurs produits, le plus fréquent étant l'alcool » -ce n'est pas niable. « Utilisé seul, le cannabis ne semble pas être un facteur majeur de risque d'accident. »
Que fait-on quand on lit pareil écrit signé d'un professeur en faculté de pharmacie ? Il y a eu des enquêtes du samu. Une conférence s'est tenue à l'Assemblée nationale sur le thème « conduite et cannabis ». Bien sûr, on retrouve des associations cannabis-amphétamines et cannabis-alcool. Il n'empêche que M. Roques ne pouvait ignorer les expériences médicales publiées dans des revues scientifiques internationales.
Je crois que l'information faite au cours des dix dernières années n'a pas été suffisamment claire pour mettre en alerte les parents, les éducateurs et les adolescents. Peut-être une information et une prévention bien conçues parviendraient-elles à être dissuasives.
Il est un principe très simple en pharmacologie qui se vérifie toujours : quand une drogue toxicomanogène est disponible, elle est consommée. En santé publique, nous avons déjà à déplorer les dégâts faits par l'alcool, drogue légale, par le tabac, drogue légale. Dépénaliser n'est pas une solution.
A la lumière de certaines expériences pratiquées en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas et ailleurs, je regrette de constater que la mise à disposition légale de ce genre de produits contrôlés par l'Etat ne fait pas disparaître le risque. D'ailleurs, dès 1986, le département d'Etat américain avait parfaitement compris que quel que soit l'état de la législation, dès lors qu'il y a de l'argent à gagner, le trafic a lieu. Je serais au passage curieux de voir comment s'y prendrait l'Etat pour distinguer - challenge intéressant ! - le cannabis légal du cannabis illégal.
En outre, le cannabis est une substance beaucoup plus dangereuse que le tabac - j'ai les moyens de le prouver. Je ne le comparerai pas à l'alcool. Pourquoi lutter contre le typhus et le choléra et réintroduire un problème supplémentaire à terme ? Il est du rôle d'une République de veiller sur la santé de ses citoyens et d'éviter de s'auto-accuser vingt ou trente ans plus tard en gémissant sur le thème : « Je ne savais pas ». Messieurs, nous savons !
M. le rapporteur - Pour revenir sur le cannabis, ne fait-on pas une erreur de sémantique en l'appelant « drogue douce », alors que cette substance reste une drogue avec des effets extrêmement nocifs ?
M. Renaud Trouvé - Votre remarque est tout à fait pertinente. Au-delà des effets agréables d'euphorie transitoire et autres états d'âme ressentis par les consommateurs, cette drogue perturbe de façon très puissante le fonctionnement mnésique. Elle provoque à long terme une atteinte sur la mémorisation qui est absolument dramatique. D'ailleurs, tous les utilisateurs le reconnaissent.
En outre - et de ce point de vue, je fais le parallèle avec l'alcool - cette drogue crée une distorsion spatio-temporelle qui ralentit les réflexes nerveux et provoque surtout un mauvais jugement quant au décours du temps. Si M. Roques avait lu le récit des expériences pratiquées sur les pilotes d'avions, il saurait que ces professionnels entraînés sont incapables de faire des atterrissages corrects car ils sont incapables de juger le temps.
Encore faut-il ajouter - c'est bien connu - des effets pulmonaires au moins égaux à ceux du tabac et des effets cancérigènes a priori plus puissants que ceux qui sont provoqués par les plus mauvais tabacs - rassurez-vous, je ne citerai pas de marque !
Avec la consommation de cannabis, une dépression de l'immunité est clairement avérée.
Cette substance a des propriétés contraceptives parfaitement naturelles et auto-établies. Il suffit à cet égard d'observer les groupes de sujets soumis à des essais cliniques : pas la moindre naissance, alors qu'aucune précaution n'a été prise.
En 1973, deux cardiologues américains ont clairement pointé certains effets de cette substance « anodine » au vu d'un test d'effort pratiqué sur des personnes présentant un risque d'infarctus du myocarde. Au cours de l'expérience témoin, les sujets pédalaient pendant 250 secondes. Après avoir fumé une cigarette contenant une quantité de nicotine dix fois supérieure à celle d'une cigarette normale, ce temps était réduit de 25 %. Après avoir fumé une seule cigarette de cannabis qui contenait vingt milligrammes de THC, leur résistance à l'effort était diminuée de plus de moitié. La comparaison avec d'autres produits ne fournit donc pas des résultats aussi favorables que certains écrits ont bien voulu le laisser penser.
Pour aller dans le sens de votre propos, il est clair qu'à l'heure actuelle, le nombre de psychoses cannabéiques apparues lors d'une consommation tout à fait normale est en forte augmentation.
En tant que pharmacologue, j'ai toujours refusé la distinction drogue douce drogue dure, qui ne veut rien dire. Il n'y a que des drogues avec des propriétés particulières. Boire cinq verres de vin va rendre la personne temporairement incapable de conduire son véhicule. Mais les effets ne dureront pas très longtemps. La demi-élimination de l'alcool chez la plupart des sujets est de l'ordre de deux à trois heures alors que la demi-élimination du cannabis est de quatre-vingt seize heures, soit quatre jours.
Je crois qu'il faut être très prudent. Certaines drogues comme la cocaïne et l'héroïne peuvent tuer instantanément. Avec le tabac, l'alcool et le cannabis, il y a risque, à une autre échelle certes, mais tout aussi, voire plus, important en termes de santé publique. L'impact sera proportionnel à la multiplication du nombre de consommateurs.
Le plus grand progrès serait de laisser une trace dans le système. Il ne s'agit pas de marquer au fer rouge les consommateurs de cannabis ou d'autres produits. Mais à partir du moment où une injonction thérapeutique est faite à certaines personnes, il est clair que la consommation de produits reste dans le cadre prévu par la loi. Ces personnes ont besoin d'une prise en charge par un système médical adéquat.
Je milite pour l'introduction dans la loi d'une obligation de suivi. Si un fléché était prévu, cela rendrait service à la justice, qui pourrait dialoguer avec les médecins dans de meilleures conditions.
M. Bernard Plasait - Pourriez-vous revenir sur l'expérience concernant les pilotes d'avions ?
M. Renaud Trouvé - Deux études ont été pratiquées aux Etats-Unis en 1985 sur des volontaires, pilotes professionnels - j'insiste sur ce point - auxquels on a fait fumer soit une cigarette de tabac, soit une cigarette de marijuana conforme au standard expérimental américain des années quatre-vingt.
L'expérience s'est décomposée en deux phases. D'abord, le vol avec simulateur dans des conditions tout à fait calmes. Les pilotes se sentaient à peu près bien, même s'il y avait des petites erreurs. Ensuite, on a créé des conditions artificielles de mauvais temps, des turbulences et une simulation de trafic, autant d'éléments de pression. C'est à ce moment-là que sont apparus nettement les désordres spatio-temporels provoqués par le cannabis.
On a constaté deux choses : premièrement, tous les pilotes qui avaient fumé du tabac ont posé leur avion à quelques dizaines de centimètres de la ligne centrale de la piste simulée. Les pilotes qui avaient fumé une toute petite dose de cannabis, eux, ont posé leur avion entre six et quinze mètres de la ligne centrale. Ce seul résultat interpelle.
Deuxièmement, que fait apparaître la trajectoire de descente ? Quand il est en approche, un pilote aux instruments met son avion à une certaine vitesse et gère son altitude en pilotant au moteur.
Un pilote parfaitement conscient qui commence à dévier de son axe surveille son instrumentation pour voir les effets produits par sa correction. Il ne réintervient que si au bout d'un certain temps, il estime que sa correction a été trop puissante ou insuffisante.
Or, les pilotes sous l'emprise du cannabis avaient un comportement tout à fait caricatural. Ils réintervenaient de façon intempestive sans attendre l'effet de leurs corrections. La perturbation spatio-temporelle créée par le cannabis est une réalité flagrante.
M. le Président - Monsieur le Professeur, nous vous remercions.
Audition de M. Philippe NOGRIX,
représentant l'Assemblée des départements de
France
(29 mai 2002)
Présidence de M. Jean-Pierre SCHOSTECK, Président
M. Jean-Pierre Schosteck, président - Nous accueillons maintenant M. Philippe Nogrix, représentant l'Assemblée des départements de France.
(Le président lit la note sur le protocole de publicité des travaux de la commission d'enquête et fait prêter serment.)
M. Philippe Nogrix - Vous avez demandé aux présidents de conseils généraux de répondre à six questions.
Question n° 1, le bilan, les préconisations et les novations dans le domaine de la prévention spécialisée, qui est de la compétence des conseils généraux.
Les prémices de la prévention spécialisée sont apparues dans les années cinquante, à titre privé. A l'origine, ce sont des associations de parents confrontés à des problèmes avec leurs adolescents qui se sont regroupées.
En 1972, il y a eu une officialisation et une prise en compte de l'éducation spécialisée sur des principes de base qui continuent à être requis aujourd'hui : une action éducative sans mandat administratif ou judiciaire, avec une libre adhésion et un respect de l'anonymat.
Les conseils généraux ont acquis la compétence par la loi particulière de janvier 1986. Pour ce faire, ils ont décidé en grande majorité de donner délégation aux associations qui assuraient cette mission et avec lesquelles ils ont passé convention. Comme la loi le leur imposait, ils leur ont attribué les moyens de remplir leur mission.
Quelques départements ont créé des services départementaux. Mais il est inutile d'insister ici sur la grande diversité des départements français. Chacun a son histoire, chacun a sa culture, chacun vit dans un milieu particulier.
Le public dont nous avons la charge, ce sont les jeunes de dix à vingt et un ans. Cette démarche, que l'on peut qualifier d'éducative de proximité, nous essayons de la mettre en cohérence avec l'ensemble des actions socio-éducatives que nous conduisons. Elle s'inscrit dans un cadre de plus en plus fréquemment écrit, qui est la référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer ; je veux parler des schémas départementaux de protection de l'enfance. Les conseils généraux élaborent de plus en plus des projets sociaux départementaux qui déclinent la façon dont les procédures sont mises en oeuvre et décrivent l'évaluation des résultats.
S'agissant du bilan des actions qui sont mises en oeuvre dans les départements, force est de reconnaître qu'il est assez mitigé. Cela fonctionne plus ou moins bien selon les départements. On sait que le manque de stabilité économique, la situation inquiétante du chômage déstabilisent beaucoup les jeunes.
Quand ils ne trouvent pas leur place dans la société, ils ont tendance à se marginaliser soit en consommant de l'alcool, des produits stupéfiants ou des drogues, soit en exprimant par une certaine violence leur refus de la société.
Aujourd'hui, dans les quartiers les plus durs s'est mise en place une organisation de plus en plus efficace pour nuire à la société par des vols ou des dégradations. Tout commence par des incivilités : agressions verbales, jets de pierres ou de cailloux sur les carrosseries des voitures... Des trafics en tous genres s'organisent, notamment dans les sous-sols des HLM, dans les friches industrielles ou artisanales.
Il nous faut réagir contre certains éléments du bilan qui nous paraissent très inquiétants. Comment faire ? Ce que nous aimerions bien, c'est pouvoir sortir du principe de la libre adhésion du jeune et de l'anonymat.
Pourquoi cela ? Parce qu'il nous semble important de faire comprendre au jeune que, de temps en temps, il a besoin de recevoir certaines instructions lui indiquant la direction à suivre. Il faut l'obliger à adhérer à un contrat de « remise dans les clous ». Et cela, pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire sans l'accord du jeune. Nous sommes obligés de le laisser venir voir l'équipe de prévention quand il veut bien le faire. Mais nous ne pouvons pas l'y contraindre tant qu'il n'y a pas de mesure judiciaire.
Nous aimerions permettre l'établissement d'un contrat d'objectifs que chaque jeune aurait à atteindre, contrat prédéfini avec son éducateur spécialisé, bilans d'étapes à l'appui.
Nous réclamons une commande claire des actions à mettre en oeuvre sur un territoire bien délimité. Dans l'état actuel des choses, le président du conseil général doit définir chaque année les territoires sur lesquels ses équipes spécialisées vont intervenir. Nous préfèrerions que ce soient les villes qui définissent la commande, et ce sur un mode beaucoup plus territorialisé.
Nous souhaitons donc la mise en place de partenariats inter-institutionnels basés sur la confiance et le respect, partenariats passés avec la PJJ, avec la police ou avec les services des villes puisque le recours aux contrats de ville est de plus en plus fréquent.
Question n° 2 : le bilan de la PMI et son utilité psychosociale.
Il nous semble important d'insister sur le fait que cette compétence qui nous a été donnée dans le cadre de la loi du 18 décembre 1989 est capitale en matière de prévention précoce. C'est à travers les services de PMI dans les départements qu'on peut, dès le départ, commencer un travail social pour éviter qu'apparaissent des précarisations et des marginalisations.
Cette structure nous permet d'intervenir dans les familles à des moments très précis pour essayer de les ressouder. C'est ainsi que lors de leur grossesse, les femmes sont très réceptives. Elles ont besoin de conseils, notamment pour leur suivi-santé. Lorsqu'elles ont été bien conseillées, soit en prénatal, soit en posnatal, elles acceptent volontiers un suivi des enfants jusqu'à l'âge de six ans.
C'est un suivi des populations qui intervient vraiment à titre préventif. La PMI est peu connue en dehors du microcosme des conseils généraux, mais nous réclamons ce domaine de compétences qui est pour nous capital.
Notre intervention se situe à trois niveaux : conseil, dépistage et actions.
Conseil aux jeunes mères qui, hélas, de plus en plus souvent, ne savent pas ce qu'est la maternité, ce qu'est la prise en charge d'un enfant en bas âge. Les conseils généraux font un travail très important à cet égard. Le planning familial est un moment privilégié du conseil à la jeune adolescente qui commence à devenir une femme et qui, bien souvent, ignore son devenir et les risques qu'elle encourt parce que les choses ont été banalisées sans être expliquées.
Dépistage : la PMI nous permet de faire des bilans de santé dès la maternelle pour les troubles auditifs et visuels ou les difficultés de langage. On reproche à l'Education nationale de laisser sortir un pourcentage relativement important de jeunes qui ne savent pas lire, écrire et compter. Il est vrai que si aux handicaps familiaux s'ajoutent des handicaps physiques, quels que soient les efforts du système éducatif, il ne parviendra pas à tout contrôler. C'est la raison pour laquelle le bilan de santé dès la maternelle me paraît essentiel. J'ai souvent eu l'occasion de dire que je regrette la disparition du service militaire, qui était le moment privilégié pour faire le bilan de santé de la nation.
Actions : les services départementaux pratiquent des visites à domicile avec des médecins, des infirmières, des assistantes sociales pour mettre en place le plus rapidement possible un accompagnement en vue d'éviter la précarisation.
Le conseil général pratique également des actions de formation. Il a l'obligation de donner une formation de base aux assistantes maternelles agréées. Ce sont des professionnelles qui accueillent des enfants déplacés momentanément de leur famille soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons d'hygiène, soit pour des raisons de placement judiciaire.
Le bilan de la PMI est en général relativement correct sur l'ensemble du territoire. C'est un très bon observatoire du potentiel de la nation et de son état sanitaire.
Ce que nous aimerions, c'est élargir le champ d'intervention des départements. On s'aperçoit en effet qu'à la sortie de l'école primaire les enfants, bien souvent, ne sont plus suivis au niveau médical. Les départements étudient actuellement la possibilité d'un accompagnement médical jusqu'à la fin du collège, structure qui relève de leur compétence.
Il faut assurément renforcer les partenariats. Nous vivons l'époque de la mise en place des réseaux réactifs. Je souhaite que nous arrivions très vite à nommer, pour chaque action sur le terrain social, un chef de file bien identifié. Animateur de réseaux, ancré dans une approche la plus globale possible, il lui appartiendra de développer les rencontres entre les familles et les intervenants du champ socio-éducatif que la déresponsabilisation des parents rend indispensable.
Nombre de départements pratiquent des cercles d'écoute, des cercles de parole qui réunissent, sur la base du volontariat, des mères et des pères de famille. La discussion a lieu en présence d'un professionnel qui n'intervient qu'en cas de dérapage. En général, cela marche très bien. Il importe de développer ce genre de rencontres.
Question n° 3 : comment voyons-nous l'articulation avec la PJJ ? Il y a incontestablement des points forts et des points faibles. Actuellement, la protection de l'enfance comporte deux dispositifs : le dispositif administratif, qui dépend des conseils généraux et le dispositif judiciaire, qui dépend du juge des enfants. Dès lors qu'il est fait appel au dispositif judiciaire, il y a signalement, qui aboutit bien souvent à un placement, puis à un suivi.
Les signalements sont devenus de plus en plus nombreux de la part de l'Education nationale et des travailleurs sociaux. En effet, des éducateurs qui travaillaient avec des familles sous la forme contractuelle se sont vu reprocher de ne pas avoir pratiqué le signalement au pouvoir judiciaire et ont été condamnés. Ils ont donc maintenant tendance à signaler les choses dès que la déstabilisation commence.
Je crois nécessaire d'établir des partenariats beaucoup plus étroits entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif des départements. J'appelle à la concertation, à l'harmonisation des pratiques, à la définition de procédures complémentaires autour d'un partenariat basé à la fois sur la confiance, le respect et l'acceptation des procédures des uns et des autres.
Premier poste budgétaire du département - la moitié du budget est consacré au secteur social et, sur cette enveloppe, 40 % revient à l'aide sociale à l'enfance - l'aide sociale à l'enfance devra rester le domaine social prioritaire du département. C'est véritablement le coeur de métier des conseils généraux qui tiennent à garder ce leadership tout en s'attachant à rechercher une meilleure articulation avec le pouvoir judiciaire.
J'en viens au bilan de l'action, qui comporte deux versants totalement différents, le versant préventif et le versant curatif. Le versant préventif est moins perceptible de l'extérieur puisqu'il s'agit d'une aide directe aux familles. Si une relation s'élabore entre la famille et le travailleur social, c'est en vue d'une prise en charge globale des enfants et pour faire comprendre aux parents qu'ils ont un rôle à multiples facettes à remplir.
Le versant curatif est le domaine de l'autorité judiciaire. L'enfant fait l'objet, soit de mesures de placement, soit de mesures d'aide éducative en milieu ouvert. Il faut réorganiser les choses pour mettre un terme à la concurrence néfaste entre les procédures de l'aide sociale à l'enfance et l'intervention judiciaire.
Cette amélioration passerait par la rédaction par le Conseil général, conjointement avec l'autorité judiciaire, de schémas départementaux de plus en plus nombreux. La situation évolue tellement vite dans les quartiers que nous avons absolument besoin d'un observatoire des enfants en danger. Il faut une volonté commune, une réflexion conjointe entre l'ADF et le ministère de la justice.
Question n° 4 : quelle est notre position vis-à-vis des contrats, contrats de ville conclus avec la CNAF et l'Education nationale ?
L'ADF est le promoteur de ce genre d'actions. Nous avons un travail important à accomplir pour mieux définir dans les départements le cadre de la prévention spécialisée et pour bien positionner le département dans le fait urbain, phénomène que les uns et les autres avons découvert récemment et qui n'est pas facile à traiter.
Il faut absolument que le partenariat technique et financier soit très imbriqué dans les actions. Actuellement, nous travaillons beaucoup avec la Caisse des dépôts et avec la délégation régionale à la ville pour engager très fortement les départements - qui le sont déjà mais peut-être pas suffisamment - dans le domaine de l'insertion comme dans le domaine de l'éducation. Pour ce faire, nous avons choisi d'expérimenter sur dix-huit sites la mise en valeur des projets sociaux de territoires : chacun de ces territoires urbains fait l'objet d'une étude au terme de laquelle tous les partenaires sociaux vont élaborer ensemble un projet social.
Question n° 5 : préciser la manière dont sont réalisées les évaluations.
Les évaluations ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des schémas de référence. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la mise en place de schémas départementaux, de projets sociaux de territoire et de chartes de qualité pour permettre la comparaison des procédures et des résultats des actions entre éducateurs du milieu judiciaire et éducateurs du département.
Question n° 6 : faut-il modifier les règles de financement des établissements d'hébergement accueillant les mineurs en danger, voire les mineurs délinquants ?
Cette question difficile est indissociable de toutes les autres. Il est bien évident que nous souffrons d'un manque d'établissements adaptés au monde moderne. Nous traitons le problème des enfants retirés de leur famille de la même façon qu'après la guerre : d'un côté, les familles d'accueil, de l'autre côté, les établissements.
Une réforme s'impose mais elle tarde, chacun attendant que l'autre la fasse. Nous avons besoin d'établissements d'accueil médicalisés car les établissements sont trop tournés vers l'éducatif, de sorte que les pratiques à la sortie sont très reproductives. Faute d'avoir été traités sur le plan médical, les jeunes sortent en apparence plus équilibrés mais ils reproduiront à un moment ou à un autre ce qu'ils ont vu dans leur famille.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur - Le département deviendrait la collectivité pilote, notamment pour tout ce qui concerne le placement, qu'il soit de type social ou de type judiciaire. Seriez-vous prêt à aller plus loin et à prendre en charge des placements de type pénal ?
Vos avez dit qu'il serait intéressant de suivre la santé des jeunes au moins jusqu'au collège. Englobez-vous le côté sanitaire et le côté social dans le terme « santé » ? L'expérience de l'étranger a montré que, quand les signaux d'alerte sont décelés très tôt, on évite aux jeunes de sombrer dans la délinquance.
M. Philippe Nogrix - En ce qui concerne le département référent, monsieur le rapporteur, nous sommes prêts à aller jusqu'au traitement pénal. Simplement, nous savons très bien que tout ce qui touche le social ne peut se faire avec une révolution interne, il faut que ce soit une évolution acceptée, une évolution partagée.
Par conséquent, monsieur le rapporteur, je vous réponds : oui, d'accord, mais sous certaines conditions de partenariat et, notamment celles que j'aime toujours bien rappeler de respect et de confiance.
Sur le plan financier, je pense qu'il faudra aussi être très attentif car vous savez que notamment avec la mise en place de l'allocation pour les personnes âgées, les départements vont se trouver très fortement grevés.
Il faut donc bien faire attention qu'au moment où l'on va faire glisser certaines compétences, on veille aussi à faire glisser les moyens.
Par ailleurs, s'agissant du suivi des jeunes sur le plan de leur santé, il est bien évident que nous sommes également prêts : j'en veux pour preuve la réflexion que nous avons entamée puisque c'est nous qui les premiers avons évoqué ce point à l'Assemblée des départements de France. Bien évidemment les présidents de conseils généraux ne sont encore pas tous d'accord, il y a en a même qui ne le sont pas du tout.
Ce suivi nous paraît pour notre part primordial et nous sommes prêts à le poursuivre non seulement au niveau social -nous en avons l'habitude - mais également au plan sanitaire - nous saurons y mettre les moyens, car il nous semble que c'est là la première des préventions.
Très souvent en effet, on parvient à déceler d'éventuelles dérives vers la délinquance à travers l'état de santé et le comportement des individus. Ainsi, quand on voit un jeune qui commence à s'alcooliser, à fumer ou à se battre et à avoir des bleus partout, on sait qu'il se passe quelque chose.
Par conséquent, nous sommes prêts à répondre présents à vos deux questions, monsieur le rapporteur.
M. le président - La commission vous remercie, monsieur Nogrix.
M. Philippe Nogrix - C'est moi qui vous remercie, monsieur le président, car nous sommes très attentifs à l'évolution de la législation concernant toutes les compétences des conseils généraux. Cela nous paraît essentiel.
* 9 Conseils départementaux d'accès au droit.
* 10 Conseils départementaux de l'aide juridique.







