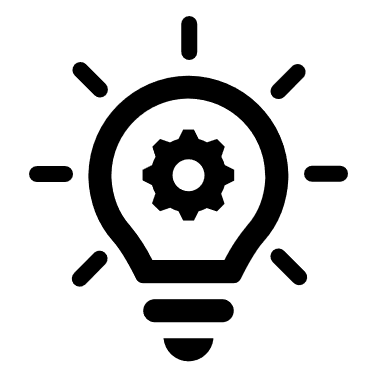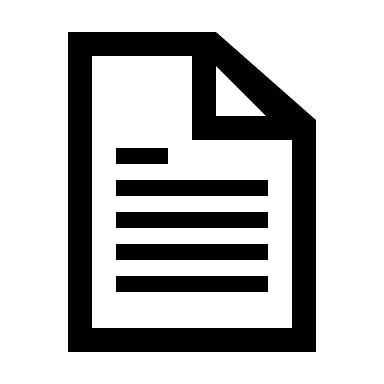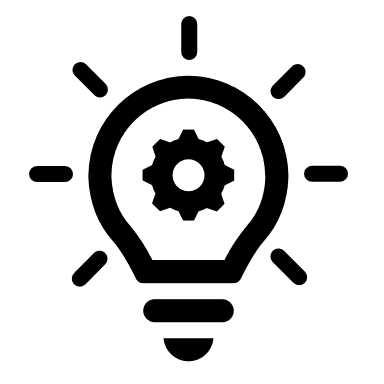C. L'ARCHITECTURE DE LA TAXE « GEMAPI » ET LA FAIBLESSE DE SES RECETTES : OBSTACLES À UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ À L'ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
1. Les recettes de la taxe GEMAPI sont insuffisantes
Aux termes de l'article 1530 bis du code général des impôts, les EPCI à fiscalité propre ont la faculté d'instaurer une taxe dont l'objet est de financer la GEMAPI. La DGCL précise que, « en matière de digues de prévention des inondations, le recours à cette recette fiscale va au-delà des seules charges de fonctionnement (surveillance, entretien courant), et peut couvrir d'éventuels investissements »60(*). Selon la direction générale des collectivités locales (DGCL), environ trois quarts des EPCI de France levaient la taxe GEMAPI en 2024.
|
Focus : La taxe GEMAPI, un impôt de répartition à la dynamique importante mais dont les recettes sont plafonnées La taxe dite « GEMAPI » est un impôt facultatif, affecté au financement de la GEMAPI. Le produit de cette taxe ne peut couvrir que les frais exclusivement liés à la compétence correspondante (items 1°,2°, 5° et 8° du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement). S'agissant d'un impôt de répartition61(*), les élus délibèrent le cas échéant dans le but d'arrêter un produit dont le montant ne peut excéder 40 euros par habitant au sens de la population DGF, et ne peut non plus excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI. Une fois ce produit déterminé, l'administration fiscale procède à la répartition de l'impôt auprès des contribuables (III de l'article 1530 bis du CGI). Sont redevables toutes personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), ainsi qu'à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et, éventuellement, de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Le taux de couverture de la taxe GEMAPI progresse de manière continue depuis son instauration : en 2018, première véritable année de mise en oeuvre, 428 EPCI percevaient la taxe, soit 34 %, tandis qu'en 2021, 665 EPCI l'avaient mise en place, soit un taux de couverture de 53 %. L'évolution concerne également le « taux » moyen de la taxe GEMAPI (de 6 euros par habitant en 2019 et de 7,5 euros en 2021). Sous le double effet de la progression de son « taux » et de l'augmentation du nombre d'EPCI l'ayant institué, le produit de la taxe GEMAPI connaît une dynamique importante : il a triplé entre 2018 et 2023, suivant un taux de croissance annuel moyen de 24,4 %. |
Le produit de la taxe GEMAPI, bien qu'en augmentation depuis son instauration62(*) et s'établissant à 455 millions d'euros fin 2023, ne permet en aucun cas de couvrir l'ensemble des dépenses afférentes à l'exercice de la compétence GEMAPI.
Si la DGCL souligne que la taxe GEMAPI n'est pas levée à son plein potentiel (458 millions d'euros levés en 2023, à comparer à un potentiel de 2,9 milliards d'euros), force est cependant de constater que ce potentiel « atteint sa limite dans de nombreux territoires où le besoin se fait particulièrement ressentir »63(*). En outre, les marges de manoeuvre des EPCI pour augmenter les prélèvements sont particulièrement réduites64(*) du fait de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la réduction des bases imposables pour les locaux industriels, l'assiette de calcul de la taxe GEMAPI est désormais concentrée sur les personnes assujetties à la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises. Comme le note finalement elle-même la DGCL, ce « resserrement de l'assiette de taxe conduit à une augmentation de la pression fiscale sur certains redevables »65(*).
2. L'architecture même de la taxe GEMAPI ne permet pas de remédier aux inégalités face au risque inondation
À bien des égards66(*), la compétence GEMAPI est une compétence que seuls les territoires riches - et tout particulièrement les territoires des métropoles aux capacités contributives importantes - peuvent sereinement assurer. À l'inverse, les territoires de montagne, ruraux ou littoraux67(*) ne disposent que rarement des capacités contributives et financières pour assumer cette compétence.
Si la « taxe GEMAPI met en oeuvre une solidarité intercommunale, elle perpétue des disparités qui existent au sein d'un même bassin versant » 68(*). Pis, la territorialisation de la GEMAPI, associée à un financement fondé sur la fiscalité locale, tend même à aggraver les inégalités entre territoires69(*). Dans la mesure où les risques d'inondation sont « plus prononcés à proximité d'un exutoire que dans la partie haute de la zone géographique, un EPCI près de l'embouchure d'un fleuve sera confronté à des dépenses plus importantes en matière de prévention des inondations »70(*), le contraignant plus fortement à instaurer la taxe GEMAPI pour parvenir à les financer.
Cette situation inéquitable a pu être observée à l'occasion des déplacements de la mission, notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence, où il est apparu que les collectivités de l'amont étaient bien souvent confrontées à de grandes difficultés de financement, alors que les grandes villes et métropoles situées en aval peuvent lever plus facilement des montants importants. En résulte une perte de solidarité entre l'amont et l'aval des bassins versants, et des risques de déséquilibres financier et fiscal au sein d'un même bassin versant71(*).
3. De la nécessité de pérenniser et élargir l'expérimentation permettant aux EPTB de lever des contributions fiscalisées
Afin d'élargir les modes de financement des actions relevant de la compétence GEMAPI et d'organiser la solidarité à une échelle plus vaste que celle des intercommunalités, l'article 34 de la « loi 3DS » a prévu un dispositif expérimental permettant aux présidents d'EPTB - lorsque ceux-ci sont compétents par transfert ou délégation en matière de protection contre les inondations - de prélever une contribution fiscalisée72(*) auprès des redevables des taxes directes locales.
À ce jour, toutefois, aucun EPTB ne s'est saisi de cette expérimentation, prévue jusqu'au 22 février 2027. Les gestionnaires de digues se sont en effet heurtés à plusieurs obstacles :
- la publication tardive du décret d'application du dispositif73(*) ne leur a pas permis de se lancer immédiatement dans l'expérimentation74(*) ;
- l'expérimentation n'est possible que sur l'item 5 de la compétence GEMAPI. Or, comme le relève l'ANEB75(*), il est plus facile de trouver un consentement à la solidarité sur l'ensemble de la compétence ;
- l'expérimentation ne permet pas de stabilité pluriannuelle des financements : les EPCI doivent donc délibérer chaque année, alors que la plupart des aménagements sont programmés de manière pluriannuelle.
Enfin, selon la DGCL, à l'ouverture de l'expérimentation, la mise en oeuvre de la GEMAPI n'était pas encore pleinement aboutie pour les EPTB, et l'institution de contributions fiscalisées avait ainsi pu « appara[ître] anticipée ou inadaptée », ce d'autant que la mise en oeuvre de la compétence avait déjà nécessité des compromis politiques parfois délicats à obtenir.
|
Recommandation n° 4 : Permettre aux EPTB de lever une contribution fiscalisée auprès des redevables locaux, en pérennisant l'expérimentation ouverte par la loi « 3 DS », et en élargissant cette possibilité pour l'ensemble des items de la GEMAPI et selon une logique pluriannuelle. |
|
Focus : L'exemple de l'Établissement public Loire - un opérateur structurant à conforter à l'échelle du bassin À partir des contributions écrites de MM. Olivier Hurabielle76(*) et Samuel Bauchet77(*) Reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB), l'Établissement public Loire (EPL) intervient sur l'ensemble du bassin versant de la Loire et de ses affluents, soit un territoire de plus de 150 000 km² couvrant quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire) et 11 départements. Il constitue ainsi l'un des plus vastes EPTB de France. La spécificité du contexte ligérien réside dans la coexistence, sur un linéaire de plus de 700 km de digues, d'une cinquantaine d'EPCI à fiscalité propre, nouveaux gestionnaires GEMAPI. Pour favoriser la cohérence des actions de lutte contre les inondations, ces EPCI ont été réunis au sein d'un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC), reconnu par l'État au titre de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Un fonctionnement articulé autour de plateformes de proximité Dans le cadre du PAIC, cinq plateformes territorialisées ont été instituées, servant de relais opérationnels aux actions menées sur les différents secteurs du bassin (prévention des inondations, entretien des digues, restauration des milieux aquatiques). Financièrement indépendantes, elles sont alimentées par les contributions directes des EPCI concernés, soit par prélèvement de la taxe GEMAPI, soit via le budget principal de la collectivité. Toutefois, cette architecture montre aujourd'hui ses limites : les contributions demeurent très inégales selon les capacités financières des EPCI, accentuant les déséquilibres entre plateformes. En l'absence de péréquation institutionnelle, les intercommunalités les plus peuplées versent peu, tandis que les plus petites, mais avec de longs linéaires de digues, supportent des charges très lourdes. Cette situation fragilise la soutenabilité des interventions de l'EPL. Un cadre juridique inachevé et des leviers encore sous-exploités L'EPL ne peut percevoir directement la taxe GEMAPI, sauf à bénéficier d'un transfert volontaire de compétence, prévu par la loi à titre expérimental. Mais ce transfert est conditionné à l'accord unanime des EPCI membres (ou d'une majorité qualifiée si elle venait à être instaurée), à renouveler chaque année lors du vote de la taxe. Compte tenu du nombre d'intercommunalités concernées (plus de 50), cette option demeure aujourd'hui inenvisageable. Par ailleurs, tous les EPCI exerçant la GEMAPI sur le bassin ne sont pas membres de l'EPL, limitant encore sa portée. Afin de remédier à ces difficultés, les interlocuteurs de la mission formulent une série de recommandations, listées ci-après. Recommandations issues de la contribution du directeur général des services de l'Établissement public Loire : - Créer, à titre expérimental, une surtaxe GEMAPI de bassin ou une taxe spéciale d'équipement (TSE) perçue à l'échelle du linéaire ligérien, pour le compte de l'EPL, par l'État ou par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ; - Garantir une ressource directe et pérenne pour l'établissement, déconnectée des contributions annuelles des EPCI ; - Assurer une péréquation entre petits et grands EPCI, en tenant compte des écarts de potentiel fiscal et de linéaire de digues à entretenir. Recommandations issues de la contribution du maire de Cuffy : - Envisager un transfert ou une délégation de la compétence GEMAPI à l'EPL sur l'ensemble de la Loire, de l'amont à l'aval, afin de garantir une action unifiée et cohérente sur le bassin ; - Permettre à l'EPL de centraliser la perception de la taxe GEMAPI, pour financer les actions de gestion du fleuve, tout en laissant aux communautés de communes la possibilité de continuer à lever cette taxe pour les actions locales (syndicats de rivières notamment) ; - Faciliter l'accès aux subventions (notamment celles du fonds Barnier) en faisant de l'EPL un interlocuteur unique des financeurs. Si la reconnaissance du PAIC donne droit à un taux de subvention bonifié jusqu'à 80 %, une clarification des rôles renforcerait encore l'efficacité du système. |
* 60 Contribution écrite de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) à la mission.
* 61 Les impôts de répartition fonctionnent en répartissant un produit prédéterminé entre les contribuables : c'est ainsi le produit qui permet de déterminer le taux, et non l'inverse. Ce produit est fixé par l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts (CGI).
* 62 Selon la DGCL, le produit de la taxe GEMAPI s'est élevé à 455 millions d'euros en 2023. Il a été multiplié par 18 entre 2017 et 2023, et a progressé de 65 % entre 2021 et 2023.
* 63 Avis n° 659 (2024-2025) déposé le 27 mai 2025 par M. Laurent Somon sur la PPL portant diverses dispositions en matière de GEMAPI., p. 18.
* 64 Si tous les EPCI prélevaient la taxe GEMAPI au plafond de 40 euros par habitant DGF, son produit atteindrait environ 2,9 milliards d'euros, contre 455 millions d'euros perçus fin 2023.
* 65 Contribution écrite de la DGCL à la mission.
* 66 Selon les propos de Maître Philippe Marc lors de son audition par les rapporteurs.
* 67 Soumis aux enjeux tels que l'érosion du littoral et la submersion marine.
* 68 Avis n° 659 (2024-2025) sur la PPL portant diverses dispositions en matière de GEMAPI., op. cit.
* 69 Lauren Matias, « La territorialisation de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) dans le bassin de l'Adour : entre volonté de générer de la solidarité territoriale autour de la gestion des cours d'eau et risque d'accentuer les inégalités territoriales ? », op. cit.
* 70 Avis n° 659 (2024-2025) sur la PPL portant diverses dispositions en matière de GEMAPI., op. cit.
* 71 Ibid.
* 72 Ces contributions fiscalisées sont destinées à remplacer partiellement ou totalement les contributions budgétaires des membres d'un EPTB pour financer les missions de défense contre les inondations.
* 73 Décret n°2022-1251 du 23 septembre 2022.
* 74 Contribution écrite de la FNCCR à la mission : dans la mesure où 40 jours sont nécessaires entre la délibération sur le principe de création de la taxe et la délibération créant la taxe, aucun instituer la taxe additionnelle GEMAPI dès 2023.
* 75 Contribution écrite de l'ANEB à la mission.
* 76 Maire de Cuffy et Président de la communauté de communes des portes du Berry.
* 77 Directeur général des services de l'Établissement public Loire.