1.3 Les délégations de l'État : ports autonomes et concessions
L'organisation portuaire instaurée par la loi de 1965 a conduit l'État à transférer une partie de ses prérogatives à des organismes publics : l'établissement public mixte aux caractères à la fois administratif et industriel et commercial dans le cas des ports autonomes. Par ailleurs, l'État confirme la concession de l'outillage public aux Chambres de commerce et d'industrie dans celui des ports d'intérêt national. Il ne sera pas examiné à ce stade si ces organismes sont les structures les mieux adaptées à hériter des « démembrements » de l'État. D'autres sont certes envisageables. L'organisation sous forme de société d'économie mixte par exemple permettrait d'intégrer un capital privé dans la structure des sociétés ainsi constituées et donner aux opérateurs et aux collectivités locales intéressées (qui dans certains ports contribuent déjà de façon significative aux investissements), un poids décisionnel en rapport avec leurs prises de participation. L'attribution de concessions de service public pourrait éventuellement être envisagée sans a priori. Ces options, jugées intéressantes par certains des intervenants audités, n'ont toutefois pas été considérées comme des mesures à caractère prioritaire pour améliorer l'organisation portuaire.
Les autorités portuaires sont à la fois les représentants de l'État, avec ses prérogatives de puissance publique, des aménageurs et promoteurs de l'espace industriel et portuaire et des entrepreneurs industriels et commerciaux fournissant des services variés. L'activité d'aménageur et de promoteur de la place portuaire permet de générer des recettes et de développer ainsi l'activité et l'emploi. Le métier d'entrepreneur industriel et commercial consiste à exploiter des ateliers d'entretien, réaliser parfois des dragages et fournir des prestations d'outillage. L'acquisition et la location avec sa main-d'oeuvre de l'outillage lourd (grues, portiques, radoubs) aux opérateurs de manutention constituent une spécificité du système portuaire français. Pour cette raison, cet outillage est qualifié de « public ». Dans les autres ports européens, il existe souvent des équipements achetés et exploités par des entreprises, en général de droit privé, qu'elles soient ou non utilisatrices uniques du site.
1.4 Le désengagement relatif du budget de l'État
Le budget des ports fait partie de celui du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement. À titre indicatif, seront précisés les montants alloués en crédits de paiement dans le cadre de la loi de finances 1998, ainsi que la répartition de ceux-ci.
|
1. En dépenses ordinaires |
en % |
|
|
- dépenses de fonctionnement destinées aux ports non-autonomes directement gérés par l'État |
43 MF |
7,3 |
|
- dépenses d'intervention destinées à l'entretien courant des six ports autonomes métropolitains |
394 MF |
66,5 |
|
2. En dépenses de capital (crédits de paiement) |
||
|
- investissements de capacité dans les ports de métropole |
139,1 MF |
23,5 |
|
- grosses réparations, d'entretien et de restauration dans les ports d'Outre-mer |
13,4 MF |
2,3 |
|
- études générales liées aux aménagements |
1,2 MF |
0,2 |
|
- subventions d'investissement aux ports maritimes |
2 MF |
0,3 |
|
TOTAL |
592,7 MF |
100,0 |
Ce budget appelle plusieurs remarques :
- les dépenses d'entretien des ports autonomes absorbent les deux tiers des crédits ;
- les crédits sont modestes au regard des autres secteurs du transport ;
- Les politiques publiques : appréciation et essai d'évaluation -
- malgré cette modestie, des annulations de crédits relativement importantes frappent chaque année la réalisation de ce budget : 11 MF en 1997, 27 MF en 1996, 70 MF en 1995, 61 MF en 1994, 59 MF en 1993, 56 MF en 1992...
Évolution des crédits en LFI et
consommés
pour les ports métropolitains
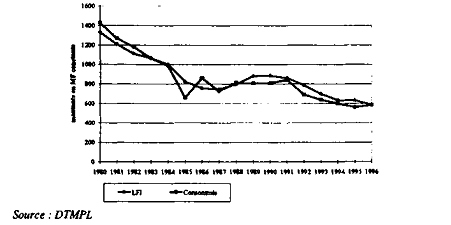
Mais la caractéristique essentielle de ce budget est sa décroissance quasi continue, comme le montre le graphique ci-dessus indiquant la dotation budgétaire en Loi de finances initiale et les crédits consommés hors fonds de concours (dépenses ordinaires et crédits de paiement) en francs constants 1996 pour les ports métropolitains (articles 35-34, 44-34 et 53-30) depuis 1980. Le décrochement des années 1985 à 1987 s'explique par des concours en provenance du FSGT (Fonds spécial des grands travaux) venus abonder les crédits budgétaires, pour des montants de l'ordre de 150 à 200 MF pendant ces années. Les tableaux en annexe 6 présentent le détail des crédits consommés de 1980 à 1996.
Les crédits d'État diminuent de moitié en seize ans en francs constants. En ce qui concerne les ports d'intérêt national, la réduction des dotations est compensée par les fonds de concours en provenance des collectivités locales, le montant de ceux-ci passant de 6 MF en 1980 à 36 MF en 1996. Malgré cela, la direction des ports fait état de dégradations multiples au niveau des quais, jetées, écluses et ponts-mobiles, mettant parfois en question la sécurité des personnes et des biens, et d'une situation préoccupante sur l'entretien des profondeurs des chenaux et avant-ports.
Ces dégradations touchent des infrastructures utiles à l'exploitation, soit datant du XIX e siècle, soit des équipements plus sophistiqués des années 1960, mais à durée de vie limitée et concernent en première urgence les ports de Brest, Boulogne, Cherbourg, Concarneau, Marseille et Sète. Une expertise technique de ces désordres a été menée en 1994 par la direction des Ports qui souhaite bénéficier à ce titre d'une enveloppe spécifique pluriannuelle. La responsabilité de l'État étant engagée, cette attente devrait être satisfaite dans la mesure du possible et il reste à déterminer l'urgence et le montant des travaux de rattrapage à effectuer.
Par ailleurs, une part des dépenses « normalement » à la charge de l'État est reprise par les autorités portuaires, ports autonomes et concessions, dans la mesure de leur capacité d'autofinancement et des possibilités d'emprunt. Des crédits initialement prévus pour les dotations en capital sont transférés aux dépenses d'entretien, l'ajustement se faisant in fine sur la part de l'État des contrats de plan État-régions qui, au rythme actuel d'exécution, serait de l'ordre d'une dizaine d'années (voir à ce sujet le tableau sur l'état d'avancement des contrats de plan État-régions en point 7 de ce chapitre).







