6.3 Le transport ferroviaire de fret constitue une question vive
6.3.1 Une meilleure desserte des ports par la SNCF constitue une attente vive des partenaires
Les autorités portuaires sont à juste titre extrêmement désireuses de voir développer leur hinterland. Actuellement, l'essentiel du trafic (75 à 80 %) est acheminé par la route, mais au-delà d'une certaine distance de l'ordre de 600 à 800 kilomètres, le moyen privilégié de transport des marchandises devient la voie ferré, dont un des atouts essentiels, le transport combiné, est particulièrement adapté aux trafics de conteneurs. Bien que ne représentant globalement que 12 milliards de tonnes-km sur un total ferroviaire de 48 Mds t-km et un total tous modes de 295 Mds t-km en 1996, la part du transport combiné fer-route est celle qui croît le plus vite surtout depuis 1990 comme le montre le graphique ci-après
Évolution du trafic de marchandises
(en
tonnes-km, base 100 en 1986)
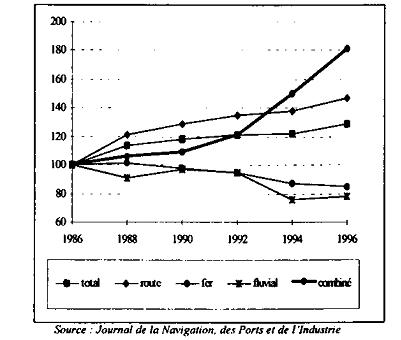
C'est pourquoi beaucoup de responsables portuaires estiment que le ferroviaire constitue le vecteur principal d'extension de leur hinterland. Cependant, le développement du transport par voie ferrée à partir des ports se heurte à un certain nombre d'obstacles de natures physique et économique. Comme obstacles physiques, on peut citer, par exemple pour le port du Havre, l'éclatement des terminaux maritimes peu propice à une desserte ferroviaire et surtout le goulet que constitue la région parisienne où certaines sections du réseau sont saturées. Comme obstacles économiques, on peut évoquer, toujours pour le port du Havre, la barrière constituée par le Rhin qui draine les trafics vers les ports du Nord de l'Europe et fait écran à un développement vers l'Allemagne méridionale, et surtout la difficulté à trouver des flux de trafic suffisamment étoffés pour s'organiser en dessertes compétitives.
Actuellement, la SNCF échange avec les ports 17 M de tonnes de marchandises, dont les deux tiers du trafic conteneurisé à partir du Havre. Le ferroviaire représente 18 % des parts de marché de ce port ce qui constitue un des plus élevés ratios d'Europe après Hambourg (40 %). Malgré l'importance globale de ces flux, il est difficile de trouver des flux suffisamment concentrés et équilibrés pour constituer des trains navettes. Un trafic de point à point de 150 000 à 200 000 tonnes annuelles est nécessaire pour justifier une exploitation sous cette forme. Aussi, la SNCF préfère développer la technique du « hub » qui répond mieux à des dessertes peu massifiées et permet de desservir l'ensemble du territoire français plus quelques villes européennes comme Francfort ou Milan. Cette technique se heurte cependant à la difficulté que constitue la priorité accordée aux transports de voyageurs, soit au niveau des grandes lignes (y compris TGV) dans leur approche terminale urbaine, soit au niveau des lignes régionales de desserte d'agglomération.
Sur le réseau national, le transport de marchandises s'effectue par « sauts de nuit ». La mise en oeuvre d'une desserte européenne correspond à un cas de figure différent. Il convient de trouver des sillons efficaces et s'affranchir des difficultés aux traversées de frontières. D'où l'idée développée par certains pays plus avancés en matière de libéralisation du transport ferroviaire de créer des itinéraires internationaux de fret : les corridors de fret. Dans l'état actuel du projet envisagé par la Commission européenne, les premiers corridors relient la mer du Nord (Rotterdam et Hambourg) et le sud de l'Italie en passant tous par l'Allemagne. La création de couloirs supplémentaires de l'Allemagne à l'Espagne et du Royaume-Uni à la Hongrie est à l'étude. La mise à l'écart des ports français a suscité des réactions négatives de la part des responsables français. La position de la France sur ce thème est pour le moins inconfortable, compte tenu de la réticence à accepter des opérateurs internationaux de fret privés et publics sur le réseau national. Le Directeur de fret de la SNCF se déclare néanmoins prêt à présenter une contre-proposition concernant un des axes nord-sud et des liaisons entre les ports français et les grands itinéraires européens, (voir paragraphe 10.4 sur les politiques européennes).







