2. Les facteurs explicatifs de cette dégradation sans précédent du solde de la branche maladie
L'effet de ciseaux entre le ralentissement des recettes
affectées, d'une part, l'accélération de la croissance des
dépenses, d'autre part, est particulièrement prégnant
s'agissant de la branche maladie
.
S'agissant des recettes
, il faut noter que la croissance globale des
produits de la branche maladie, qui était de 6,6 % en 2001, est
tombée à 2,1 % en 2002. Le ralentissement conjoncturel, et en
particulier celui de la masse salariale, a affecté les ressources de la
CNAM comme celles de l'ensemble du régime général. La
croissance des cotisations est passée de 6 % à 2,1 %, celle de la
CSG de 10,6 % à 1,3 %.
S'agissant des dépenses
, la progression des prestations de la
branche maladie en 2002 a été de 7,3 %, contre 6 % en 2001. Cette
accélération résulte de l'augmentation très forte
des dépenses de prestations maladie et maternité entrant dans le
champ de l'ONDAM.
Le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de
septembre 2003 souligne l'existence de
deux types de facteurs
expliquant
l'accélération régulière de l'évolution des
dépenses d'assurance maladie : des
facteurs structurels
,
d'une part - surprescription de médicaments, progression forte des
dépenses d'indemnités journalières, accès croissant
de certains assurés au bénéfice de l'affection de longue
durée (qui concerne aujourd'hui six millions de personnes)
- des
facteurs
plus conjoncturels
, d'autre part, tels que certaines
décisions récentes, qu'il s'agisse de la succession des
protocoles hospitaliers ou des revalorisations substantielles d'honoraires qui
ont accéléré les dépenses et dégradé
les comptes.
a) Des facteurs structurels impliquant des tendances lourdes
La
croissance des dépenses d'assurance maladie est une tendance lourde
depuis plus de vingt ans, liée notamment à l'influence de
facteurs structurels à l'oeuvre dans l'ensemble de nos
sociétés modernes, tel le vieillissement de la population ou
encore l'amélioration des techniques médicales.
Dans son rapport sur la sécurité sociale datant de septembre
2003, la Cour des comptes souligne que «
l'écart de
croissance entre le PIB et la consommation finale des ménages d'une
part, les dépenses d'assurance maladie d'autre part, se creuse nettement
en 2001 et 2002. L'écart annuel moyen de croissance entre PIB et
dépenses d'assurance maladie est de 1,47 point entre 1990 et 2002
et de 3,1 points en 2001-2002. D'environ 15 points entre 1996 et
2000, l'écart cumulé passe de 20 points en 2001 à
28 points en 2002
».
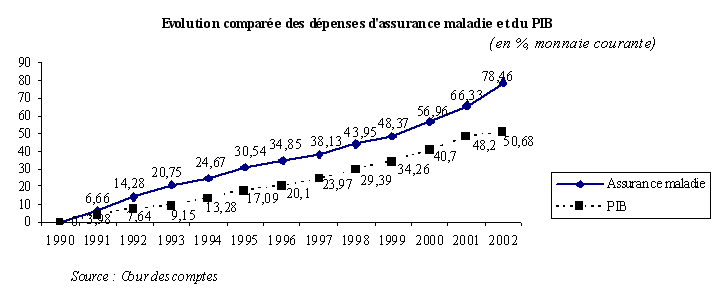
La
consommation des soins
a connu une augmentation rapide depuis
1997 : cette augmentation est liée à des facteurs
structurels - le vieillissement de la population qui se traduit par une hausse
du nombre de personnes âgées dont la consommation médicale
est élevée ; le progrès technique qui met à
disposition des patients des traitements plus efficaces mais aussi plus
coûteux.
Une récente étude, publiée par le Comité de
politique économique de l'Union européenne en novembre 2003,
consacrée à l'évaluation de l'impact du vieillissement sur
les finances publiques, révèle que, en moyenne, le vieillissement
de la population conduira dans les Etats membres, d'ici à 2050, à
une augmentation des dépenses publiques comprises entre 3 % et 7 % du
PIB si aucune mesure correctrice n'est prise. Dans la plupart des Etats
membres, cet impact budgétaire débutera dès 2010, les
répercussions les plus importantes étant attendues entre 2010 et
2030.
En France, compte tenu du vote de la loi du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, l'augmentation des dépenses publiques
devrait être, malgré tout d'après ce rapport, de 2,4 % du
PIB.
En outre, la croissance des dépenses de santé devrait se
traduire, dans l'ensemble des Etats membres, par des augmentations de
dépenses publiques comprises entre 1,5 % et 4 % du PIB.
Les études disponibles mesurant l'impact du vieillissement de la population sur l'évolution des dépenses de santé
Comme
l'a rappelé M. Jean-François Mattei, ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées, lors de la
présentation du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004, il faut «
accepter
d'assumer une part inéluctable d'augmentation des dépenses de
santé, liée au vieillissement de nos sociétés et au
progrès médical
».
Le vieillissement a en effet aujourd'hui un coût
: les
dépenses de santé des plus de 60 ans sont trois fois plus
élevées que celle des trentenaires et les personnes
âgées de plus de 70 ans consomment 30 % des dépenses
totales.
D'après une étude réalisée par la DREES
11(
*
)
,
les facteurs démographiques
seraient tendanciellement à l'origine d'environ 1 point par an de
croissance des dépenses totales de santé en volume, dans la
plupart des pays d'Europe occidentale. En outre, au sein de ces facteurs
démographiques structurels, l'impact du vieillissement serait de l'ordre
de 0,7 % par an sur la période 2000-2020
.
A l'avenir, la croissance du nombre de personnes âgées devrait
induire une croissance des dépenses d'assurance maladie. Selon les
projections démographiques publiées par l'INSEE en 2001, la
France compterait en 2020 1,4 fois plus de personnes de 60 ans et plus, qu'en
2000, et 1,8 fois plus de personnes de 80 ans et plus, (3,2 fois plus en 2040).
Ainsi en 2020, la France compterait 17 millions de personnes de 60 ans et plus
et près de 4 millions de personnes de 80 ans et plus. A l'horizon
2040, il y aurait près de 7 millions de personnes de 80 ans et plus.
A cet égard, la DREES
12(
*
)
a réalisé des
projections du nombre de personnes
âgées dépendantes à l'horizon 2020 puis 2040
,
afin d'appréhender les effets des évolutions
démographiques futures en fonction de différents scénarii
possibles d'évolution de la dépendance aux âges
élevés.
A l'horizon 2040, le vieillissement de la population devrait conduire, dans
les trois hypothèses, à une augmentation tendancielle du nombre
de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans
. Une
première accélération aurait lieu à partir de 2010
et une seconde à partir de 2030. Sur la période 2000-2020, la
hausse serait de l'ordre de 16 % dans le scénario optimiste, 25 %
dans le scénario central et de 32 % dans le scénario pessimiste.
Entre 2020 et 2040, le nombre de personnes âgées
dépendantes augmenterait dans des proportions légèrement
supérieures. Au total, sur les quarante années, l'augmentation
serait de 35 % dans le scénario optimiste, 55 % dans le scénario
central ou de 80 % dans le scénario pessimiste.
Cette hausse serait
en outre concentrée sur les 80 ans et plus
.
La croissance tendancielle est également favorisée,
d'après le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003, par «
la grande
liberté dont l'ensemble des acteurs disposent dans le système de
soins. Les gains potentiels du système de soins en termes
d'efficacité sont sans doute très importants. On peut ainsi
simplement rappeler que la France est selon l'OCDE le premier consommateur de
médicament par habitant, au-delà même des Etats-Unis, sans
que le bénéfice en termes de santé soit
démontré
».
A l'augmentation de la consommation, s'ajoute une
croissance
régulière du taux moyen de remboursement
: le nombre des
assurés exonérés du ticket modérateur augmente
très rapidement et celui des patients admis en « affection
longue durée » ouvrant droit à l'exonération
totale du ticket modérateur s'accroît d'environ 6 % par an. Au
total, les dépenses relatives aux personnes exonérées du
ticket modérateur représentent plus de la moitié des
remboursements. Parallèlement au développement des
exonérations de ticket modérateur, on constate une
déformation générale de la consommation de soins au
profit des soins les mieux pris en charge par l'assurance maladie
, ce qui a
tendance à augmenter le taux moyen de remboursement des soins.
S'agissant des soins de ville, l'effet de cette seule amélioration
tendancielle du taux de remboursement conduit à un surcoût pour
l'assurance maladie de 350 millions d'euros en 2002.







