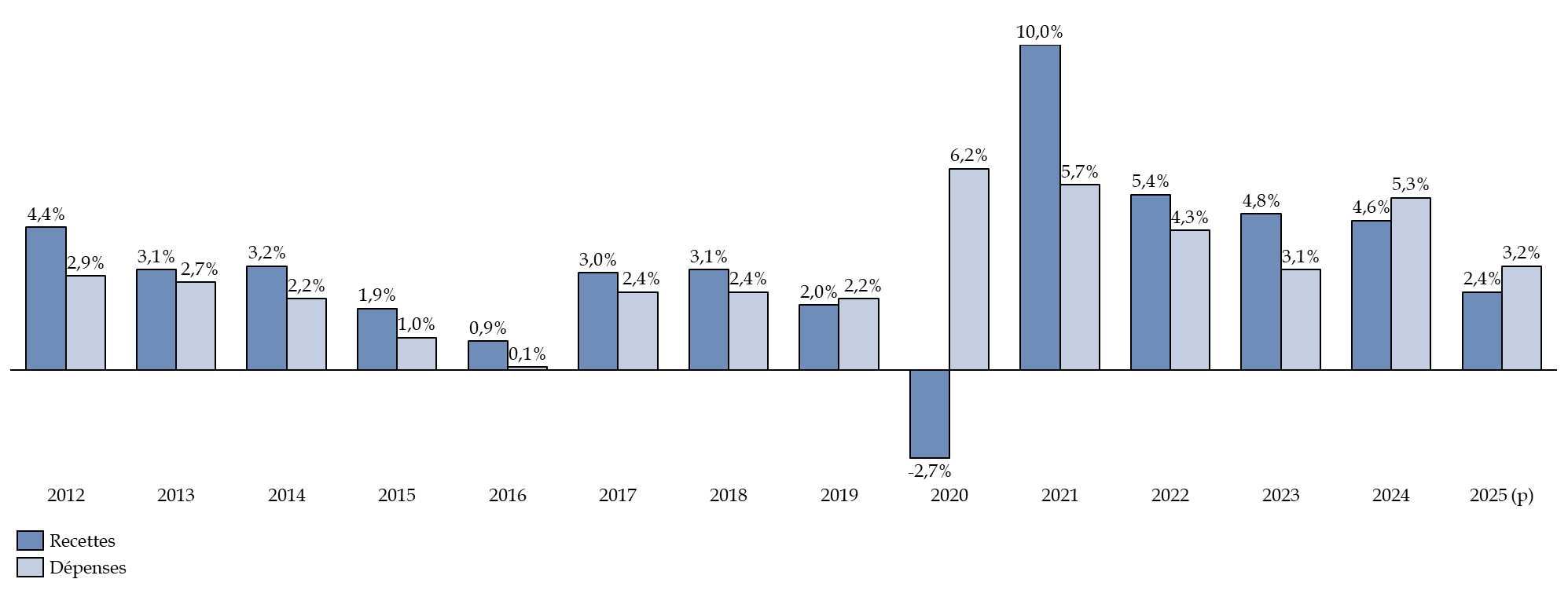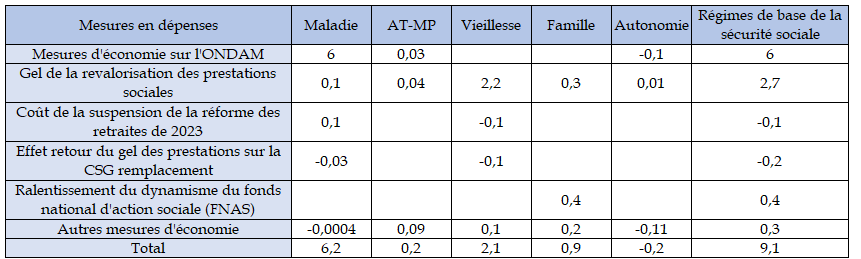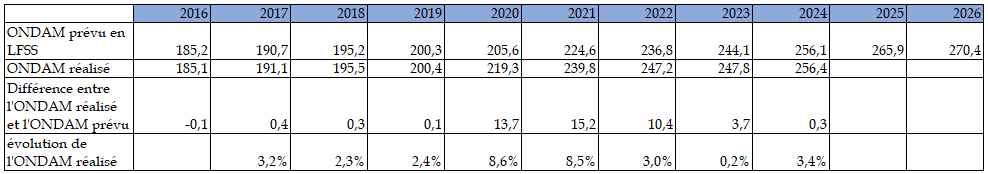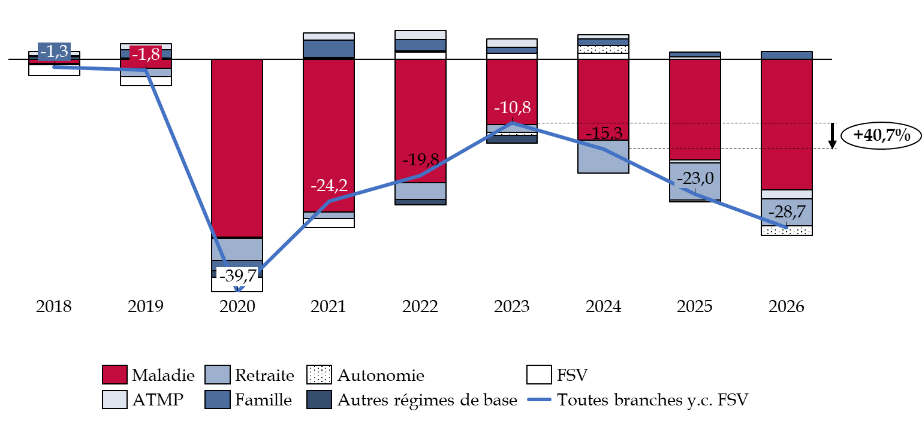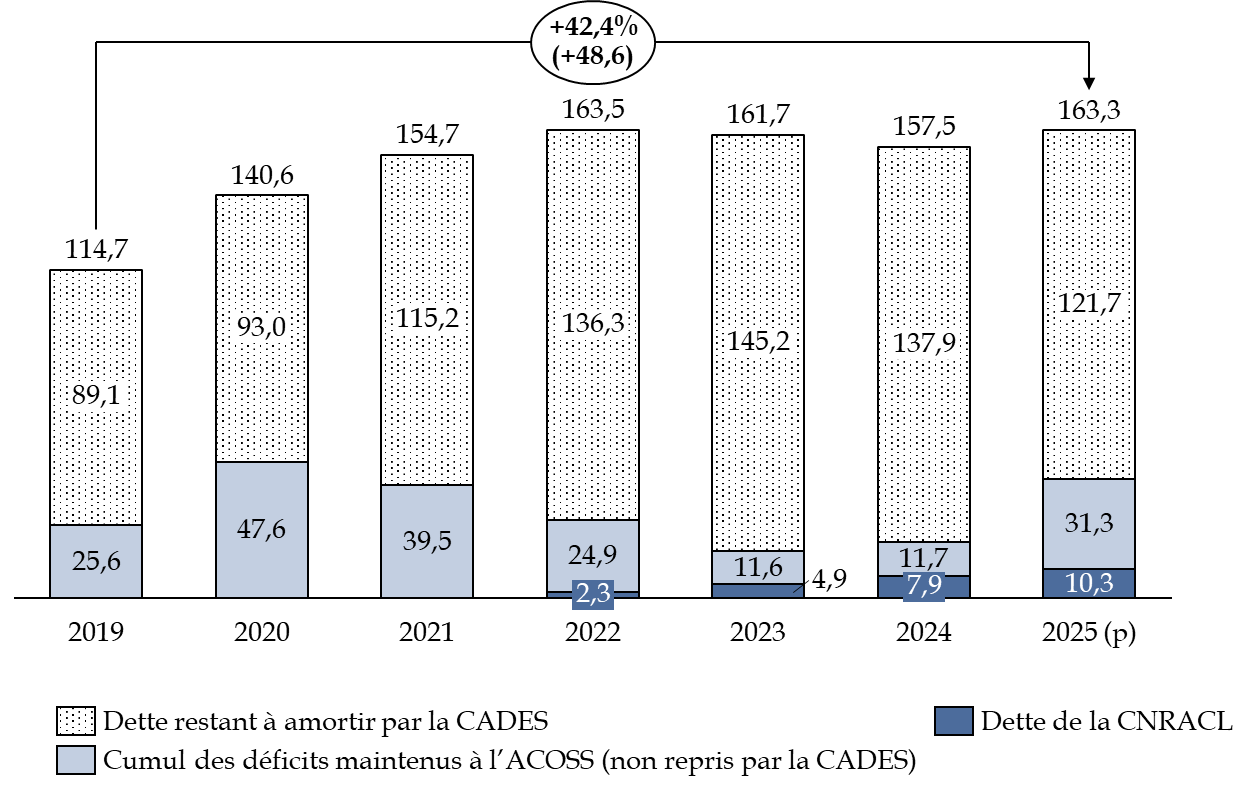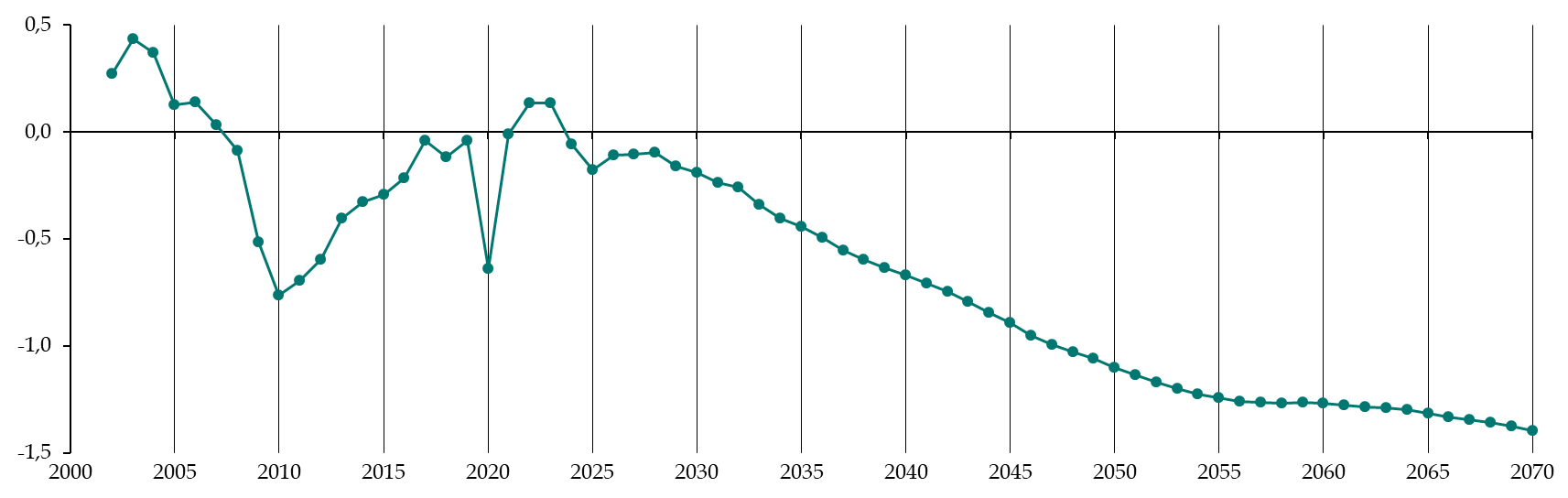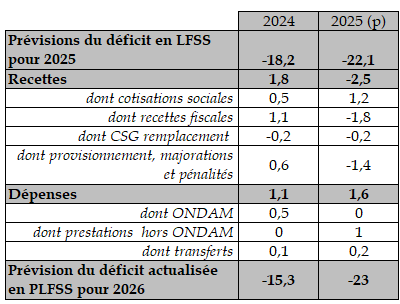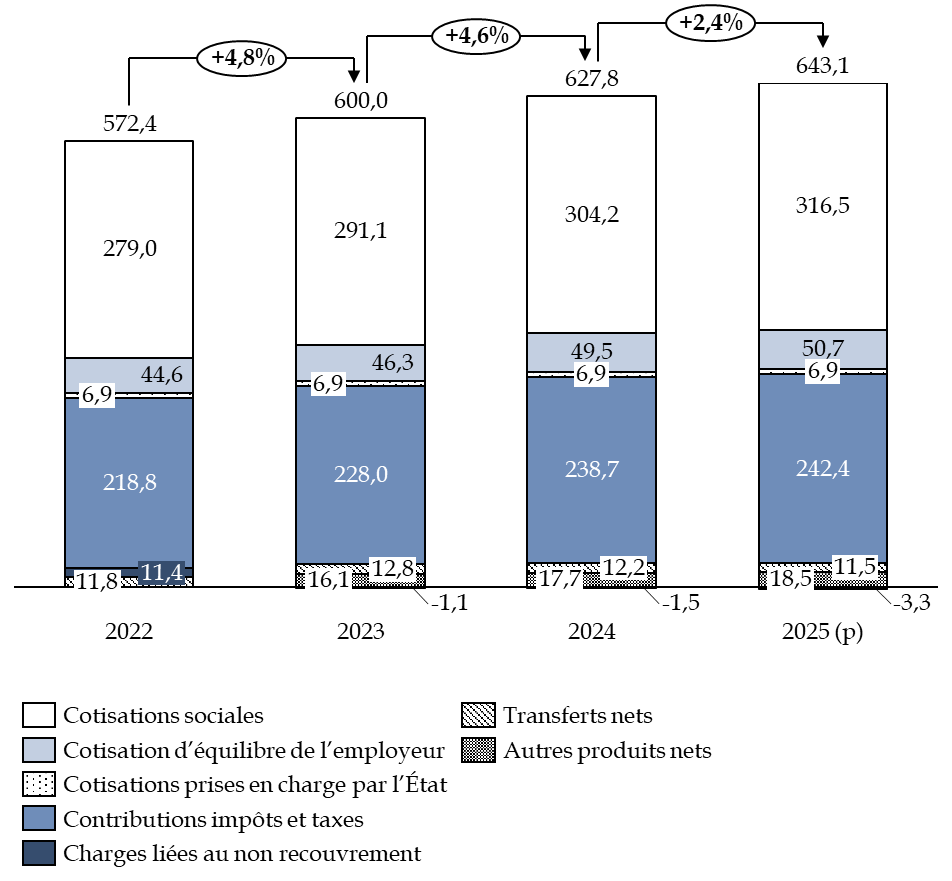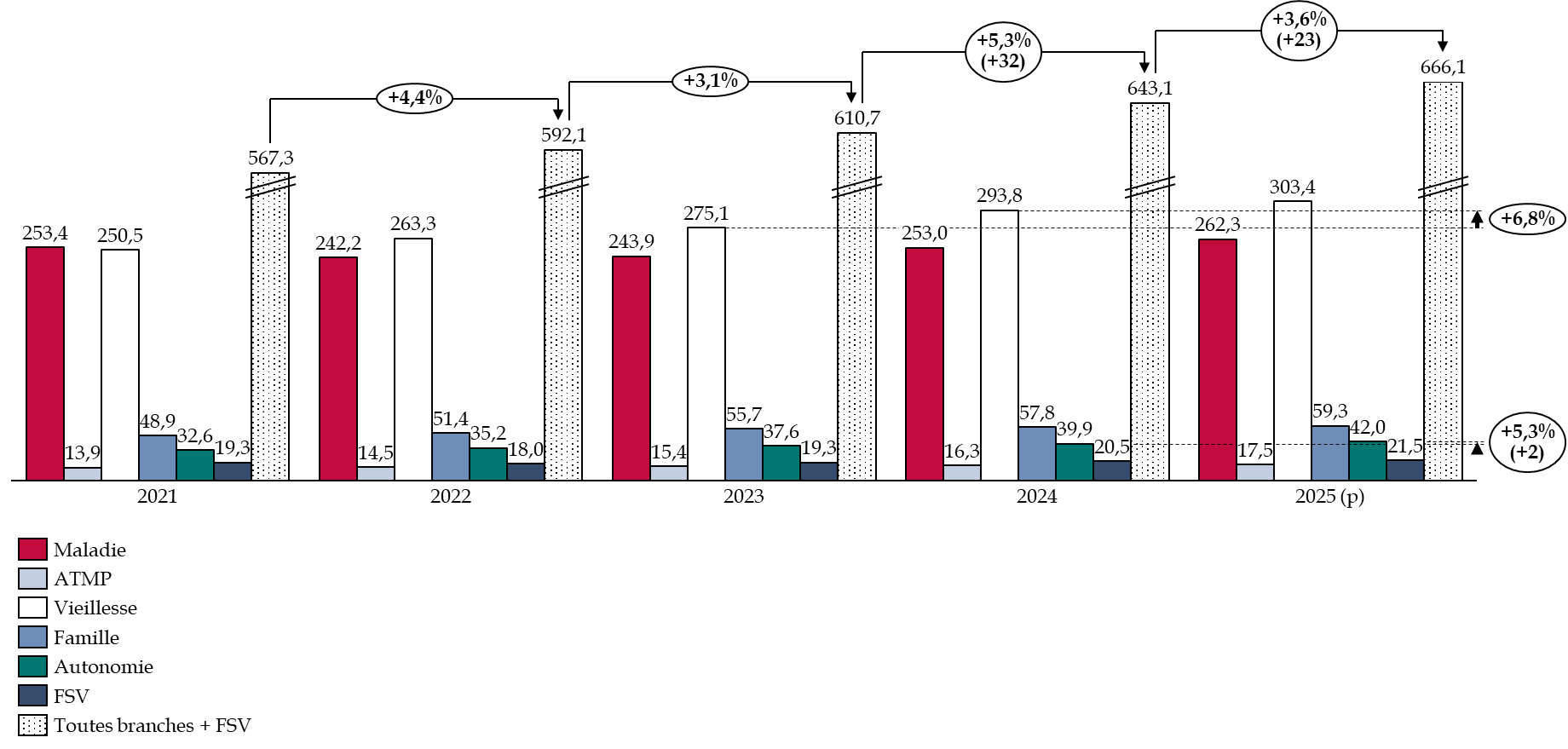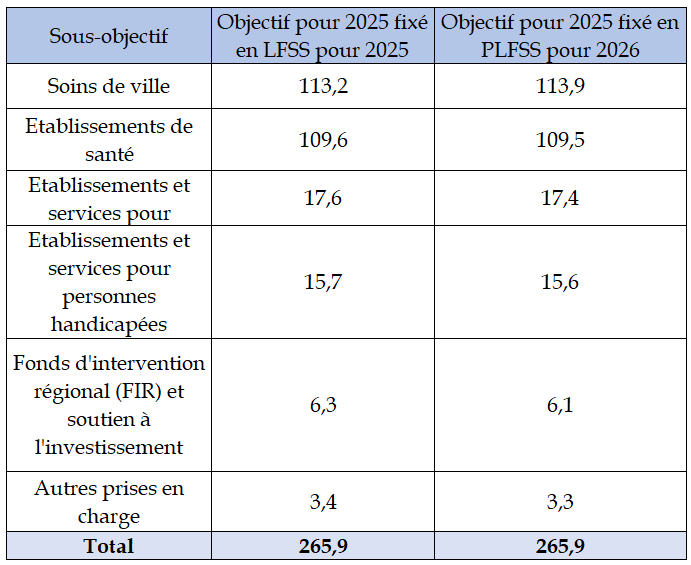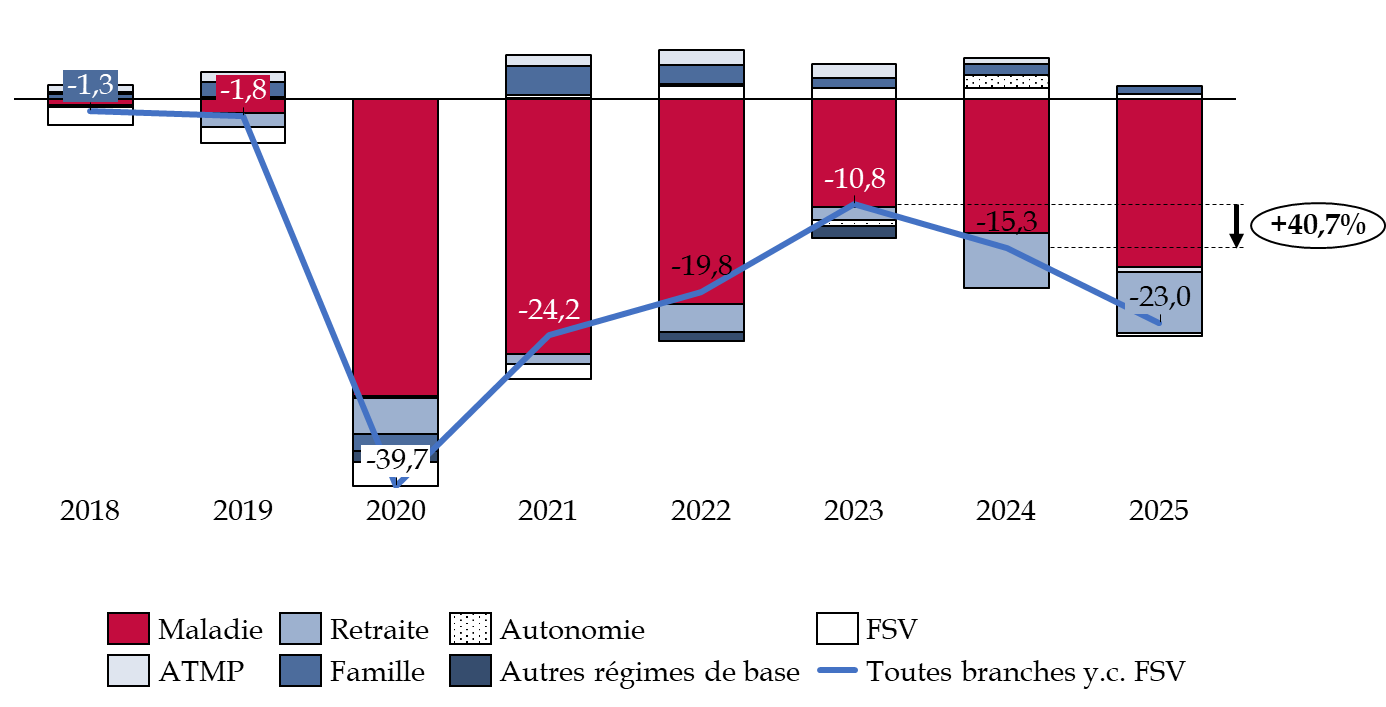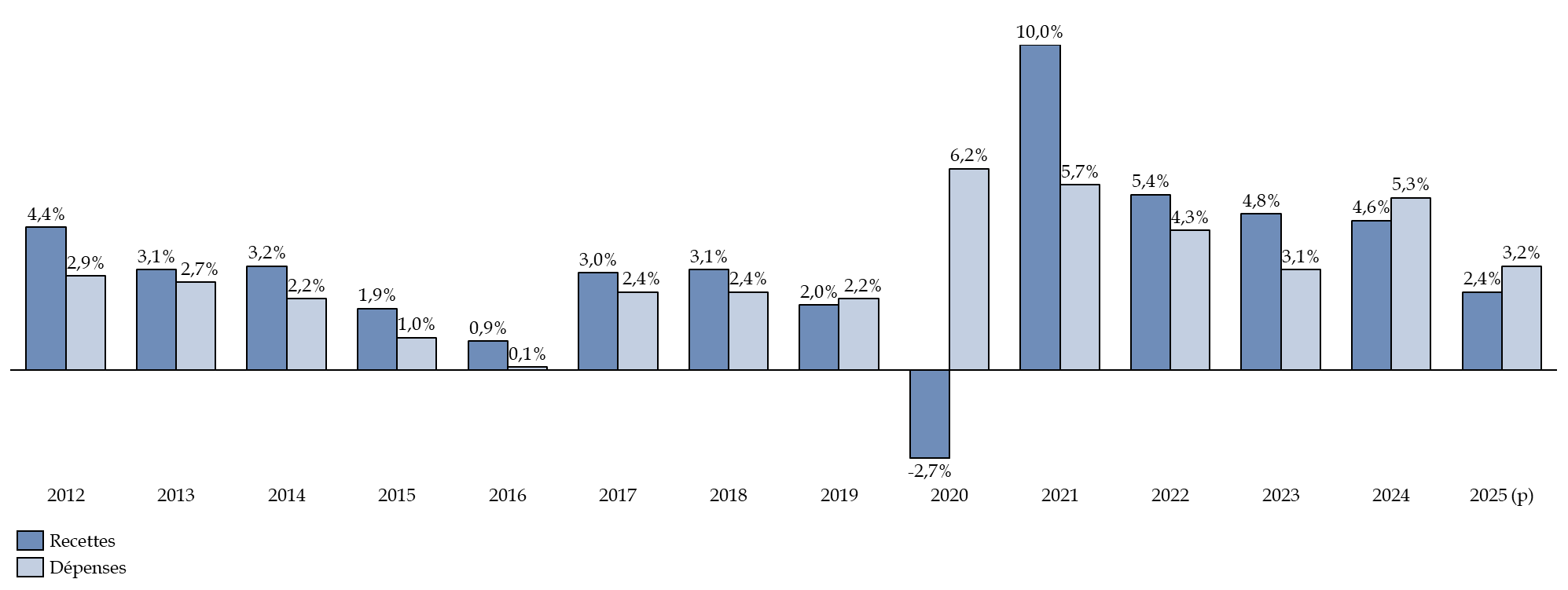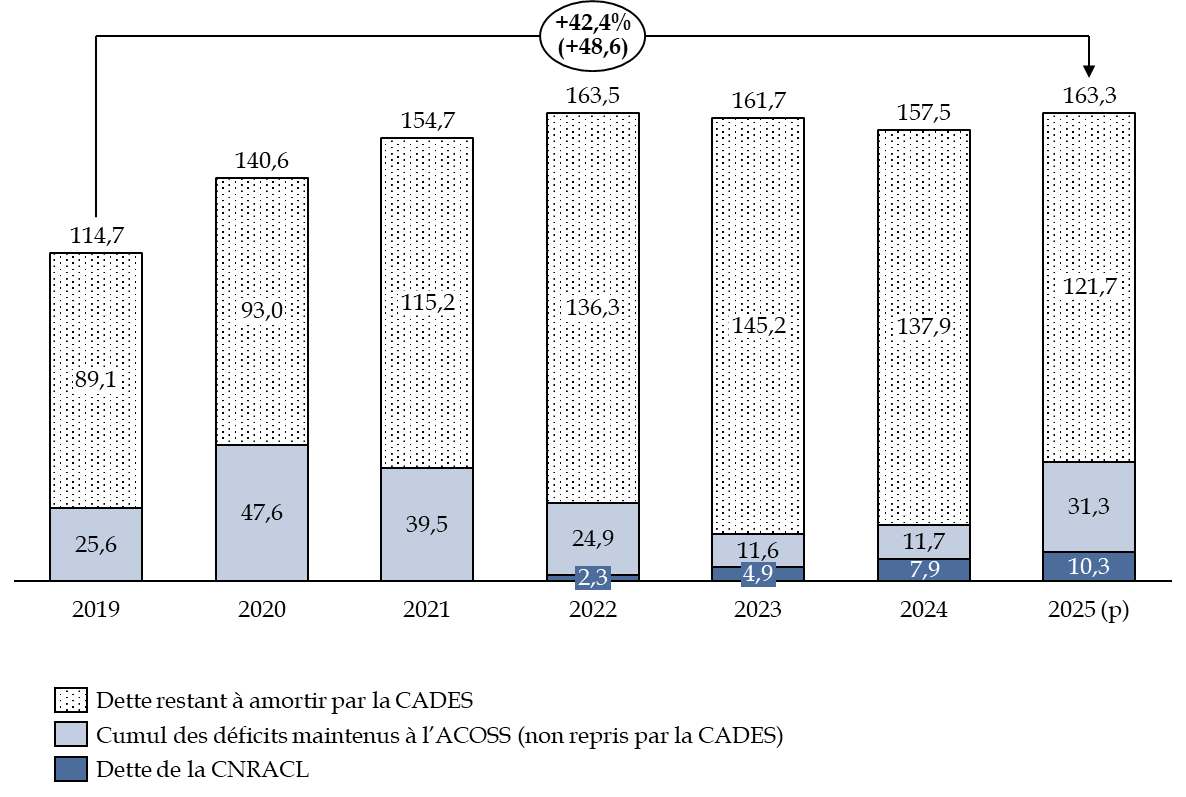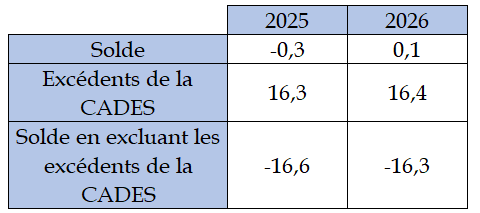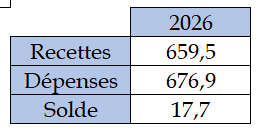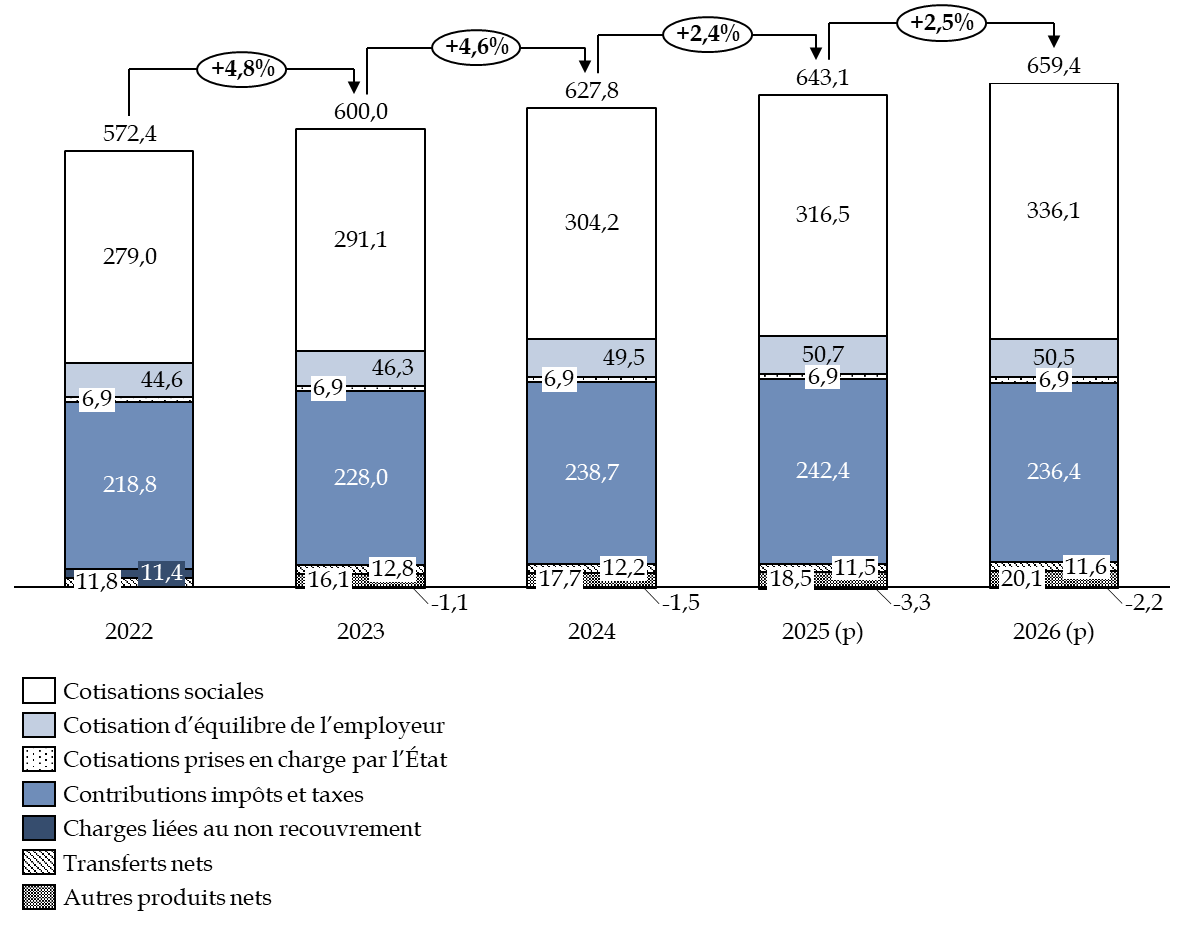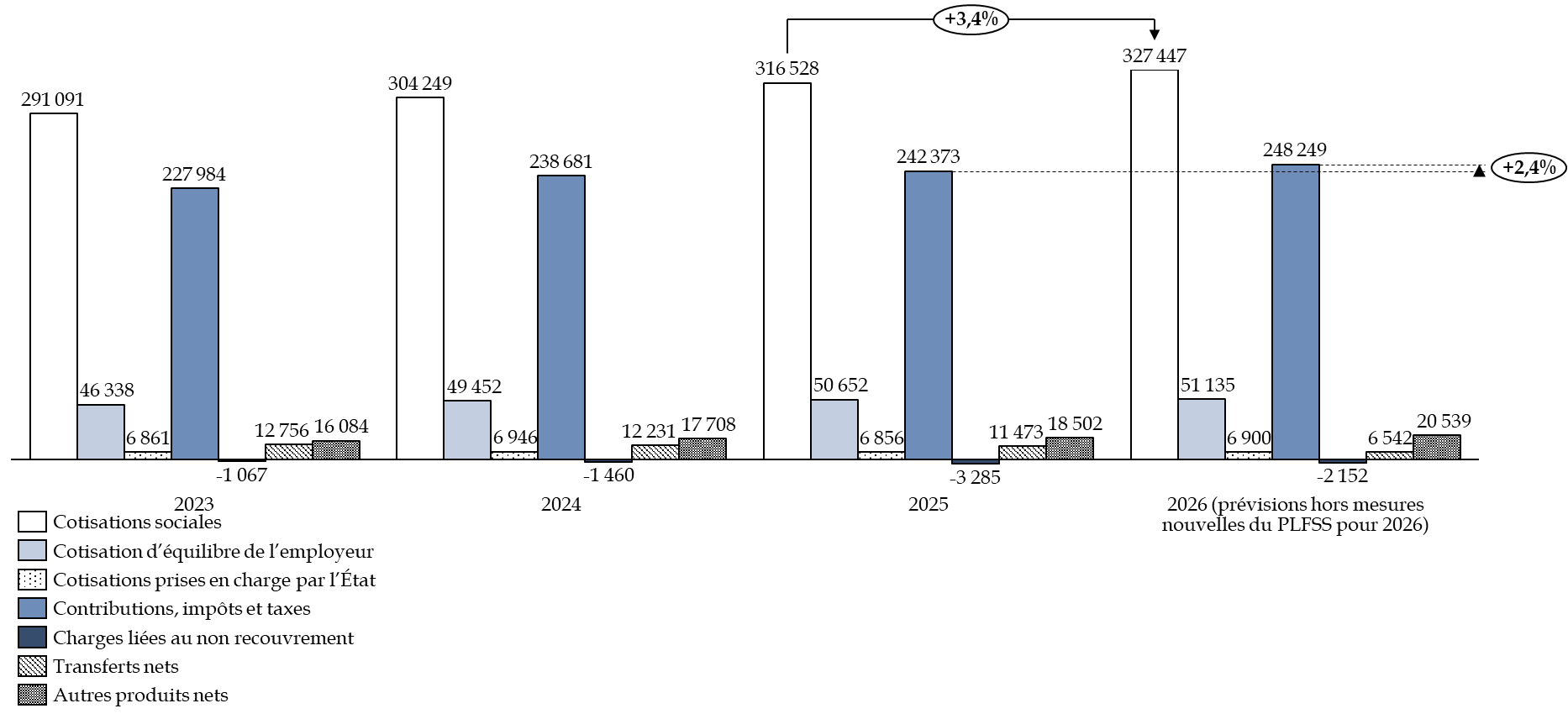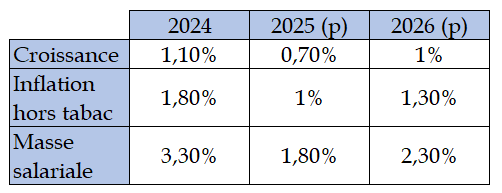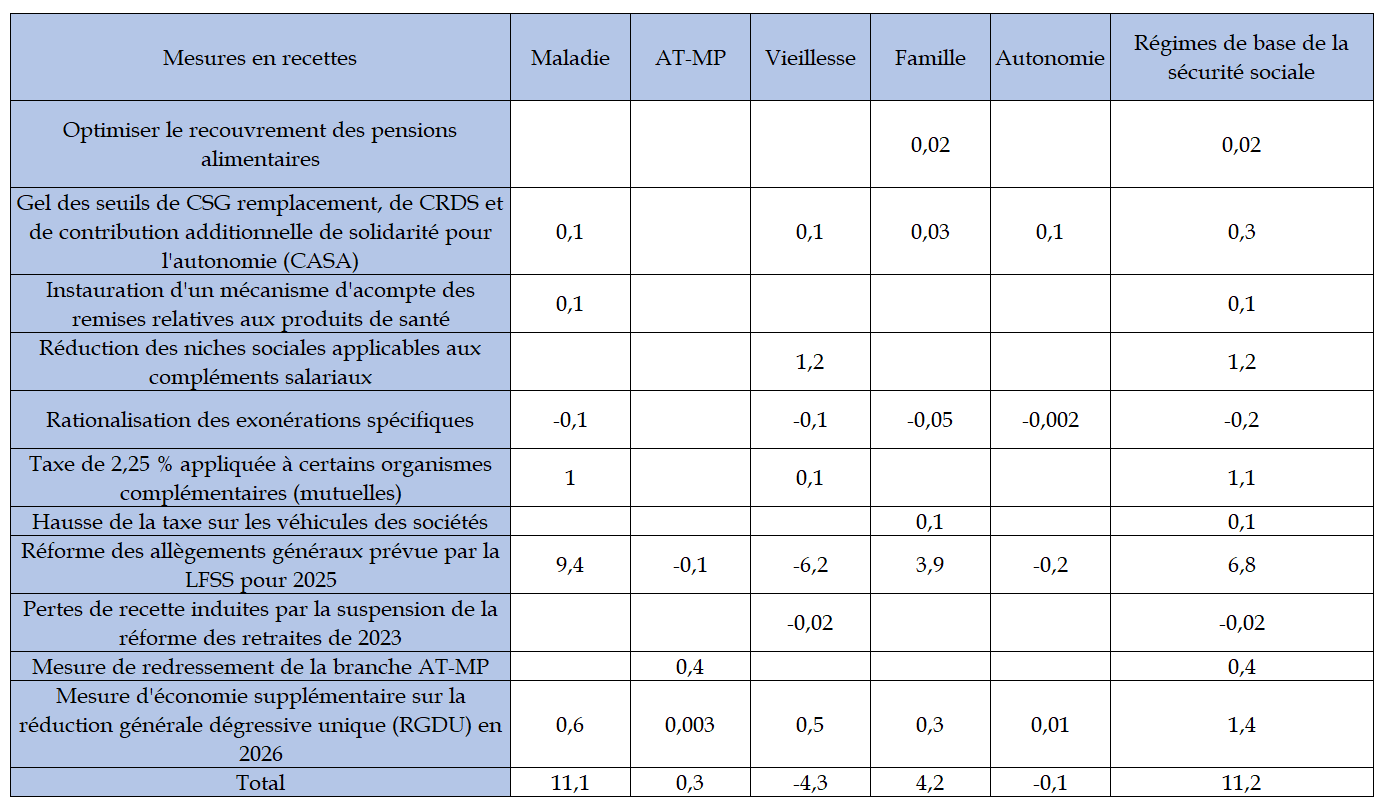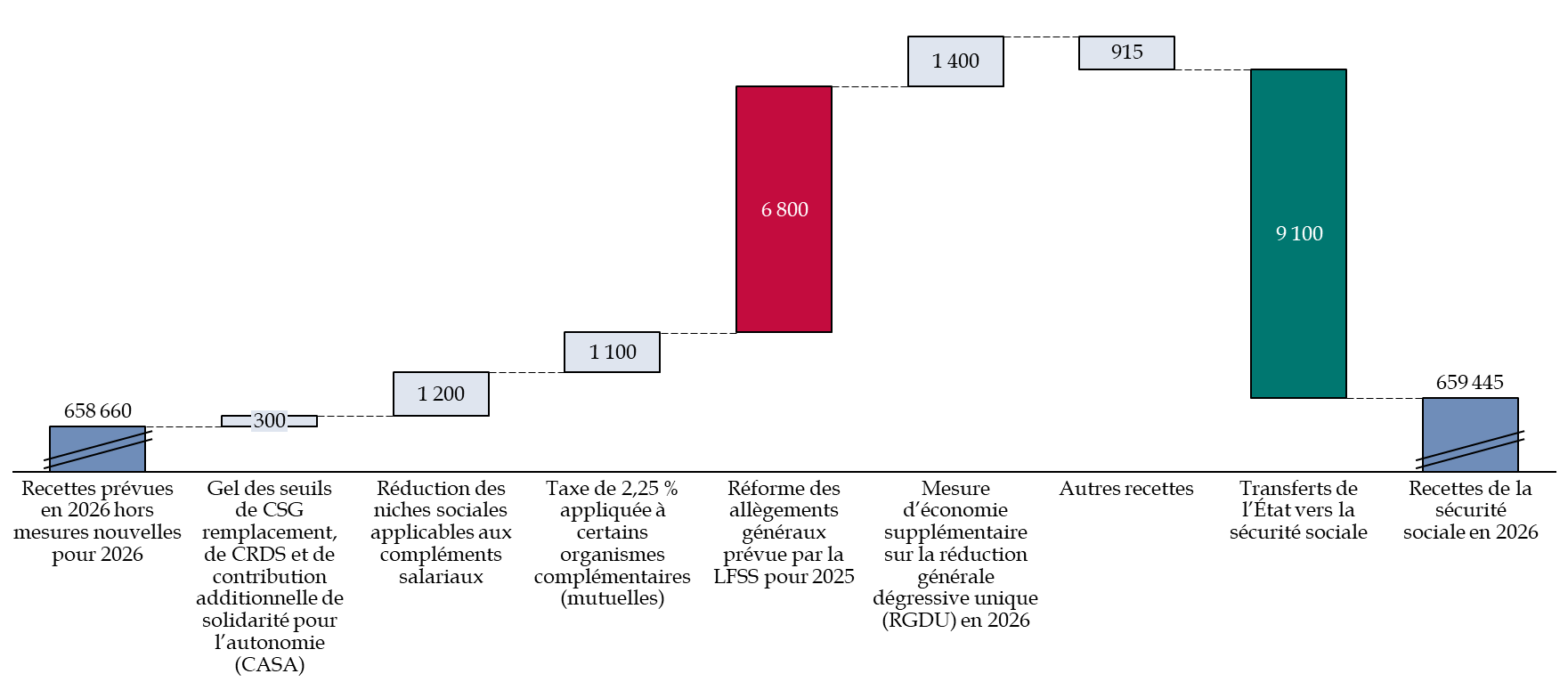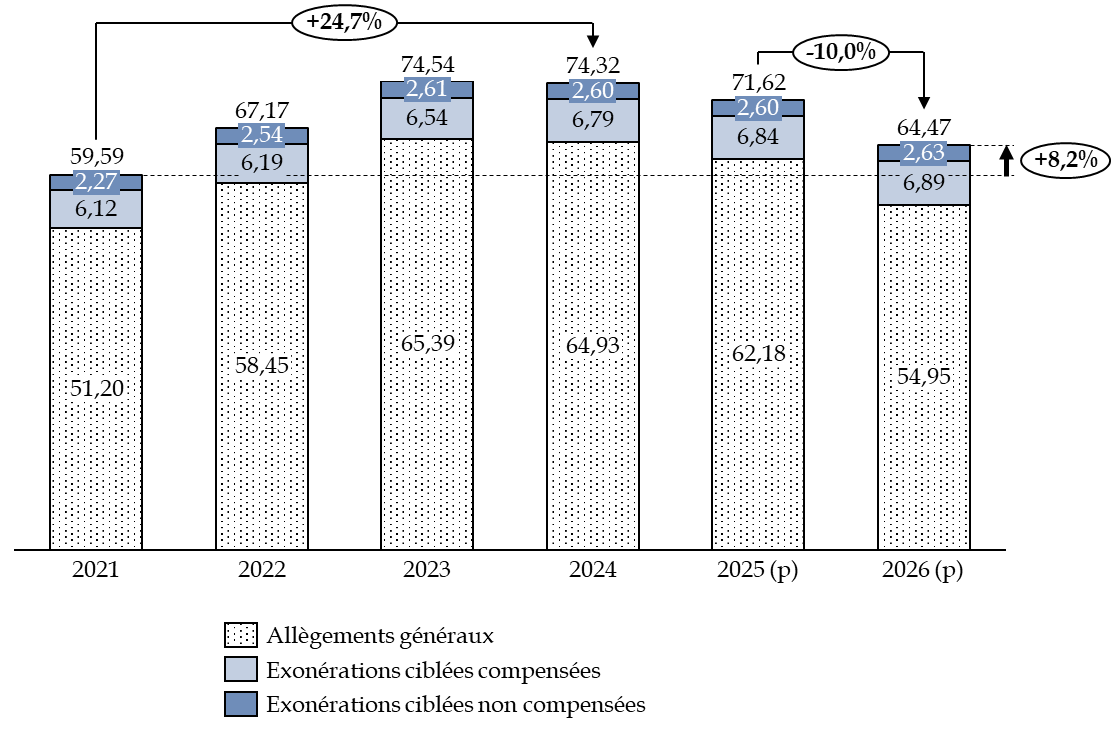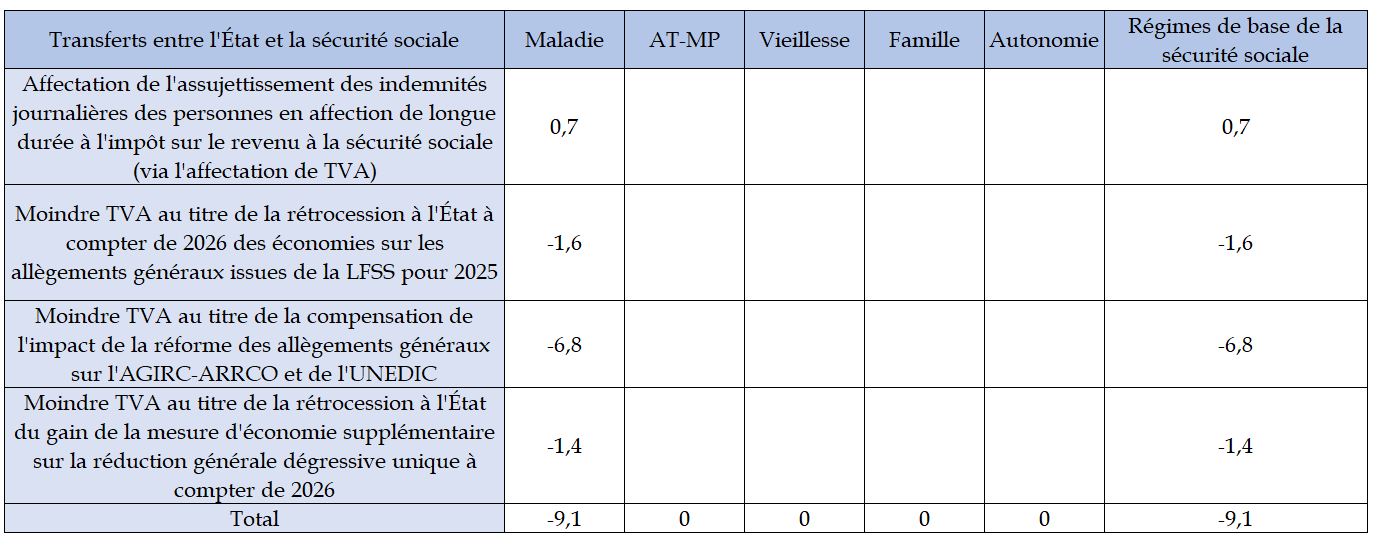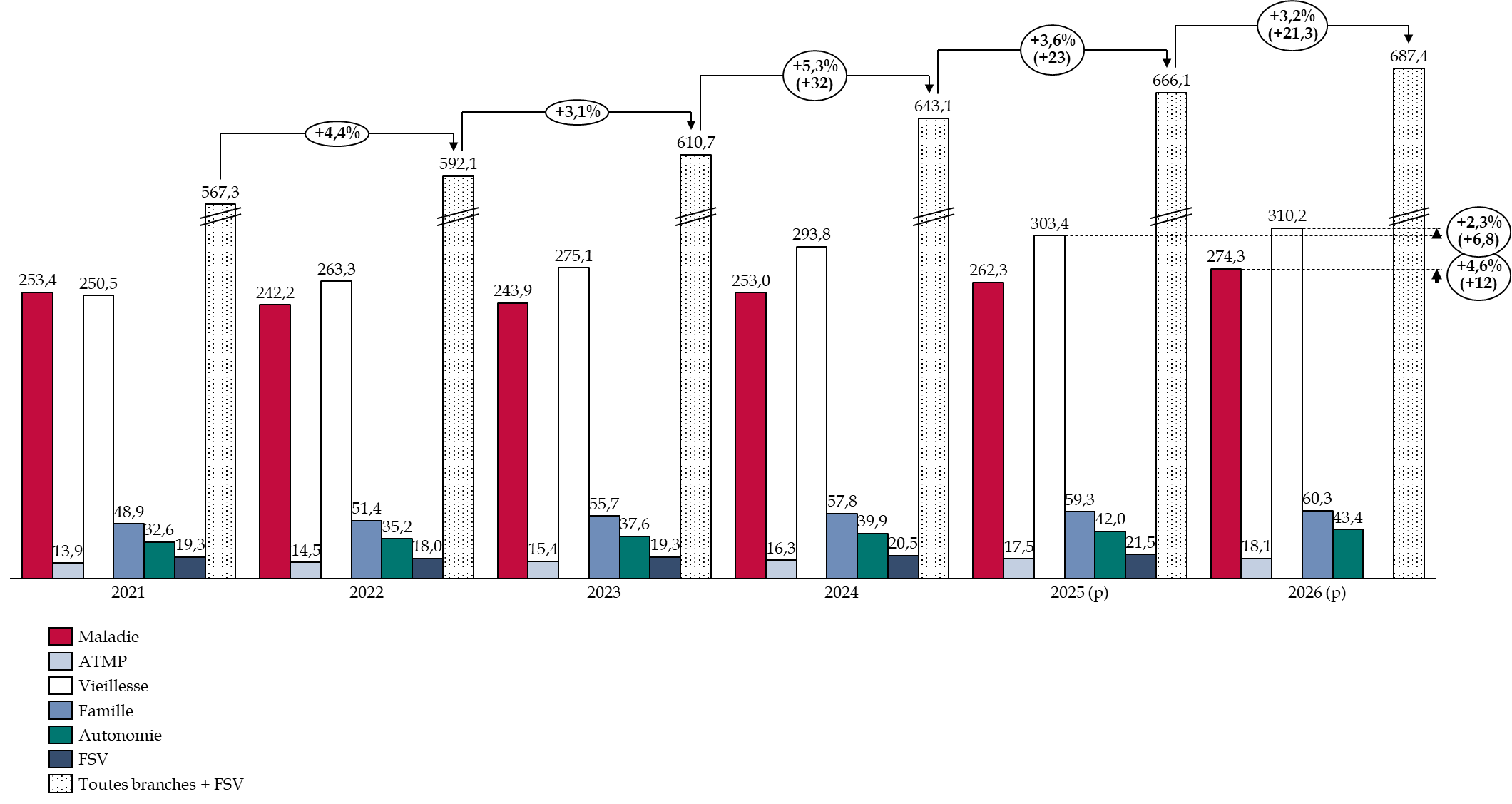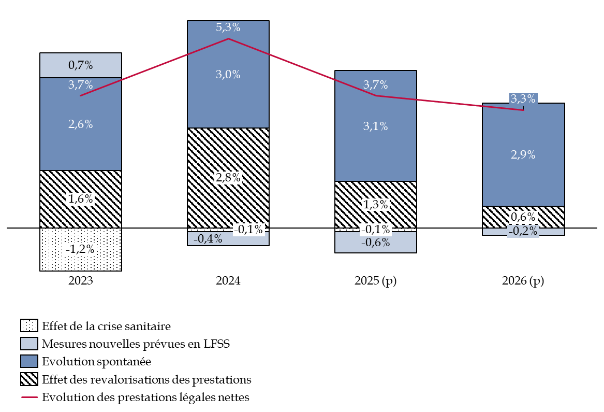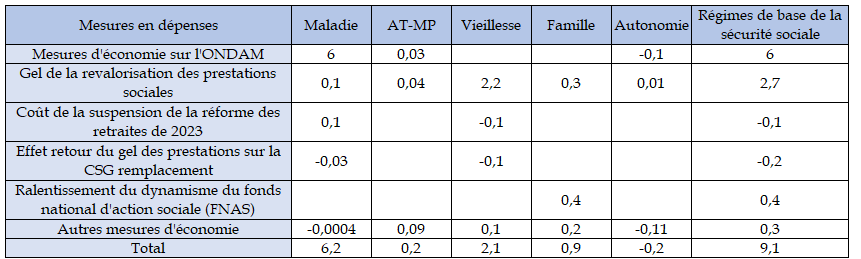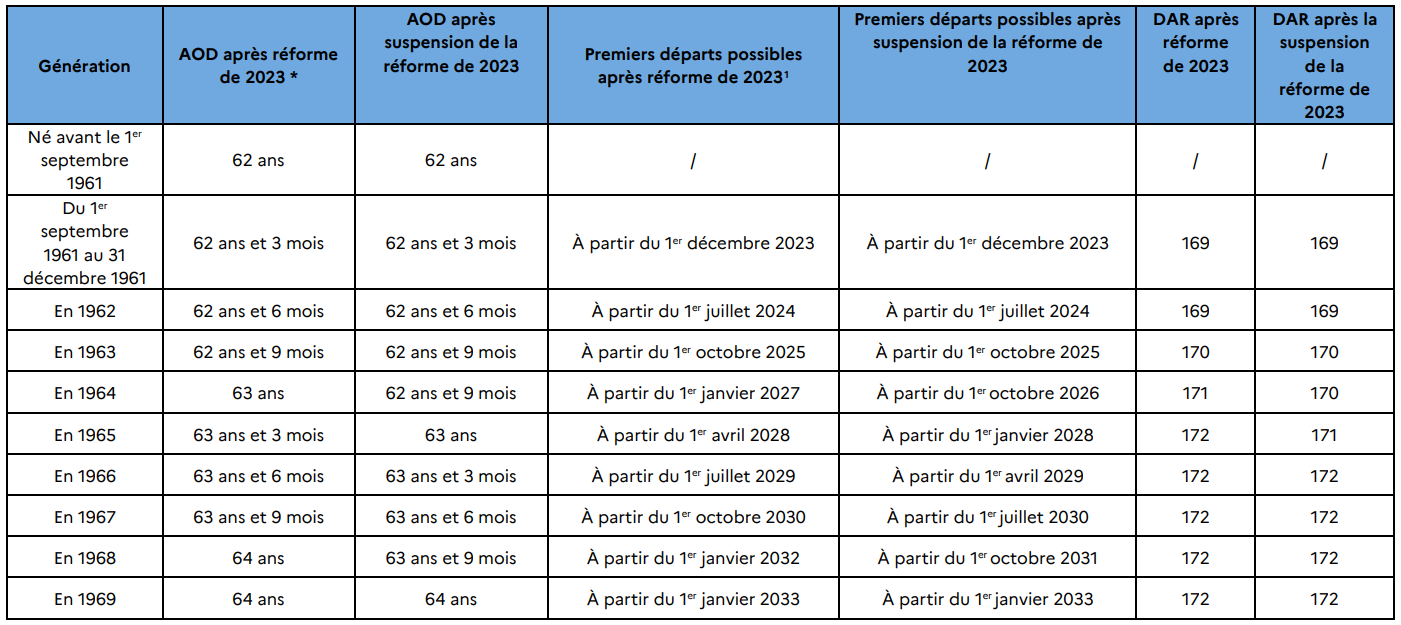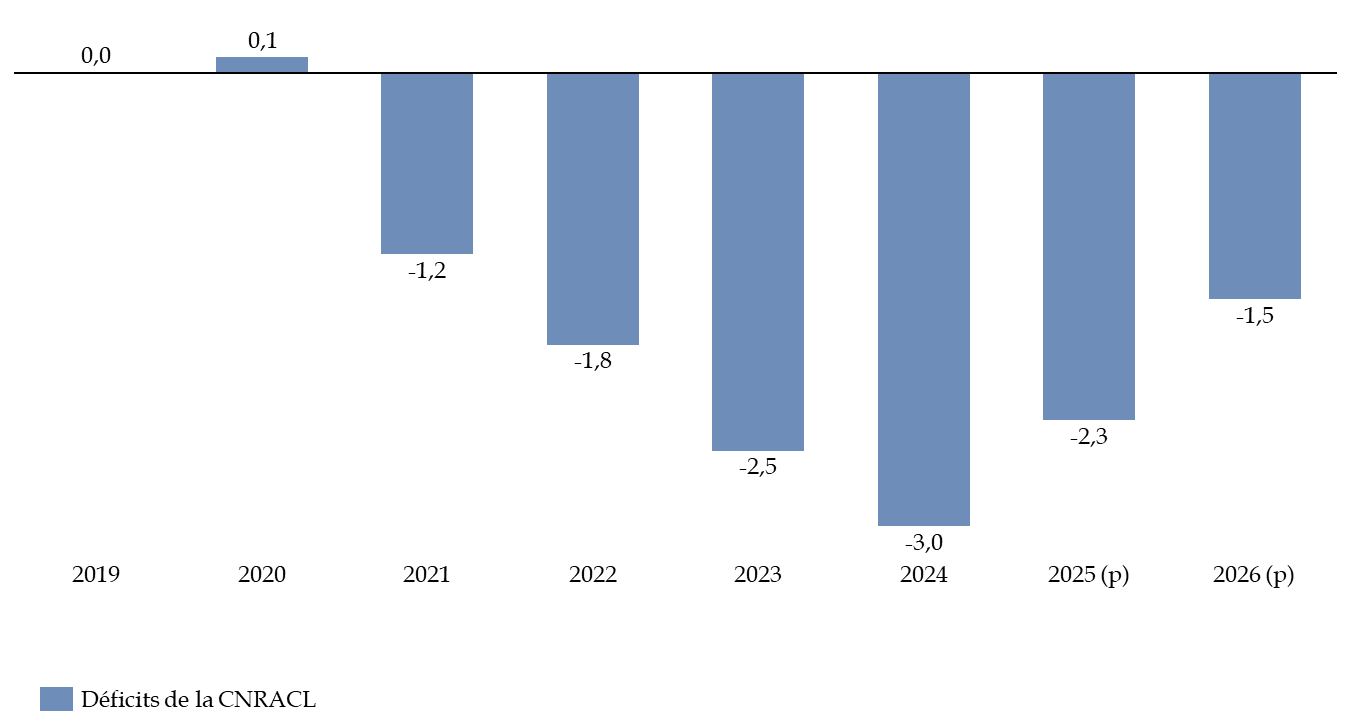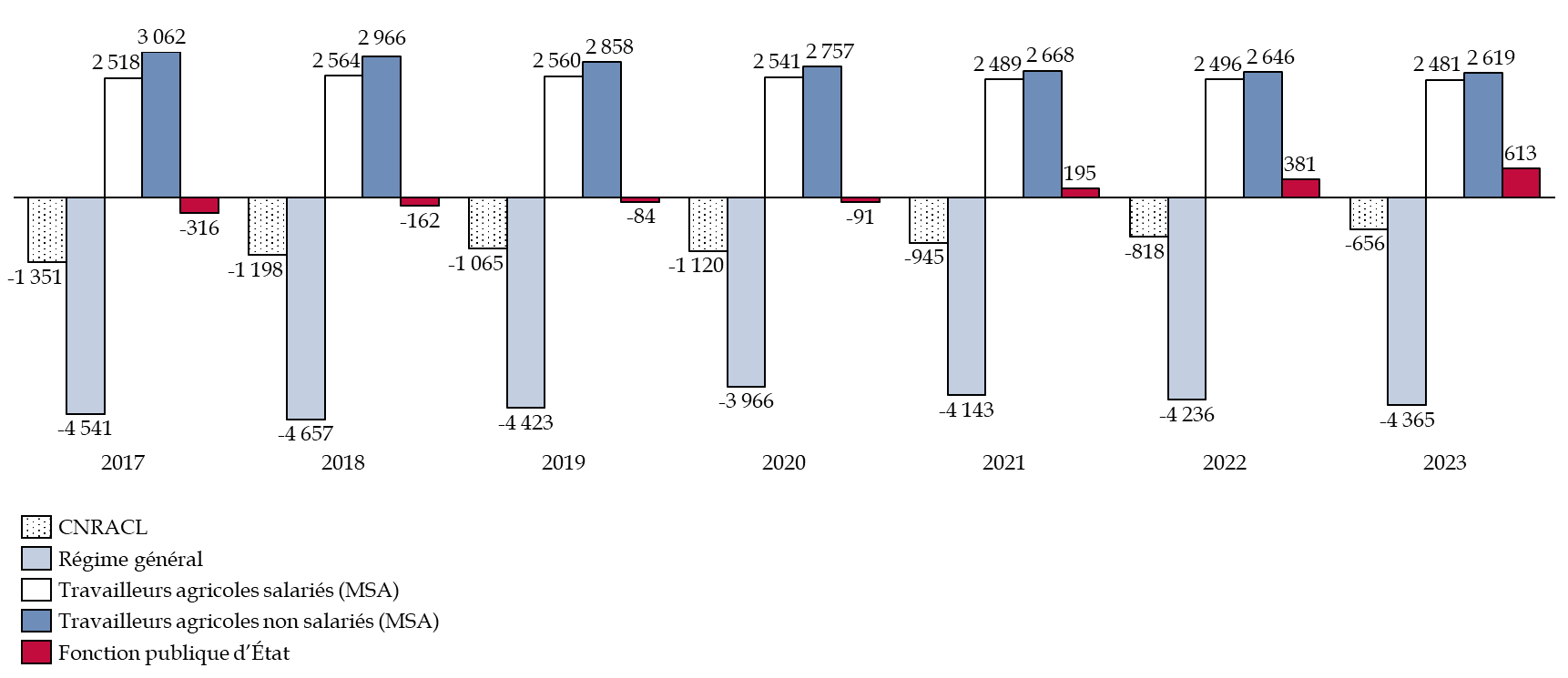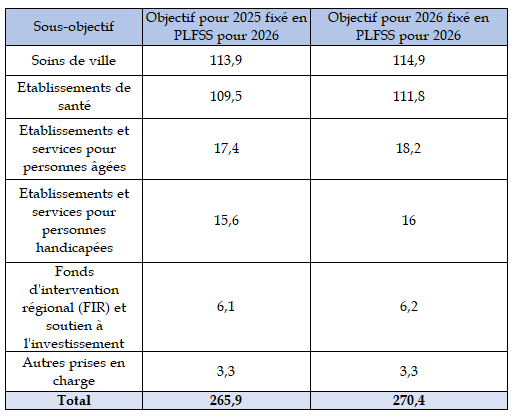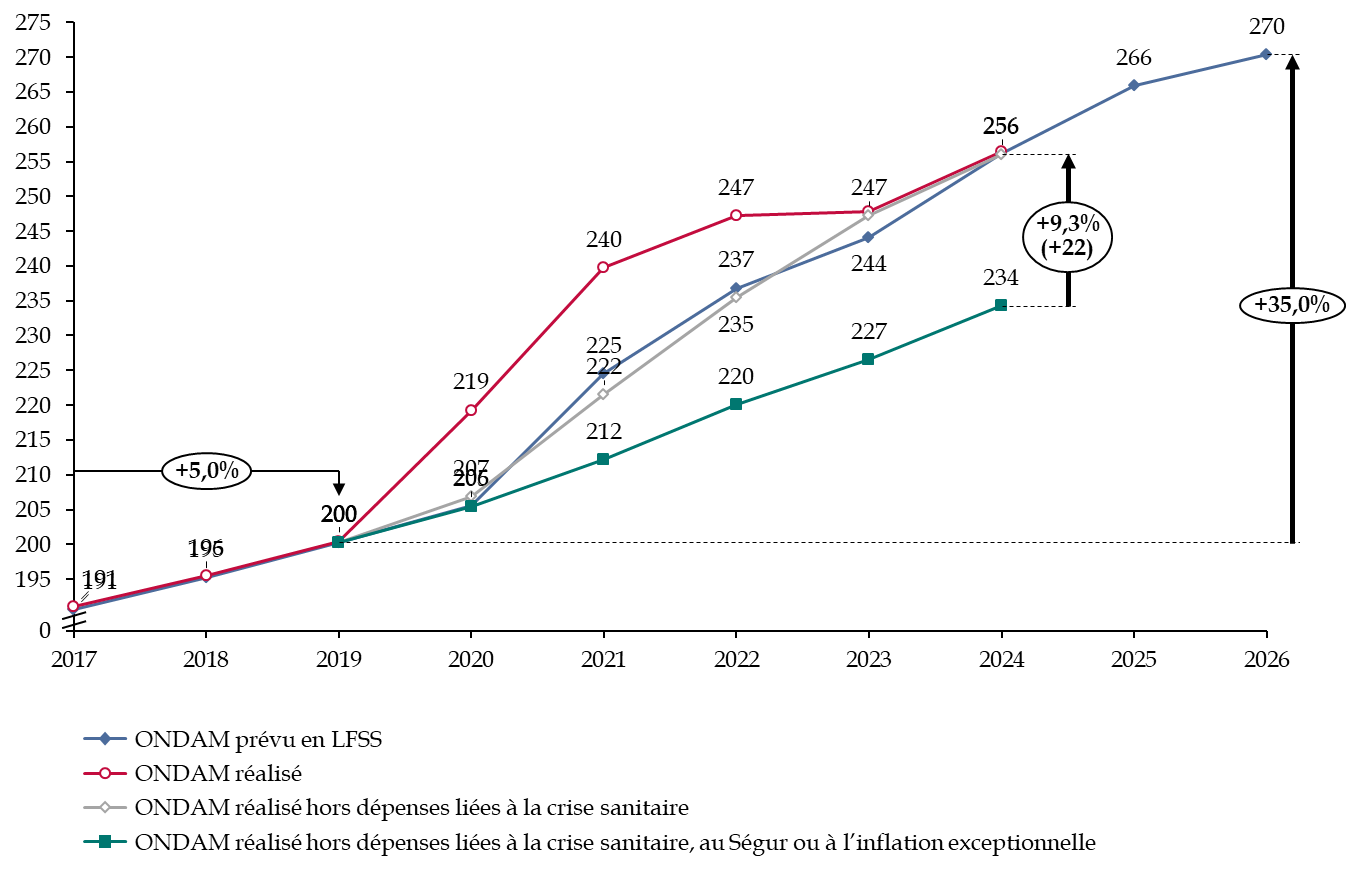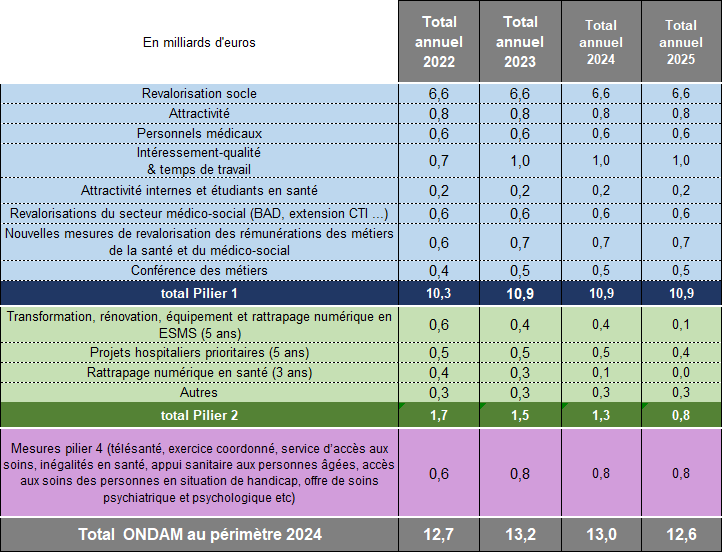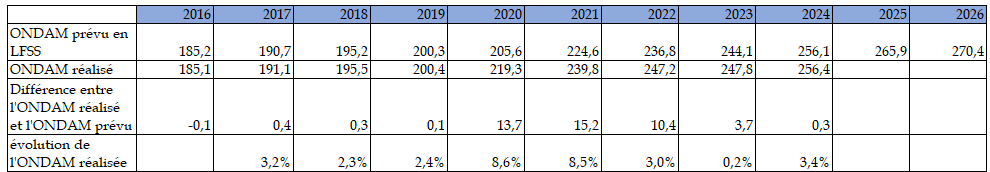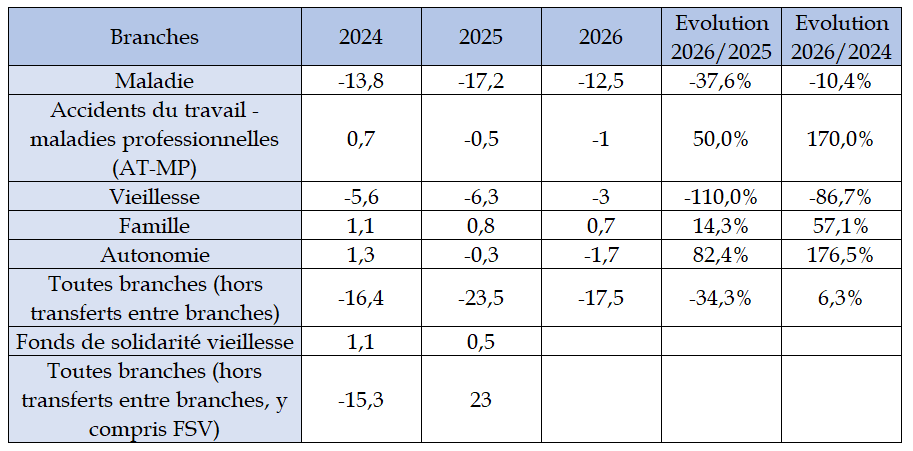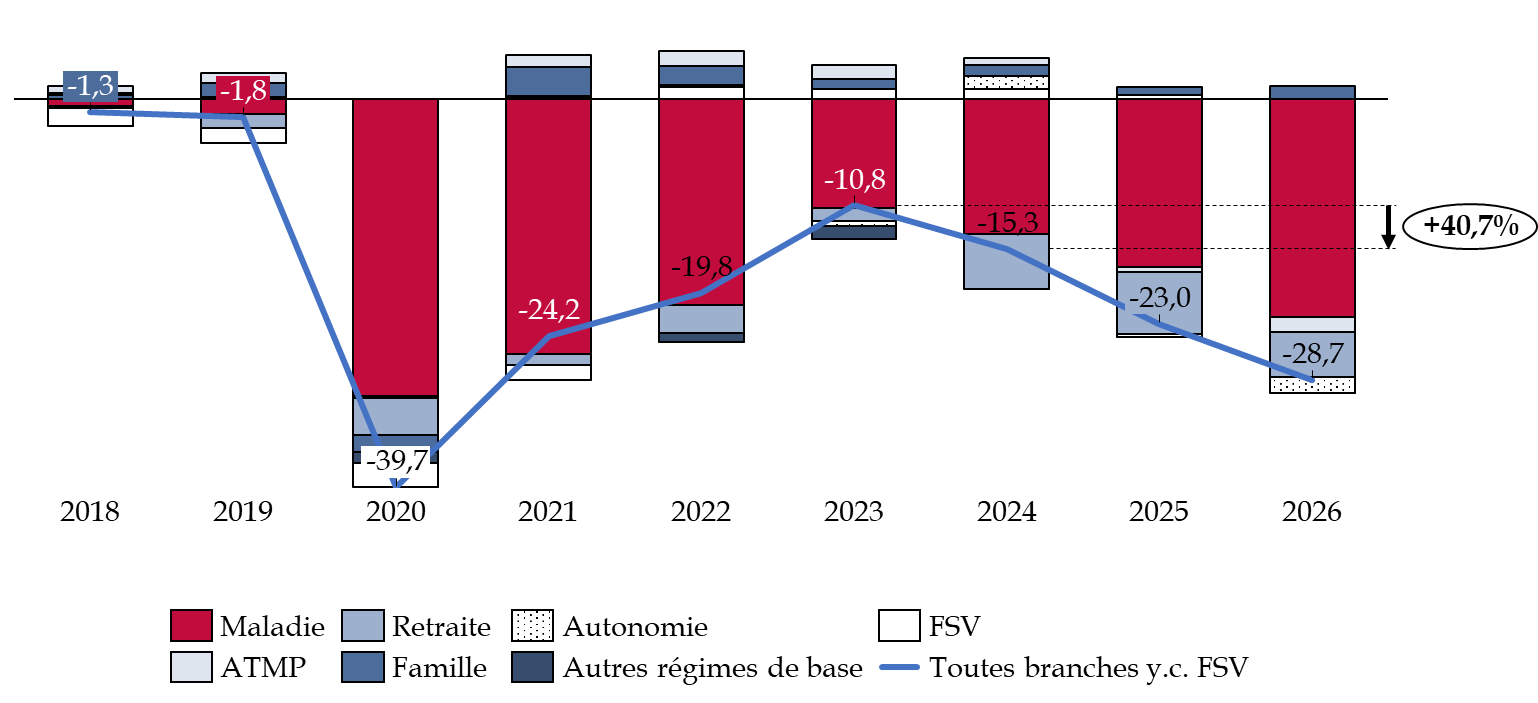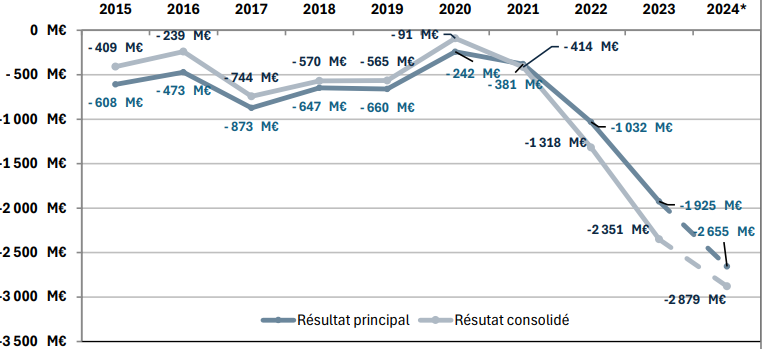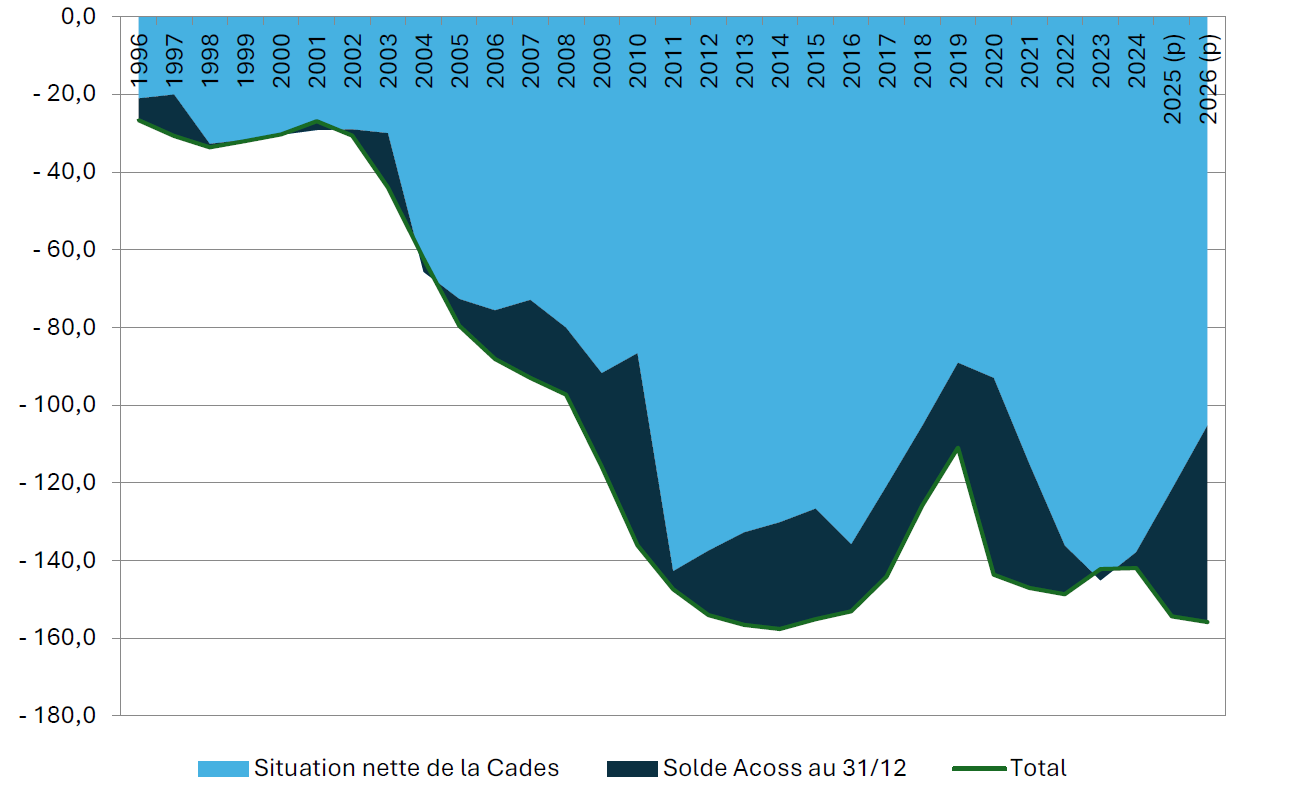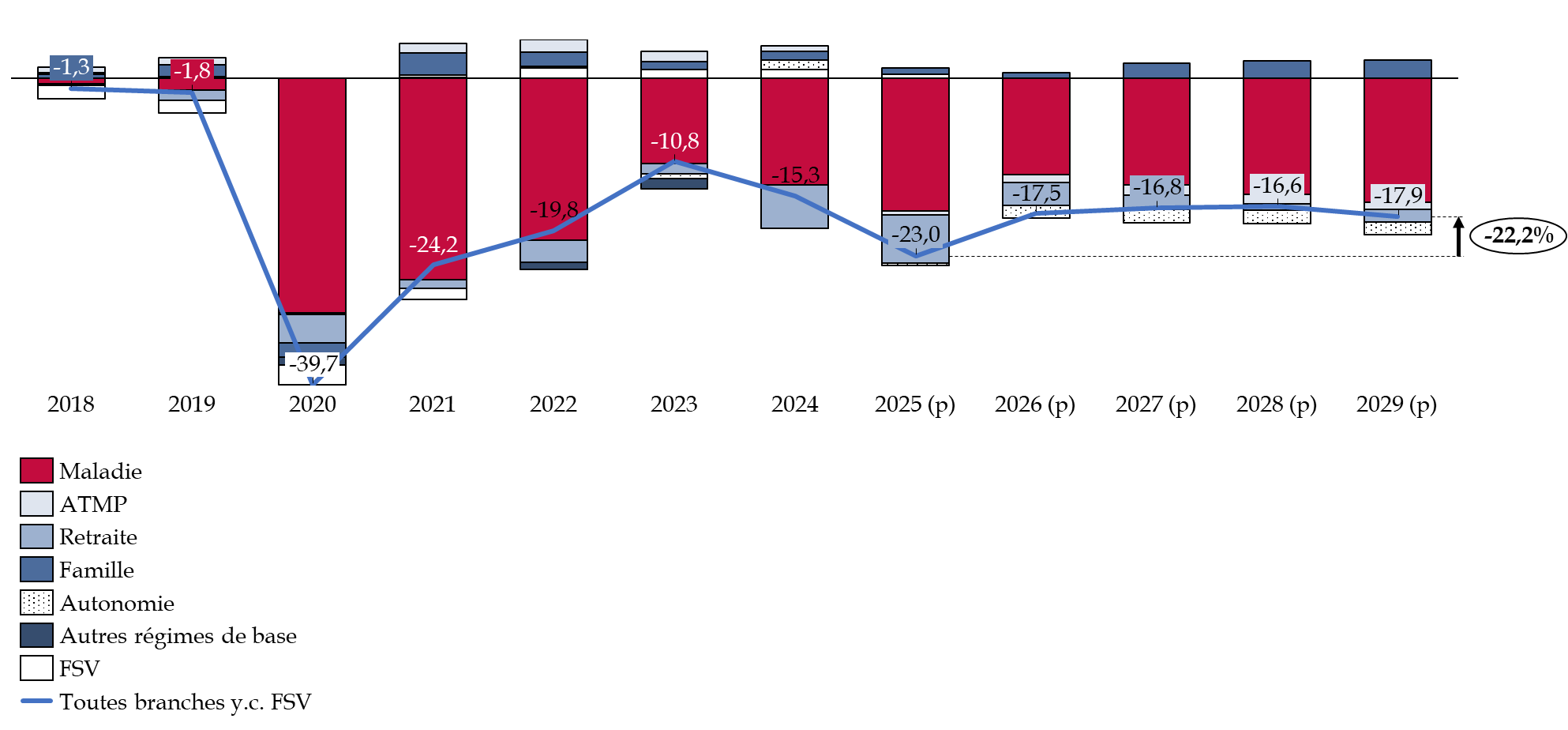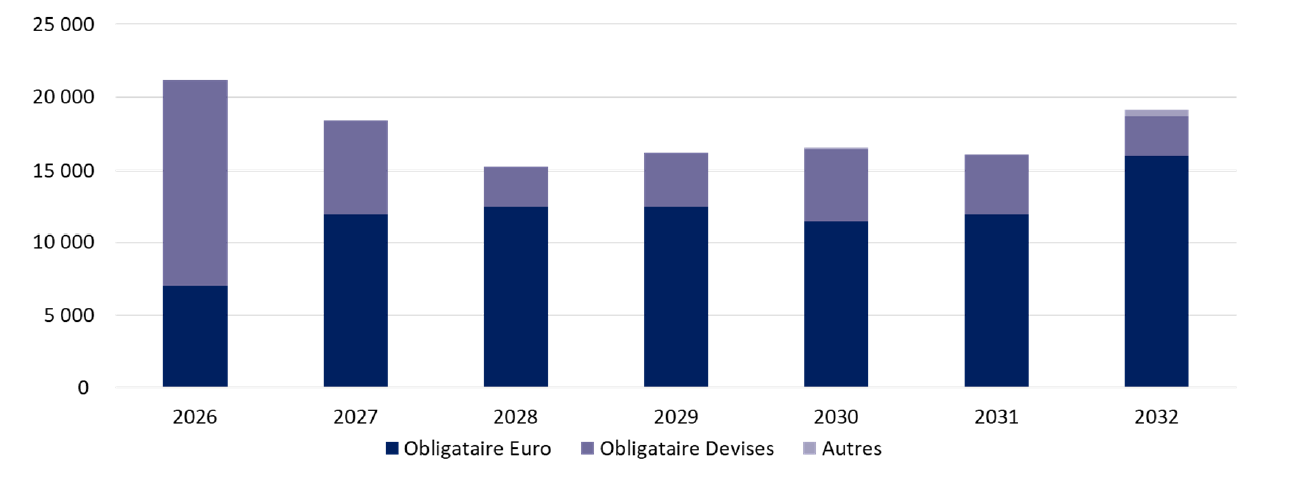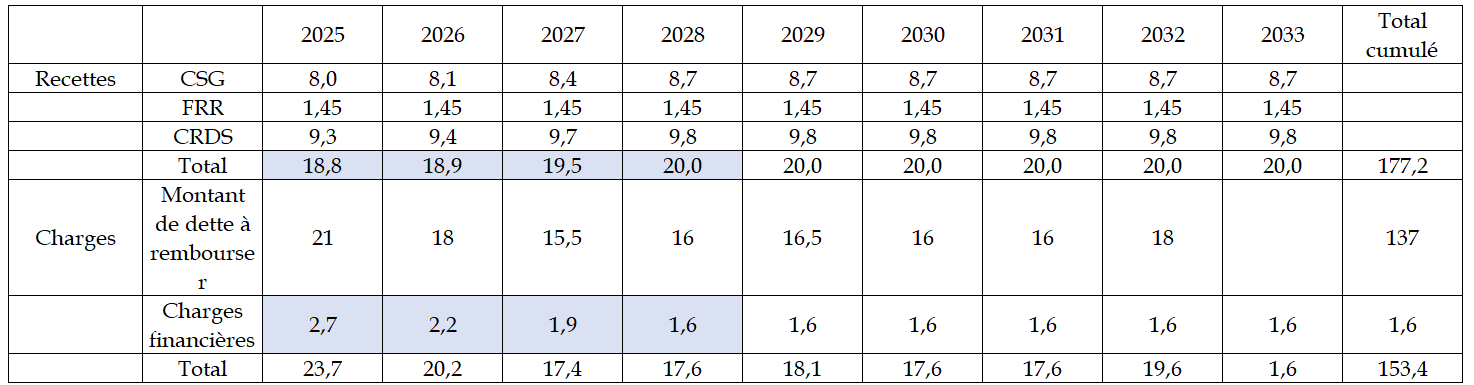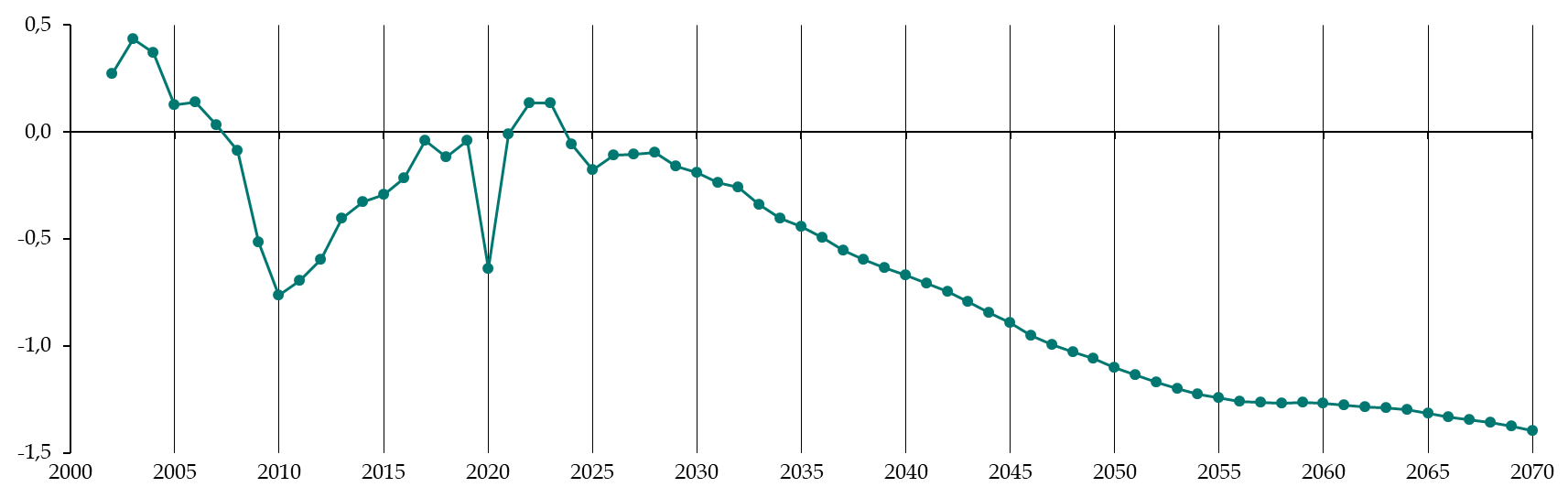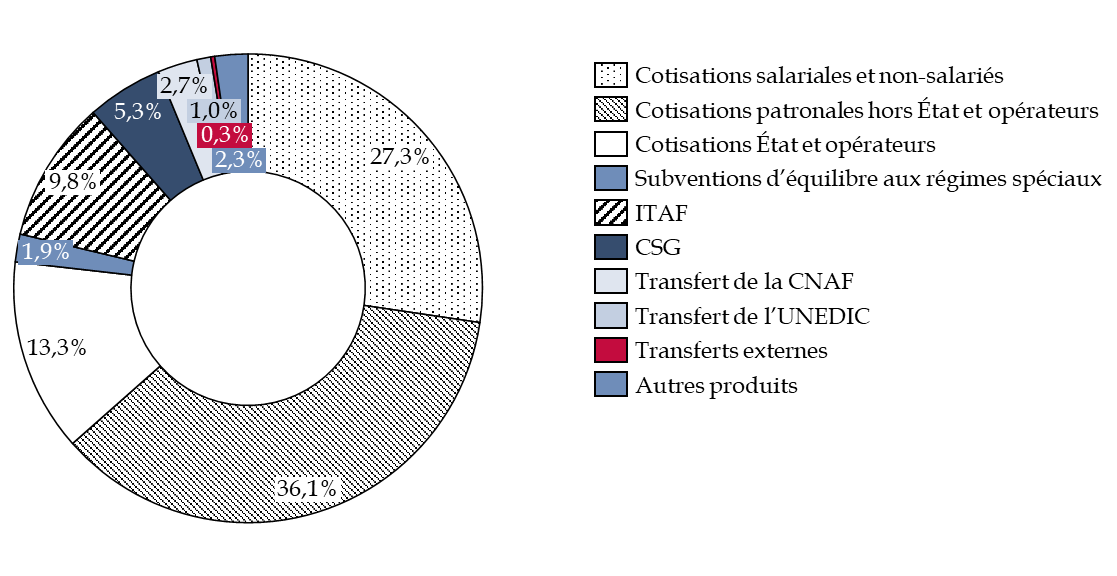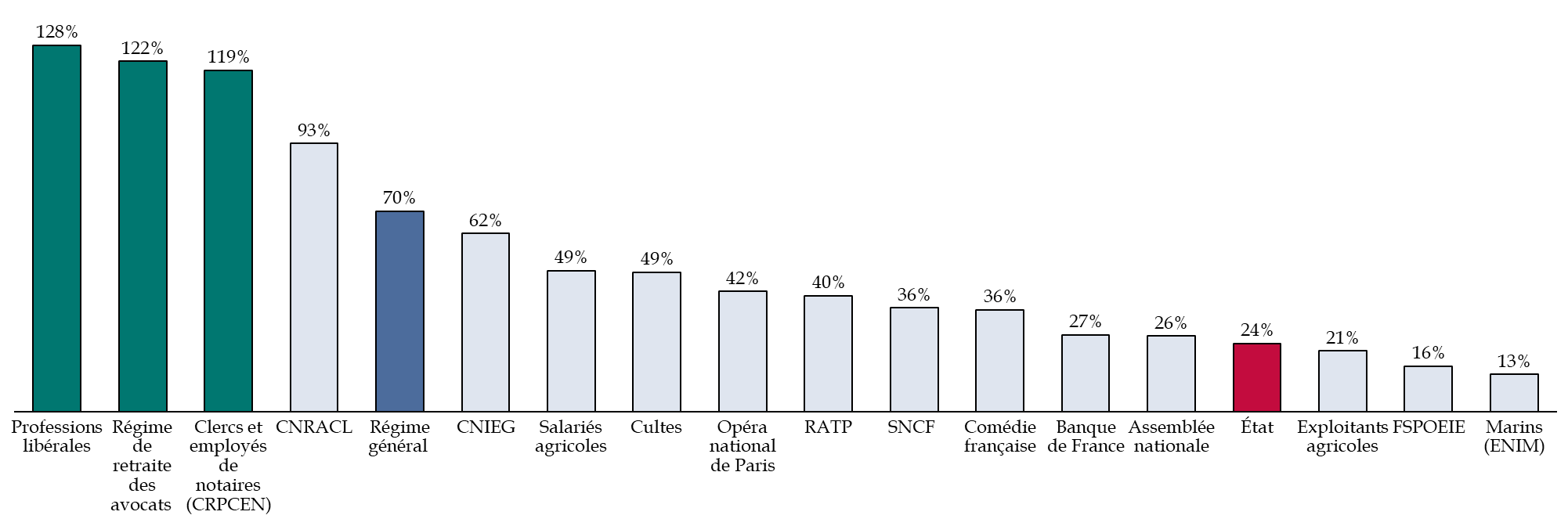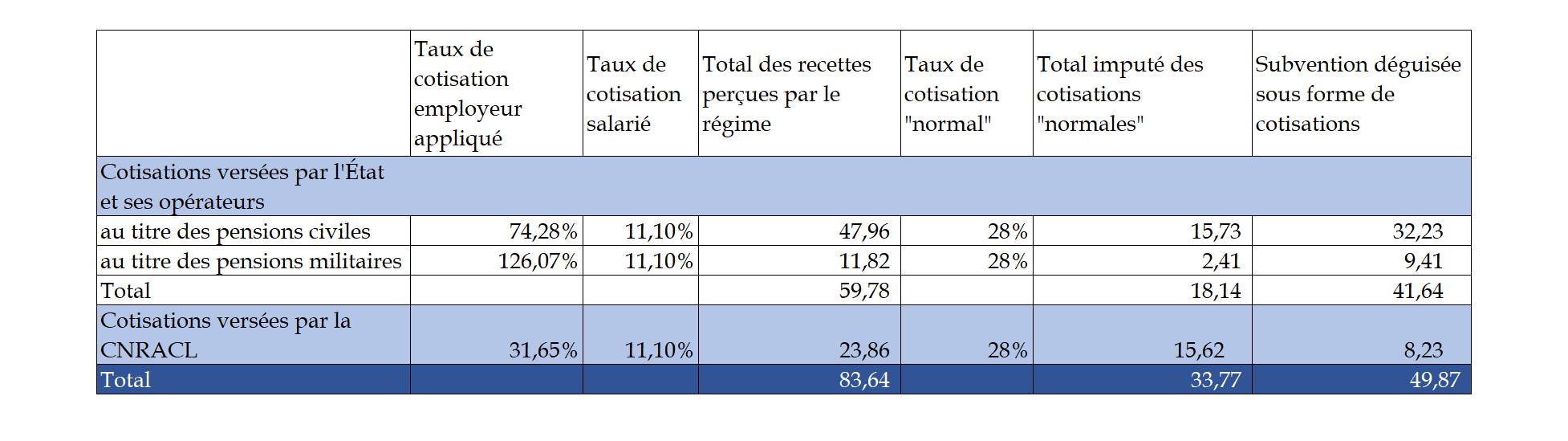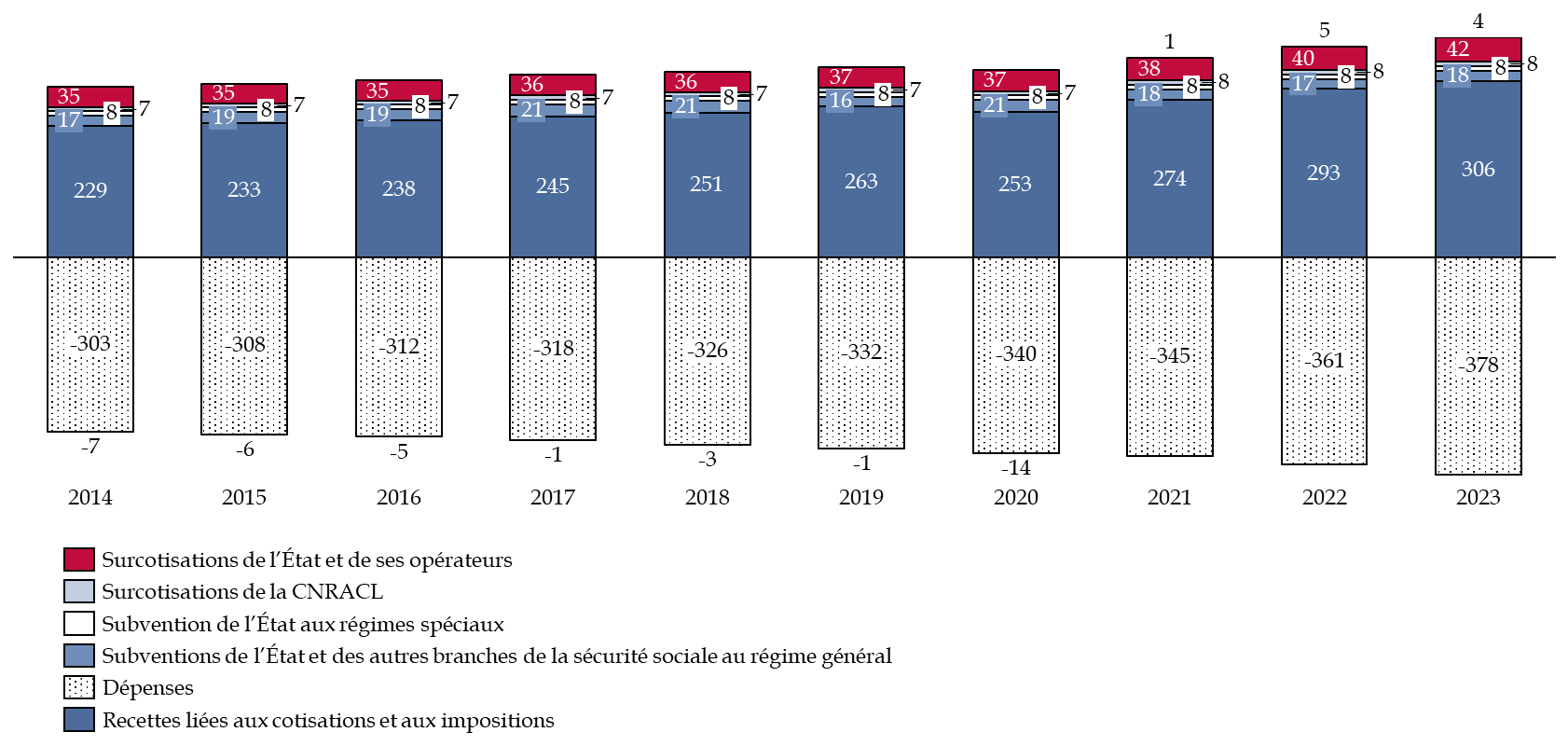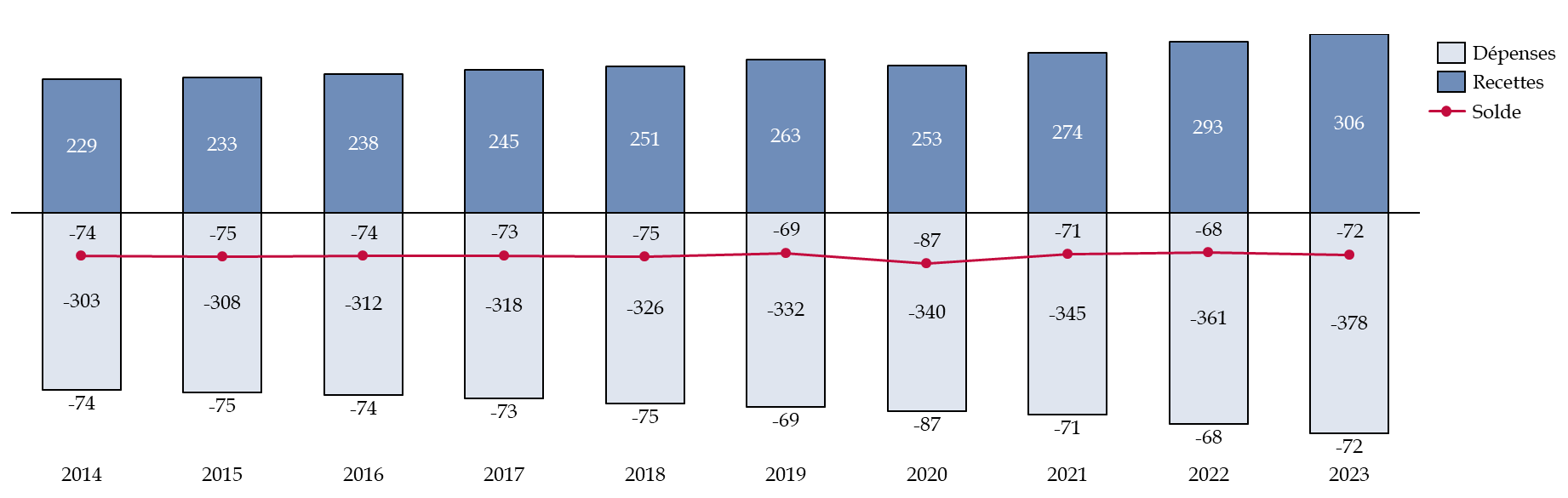- L'ESSENTIEL
- AVANT PROPOS
- I. LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
FIN 2025 : UNE DÉGRADATION DRASTIQUE MAIS MIEUX ANTICIPÉE DU
DÉFICIT
- II. LES ÉVOLUTIONS PRÉVUES
EN 2026 : UN DÉFICIT RESTANT TRÈS ÉLEVÉ,
DÉPENDANT DE MESURES D'ÉCONOMIES DIFFICILES À
CONCRÉTISER
- A. UN RALENTISSEMENT TENDANCIEL DE LA CROISSANCE
DES RECETTES, MALGRÉ LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS
GÉNÉRAUX
- B. UNE HAUSSE STRUCTURELLE DES DÉPENSES, QUE
LES MESURES D'ÉCONOMIES PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT NE
PARVIENDRONT PAS À CONTENIR
- 1. Des propositions d'économies
de 9,1 milliards d'euros dans la copie initiale du
gouvernement
- 2. Des économies substantielles sur la
branche « vieillesse » grâce au gel des pensions
pourtant supprimé par l'Assemblée nationale et minorées
par la suspension de la réforme des retraites
- 3. Des dépenses structurellement très
élevées de la branche « maladie »
- 4. Les branches « famille »
et « AT-MP » en hausse modérée, mais une
augmentation relativement élevée des dépenses de la
branche « autonomie »
- 1. Des propositions d'économies
de 9,1 milliards d'euros dans la copie initiale du
gouvernement
- C. UN SOLDE TRÈS ÉLEVÉ EN
2026, DEMEURANT SUPÉRIEUR À CELUI DE 2024 MÊME EN
INCLUANT LES MESURES NOUVELLES DU PLFSS PRÉSENTÉES
INITIALEMENT
- A. UN RALENTISSEMENT TENDANCIEL DE LA CROISSANCE
DES RECETTES, MALGRÉ LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS
GÉNÉRAUX
- III. DES DÉFICITS DEMEURANT TRÈS
ÉLEVÉS JUSQU'EN 2029 : UN REPORT DE L'EXTINCTION DE LA DETTE
SOCIALE PRATIQUEMENT INÉVITABLE
- IV. UN POIDS DU SYSTÈME DES RETRAITES SUR
LES DÉPENSES PUBLIQUES ENCORE SOUS-ESTIMÉ
- A. UN SYSTÈME DES RETRAITES
STRUCTURELLEMENT DÉFICITAIRE JUSQU'EN 2070
- 1. Une dégradation à venir du
déficit lié au système des retraites, compte tenu de la
moindre progression des recettes par rapport aux dépenses
- 2. Un financement des retraites dépendant
des subventions publiques
- 3. Des cotisations insuffisantes pour financer les
pensions servies pour la quasi-totalité des régimes de base
- 1. Une dégradation à venir du
déficit lié au système des retraites, compte tenu de la
moindre progression des recettes par rapport aux dépenses
- B. UNE NÉCESSITÉ : MIEUX
INFORMER SUR LE POIDS RÉEL DES RETRAITES DANS LES DÉPENSES
PUBLIQUES
- 1. La cotisation
« employeur » de l'État et des
collectivités territoriales permet de pallier les besoins de financement
des régimes de retraite des fonctionnaires
- 2. L'État subventionne les
déséquilibres démographiques de tout le système de
retraite à travers le régime des fonctionnaires de l'État
- 3. Un système largement déficitaire
dont le financement repose sur l'endettement de l'État et des
administrations publiques
- 1. La cotisation
« employeur » de l'État et des
collectivités territoriales permet de pallier les besoins de financement
des régimes de retraite des fonctionnaires
- A. UN SYSTÈME DES RETRAITES
STRUCTURELLEMENT DÉFICITAIRE JUSQU'EN 2070
- I. LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
FIN 2025 : UNE DÉGRADATION DRASTIQUE MAIS MIEUX ANTICIPÉE DU
DÉFICIT
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 126
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2025
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des finances (1) sur le projet
de loi de financement
de la
sécurité sociale, dont le Sénat
est saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la
Constitution, pour 2026,
Par M. Vincent DELAHAYE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1907, 1999, 2057 et 2049 |
|
Sénat : |
122 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte sur près de 680 milliards d'euros de dépenses publiques. Comme chaque année, la commission des finances s'en est saisie pour avis.
I. LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIN 2025 : UNE DÉGRADATION DRASTIQUE MAIS MIEUX ANTICIPÉE DU DÉFICIT
A. UN DÉFICIT EN 2025 CONFORME À LA PRÉVISION
Pour 2025, le déficit anticipé devrait s'élever à 23 milliards d'euros, soit un écart modéré de 900 millions d'euros par rapport à la prévision de la LFSS pour 2025, liés à de moindres recettes. Cette sincérisation des prévisions de déficit de la sécurité sociale est bienvenue et doit être poursuivie.
Comme depuis 2020, l'essentiel du déficit des comptes sociaux se concentre sur la branche maladie (- 17,2 milliards d'euros en 2025) et sur la branche vieillesse (- 6,3 milliards d'euros en 2025).
B. DES RECETTES QUI AUGMENTENT MOINS VITE QUE LES DÉPENSES
L'explication du creusement du déficit de la sécurité sociale en 2024 et 2025 s'explique largement par la moindre dynamique des recettes par rapport à celle des dépenses. Ainsi, depuis 2024, pour la première fois depuis 2012, à l'exception de 2019 et 2020, l'augmentation des dépenses est supérieure de pratiquement 0,7 point de pourcentage par rapport à celle des recettes, en raison de mesures de hausse des dépenses non financées, comme le Ségur de la santé, et de la revalorisation des prestations sociales sur l'inflation.
Taux d'évolution des recettes et des
dépenses de la Sécurité sociale
entre
2012 et 2025
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2025
Les dépenses liées au Ségur représentent un surcoût de 13 milliards d'euros par an, soit plus de la moitié du déficit actuel de la sécurité sociale.
II. LES ÉVOLUTIONS PRÉVUES EN 2026 : UN DÉFICIT TRÈS ÉLEVÉ, DÉPENDANT DE MESURES D'ÉCONOMIES DIFFICILES À RÉALISER
Dans le PLFSS tel que déposé par l'Assemblée nationale :
|
le déficit de la sécurité sociale s'élèverait à |
Il intègrerait |
et |
|
en incluant les mesures nouvelles du texte initial. |
de mesures en hausse de recettes et en transfert |
d'économies sur les dépenses. |
Mesures en dépenses proposées par le PLFSS pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
Or la réalisation des mesures de hausse de recettes et de diminution des dépenses parait très compromise après l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
- En particulier, la hausse des plafonds et des montants sur les franchises médicales et les participations forfaitaires, pour un montant de 2,3 milliards d'euros a été très critiquée et son extension aux actes des chirurgiens-dentistes et aux dispositifs médicaux a été supprimée.
- L'Assemblée a supprimé le gel des prestations sociales, qui aurait représenté une économie nécessaire de 2,7 milliards d'euros, ce qui est regrettable.
- Par ailleurs, la suspension de la réforme des retraites de 2023 introduite par lettre rectificative et adoptée par l'Assemblée représentera un coût de 100 millions d'euros en 2026 et de 800 millions d'euros en 2027, selon l'étude d'impact. L'impact financier est limité en 2026 au vu de l'adoption tardive de la mesure.
À noter, que depuis 2017, l'ONDAM prévu n'a jamais été réalisé, rendant peu crédibles une partie des mesures d'efficience des dépenses de santé envisagées. L'ONDAM a été augmenté de 1 milliard d'euros par l'Assemblée nationale. Sa progression serait de 2 % entre 2025 et 2026, et non 1,6 % comme prévu par le texte initial.
ONDAM prévu et réalisé entre 2016 et 2026
(en milliards d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les documents annexés au PLFSS et au PLACSS entre 2016 et 2026
Hors mesures nouvelles, le déficit de la sécurité sociale s'établirait en 2026 à 28,7 milliards d'euros, soit un niveau dépassé exclusivement en 2010 et en 2020, au plus fort des crises financière et sanitaire. Un tel niveau de déficit n'est pas acceptable ni soutenable pour le système social et appelle à des réformes urgentes.
Évolution du solde des branches de la
sécurité sociale entre 2018 et 2026,
hors mesures nouvelles en
PLFSS
(en milliard d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2026
Après l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le déficit de la sécurité sociale serait compris entre 24 et 25 milliards d'euros, et pourrait se rapprocher de son évolution tendancielle, hors mesures nouvelles, de 28,7 milliards d'euros.
III. DES DÉFICITS DEMEURANT TRÈS ÉLEVÉS JUSQU'EN 2029 : UN INDISPENSABLE RETOUR À L'ÉQUILIBRE DES COMPTES SOCIAUX
Le déficit de la sécurité sociale continuerait de plus à se dégrader, pour s'établir à 16,8 milliards d'euros en 2027, 16,6 milliards d'euros en 2028 et 17,9 milliards d'euros en 2029. La dette sociale augmenterait de 110 milliards d'euros entre 2023 et 2029. Elle s'élève à 163,3 milliards d'euros fin 2025.
Évolution de la dette sociale entre 2019 et 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après la Cour des comptes
Or il n'est plus possible depuis 2025 de transférer des excédents à la CADES, le plafond autorisé de 136 milliards d'euros de reprise de dette ayant été atteint. En conséquence, c'est l'ACOSS qui emprunte pour couvrir les déficits du système, à hauteur de 83 milliards d'euros.
Cette situation fait toutefois courir un risque important de refinancement à l'ACOSS, qui ne peut emprunter qu'à court terme. Cette situation n'est pas pérenne et une reprise de dette par la CADES pourrait être envisagée. Toutefois, la maitrise de la trajectoire des comptes sociaux est absolument indispensable pour permettre de transférer les déficits restants à la CADES.
IV. UN POIDS DU SYSTÈME DES RETRAITES SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES ENCORE SOUS-ESTIMÉ
Le déficit du système des retraites est voué à s'accentuer. Il représenterait - 0,2 % du PIB en 2030, - 1,1 % en 2050 et - 1,4 % en 2070. Or à l'exception notable des régimes des professions libérales, des avocats et des clercs et employés de notaires, les cotisations ne permettent pas de couvrir l'ensemble des prestations servies pour la plupart des régimes.
Évolution du solde du système des retraites entre 2000 et 2070
(en pourcentage du PIB, prévisions à partir de 2024)
Source : commission des finances d'après le COR
Ainsi, concernant le régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État, afin d'équilibrer le système, l'État verse directement une cotisation dite « d'équilibre », mais à un taux de cotisation beaucoup plus élevé que dans le privé (98 % en moyenne, contre 15,5 % pour le régime général). Un même système est utilisé pour la CNRACL.
En distinguant les cotisations dites normales, relevant d'un taux de cotisation employeur de 28 %, soit le taux plafond légal aux cotisations, de ce qui relève de la subvention, les cotisations relevant d'un taux « normal » et les impôts et taxes affectées ne couvrent que 81 % du coût des retraites dans l'ensemble du système. Le besoin de financement du système des retraites s'élève ainsi à 72 milliards d'euros.
L'institut1(*) des politiques publiques montre notamment que l'État compenserait à travers le régime des retraites de la fonction publique le déséquilibre démographique global du système des retraites, pour un coût estimé en 2020 à 18 milliards d'euros, au profit notamment du régime général.
Il est particulièrement dommage que le PLFSS ne présente pas cette information de façon claire. Un couplage avec une présentation du solde des retraites pour l'ensemble de la sphère publique, comme le recommande Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale de la mission « Régimes sociaux et de retraite » et du compte d'affectation spéciale « Pensions », serait bienvenu.
AVANT PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 couvre un champ considérable des finances publiques par ses dépenses (659,5 milliards d'euros en 2026) et ses recettes (676,9 milliards d'euros), celles-ci provenant à 46,5 % d'« impositions de toute nature » (CSG, impôts et taxes affectés) et de charges budgétaires (cotisations d'équilibre de l'État employeur, subventions aux régimes sociaux et de retraite, compensation d'exonérations sociales).
En raison du poids de ce texte dans les finances publiques et de son impact macro-économique, la commission des finances, comme chaque année, en est saisie pour avis.
Le présent rapport pour avis vise à établir un tableau synthétique de la situation financière de la sécurité sociale et à donner l'appréciation de la commission des finances, après les avoir présentés, sur les principaux arbitrages opérés par le projet de loi et leurs effets sur l'évolution des ressources, des dépenses et du solde de celle-ci en 2026 et au-delà.
En vertu de l'article 47-1, alinéa 2 de la Constitution, le projet de loi a été transmis au Sénat le jeudi 13 novembre 2025.
Il est complété par les articles 4 bis, 5 bis à 5 quater, 6 bis à 6 ter, 7 bis, 7 ter, 8 bis à 8 octies, 9 bis à 9 septies, 10 bis, 10 ter, 11 bis à 11 septies, 12 bis à 12 undecies, 16 bis, 18 bis à 18 quater, 20 bis à 20 duodecies, 21 bis à 21 decies, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 25 bis, 26 bis à 26 quater, 27 bis, 27 ter, 28 bis et 28 ter.
I. LA SITUATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIN 2025 : UNE DÉGRADATION DRASTIQUE MAIS MIEUX ANTICIPÉE DU DÉFICIT
Après avoir atteint en 2020 un niveau inégalé proche de 40 milliards d'euros, le déficit de la sécurité sociale s'est réduit les années suivantes : il atteignait ainsi 10,8 milliards d'euros en 2023. En 2024, ce déficit a subi à nouveau une forte augmentation et s'élève à 15,3 milliards d'euros. À noter, que les dépenses du Ségur de la santé représentent 13 milliards d'euros en 2024 : le déficit aurait donc été réduit à 2 milliards d'euros en l'absence de mise en oeuvre de ces mesures non financées.
Outre que cette dramatique aggravation des comptes de la Sécurité sociale est très inquiétante, elle a également été très mal anticipée. L'écart entre les prévisions établies dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et les prévisions actualisées présentées dans la loi de financement pour 2025 interrogeaient quant à la fiabilité des prévisions qui avaient été présentées en 2024. La LFSS pour 2024 avait en effet estimé le déficit pour 2024 à 10,5 milliards d'euros, alors que le déficit réalisé a été de 15,3 milliards d'euros.
Toutefois, en LFSS pour 2025, le déficit pour 2024 avait été estimé à 18,2 milliards d'euros, alors qu'il a été finalement inférieur de 2,9 milliards d'euros. Pour 2025, le déficit anticipé a été fixé à 22,1 milliards d'euros, alors qu'il devrait être de 23 milliards d'euros, selon la prévision du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit un écart modéré de 900 millions d'euros liés à des moindres recettes de 2,5 milliards d'euros, contrebalancées par des moindres dépenses, notamment sur les prestations maladie et famille non incluses dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Cette sincérisation des prévisions de déficit de la sécurité sociale est bienvenue et doit être poursuivie. Le coût du Ségur de la santé s'élève à 12,6 milliards d'euros en 2025, représentant près de la moitié du déficit anticipé.
Principaux écarts entre les
prévisions de solde pour 2024 et 2025
inscrites en LFSS
pour 2025 et en PLFSS pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'annexe n° 3 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
A. DES RECETTES DE MOINS EN MOINS DYNAMIQUES, EN RAISON D'UNE SURESTIMATION DE LA TVA
1. Un ralentissement de la progression des recettes en raison de la conjoncture économique peu favorable
Les recettes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) avaient bénéficié d'un fort effet rebond en 2021 et 2022 et leur dynamique s'est avérée supérieure à celle des dépenses, pourtant encore soutenue. Entre 2022 et 2023, les recettes des régimes de base et du FSV ont progressé de 4,8 %, soit un rythme ralenti par rapport à 2021 et 2022 (+ 5,4 %). Entre 2023 et 2024, les recettes n'ont augmenté que de 4,6 %, soit une hausse plus faible que les années précédentes, en raison de la normalisation de l'évolution des prix et d'une croissance modérée. Entre 2024 et 2025, les recettes augmenteraient de seulement 2,4 %, soit un rythme bien inférieur à celui des années précédentes, ainsi qu'à celui des dépenses, de 3,2 %.
Évolution des recettes de la Sécurité sociale entre 2023 et 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2025
Les cotisations sociales progresseraient pourtant à hauteur de 4 %, après une croissance de 4,5 % entre 2023 et 2024. La hausse des cotisations du secteur privé (de 4,1 %) est en effet stimulée par le gel du SMIC de référence pris en compte pour le calcul des allègements de cotisations maladie et famille (opéré en LFSS pour 2024), puis par l'abaissement du seuil des allègements généraux de cotisations maladie et famille respectivement à 2,25 et 3,3 SMIC. L'intégration de la prime de partage de la valeur dans l'assiette de cotisation permet également d'augmenter les cotisations. Au total, ce sont 3,1 milliards d'euros supplémentaires de cotisations qui seront perçus en 2025 par rapport à 2024. Les cotisations du secteur public demeurent également dynamiques, à hauteur de 4,4 %, en raison de la hausse de 3 points du taux de cotisations patronales des collectivités territoriales et des hôpitaux à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Les recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) n'augmenteraient en revanche que de 2,1 % en 2025, contre 6,2 % en 2024, partiellement en raison de la réaffectation des recettes de la CADES à la CNSA en 2024 qui a gonflé les recettes cette année-là. Hors cette mesure de périmètre, la progression de la CSG serait ralentie par la moindre dynamique de la masse salariale du secteur privé, de 1,8 %, qui ne se répercute pas sur les recettes de cotisations en raison des réformes des allègements généraux en LFSS de 2024 et 2025.
Enfin, les recettes fiscales connaitraient une diminution modérée de - 0,2 %, après une hausse de 2,6 % en 2024, liée à des prévisions économiques peu favorables, notamment concernant la TVA. L'affectation à la CNSA d'une part supplémentaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et la réévaluation des barèmes de contribution sur les boissons sucrées permettent pourtant de soutenir les recettes fiscales.
2. Des recettes encore surestimées, mais à un degré moindre qu'en 2024
Les recettes de la Sécurité sociale en 2025 sont inférieures de 2,5 milliards d'euros aux prévisions de la LFSS pour 2025, ce qui explique l'essentiel de l'aggravation du déficit de la Sécurité sociale de 0,9 milliard d'euros par rapport à la cible fixée en LFSS pour 2025. Les raisons expliquant l'écart de déficit sont les suivantes :
- d'une part, la surestimation de l'inflation, qui devrait être de 1 % et non de 1,4 % comme envisagé initialement, et de la masse salariale, estimée à 2,5 % en LFSS pour 2025 et réévaluée à 1,8 % en PLFSS 2026 ;
- d'autre part, une hausse de la provision pour non-recouvrement explique une baisse de recettes de 1,4 milliard d'euros.
Il est à noter que le Haut Conseil des finances publiques avait estimé la prévision d'inflation pour 2025 « un peu élevée au regard de l'ampleur du mouvement de désinflation observé depuis le début de l'année » dans son avis du 8 octobre 2024. Une partie de la surestimation des recettes par le Gouvernement aurait donc sans doute pu être évitée par une prévision plus prudente de l'inflation pour 2025.
Il faut toutefois constater que la surestimation des recettes avait été plus forte en 2024 : elles avaient en effet été estimées à 630,7 milliards d'euros en LFSS pour 2024, alors qu'elles se sont élevées à 627,8 milliards d'euros, soit un écart de 3 milliards d'euros.
B. UNE HAUSSE DES DÉPENSES PRINCIPALEMENT TIRÉE PAR LES BRANCHES RETRAITE ET MALADIE
En 2025, les dépenses augmenteraient nettement moins qu'en 2024 (+ 3,6 % contre + 5,3 % en 2024), en raison du reflux de l'inflation qui limite la revalorisation des prestations sociales. Ce sont 23 milliards d'euros qui seront dépensés en plus par la sécurité sociale en 2025, par rapport à 2024.
Les dépenses de la branche retraite augmenteraient de 3,3 %, soit une hausse de 9,6 milliards d'euros, et les dépenses de la branche maladie de 3,7 %, représentant 9,3 milliards d'euros.
Évolution des dépenses des branches
de la sécurité
sociale
entre 2021 et 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
1. Une moindre hausse des dépenses de retraite en raison de la réforme des retraites
Par rapport à l'année 2024, les dépenses de la branche retraite augmentent beaucoup moins fortement en 2025. Ainsi, les pensions de retraite avaient été revalorisées de 5,3 % au 1er janvier 2024, et les autres prestations de 4,6 % au 1er avril 2024 (représentant une hausse de 3,9 % des prestations pour l'année 2024). Les prestations sociales de la branche retraite n'ont été revalorisées qu'à hauteur de 2,2 % au 1er janvier 2025. Les autres prestations familiales, les pensions d'invalidité et les prestations AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) n'ont été revalorisées qu'à hauteur de 1,7 % au 1er avril 2025.
Par ailleurs, la réforme des retraites, entrée en vigueur au 1er septembre 2023, a entrainé une diminution des dépenses à hauteur de 0,8 milliard d'euros, en raison notamment du relèvement de trois mois de l'âge d'ouverture des droits pour la génération 1963, portant l'âge légal à 62 ans et 9 mois, et de l'allongement de trois mois de la durée d'assurance requise, fixée à 42,5 années.
2. Un ONDAM qui pourrait être respecté en 2025
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2025 devrait être respecté, selon le présent PLFSS. Il est fixé à 265,9 milliards d'euros, soit un montant en hausse de 3,6 % par rapport à la réalisation de 2024, l'ONDAM s'étant élevé à 256,4 milliards d'euros, soit 1,5 milliard d'euros supplémentaires par rapport à la cible fixée en LFSS pour 2024.
Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie avait pourtant alerté2(*) en juin 2025 sur le risque de dépassement de l'ONDAM excédant le seuil de 0,5 % fixé par l'article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale. Ce dépassement était lié à la hausse des dépenses d'indemnités journalières, de médicaments et des hôpitaux.
Suite à cet avis, des économies ont été réalisées, pour permettre le respect de l'ONDAM :
- une économie de 770 millions d'euros sur les dotations aux établissements, dont 267 millions d'euros sur les dotations aux établissements de santé, 125 millions d'euros au titre des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes handicapées, 116 millions d'euros au titre des ESMS accueillant des personnes âgées, 60 millions d'euros au titre du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) et 54 millions d'euros au titre du financement d'opérateurs de l'État par l'ONDAM ;
- un transfert de 110 millions d'euros de dépenses relevant antérieurement de l'ONDAM à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), dont 50 millions d'euros au titre du remboursement aux départements expérimentateurs de la fusion de sections « soins » et « dépendance » des EHPAD et des unités de soins de longue durée (USLD) et 110 millions d'euros de financement pour les départements sur l'extension du Ségur dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
- une absence de dégel du coefficient prudentiel sur les tarifs des établissements de santé, révisé à 430 millions d'euros. Il s'agit d'une mise en réserve effectuée tous les ans sur les dotations aux établissements de santé, dotations permettant de financer certains projets des hôpitaux, qui permet de compenser un éventuel dépassement de l'ONDAM.
Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie estime dans son avis3(*) du 4 novembre 2025 qu'il « est probable que l'ONDAM qui sera constaté s'écartera de cette prévision, à la baisse ou à la hausse, dans une mesure que le comité d'alerte n'est pas en mesure d'évaluer, mais qui apparaît en tout état de cause devoir être inférieure au seuil d'alerte de 1,3 Md€. »
Le rapporteur spécial note toutefois que seuls 1,2 milliard d'euros seront véritablement économisés par la puissance publique, le reliquat représentant simplement un transfert entre administrations. Il ne s'agit par ailleurs pas de mesures structurelles de dépenses, mais simplement de gel de dotations, qui n'assainiront pas à long terme la situation financière de la branche « maladie ».
ONDAM pour 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
C. UNE HAUSSE IMPORTANTE DU DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7,7 MILLIARDS D'EUROS
1. Un déficit porté à 23 milliards d'euros
Comme depuis 2020, l'essentiel du déficit des comptes sociaux se concentre sur la branche maladie (- 17,2 milliards d'euros en 2025) et sur la branche vieillesse (- 6,3 milliards d'euros en 2025). La branche famille est revenue à sa situation traditionnellement excédentaire dès 2021, à hauteur de 0,8 milliard d'euros. Les branches Autonomie et Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) sont toutefois déficitaires, à hauteur respectivement de 0,5 milliard d'euros et de 0,3 milliard d'euros.
Le déficit de la sécurité sociale en 2025 est porté également par le déficit de la Caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), qui s'élèverait à 2,3 milliards d'euros. Le relèvement du taux de cotisation patronale de 3 points a toutefois permis une nette amélioration du solde, de 0,7 milliard d'euros par rapport à 2024.
Évolution
du solde des branches des régimes obligatoires de base et du
FSV
entre 2018 et 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après le PLFSS pour 2026 et le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de 2024
Alors qu'en 2023, le déficit commençait à se résorber après des années de crise sanitaire, tout en se maintenant à un niveau très élevé, en 2024 le solde de la sécurité sociale est à peine moins élevé qu'en 2022. En 2025, le déficit de la sécurité sociale continue à se creuser, représentant 23 milliards d'euros, soit un niveau presqu'équivalent à celui de 2021, au plus fort de la crise sanitaire. Une telle augmentation du déficit, qui ne s'explique ni par une inflation plus élevée en 2024, ni par une crise, n'est pas acceptable et illustre la nécessité de réformes structurelles du financement de la sécurité sociale. Comme évoqué infra, le coût des mesures du Ségur de la santé, de 12,6 milliards d'euros, non financées, expliquent pratiquement la moitié du déficit en 2025.
L'explication de ce creusement de déficit de la sécurité sociale tient à la moindre dynamique des recettes par rapport à celle des dépenses. Ainsi, depuis 2024, pour la première fois depuis 2012, à l'exception des années 2019 et surtout 2020, l'augmentation des dépenses est supérieure de pratiquement 0,7 point de pourcentage par rapport à celle des recettes. Ce différentiel est lié partiellement au décalage des effets de l'inflation sur les recettes par rapport aux dépenses, puisque l'inflation a un effet plus rapide sur la masse salariale que sur la revalorisation des prestations sociales, qui est opérée au 1er janvier ou au 1er avril de l'année d'après.
Ces éléments d'explication ne sont toutefois pas satisfaisants. Les causes du déficit de la sécurité sociale ont des facteurs beaucoup plus structurels, liés notamment à l'équilibre démographique de la population. Des mesures sont absolument nécessaires pour garantir la pérennité de la sécurité sociale.
Taux
d'évolution des recettes et des dépenses de la
sécurité sociale
entre 2012 et 2025
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
2. Une dette sociale de 163,3 milliards d'euros fin 2025
Entre 2024 et 2025, le solde net de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) devrait empirer, passant de - 4,1 milliards d'euros fin 2024 à -32,6 milliards d'euros fin 2025.
Le plafond d'emprunt de l'Acoss a été relevé à 65 milliards d'euros en 2025, contre 45 milliards d'euros en 2023 et en 2024, soit un niveau équivalent à celui de 2022. L'encours maximal mobilisé cette année a été de 54,1 milliards d'euros, en hausse par rapport à l'année 2024 (40,1 milliards d'euros).
La dégradation de la situation financière de l'Acoss, expliquée par l'augmentation du déficit de la sécurité sociale, n'a pas pu être minorée par les reprises de ses dettes par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). En effet, en application des modalités de gestion de la dette sociale arrêtées en 20204(*), l'Acoss a reçu de la Cades 20 milliards d'euros en 2020, 40 milliards d'euros en 2021, 40 milliards d'euros en 2022, 27,2 milliards d'euros en 2023 et enfin 8,8 milliards d'euros en 2024. Ces montants incluent toutefois des dotations destinées au désendettement et à l'investissement des établissements de santé5(*). Aucune autre dette ne peut être transférée à la CADES sans une évolution législative. Le montant total de la dette sociale amortie au 31 décembre 2024 est de 258,6 milliards d'euros ; il lui restait ainsi 137,9 milliards d'euros à amortir début 2025.
La dette sociale, entendue comme la somme des déficits restant à amortir par la Cades et de ceux non repris par celle-ci et maintenus à l'Acoss, atteindrait, d'après les dernières évaluations de la Cour des comptes6(*), près de 163,3 milliards d'euros fin 2025, un niveau en hausse de 5,8 milliards d'euros par rapport à 2024 et de 48,6 milliards d'euros par rapport à 2019.
Évolution de la dette sociale entre 2019 et 2025
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après la Cour des comptes
II. LES ÉVOLUTIONS PRÉVUES EN 2026 : UN DÉFICIT RESTANT TRÈS ÉLEVÉ, DÉPENDANT DE MESURES D'ÉCONOMIES DIFFICILES À CONCRÉTISER
La prévision du solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) s'élève pour 2021 à 0,2 milliard d'euros, après un solde négatif de - 0,3 milliard d'euros en 2025. Il est toutefois à noter que les prévisions de bénéfice de la CADES, qui servent à financer le remboursement de la dette sociale passée, sont comptabilisées comme des excédents dans le solde des ASSO. Il s'agit d'une norme comptable contestable, car si comptablement la CADES dégage des excédents (ses charges étant inférieures à ses produits), dans la pratique l'unique objectif de ces excédents est de rembourser la dette sociale contractée. Il est donc artificiel d'intégrer les excédents de la CADES dans le solde des ASSOS.
Si on exclut les excédents de la CADES, alors le solde des ASSO serait en 2025 de - 16,6 milliards d'euros et en 2026 de - 16,3 milliards d'euros.
Prévision du solde des administrations de
sécurité sociale en 2025 et 2026,
avec et sans les
excédents de la CADES
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après le PLFSS pour 2026
La prévision de déficit de la sécurité sociale pour 2026 s'établit à 17,5 milliards d'euros dans le texte initial, en incluant les mesures en recettes et en dépenses prévues par le PLFSS. Hors mesures nouvelles, le déficit de la sécurité sociale s'élèverait en 2026 à 28,7 milliards d'euros, représentant 0,9 point de produit intérieur brut. Les dépenses liées au Ségur de la santé, d'environ 13 milliards d'euros en 2026, représentent 45 % de ce déficit.
Prévision de recettes, dépenses et
solde des régimes obligatoires
de base et du FSV pour
2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après le PLFSS pour 2026
A. UN RALENTISSEMENT TENDANCIEL DE LA CROISSANCE DES RECETTES, MALGRÉ LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX
L'évolution des recettes de la sécurité sociale résulte essentiellement des mesures décidées en PLFSS, ainsi que des hypothèses de croissance et d'évolution de la masse salariale. En 2026, d'après le texte déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, les recettes de la sécurité sociale augmenteraient de seulement 2,5 % et s'élèveraient à 659,4 milliards d'euros grâce aux mesures nouvelles en recettes qu'il propose, après une progression de 2,4 % entre 2024 et 2025.
Évolution des recettes de la sécurité sociale entre 2022 et 2026
(en milliards d'euros)
Note : il s'agit des évolutions en recettes prévues par le PLFSS pour 2026 déposé à l'Assemblée nationale.
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
1. Des recettes de moins en moins dynamiques en raison d'une conjoncture économique défavorable
a) Une hausse des recettes de 2,5 % par rapport à 2025
Au total, l'évolution des recettes en 2026 (+ 2,5 % contre + 2,4 % en 2025) résulterait surtout de l'évolution attendue des cotisations sociales, de 3,4 %, qui représentent 49,7 % des recettes de la sécurité sociale. Hors mesures nouvelles, les recettes progresseraient en effet de 2,4 % par rapport à 2025.
La hausse des cotisations sociales est liée à la progression de la masse salariale du secteur privé, qui serait de 2,3 % en 2026 après 1,8 % en 2025. La progression des cotisations sociales est tirée également par le relèvement de 3 points du taux de cotisation des employeurs locaux et hospitaliers à la CNRACL, décidé en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Les cotisations sociales rapporteraient en tendanciel, hors mesures nouvelles, 327,4 milliards d'euros à la sécurité sociale.
Évolution des recettes de la
sécurité sociale entre 2022 et 2026
hors mesures nouvelles
introduites par le PLFSS 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Les recettes de contribution sociale généralisée (CSG) diminueraient de 0,7 % hors mesures nouvelles, et de 0,6 % en intégrant les mesures prévues par le PLFSS tel que déposé par le Gouvernement, entre 2025 et 2026. Les recettes de CSG avaient pourtant augmenté de 2,5 % entre 2024 et 2025. Cette diminution des recettes de la CSG est liée à une réforme7(*) de l'assiette sociale des travailleurs indépendants, qui entraine une baisse des recettes de 3,8 milliards d'euros pour la CSG, mais une hausse de 2,4 milliards d'euros des cotisations sociales prélevées. Hors de cette réforme, les recettes de CSG augmenteraient de 2,2 %, soit une évolution proche de celle de la masse salariale.
Les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale s'élèveraient à 103,8 milliards d'euros en 2026 en tendanciel, hors mesures nouvelles, dont 49,8 milliards d'euros de TVA, 18 milliards d'euros de taxe sur les salaires et 11,8 milliards d'euros d'accise sur les tabacs. La hausse de 6,6 % des impôts et taxes anticipée ici traduit toutefois essentiellement un effet de périmètre, 4,78 milliards d'euros de recettes fiscales étant affectées à la CNAV en application de la réforme des retraites pour équilibrer les régimes spéciaux de retraite fermés. Hors de cet effet de périmètre, les recettes des impôts et taxes n'augmenteraient que de 1,2 %. En intégrant les mesures nouvelles, les recettes fiscales s'élèveraient à 91,4 milliards d'euros.
Par ailleurs, les produits de la TVA affectée à la sécurité sociale devraient diminuer de près de 2 ,3 milliards d'euros en 2026 sous l'effet tant d'une minoration de la fraction de TVA qui lui est affectée au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales8(*) que d'une diminution supplémentaire de 750 millions d'euros de la fraction affectée à l'Acoss, qui correspond à une reprise des excédents de l'Unédic.
En effet, la réforme des allègements généraux de cotisations sociales, prévue à l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, permet de minorer de 3,1 milliards d'euros le coût des allègements généraux pour la sécurité sociale. Les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale, qui ont vocation à compenser le coût des allègements généraux pour la sécurité sociale, sont réduites à due concurrence.
Cette reprise d'excédents de l'Unédic, qui se traduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale par un plafonnement de la part de TVA que l'Acoss verse à l'organisme gestionnaire de l'Assurance chômage, a donné lieu à d'importantes contestations des partenaires sociaux. Au total, elle s'élèverait à 4,1 milliards d'euros en 2026.
Le ralentissement tendanciel de la hausse des recettes entraine une augmentation mécanique du déficit de la sécurité sociale, rendant d'autant plus indispensable une maitrise des dépenses sociales.
b) Des prévisions macroéconomiques encore très optimistes, qui pourraient conduire à des recettes moins élevées
Dans son avis9(*) du 9 octobre 2025, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a jugé « optimistes » les hypothèses sur lesquelles reposent le scénario économique. En effet, si les prévisions de croissance, de 1 %, sont très proches de celles du consensus des économistes (de 0,9 %), celles-ci reposent sur une « orientation plus restrictive des finances publiques, qui pèserait donc davantage à court terme sur l'activité ». Le Haut Conseil relève qu'en compensation, cette prévision « suppose une reprise de la demande intérieure privée, dont l'ampleur parait volontariste au regard du climat général d'incertitude ». En effet, le climat d'incertitude actuel n'encourage ni l'investissement des entreprises, ni la consommation des ménages.
Les prévisions d'évolution de la masse salariale, de 2,3 %, sont considérées comme « un peu haute », tandis que l'inflation anticipée serait « plausible ». Elle s'élèverait à 1,3 % en 2026.
Prévisions macroéconomiques pour 2026
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
Les recettes pourraient être inférieures à la prévision, au vu de l'optimisme du scénario macroéconomique sur lequel elles reposent.
2. Si les mesures portées par le PLFSS 2026 tel que déposé par le gouvernement majorent les recettes de 11,2 milliards d'euros, beaucoup ont été révisées, voire supprimées par l'Assemblée nationale
a) Des mesures de hausse des recettes largement remaniées par l'Assemblée nationale
Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte plusieurs mesures en recette avec un impact financier pour 2026, à hauteur de 11,2 milliards d'euros.
Effet des mesures en recettes contenues dans le
PLFSS pour 2026
sur les recettes des branches de la
sécurité sociale
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
Les mesures contribuant le plus à l'augmentation des recettes de la sécurité sociale sont les suivantes :
- la refonte des allègements généraux, pour un rendement brut de 6,8 milliards d'euros, au titre de la LFSS pour 2025, complété par une mesure d'économie supplémentaire sur la réduction générale dégressive unique (RGDU) à hauteur de 1,4 milliard d'euros ;
- le gel des seuils d'imposition de CSG remplacement, de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA), qui rapporterait 300 millions d'euros, à l'article 6, lequel a toutefois été supprimé par l'Assemblée nationale ;
- l'article 6 bis, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit toutefois de rehausser la CSG applicable aux revenus du capital de 1,4 point, passant le taux d'imposition de 9,2 % à 10,4 %, pour un rendement estimé à 2,7 milliards d'euros ;
- l'article 7 prévoit une taxe des organismes complémentaires de mutuelle de 2,25 % sur les cotisations perçues, représentant un rendement de 1,2 milliard d'euros. L'article 7 a toutefois été supprimé par l'Assemblée nationale ;
- l'article 8 prévoit de soumettre les compléments de salaires, tels que les titres-restaurant, les chèques-vacances ou encore les avantages financés par les comités sociaux et économiques des entreprises (CSE) à une contribution patronale de 8 %. Par ailleurs, la contribution patronale spécifique appliquée aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite est augmentée de 10 points. Une telle mesure aurait rapporté 1,2 milliard d'euros. Un amendement de compromis a toutefois été adopté à l'Assemblée nationale, qui permet d'augmenter la contribution patronale spécifique appliquée aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite de 10 points, mais qui ne touche pas aux exonérations sociales sur les compléments de salaires, dont bénéficient les salariés les moins aisés. Selon l'évaluation préalable au PLFSS 2026, l'assujettissement des compléments de salaire à une contribution patronale aurait permis de générer 950 millions d'euros de recettes nouvelles, dont ne bénéficiera pas la sécurité sociale.
- Enfin, la perte de recettes induite par la suspension de la réforme des retraites de 2023 par l'article 45 bis du présent PLFSS représente un coût de 20 millions d'euros, lié à de moindres recettes d'activité.
Ainsi, concernant le solde de la sécurité sociale, après le vote de l'Assemblée nationale, le déficit s'élèverait à 20,6 milliards d'euros. La suppression de certaines mesures de recettes, bienvenue dans quelques cas par exemple concernant les mutuelles, doit impérativement être équilibrée par des mesures plus exigeantes et plus structurelles en dépenses, afin de permettre une trajectoire saine de diminution des déficits de la sécurité sociale.
Décomposition de la hausse des recettes de
la sécurité sociale pour 2026
dans le texte
initial
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
b) La refonte prévue des allègements généraux
La refonte des allègements généraux de cotisations sociales, prévue à l'article 18 de la LFSS pour 2025, a permis à la sécurité sociale d'augmenter les recettes de 8,2 milliards d'euros en 2026. Fondé sur les recommandations du rapport10(*) Bozio-Wasmer, l'article 18 prévoit :
- une réforme paramétrique pour 2025, en diminuant le montant maximal d'exonération de la réduction générale de 2 points, au bénéfice de l'assurance vieillesse. En outre, les points de sortie des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales seront respectivement ramenés à 2,2 et 3,2 SMIC (contre 2,5 et 3,5 SMIC actuellement) ;
- une réforme structurelle pour 2026, dont l'objectif est de créer un dispositif unique de réduction générale dégressive des cotisations sociales qui s'appliquera à l'ensemble des salaires de montant inférieur à 3 SMIC, en supprimant en contrepartie les dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales.
Les allègements généraux de cotisations sociales représentaient en effet un coût de 64,93 milliards d'euros pour la sécurité sociale en 2024. Or, le choix récent de faire bénéficier de la réduction générale des cotisations et contributions patronales tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC a entrainé une très forte hausse de 24,7 % du coût des exonérations de cotisations sociales pour la sécurité sociale entre 2021 et 2024.
Une telle perte de recettes pour la sécurité sociale, concomitante d'une augmentation forte de ses dépenses suite aux mesures liées à la crise sanitaire et au Ségur de la santé, n'était pas viable à long terme pour sa bonne santé financière. La réforme des allègements généraux a ainsi permis de diminuer le coût des exonérations de cotisations sociales de 3,6 % entre 2024 et 2025, et de 10 % entre 2025 et 2026. Le coût n'est plus supérieur que de 8,2 % en 2026 par rapport à 2021.
Évolution du coût des
exonérations de cotisations sociales
pour la sécurité
sociale
(en milliards d'euros)
Note : il s'agit ici du coût des exonérations de cotisations sociales pour la sécurité sociale. Le coût monte à près de 85 milliards d'euros en 2026 pour l'ensemble des ASSO.
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 4 du PLFSS pour 2025
Par ailleurs, l'un des effets négatifs constatés de l'exonération de cotisations sociales jusqu'à 1,6 SMIC est le fait de concentrer les salaires autour du SMIC, conduisant à une « smicardisation » des emplois. La réforme des allègements généraux a également pour objectif de « désmicardiser » les salaires.
c) Des mesures compensées par de moindres transferts de l'État à la sécurité sociale
À noter toutefois, qu'une partie de ces mesures est compensée par la diminution des transferts de l'État à la sécurité sociale via la TVA, qui compense précisément le coût des allègements généraux. Au total, les mesures en recettes et en transferts ne conduisent qu'à une hausse de 2,5 milliards d'euros du solde de la sécurité sociale. En effet, comme mentionné supra, le gain associé à la réforme des allègements généraux pour 2025 et 2026, pour un total de 3,1 milliards d'euros (dont 1,6 milliards d'euros au titre de 2025 et 1,4 milliards d'euros au titre de 2026) est rétrocédé à l'État au titre d'une moindre affectation de recettes de TVA.
Par ailleurs, près de 6,8 milliards d'euros du gain pour l'assurance maladie de la réforme des allègements généraux correspond à une perte brute de la réforme pour l'AGIRC-ARRCO et l'UNEDIC, qui leur sont rétrocédés par l'ACOSS. En conséquence, l'article 40 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit d'affecter une plus large fraction de TVA à l'ACOSS et de diminuer à due concurrence l'affectation de TVA à la branche maladie, afin de permettre le transfert de l'ACOSS à l'AGIRC-ARRCO et à l'UNEDIC des financements compensant les pertes engendrées par la réforme des allègements généraux.
Effet des transferts entre l'État et la
sécurité sociale
sur les produits des branches de la
sécurité sociale
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
B. UNE HAUSSE STRUCTURELLE DES DÉPENSES, QUE LES MESURES D'ÉCONOMIES PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT NE PARVIENDRONT PAS À CONTENIR
En incluant les mesures nouvelles prévues par le PLFSS tel que déposé initialement par le gouvernement, les dépenses de la sécurité sociale augmenteraient de 1,6 % entre 2025 et 2026, soit une augmentation plus modérée que celle des recettes, contre une hausse des dépenses de 2,2 % entre 2024 et 2025.
Évolution des dépenses de la
sécurité sociale par branche,
en incluant les mesures
nouvelles pour 2026, entre 2021et 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après le PLFSS pour 2026
1. Des propositions d'économies de 9,1 milliards d'euros dans la copie initiale du gouvernement
Hors mesures nouvelles comprises dans le présent PLFSS, les dépenses de la sécurité sociale augmenteraient de 3,3 % entre 2025 et 2026, contre 3,3 % entre 2024 et 2025.
La situation est contrastée entre les branches : la branche « vieillesse » (+ 2,3 %) et la branche « maladie »" (+ 4,6 %) sont les principales contributrices à l'augmentation des dépenses de la sécurité sociale, à l'inverse de la branche « famille » (+ 1,7 %). Les dépenses de la branche « AT-MP » (+ 3,4 %) et de la branche « autonomie » (+ 3,3 %) augmentent aussi fortement en proportion. En volume, ce sont les branches « vieillesse »et « maladie » qui contribuent le plus à l'augmentation des dépenses de la sécurité sociale, à hauteur de respectivement de 6,8 milliards d'euros et 12 milliards d'euros.
Évolution des dépenses des branches de la sécurité sociale entre 2021 et 2026
(en milliards d'euros)
Note : à compter de 2026, le fonds de solidarité vieillesse est intégré dans la branche « vieillesse ».
Source : commission des finances du Sénat d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
À noter, que depuis 2023, l'évolution des dépenses de la sécurité sociale est très largement liée aux revalorisations des prestations légales nettes servies par la sécurité sociale, en particulier des pensions de retraite. Ainsi, pour 2026, la hausse de 3,3 % du coût des prestations légales est liée pour 0,6 point à la revalorisation des prestations, prévues aux 1er janvier et 1er avril (voir infra). La hausse massive des prestations de 5,3 % entre 2023 et 2024 est très largement liée à la revalorisation de celles-ci, et notamment des prestations de retraites, à hauteur de 2,8 points.
Décomposition de l'évolution du
coût des prestations légales nettes
servies par la
sécurité sociale entre 2023 et 2026
(en pourcentage)
Note : pour 2026, il s'agit des mesures proposées par le Gouvernement dans le texte initialement déposé.
Source : commission des finances du Sénat d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Le ralentissement de l'évolution des dépenses de la sécurité sociale prévu par le PLFSS tel que déposé par le Gouvernement est dû tant à la conjoncture qu'aux mesures d'économies substantielles présentées, pour un montant de 9,1 milliards d'euros. L'essentiel des mesures d'économies initialement envisagées est lié :
- aux mesures d'économies prévues sur l'ONDAM, pour un total de 6 milliards d'euros (voir infra) ;
- au gel de la revalorisation des prestations sociales, prévu à l'article 44 du présent PLFSS, pour un montant de 2,7 milliards d'euros d'économies, dont 2,2 milliards d'euros sur les pensions de retraite. Cette mesure entraine toutefois une diminution de 200 millions d'euros des recettes de CSG remplacement ;
- la suspension de la réforme des retraites entrainerait un surcoût de 100 millions d'euros pour 2026 ;
- des économies de 400 millions d'euros sont anticipées sur le fonds national d'action sociale (FNAS), en raison de la faible dynamique de créations de place de garde d'enfants.
L'Assemblée nationale a toutefois supprimé la mesure du gel de la revalorisation des prestations sociales, prévue par l'article 44 du présent PLFSS, générant un déficit supplémentaire de 2,7 milliards d'euros.
Mesures en dépenses proposées par le PLFSS pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après l'annexe 3 du PLFSS pour 2026
2. Des économies substantielles sur la branche « vieillesse » grâce au gel des pensions pourtant supprimé par l'Assemblée nationale et minorées par la suspension de la réforme des retraites
La hausse des prestations de la branche « vieillesse » en 2026 (+ 1,3 %) est fortement ralentie par rapport à 2025 (+ 3,1 %). L'effet « noria », c'est-à-dire la croissance de la pension moyenne des salariés, contribuerait à l'augmentation des prestations de la branche à hauteur de 0,3 point en 2026.
La non revalorisation des pensions de retraite de 1 % au 1er janvier 2026, correspondant à l'inflation atteinte entre octobre 2024 et octobre 2025 contribuerait grandement à la décélération de la hausse des pensions de retraite. Selon l'annexe 3 du PLFSS, la mesure représenterait une économie de 2,2 milliards d'euros.
Ces mesures d'économies permettent de limiter les dépenses des retraites. Elles sont bienvenues, au vu de la dégradation des finances publiques. Malgré le vote de l'Assemblée nationale, il serait regrettable de renoncer totalement à cette économie.
La réforme des retraites adoptée en 202311(*) aurait permis de procurer un gain net de 0,1 milliard d'euros en 2024, de 0,8 milliard d'euros en 2025 et de 1,4 milliards d'euros en 2026. Sa suspension par l'article 45 bis du présent PLFSS représentera un coût de 100 millions d'euros en 2026 et 800 millions d'euros en 2027. L'impact financier de la suspension de la réforme devrait en effet rester limité en 2026, au vu de l'adoption tardive de la mesure qui n'aura pas permis aux personnes pouvant en bénéficier d'anticiper leur départ en retraite. Le coût de la réforme sera toutefois beaucoup plus élevé en 2027, et au-delà. La suspension a les effets suivants :
- l'âge d'ouverture des droits de la génération née en 1964 sera réduit à 62 ans et 9 mois, comme pour la génération 1963, au lieu de 63 ans comme prévu par la réforme. Cette réduction permettra aux premiers membres de cette génération non éligibles à des dispositifs de départ anticipé de liquider leur pension au 1er octobre 2026 au lieu du 1er janvier 2027. Corrélativement, l'âge d'ouverture des droits de chacune des générations suivantes, soit les générations 1965, 1966, 1967 et 1968 sera réduit également d'un trimestre. L'âge d'ouverture des droits de 64 ans s'appliquera uniquement à compter de la génération 1969 ;
- la durée d'assurance requise pour l'atteinte du taux plein sera également abaissée d'un trimestre pour la génération née en 1964, passant à 170 trimestres. De même, la durée d'assurance requise pour la génération née en 1965 sera réduite de 1 trimestre. L'obligation de cotisation de 172 trimestres, s'appliquera uniquement à partir de la génération née en 1966.
Effet de la suspension de la réforme des retraites sur l'âge d'ouverture des droits (AOD) et la durée d'assurance au régime général (DAR) pour le droit commun
Source : annexe 9 du PLFSS pour 2026
Une amélioration du solde de la CNRACL, au
prix de cotisations
pesant lourdement sur les employeurs locaux et
hospitaliers
Les prévisions de recettes du PLFSS pour 2025 sont assises sur une hausse de 3 points du taux de cotisation employeur de la CNRACL par an entre 2025 et 2028, engendrant un surcroît de cotisations estimé à 1,8 milliards d'euros par an.
Cette augmentation des cotisations de la CNRACL permet d'améliorer son solde. Alors que le déficit s'élevait à 2,5 milliards d'euros en 2023, et à 3 milliards d'euros en 2024, il devrait diminuer de 0,7 milliard d'euros pour représenter 2,3 milliards d'euros en 2025. En 2026, le déficit de la CNRACL serait contenu, à hauteur de 1,5 milliard d'euros.
Solde de la CNRACL entre 2019 et 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
À noter, toutefois, le poids représenté par le mécanisme de compensation démographique ces dernières années pour la CNRACL. Il vise à effectuer des transferts entre régimes, en fonction de la situation démographique relative et de la capacité contributive de ceux-ci. Or la CNRACL est en réalité dans une situation moins dégradée que les autres régimes au vu de ces critères et est donc contributrice à ce titre, jusqu'en 2027. Elle a dû verser près de 100 milliards d'euros constants à ce titre depuis 1974, dont 16,7 milliards d'euros entre 2012 et 2022. En 2023, la CNRACL a ainsi versé 656 millions d'euros, et le régime général 4,37 milliards d'euros au titre de la compensation démographique, alors que le régime des travailleurs agricoles non-salariés a perçu 2,62 milliards d'euros. En 2024, la CNRACL aurait versé encore 533 millions d'euros au titre de la compensation démographique.
Une telle situation est difficile à comprendre et à justifier, et une révision des règles du mécanisme de compensation démographique devrait être envisagée.
Montants de compensation concernant divers régimes entre 2017 et 2023
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les inspections ministérielles
3. Des dépenses structurellement très élevées de la branche « maladie »
La hausse des prestations de la branche « maladie » en 2025 (+ 2 %) était prévue pour être fortement ralentie par rapport à 2025 (+ 3,7 %), grâce aux mesures proposées par le PLFSS tel que déposé par le Gouvernement.
a) Une hausse des dépenses de l'ONDAM limitées uniquement grâce à des économies toutefois difficiles à réaliser
La hausse des dépenses de la branche « maladie » serait, hors mesures nouvelles, de 4,6 % entre 2025 et 2026, soit 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
Après mesures nouvelles, l'Ondam s'élève à 270,4 milliards d'euros pour 2026, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2025. Hors mesures portées par le présent PLFSS, l'ONDAM s'élèverait pourtant à 3,9 %, atteignant 276,4 milliards d'euros. La progression spontanée des dépenses de l'ONDAM est en effet estimée à 3,4 %, à laquelle s'ajoutent des mesures déjà décidées, telles que les revalorisations conventionnelles de 0,9 milliard d'euros et la compensation du relèvement des taux de cotisation de la CNRACL pour les établissements de santé.
Évolution des sous-objectifs de l'Ondam pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après les articles 2 et 49 du PLFSS pour 2026
Si aucune dépense de crise sanitaire n'est par exemple prévue pour 2026, la crise du Covid puis la crise inflationniste ayant suivi ont entrainé une hausse massive des dépenses structurelles de l'ONDAM. Comme le démontre le graphique ci-dessous, la trajectoire de l'Ondam hors-crise sanitaire et hors Ségur de la santé aurait été largement inférieure à la trajectoire constatée. En effet, si les dépenses directement liées à la crise sanitaire se sont résorbées, celle-ci a conduit à la mise en oeuvre des dépenses pérennes du Ségur et qui établissent l'Ondam à un niveau supérieur de 22,1 milliards d'euros au-dessus de son niveau « naturel ».
Évolution de l'ONDAM entre 2017 et 2026
(en milliards d'euros)
Note : en 2026, l'ONDAM présenté correspond à celui qui a été présenté par le Gouvernement dans le PLFSS déposé initialement à l'Assemblée nationale.
Source : commission des finances d'après la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), octobre 2025
Quoique l'on pense de la justification des dépenses liées au Ségur au regard de l'état du système de santé français, force est de constater que leur montant est très élevé : elles représentent un surcoût de 13 milliards d'euros en 2024 et de 12,6 milliards d'euros en 2025.
En l'absence du Ségur de la santé, le déficit serait probablement minoré de 13 milliards d'euros en 2026.
Coût des mesures du Ségur de la Santé
Note : ESMS signifie établissements et services médico-sociaux ; BAD : branche de l'aide à domicile, CTI : complément de traitement indiciaire.
Source : Direction de la sécurité sociale
b) Le PLFSS pour 2026 propose de minorer l'ONDAM de 6 milliards d'euros
Dans sa version initiale, telle que déposée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, le PLFSS propose des mesures d'économies sur l'ONDAM, à hauteur de 6 milliards d'euros nets, qui, d'après l'annexe 5 du PLFSS, comprennent notamment :
- des mesures de baisses des prix des médicaments, pour un montant d'1,6 milliard d'euros ;
- des mesures de meilleur usage du prix des médicaments, représentant des économies de 0,7 milliards d'euros ;
- une amélioration de l'efficience sur les achats en établissements de santé et médico-sociaux, représentant un coût de 0,7 milliard d'euros ;
- la montée en charge des protocoles de maitrise des dépenses en ville et mesures de lutte contre les rentes pour 0,6 milliard d'euros, notamment à l'article 26 du PLFSS prévoyant de renforcer les incitations au conventionnement des professionnels de santé et de mieux maitriser les dépassements d'honoraires ;
- la hausse des plafonds et des montants sur les franchises et les participations forfaitaires, pour un montant de 2,3 milliards d'euros. L'article 18, qui étend les franchises aux actes réalisés par les chirurgiens-dentistes et aux dispositifs médicaux, a toutefois été supprimé par l'Assemblée nationale, creusant d'autant le déficit à venir de la sécurité sociale ;
- la baisse du plafond de revenus pris en charge pour le calcul des indemnités journalières de maladie, pour un montant de 0,5 milliard d'euros ;
- le déremboursement des cures thermales et la fin de l'exemption de ticket modérateur sur les médicaments à faible service médical rendu pour les assurés en affection de longue durée (0,3 milliard d'euros) ;
- l'augmentation de la part de financement portée par les complémentaires santé à l'hôpital pour 0,4 milliard d'euros.
Il n'est toutefois pas certain que ces mesures soient conservées dans la version finale du PLFSS. Par exemple, la hausse des franchises sur les médicaments toucherait tous les patients quel que soit leur revenu, ce qui est particulièrement difficile à justifier auprès de l'opinion publique.
Elles ne permettraient pas non plus nécessairement de réaliser les économies désirées, en particulier les mesures visant à améliorer l'efficience de la dépense des établissements de santé et médico-sociaux. Ainsi, depuis 2017, l'ONDAM prévu n'a jamais été réalisé, même s'il était vraiment très proche de la cible en 2019 par exemple. Les mesures de maitrise des dépenses relevant de cet objectif doivent donc être accentuées, afin d'éviter qu'il n'augmente de trop chaque année.
ONDAM prévu et réalisé entre 2016 et 2026
(en milliards d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les documents annexés au PLFSS et au PLACSS entre 2016 et 2026
4. Les branches « famille » et « AT-MP » en hausse modérée, mais une augmentation relativement élevée des dépenses de la branche « autonomie »
a) Les dépenses de la branche « AT-MP » en hausse en raison de la montée en charge du FIPU
Les dépenses de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) augmenteraient de 2,8 % en 2026. Les prestations sous ONDAM resteraient très dynamiques (+ 6,8 %), en lien avec la dynamique tendancielle des indemnités journalières (+ 7,3 %), tout comme les prestations hors ONDAM (+ 3,7 %), sous l'effet de l'achèvement de la montée en charge du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) créé par la réforme des retraites de 2023, dont les dépenses atteindraient 0,2 milliard d'euros en 2026, après avoir représenté 0,1 milliard d'euros en 2025. La dotation allouée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par la branche « AT-MP » diminuerait à l'inverse de 0,1 milliard d'euros.
b) Les dépenses de la branche « famille » contenues par les mesures du présent PLFSS
Les dépenses de la branche « famille » augmenteraient à un rythme modéré (+ 0,2 %) en incluant les mesures nouvelles prévues par le présent PLFSS. Le gel des prestations familiales représente en effet une économie de 0,3 milliard d'euros. Par ailleurs, la majoration pour âge des allocations familiales est repoussée de 14 à 18 ans, soit une économie de 200 millions d'euros. Enfin, les dépenses du fonds national d'action sociale (FNAS) devraient diminuer de 400 millions d'euros, en raison de la baisse des créations de places de garde d'enfants.
c) Une progression de 3,3 % des dépenses de la branche « autonomie » expliquée par la tendance
Les dépenses de la branche « autonomie » enregistreraient en 2026 une progression de 3,4 %, soit 1,5 milliard d'euros, en incluant les mesures nouvelles, de portée très limitée. Hors mesures nouvelles, les dépenses augmenteraient de 3,3 %. En particulier, les transferts aux départements progresseraient de 4,7 %, représentant un montant de 4,9 milliards d'euros en 2026. Le gel des prestations sociales permettrait de réaliser une économie de 10 millions d'euros.
C. UN SOLDE TRÈS ÉLEVÉ EN 2026, DEMEURANT SUPÉRIEUR À CELUI DE 2024 MÊME EN INCLUANT LES MESURES NOUVELLES DU PLFSS PRÉSENTÉES INITIALEMENT
1. Un déficit de 17,5 milliards d'euros du solde des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV, mesures nouvelles du PLFSS présentées initialement incluses
Établie à 23 milliards d'euros pour 2025, la prévision de déficit de l'ensemble des régimes obligatoires de base est de 17,5 milliards d'euros pour 2026, soit une amélioration de 5,5 milliards d'euros par rapport à 2025 mais une dégradation de 1,1 milliard d'euros par rapport à 2024, liée essentiellement à la branche « maladie », dont le solde se dégrade de 1,3 milliard d'euros, et à la branche « vieillesse ».
Évolution du solde des branches de la
sécurité sociale
entre 2024 et 2026
(en milliard d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le PLFSS pour 2026
Le déficit de l'ensemble du régime vieillesse atteindrait 3 milliards d'euros, soit une amélioration du déficit de 3,3 milliards d'euros par rapport à 2026, essentiellement en raison du gel des pensions de retraite.
Au vu des votes de l'Assemblée nationale, le déficit global de la sécurité sociale serait compris entre 24 et 25 milliards d'euros. Ce chiffrage reste toutefois sujet à caution, d'autant qu'il repose sur des hypothèses d'évolution de la masse salariale jugées optimistes par la Haut conseil des finances publiques (voir supra). Le déficit réel de la sécurité sociale pourrait se rapprocher de son évolution tendancielle.
Hors mesures nouvelles, en tendanciel, le déficit de la sécurité sociale s'établirait en 2026 à 28,7 milliards d'euros, soit un niveau dépassé exclusivement en 2010 et en 2020, au plus fort des crises financière et sanitaire. Un tel niveau de déficit n'est pas acceptable ni soutenable pour le système social et appelle à des réformes urgentes.
Évolution du solde des branches de la
sécurité sociale
entre 2018 et 2026, hors mesures nouvelles en
PLFSS
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2026
Un déficit record des établissements de santé en 2024
Les déficits de la branche « maladie » de la sécurité sociale sont par ailleurs renchéris par les déficits des établissements de santé, qui n'ont cessé d'augmenter et concernent un nombre croissant d'établissements depuis 2021. En 2024, le déficit atteindrait 2,9 milliards d'euros, soit le plus haut niveau atteint depuis 2005.
Compte de résultat des hôpitaux publics depuis 2005
(en millions d'euros)
Source : Annexe 6 du PLFSS pour 2026
2. Une gestion à saluer de la dette sociale, mais un risque important pour l'ACOSS au vu des prévisions de déficit
a) La hausse des déficits non repris par la CADES, un risque pour l'ACOSS
Les reprises par la Cades de dettes des branches « maladie » et « vieillesse » du régime général et du FSV contribuent à améliorer le solde de trésorerie du régime général.
Comme mentionné infra, il n'est plus possible depuis 2025 de transférer des déficits à la CADES, le plafond autorisé de 136 milliards d'euros de reprise de dette ayant été atteint. En conséquence, les emprunts nécessaires pour couvrir le déficit de la sécurité sociale ne peuvent être effectués que par l'ACOSS. Le PLFSS pour 2026 propose de rehausser le plafond d'emprunt de l'ACOSS pour 2026 à 83 milliards d'euros à son article 16.
Cette situation fait toutefois courir un risque certain à l'ACOSS. Le montant de la dette sociale que l'ACOSS atteindrait 59,7 milliards d'euros en 2025 et même 88,6 milliards d'euros fin 2026, dont 54,1 milliards d'euros pour la branche « maladie », 20,6 milliards d'euros pour la branche « vieillesse » et 13,8 milliards d'euros pour la CNRACL.
Or en cas de crise financière, l'ACOSS pourrait ne pas trouver suffisamment d'emprunteurs prêts à financer de la dette de court terme, puisqu'elle ne peut pas emprunter à un horizon supérieur à 12 mois. Cette situation n'est donc pas pérenne : la maitrise de la trajectoire des comptes sociaux est absolument indispensable pour éviter ce risque. Une fois des mesures structurelles de diminution des dépenses engagées, il pourrait être envisagé de transférer les déficits restants à la CADES.
Déficits non amortis financés par la CADES et l'ACOSS
(en milliards d'euros)
Source : commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2026
b) Une gestion satisfaisante de la dette sociale par la CADES
Selon les informations communiquées au rapporteur pour avis, le taux global de refinancement de la CADES était de près de 2 % en août 2025, soit une situation assez favorable, le spread étant réduit de 7 points de base par rapport aux obligations assimilables au Trésor (OAT).
En 2025, les ressources de la Cades représenteraient 18,7 milliards d'euros et sont constituées de la CRDS au taux de 0,5 % pour un montant net de 9,3 milliards d'euros, de la CSG au taux de 0,45 % pour un montant net de 8 milliards d'euros et d'un versement annuel du FRR pour un montant de 1,45 milliards d'euros.
En effet, en vertu de la loi du 7 août 202012(*), les ressources attribuées à la Cades ont diminué à partir de 2024 pour abonder les branches et renforcer la trajectoire d'équilibre de la sécurité sociale :
- en 2024, la fraction de CSG affectée à la Cades est passée de 0,6 à 0,45 point, notamment pour financer des dépenses nouvelles liées à la prise en charge de la perte d'autonomie par la CNSA ;
- en 2025, le versement annuel du Fonds de réserve des retraites (FRR) passe de 2,1 milliards d'euros à 1,45 milliards d'euros, faute de réserves suffisantes.
La baisse des ressources affectées à la CADES rend plus difficile le remboursement de la dette sociale sur les marchés, même si la fixation de ce niveau de ressources par la loi, et ce depuis 2020, a permis aux marchés d'intégrer ce risque dans les emprunts contractés.
En 2025, ce sont 274,7 milliards d'euros de dettes qui ont été amortis. En 2026, ce sont 291,193 milliards d'euros qui auront été remboursés.
III. DES DÉFICITS DEMEURANT TRÈS ÉLEVÉS JUSQU'EN 2029 : UN REPORT DE L'EXTINCTION DE LA DETTE SOCIALE PRATIQUEMENT INÉVITABLE
Selon les prévisions pluriannuelles du Gouvernement, le déficit de la sécurité sociale continuerait à se dégrader, pour s'établir à 16,8 milliards d'euros en 2027, 16,6 milliards d'euros en 2028 et 17,9 milliards d'euros en 2029, soit un niveau presqu'équivalent à celui de 2024, alors qu'aucune crise ne le justifie. Le Ségur de la santé représenterait toujours des dépenses supplémentaires de 12,6 à 13 milliards d'euros chaque année, expliquant environ 70 % des déficits.
Sous ces hypothèses, la dette sociale augmenterait de 110 milliards d'euros d'ici à 2029.
Solde des régimes obligatoires de base et
du FSV entre 2018 et 2029,
en incluant les mesures prévues en PLFSS
pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après les annexes du PLFSS pour 2026
A. UNE TRAJECTOIRE REPOSANT SUR LA DIMINUTION DES DÉPENSES DES BRANCHES « MALADIE » ET « RETRAITE »
1. Des économies insuffisantes pour endiguer structurellement le déficit de la branche « maladie »
Le déficit de la branche « maladie » se maintiendrait à des niveaux très élevés dans les années à venir, à hauteur de 13,8 milliards d'euros en 2027, de 15 milliards d'euros en 2028 et de 16,1 milliards d'euros en 2029.
Comme le relève également la Cour des comptes13(*), cette trajectoire repose sur l'hypothèse d'un ONDAM inférieur à 2,9 % par an jusqu'en 2027, conformément aux préconisations de la loi de programmation des finances publiques. Le respect de cette cible par l'ONDAM dans les années à venir parait loin d'être garanti.
Par ailleurs, le respect de cette trajectoire suppose des capacités de régulation des dépenses de l'Ondam. En tout état de cause, il apparaît nécessaire que cette régulation ne porte pas, comme avant la crise sanitaire, essentiellement sur l'hôpital. Le rapporteur pour avis réitère donc sa déception que le Gouvernement en place en 2023 n'ait pas souhaité entendre les propositions du Sénat visant à ce que les mesures de régulation des dépenses de santé concernent également l'Ondam « soins de ville »14(*), de même que le retour de la réserve prudentielle appliquée à l'Ondam de ville en 2019 et en 2020, avant la crise sanitaire.
2. Une hausse contenue du déficit de la branche « vieillesse », notamment grâce à la sous-indexation des pensions de retraite
Enfin, le déficit porté par la branche « vieillesse » serait contenu en 2027 à 1,8 milliard d'euros, et représenterait 0,8 milliard d'euros en 2028 et 1,6 milliard d'euros en 2029, sous l'effet du vieillissement de la population.
Comme le relève toutefois la Cour des comptes dans le rapport précité, cette trajectoire intègre les relèvements successifs de cotisations à la CNRACL de trois points chaque année d'ici à 2028, la sous-indexation des pensions de retraite de 0,9 point en 2027 puis chaque année de 0,4 point jusqu'en 2029, prévue par l'article 44 du PLFSS pour 2026.
B. FACE À L'ACCUMULATION PRÉVISIBLE DE NOUVEAUX DÉFICITS, LA NÉCESSITÉ D'UNE TRAJECTOIRE DE MAITRISE DES COMPTES SOCIAUX, CONDITION POUR PERMETTRE UNE REPRISE DES DÉFICITS PAR LA CADES
Comme mentionné infra, compte tenu du plafond de reprise fixé à 136 milliards d'euros par la loi organique du 7 août 2020, la Cades ne peut plus recevoir de nouveaux transferts de dette, après celui de 8,8 milliards d'euros opéré en 2024.
Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, la Cades a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps l'évolution du niveau des dettes restant à amortir. Dans le scénario médian, la Cades amortirait au cours de l'année 2032 l'intégralité de la dette qui lui aura été transférée. Selon un scénario plus optimiste, la CADES pourrait amortir l'intégralité de la dette en 2031, contre 2033 pour un scénario plus pessimiste.
Le rapporteur a souhaité expertiser la capacité de la CADES à amortir l'intégralité de la dette transférée. Des estimations de ressources et de charges financières ayant été fournies jusqu'en 2028, le rapporteur a ensuite supposé que le montant des charges financières et des ressources demeurerait identique jusqu'en 2033. Il s'agit d'une hypothèse extrêmement conservatrice, puisque les ressources devraient augmenter, tandis que les charges financières devraient décroître avec le montant de la dette restant à amortir. Par ailleurs, la dette devant être amortie chaque année par la CADES est comprise entre 15 et 22 milliards d'euros.
Encours de dette restant à amortir par la CADES en septembre 2025
(en millions d'euros)
Source : réponses au questionnaire de la CADES
Même avec ces hypothèses très conservatrices, excepté en 2025 et en 2026, où la CADES devra sans doute s'endetter encore sur les marchés financiers, à partir de 2027, les ressources de l'organisme devraient permettre de couvrir les charges financières et la dette restant à amortir. Au vu de l'importance des ressources par rapport aux charges, il est probable que la CADES soit en mesure de couvrir également les intérêts associés à la dette contractée en 2025 et 2026.
Prévision d'évolution des ressources
et des charges de la CADES
entre 2025 et 2029
Note : cette prévision est réalisée à l'aide d'hypothèses extrêmement conservatrices et simplifiées. Elle n'engage en aucune façon la CADES, qui n'a pas réalisé cette prévision.
Source : commission des finances
La capacité d'amortissement de la Cades semble donc, à ce stade, préservée. Toutefois, elle tient aussi à l'ampleur des déficits à venir, dont la tenue dans les limites fixées par les projections pluriannuelles du Gouvernement est loin d'être garantie. La question du partage de la charge des déficits sociaux entre l'Acoss et la Cades et de leurs conditions de financement et d'amortissement se pose donc avec acuité, compte tenu, à ce stade, d'absence de perspective de réduction de ces déficits.
Or malgré les propositions de rehaussement du plafond de l'ACOSS, cette dernière n'a pas vocation à porter à long terme des montants élevés de dette sociale. La Cour des comptes évoque à ce sujet une « impasse du financement » de la dette sociale.
Dans ces conditions, une nouvelle reprise de dette par la Cades n'est pas à exclure, ce qui aura nécessairement pour conséquence de prolonger - encore - la longévité déjà impressionnante de cet établissement pourtant créé pour rapidement disparaître.
IV. UN POIDS DU SYSTÈME DES RETRAITES SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES ENCORE SOUS-ESTIMÉ
A. UN SYSTÈME DES RETRAITES STRUCTURELLEMENT DÉFICITAIRE JUSQU'EN 2070
1. Une dégradation à venir du déficit lié au système des retraites, compte tenu de la moindre progression des recettes par rapport aux dépenses
En 2024, les dépenses de l'ensemble du système des retraites, c'est-à-dire incluant les pensions versées par les régimes de retraite complémentaires, s'élèvent à 407 milliards d'euros, soit 13,9 % du PIB. Elles représenteraient 14,1 % du PIB en 2025 selon le scénario de référence du Conseil d'orientation des retraites15(*) (COR), soit une hausse de 0,2 point de pourcentage, en raison essentiellement de l'indexation des pensions sur l'inflation.
La part des dépenses de retraite dans le PIB devrait rester relativement stable dans le temps, représentant 14 % du PIB en 2030 et 14,2 % du PIB en 2050 en 2070.
Les ressources du système des retraites s'élèvent quant à elles en 2024 à 405 milliards d'euros, représentant 13,9 % du PIB. Le solde du système des retraites est donc légèrement négatif en 2024, à hauteur de 1,7 milliards d'euros. Ce déficit provient dans une large mesure de la revalorisation de 5,3 % des pensions intervenue en 2024, ainsi que de l'augmentation du minimum vieillesse liée à la réforme des retraites de 2023, selon le COR.
En 2025, les ressources du système des retraites devraient représenter 13,9 % du PIB, impliquant un déficit de 0,2 % du PIB.
La part des ressources du système des retraites dans le PIB devrait diminuer encore davantage dans le temps, en raison des évolutions démographiques. Elle ne représenterait que 13,8 % du PIB en 2030, 13,1 % du PIB en 2050 et 12,8 % du PIB en 2070.
Le solde du système des retraites devrait donc être de plus en plus déficitaire. Il serait de - 0,2 % en 2030 et de - 1,1 % en 2050 et à -1,4 % en 2070. Cette situation est très inquiétante, alors que les finances publiques reposent déjà largement sur l'endettement et que les cotisations sociales ne permettront pas d'équilibrer le régime des retraites en l'absence de réforme structurelle.
Évolution du solde du système des retraites entre 2000 et 2070
(en pourcentage du PIB, prévisions à partir de 2024)
Source : commission des finances d'après le COR
2. Un financement des retraites dépendant des subventions publiques
Le financement des régimes de retraite obligatoires de base en France n'est pas assuré exclusivement par les cotisations sociales. Celles-ci, selon le Conseil d'orientation des retraites, représentent 65,1 % des ressources du système des retraites, à hauteur de 269,3 milliards d'euros, hors cotisations dites « employeurs » de l'État au bénéfice des fonctionnaires.
La contribution d'équilibre de l'État au régime des fonctionnaires, représente quant à elle 48,2 milliards d'euros, soit 11,7 % des ressources.
Les impôts et taxes affectés correspondent à 62,2 milliards d'euros, soit 15 % des ressources.
Enfin, 22,4 milliards d'euros, soit 5,6 % des ressources, correspondent à des subventions versées au système de financement des retraites. Elles recouvrent :
- 8 milliards d'euros versés par l'État aux régimes spéciaux déficitaires au titre d'une « subvention d'équilibre » ;
- 11,3 milliards d'euros versés par la CNAF, excédentaire ;
- 3,9 milliards d'euros versés par l'Unédic, également excédentaire.
Sans ces subventions, le système des retraites serait déficitaire à hauteur de 24,4 milliards d'euros, soit un déficit plus élevé que celui de l'ensemble de la sécurité sociale en 2024, qui s'élève à 15,3 milliards d'euros.
Structure des ressources des régimes
obligatoires de base de retraite
de la sécurité sociale en
2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après le COR
3. Des cotisations insuffisantes pour financer les pensions servies pour la quasi-totalité des régimes de base
On constate qu'à l'exception notable des régimes des professions libérales, des avocats et des clercs et employés de notaires, les cotisations ne permettent pas de couvrir l'ensemble des prestations servies pour la plupart des régimes de retraite de base, y compris le régime général. Ainsi, les cotisations ne représentent que 70 % des pensions servies par le régime général, 62 % des pensions des industries électriques et gazières (IEG) ou encore 93 % des pensions des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le ratio démographique est, en effet, en général insuffisant pour couvrir les besoins des régimes : à l'exception du régime de retraite des avocats, le nombre de cotisants ne représente jamais le double du nombre de pensionnés.
Il faut toutefois noter ici que pour le régime des fonctionnaires de l'État, seules les cotisations salariales et les cotisations « employeur » des opérateurs de l'État sont décomptées, et non les cotisations versées par l'État lui-même en tant qu'employeur (voir supra pour davantage de précisions sur les cotisations « employeurs » de l'État, ainsi que le rapport16(*) budgétaire sur la mission « Régimes sociaux et de retraites » de la loi de finances pour 2025 et du PLF 2026).
Ratio de cotisations sur les pensions de retraites servies pour 2023
(en pourcentage)
CRPCEN signifie caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; CNRACL : caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; CNIEG : caisse nationale des industries électriques et gazières ; FSPOEIE : fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ; ENIM : établissement national des invalides de la marine.
Source : commission des finances à partir des données de la Commission des comptes de la sécurité sociale
B. UNE NÉCESSITÉ : MIEUX INFORMER SUR LE POIDS RÉEL DES RETRAITES DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES
1. La cotisation « employeur » de l'État et des collectivités territoriales permet de pallier les besoins de financement des régimes de retraite des fonctionnaires
Le financement de la plupart des régimes de base de retraite ne repose donc pas exclusivement sur les cotisations versées mais sur une subvention versée par l'État. Toutefois, le régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État constitue un cas particulier : l'État étant lui-même l'employeur, plutôt que de verser une cotisation « employeur » qu'il complèterait par une subvention permettant d'équilibrer le système, il verse directement une cotisation dite « d'équilibre ». Un même système est utilisé pour le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL).
Ainsi, les taux de cotisation dits « employeurs » de l'État et des collectivités territoriales sont très supérieurs aux autres taux de cotisation des autres caisses de retraites. Le taux de cotisation dit « employeur » est de 78,28 % pour les fonctionnaires civils de l'État et de 126,07 % pour les militaires ; celui de la CNRACL est de 34,65 % en 202517(*). Pourtant, le taux de cotisation employeur pour les entreprises dont les salariés sont affiliés au régime général, soit les trois quarts des cotisants, n'est que de 8,55 % sur les revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale (PASS, valant 43 992 euros en 2023). Les revenus au-delà du plafond annuel de la sécurité sociale sont prélevés à hauteur de 2,02 % et n'ouvrent pas de droit à retraite. À noter, toutefois, que le régime des retraites de l'État et de la CNRACL est un régime intégré, comprenant les cotisations de retraite de base et complémentaires.
Il apparait en tout état de cause que l'État et les collectivités territoriales abondent très largement les systèmes de retraite des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Ces subventions déguisées n'apparaissent pourtant qu'au titre de la contribution d'équilibre de l'État, ce qui constitue un obstacle à la compréhension des équilibres globaux du système. Cette contribution masque le coût réel du système des retraites pour les finances publiques. Le rapport18(*) spécial de Sylvie Vermeillet, fait au nom de la commission des finances du Sénat, sur la mission « Régimes sociaux et de retraites » au titre du PLF 2026 explicite également ce dispositif.
Il serait intéressant de distinguer parmi les cotisations « employeur » d'équilibre versée par l'État et par la CNRACL la part qui relève d'un taux de cotisation employeur normal, proche du régime général, et la part qui relève en réalité d'une subvention de ces régimes par les dépenses publiques.
Une évaluation a été effectuée en ce sens notamment par M. Jean-Pascal Beaufret19(*) en 2023 dans la revue Commentaires, ainsi que par le Haut-Commissariat20(*) au plan en 2022. Conformément au décret du 20 juin 201421(*), il est possible de retenir un taux de cotisation (employeur et salarié), de 28 %, qui correspond au plafond maximum possible. Ce taux de 28 % appliqué aux traitements des fonctionnaires de l'État et des collectivités permet d'obtenir un montant de cotisations dit « normal » qui correspond à ce que verseraient l'État, les opérateurs de l'État et la CNRACL si elles n'abondaient pas ces cotisations pour équilibrer le système des retraites. Le restant de ce qui est versé correspond en réalité aux subventions versées par l'État et les collectivités en plus des cotisations dites « normales ».
Cotisation « normale » et
subvention aux régimes des fonctionnaires
de l'État et des
collectivités
(en milliards d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances
Il apparait ainsi que le montant de cotisations dit « normal » versé à titre d'employeur s'élève à 18,1 milliards d'euros pour l'État et ses opérateurs et à 15,62 milliards d'euros pour la CNRACL. Le montant de subvention versé par l'État et ses opérateurs correspond à 41,6 milliards d'euros, dont 36,1 milliards d'euros au titre de l'État seul. Les collectivités verseraient 8,2 milliards d'euros de subvention pour financer le système des retraites. Ainsi, au total, le système des retraites des fonctionnaires serait subventionné par les administrations publiques à hauteur de 49,9 milliards d'euros. Seuls 33,8 milliards d'euros constitueraient des cotisations « employeur » proches de ce que versent les employeurs privés. Pour la fonction publique d'État, il s'agit d'un surcoût annuel de 18 400 euros par bénéficiaire.
Une telle analyse illustre l'importance du système des retraites en termes de dépenses publiques.
2. L'État subventionne les déséquilibres démographiques de tout le système de retraite à travers le régime des fonctionnaires de l'État
Une méthodologie complémentaire peut être employée pour expliciter l'origine de cette cotisation « employeur ». L'institut22(*) des politiques publiques estime ainsi que plusieurs éléments peuvent expliquer l'ampleur de la contribution de l'État au régime de retraite des fonctionnaires :
- d'une part, l'État subventionnerait les droits à la retraite propres à certains fonctionnaires, en particulier des militaires et des policiers, à hauteur de 6,8 milliards d'euros ;
- d'autre part, l'État compenserait à travers le service des retraites de l'État le déséquilibre démographique global du système des retraites, qui est amplifié par l'éclatement des régimes de retraite. En effet, au total, tous régimes confondus, il existe environ 2,05 cotisants pour un bénéficiaire d'une pension de retraite. Toutefois, concernant le service des retraites de l'État, il existe seulement 1,29 cotisant pour un bénéficiaire d'une pension de retraite. En conséquence, le déséquilibre démographique subi par le service des retraites de l'État serait de 37 %, soit un coût pour l'État en 2020 estimé par l'IPP à 18 milliards d'euros.
C'est la diminution du nombre de cotisants au régime de la fonction publique d'État, au bénéfice du régime général, qui serait pour partie à l'origine de l'importante cotisation « employeur » de l'État. En conséquence, il pourrait être justifié de considérer ces 18 milliards d'euros comme un besoin de financement global du système de retraites, le nombre de cotisants étant trop faibles par rapport aux pensionnés. Ce besoin de financement serait financé par l'État à travers la contribution au CAS « Pensions ». En effet, dans un système intégré, sans régime spécial, ce déséquilibre démographique serait supporté par l'ensemble des cotisants, et non uniquement par l'État. Or le mécanisme de compensation démographique existant actuellement ne permet pas véritablement de partager la charge du déséquilibre démographique de manière équitable entre l'ensemble des cotisants des régimes.
L'Institut des politiques publiques en déduit un taux de cotisation employeur de l'État de 45,6 % sur le traitement indiciaire, qui serait équivalent à un taux de 35,4 % sur l'ensemble de la rémunération et demeurerait donc plus élevé que dans le secteur privé. En effet, le taux de cotisation employeur du privé pourrait être sous-estimé et ne pas correspondre aux équilibres démographiques globaux de l'ensemble des régimes. Les cotisations « employeurs » sont toutefois particulièrement élevées en France, puisqu'elles représentent 9,9 % du PIB en 2023, contre 7,6 % en moyenne dans la zone euro et 6,8 % en Allemagne. Le rapporteur spécial estime qu'un plafonnement des cotisations sociales à 28 % du revenu est justifié et pourrait être utilisé comme norme pour calculer la part de « cotisation normale » de l'État en tant qu'employeur.
En tout état de cause, ces analyses permettent d'illustrer que la présentation actuelle des documents budgétaires relatifs au système de retraite conduit à sous-estimer l'ampleur du besoin de financement du système de retraite, qui est au moins partiellement couvert par l'État.
Une présentation montrant que l'État contribue par sa cotisation « d'équilibre » à pallier un déséquilibre démographique global du régime des retraites serait pertinente pour illustrer la nécessité d'assainir de la trajectoire des dépenses de retraite.
3. Un système largement déficitaire dont le financement repose sur l'endettement de l'État et des administrations publiques
Le subventionnement par l'État et les collectivités des régimes de retraite implique que le poids des retraites pour les dépenses publiques est autrement plus important que ce qui est habituellement présenté. Ainsi, selon le calcul du Haut-Commissariat au plan et de M. Beaufret précité, les cotisations dites « normales » représenteraient 252,6 milliards d'euros, soit 67 % des dépenses du système des retraites. Les subventions des administrations publiques au système des retraites s'élèveraient à 75,5 milliards d'euros, décomposées ainsi :
- l'État subventionnerait le système des retraites à hauteur de 53,3 milliards d'euros, dont 41,6 milliards d'euros pour le système de retraites des fonctionnaires, 7,8 milliards d'euros de subventions aux autres régimes spéciaux et 3,9 milliards d'euros au titre des compensations d'exonérations de cotisations sociales ;
- les collectivités subventionneraient à hauteur de 8,2 milliards d'euros ;
- et enfin la CNAF et l'UNEDIC subventionneraient le système à hauteur respectivement de 10,3 milliards d'euros et 3,7 milliards d'euros.
Une telle observation peut être généralisée aux années récentes : ainsi, depuis 2014, le montant des subventions des administrations publiques au système des retraites, hors cotisations jugées « normales », oscille entre 66 et 75 milliards d'euros.
Évolution des différentes recettes
et des dépenses du système des
retraites
depuis 2014
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances
Ainsi, si l'on considère que les subventions des administrations publiques (État, collectivités et administrations de sécurité sociale) ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources du système du financement des retraites, le besoin de financement s'élève à 72 milliards d'euros en 2023. Il était déjà de 68 milliards d'euros en 2022.
Évolution des recettes, des dépenses
et du déficit du système des retraites
hors subventions des
administrations publiques
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances
Il est très regrettable que le Parlement ne dispose pas, à ce jour, d'une analyse complète dans un document unique présenté au vote lors de la période budgétaire et portant sur le coût de l'ensemble du système des retraites, tous régimes confondus.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le vendredi 14 novembre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Vincent Delahaye sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
M. Claude Raynal, président. - Nous examinons le rapport pour avis de Vincent Delahaye sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Nous avons le plaisir de recevoir Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales, ainsi que Mme Florence Lassarade, rapporteure pour avis de la mission « Santé », que nous examinerons dans un second temps.
M. Vincent Delahaye, rapporteur pour avis. - Le PLFSS pour 2025 nous a été transmis hier. La part que représente ce texte dans les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques - plus de 680 milliards d'euros - et son impact macroéconomique justifient la saisine pour avis, comme chaque année, de notre commission.
Comme vous le savez, la crise sanitaire a provoqué en 2020 un déficit record de la sécurité sociale de l'ordre de 40 milliards d'euros, alors qu'elle finissait à peine d'absorber les conséquences du choc de la crise financière de 2008-2009.
Depuis, la situation des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s'est légèrement redressée, mais son déficit restait très élevé, à hauteur de 10,8 milliards d'euros en 2023. En 2024, le déficit a été porté à 15,3 milliards d'euros et atteindrait même 23 milliards d'euros en 2025 d'après le présent PLFSS. Cette aggravation massive du déficit est d'autant plus frappante qu'aucune crise sanitaire ou financière ne vient spécifiquement la justifier.
L'augmentation forte du déficit depuis 2024 s'explique par le décalage entre l'évolution des recettes et des dépenses. Alors que l'augmentation des dépenses avait toujours été inférieure à celle des recettes, sauf en 2020, cette tendance s'est inversée en 2024 et 2025. La conjoncture économique inquiétante nuit en effet à la hausse des recettes, alors que les dépenses sont dynamiques structurellement, notamment sous l'effet de la démographie et de la revalorisation des prestations sociales sur l'inflation.
Par ailleurs, ce déficit de la sécurité sociale s'explique largement par des hausses de dépenses non financées, notamment le Ségur de la santé, qui représente ainsi un surcoût de près de 13 milliards d'euros par an depuis 2024.
Je note toutefois une amélioration dans la prévision du déficit, puisqu'il avait été anticipé à 22,1 milliards d'euros dans la loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, soit un écart de 900 millions d'euros - en 2024, l'écart avait été de 4,8 milliards d'euros.
Une telle aggravation du déficit de la sécurité sociale n'est pas acceptable. Des réformes structurelles des dépenses sociales sont indispensables pour permettre aux administrations publiques de retrouver un solde budgétaire positif, en contenant la hausse des dépenses par rapport à celle des recettes.
Le Gouvernement anticipait pour 2026 un déficit de 17,5 milliards d'euros, inférieur de 5,5 milliards d'euros à celui de 2025, mais supérieur de 2,2 milliards d'euros à celui de 2024. La réalisation de cette cible de déficit est de plus en plus improbable, puisqu'elle dépend de baisses des dépenses et de hausses des recettes qui ont été largement remaniées par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne les recettes, celles-ci devraient augmenter de 2,5 %, contre 2,4 % entre 2024 et 2025. Les mesures en recettes, minorées par des mesures en transfert de l'État vers la sécurité sociale, représenteraient un gain de 2,5 milliards d'euros dans le texte initial.
Le Gouvernement propose ainsi une taxe sur les cotisations perçues par les organismes complémentaires à hauteur de 2,25 %, qui viserait à percevoir la hausse de leurs cotisations opérées en 2024, alors qu'elles n'ont pas subi de hausse des dépenses. L'Assemblée nationale a toutefois supprimé cette disposition, tout comme le gel des seuils d'imposition de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement, qui aurait rapporté 300 millions d'euros. De même, l'article 8 du présent PLFSS avait prévu de soumettre les compléments de salaire, comme les titres-restaurant et les chèques-vacances, à une contribution patronale de 8 %. Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale, pour un coût de 950 millions d'euros.
S'agissant des dépenses, l'objectif du texte initial était de les limiter à 1,6 %, ce qui est déjà important. Elles relèvent largement de la branche maladie, à hauteur de 267,5 milliards d'euros, et de la branche vieillesse, pour 307,5 milliards d'euros. À la lecture du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, je suis très sceptique sur la réalisation de cet objectif.
Des mesures d'économies étaient proposées dans le texte initial, à hauteur de 9,1 milliards d'euros. En particulier, le gel de la revalorisation des prestations sociales, supprimé par l'Assemblée nationale mercredi dernier, devait rapporter 2,7 milliards d'euros. Je rappelle que les salaires des actifs ne sont pas systématiquement revalorisés tous les ans sur l'inflation, par exemple, contrairement aux prestations sociales. Concernant les pensions, cela représente une perte de 2,2 milliards d'euros d'économies.
La suspension de la réforme des retraites, à l'article 45 bis du PLFSS, entraîne un surcoût estimé dans l'étude d'impact à 100 millions d'euros en 2026 - certains parlent de 300 millions, mais on peut penser que les personnes qui auraient le droit de partir plus tôt à la retraite grâce à cette disposition ne l'auront pas anticipé, minorant le coût pour cette année... Le coût serait en revanche de 800 millions d'euros en 2027. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Thibault Bazin, penche plutôt pour la fourchette haute de 300 millions en 2026. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un coût considérable, alors que le vieillissement démographique ne permet pas à la France de maintenir son système de retraite en l'état.
Quant à la branche maladie, ses dépenses seraient en principe modérées, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) étant fixé pour 2026 à 270,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 2025. Les mesures d'économies proposées dans le texte initial, pour un montant de 6 milliards d'euros, ont été largement supprimées par l'Assemblée nationale. En particulier, la hausse des plafonds et des montants sur les franchises médicales et les participations médicales, à hauteur de 2,3 milliards d'euros, a été très critiquée par l'Assemblée.
Malgré le vote de la hausse de 1,4 point de la CSG sur les revenus du capital, censée rapporter 2,7 milliards d'euros, le déficit de la sécurité sociale pour 2026 se rapprocherait de celui qui était annoncé en l'absence de mesures nouvelles, soit 28,7 milliards d'euros. Il devrait en effet s'établir entre 24 et 25 milliards d'euros après sa modification par l'Assemblée nationale, contre 17,5 milliards d'euros dans le texte initial. Il relèvera de la branche maladie pour 22,3 milliards d'euros et de la branche retraite pour 4,6 milliards d'euros. Un tel déficit est totalement insoutenable et inacceptable, et appelle à une réforme structurelle et urgente de tout le système social français.
Selon les prévisions du Gouvernement, même en incluant les mesures proposées par le PLFSS initial, le déficit de la sécurité sociale demeurerait très élevé dans les années à venir, à hauteur de 16,8 milliards d'euros en 2027, 16,6 milliards d'euros en 2028 et 17,9 milliards d'euros en 2029. Ces chiffres sont sujets à caution.
La gestion à venir de la dette sociale est une source d'inquiétude. En effet, depuis fin 2024, il n'est plus possible, en l'absence de nouvelles dispositions législatives, de transférer les déficits de la sécurité sociale à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). C'est donc l'Urssaf Caisse nationale qui prend en charge l'intégralité des déficits. Si son plafond d'endettement est porté à 83 milliards d'euros par le présent PLFSS, celle-ci ne peut s'endetter qu'à court terme, à l'horizon d'un an. En cas de choc sur les marchés financiers, il n'est pas certain qu'elle parviendrait à trouver suffisamment d'acheteurs de dette sociale pour couvrir ses besoins. Il est donc très risqué de la charger d'autant de dette.
Pour autant, un nouveau transfert de dette à la Cades n'est pas envisageable en l'absence d'un plan sérieux de reprise en main de la trajectoire des comptes sociaux. Il est donc d'autant plus urgent d'assainir financièrement la sécurité sociale.
J'en viens à un sujet que j'ai choisi d'approfondir comme l'an dernier : le poids du système des retraites sur la dépense publique.
Depuis des années, dans la plupart des régimes de retraite, les cotisations ne sont pas suffisantes pour couvrir le niveau des pensions. Pour celui des fonctionnaires, l'État augmente artificiellement chaque année les taux de cotisation employeur afin de combler les déficits. Un même système est appliqué à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Si un taux identique à celui du secteur privé était appliqué, les cotisations employeur seraient beaucoup plus basses.
La somme des cotisations de niveau normal et des impositions et taxes affectées à l'ensemble des régimes de retraite représente près de 80 % des pensions versées par l'ensemble du système de retraite. Au total, les administrations publiques - État, CNRACL, mais aussi la branche famille et l'Unedic - comblent les besoins de financement du système des retraites pour près de 72 milliards d'euros. Cela fait peser un doute sur l'équilibre à long terme de ce système. L'Institut des politiques publiques a d'ailleurs montré dans une étude récente que près de 18 milliards d'euros de cette surcotisation de l'État dans le régime des retraites des fonctionnaires étaient dus au déséquilibre démographique global du système, qui serait supporté par tous les cotisants s'il existait un unique régime de retraite. L'État subventionne ainsi au travers du régime de ses fonctionnaires des déséquilibres imputables en réalité, pour partie, à l'ensemble des régimes de retraite.
Une présentation unifiée de ces éléments serait nécessaire. Notre collègue Sylvie Vermeillet recommande d'ailleurs d'améliorer l'information concernant les retraites de la sphère publique dans le compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », et je soutiens cette idée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vous aurez compris que ma position sur l'équilibre général du texte est extrêmement critique.
Mme Christine Lavarde. - Le déséquilibre, plutôt !
M. Vincent Delahaye, rapporteur pour avis. - C'est pourquoi je vous propose un avis défavorable sur le texte tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale et que le Sénat devrait améliorer significativement.
M. Claude Raynal, président. - Votre conclusion est assez proche de celle de l'an dernier. Je remarque une certaine continuité...
M. Vincent Delahaye, rapporteur pour avis. - Une certaine cohérence, oui.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. - Merci pour votre invitation. Il est toujours important de croiser les analyses de nos deux commissions. La situation est préoccupante. Chacun, quelles que soient ses opinions politiques, se pose la question de la pérennité de notre système de protection sociale, car la situation est intenable dans la durée.
Il nous faut préparer l'avenir et débattre des choix permettant un retour à l'équilibre, condition de notre crédibilité. Nous connaissons une dégradation sans précédent et hors période de crise des finances publiques : déficit des administrations publiques de 5,4 points de PIB, soit 160 milliards d'euros ; déficit le plus élevé de la zone euro - veut-on rester le mauvais élève ? - ; déficit de la sécurité sociale de 23 milliards d'euros en 2025.
La France est toujours sous surveillance de l'Union européenne - on a tendance à l'oublier... - et sous la surveillance des marchés financiers, puisque les taux d'intérêt sont plus élevés que ceux de l'Italie ou de l'Espagne, qu'on montrait du doigt il y a peu.
L'examen des budgets s'annonce donc compliqué, avec des sujets très sensibles. Deux années après son vote, la réforme des retraites est remise en cause avec sa suspension par lettre rectificative. Si le coût est négligeable pour 2026, c'est une bombe à retardement.
L'Assemblée nationale nous transmet des textes alourdis par des mesures inconséquentes : plus de taxes, plus de niches ; bref, beaucoup d'imagination, mais aucune mesure de redressement. Après son passage à l'Assemblée nationale, le PLFSS a gonflé à 24 ou 25 milliards d'euros de déficit. C'est catastrophique !
En tant que rapporteure générale, ma ligne de conduite sera de revenir à un déficit de 17 milliards d'euros. C'est un impératif. Cela peut paraître difficile, mais je serai intraitable et je n'en démordrai pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus transférer de dette à la Cades. On peut certes envisager ce qui est évoqué dans la note de bas de page n° 65 du rapport de la Cour des comptes, mais il faut pour cela une vraie trajectoire de retour à l'équilibre. La dette de l'Urssaf Caisse nationale sera de 120 milliards d'euros en 2027. Cela la rend fébrile.
Un point de vigilance : les 3 milliards d'euros prévus à l'article 40 du projet de loi de finances (PLF) concernant les allègements généraux. La réforme des allègements généraux permet un gain net pour la sécurité sociale de 1,6 milliard d'euros en 2025 et de 1,4 milliard en 2026. L'article 40 du PLF réduit de 9,1 milliards d'euros la TVA affectée à la sécurité sociale. Cette réduction, pour l'essentiel, est technique et justifiée, sauf pour les 3 milliards d'euros correspondant aux gains sur les allègements généraux. Pourquoi ? Parce que ces derniers sont actuellement sous-compensés à hauteur de 5,5 milliards d'euros, selon la Cour des comptes dans son rapport d'information sur l'application de la loi fiscale (Ralf).
En outre, le décret du 4 septembre dernier ne prévoit pas de réduction de 1,4 milliard d'euros. Ce budget anticipe donc quelque chose qui n'existe pas.
Les 3 milliards d'euros prévus n'annulent donc pas totalement la sous-compensation, puisque celle-ci s'élève à 5,5 milliards d'euros : il restera 2,5 milliards à compenser.
Je compte sur la commission des finances pour rendre à César ce qui revient à César. Bercy serait trop content de voir ces 3 milliards d'euros tomber dans son escarcelle. Le Sénat doit montrer le chemin du sérieux et de la sincérité budgétaires.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. - Je souscris à vos derniers propos. Merci à Vincent Delahaye, comme toujours tonique et très clair, malgré la difficulté qu'il y a à travailler dans l'improvisation permanente. Pour prendre une métaphore agricole, on a l'impression d'être sous la trémie de la moissonneuse-batteuse : on reçoit le grain au fur et à mesure de la coupe sans savoir ce que cela donne...
Or, on se trouve face à une augmentation sensible du déficit . Je comprends que, à force d'avoir reçu de l'argent public en perfusion, à flux continu sans efficacité, cela devient plus difficile de faire des choix.
Concernant le projet de loi de finances, nous avons travaillé sur la copie originale du Gouvernement. Nous aurons sans doute une version transformée, mais nous le saurons au dernier moment.
Je le dis au Gouvernement : il y a un problème de gouvernance. Qui porte le projet de loi de finances ? L'idée - mais je n'ose croire que ce soit le souhait du Gouvernement - de refiler la patate chaude au Parlement, faute de majorité politique, pour dresser ensuite un constat d'incapacité est profondément dangereuse, voire suicidaire. Personne n'étant candidat au suicide, dans ce contexte inédit de grand questionnement de nos concitoyens, nous nous efforcerons de proposer un redressement des comptes publics au moins aussi important qu'en 2025. Il serait coupable de laisser faire en attendant que d'autres aient à prendre des décisions encore plus douloureuses. Merci d'avoir rappelé qu'en ne présentant pas de consolidation des comptes relatifs aux retraites, on fait comme si on ne voyait pas le problème. Finalement, cela arrange tout le monde !
Nous devons faire très attention. Si nous voulons de la cohésion, il faut éviter de dresser les Français les uns contre les autres. Je ne crois pas que les retraités veuillent d'abord protéger leur condition, plus que celles des actifs ou des jeunes. Nous devons objectiver les données pour que la solidarité entre les générations continue de s'exercer pleinement.
J'ai aussi entendu la détermination de la rapporteure générale de la commission des affaires sociales.
M. Arnaud Bazin. - Merci aux rapporteurs qui ont parlé de façon très claire et directe. Si le rapporteur général s'est réjoui de l'absence de périphrase, je poserai tout de même une question de vocabulaire : le transfert d'un déficit de cette ampleur - potentiellement 24 milliards d'euros - vers une caisse de trésorerie ne s'appelle-t-il tout simplement pas une cavalerie ?
M. Victorin Lurel. - Que le Sénat fasse preuve de sérieux budgétaire, nous l'entendons. Mais que le Sénat fasse aussi preuve de réalisme politique ! Personne n'a raison tout seul. L'état de l'opinion publique est ce qu'il est. L'Assemblée nationale en est la traduction fidèle et son texte le reflète. Penser que ce dernier est forcément mauvais serait un regrettable manque de réalisme politique.
La majorité sénatoriale colorera le PLFSS d'une autre teinte que l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire (CMP) ne sera probablement pas conclusive et peut-être que le Premier ministre demandera à l'Assemblée nationale de se prononcer. S'il y a quelque cohérence à l'Assemblée, elle reviendra à l'épure de ce qui nous a été envoyé. Auquel cas, pourquoi ne pas déposer une motion plutôt que de perdre du temps à tout modifier ? Je ne prêche pour aucune démagogie budgétaire : je sais très bien que l'estimation de 17,5 milliards d'euros n'est pas bonne et que la réalité est plus proche de 24 à 25 milliards d'euros ; Vincent Delahaye évoque même 28,7 milliards d'euros. Il n'y a pas de bonne solution, mais de moins mauvaises solutions. Un déficit de 5 % du PIB reste raisonnable en programmation pluriannuelle. C'est un bon compromis compte tenu de l'émiettement politique actuel.
Nous aimerions conserver des acquis du texte modifié. Aussi, nous réservons notre position.
M. Laurent Somon. - Je m'opposerai à une motion. Il faut absolument débattre des retraites, sujet très important.
Le constat n'est-il pas biaisé dès lors que l'on fait l'hypothèse d'une hausse de l'Ondam de 1,6 % alors que ces dernières années, elle était de plus de 4 % et que depuis 2012, elle est rarement passée sous la barre des 2,5 % ?
M. Claude Raynal, président. - À titre personnel, je pense que nous devons nous interroger sur notre état d'esprit. Merci à la rapporteure générale d'avoir clairement dit ce qu'elle souhaitait faire. Si le Sénat revient à la copie initiale agrémentée de quelques zakouski en estimant que l'Assemblée nationale a fait n'importe quoi, et que l'on se retrouve en CMP, son apport final sera faible.
L'Assemblée nationale trouve des majorités sur des amendements qui s'additionnent sans grande cohérence : il faut ensuite mener un travail de peignage. C'est un nouveau monde dans lequel il faut apprendre à fonctionner, car il va durer - on pourrait connaître le tripartisme pendant longtemps. Il faut conserver les mesures qui peuvent participer à l'équilibre et écarter les autres. On peut choisir de faire l'inverse pour envoyer un message politique, mais cela pourrait se traduire par une défaite en rase campagne.
Je ne souhaite pas que le Sénat refuse de prendre en compte la réalité de la discussion politique telle qu'elle se présente. Nous gagnerions tous à être dans la modération et la recherche d'équilibre. C'est l'intérêt du pays.
Un compromis en CMP nous offrirait une sortie par le haut. On n'a rien à gagner au rejet du PLFSS. C'est tout de même le texte sur lequel le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Évitons de nouveaux événements désagréables ; nous n'en avons pas besoin.
M. Vincent Delahaye, rapporteur pour avis. - Faut-il du réalisme politique ? Faut-il voter des mesures populaires pour faire plaisir aux gens ? Faut-il leur distribuer de l'argent ? La ministre de la santé a affirmé, lors de la dernière séance de questions d'actualité au Gouvernement, qu'elle donnerait 1 milliard d'euros aux hôpitaux : mais d'où ce milliard sort-il ? On dit aux Français qu'il faut se serrer la ceinture et d'un seul coup, on trouve 1 milliard venu d'on ne sait où. Les Français en ont assez des petites combines entre partis.
Il faut que le Sénat ait une voix forte, claire, et affirme que cette situation ne peut pas perdurer. Politiquement, j'ai bien conscience de la difficulté liée à l'hétérogénéité de l'Assemblée nationale, mais nous devons fixer un cap. Or, pour moi, ce doit être le redressement des comptes publics. Il faut aussi soutenir l'économie, car si l'on taxe trop les entreprises, on taxe les emplois et les salaires.
Je suis pour une pédagogie claire. Le Sénat doit faire preuve de sagesse, en répondant aux Français qu'il les a entendus, mais que malheureusement, il n'y a plus d'argent. Nous allons tomber dans le précipice. Il faut arrêter d'avancer !
Je suis défavorable à une motion. Il faut débattre. Nous devrons essayer de garder le meilleur de la copie et de faire adopter le PLFSS. J'ai bien conscience des difficultés ; je ne crois pas beaucoup à une CMP conclusive. Néanmoins, le Sénat doit se distinguer de l'Assemblée nationale, en évitant de tomber dans les petites combines qui reportent l'effort sur les générations futures. Je ne suis pas du tout d'accord avec le président Raynal sur ce point.
Oui, M. Bazin a raison : c'est de la cavalerie ! L'Assemblée nationale augmente le déficit de 6,6 à 7 milliards d'euros sans souci, en deux jours, en supprimant toutes les contraintes impopulaires. Elle laisse filer le déficit sans savoir du tout comment on redressera les comptes.
En effet, cher Laurent Somon, une hausse de l'Ondam de 1,6 % est une hypothèse extrêmement optimiste. Il est évident qu'elle ne sera pas plus respectée que celles des années précédentes. Cet objectif a été fixé pour atteindre 17,5 milliards d'euros de déficit. De même, l'hypothèse de hausse de la masse salariale de 2,3 % a été qualifiée d'optimiste par le Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Elle a été formulée ainsi parce que le calcul des cotisations se base dessus.
Nous allons vraiment dans la mauvaise direction. C'est pourquoi je maintiens mon avis défavorable.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. - Chacun est dans son rôle. Le mien doit être de plaider pour le retour à l'équilibre des comptes. Au fil du temps, nous avons trop renoncé aux économies. C'est un coup de canif dans le contrat entre générations.
Le déficit de la branche maladie est l'éléphant dans la pièce. Laisser les générations futures payer pour nous n'est pas fidèle au contrat de la sécurité sociale. Celle-ci repose sur une solidarité contemporaine entre générations. J'entends les jeunes qui disent qu'ils n'auront pas de retraite ; ils ont peur.
Le système actuel doit être remanié. Certes, ce n'est pas le temps politique pour le faire, mais il faut imprimer une marque de sérieux et cesser de procrastiner.
Mon rôle sera toujours de rappeler qu'il faut diminuer le déficit. La solution proposée par la Cour des comptes dans la note de bas de page n° 65 de son dernier rapport, selon laquelle la Cades amortira la dette plus tôt d'un semestre, dégageant une ressource non affectée de 20 milliards d'euros, n'est possible que si l'on s'assure de recettes correspondantes. La loi organique l'impose : si l'on prolonge la durée d'exercice de la Cades, il lui faut des recettes, ou tout au moins une trajectoire crédible. Sinon, comment les marchés financiers pourraient-ils croire à notre sérieux ?
C'est à l'ensemble de l'assemblée sénatoriale de trouver un compromis. Notre devoir est de tracer une trajectoire raisonnable pour les générations futures.
Je ne crois pas qu'il faille attendre 2027, donc encore deux ans, pour se confronter au problème. À force d'ajouter de la dette à la dette, en particulier via l'Urssaf Caisse nationale, nous n'avons plus le matelas financier qui a permis d'amortir les dépenses durant la crise financière ou la crise sanitaire.
M. Claude Raynal, président. - Madame la rapporteure générale, nous vous remercions de vos précisions. Tous les commissaires des finances comprennent très bien l'importance de la ligne politique et de l'objectif affiché : personne ne le conteste.
Toutefois, il y a un problème de gestion du temps. Depuis l'examen des derniers PLF, et désormais à l'occasion du PLFSS, la commission des finances fait face à une difficulté particulière. Nous avons le sentiment que ces textes abordent des questions qui auraient dû être traitées en amont, alors qu'ils devraient plutôt être le point d'arrivée d'une réflexion antérieure. Ainsi, on dépose, un peu à la hussarde, dans le PLF, un amendement d'appel visant à transférer plusieurs milliards d'euros de crédits ou à supprimer une taxe - c'est ainsi que l'Assemblée nationale a supprimé la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), qui rapporte pourtant 5 milliards d'euros par an. Espérons que l'on n'en arrive pas là dans notre assemblée, et que les amendements d'appel finiront par être retirés.
Certes, on peut estimer que des mesures ponctuelles permettront, petit à petit, de réduire le déficit. Dans la version initiale du PLFSS, le Gouvernement prévoyait de réduire le déficit de 17,5 milliards d'euros, ce qui n'a rien de grandiose ; il avance désormais que nous ne parviendrons toujours pas à l'équilibre d'ici à trois ans. Pour le dire autrement, des décisions techniques ne permettront pas de résoudre le déficit.
Si, avant les discussions financières, il n'y a pas un débat de société sur l'ensemble de la sphère sociale, qui représente plus de la moitié de la dépense publique ; si les choses ne sont pas clairement mises sur la table - je ne parle pas uniquement des retraites ou de la sécurité sociale, mais bien de l'ensemble des dépenses sociales - ; s'il n'y a pas un accord transgénérationnel à ce sujet, alors nous n'y arriverons pas. C'est compliqué, mais dans une démocratie, il faut en passer par là. Sinon, nous n'arriverons jamais à atteindre l'équilibre nécessaire.
Je me souviens que, l'année dernière, Christine Lavarde avait déposé un amendement visant à modifier la fiscalité des pensions de retraite. Il ne me posait pas de problème sur le fond, mais j'étais intervenu pour souligner que nous ne pouvions pas procéder de cette manière : la mesure n'aurait pas abouti !
Mme Christine Lavarde. - Nous en reparlerons lors du PLF...
M. Claude Raynal, président. - C'est uniquement en préparant la discussion budgétaire que celle-ci peut aboutir. Il me semble que l'urgence est de parvenir à un accord sur le PLFSS. Même si nous le considérons tous mauvais - la majorité sénatoriale estime qu'il va trop loin, quand nous pensons qu'il ne va pas assez loin, mais peu importe -, nous devons parvenir à un accord, car sinon, je le dis sincèrement, je crains que ce ne soit pire encore.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. - J'en reviens à la patate chaude qui a été donnée au Parlement. Ces difficultés découlent de la décision de la dissolution : depuis, il n'y a plus de gouvernement qui « détermine et conduit la politique de la Nation », selon les termes de l'article 20 de la Constitution. Le Gouvernement nous transmet un texte, en nous demandant de nous débrouiller pour naviguer. Nous allons nous battre : c'est un débat politique, et nos concitoyens doivent bien voir que nous ne sommes pas dupes.
La commission émet un avis défavorable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction générale de la santé (DGS)
- Mme Sarah SAUNERON, directrice générale adjointe ;
- Mme Claire MARIN, adjointe à la cheffe de bureau budget et performance) ;
- Mme Florence LYS, chargée de mission auprès du sous-directeur appui au pilotage et ressources.
Direction de la sécurité sociale
- M. Thomas RAMILIJAONA, sous-directeur du financement de la sécurité sociale ;
- Mme Marion MUSCAT, sous-directrice de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail ;
- Mme Marie-Agnès PARIAT-POMMERY, cheffe de bureau à l'accès aux soins et prestations de santé ;
- Mme Cindy RIVIÈRE-MARBOIS, chargée de mission du financement de la sécurité sociale, synthèse financière, relations État/sécurité sociale : champ emploi.
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES)
- M. Pierre RICORDEAU, président ;
- M. Philippe PETITBON, secrétaire général.
Institut des politiques publiques (IPP)
- M. Patrick AUBERT, économiste senior ;
- Mme Maïlys PEDRONO, économiste junior ;
- M. Maxime TÔ, responsable du pôle retraite de l'IPP et chercheur associé au CREST et à l'IFS ;
- M. Todor TOCHEV, économiste senior.
Expert
- M. Jean-Pascal BEAUFRET, spécialiste des finances publiques.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2026.html
* 1 Retraites des fonctionnaires d'État : faut-il changer la convention comptable ? Institut des politiques publiques, juillet 2025.
* 2 Avis du Comité d'alerte n°2025-2 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
* 3 Avis du Comité d'alerte n° 2025-4 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
* 4 Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.
* 5 5 milliards d'euros en 2021 puis à nouveau en 2022 destinés au désendettement et à l'investissement des établissements de santé, un solde de 3 milliards d'euros étant prévu en 2023.
* 6 Rapport annuel sur les lois de financement de la sécurité sociale - mai 2025.
* 7 Le décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants prévoit de créer une assiette unique pour les cotisations sociales et les prélèvements de CSG et de CRDS.
* 8 L'article 40 du projet de loi de finances pour 2024 propose de porter de 23,24 % à 19,26 % la fraction de TVA destinée à la branche « maladie » du régime général de sécurité sociale. La fraction de TVA attribuée à l'ACOSS est toutefois augmentée de 5,18 % à 8,10 %.
* 9 Haut Conseil des finances publiques , avis n° 2025-5 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026, 9 octobre 2025.
* 10 Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, A. Bozio et E. Wasmer, octobre 2024.
* 11 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 12 Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.
* 13 La situation financière de la sécurité sociale, Cour des comptes, octobre 2025.
* 14 En ce sens, la commission des finances a adopté un amendement COM-47 de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, supprimé à l'Assemblée nationale, réintroduit en nouvelle lecture par un amendement COM-23 du rapporteur général.
* 15 Rapport annuel du COR, juin 2025.
* 16 Rapport général n° 144 (2024-2025), tome III, annexe 25, Mme Vermeillet, déposé le 21 novembre 2024.
* 17 Ce taux est appliqué sur le traitement indiciaire hors prime des fonctionnaires.
* 18 Rapport général n° 144 (2024-2025), tome III, annexe 25, Mme Vermeillet, déposé le 21 novembre 2024.
* 19 Retraites obligatoires et déficits publics, Commentaires, été 2023 ; Les trois singes et les finances publiques, Commentaires, automne 2024.
* 20 Retraites, une base objective pour le débat civique, Haut-Commissariat au plan, décembre 2022.
* 21 Décret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites.
* 22 Retraites des fonctionnaires d'État : faut-il changer la convention comptable ? Patrick Aubert, Maïlys Pedrono, Maxime Tô, Todor Tochev, Institut des politiques publiques, juillet 2025.