B. FAIRE FACE À LA DYNAMIQUE DES DÉPENSES SOCIALES
1. Les facteurs de croissance des dépenses sociales
a) La sécurité sociale confrontée, avant tout, à une crise des dépenses
La
dégradation rapide du solde du régime général de la
sécurité sociale est le résultat d'une conjonction de
plusieurs facteurs défavorables et avant tout d'une progression
accélérée des dépenses sociales bien plus que d'une
progression ralentie des recettes.
D'après le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003, cette
accélération des dépenses sociales crée des risques
importants, notamment «
celui d'une dérive
financière et d'une perte durable de la maîtrise du
système ;
celui aussi d'être contraint, si d'autres
solutions n'étaient pas mises en oeuvre, à des hausses de
prélèvements qui seraient d'autant plus massives qu'elles
auraient été différées
».
L'analyse des facteurs explicatifs de l'accélération de la hausse
des dépenses sociales permet toutefois de faire la part entre les causes
structurelles de ce phénomène et ses causes conjoncturelles.
Cette analyse conduit dès lors à se demander s'il est
judicieux et souhaitable de faire reposer tout le poids de la régulation
des dépenses sociales, et notamment des dépenses d'assurance
maladie, sur le seul instrument financier que constituent les
prélèvements obligatoires
.
Il faut souligner que l'assurance maladie n'a jamais connu un déficit
équivalent à celui d'aujourd'hui. En outre, quelle que soit la
situation économique, ce déficit persiste, ce qui conduit
à penser que le système de protection sociale est
confronté à une crise de dépenses et non à une
crise de recettes et que la priorité doit être donnée
à la maîtrise des dépenses de santé, d'autant plus
qu'il ne faut pas s'attendre à un ralentissement spontané de leur
dynamique, compte tenu des besoins croissants liés à
l'évolution de la société (allongement de la durée
de la vie, progrès médicaux, débat récurrent sur la
création d'un cinquième risque pour la dépendance).
Déficit de la Caisse nationale d'assurance maladie
rapporté
aux recettes de cotisations et d'impôts
affectés
(en %)
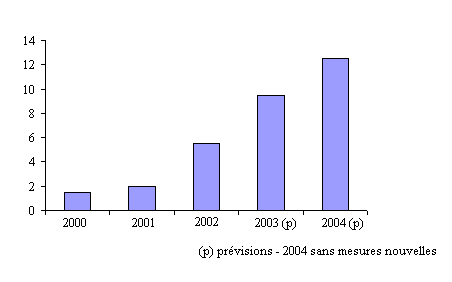
Source : commission des comptes de la sécurité sociale
b) Les facteurs structurels à l'origine de l'accélération de l'augmentation des dépenses d'assurance maladie
Le
rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de
septembre 2003 souligne l'existence de
deux types de facteurs
expliquant
l'accélération régulière de l'évolution des
dépenses d'assurance maladie : des
facteurs structurels
,
d'une part - surprescription de médicaments, progression forte des
dépenses d'indemnités journalières, accès croissant
de certains assurés au bénéfice de
l'affection de
longue
durée (qui concerne aujourd'hui six millions de personnes)
- des facteurs
plus conjoncturels
, d'autre part, tels que certaines
décisions récentes, qu'il s'agisse de la succession des
protocoles hospitaliers ou des revalorisations substantielles d'honoraires qui
ont accéléré les dépenses et dégradé
les comptes.
La
consommation de soins
a connu une augmentation rapide depuis
1997 : cette augmentation est liée à des facteurs
structurels - le vieillissement de la population - qui se traduit par une
hausse du nombre de personnes âgées dont la consommation
médicale est élevée ; le progrès technique qui
met à disposition des patients des traitements plus efficaces mais aussi
plus coûteux.
Les études disponibles mesurant l'impact du vieillissement de la population sur l'évolution des dépenses de santé
Comme
l'a rappelé M. Jean-François Mattéi, ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées, lors de la
présentation du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004, il faut «
accepter
d'assumer une part inéluctable d'augmentation des dépenses de
santé, liée au vieillissement de nos sociétés et au
progrès médical
».
Le vieillissement a en effet aujourd'hui un coût
: les
dépenses de santé des plus de 60 ans sont trois fois plus
élevées que celle des trentenaires et les personnes
âgées de plus de 70 ans consomment 30 % des dépenses
totales.
D'après une étude réalisée par la DREES
16(
*
)
,
les facteurs démographiques
seraient tendanciellement à l'origine d'environ 1 point par an de
croissance des dépenses totales de santé en volume, dans la
plupart des pays d'Europe occidentale. En outre, au sein de ces facteurs
démographiques structurels, l'impact du vieillissement serait de l'ordre
de 0,7 % par an sur la période 2000-2020
.
A l'avenir, la croissance du nombre de personnes âgées devrait
induire une croissance des dépenses d'assurance maladie. Selon les
projections démographiques publiées par l'INSEE en 2001, la
France compterait en 2020 par rapport à 2000, 1,4 fois plus de personnes
de 60 ans et plus, et 1,8 fois plus de personnes de 80 ans et plus, (et 3,2
fois plus en 2040). Ainsi en 2020, la France compterait 17 millions de
personnes de 60 ans et plus et près de 4 millions de personnes de
80 ans et plus. A l'horizon 2040, il y aurait près de 7 millions de
personnes de 80 ans et plus.
A cet égard, la DREES
17(
*
)
a réalisé des
projections du nombre de personnes
âgées dépendantes à l'horizon 2020 puis 2040
,
afin d'appréhender les effets des évolutions
démographiques futures en fonction de différents scénarii
possibles d'évolution de la dépendance aux âges
élevés.
A l'horizon 2040, le vieillissement de la population devrait conduire, dans
les trois hypothèses, à une augmentation tendancielle du nombre
de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans
. Une
première accélération aurait lieu à partir de 2010
et une seconde à partir de 2030. Sur la période 2000-2020, la
hausse serait de l'ordre de 16 % dans le scénario optimiste, 25 %
dans le scénario central et de 32 % dans le scénario pessimiste.
Entre 2020 et 2040, le nombre de personnes âgées
dépendantes augmenterait dans des proportions légèrement
supérieures. Au total, sur les quarante années, l'augmentation
serait de 35 % dans le scénario optimiste, 55 % dans le scénario
central ou de 80 % dans le scénario pessimiste.
Cette hausse serait
en outre concentrée sur les 80 ans et plus
.
La croissance tendancielle est également favorisée,
d'après le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003, par «
la grande
liberté dont l'ensemble des acteurs disposent dans le système de
soins. Les gains potentiels du système de soins en termes
d'efficacité sont sans doute très importants. On peut ainsi
simplement rappeler que la France est selon l'OCDE le premier consommateur de
médicaments par habitant, au-delà même des Etats-Unis, sans
que le bénéfice en termes de santé soit
démontré
».
A l'augmentation de la consommation, s'ajoute une
croissance
régulière du taux moyen de remboursement
: le nombre des
assurés exonérés du ticket modérateur augmente
très rapidement et celui des patients admis en « affection
longue durée » ouvrant droit à l'exonération
totale du ticket modérateur s'accroît d'environ 6 % par an.
c) Des facteurs plus conjoncturels
Les
années 2002-2003 ont du supporter l'impact de
mesures
financières exceptionnelles
dont l'incidence a été
simultanée :
- les créations d'emplois dans la fonction publique hospitalière
liées aux programmes de santé publique et à la
mise en
place de la réduction du
temps de travail
s'ajoutant à
des revalorisations salariales importantes négociées à
partir de l'année 2000 dans le secteur public et à partir de
l'année 2002 dans les cliniques ;
- les revalorisations tarifaires accordées aux professionnels de
santé libéraux en 2002 et 2003 ;
- la montée en charge des plans de développement dans le secteur
médico-social ;
- le transfert sur l'assurance maladie de charges financées
antérieurement par le budget de l'Etat.
Le coût pour l'assurance maladie des mesures exceptionnelles intervenues depuis 2000
La mise
en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
(ARTT) dans la fonction publique hospitalière doit s'accompagner de la
création de 45.000 emplois personnels non médicaux et de 3.500
emplois médicaux
(dont les postes correspondant à
l'intégration des gardes dans le temps de travail) pour un coût de
1,9 milliard d'euros en année pleine. Les 45.000 emplois non
médicaux se répartissent en 37.000 emplois dans le champ
sanitaire et 8.000 emplois dans le champ médico-social. Compte tenu du
temps nécessaire pour pourvoir les emplois créés, la mise
en place de l'ARTT s'est accompagnée au cours des exercices 2002 et 2003
de l'introduction d'un
compte épargne temps
(CET) destiné
à « stocker » les congés non utilisés
et du paiement d'heures supplémentaires.
Au plan financier, le coût global prévisionnel de la
création, échelonnée sur la période 2002-2005, des
34.600 emplois non médicaux (hors unités de soins longue
durée) et des 3.500 emplois médicaux dans les
établissements publics de santé s'élève à
1,624 milliard d'euros. Ce montant est porté à 1,865 milliard
d'euros pour 45.000 emplois créés (hors médecins), si l'on
tient compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Il convient d'y ajouter les crédits non pérennes consacrés
au financement du CET, soit 1,256 milliard d'euros pour les
établissements publics de santé (1,364 milliard d'euros si
l'on ajoute les établissements sociaux et médicaux sociaux
publics). Ces crédits sont destinés à financer, pour la
période 2002-2004 pour les médecins et 2002-2003 pour les
personnels non médicaux, les droits à congé non pris ou
portés dans un CET du fait de l'étalement sur trois ans des
créations d'emplois au titre de la réduction du temps de travail.
Ce financement permettra aux établissements de remplacer les agents qui
utiliseront ces droits, qui représentent un volume de plus de 30.000
équivalents temps plein sur la période 2002-2004.
D'après le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale datant de septembre 2003, les
conséquences financières
de la réduction du temps de travail à l'hôpital sont
évaluées
pour 2004 et 2005 à, respectivement,
881 millions d'euros et 355 millions d'euros, ces coûts
étant essentiellement liés au CET.
Au total, les protocoles hospitaliers signés en 2000 et 2001 et la mise
en oeuvre de la réduction du temps de travail majorent de près de
3,4 milliards d'euros les dépenses de l'ONDAM par rapport à 1999,
avec le bénéfice de la création de 43.000 emplois.
En outre, la revalorisation des honoraires des généralistes en
2002 s'est traduite par un coût en année pleine de
690 millions d'euros.
L'effet net cumulé sur 2003 de l'ensemble des décisions publiques
intervenues depuis 2000 en termes d'assurance maladie est de 5 à 5,5
milliards d'euros par rapport à 2000 d'après les calculs de la
Cour des comptes. Ce montant mérite d'être rapproché des
déficits des régimes obligatoires d'assurance maladie de 2002
(6,1 milliards d'euros) et 2003 (10,6 milliards d'euros).







