D. TROUVER DES ALTERNATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
1. Des prélèvements obligatoires qui doivent se justifier par une plus grande efficience de la sphère publique
a) Mieux arbitrer entre l'efficacité de la dépense publique et celle de la dépense privée
Le taux
de prélèvements obligatoires est directement lié au
montant des dépenses publiques.
La question est de savoir si la France doit maintenir un niveau de
dépense publique aussi important qu'aujourd'hui, et notamment si
certaines activités assumées aujourd'hui par l'Etat ne pourraient
pas l'être plus efficacement par le secteur privé.
Dans ce
cas, les prélèvements obligatoires levés pour ces
actions seraient supprimés.
Il s'agit de bien identifier l'avantage de la dépense publique par
rapport au marché
. Certaines dépenses publiques sont
justifiées parce qu'elles ne pourraient être assumées par
le marché dans des conditions satisfaisantes pour la
société. En revanche, quand le secteur privé se
développe et devient efficient au point de pouvoir prendre en charge
certaines actions, il n'y a pas lieu de maintenir la dépense publique.
Or, si l'on fait le rapport entre le montant de la dépense publique dans
un pays et son taux de croissance, il apparaît que sur les vingt
dernières années, la France détient à la fois un
record en termes de dépenses publiques mais également en
matière de faible croissance du PIB.
Relation croissance économique - dépenses publiques
(en %)
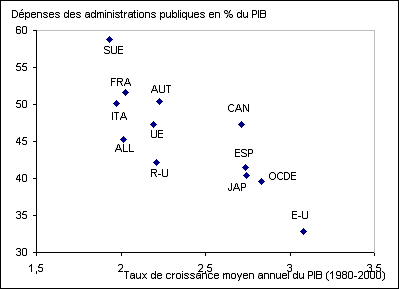
Source : OCDE
b) Un moindre recours au citoyen contribuable
(1) Mieux identifier les coûts : faire payer davantage l'usager
L'usager doit contribuer au financement des services
collectifs
qu'il utilise.
Les mécanismes de financement par péages ou redevances sont ainsi
centraux dans l'économie des transports. Ils déterminent la part
de l'usager dans le financement de l'infrastructure par rapport à celle
du contribuable.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
souhaite que les péages et redevances deviennent le mode normal de prise
en charge par l'usager des coûts d'infrastructures de transport.
Mais tous les chiffres montrent que le recours aux péages et redevances
est encore très limité et inégal.
Si la part de l'usager dans le financement des autoroutes
concédées atteint 92 %
21(
*
)
, elle descend à 76 % pour
le contrôle aérien, 63 % pour les aéroports, et
56 % pour les ports. Elle est très réduite pour le transport
ferroviaire (25 %) et les voies navigables (9 %) et nulle pour les
routes nationales.
Le péage reste donc un modèle d'exception pour la plupart des
modes de transport
, à l'exception des autoroutes
concédées, alors même que toutes les réflexions
menées dans le cadre européen préconisent le
développement du péage.
Effort de l'usager dans le financement des infrastructures
(en millions d'euros)
|
|
Etat |
Fiscalité affectée |
Collectivités locales |
dette du gestionnaire |
Effort de l'usager |
Total |
part de l'usager |
|
Autoroutes concédées |
|
|
|
457 |
4 939 |
5 397 |
92 % |
|
Routes nationales |
1 486 |
233 |
762 |
0 |
0 |
2 481 |
0 % |
|
Total |
1 486 |
233 |
762 |
457 |
4 939 |
7 878 |
63 % |
|
Réseau ferré national |
3 859 |
352 |
122 |
305 |
1 508 |
6 146 |
25 % |
|
Contrôle aérien |
32 |
192 |
0 |
76 |
946 |
1 246 |
76 % |
|
Aéroports |
0 |
252 |
12 |
46 |
521 |
831 |
63 % |
|
Voies navigables |
0 |
76 |
30 |
0 |
10 |
117 |
9 % |
|
Ports |
104 |
45 |
91 |
-15 |
291 |
517 |
56 % |
Source : rapport de M. Jacques Oudin sur le financement des infrastructures de transports n° 42 (2000-2001), données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ces
chiffres montrent que les autoroutes concédées sont
financées presque exclusivement par les usagers et non par les
contribuables. Les aéroports et les ports sont également
majoritairement financés par l'usager. En revanche, c'est
essentiellement le contribuable national ou local (particulièrement dans
le cas des routes nationales) qui finance le réseau ferré, les
routes nationales, et les voies navigables.
Le fait que le contribuable paye le coût d'un service qu'il n'utilise
pas toujours alors que l'usager bénéficie d'un service
sous-tarifé a des conséquences.
Ainsi, en matière de transports publics, le paiement du ticket
en-dessous du coût de revient a pu conduire à un comportement des
voyageurs parfois peu respectueux des équipements mis à leur
disposition : l'usager n'assume pas l'intégralité du
coût, qu'il délègue au contribuable. La subvention
publique, contrepartie de l'impôt, distend le lien entre le service et
l'usager, celui-ci étant moins exigeant qu'un client normal et
l'entreprise ayant une politique commerciale moins attentive. Pour cette
raison, la répartition du financement entre impôt et
« redevance pour service rendu » doit évoluer.
(2) La nécessité de la responsabilisation des assurés sociaux : l'exemple de l'assurance maladie
Dans le
domaine de l'assurance maladie, la question de la responsabilisation des
assurés sociaux se pose avec acuité dans un contexte de
déficit record (10,6 milliards d'euros pour la branche maladie du
régime général en 2003 et 14,1 milliards d'euros en 2004
en l'absence de mesures nouvelles) et de poids prépondérant des
prélèvements sociaux dans le PIB.
Deux questions principales s'agissant du financement des dépenses de
santé et du partage des responsabilités entre acteurs du
système de santé se posent : d'une part, la question de la
répartition des rôles entre régimes obligatoires et
organismes complémentaires, d'autre part, la question de la prise en
charge par les assurés eux-mêmes de certains frais jusqu'ici
supportés par la collectivité.
En France aujourd'hui, 76 % des dépenses de santé sont
financés par des fonds publics, un niveau plus élevé que
la moyenne des pays de l'OCDE qui se situe à 72 %. Le reste des
dépenses de santé est assuré à hauteur de 14 %
par les assurances privées et de 10 % par les versements nets des
ménages, alors qu'aux Etats-Unis, par exemple, 35 % du total des
dépenses de santé sont pris en charge par les assurances
privées et 15 % par les consommateurs, et qu'en Suisse, 10 % seulement
des dépenses totales de santé sont financées par les
assurances privées tandis que 33 % sont payées directement par
les consommateurs.
S'agissant de la répartition des rôles entre régimes
obligatoires et organismes complémentaires
, des propositions
existent pour une plus grande rationalisation de ce partage. Ainsi, le groupe
de travail de la commission des comptes de la sécurité sociale
sur la «
répartition des interventions entre les assurances
maladie obligatoires et complémentaires en matière de
dépenses de santé
», présidé par M.
Jean-François Chadelat, avait proposé, dans son rapport datant du
mois d'avril 2003, la création d'une couverture maladie
généralisée, consacrant l'existence d'un mécanisme
de prise en charge à deux étages, le premier correspondant aux
assurances maladie obligatoires, le second aux assurances maladie
complémentaires. Le rapport préconisait notamment de faire des
assurances maladie complémentaires un acteur à part
entière de la couverture maladie et de définir certains actes ou
certaines catégories d'actes pour lesquelles les complémentaires
santé pourraient devenir les acteurs pilotes du dispositif. Parmi ces
actes, on peut penser notamment aux soins optiques, dentaires ou encore au
domaine de l'appareillage au sens large.
La piste d'une redéfinition des champs d'intervention respectifs de
l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance complémentaire
mérite donc d'être creusée.
S'agissant de la question de la responsabilisation des assurés
sociaux
, une réelle réflexion sur la définition des
actes qui relèvent de la prise en charge par la collectivité, au
nom du principe de solidarité, et de ceux qui relèvent de la
responsabilité individuelle de l'assuré, doit aujourd'hui
être menée.
Sans anticiper sur les conclusions qui seront rendues avant la fin de
l'année par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie,
installé par le Premier ministre le 13 octobre 2003, il est aujourd'hui
nécessaire de remettre en perspective l'idée selon laquelle le
remboursement social est seul garant de l'accès aux soins et de trouver
le juste équilibre entre solidarité collective et
responsabilité individuelle. Comme le soulignait le Premier ministre
lors de l'installation du Haut conseil : «
Faut-il couvrir
dans les mêmes conditions une fracture du bras causée par une
chute dans la rue ou par un accident de ski ?
».
La responsabilisation des assurés sociaux peut dès lors prendre
différentes formes : l'acceptation du déremboursement des
médicaments à service médical rendu insuffisant ou des
médicaments « princeps » trouvant leur
équivalent dans des groupes génériques, le
développement des assurances privées et une participation accrue
des patients eux-mêmes s'agissant de la couverture de pathologies
résultant de conduites à risque imputable au seul assuré
(comme par exemple, la pratique d'un sport à haut risque). Ainsi, il est
possible d'envisager que des mécanismes d'assurance personnalisée
prennent le relais de l'assurance maladie pour la couverture de certains frais
accessoires ou relevant directement de la responsabilité individuelle du
patient.







