b) Le modèle japonais
(1) Un système particulièrement bien adapté aux tsunamis locaux
Avec 2000 tremblements de terre par an susceptibles d'être ressentis par la population (soit près de 5 par jour), le Japon est le pays le plus sismique au monde. Beaucoup de ces séismes se produisent en mer, ce qui explique que le Japon est également le pays au monde le plus touché par des tsunamis. Le tableau suivant dresse une liste des tsunamis historiques les plus destructeurs depuis le début du siècle.
Liste des tsunamis au Japon
depuis le début du XXème siècle
|
Année |
Localisation de l'épicentre |
Profondeur (km) |
Magnitude |
Amplitude maximale du tsunami mesurée par un marégraphe |
Dommages (selon la classification japonaise) (*) |
|
1933 |
Off Sanriku |
0 |
8.1 |
143 |
6 |
|
1944 |
Off Kii peninsula |
40 |
7.9 |
115 |
5 |
|
1946 |
Off Kii peninsula |
24 |
8.0 |
280 |
5 |
|
1952 |
Off Kushiro (Hokkaido) |
54 |
8.2 |
100 |
1 |
|
1960 |
Near coast of northern Pen |
0 |
8.5/9.5 |
305 |
4 |
|
1964 |
Off Nigata pref. |
34 |
7.5 |
140 |
2 |
|
1968 |
Off east of Kyushu |
30 |
7.5 |
116 |
2 |
|
Off Sanriku |
0 |
7.9 |
295 |
2 |
|
|
1969 |
Off east of Hokkaido |
30 |
7.8 |
130 |
2 |
|
1973 |
Off SE of Nemuro (Hokkai) |
40 |
7.4 |
>280 |
2 |
|
1983 |
Off Akita pref. |
14 |
7.7 |
194 |
4 |
|
1993 |
Off SW Hokkaido |
35 |
7.8 |
>175 |
5 |
|
1994 |
Off east of Hokkaido |
28 |
8.2 |
168 |
2 |
|
1996 |
Near Irian Jaya (Indonesia) |
33 |
8.1 |
104 |
1 |
|
2003 |
Off Kushiro (Hokkaido) |
45 |
8.0 |
255 |
3 |
|
2004 |
Off Kii peninsula |
38 |
7.1 |
66 |
1 |
|
Off Kii peninsula |
44 |
7.4 |
101 |
|
(*) |
Classification des dommages (au Japon) |
|
1. |
Dégâts légers observés sur des bateaux et des fermes d'élevage |
|
2. |
Dégâts légers observés sur des maisons et des routes |
|
3. |
Victimes/destructions de maisons (moins que la classe 4) |
|
4. |
Victimes (moins de 20) ou destructions de maisons (moins de 1 000) |
|
5. |
Plus de 200 victimes ou plus de 10 000 destructions de maisons |
|
6. |
Plus de 2 000 victimes ou plus de 100 000 destructions de maisons |
|
7. |
Plus de 20 000 victimes ou plus de 1 000 000 destructions de maisons |
Source : Japan Meteorological Agency
En outre, si le Japon est concerné par les télétsunamis transpacifiques, il doit surtout affronter des tsunamis locaux souvent dévastateurs. Aussi, ce pays a mis en place un système capable d'alerter la population en quelques minutes.
L'agence météorologique japonaise (JMA), sous la tutelle du ministère des infrastructures et des transports, constitue le centre d'alerte multirisque au niveau national. C'est elle qui collecte les données sur les phénomènes naturels et déclenche l'alerte auprès des autorités et de la population en cas de nécessité.
Dans la mesure où les tsunamis locaux ne laissent que peu de temps pour réagir, le dispositif d'alerte japonais privilégie l'émission rapide d'un message d'alerte, quitte à ce que celui-ci s'avère infondé. Dans les trois minutes suivant la détection d'un séisme, la JMA émet un message sur l'heure prévisible d'arrivée du tsunami, les côtes concernées et la hauteur de vague estimée.
Les messages de prévision des tsunamis locaux sont de deux types : les messages d'alerte (la hauteur de la vague doit être supérieure à un mètre) et les messages d'information lorsque la hauteur de la vague est inférieure ou égale à 50 centimètres.
Les messages d'alerte sont eux-mêmes divisés en deux catégories : les messages en cas de tsunami pouvant atteindre deux mètres de haut et les messages pour les tsunamis majeurs de trois mètres et plus.
Prévision de tsunami et information
|
Prévision de Tsunami |
Réalisée dans les 3-5 minutes après le tremblement de terre Répartie selon la hauteur du tsunami
|
|||||||||||
|
Information sur l'heure d'arrivée prévisionnelle et la hauteur du tsunami pour chaque région côtière |
||||||||||||
|
Information sur l'heure d'arrivée de la marée haute et du tsunami sur les côtes |
||||||||||||
|
Information sur l'heure réelle d'arrivée du tsunami et sur sa hauteur |
||||||||||||
Source : Japan Meteorological Agency
Par ailleurs, la JMA a divisé les côtes japonaises en 66 régions qui sont récipiendaires des messages d'alerte et d'information lorsqu'elles sont concernées.
Répartition des côtes japonaises en 66 régions
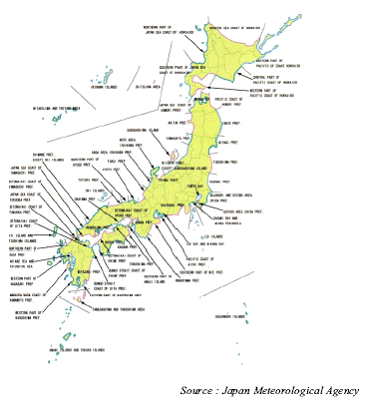
La JMA dispose d'un réseau très dense de stations sismiques (182) et de marégraphes (80) dont les données sont complétées par celles en provenance des instruments de mesure des gouvernements locaux, du NIED 20 ( * ) ou encore des garde côtes. Ces informations sont transmises par voie satellitaire en temps réel à la JMA où elles sont traitées par ordinateur afin de déterminer au plus vite l'hypocentre et la magnitude du séisme et d'évaluer si un tsunami a été déclenché.
Pour autant, le délai extrêmement bref imposé à la JMA pour émettre un éventuel message d'alerte (3 minutes) ne permet pas de vérifier si le séisme détecté a véritablement provoqué un tsunami (le réseau de stations de mesure du niveau de la mer n'est pas suffisamment dense pour enregistrer un tsunami dans les 3 minutes). En réalité, la JMA utilise des simulations de tsunami déjà réalisées à partir de 100.000 tremblements de terre tsunamigènes potentiels et utilisent le scénario dans lequel les caractéristiques du séisme simulé sont les plus proches de celles du séisme détecté. Parallèlement, une fois les informations sur le tremblement de terre observé connues, une simulation est lancée pour affiner les informations données sur le tsunami potentiel.
Les messages d'alerte font l'objet d'une diffusion très large.
D'une part, ils sont envoyés aux gouvernements locaux et aux agences chargées de la gestion des désastres.
D'autre part, la JMA a passé un accord de coopération avec la télévision publique NHK pour la dissémination des messages d'alerte. NHK gère 10 chaînes de télévision et 3 radios qui sont mobilisées en cas de risque de tsunami. Lorsqu'une alerte est déclenchée, les émissions sont interrompues et un message est diffusé, accompagné d'une carte du Japon avec les zones côtières à risque coloriées en jaune, orange ou rouge selon l'amplitude du tsunami prévu.
Lors du tremblement de terre de Kobbé le 17 janvier 1995, de graves dysfonctionnements avaient été constatés, notamment en raison du manque de diffusion des informations sur le séisme. C'est pourquoi le dispositif d'alerte aux tsunamis privilégie désormais la multiplication des canaux d'information et des récipiendaires capables de prendre des décisions. Ainsi, dans la préfecture de Wakayama, au moins trois organismes différents reçoivent les messages de la JMA et sont susceptibles de déclencher les sirènes pour avertir la population du danger.
* 20 National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (Institut national de recherche pour les sciences de la terre et la prévention des catastrophes).







