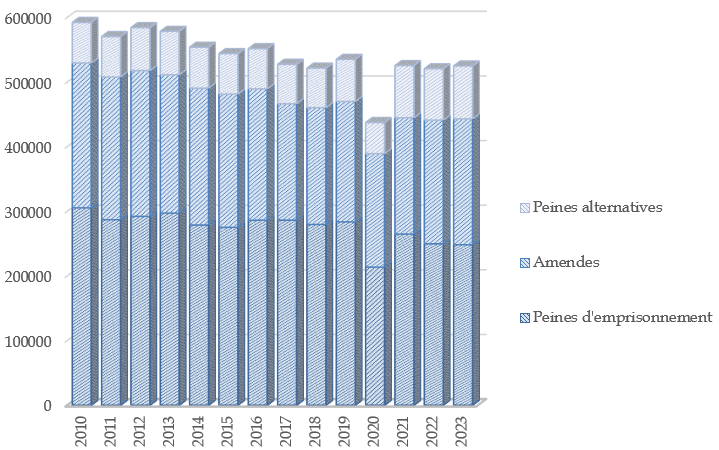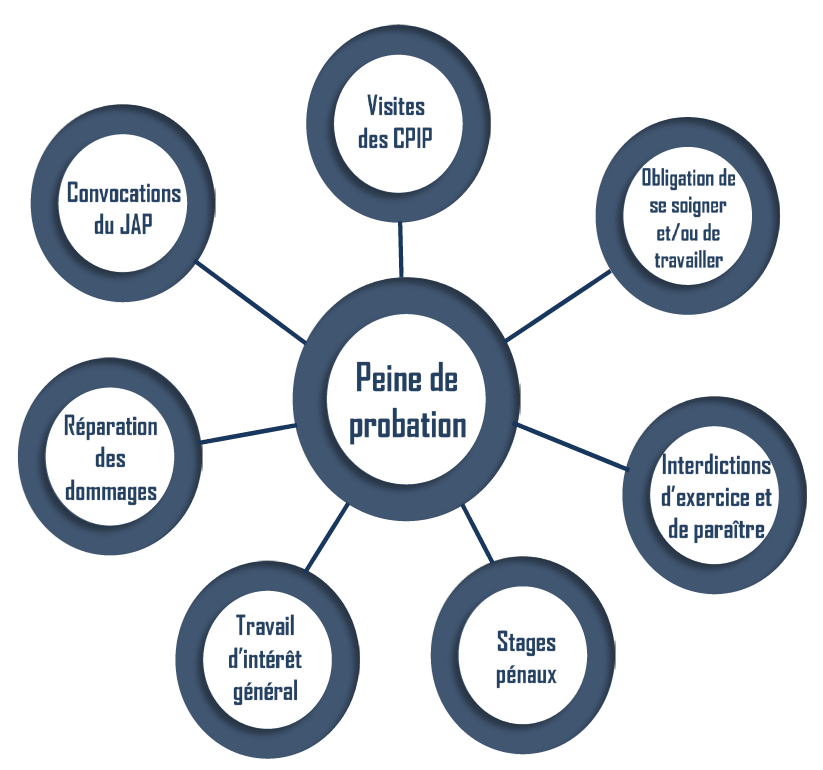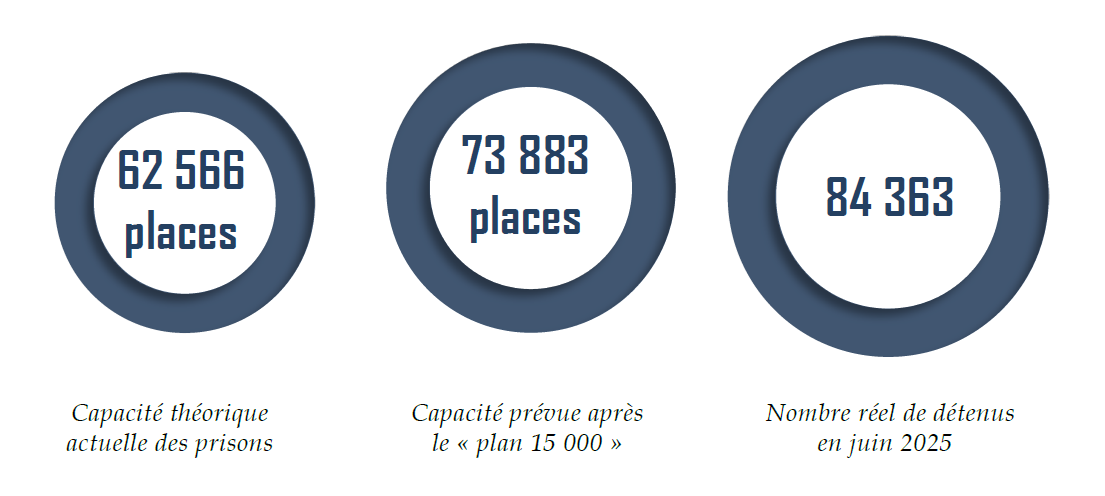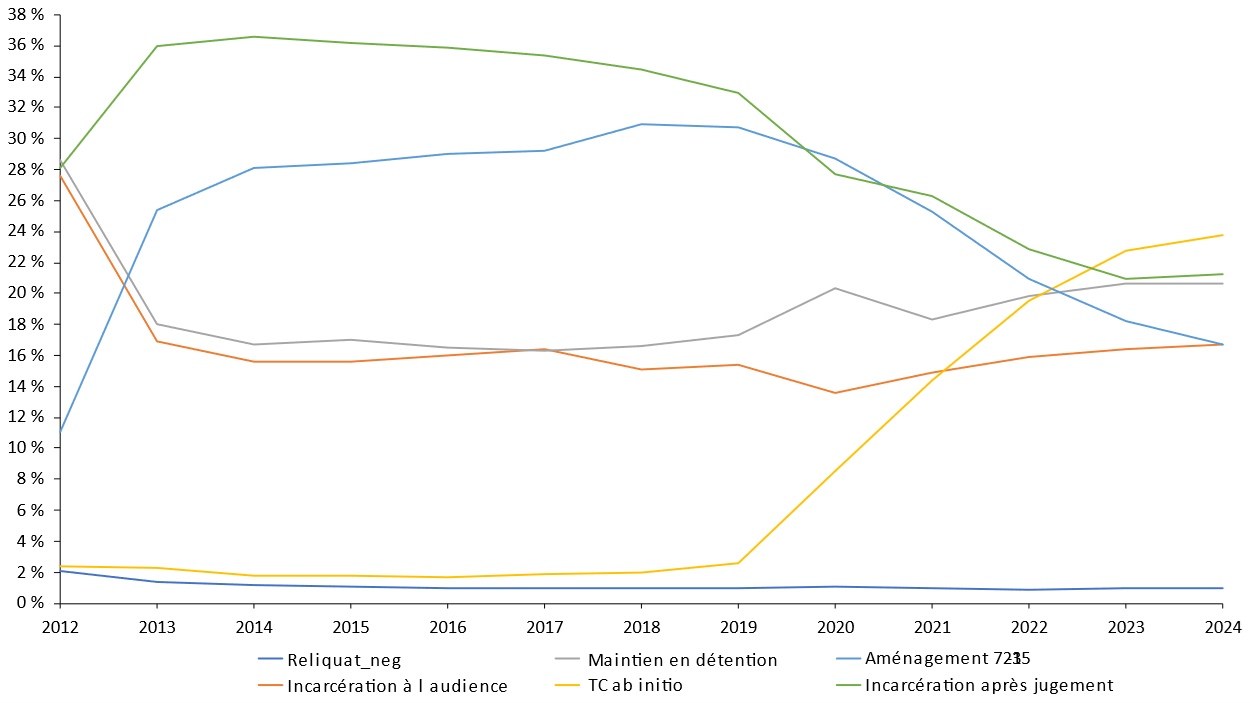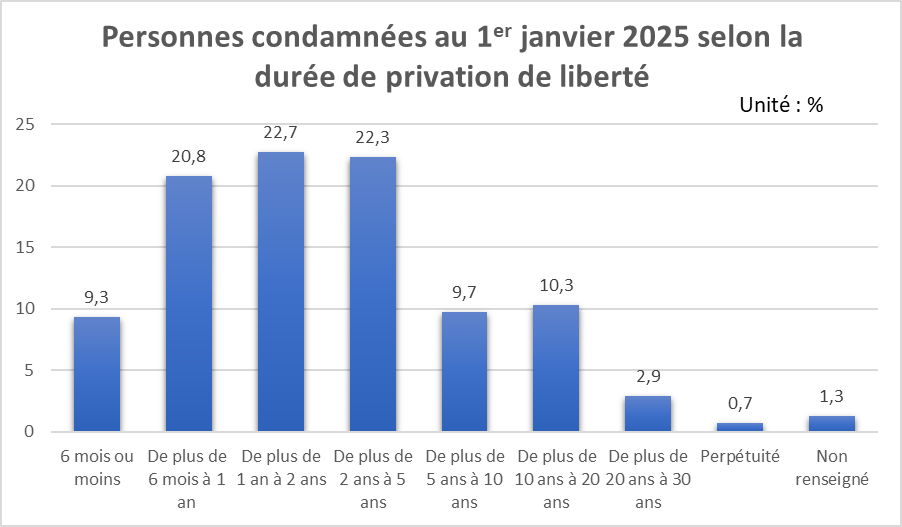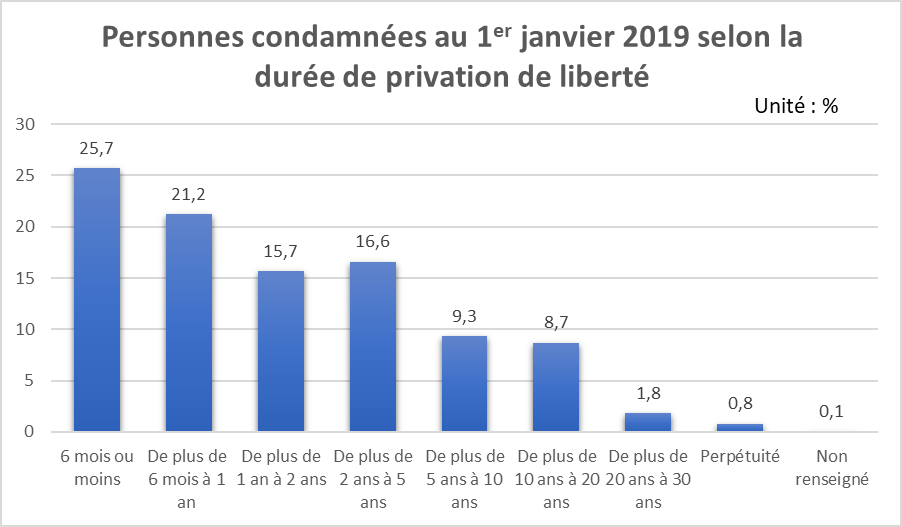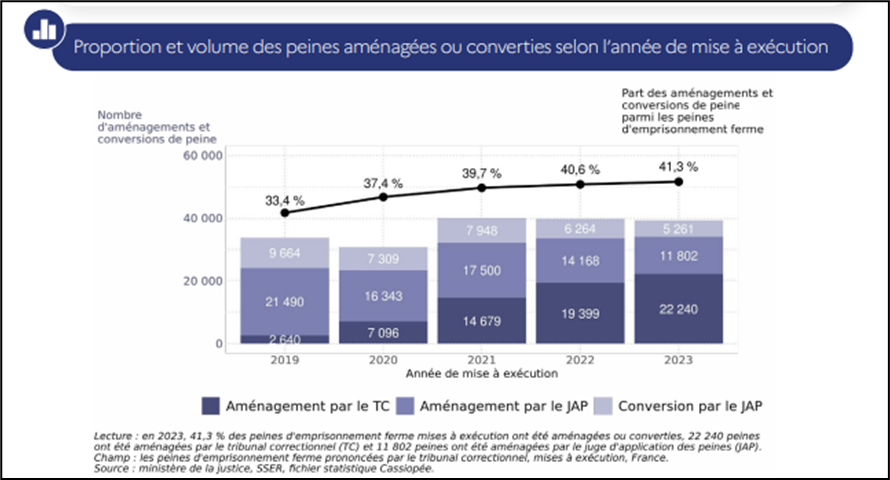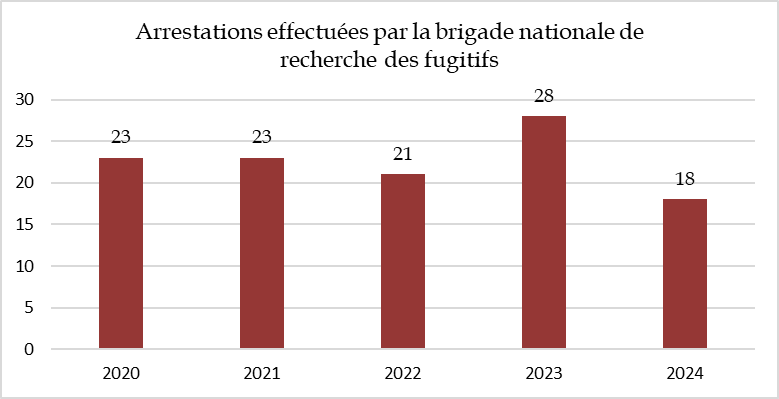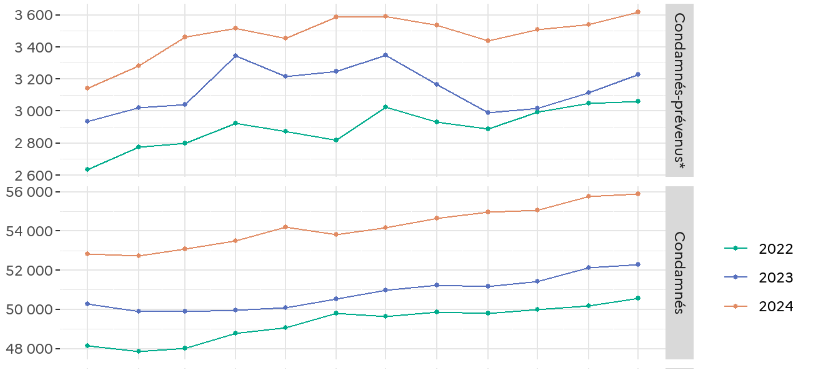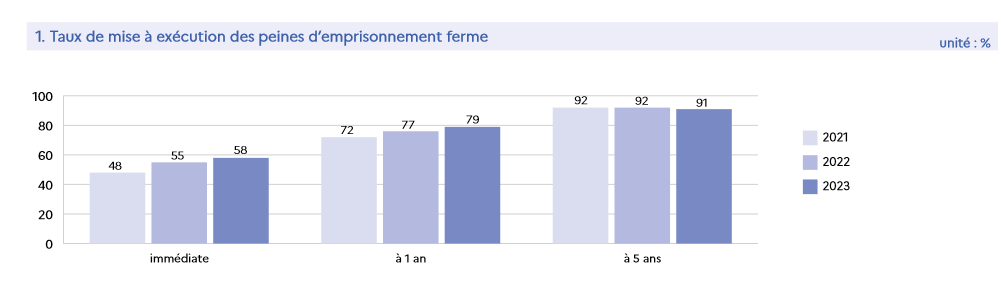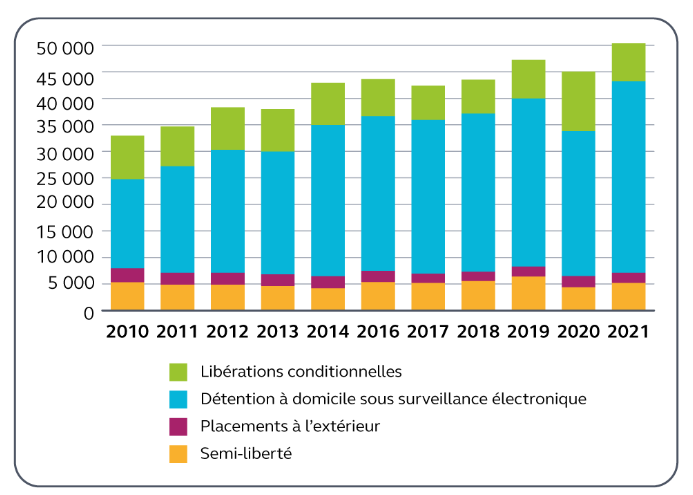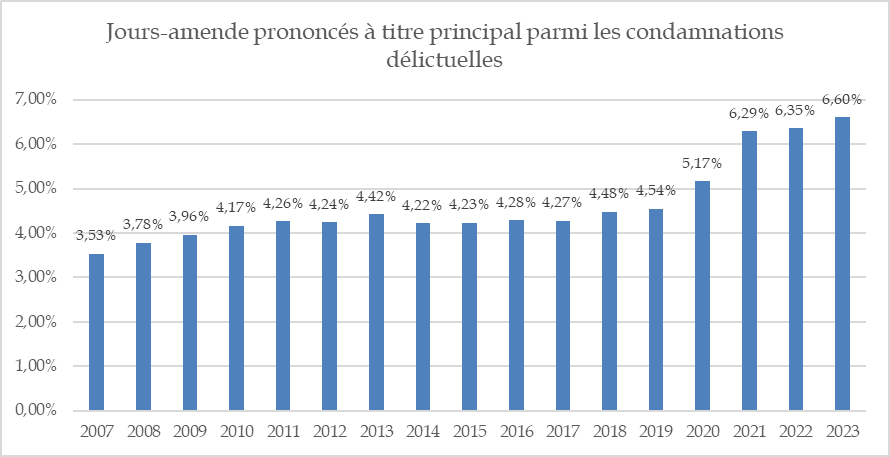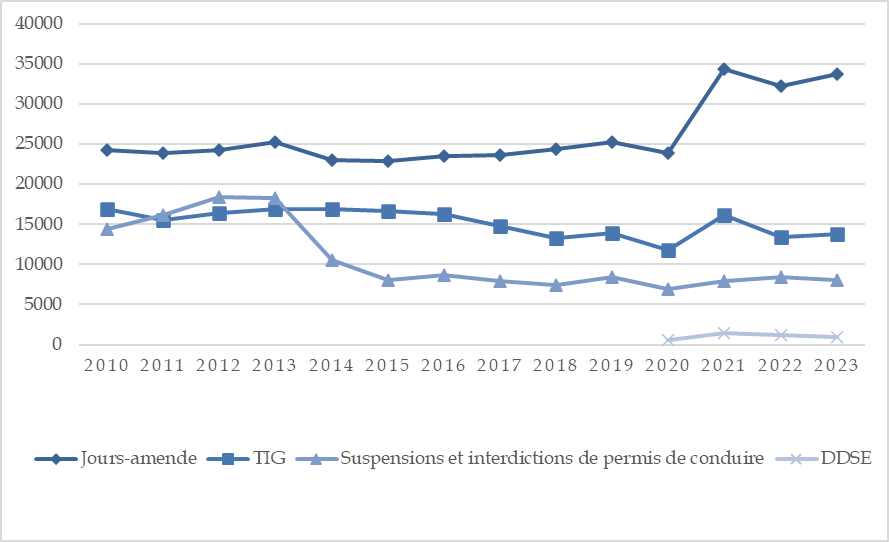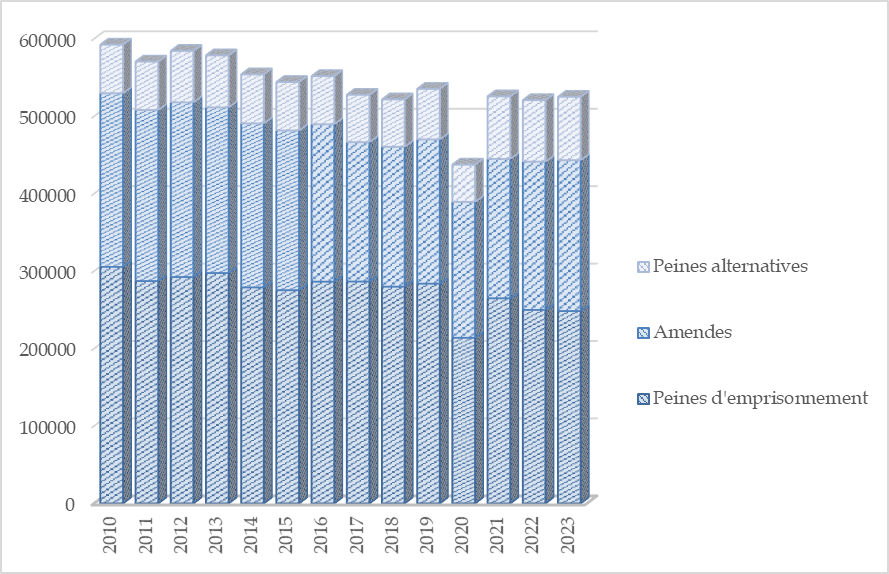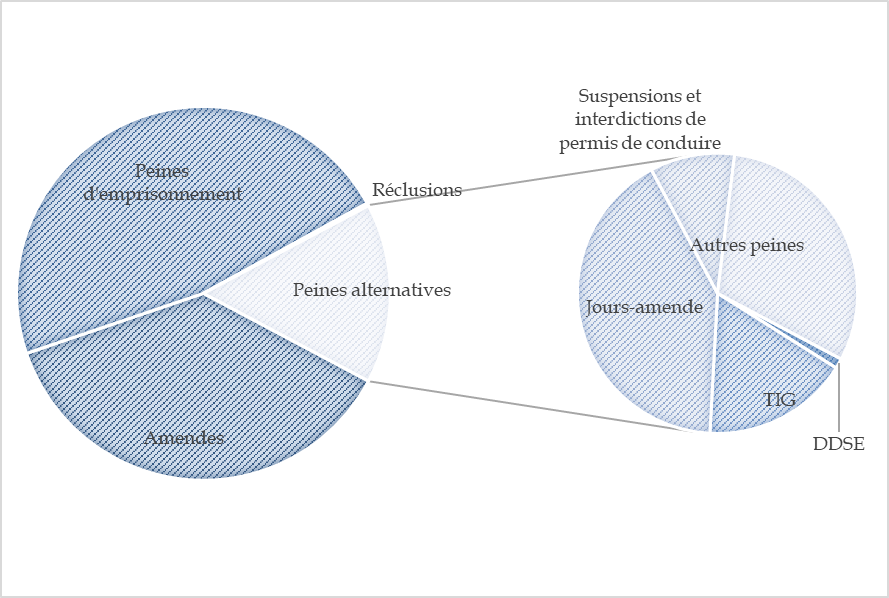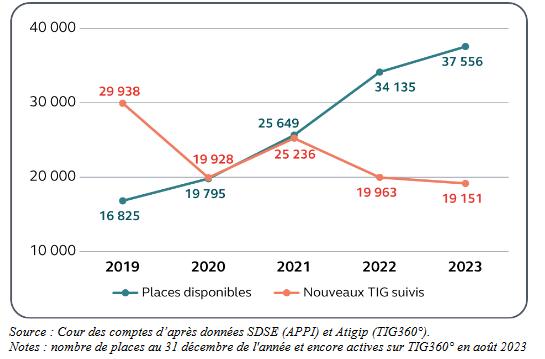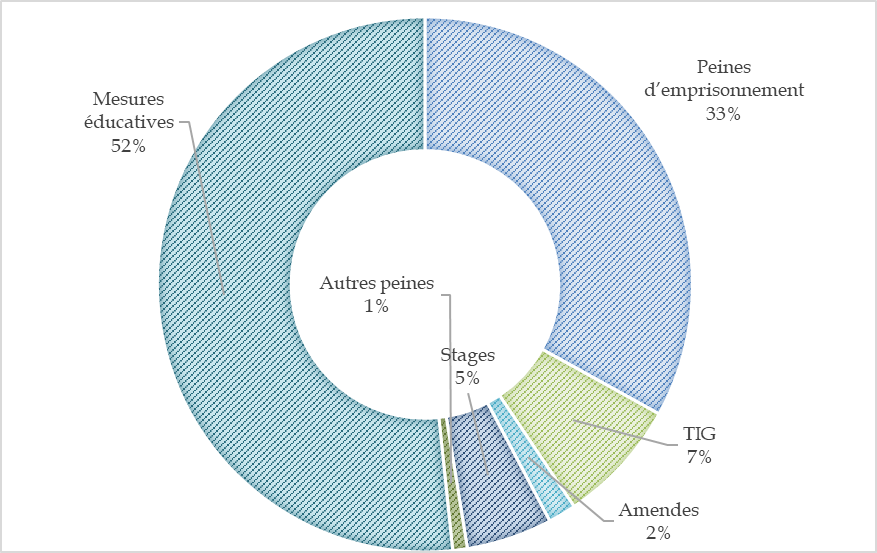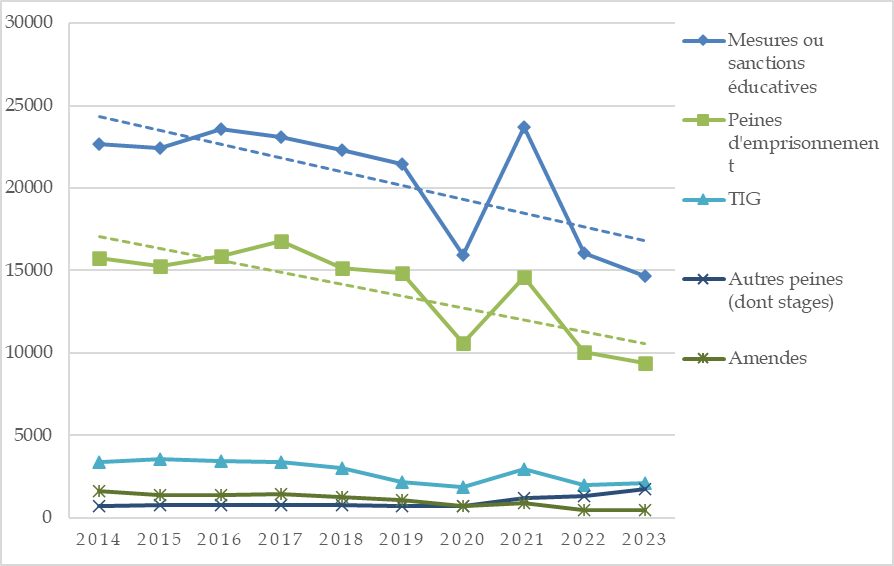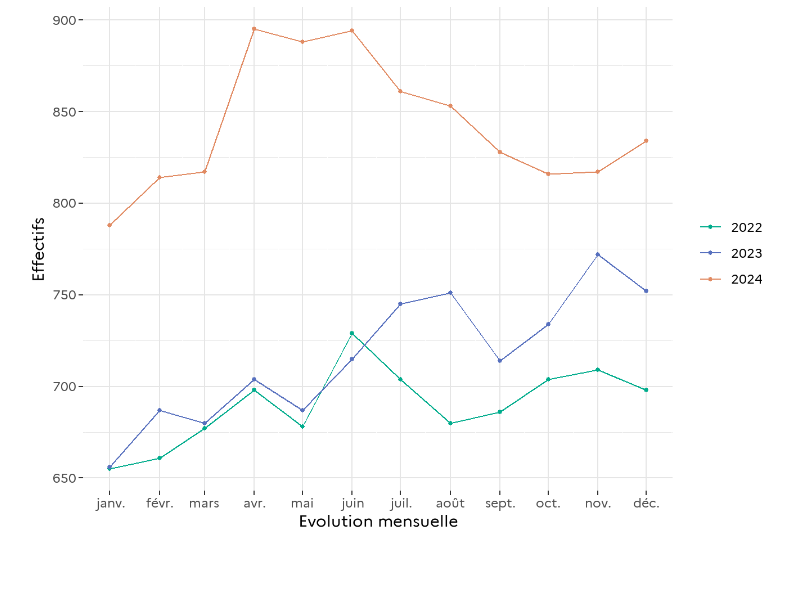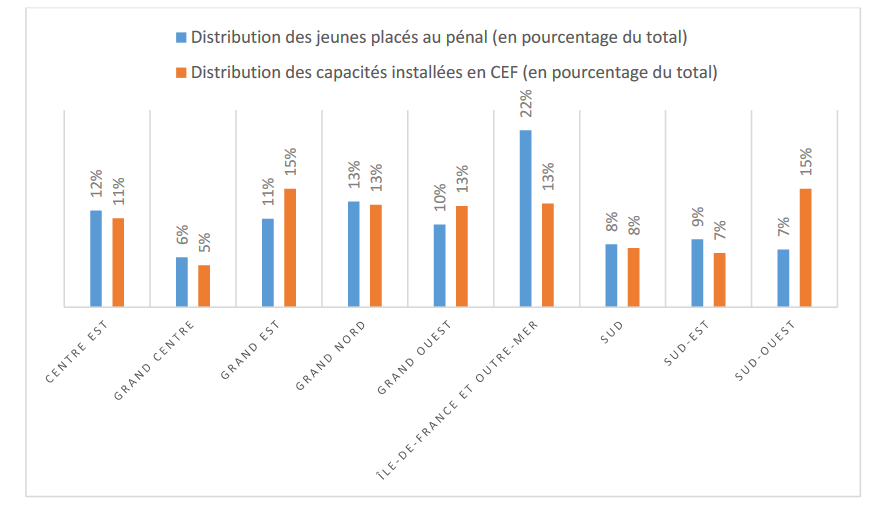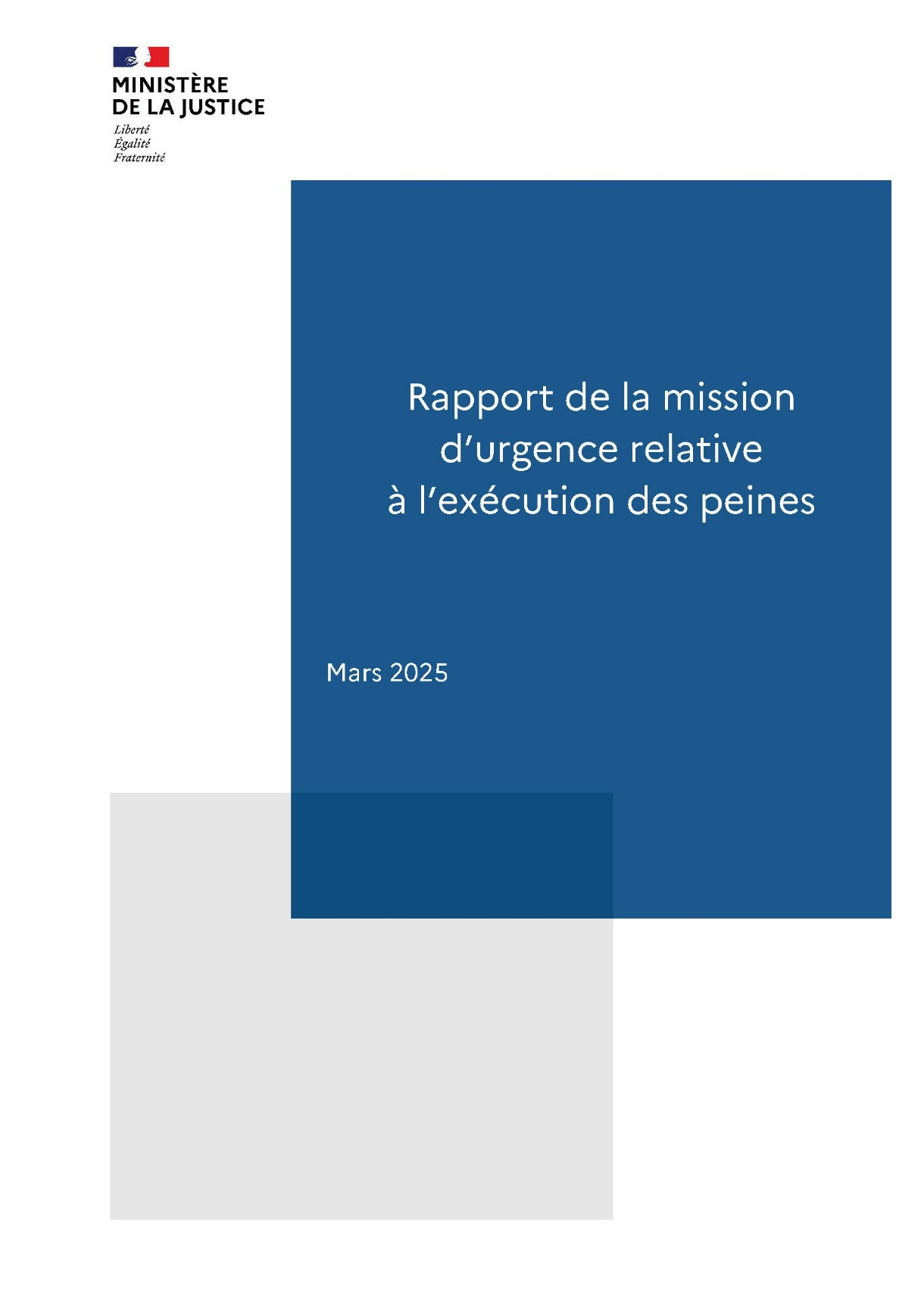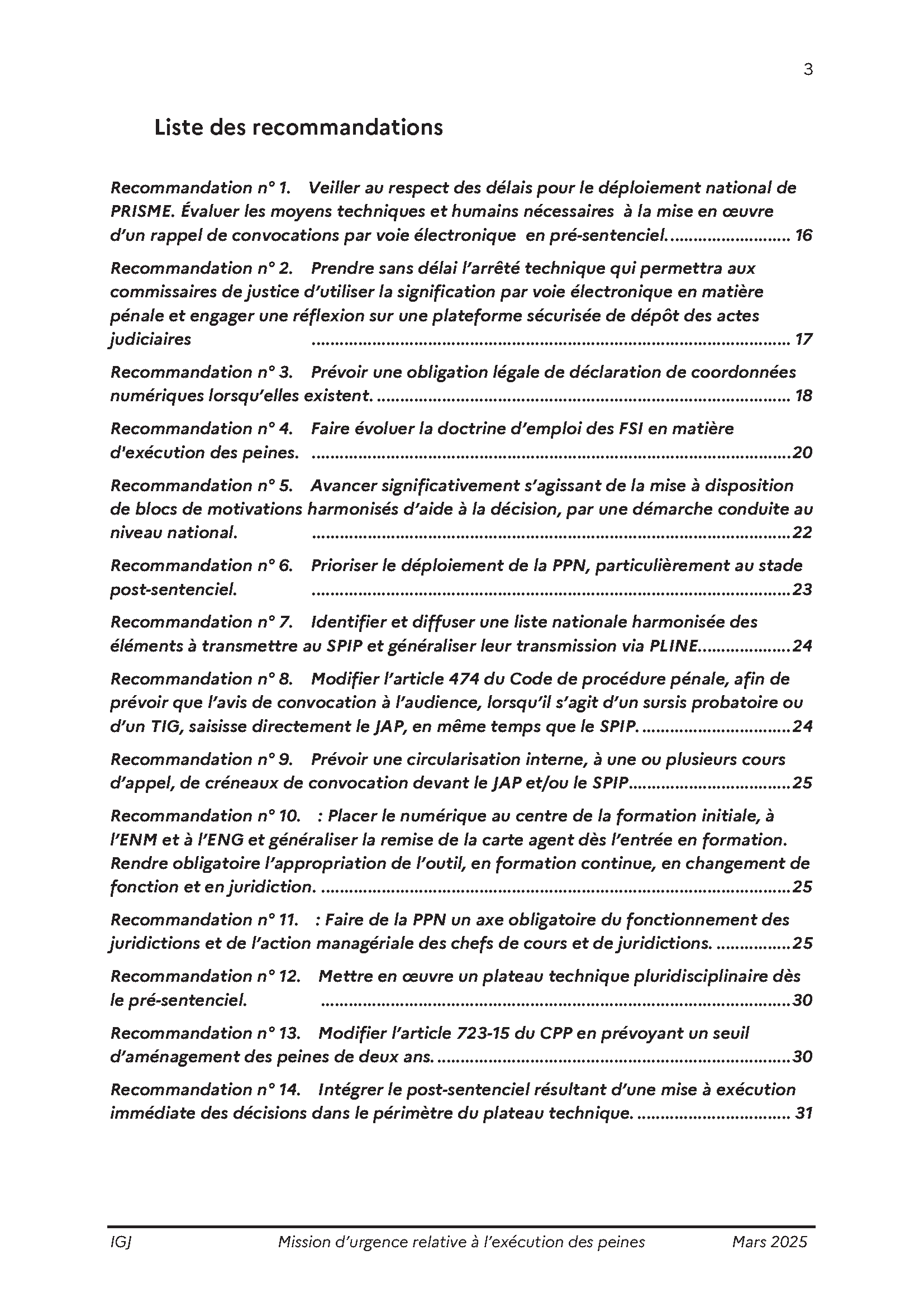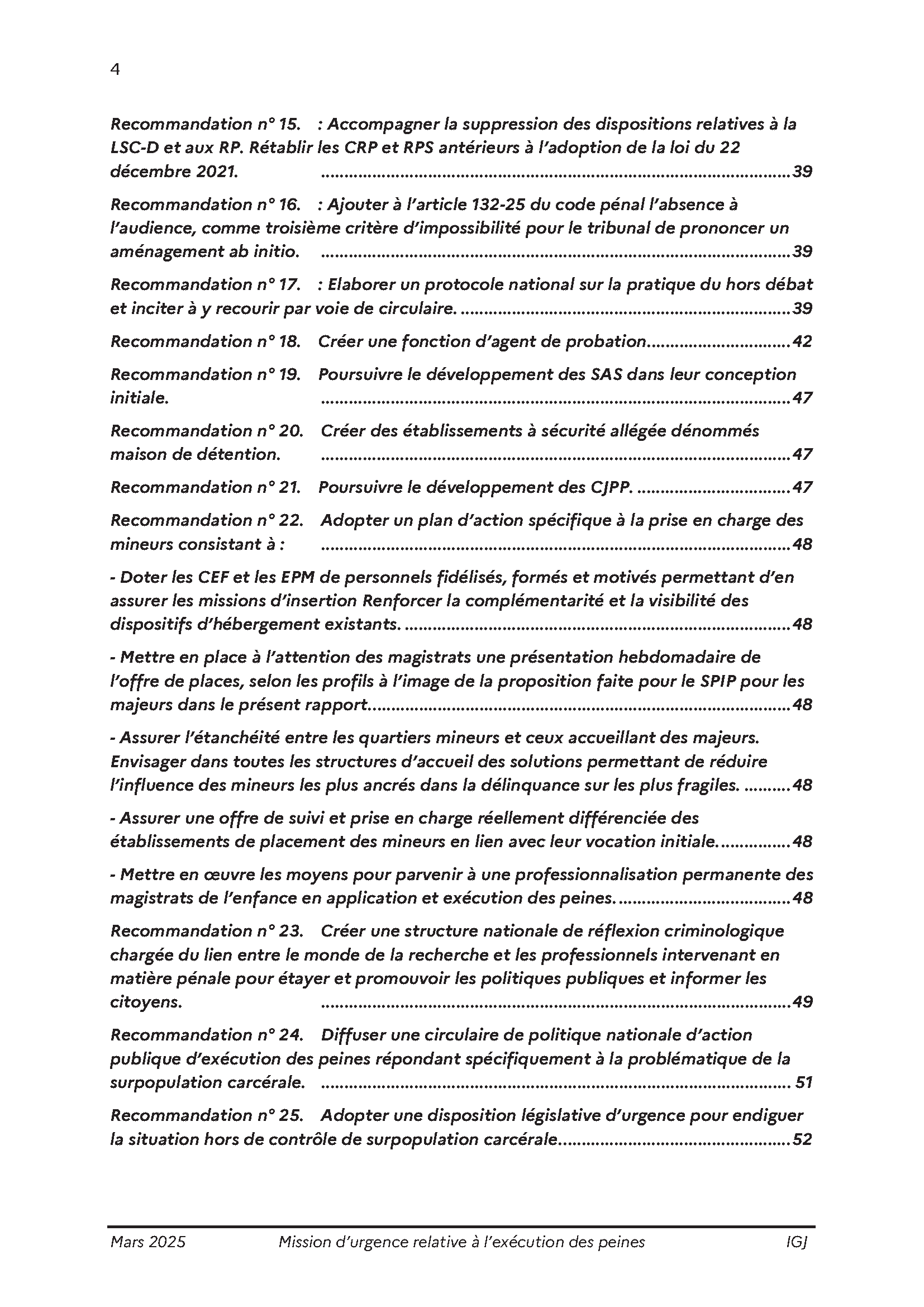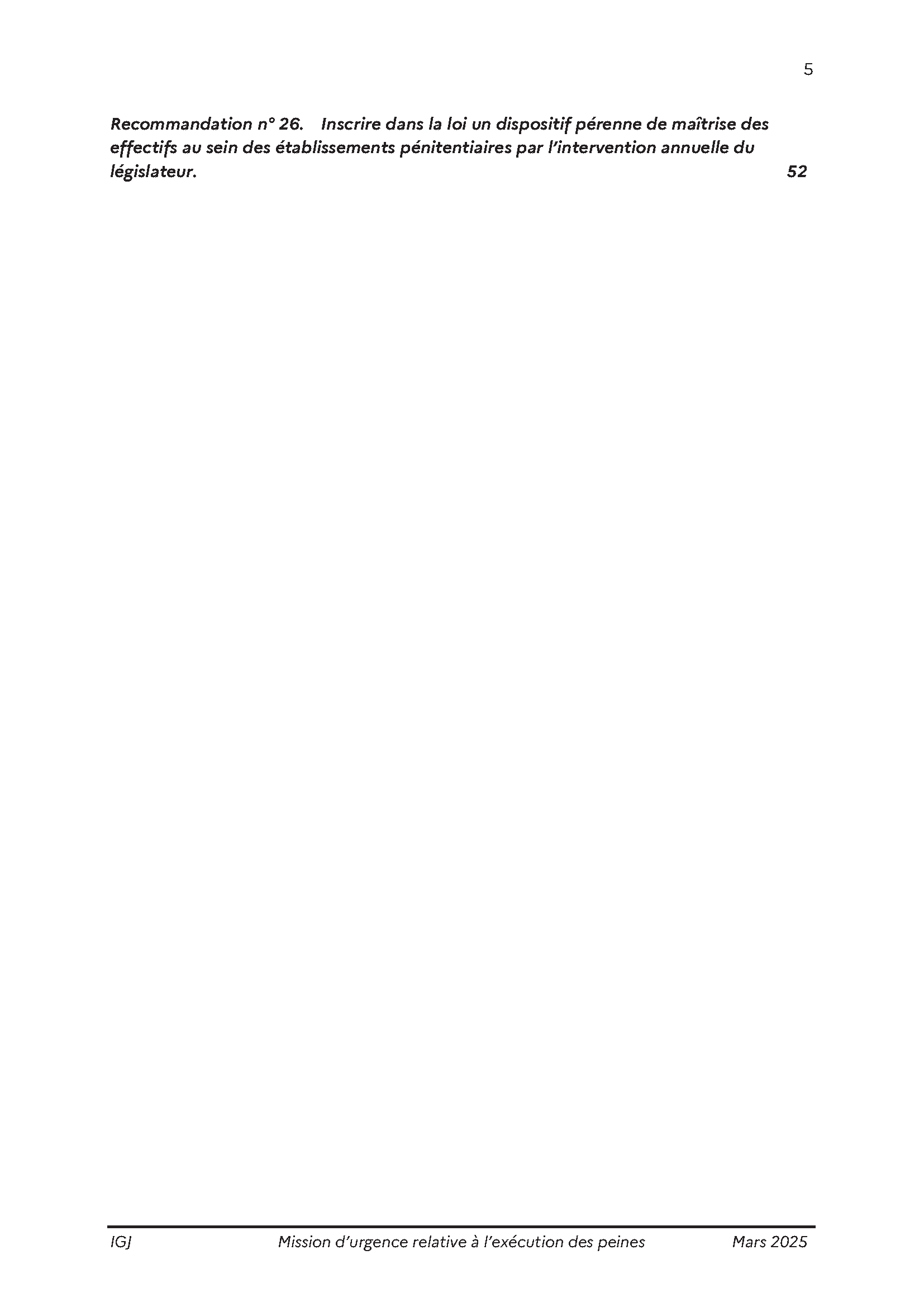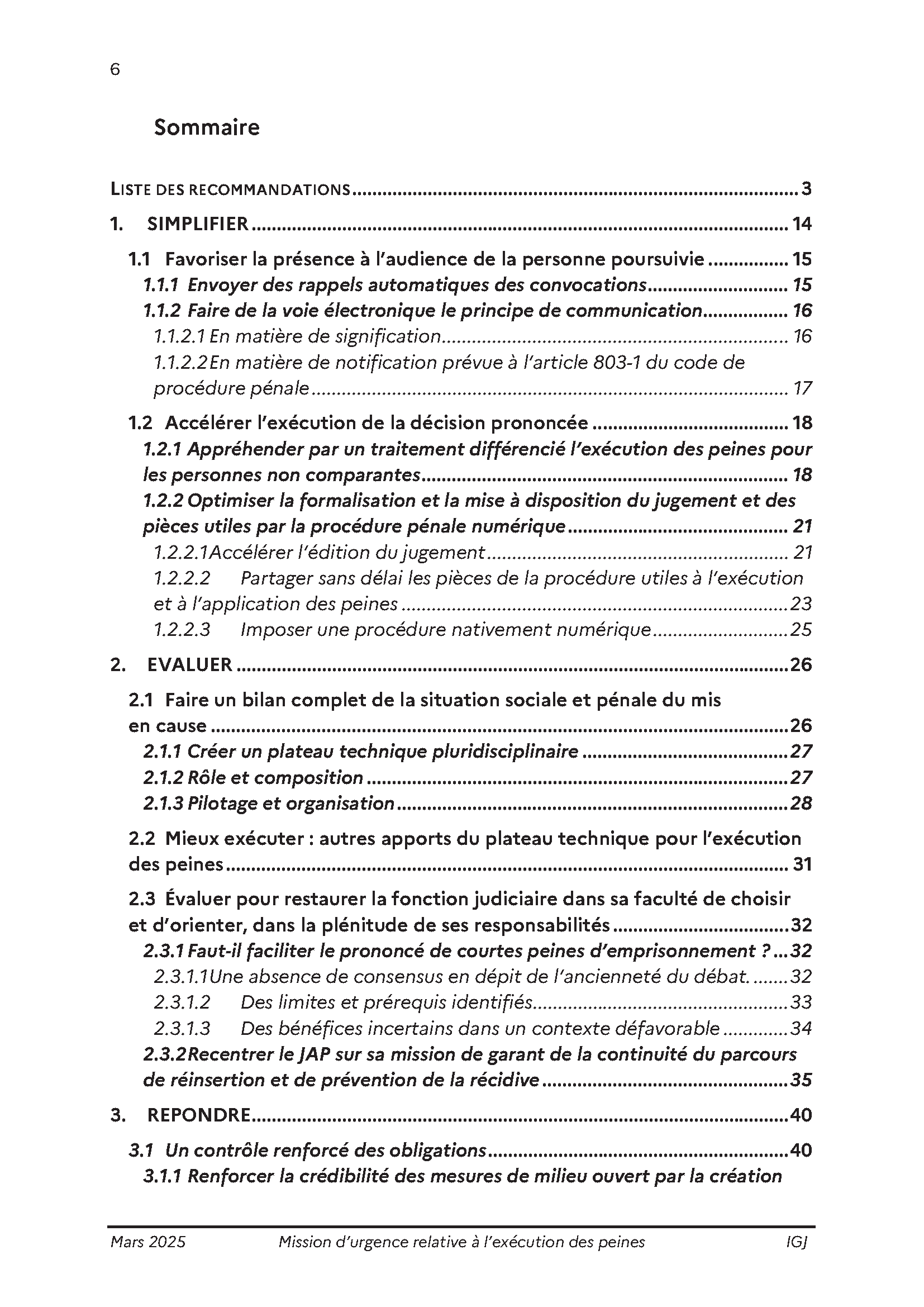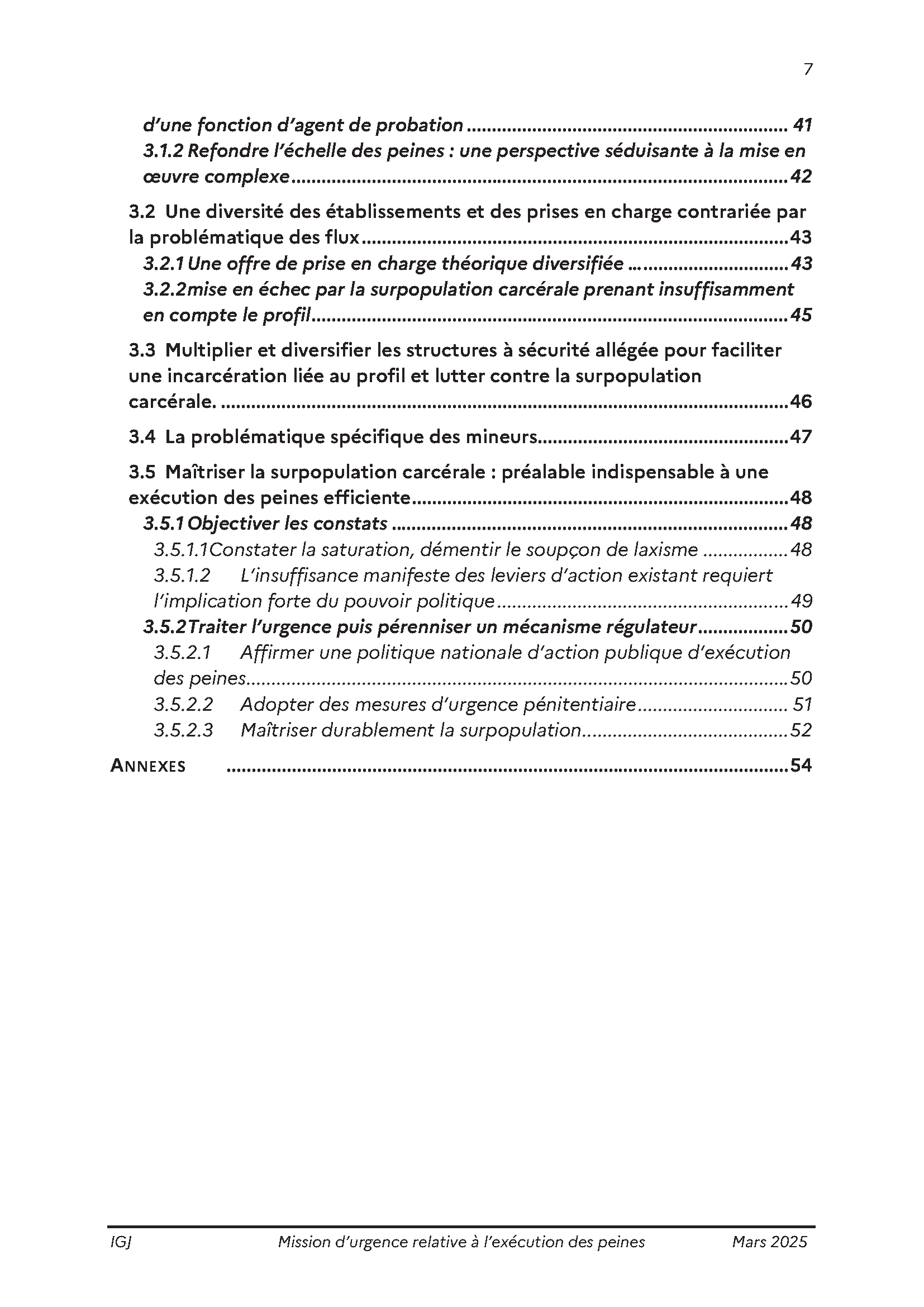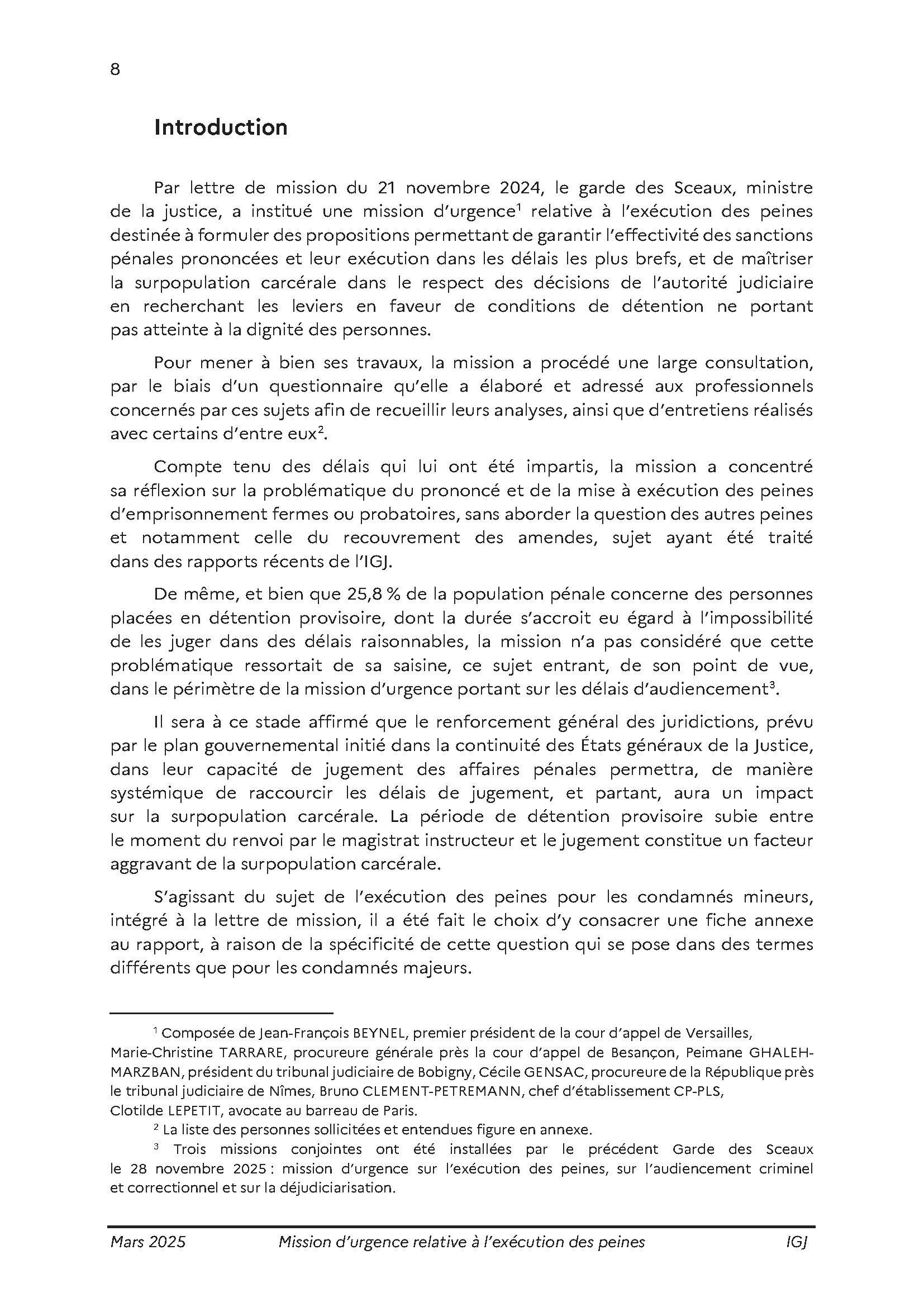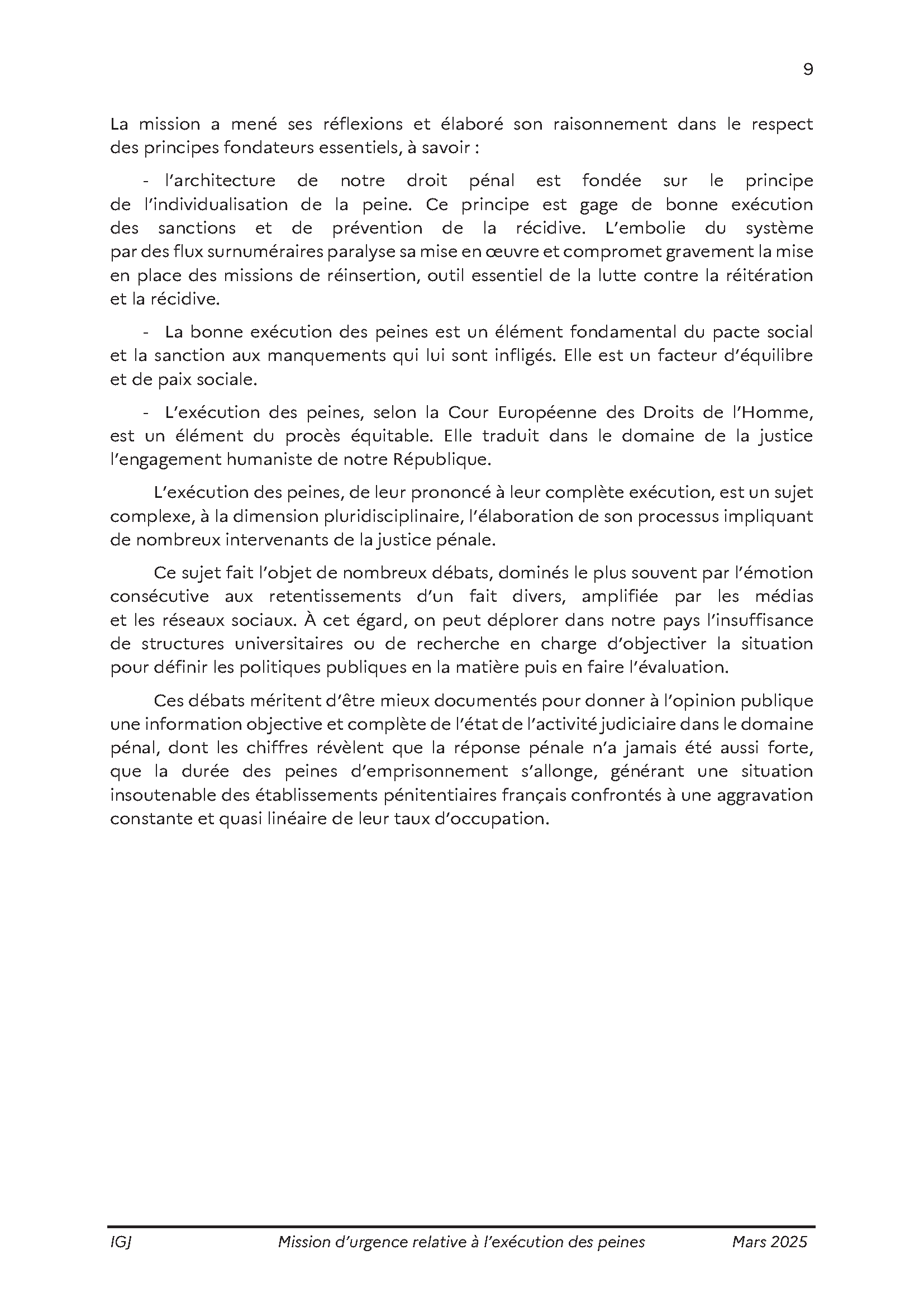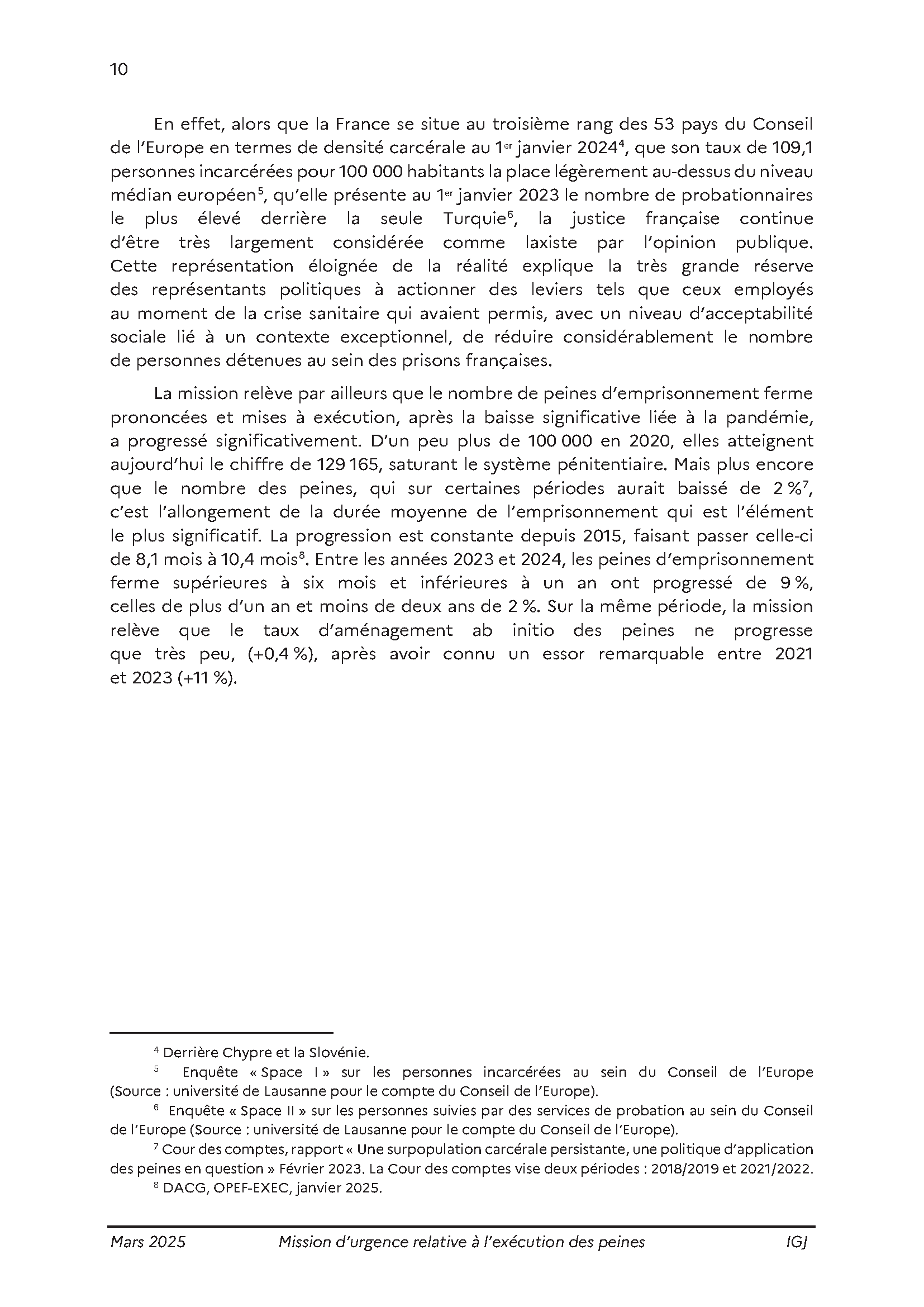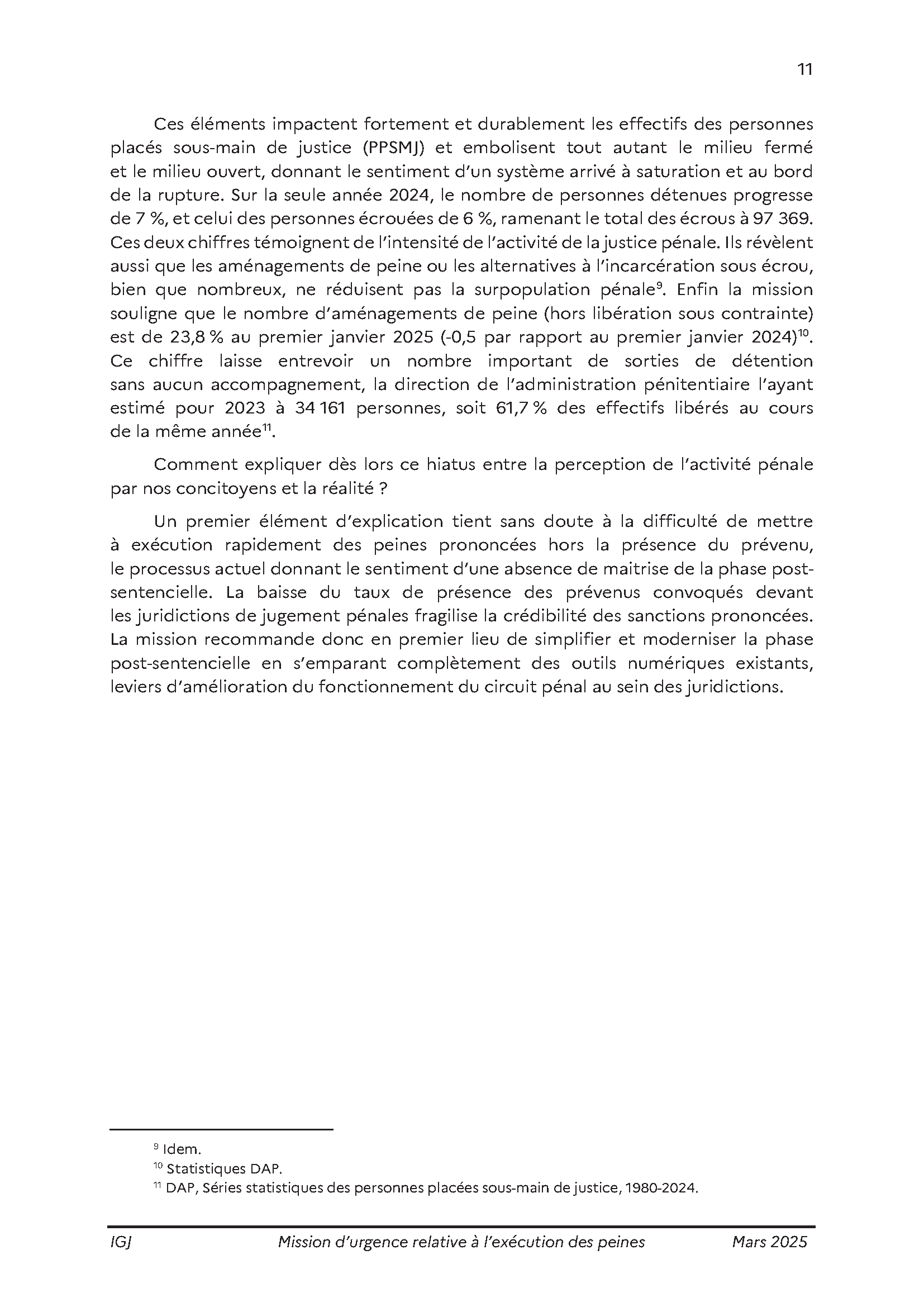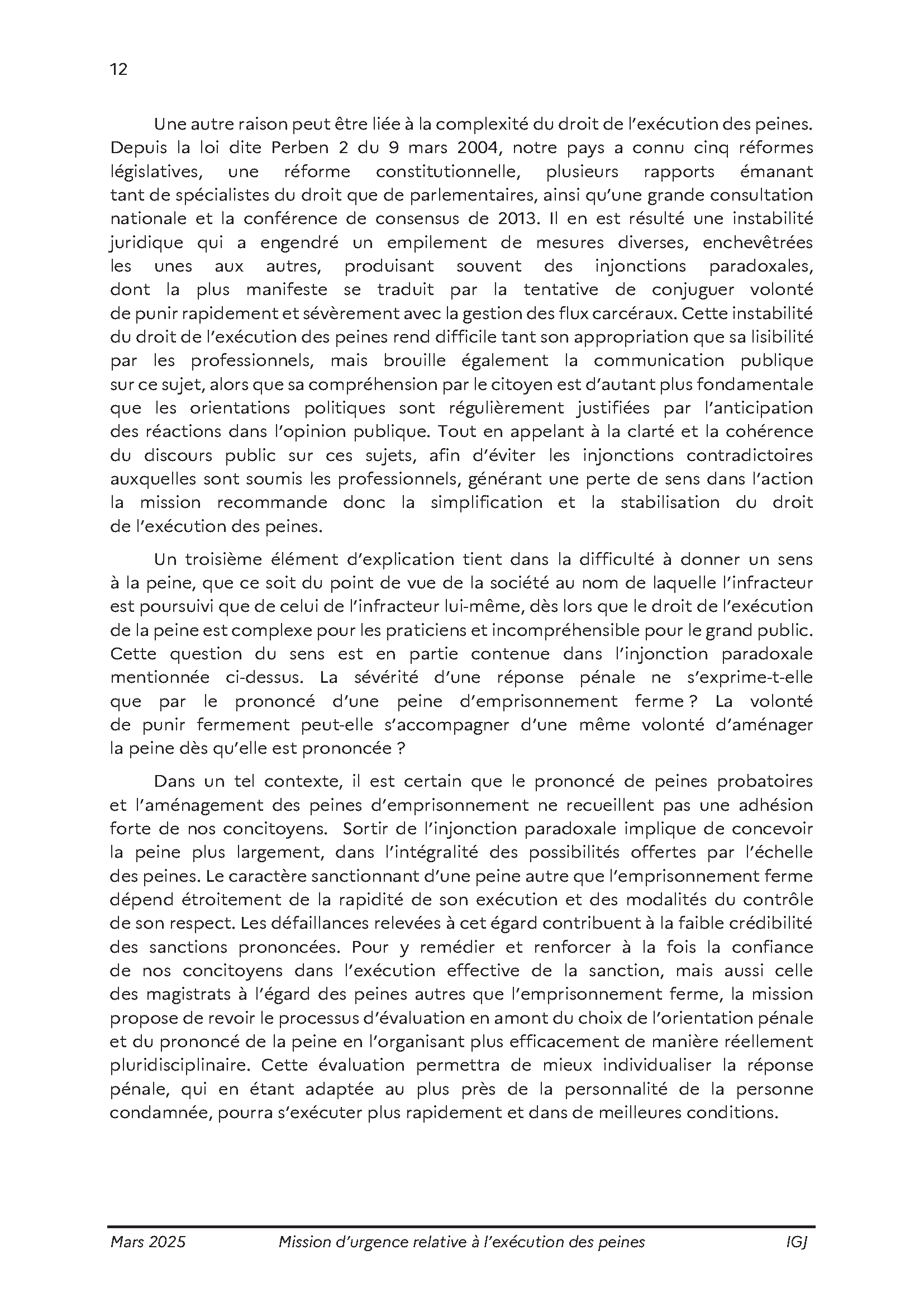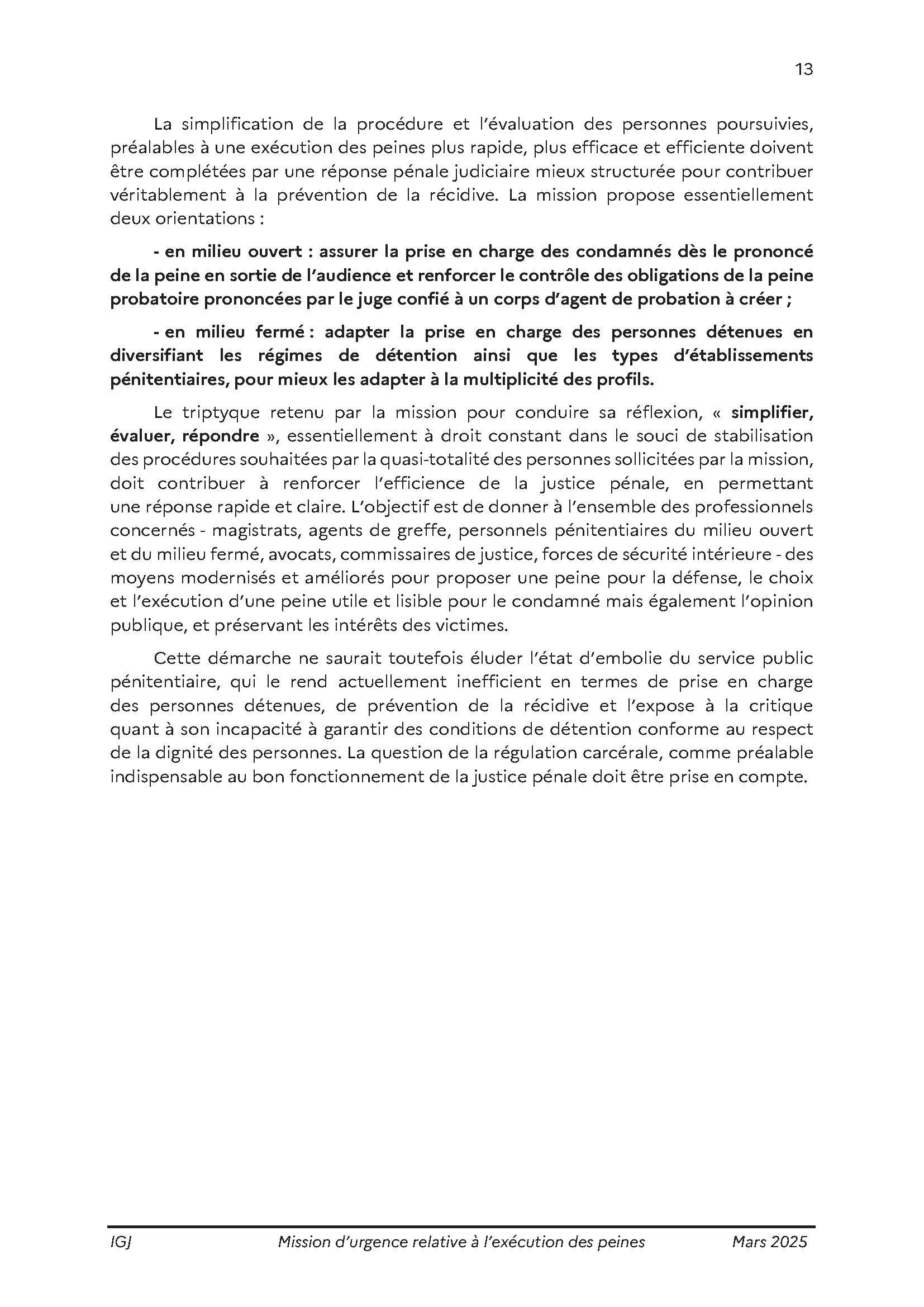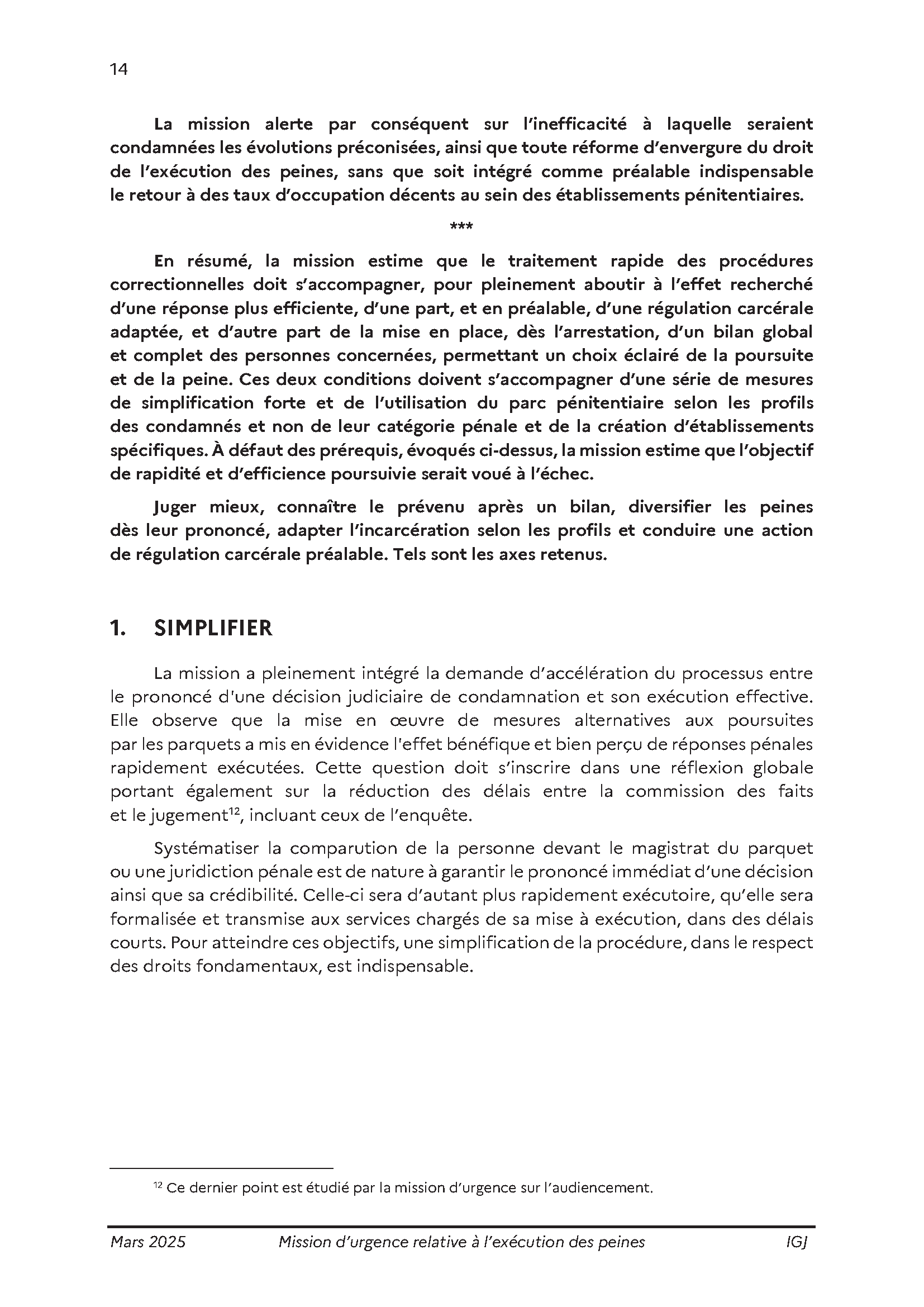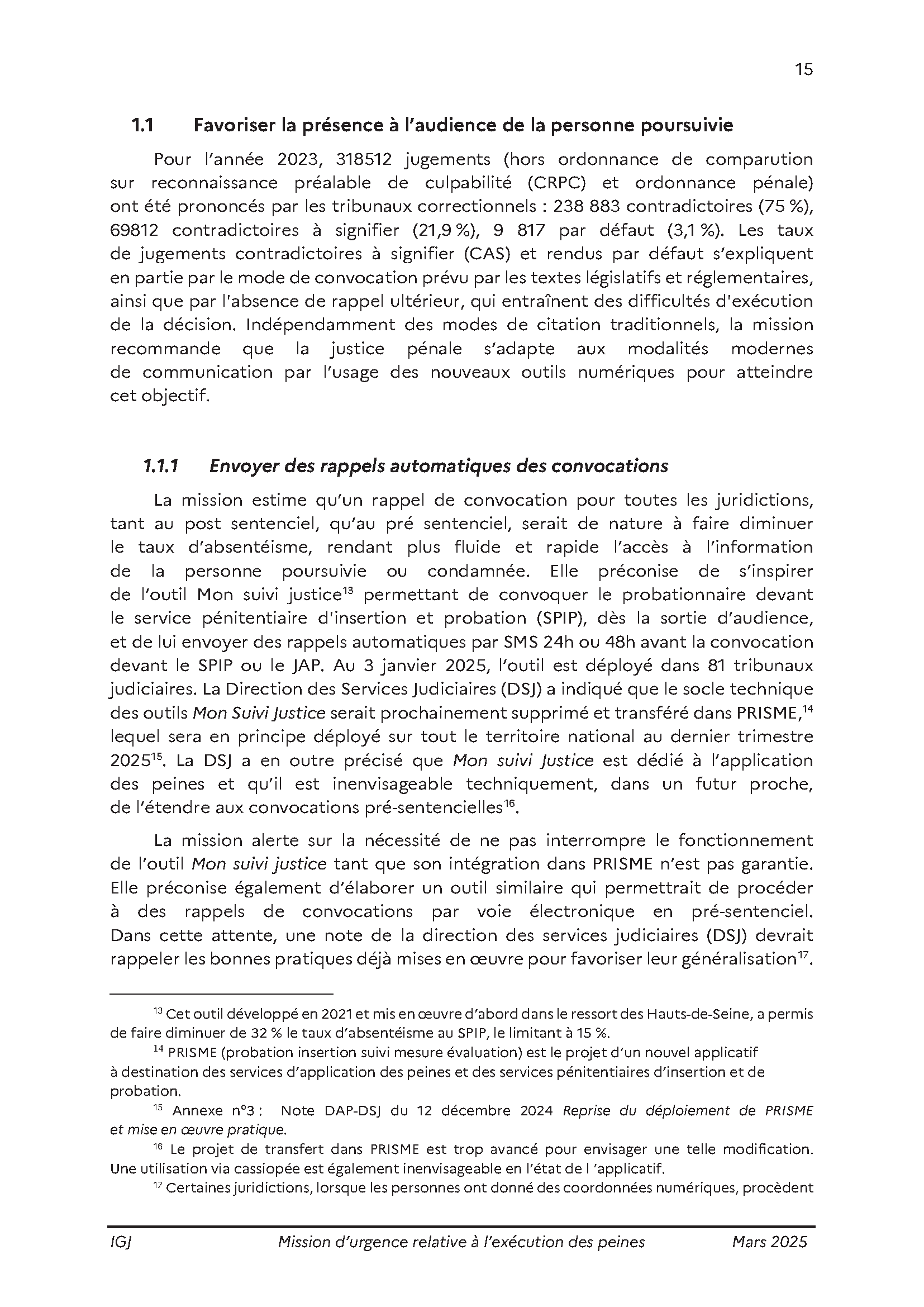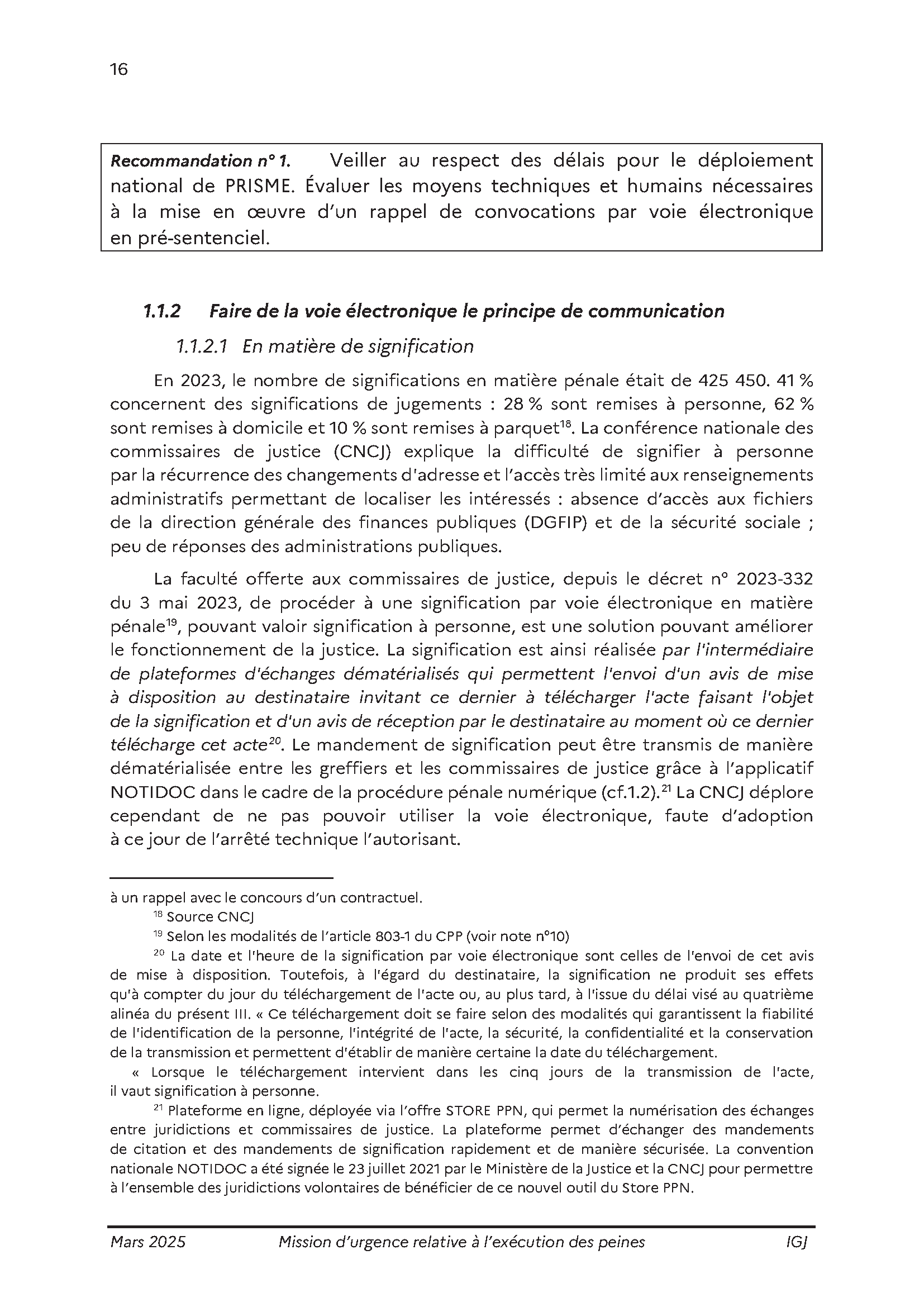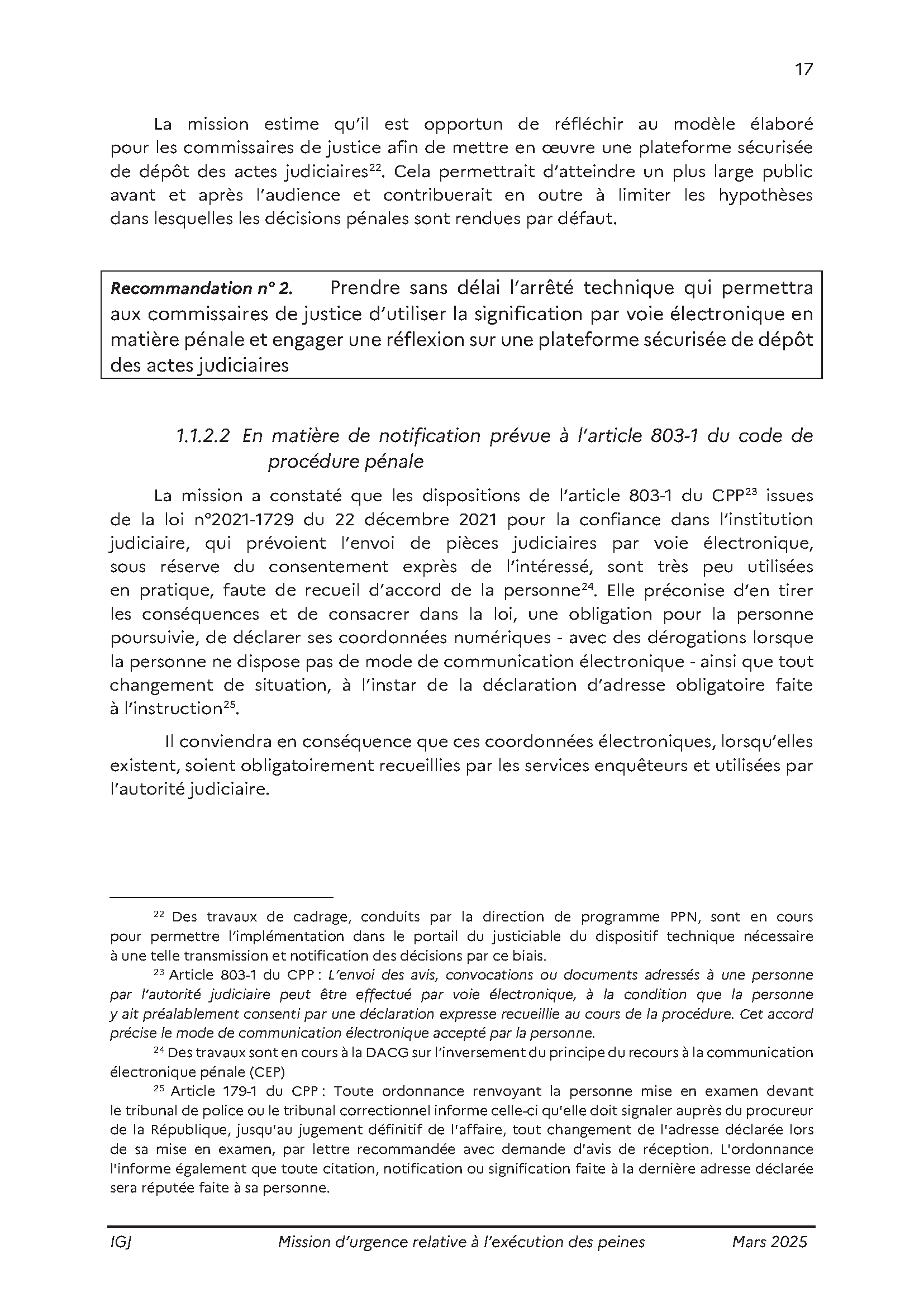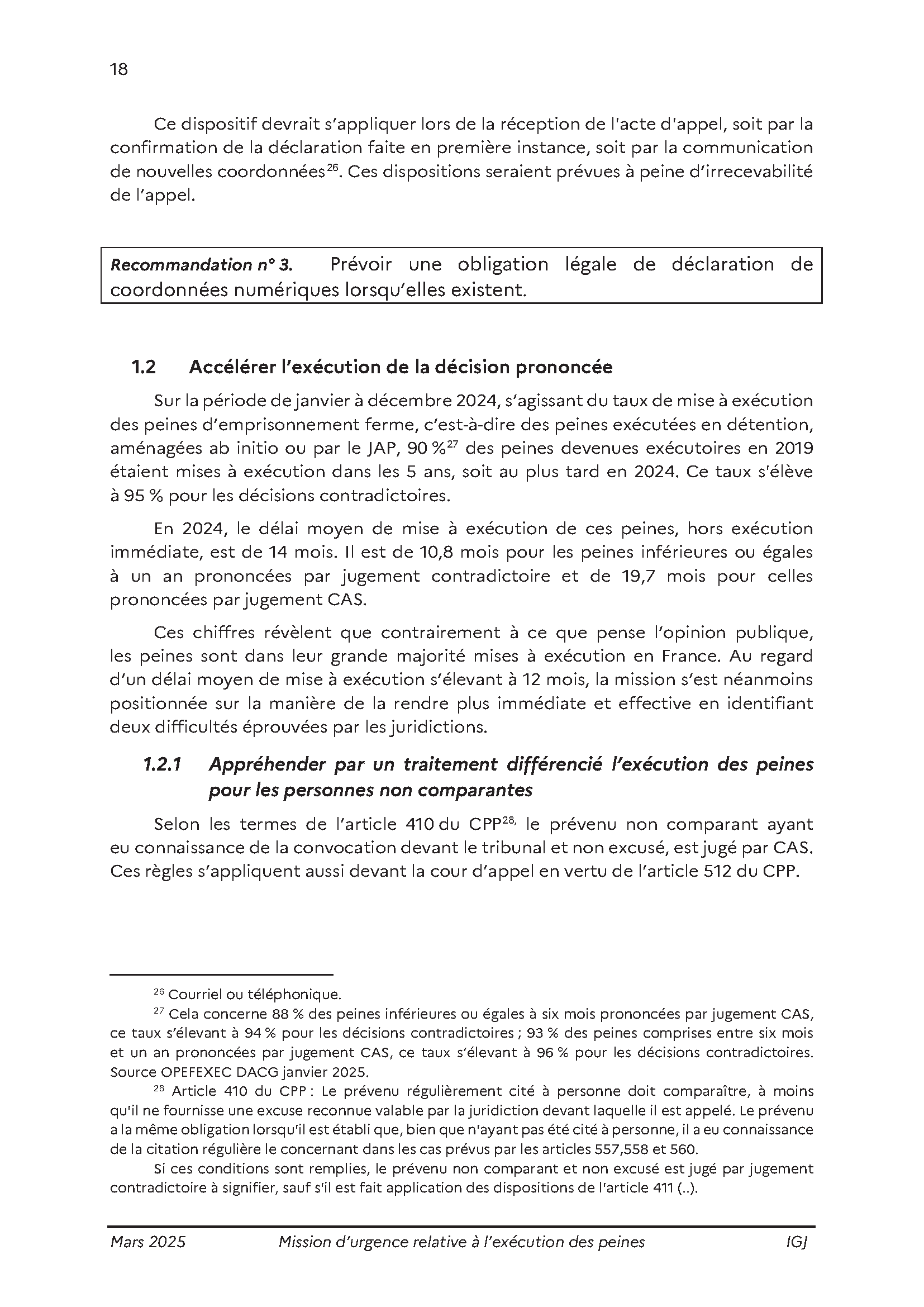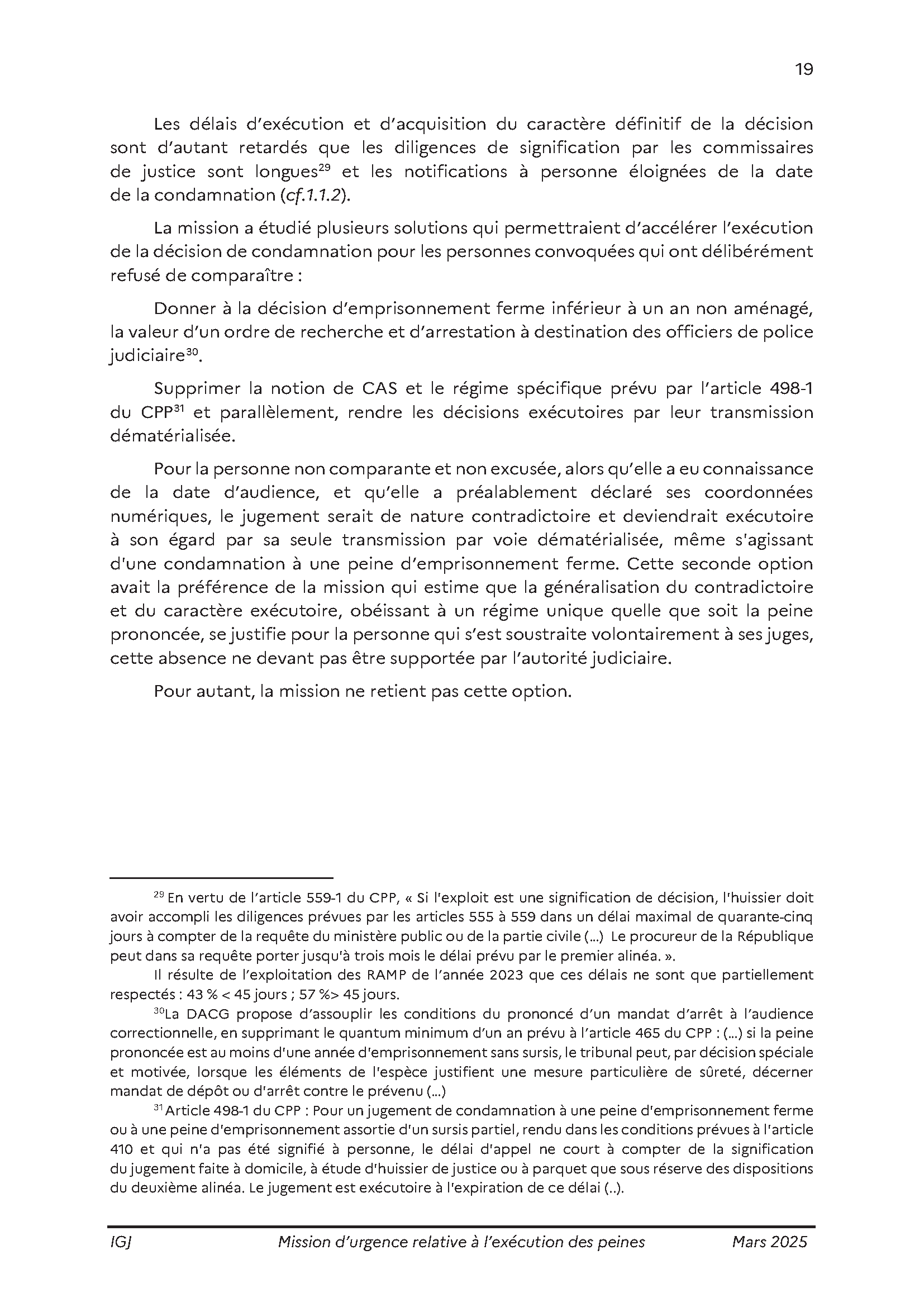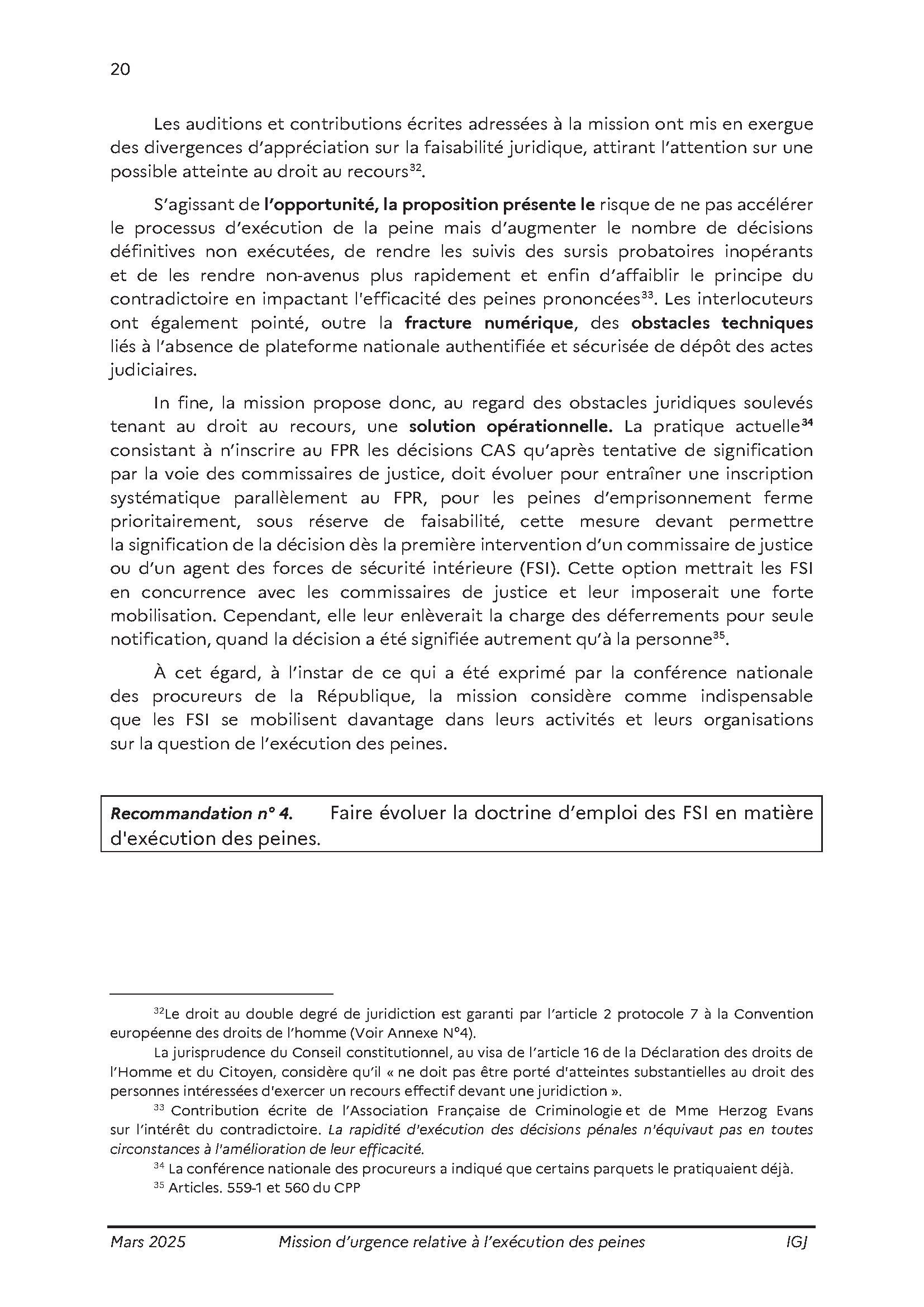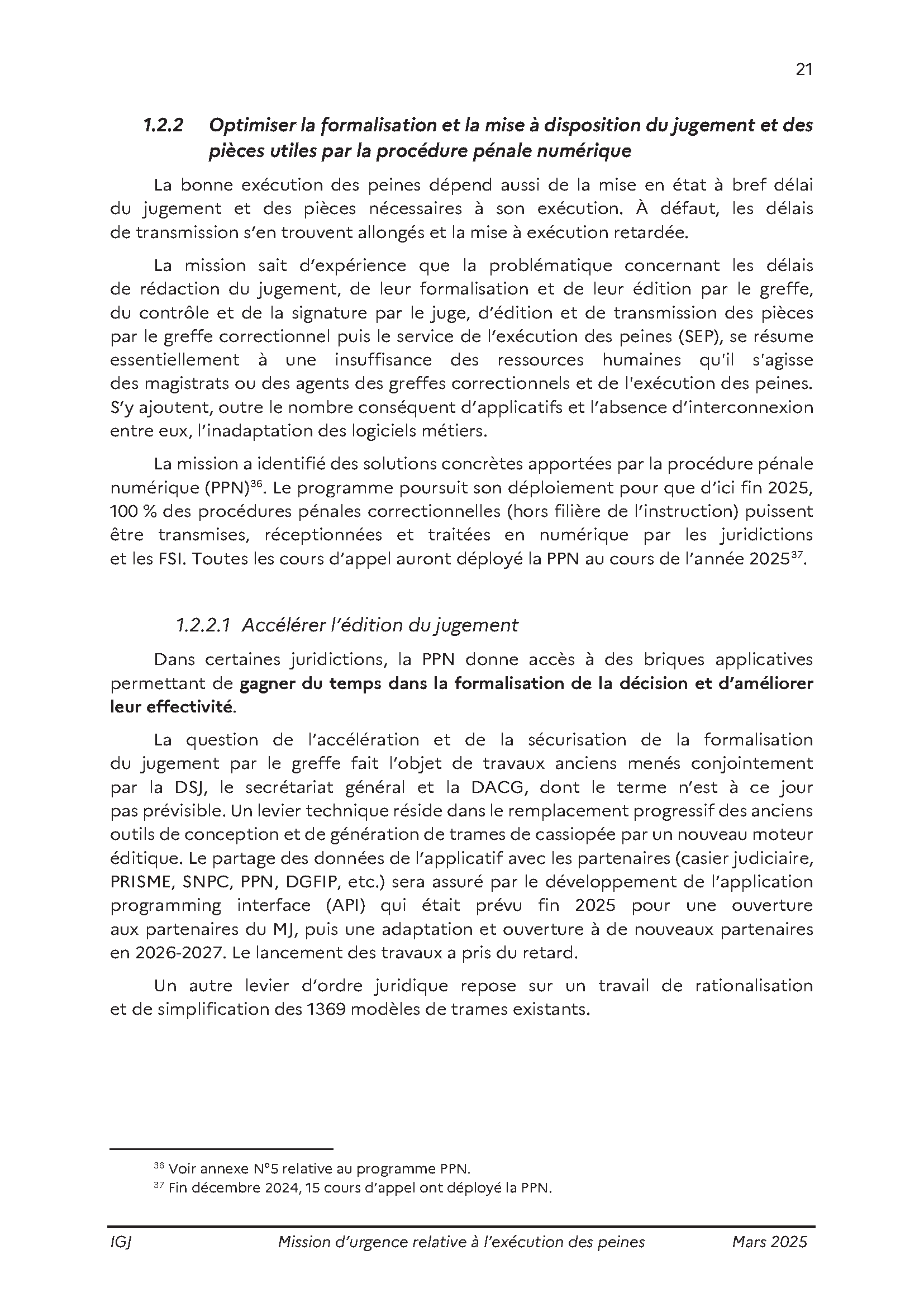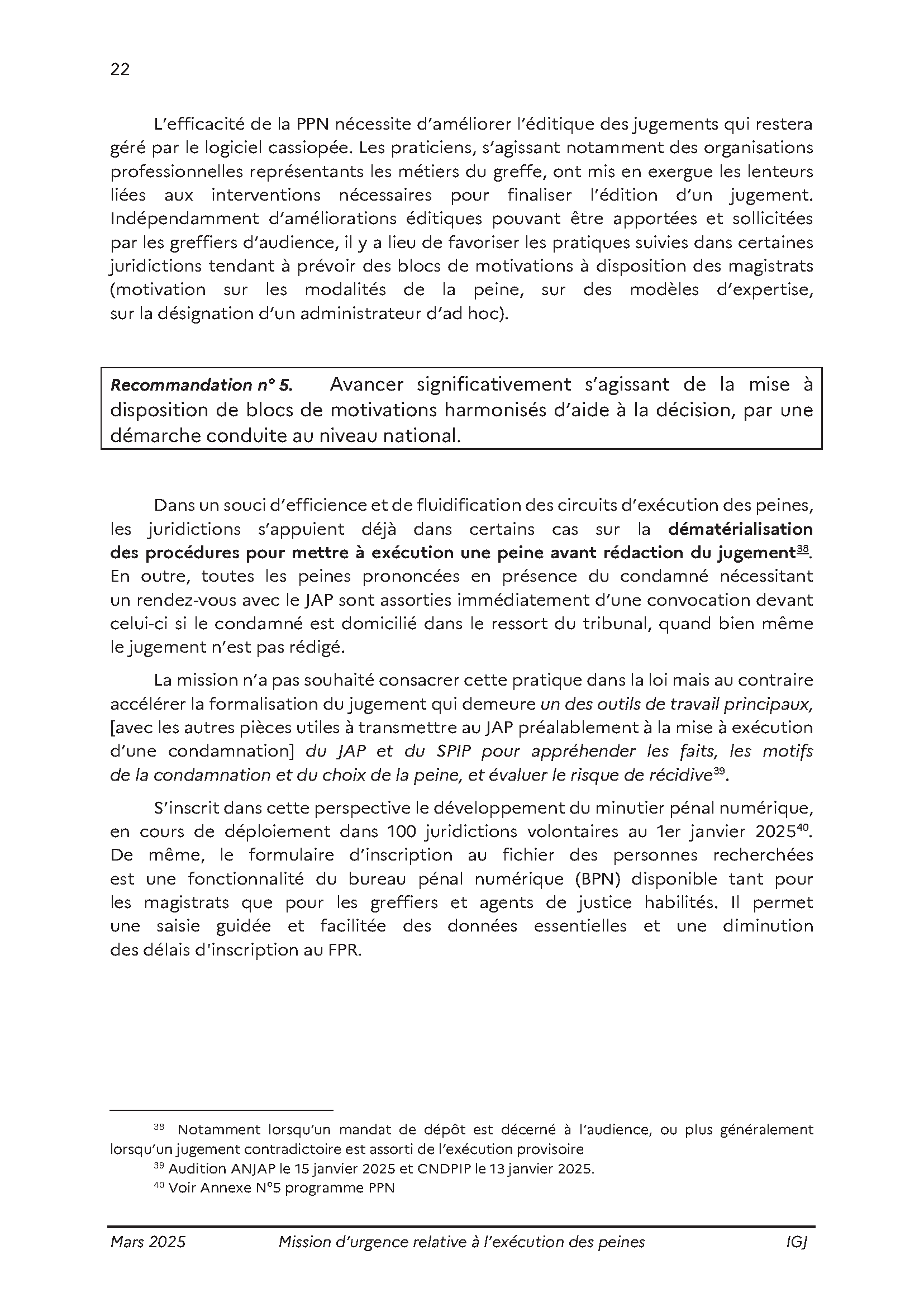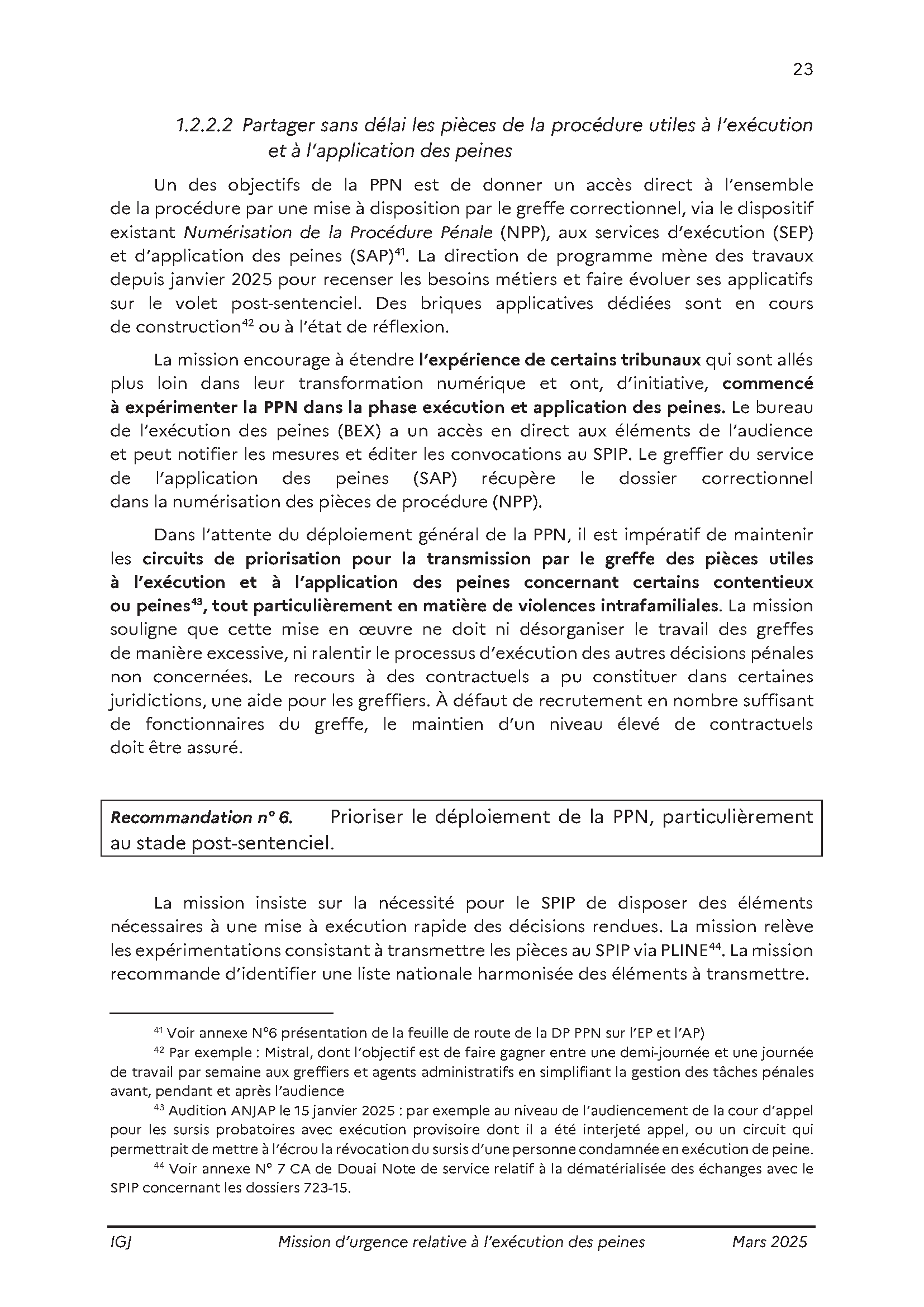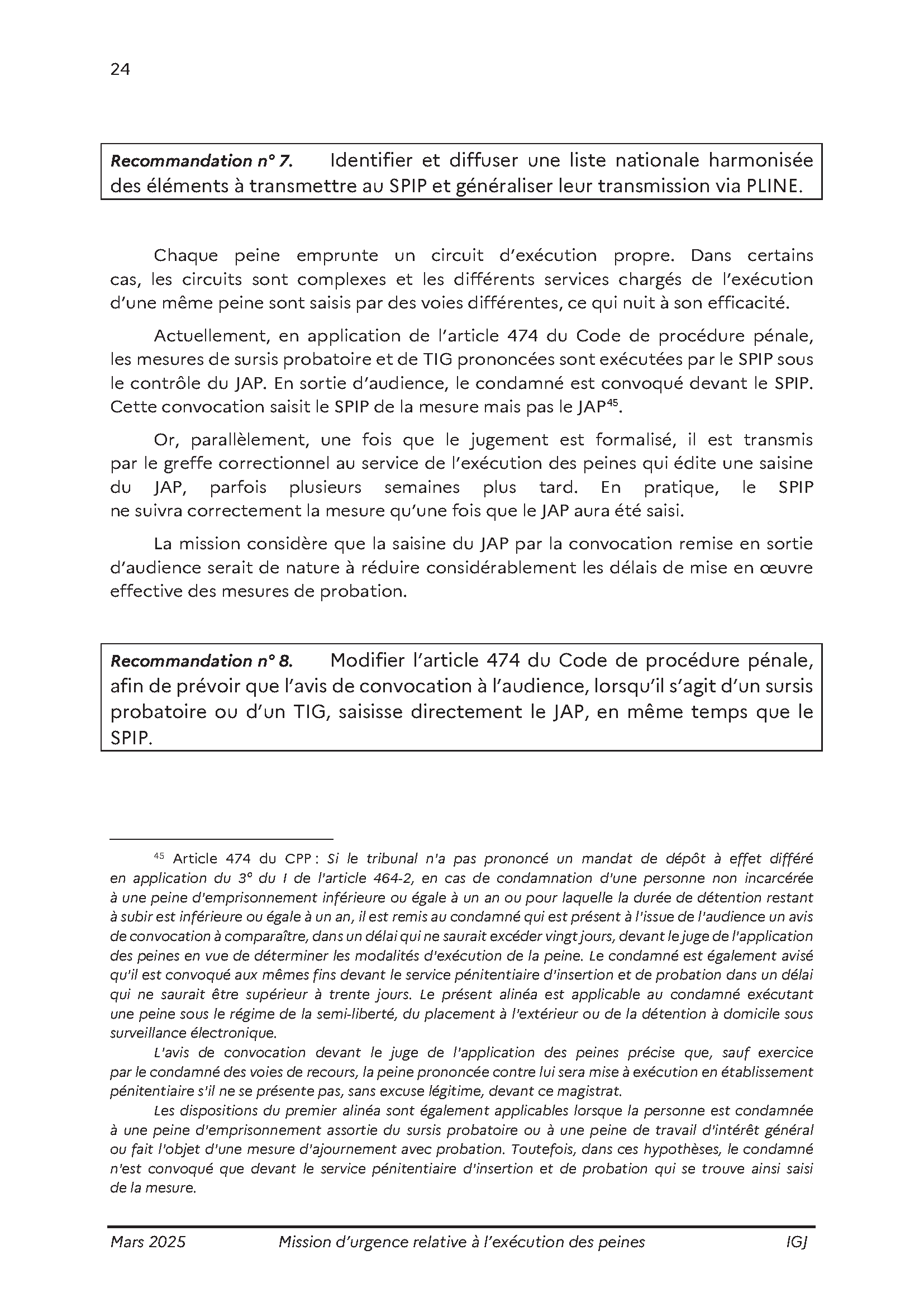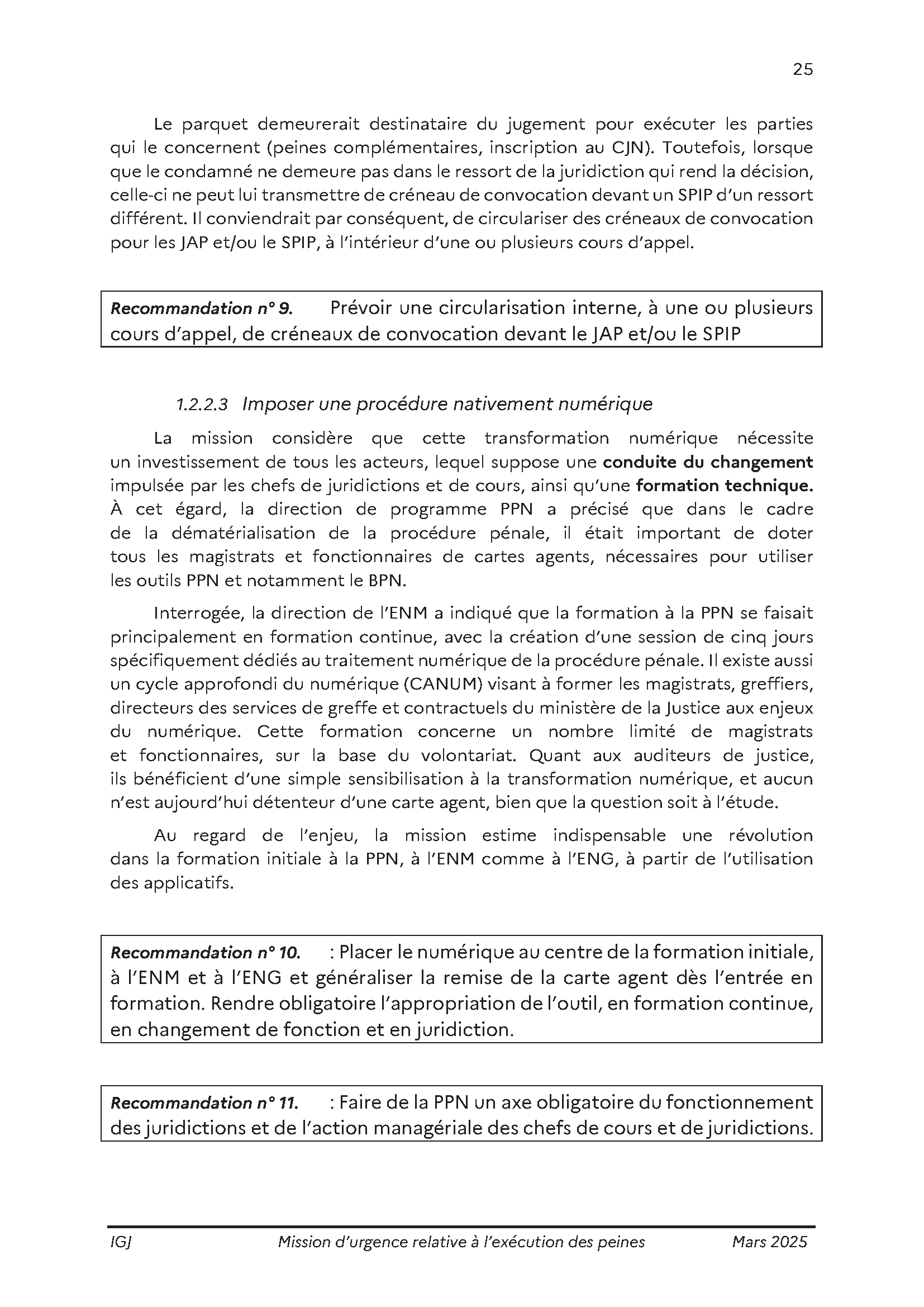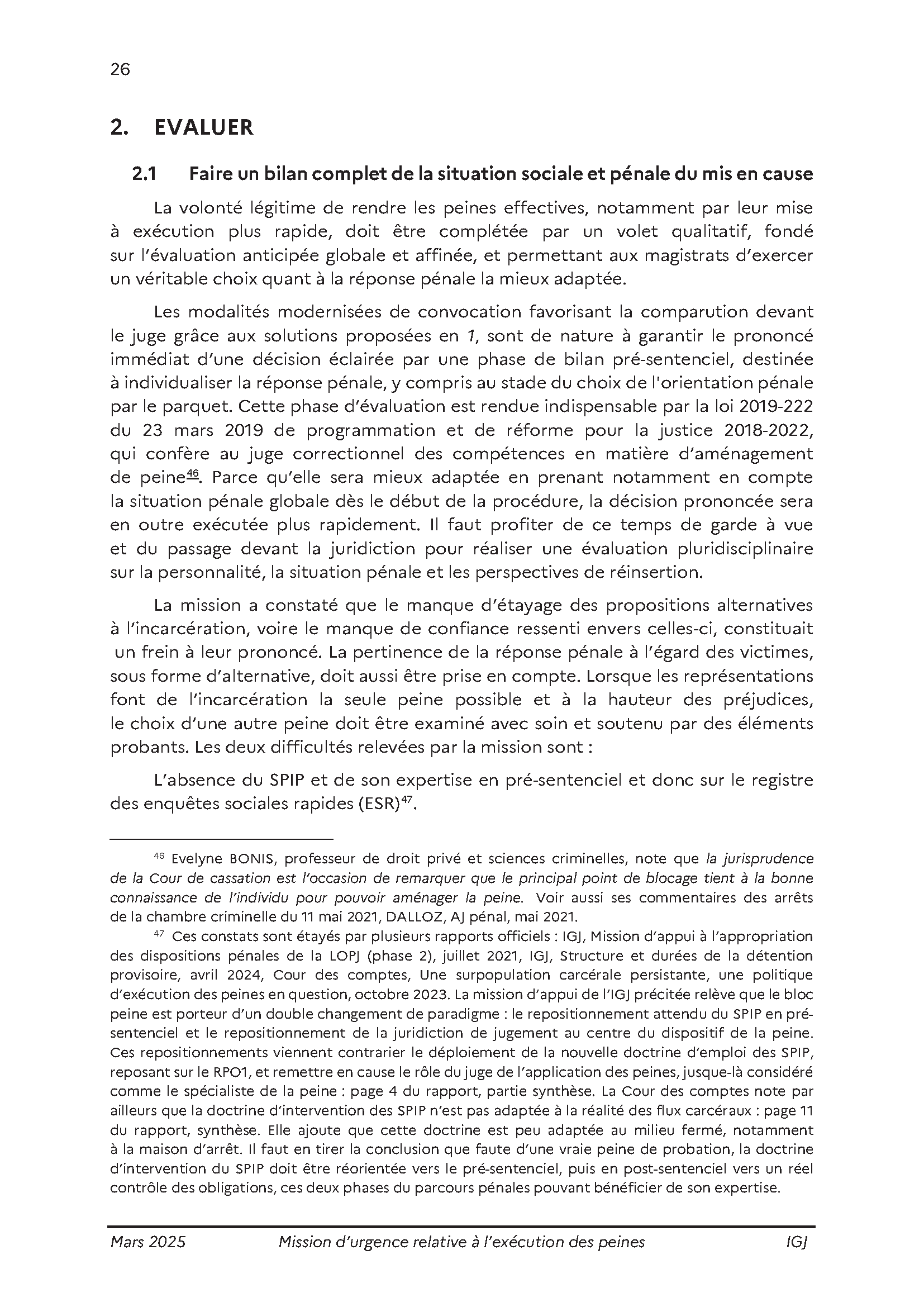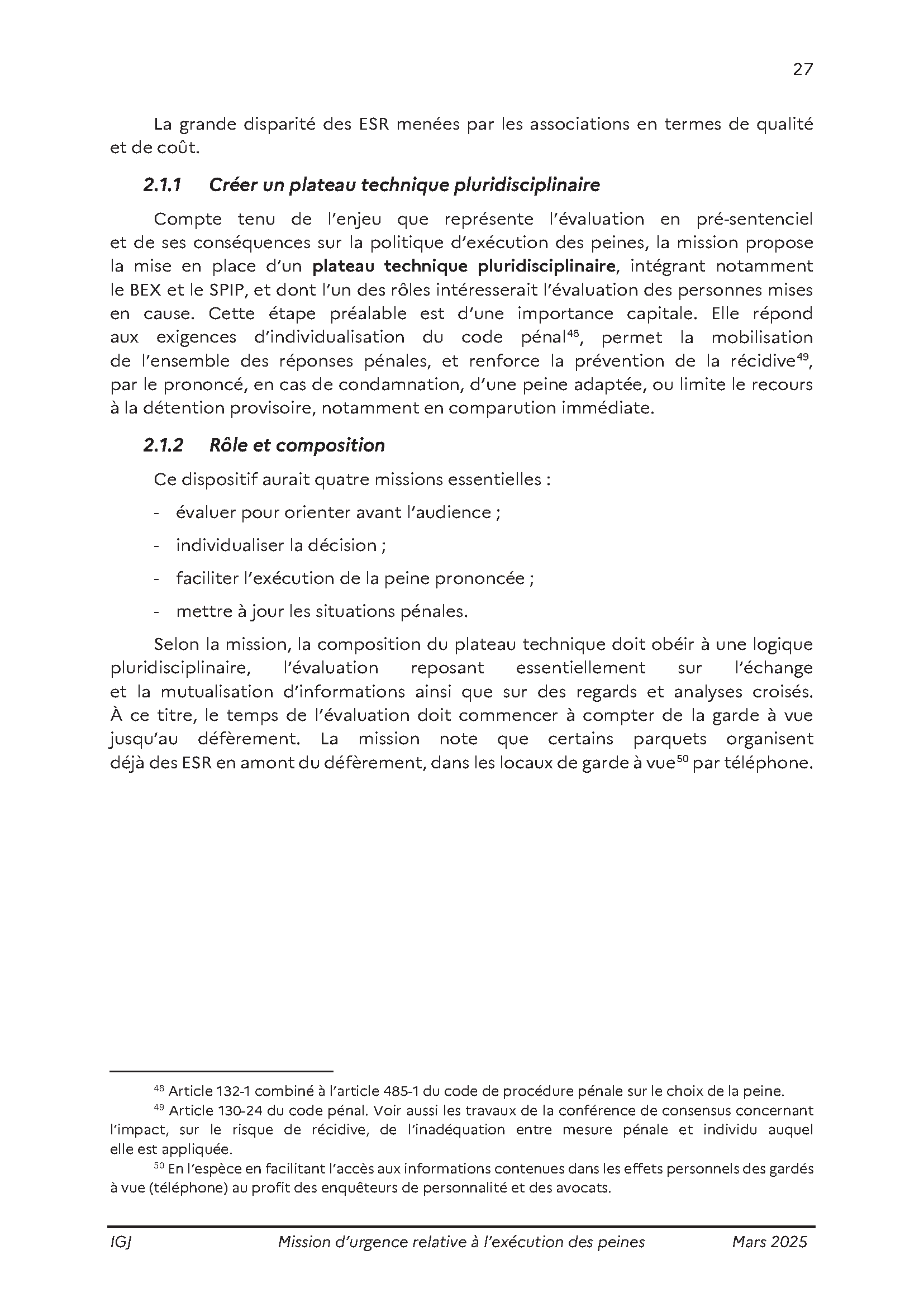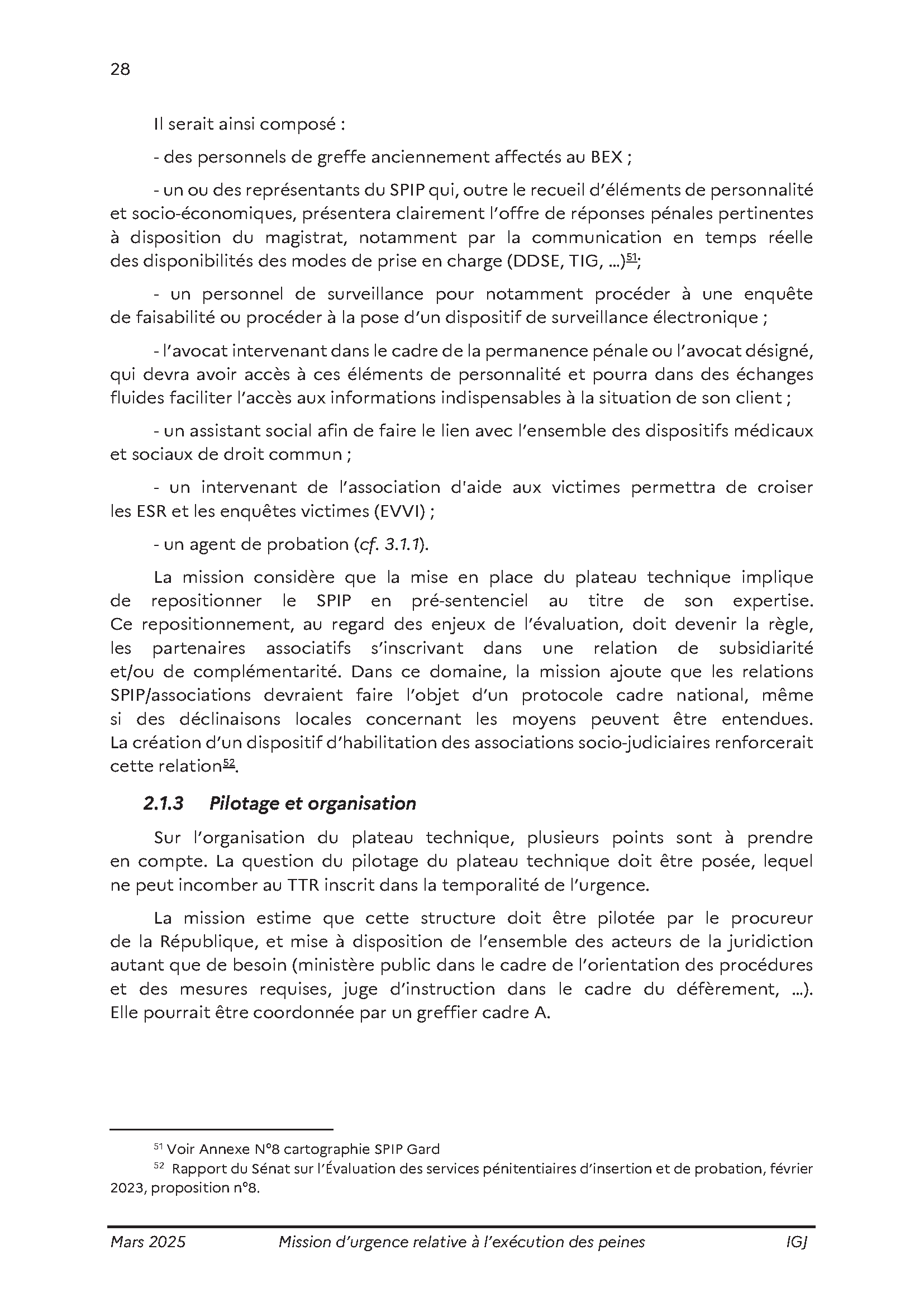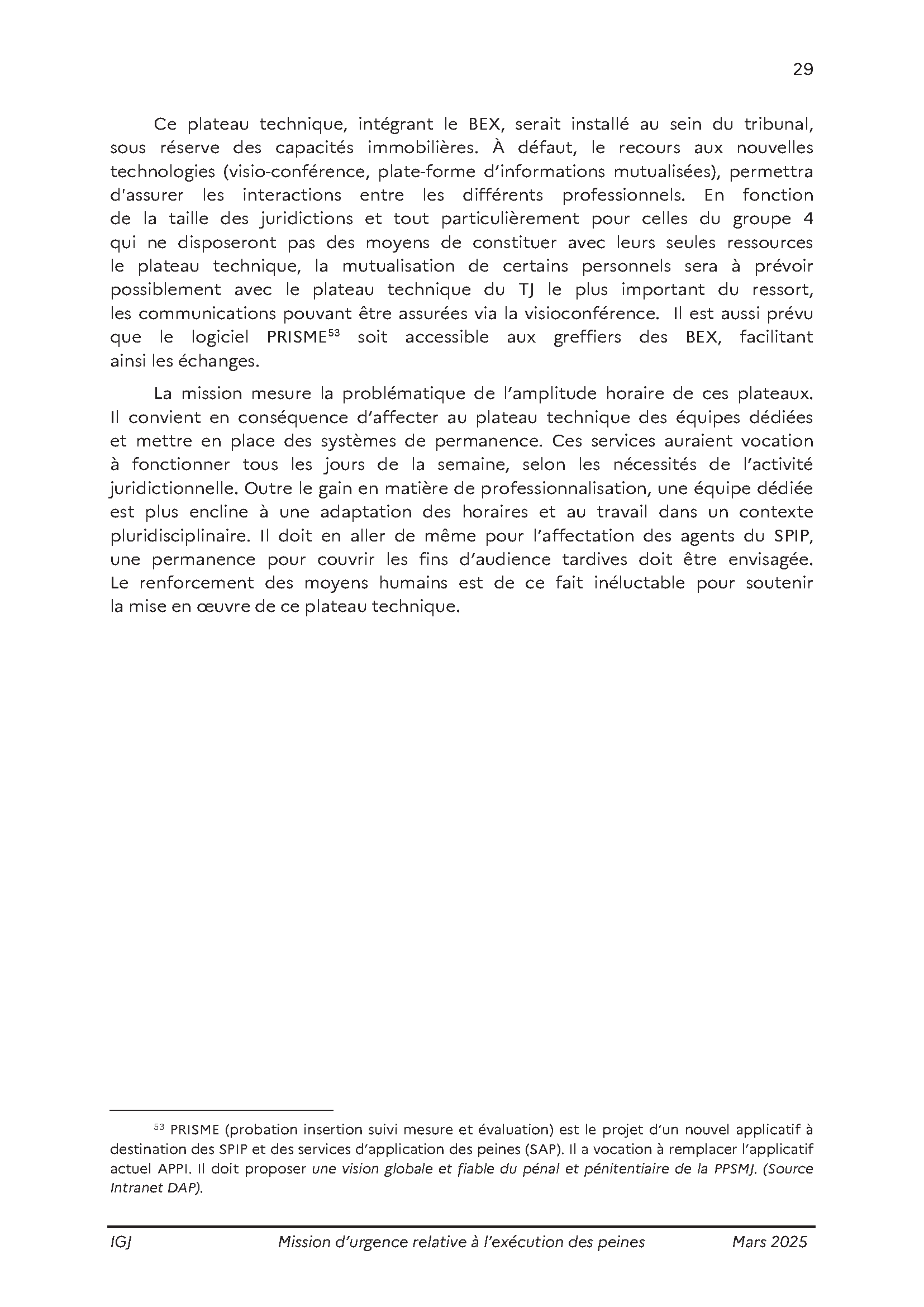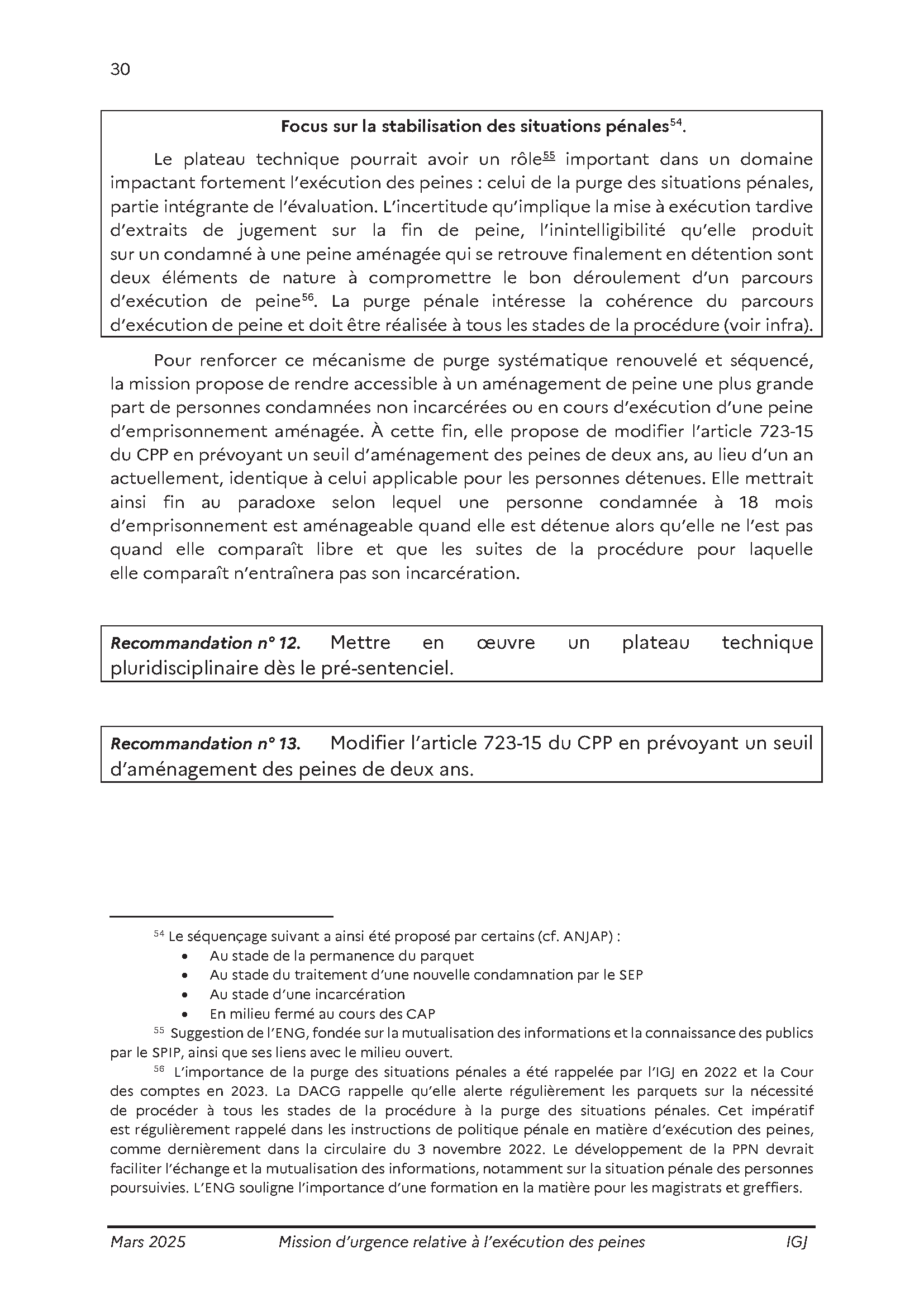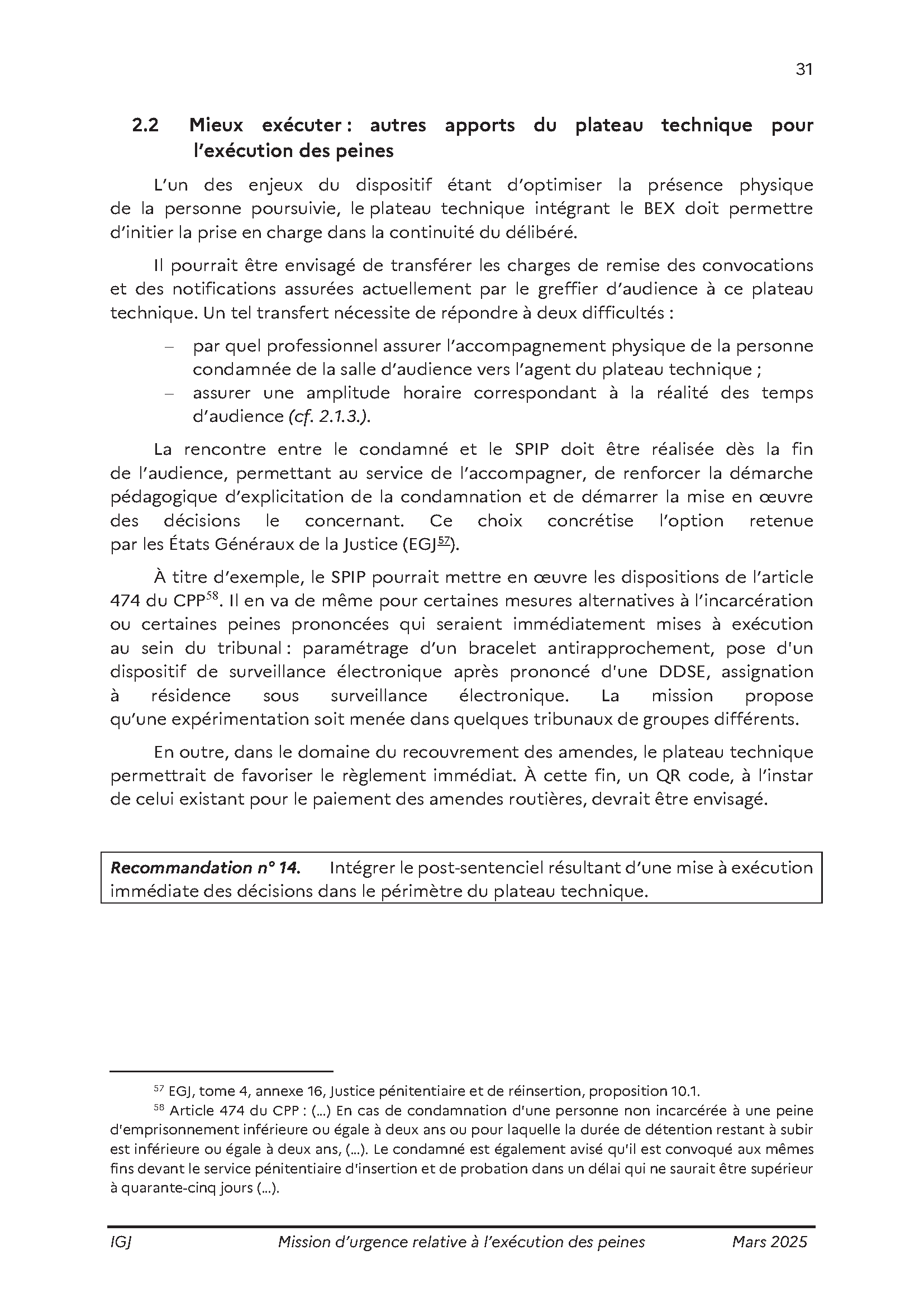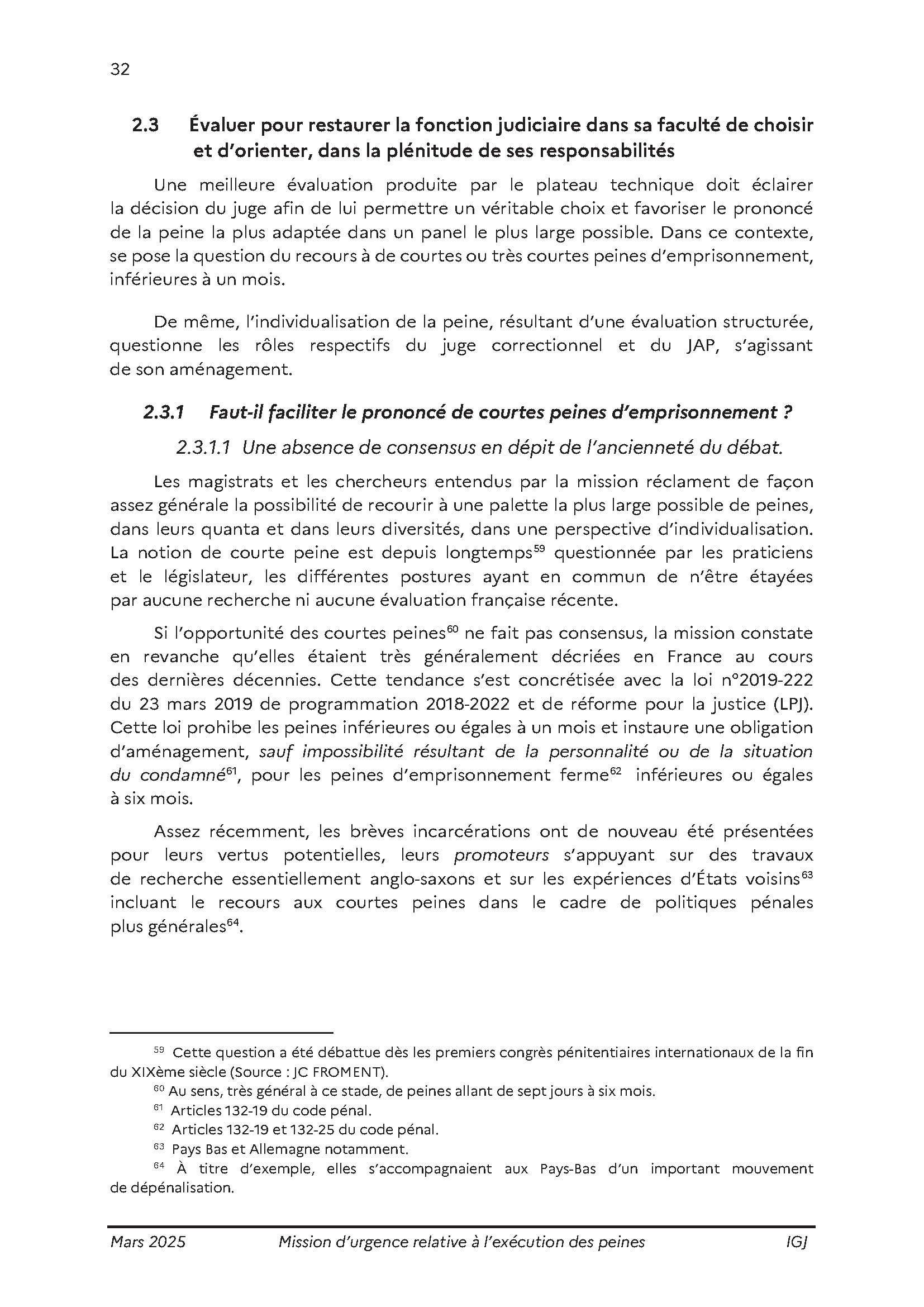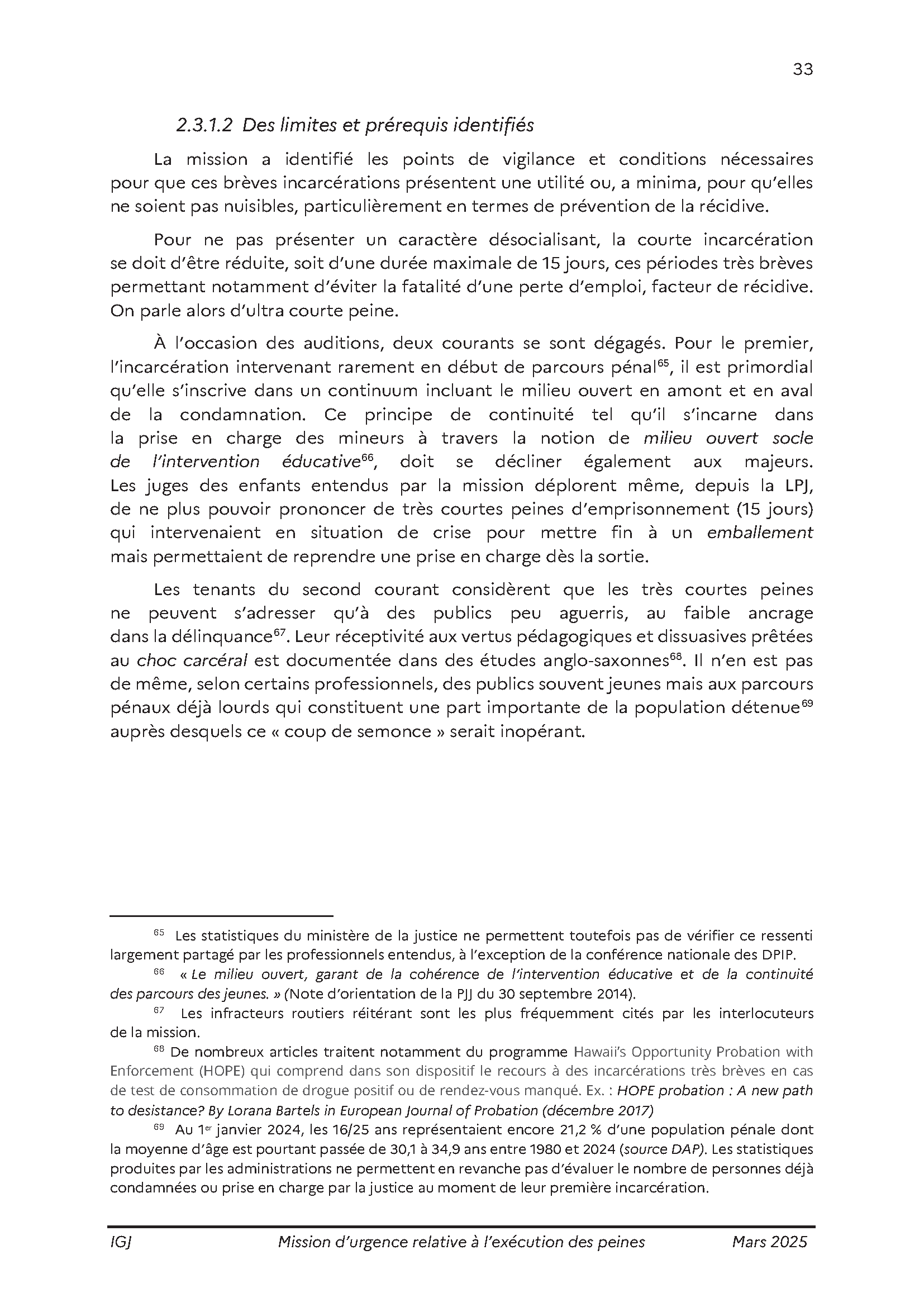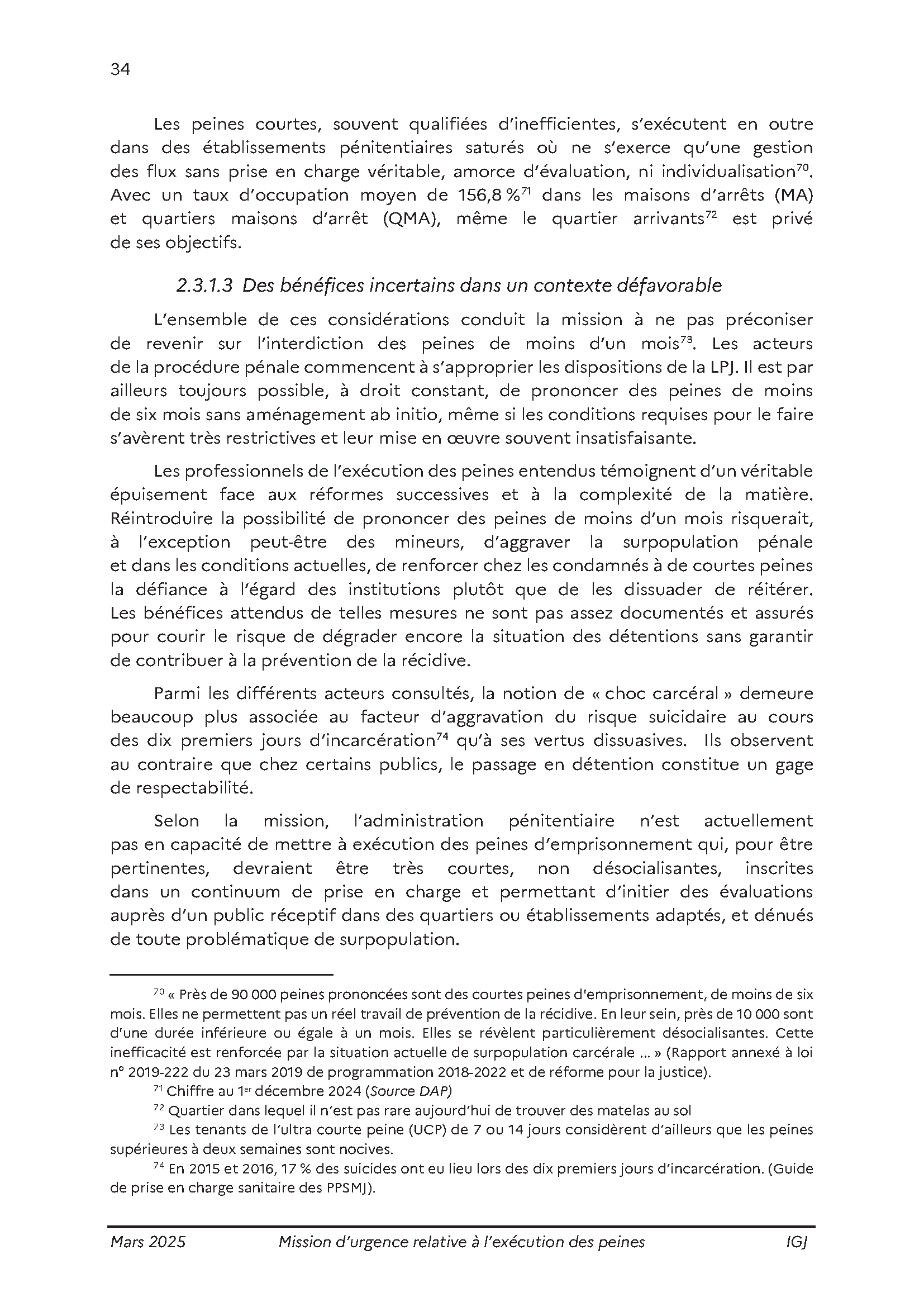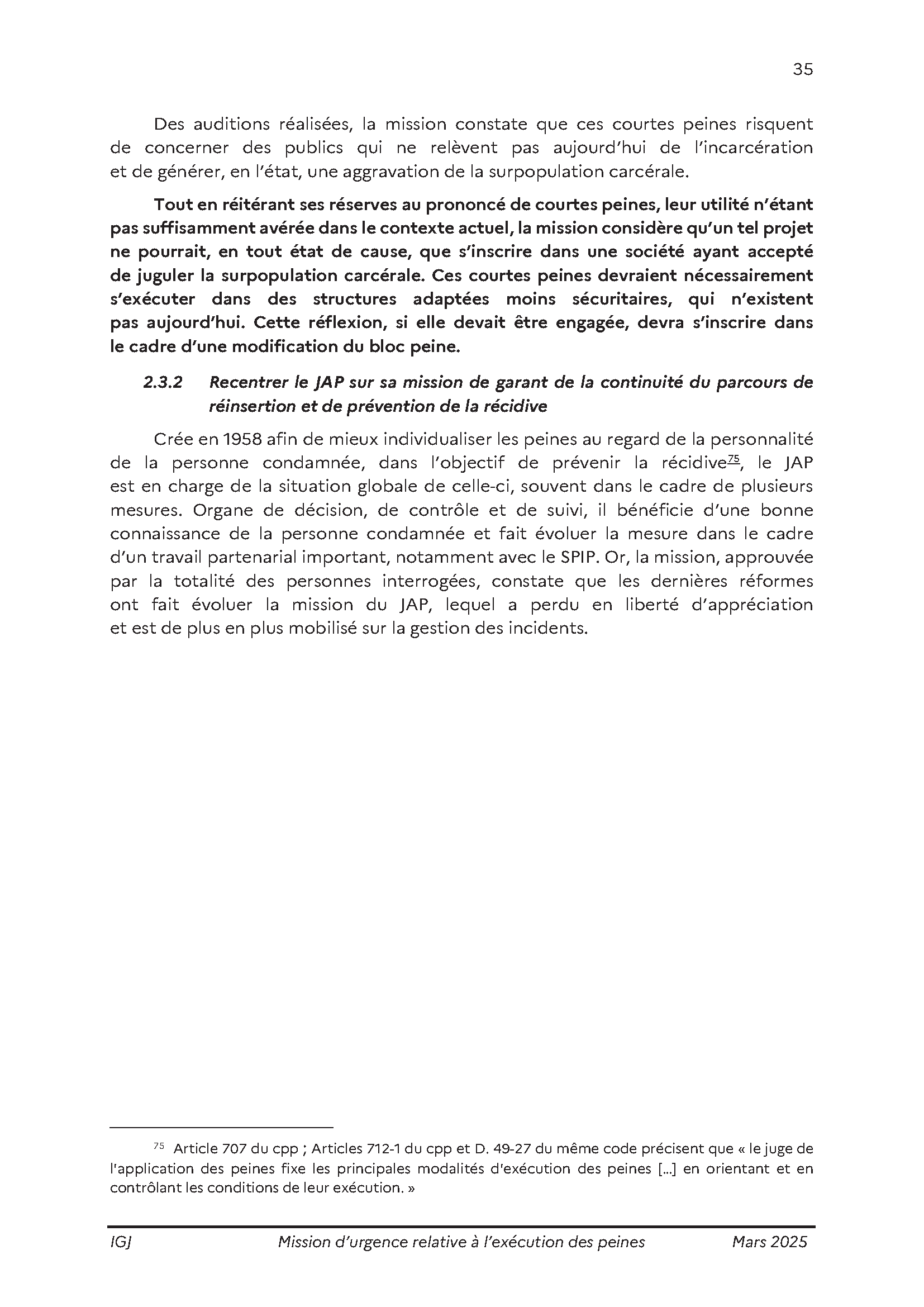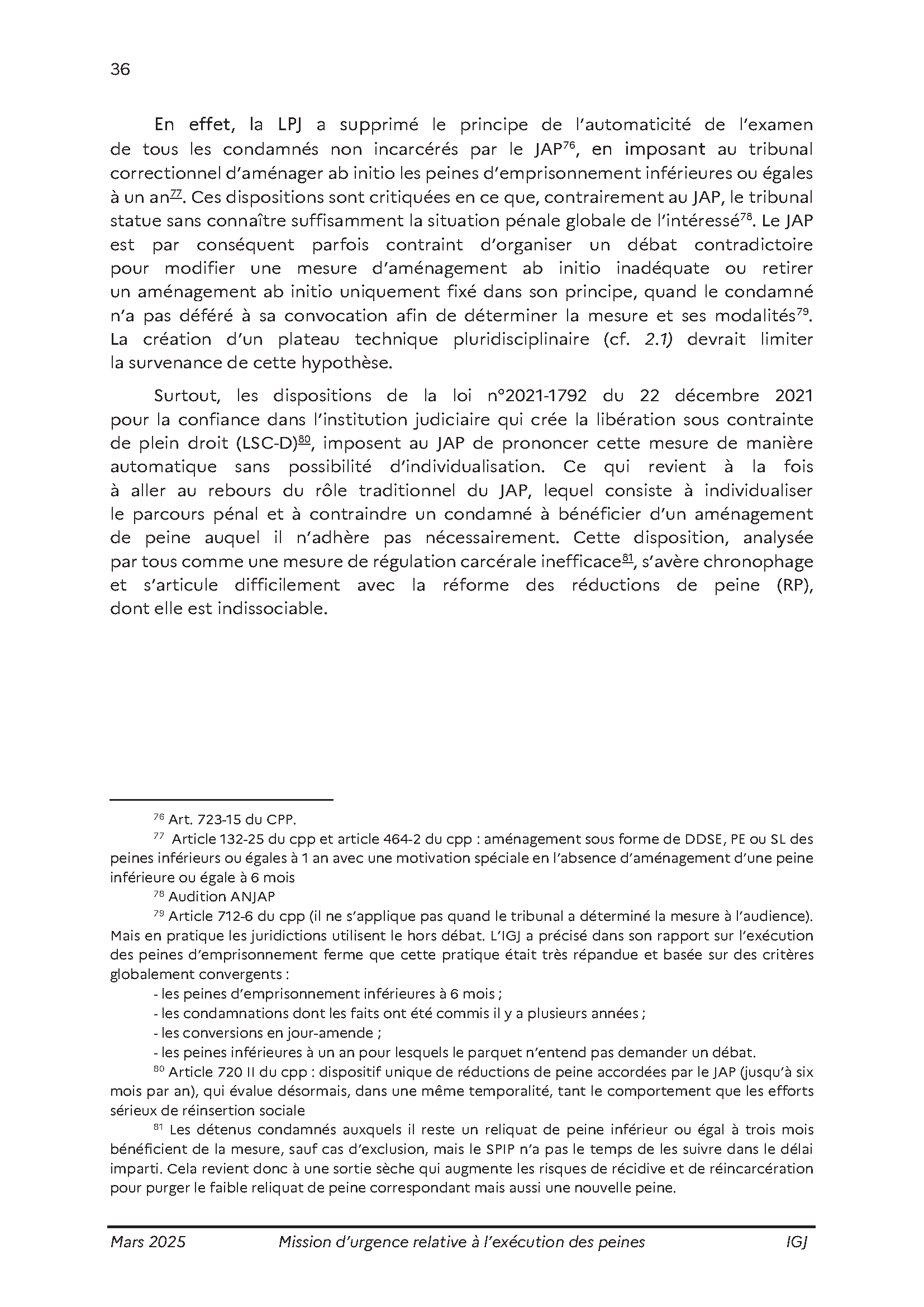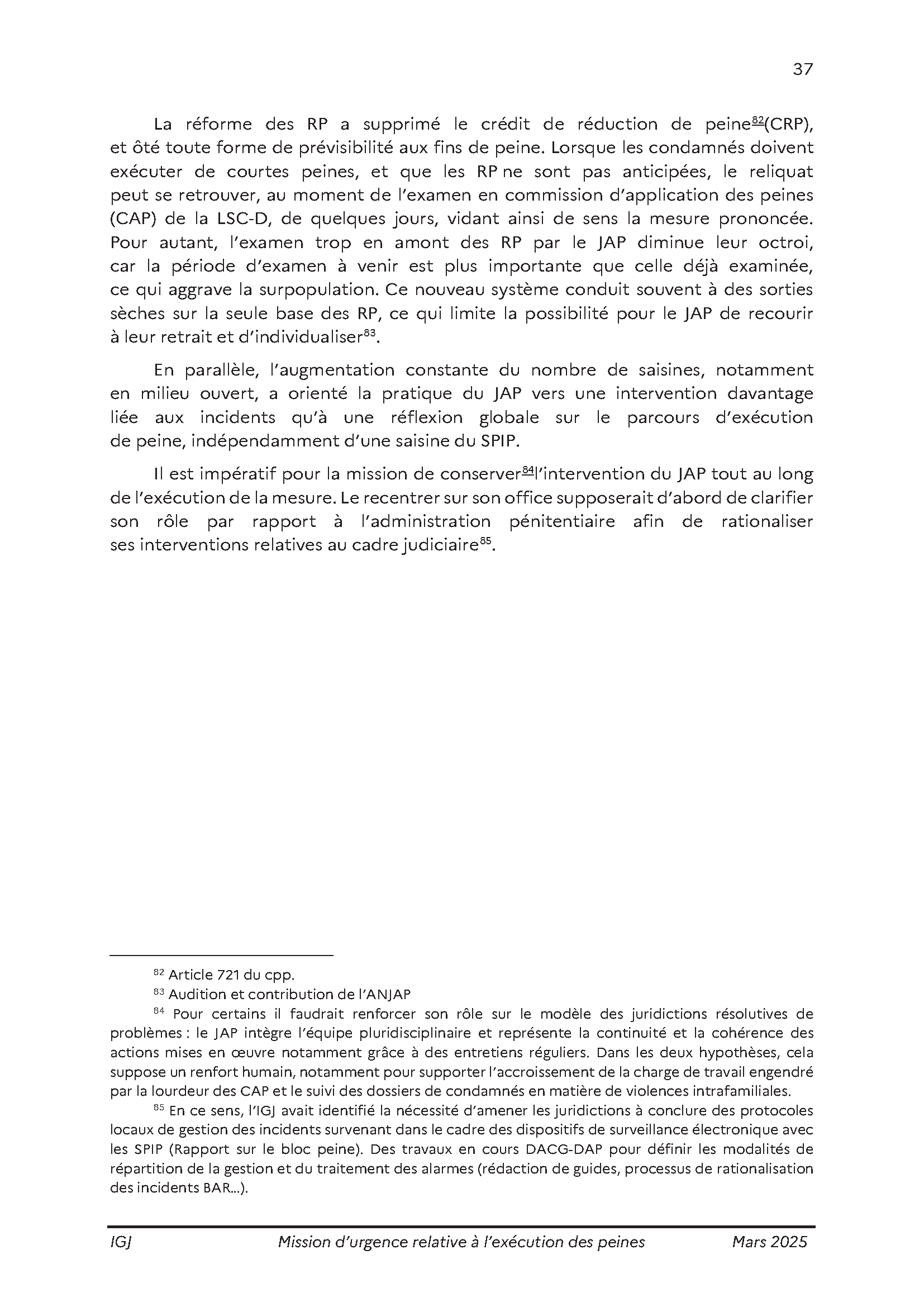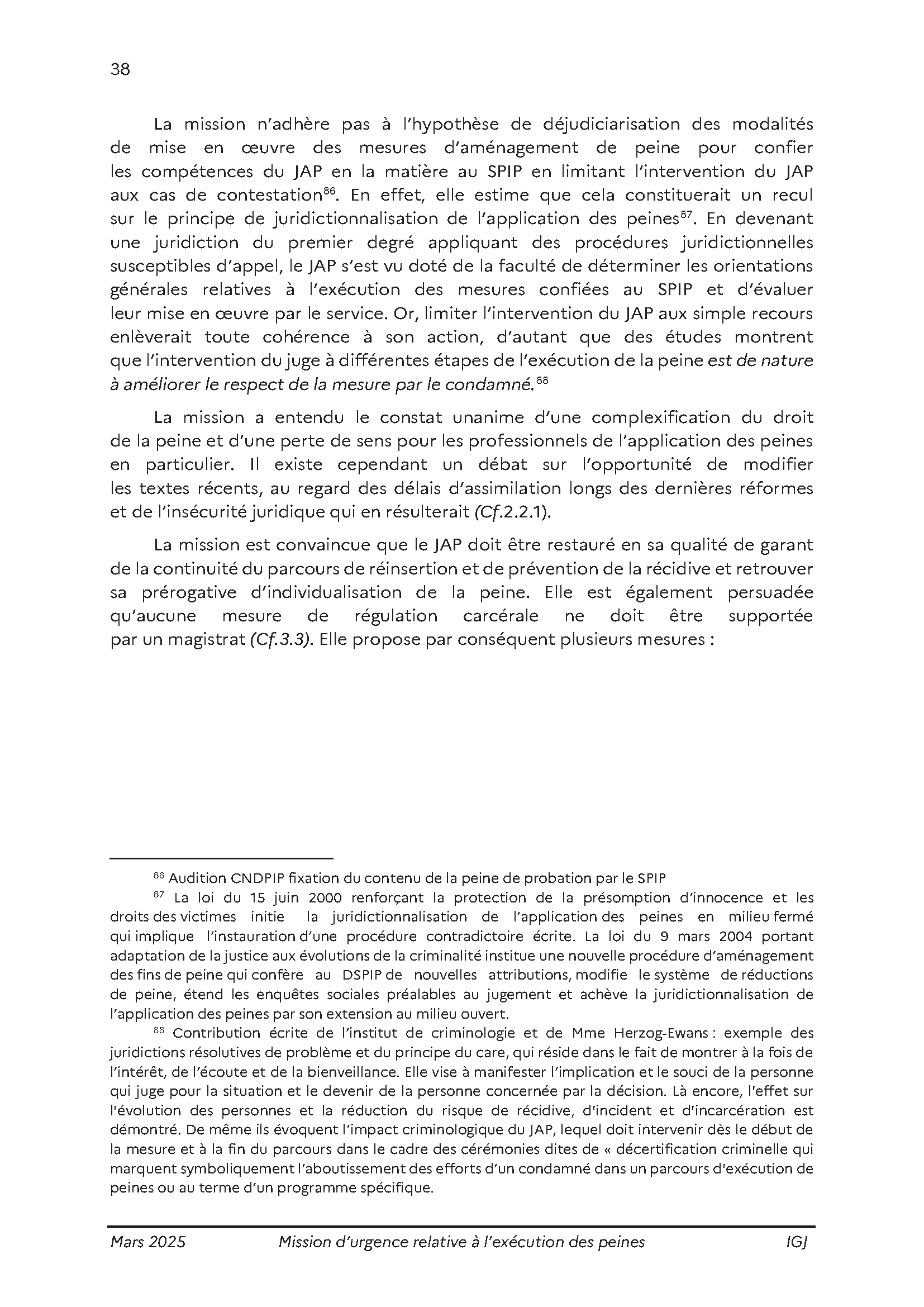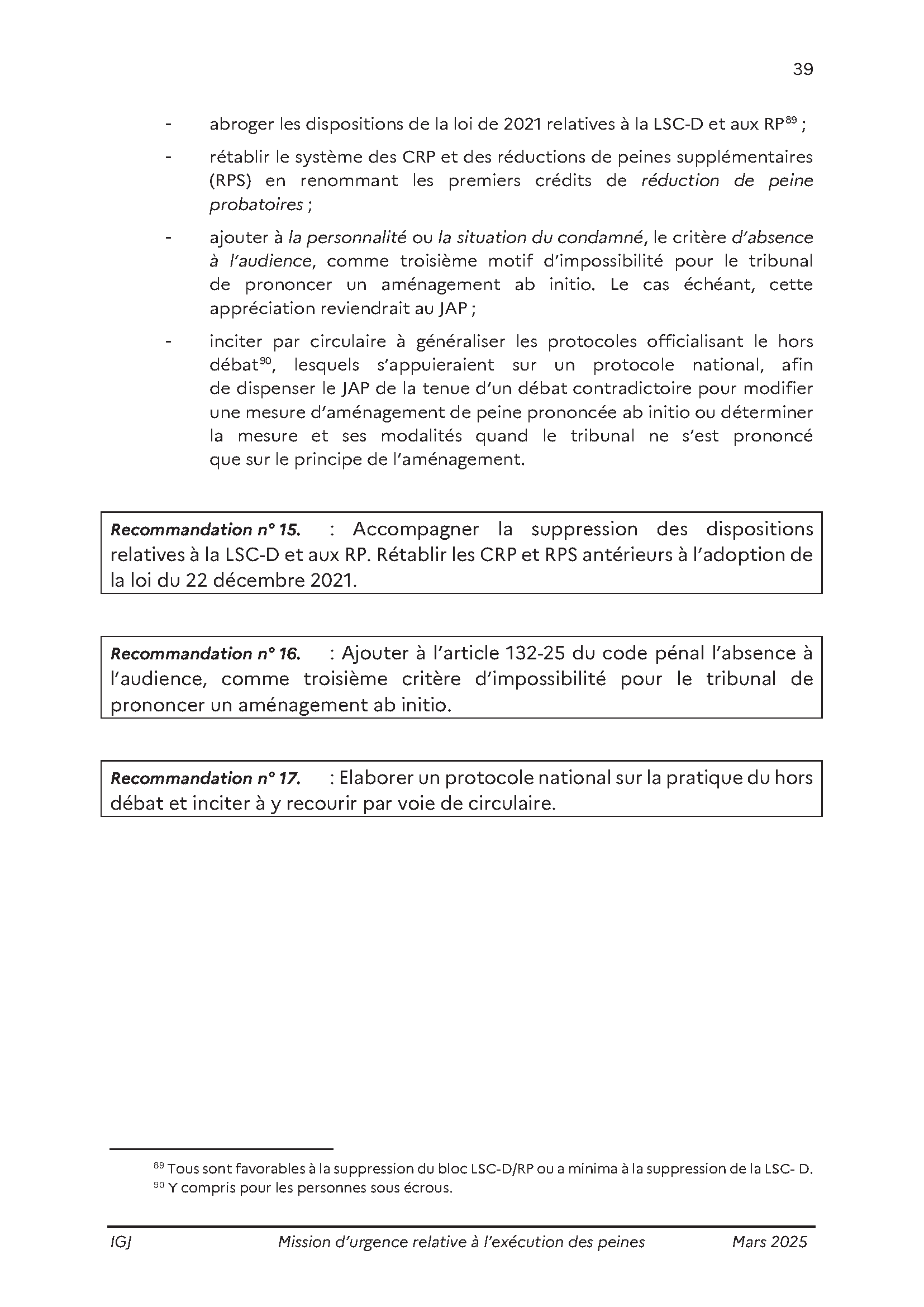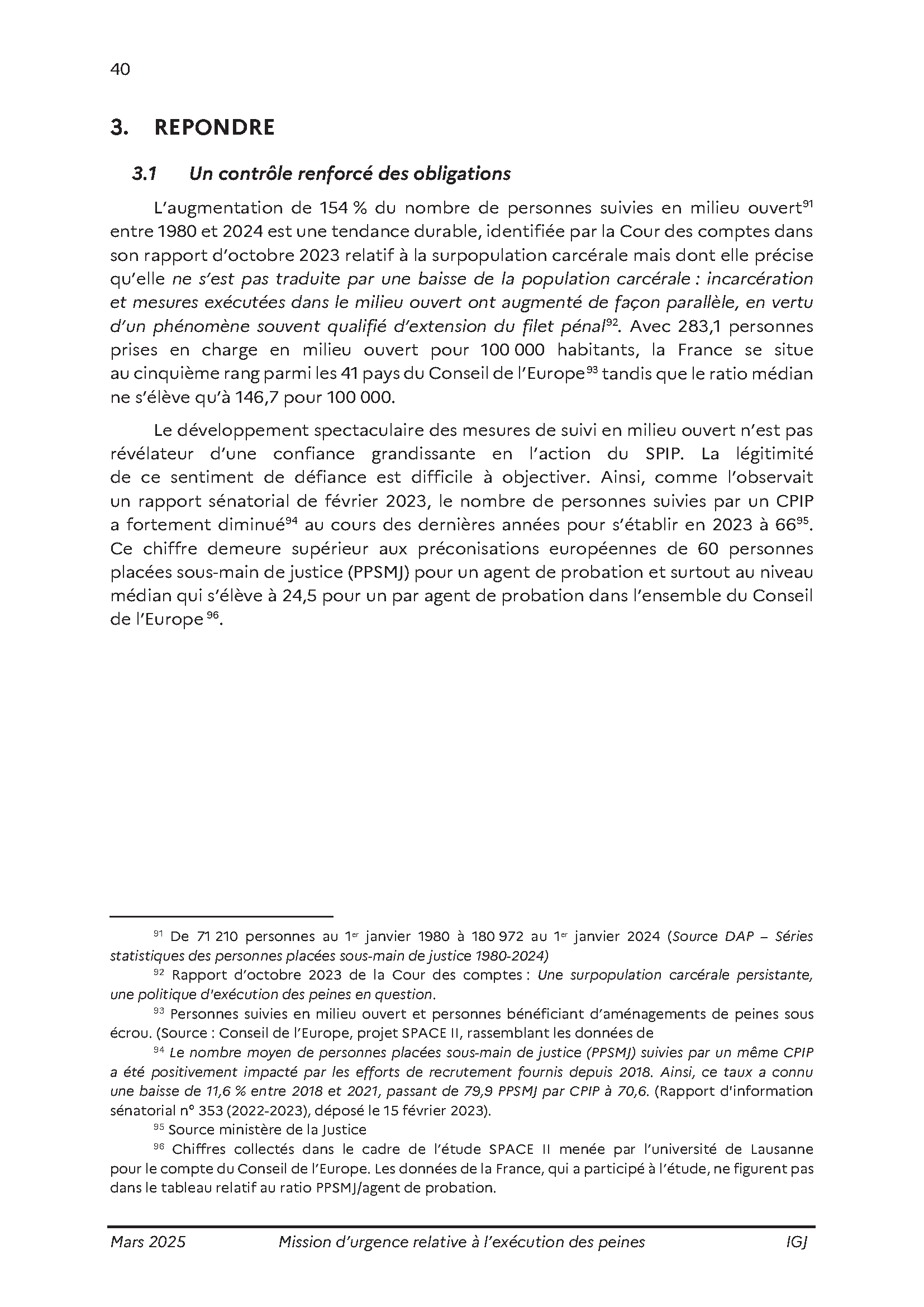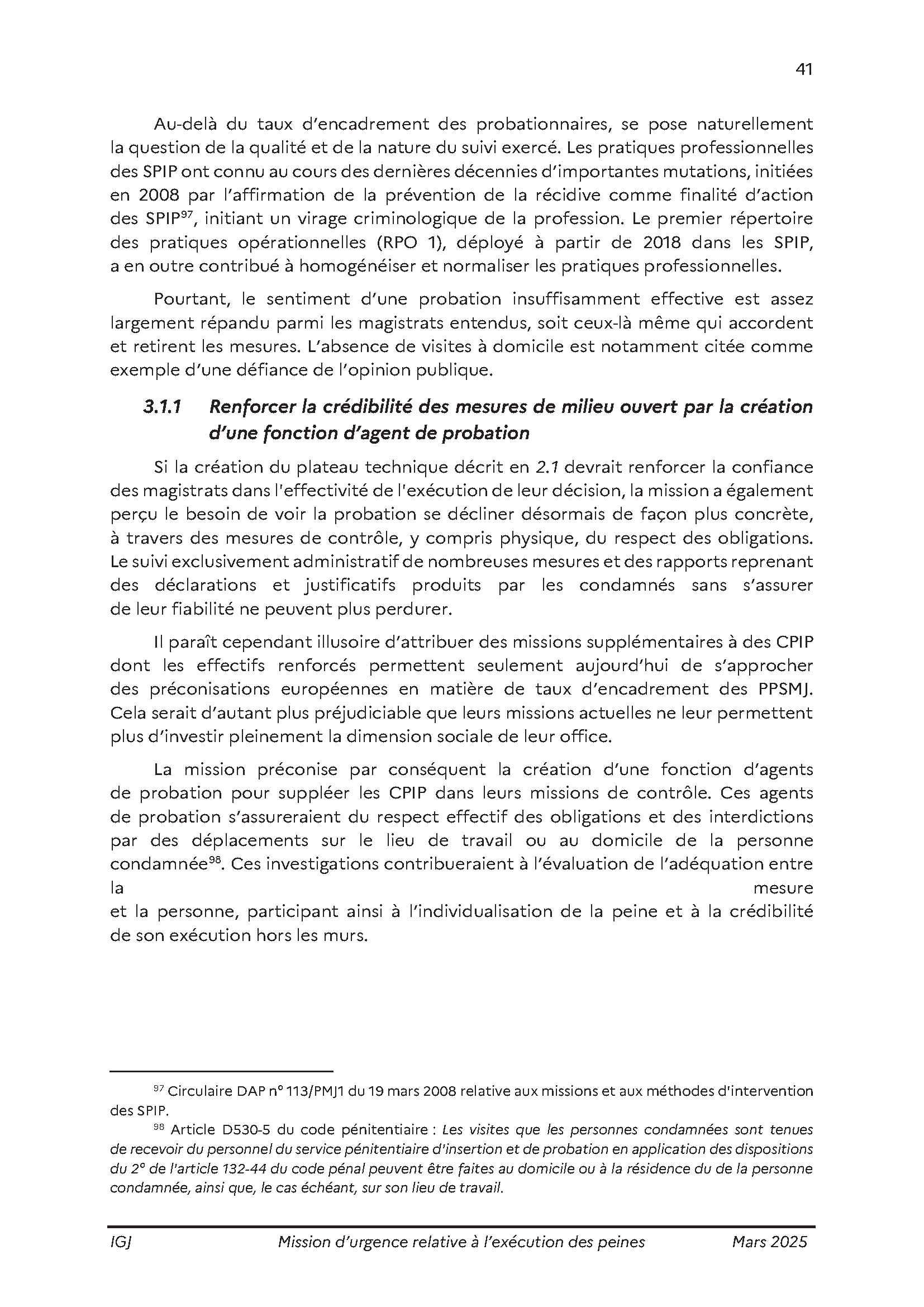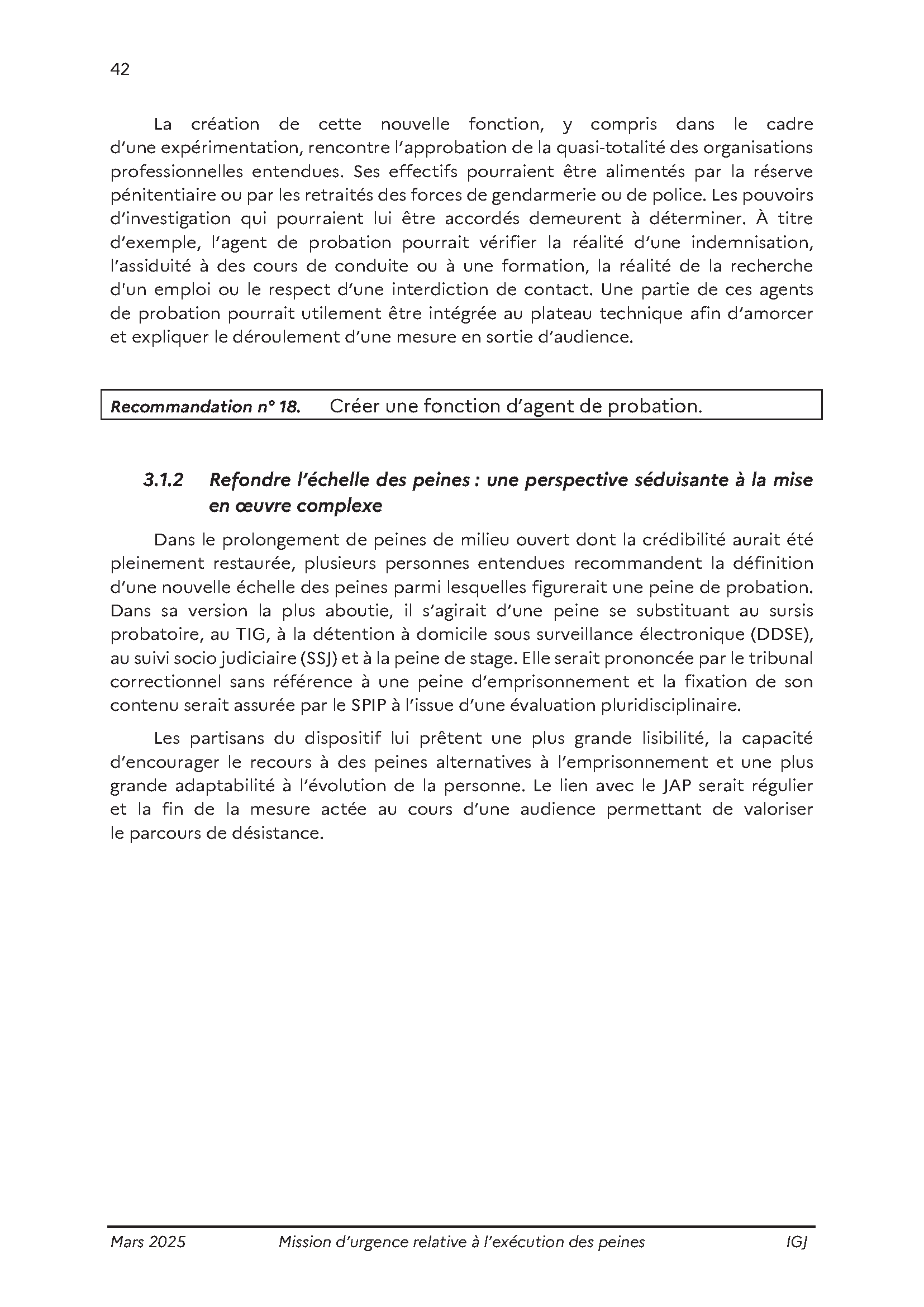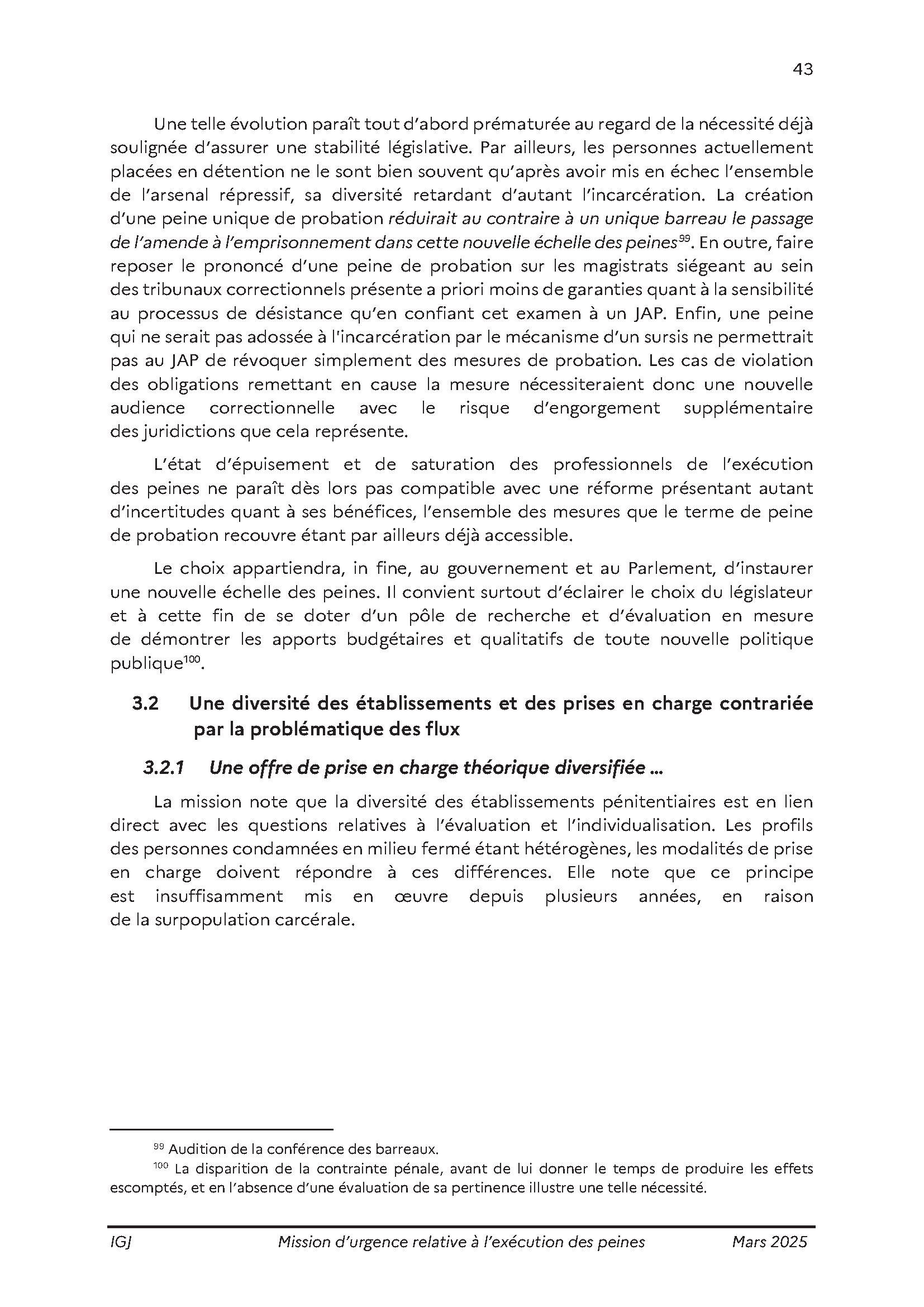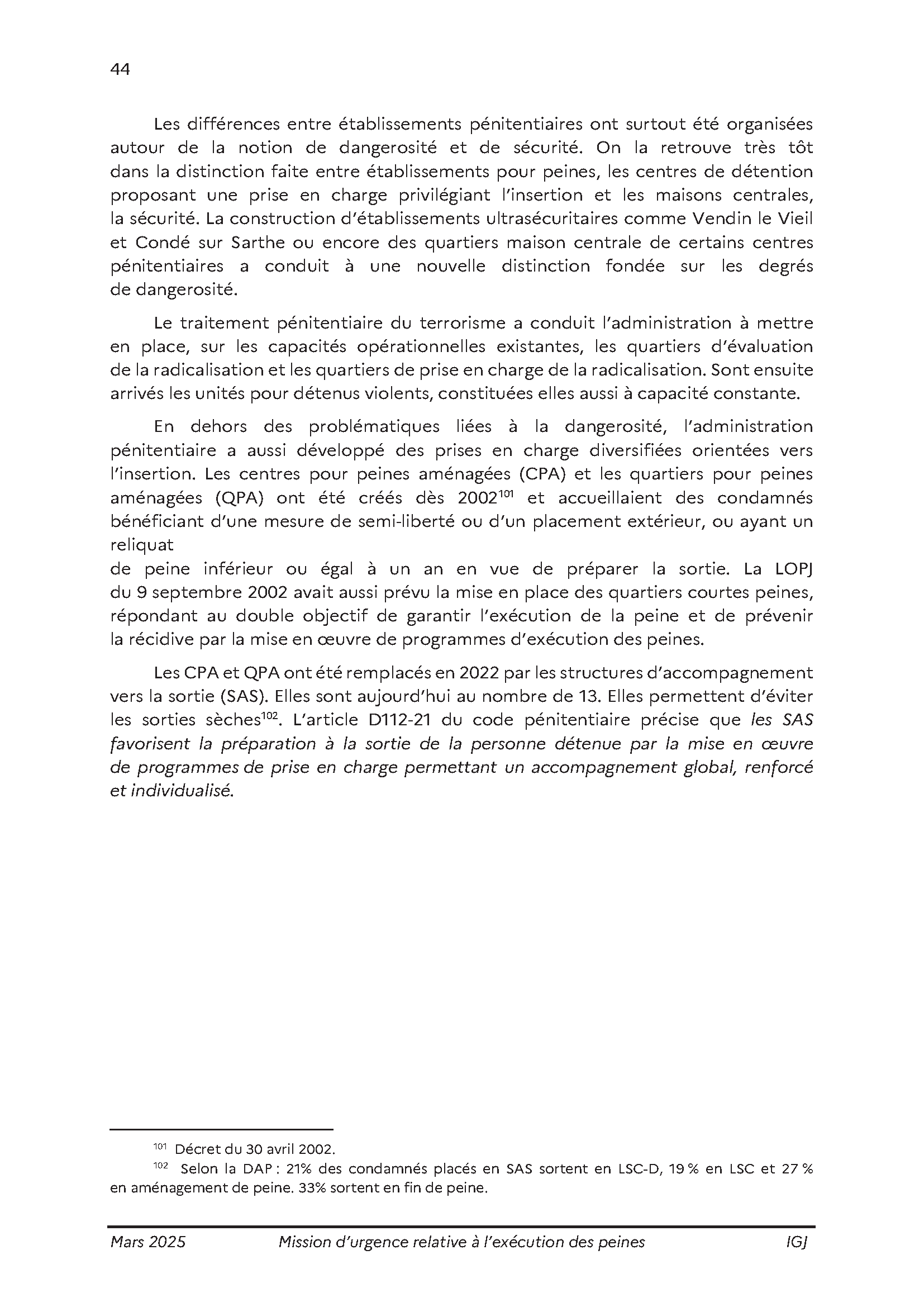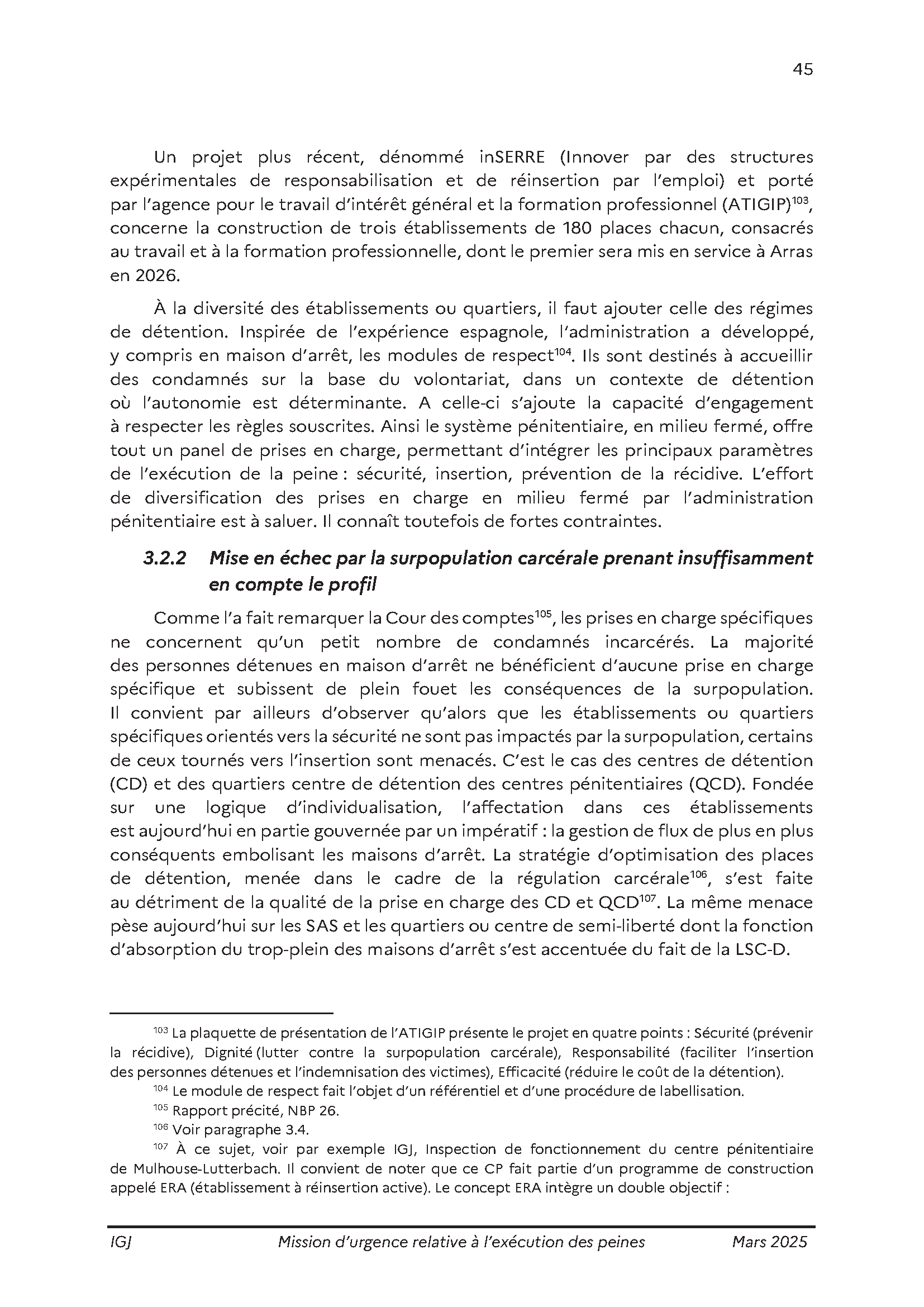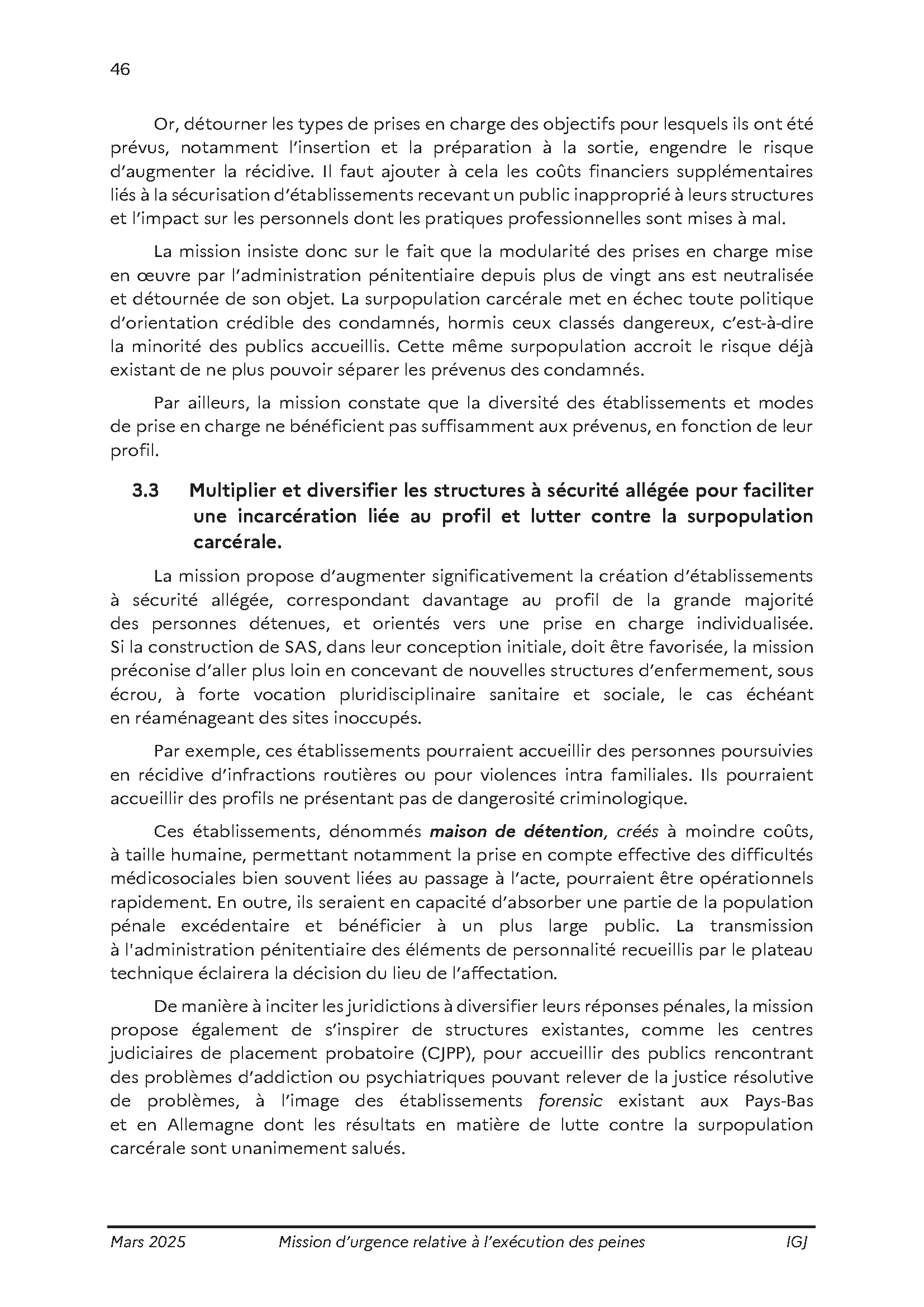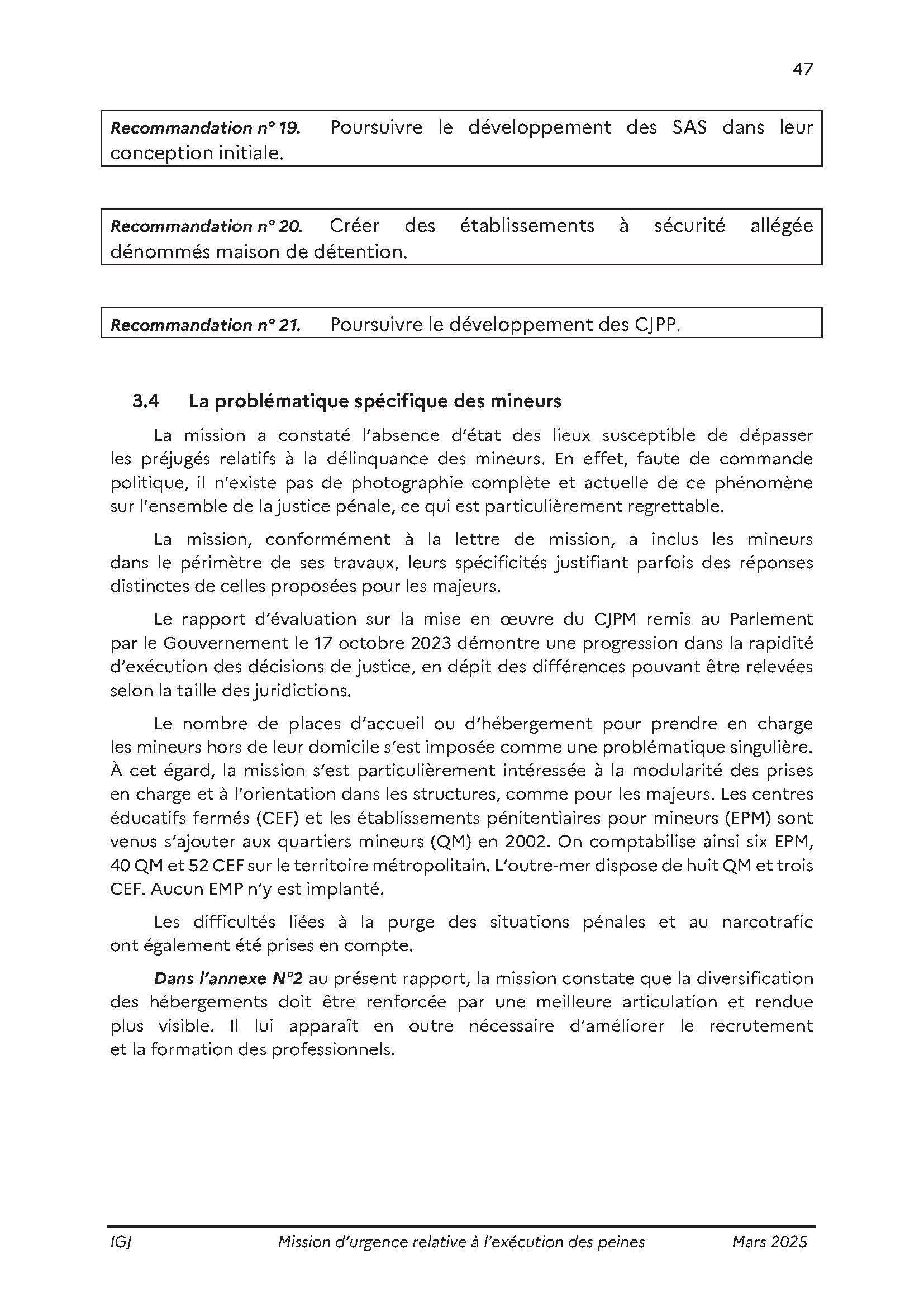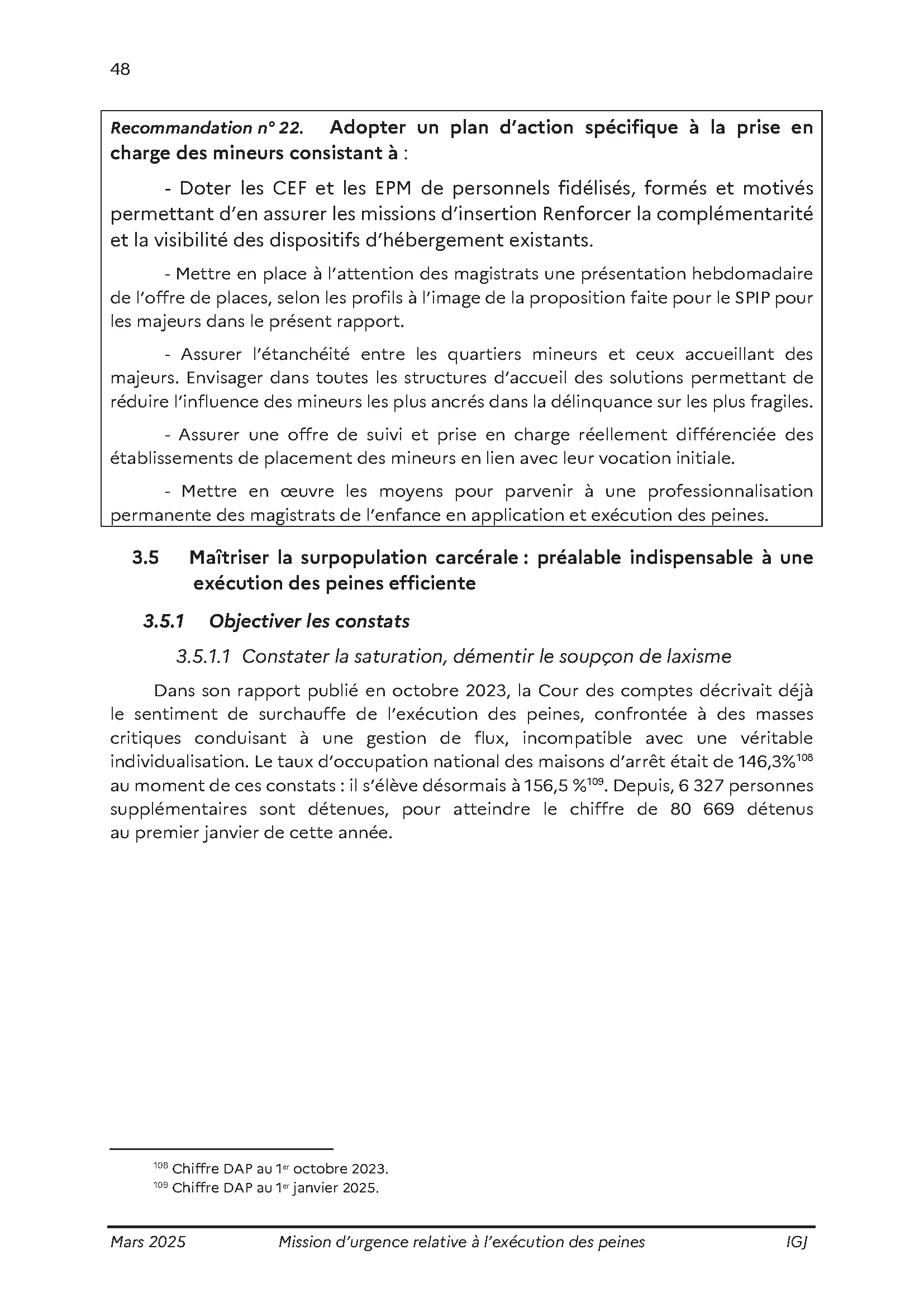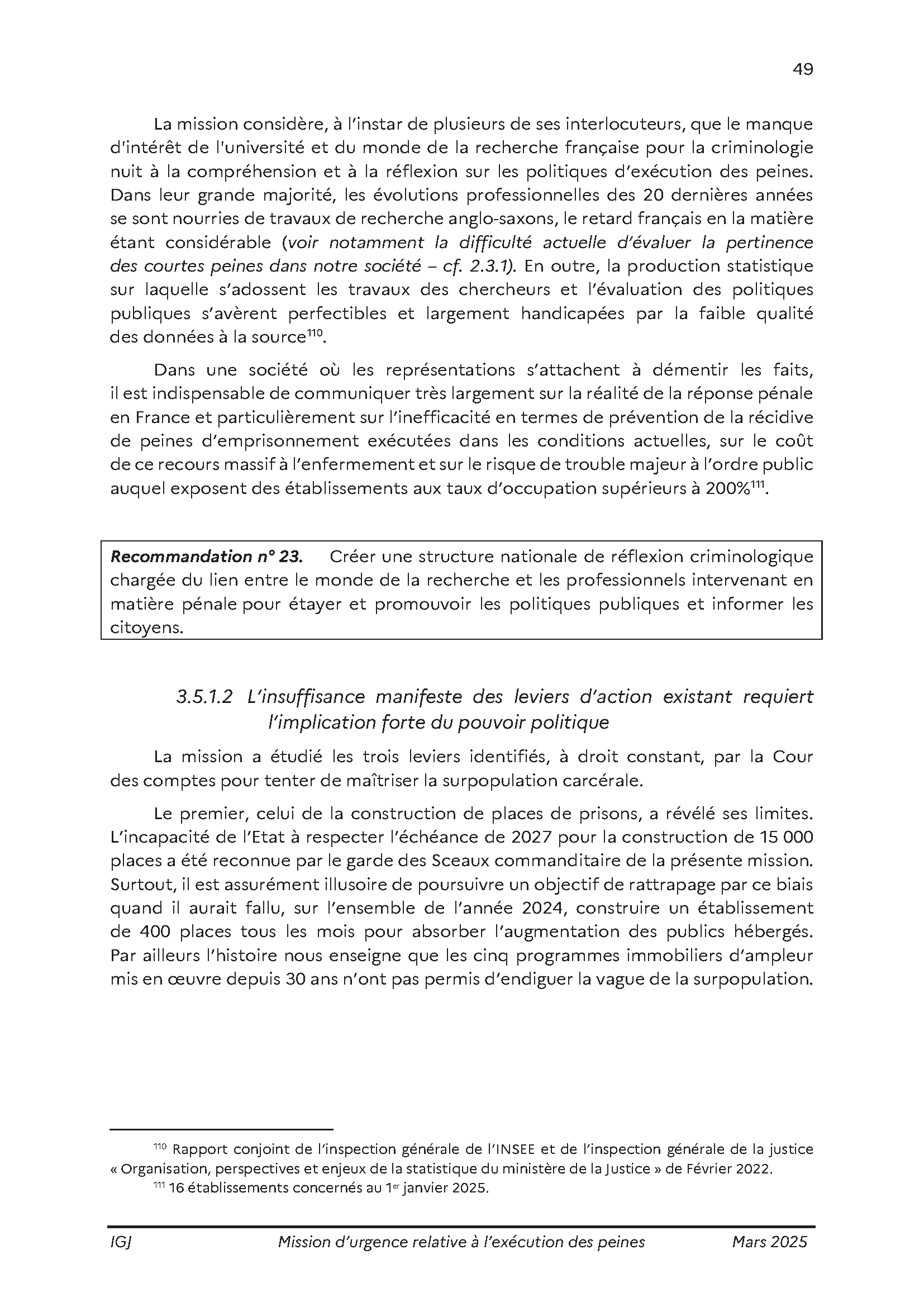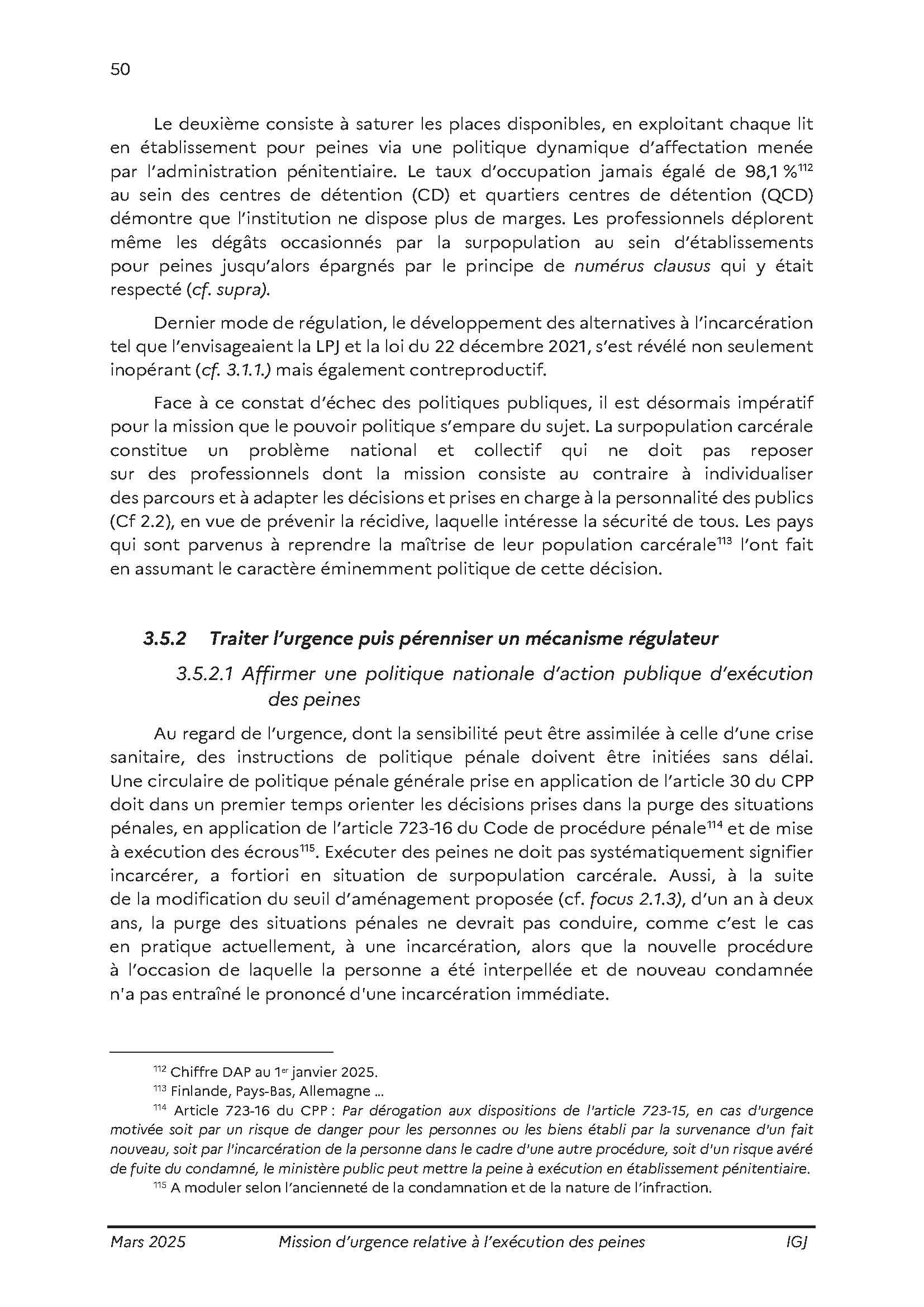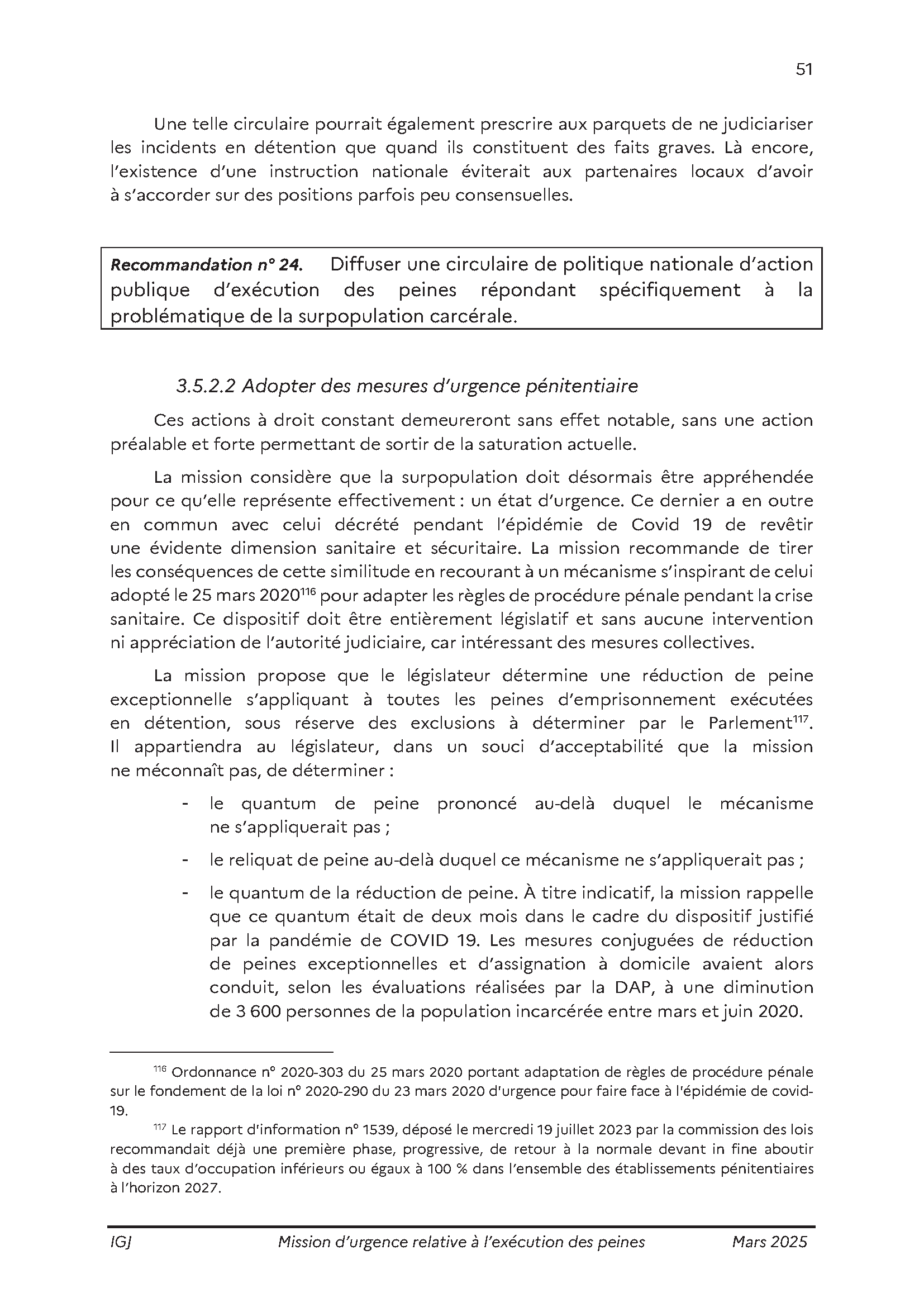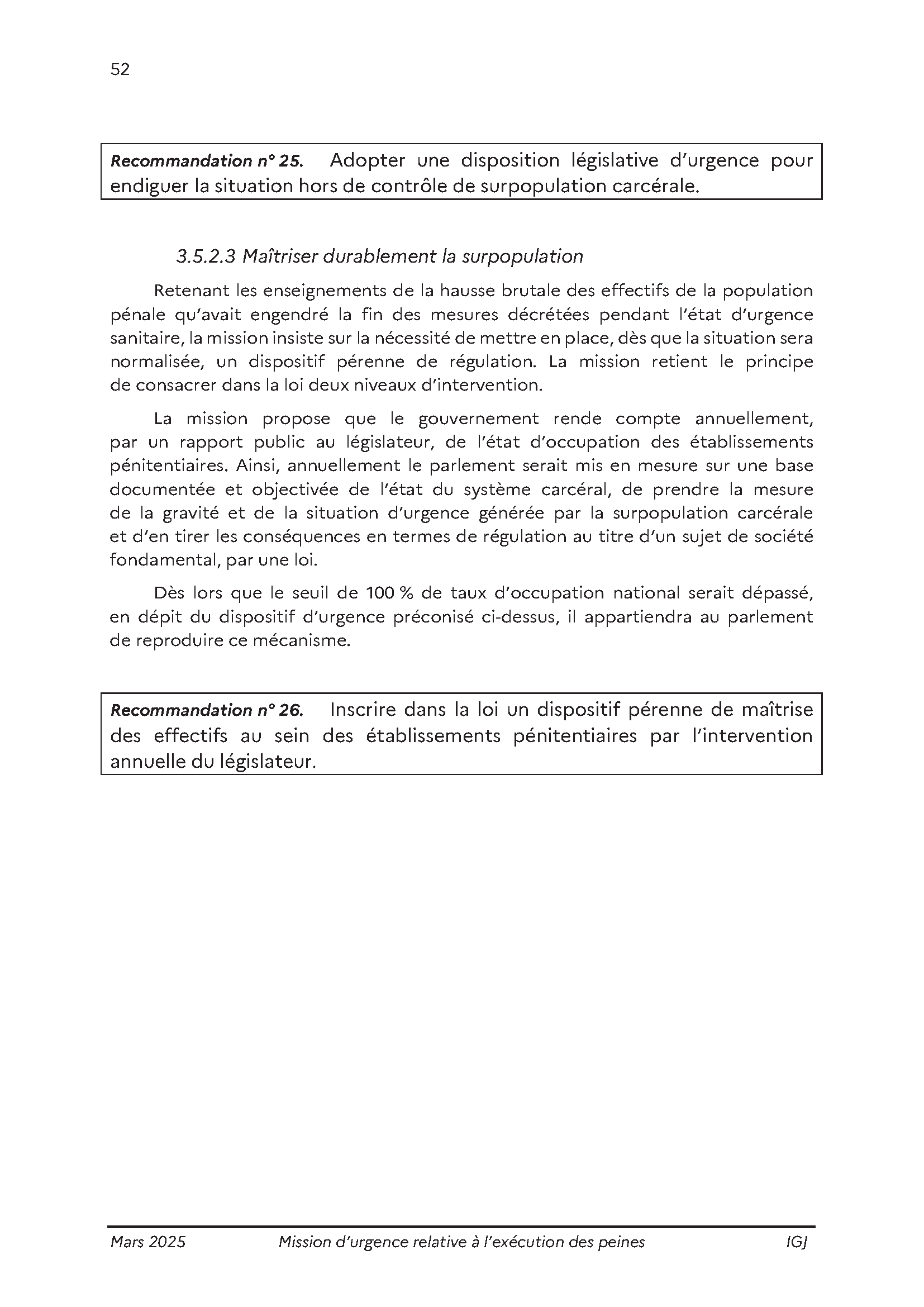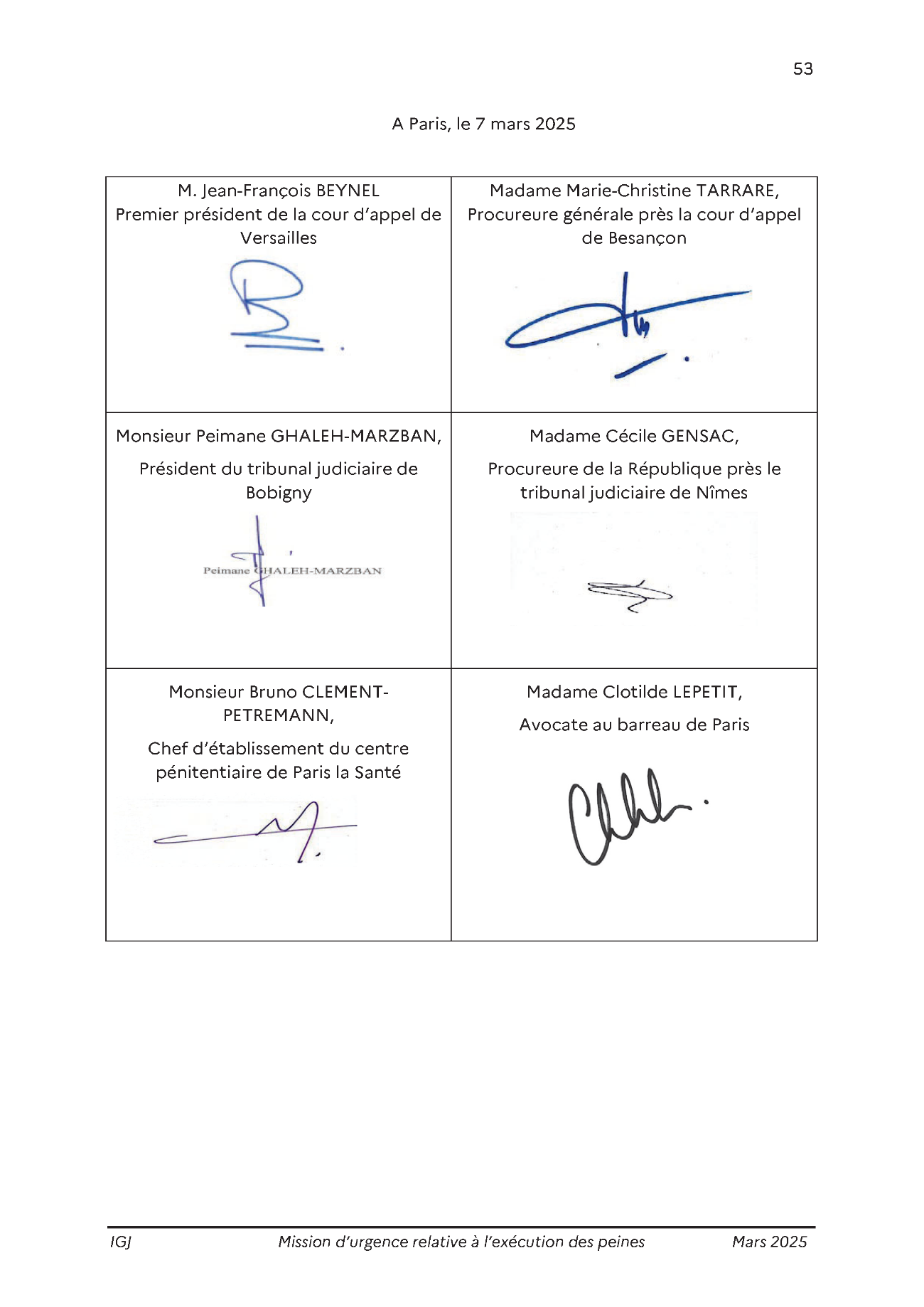- L'ESSENTIEL
- I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS
DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
- II. PLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA
PEINE
- III. JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE
- IV. ACCÉLERER L'EXÉCUTION DE LA PEINE
ET RENFORCER SON CONTRÔLE
- A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE
L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
- B. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA
PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET
EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS
- C. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES
À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE
LA PROBATION
- A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE
L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
- V. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES
CONDAMNÉS MINEURS
- I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS
DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
- LISTE DES PROPOSITIONS
- AVANT PROPOS
- I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE
INACCEPTABLE DÉFAILLANCE
- A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS
DÉBOUSSOLÉS
- 1. Une succession irréfléchie de
réformes contradictoires
- a) Un récent amoncellement de
réformes parfois contradictoires a aggravé
les modalités d'exécution des peines en France
- b) Le droit de l'application des peines
connaît en conséquence une complexification croissante, qui
altère la bonne exécution des peines
- c) L'impossible évaluation de
l'exécution des peines
- a) Un récent amoncellement de
réformes parfois contradictoires a aggravé
les modalités d'exécution des peines en France
- 2. Une chaîne d'acteurs variés et
dévoués, mais souvent dépassés
- a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens
de la peine
- (1) L'exécution de la peine relève
à titre principal du parquet
- (2) Un fonctionnement bousculé par le
partage croissant de l'aménagement des peines entre juge correctionnel
et juge de l'application des peines
- b) Les acteurs intervenant principalement en
post-sentenciel : des missions essentielles dont la
réalisation est obérée par un sentiment de
submersion
- (1) Les personnels de surveillance, dont le nombre
a crû moins rapidement que celui des détenus, assurent
l'exécution des peines d'emprisonnement
- (2) Les conseillers pénitentiaires
d'insertion et de probation, chevilles ouvrières surchargées de
l'individualisation et du suivi des peines
- (3) Des acteurs associatifs au rôle mal
défini, et donc variable
- c) Les forces de sécurité
intérieure : une participation à géométrie
variable, malgré des initiatives louables
- (1) Les forces de sécurité
intérieure sont, en théorie, un rouage essentiel de
l'exécution des peines
- (2) Deux brigades spécialisées
concourent à l'exécution des décisions de justice
- (3) Faute de moyens et d'un intérêt
pour les missions liées à l'exécution des peines,
l'investissement des forces de sécurité intérieure demeure
minimal
- a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens
de la peine
- 1. Une succession irréfléchie de
réformes contradictoires
- B. UNE SURPOPULATION CARCÉRALE
PARADOXALEMENT AGGRAVÉE PAR LES TENTATIVES DE « GESTION DES
FLUX »
- 1. Des prisons surpeuplées,
dégradées et insuffisamment différenciées
- a) La surpopulation carcérale : une
ampleur inédite, des conséquences dramatiques
- (1) La surpopulation carcérale, un mal
endémique
- (2) La création de nouvelles places
à l'épreuve du réel : un « plan
15 000 » contrarié, une administration qui peine
à recruter
- b) Des délais d'incarcération
excessifs pour les condamnés qui n'entrent pas immédiatement en
détention
- c) Des conditions de détention qui font
obstacle à la réinsertion des condamnés
- (1) L'insuffisante différenciation des
établissements pénitentiaires, obstacle à la
réinsertion
- (2) Des moyens faméliques de suivi, de
formation et de soin en détention
- a) La surpopulation carcérale : une
ampleur inédite, des conséquences dramatiques
- 2. Les aménagements de peine et la
libération sous contrainte : des solutions de
facilité ?
- a) Une logique de « gestion des
flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...
- b) ... qui favorise les sorties
« sèches » et prive la sanction de son sens
- (1) Les effets pervers des aménagements de
peine
- (2) La libération sous contrainte de plein
droit, facteur d'illisibilité sur le déroulé de la
peine et d'augmentation des « sorties
sèches »
- (3) Une rivalité objective entre LSC-D et
aménagements de fin de peine qui dégrade l'efficacité de
ces derniers dans la lutte contre la récidive
- (4) Une perte de sens
généralisée
- a) Une logique de « gestion des
flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...
- 1. Des prisons surpeuplées,
dégradées et insuffisamment différenciées
- C. LES PEINES ALTERNATIVES, PARENT PAUVRE DE LA
SANCTION
- 1. Les alternatives à la prison : une
exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à
une efficacité contestée et difficilement mesurable
- a) Une grande diversité de peines
permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de
la peine
- b) Une exécution complexe et partielle,
sans réels effets sur la réduction de la population
carcérale
- (1) Des outils peu mobilisés par les
magistrats malgré une volonté politique affichée
- (2) Le développement des peines
alternatives s'est fait sans effet de substitution sur la prison ferme
- c) Des ambitions contrariées par des
difficultés structurelles
- a) Une grande diversité de peines
permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de
la peine
- 1. Les alternatives à la prison : une
exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à
une efficacité contestée et difficilement mesurable
- D. LES MINEURS DÉLINQUANTS, DES
CONDAMNÉS COMME LES AUTRES ?
- 1. Un cadre pénal spécifique
- a) Un corpus juridique pour partie autonome
- b) Des acteurs spécialisés
- (1) Le rôle particulier du juge des enfants,
juge du fond et de l'application des peines
- (2) La protection judiciaire de la jeunesse,
actrice de l'exécution des peines
- c) Un droit commun de l'exécution des
peines aux conséquences particulièrement néfastes sur les
mineurs
- a) Un corpus juridique pour partie autonome
- 2. Les mineurs en milieu ouvert : des outils
insuffisamment mobilisables faute de moyens
- 3. Les mineurs en milieu fermé : des
affectations erratiques, un suivi lacunaire
- 1. Un cadre pénal spécifique
- A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS
DÉBOUSSOLÉS
- II. RÉFORMER SANS SURSEOIR : CINQ AXES
POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DES PEINES
- A. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS
DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
- B. REPLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA
PEINE
- C. JUGULER LA SURPOPULATION
CARCÉRALE
- 1. Créer une véritable peine de
probation
- 2. Faire enfin de la peine de prison ferme une
sanction efficace et dissuasive
- 3. Ne plus utiliser la fin de peine comme un
levier de régulation carcérale
- 4. Se donner les moyens d'un diagnostic objectif
de l'état du milieu fermé et de l'efficacité des peines
qui s'y accomplissent
- 1. Créer une véritable peine de
probation
- D. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE
LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE
- 1. Développer une culture de
l'exécution des peines au sein des forces de sécurité
intérieure
- 2. Accélérer l'exécution de
la peine en favorisant la présence du prévenu aux audiences
et en modernisant les voies de signification des jugements
- 3. Donner confiance dans les peines alternatives
à l'emprisonnement par l'accroissement des contrôles de
la probation
- 1. Développer une culture de
l'exécution des peines au sein des forces de sécurité
intérieure
- E. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES
CONDAMNÉS MINEURS
- A. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS
DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
- I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE
INACCEPTABLE DÉFAILLANCE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES EN
DÉPLACEMENT
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
- ANNEXE 1
LÉGISLATION COMPARÉE
NOTE SUR L'EXÉCUTION DES PEINES
- 1. 1. Tableau de synthèse
- 1. 2. Canada et province du Québec
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- (1) Les formes d'aménagement de peine et
les conditions pour en bénéficier
- (a) La libération d'office
- (b) La liberté conditionnelle
- (i) Au niveau fédéral
- (ii) Au Québec
- (c) La peine discontinue
- (d) La permission de sortir
- (i) Au niveau fédéral
- (ii) Au Québec
- (2) Les autorités compétentes
- (a) La libération d'office
- (b) La libération conditionnelle
- (c) La peine discontinue
- (d) La permission de sortir
- (3) Les statistiques disponibles en matière
d'aménagements de peines
- (a) Statistiques générales
- (b) Libération conditionnelle
- (c) La peine discontinue
- b) Les alternatives à
l'emprisonnement
- (1) Le sursis
- (2) Les travaux compensatoires
- (3) Le programme d'accompagnement justice et
santé mentale +
- c) Le recours à la justice
restaurative
- (1) Au niveau fédéral
- (2) Au Québec
- (a) La loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA)
- (b) Les programmes de réinsertion
- (c) Le programme de mesures de rechange
général
- (d) Les organismes indépendants
spécialisés
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- 3. Espagne
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- (1) Les formes d'aménagement de peine et
les conditions pour en bénéficier
- (a) La suspension de l'exécution de la
peine (articles 80 à 87 du code pénal)
- (b) La liberté conditionnelle (articles 90
à 92 du code pénal)
- (c) Les permissions de sortie (articles 47 et
48 de la loi organique générale pénitentiaire)
- (2) Les autorités compétentes
- (3) Les données statistiques
- b) Les alternatives à
l'emprisonnement
- (1) Le régime carcéral du
troisième degré, dit régime
« ouvert » (articles 80 à 88 du
règlement pénitentiaire)
- (2) Le travail d'intérêt
général (article 49 du code pénal)
- (3) La peine d'assignation à
résidence (article 37 du code pénal)
- (4) La liberté surveillée
(article 106 du code pénal)
- c) Le recours à la justice
restaurative
- (1) Principes, objectifs et cadre juridique
- (2) Acteurs et modalités de mise en
oeuvre
- (3) Typologie des délits et volume
d'activité
- (4) Effets, bénéfices et limites des
processus restauratifs
- (5) Perspectives d'évolution et
recommandations institutionnelles
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- 4. Italie
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- (1) Les formes d'aménagement de peine et
les conditions pour en bénéficier
- (a) Les permissions de sortie à titre de
récompense (articles 30-ter et 30-quater)
- (b) Le placement à l'épreuve
auprès des services sociaux (article 47)
- (c) La détention à domicile
(article 47-ter)
- (d) La semi-liberté
(article 48)
- (e) La libération anticipée
(article 54)
- (f) La suspension du procès avec mise
à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de
procédure pénale)
- (2) Les autorités compétentes
- (3) Les données statistiques
- b) Les alternatives à
l'emprisonnement
- (1) Un nouveau régime de peines
substitutives prononcées ab initio
- (2) Une réforme conçue pour faire
face à la crise de l'exécution pénale
- (3) Les limites du dispositif et les perspectives
d'amélioration
- c) Le recours à la justice
restaurative
- (1) Contexte et origine de la réforme
- (2) Esprit et contenu du décret de 2022
- (3) Principales dispositions et modalités
de fonctionnement de la justice restaurative
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- 5. Les Pays-Bas
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- (1) Les différentes formes
d'aménagement de peine
- (2) Les conditions pour bénéficier
d'un aménagement de peine
- (a) La libération conditionnelle
- (b) La permission de réinsertion
- (c) La permission de capacité sous
surveillance électronique
- (d) La détention à domicile dans le
cadre du programme pénitentiaire
- (3) Les autorités compétentes
- (a) La libération conditionnelle
- (b) Les permissions de réinsertion, de
capacité et le programme pénitentiaire
- (4) Les données statistiques
- b) Les alternatives à l'emprisonnement
- (1) Les amendes
- (2) Le travail d'intérêt
général
- (3) Les peines avec sursis
- (4) Les critiques relatives aux courtes peines
d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances
pénales
- c) Le recours à la justice
restaurative
- (1) La médiation restaurative
- (2) La médiation pénale
- (3) Les mesures de médiation et de
réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt)
- (4) L'évaluation du cadre de la politique
de justice restaurative en matière pénale
- a) Les règles d'aménagement des
peines d'emprisonnement ferme
- 1. 1. Tableau de synthèse
- ANNEXE 2
RAPPORT DE LA MISSION D'URGENCE RELATIVE
À L'EXÉCUTION DES PEINES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
- LE CONTRÔLE EN CLAIR
N° 2
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1)
sur
l'exécution des
peines,
Par Mmes Elsa SCHALCK, Laurence HARRIBEY et Dominique VÉRIEN,
Sénatrices
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
L'ESSENTIEL
L'exécution des peines s'est imposée depuis la fin des années 2000 comme un thème majeur du débat public. Alors que la part des citoyens qui estiment que la justice est « laxiste »1(*) atteint des niveaux préoccupants, la surpopulation carcérale est désormais hors de contrôle et atteste à l'inverse d'une sévérité croissante des lois pénales comme des juridictions chargées de les appliquer.
Ce paradoxe manifeste appelait une étude approfondie des règles applicables en matière d'exécution des peines ainsi que de leur mise en oeuvre concrète.
Afin d'évaluer la capacité de notre droit à remplir les fonctions traditionnelles de la peine, y compris la lutte contre la récidive et la réinsertion, la commission des lois a lancé une mission d'information transpartisane sur l'exécution des peines. À l'issue de leurs travaux, au cours desquels elles ont auditionné 75 personnes et conduit deux déplacements (dont un aux Pays-Bas), les trois rapporteures dressent un diagnostic alarmant : illisible, le droit de l'exécution des peines produit depuis plus de dix ans des effets inverses à l'intention du législateur au détriment des condamnés, des professionnels concernés et de la société dans son ensemble.
Pour ne pas réitérer les cinglants échecs du passé, la mission préconise un changement profond de philosophie. Ses propositions s'articulent autour de cinq axes directeurs : réaffirmer le sens de la peine auprès du condamné et de la société ; replacer la réinsertion au coeur de la peine ; juguler la surpopulation carcérale ; garantir l'exécution rapide et effective des sanctions pénales ; enfin, assurer un traitement adapté des mineurs condamnés.
I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
L'analyse de l'exécution des peines est obérée par des lacunes statistiques importantes, elles-mêmes liées à l'obsolescence ou à la complexité des applicatifs du ministère de la justice. Les rapporteures déplorent l'incapacité de l'administration à fournir des chiffres pourtant essentiels (en particulier l'ampleur des réductions de peine accordées aux détenus, les délais d'exécution des peines « alternatives » à l'incarcération à l'exception des travaux d'intérêt général ou encore les caractéristiques des peines réellement effectuées par les sortants de prison après 2020). Elles appellent le ministère à consentir les efforts requis pour que le législateur puisse enfin évaluer l'effet des lois en vigueur, condition impérative pour concevoir sereinement et sérieusement les réformes à venir.
A. GARANTIR UNE MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LES PEINES ENCOURUES, LES PEINES PRONONCÉES ET LEUR EXÉCUTION EFFECTIVE
L'érosion du sens de la peine que connaît aujourd'hui le système pénal français tient assez largement à l'incohérence qui s'est progressivement installée entre peine encourue, peine prononcée et peine exécutée. Aussi importe-t-il pour y remédier de renforcer la lisibilité et l'effectivité des sanctions pénales.
Les rapporteures ont observé une distorsion croissante entre le quantum des peines encourues et celui des peines effectivement prononcées, laquelle alimente, dans l'opinion publique, le sentiment d'une justice indulgente voire permissive. La mission recommande d'évaluer les causes des écarts entre les quantums encouru et prononcé pour rétablir la crédibilité de la sanction.
La quasi-unanimité des personnes entendues par les rapporteures a en outre vivement critiqué les récentes évolutions législatives en matière d'exécution des peines. Il en va spécialement ainsi du cadre de l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement. Celui-ci est désormais obligatoire pour peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué par principe pour les peines d'emprisonnement de six mois à un an. Cette réforme a eu l'effet pervers d'inciter les magistrats à alourdir les peines prononcées pour contourner les effets attachés à ces seuils. La mission recommande en conséquence de supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et de le rendre possible, dès lors que le juge dispose d'éléments suffisants sur la personnalité et la situation du condamné, pour toutes les peines de moins de deux ans. Suivant la même logique, elle préconise d'écarter les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge du fond lorsqu'il n'entend pas aménager la peine.
B. RÉINTRODUIRE LES TRÈS COURTES PEINES, LEVIERS D'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE
La politique pénale française se caractérise par un allongement continu de la durée moyenne des incarcérations - 11,3 mois en moyenne, contre 4,6 en Allemagne -, sans effet tangible sur la récidive ni sur la surpopulation carcérale. Ce paradoxe fragilise la lisibilité et l'efficacité de la réponse pénale.
Les courtes peines, c'est-à-dire les peines d'un à six mois, posent, quant à elle, de sérieuses difficultés : alors qu'elles entraînent bien souvent un effet désocialisant majeur (perte d'emploi, rupture familiale), elles restent trop brèves pour permettre un véritable accompagnement par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et sont en conséquence inefficaces en matière de réinsertion.
Dans ce contexte, la réintroduction de très courtes peines d'emprisonnement, c'est-à-dire les peines inférieures ou égales à un mois, qui avaient été supprimées en 2019, offre une véritable alternative. Leur exécution rapide et brève permettrait de produire un « choc carcéral » dissuasif sans rompre les attaches sociales ni compromettre l'insertion professionnelle. Les travaux de la mission et les comparaisons internationales montrent que ces peines, si elles sont exécutées dans des établissements spécialisés et réservées à des publics spécifiques - jeunes délinquants ou personnes insérées socialement, mineurs en situation de crise -, peuvent prévenir l'ancrage dans la délinquance et éviter l'« escalade » vers des peines plus longues.
C. PROMOUVOIR UNE INDIVIDUALISATION DES PEINES PLUS EFFECTIVE
L'individualisation des peines, qui constitue l'un des ressorts fondamentaux du régime d'exécution de ces dernières, est actuellement dévoyée pour des raisons tant juridiques que pratiques.
Il apparaît tout d'abord que les acteurs de l'exécution des peines ne disposent pas d'un renseignement suffisant sur la personnalité des condamnés, ce qui altère par définition les capacités d'individualisation des peines du système pénal français. La mission recommande donc de veiller à la qualité de la décision d'individualisation, grâce à une plateforme pluridisciplinaire garantissant une meilleure connaissance par le juge de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle.
Fait également obstacle à la juste individualisation des peines l'insuffisante connaissance que les différents acteurs ont de leurs fonctions respectives. Ce phénomène est flagrant pour les SPIP, dont les juridictions de jugement connaissent insuffisamment les compétences, alors qu'ils sont un maillon crucial du dispositif pénal. La mission préconise ainsi de clarifier les rôles respectifs des différents acteurs de la chaîne pénale.
Enfin, compte tenu de l'insuffisante connaissance de la personnalité des condamnés et de la surpopulation carcérale, les détenus sont rarement incarcérés dans un établissement qui correspond à leur situation ou à leur profil. Les affectations en quartier de semi-liberté servent par exemple souvent à contenir la surpopulation d'une maison d'arrêt, à rebours de la vocation de préparation à la sortie de ces structures. La mission insiste donc sur la nécessité de garantir une adéquation entre la nature des établissements d'incarcération et la personnalité des détenus ; elle encourage le développement des quartiers ou établissements spécialisés qui obéissent à cette logique - quartiers de lutte contre la criminalité organisée, programme InSERRE, etc.
II. PLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA PEINE
A. DONNER À L'INCARCÉRATION UNE FINALITÉ CONSTRUCTIVE
La mission a dressé un constat sans appel sur les moyens dédiés au suivi des détenus : ces moyens sont faméliques et ne permettent pas une exécution correcte des peines de prison ferme. Elle appelle ainsi à une augmentation des effectifs des SPIP, corollaire indispensable des missions que ceux-ci doivent investir ou réinvestir : retour à un ratio de 60 dossiers par conseiller, conformément aux standards européens ; repositionnement de l'intervention des SPIP en pré-sentenciel, pour nourrir l'enquête sociale grâce à laquelle le juge du fond pourra individualiser la peine et, le cas échéant, l'aménager ; intégration des SPIP à l'intérieur des juridictions, quand, aujourd'hui, leurs locaux sont éloignés des tribunaux et vétustes ; établissement d'une doctrine mieux adaptée au milieu fermé...
Les rapporteures ont également confirmé que l'accès aux soins en détention se heurtait à de lourdes difficultés. Tel est singulièrement le cas en santé mentale, alors même que certaines analyses évaluent à plus de 50 % la proportion de détenus atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques. La mission propose, dès lors, plusieurs mesures pour faciliter l'accès aux soins en prison, notamment en ce qui concerne la médecine spécialisée, la santé mentale et les troubles addictifs.
B. DONNER UN VÉRITABLE CONTENU AUX PEINES ALTERNATIVES
Les peines alternatives à l'incarcération, dont le développement a été amorcé au cours des années 1970, occupent désormais une place centrale dans la justice pénale. Ayant vocation à se substituer à la peine principale d'emprisonnement lorsque celle-ci apparaît inutilement désocialisante, elles permettent théoriquement de concourir à l'application du principe d'individualisation de la peine. Cet objectif est favorisé par la grande diversité des peines alternatives qui coexistent aujourd'hui : détention à domicile sous surveillance électronique, jours-amende, stages, peines privatives ou restrictives de liberté, travail d'intérêt général ou peine de sanction-réparation.
Pour autant, malgré les prometteuses perspectives offertes par le développement des peines alternatives, leur portée reste limitée, en raison d'une crédibilité qui demeure fragile. En conséquence, et en dépit d'une volonté politique constamment réaffirmée par les gouvernements successifs, les peines alternatives demeurent des outils peu mobilisés par les magistrats, représentant à ce jour moins de 20 %2(*) des peines principales prononcées. Leur mise en oeuvre est jugée trop lente, leur contenu trop léger et leur exécution insuffisamment contrôlée. Dans ces conditions, elles peinent à apparaître comme de véritables sanctions, distinctes de la prison mais également efficaces.
Évolution du nombre de peines alternatives prononcées sur le total des peines prononcées
Source : commission des lois, d'après les
données du ministère de la justice
(Références
statistiques justice et Annuaires statistiques justice 2011-2024)
Pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle, il est nécessaire de leur donner une assise plus solide. Elles devraient être immédiatement exécutées, comporter des obligations adaptées et exigeantes, et s'inscrire dans un cadre clair pour le condamné comme pour la société. Les rapporteures appellent plus particulièrement à la prudence dans le recours à la DDSE, devenue une réponse par défaut et pâtissant d'un appauvrissement de son contenu et d'un suivi moins qualitatif. Elles recommandent ainsi de lui redonner une véritable consistance et, à défaut, de ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.
III. JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE
La surpopulation carcérale a atteint, au cours de l'année 2025, une ampleur inédite. Au 5 juin 2025, les prisons françaises comptaient 84 363 détenus, en augmentation de plus de 6 000 détenus en une année, pour une capacité opérationnelle de seulement 62 566 places ; plus de 5 000 détenus dorment sur des matelas placés à même le sol.
Mère de toutes les batailles, la lutte contre la surpopulation carcérale ne peut plus être menée selon la logique de « gestion des flux » qui a prévalu jusqu'à ce jour et dont l'inefficacité est désormais prouvée. Ni le développement des aménagements ab initio à compter de 20203(*), ni la mise en place d'un mécanisme de libération sous contrainte automatique (dit « de plein droit ») en fin de peine en 20214(*) n'ont atteint les résultats escomptés. Pire, leurs effets pervers n'ont qu'aggravé la surpopulation carcérale. Quant aux tentatives de régulation carcérale « souple » menées dans certains territoires, elles se sont avérées improductives. Pour concilier la dignité des détenus avec la nécessaire sévérité attendue des peines de prison ferme, la mission propose de tourner le dos aux solutions quantitatives et de rendre sa lisibilité au droit de l'exécution des peines.
A. CRÉER UNE VÉRITABLE PEINE DE PROBATION
Les travaux des rapporteures ont montré que les magistrats préféraient prononcer des peines de prison ferme, y compris en les aménageant dès le jugement, plutôt que de faire le choix d'une peine de milieu ouvert. Leur choix s'explique notamment par l'insuffisante crédibilité des sanctions alternatives à la détention. Résoudre cette difficulté passe, comme le Sénat le recommande depuis 2018, par la création d'une peine autonome de probation permettant de sanctionner efficacement des condamnés qui, aujourd'hui envoyés en prison en raison non pas de la gravité de l'infraction ou du risque de récidive, mais de leur profil lourdement désocialisé (absence de garanties de représentation, troubles psychiatriques...), pourraient être plus longuement suivis et plus efficacement punis en dehors de la détention.
Hautement personnalisable, la peine de probation offrirait au juge du fond une large palette de mesures contraignantes (cf. schéma ci-contre5(*)), garantissant un suivi étroit et - surtout - le placement immédiat du condamné en détention dès lors qu'il ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
B. ROMPRE AVEC LA LOGIQUE DE « GESTION DES FLUX »
Les rapporteures proposent par ailleurs de rompre avec la logique de « gestion des flux » dont l'échec est aujourd'hui patent.
Leurs propositions supposent que les capacités opérationnelles du système carcéral français soient enfin mises à niveau. La mission appelle à achever le « plan 15 000 », lancé en 2017 par le Président de la République avec pour objectif de mettre en service 15 000 places de détention supplémentaires, sans nouveau retard, donc au plus tard en 2031. Cette avancée est nécessaire, mais non suffisante : au vu de la saturation des prisons françaises, le « plan 15 000 » est, en effet, déjà obsolète et ne permettrait pas d'absorber le niveau actuel d'occupation des établissements pénitentiaires.
La mission a par ailleurs constaté que la libération sous contrainte de plein droit (LCS-D) était un facteur de moindre prévisibilité de la date de fin de peine, d'augmentation des « sorties sèches » qui favorisent la récidive, de perte de sens pour les condamnés du fait de son automaticité et de moindre efficacité des aménagements, le taux d'échec (donc de réincarcération) ayant cru avec la mise en place de ce nouveau mécanisme. Par ailleurs, accordée à « seulement » 63 % des détenus alors qu'elle devait profiter à tous, sauf en l'absence de solution d'hébergement, la LSC-D a été impuissante à lutter contre la surpopulation carcérale. Les rapporteures en proposent par conséquent la suppression avec, en contrepartie, un élargissement des dispositifs reposant sur des critères individuels pour faciliter la remise en liberté des détenus faisant preuve d'un bon comportement ou manifestant des efforts sérieux de réinsertion.
IV. ACCÉLERER L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE
A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Les rapporteures regrettent que les forces de sécurité intérieure, auxquelles le code de procédure pénale confie de nombreuses tâches liées à l'exécution des peines, ne puissent, en raison d'une forte mobilisation sur les missions de voie publique et de police judiciaire, s'investir davantage dans ces tâches autrement qu'en cas de difficulté de signification des jugements.
Au-delà des enjeux liés aux moyens alloués aux forces de sécurité intérieure, et sans qu'une réforme législative ne soit nécessaire, les rapporteures appellent à un changement de culture en leur sein, par exemple par le biais d'une circulaire ministérielle, a minima pour que ces dernières aient pleinement conscience que les missions liées à l'exécution des peines font partie intégrante de leur coeur de métier, en sus et non en concurrence avec les missions de voie publique et de police judiciaire. En outre, il serait souhaitable qu'une véritable ligne directrice soit définie quant au contrôle de l'exécution des peines, notamment des peines alternatives à l'emprisonnement, qui s'opère concrètement sous la forme de contrôles fortuits.
B. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS
Alors que plus de 20 % des jugements rendus par les tribunaux correctionnels le sont en l'absence du prévenu, il appert que ce dernier a de facto intérêt à ne pas se présenter afin d'en freiner l'exécution puisque les jugements sont proportionnellement davantage exécutés lorsque le prévenu se présente aux audiences. Le taux d'exécution à 5 ans des jugements contradictoires à signifier n'atteint que de 76 % en 2024, contre 95 % pour les autres types de jugements.
En effet, la présence du prévenu aux audiences permet - notamment - de respecter les exigences liées au principe du contradictoire et ainsi de rendre exécutoire la décision de l'autorité judiciaire. Outre qu'elle facilite la signification du jugement et évite la mobilisation des forces de sécurité intérieure, la présence du prévenu aux audiences permet aussi sa prise en charge rapide une fois sa condamnation acquise, puisqu'il peut être reçu physiquement par le bureau de l'exécution des peines afin que lui soit présenté son parcours judiciaire.
L'un des moyens pour accélérer l'exécution des peines est donc d'améliorer l'information des prévenus, aussi bien en amont pour qu'il soit présent lors des audiences, qu'en aval pour que les jugements contradictoires à signifier soient transmis avec célérité. L'objectif est ainsi d'éviter que le prévenu ait intérêt à ne pas se présenter à l'audience, d'une part, ou à développer une stratégie d'évitement de la signification du jugement, d'autre part.
Sur le premier point, la mission d'information fait sienne la suggestion émise par la mission d'urgence sur l'exécution des peines, consistant à généraliser et étendre, notamment au stade pré-sentenciel, le rappel automatique et dématérialisé des dates d'audiences et des convocations, qui est actuellement expérimenté dans un peu moins d'une centaine de tribunaux judiciaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Sur le second point, les rapporteures partagent le constat assez unanime quant à l'inadaptation du cadre juridique régissant les voies de signification des jugements, notamment aux fins de les rendre exécutoires. Elles appellent donc à ce que la réflexion sur la modernisation des voies de signification des jugements soit poursuivie, voire accélérée, en ciblant davantage la participation des forces de sécurité intérieure à cette mission du service public de la justice et en considérant que, sauf mention contraire, le consentement à la transmission dématérialisée des documents judiciaires est réputé acquis. En outre, pour inciter le prévenu à se rendre aux audiences, il pourrait être donné à la décision d'emprisonnement ferme inférieur à un an non aménagé la valeur d'un ordre de recherche et d'arrestation à destination des officiers de police judiciaire.
C. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE LA PROBATION
Les travaux de la mission ont mis en évidence la persistance d'un recours préférentiel à l'emprisonnement par les magistrats, lié à une confiance limitée dans l'effectivité des peines alternatives. Sur les quatre dernières décennies, la population française a en effet progressé de 20 %, tandis que la population détenue augmentait de 107 % et que celle suivie en milieu ouvert connaissait une croissance de 200 %6(*).
La réduction durable de la population carcérale suppose pourtant le développement des sanctions exécutées en milieu ouvert, lorsque la situation de la personne condamnée le permet. À cette fin, il importe de renforcer la crédibilité de ces mesures en garantissant leur bonne exécution.
Pour ce faire, et en pleine cohérence avec la mise en place d'une peine autonome de probation, les rapporteures préconisent de renforcer le contrôle des mesures de probation et autres peines alternatives à l'emprisonnement, notamment à travers la création d'une police de la probation ou par la spécialisation d'agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur les fonctions de probation. La mission de cette police ou de ces agents serait centrée sur le contrôle du respect des obligations des personnes condamnées, via par exemple des contrôles physiques sur le lieu de travail ou le domicile et en assurant une articulation entre les services pénitentiaires et les services de police et de gendarmerie.
V. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES CONDAMNÉS MINEURS
Soumis à des principes spécifiques de droit pénal et généralement jugés, puis suivis par des professionnels spécialisés (juge des enfants et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse) dans des structures, établissements ou quartiers dédiés, les mineurs condamnés ont toutefois un point commun d'importance avec les majeurs : un manque partagé de moyens en matière de suivi, de soins et de lutte contre la récidive. Alors que la délinquance des mineurs grandit en violence autant qu'elle se rajeunit, la situation appelle des propositions particulières, adaptées au profil des jeunes délinquants.
A. CONSTRUIRE POUR LES MINEURS CONDAMNÉS UN PARCOURS ÉDUCATIF ET RESPONSABILISANT
La justice pénale des mineurs privilégie une finalité éducative où l'incarcération demeure exceptionnelle. Elle s'appuie principalement sur des mesures éducatives judiciaires prévues par le code de la justice pénale des mineurs, qui offrent un accompagnement adapté aux besoins des jeunes auteurs d'infractions, en associant modules d'insertion, réparation, suivi sanitaire ou placement éducatif, assortis d'obligations et d'interdictions encadrant leur comportement. Des sanctions pénales classiques exécutées en milieu ouvert peuvent parallèlement être prononcées, à l'instar des Tig.
Pour autant, initialement conçus pour accueillir prioritairement les mineurs multirécidivistes, les centres éducatifs fermés (CEF) tendent, au fil du temps, à s'imposer comme une modalité de placement par défaut, y compris pour des jeunes dont la situation ne correspond pas à leur vocation initiale. Cette évolution, qui s'est traduite parallèlement par un net recul de l'hébergement diversifié, fragilise l'équilibre du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse et restreint la capacité des magistrats à mobiliser une palette de réponses véritablement adaptées aux profils des mineurs.
Afin de préserver la diversité des prises en charge et d'éviter que les CEF ne se substituent indûment aux autres formes de placement, la mission juge nécessaire de renforcer les alternatives existantes et de recentrer les CEF sur leur mission première : la prise en charge des mineurs durablement ancrés dans la délinquance.
Cette exigence de clarification des missions des CEF s'inscrit d'autant plus dans l'actualité qu'aucun bilan d'ensemble n'a été conduit près de vingt ans après leur création. Or, les constats de la mission mettent en évidence des fragilités préoccupantes : pilotage insuffisant, contrôles rares et durées de placement généralement inférieures au seuil de six mois, pourtant jugé indispensable pour garantir un véritable travail éducatif et pour lutter contre la récidive.
La mission relève enfin la persistance de carences graves dans l'accompagnement éducatif et psychologique des mineurs placés. Les obligations minimales d'enseignement sont rarement respectées et la présence de psychologues demeure trop irrégulière, alors même que ces jeunes cumulent fragilités scolaires, familiales et sanitaires. Dans ces conditions, il est impératif de garantir sans délai une prise en charge à la hauteur des besoins, notamment par l'affectation systématique de psychologues dans chaque structure et par le respect strict des normes en matière de scolarisation.
B. RÉÉQUILIBRER LES MOYENS ENTRE LES STRUCTURES DE MILIEU FERMÉ
Les mineurs incarcérés, peu nombreux (327 condamnés détenus au 1er décembre 2024, soit environ 40 % du total des mineurs détenus, les 60 % étant des mineurs prévenus, donc non encore condamnés), sont affectés dans des quartiers « mineurs » (QM) ou dans des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) permettant une séparation d'avec les détenus majeurs. Ils ne sont pas frappés par la surpopulation carcérale : le taux d'occupation moyen y était de 62 % au 1er janvier 2024, ce qui ne doit pas dissimuler de fortes disparités selon les territoires (les structures d'Île-de-France sont saturées, obligeant à éloigner les mineurs détenus de leur domicile et donc de leur famille).
Outre des lacunes communes avec celles observées dans les structures pour majeurs (affectation ne tenant pas compte du profil des condamnés, suivi lacunaire en matière scolaire et sanitaire...), les QM et EPM présentent une particularité : celle d'une divergence substantielle de prise en charge, attestée par des coûts allant du simple au quadruple (144 euros par jour en QM, contre 601 euros en EPM), alors même que rien n'indique une différence des profils entre les mineurs incarcérés dans les premiers ou les seconds. C'est pourquoi la mission d'information réclame que soit conduite une évaluation des QM et des EPM, en vue de procéder à un rééquilibrage entre ces deux types de structures.
Les effets de la LCS-D, délétères pour les majeurs, ayant été dévastateurs pour les mineurs au vu de la durée généralement plus courte de leurs peines, les rapporteures estiment que la fin de peine doit faire l'objet d'une vigilance accrue pour les jeunes détenus : elles proposent à ce titre un recours accru aux aménagements sous forme de stages, de Tig ou de mesures éducatives pour favoriser la réinsertion des mineurs.
LISTE DES PROPOSITIONS
1. GARANTIR UNE MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LES PEINES ENCOURUES, LES PEINES PRONONCÉES ET LEUR EXÉCUTION EFFECTIVE
Rétablir la signification de la sanction prononcée
Proposition n° 1 : Rapprocher le prononcé des peines de leur exécution effective en limitant les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge correctionnel.
Proposition n° 2 : Supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et les rendre possibles pour le juge du fond, sur la base d'une enquête sociale étayée, pour toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à deux ans.
Réajuster le quantum des peines prononcées au regard du quantum encouru
Proposition n° 3 : Évaluer les causes d'écart entre le quantum encouru et le quantum prononcé, afin de renforcer la crédibilité de la sanction.
2. RÉINTRODUIRE LES TRÈS COURTES PEINES, LEVIERS D'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE
Proposition n° 4 : Rétablir la possibilité, pour le juge du fond, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, ces très courtes peines étant destinées aux condamnés bien insérés et non encore ancrés dans la délinquance, mineurs comme majeurs, et exécutées dans des établissements spécialisés.
3. PROMOUVOIR UNE INDIVIDUALISATION DES PEINES PLUS EFFECTIVES
Garantir les moyens matériels de l'individualisation des peines
Proposition n° 5 : Assurer l'adéquation entre l'établissement d'incarcération et la personnalité des personnes détenues pour favoriser leur réinsertion en sortie de peine.
Améliorer les décisions relatives à l'individualisation des peines
Proposition n° 6 : Favoriser la meilleure individualisation de la peine et de son exécution en acquérant une meilleure connaissance de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle, grâce au renforcement du rôle des SPIP en phase pré-sentencielle.
Proposition n° 7 : Clarifier les rôles respectifs du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
4. DONNER À L'INCARCÉRATION UNE FINALITÉ CONSTRUCTIVE
Renforcer la présence et la formation des personnels pénitentiaires
Proposition n° 8 : Accroître les moyens humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de réduire le nombre de personnes suivies par conseiller et d'assurer un accompagnement social et professionnel adapté.
Proposition n° 9 : Unifier la doctrine d'intervention des associations d'accompagnement social en détention, afin de réduire les disparités territoriales constatées par la mission.
Garantir une prise en charge sanitaire digne et effective
Proposition n° 10 : Assurer un accès effectif à la santé en détention en :
- développant les partenariats avec les hôpitaux pour des interventions, dans la mesure du possible, au sein des établissements pénitentiaires pour la médecine spécialisée ;
- fixant les effectifs des unités sanitaires non pas selon le nombre théorique de places, mais selon la moyenne d'occupation des cinq dernières années ;
- garantissant la prise en charge de la santé mentale et des troubles addictifs, avec la présence permanente de professionnels dédiés auprès des détenus et de l'administration pénitentiaire.
5. DONNER UN VÉRITABLE CONTENU AUX PEINES ALTERNATIVES
Proposition n° 11 : Redonner une véritable consistance à la détention à domicile sous surveillance électronique et, à défaut, ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.
6. CRÉER UNE VÉRITABLE PEINE DE PROBATION
Proposition n° 12 : Créer une peine autonome de probation.
7. FAIRE ENFIN DE LA PEINE DE PRISON FERME UNE SANCTION EFFICACE ET DISSUASIVE
Proposition n° 13 : Mener à bien le « plan 15 000 », en s'interdisant tout nouveau retard et en tenant compte de la nécessaire diversification des établissements en fonction des profils des détenus.
8. NE PLUS UTILISER LA FIN DE PEINE COMME UN LEVIER DE RÉGULATION CARCÉRALE
Proposition n° 14 : Mettre fin à la libération sous contrainte de plein droit pour privilégier des mécanismes individuels, tenant compte des efforts accomplis par le condamné pendant sa détention.
En contrepartie, faciliter les aménagements, conversions, placements en semi-liberté en fin de peine par les JAP, ainsi que l'octroi des réductions de peine, sur une base individuelle.
9. SE DONNER LES MOYENS D'UN DIAGNOSTIC OBJECTIF DE L'ÉTAT DU MILIEU FERMÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES PEINES QUI S'Y ACCOMPLISSENT
Proposition n° 15 : Garantir la pleine information du Parlement et du grand public sur l'occupation des prisons, les causes de son évolution et l'effet de l'emprisonnement sur le parcours pénal des condamnés.
10. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS
Proposition n° 16 : Généraliser le mécanisme de rappel des convocations devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'étendre dès que possible au stade pré-sentenciel.
11. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE LA PROBATION
Proposition n° 17 : Créer une police de la probation ou spécialiser certains agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur le contrôle des mesures de probation.
12. CONSTRUIRE POUR LES MINEURS CONDAMNÉS UN PARCOURS ÉDUCATIF ET RESPONSABILISANT
Proposition n° 18 : Développer les possibilités de placement hors centre éducatif fermé (CEF) et recentrer ces derniers sur le placement des mineurs ancrés dans la délinquance.
Proposition n° 19 : Garantir une durée de placement en CEF de six mois au moins, en élargissant le recours à ces centres en fin de peine de prison, voire en envisageant une extension de leur utilisation en tant que sanction ou comme équivalent de semi-liberté.
13. RÉÉQUILIBRER LES MOYENS ENTRE LES STRUCTURES DE MILIEU FERMÉ
Proposition n° 20 : Opérer un rééquilibrage entre quartiers « mineurs » et établissements pour mineurs, fondé sur une évaluation précise de leur fonctionnement actuel.
AVANT PROPOS
« Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. »
Montesquieu, De l'esprit des lois7(*)
La crise profonde qui touche l'institution judiciaire depuis plusieurs années est désormais abondamment documentée. Juridictions sous tension, voire débordées, dans lesquelles les délais s'allongent en tous domaines ; défiance croissante des citoyens qui, selon la dernière étude conduite par le Sénat, estiment pour 68 % d'entre eux que la justice est « laxiste »8(*) ; surpopulation carcérale hors de contrôle, avec des niveaux records atteints en 2025 ; interrogations récurrentes sur l'efficacité du système pénal sous l'effet d'une expansion des formes de délinquance les plus violentes (crimes et délits à caractère sexuel, criminalité organisée...) et d'une multiplication des infractions graves commises pour des motifs futiles, voire dérisoires : le diagnostic est préoccupant et met en cause, pour une large partie, les modalités d'exécution des peines en France.
Cette exécution est en effet au coeur des cinq fonctions que la doctrine accorde traditionnellement à la sanction pénale :
- la rétribution (donc la punition du condamné), qui n'est assurée que si la peine est réellement - et rapidement - exécutée ;
- la neutralisation du condamné, qui suppose qu'il soit placé sous main de justice pendant un délai suffisant pour garantir la protection de la société ;
- la dissuasion (à la fois vis-à-vis du condamné - ce qui renvoie à la lutte contre la récidive - et de la société dans son ensemble), qui implique des peines suffisamment sévères par leur exemplarité non seulement dans leur prononcé, mais surtout dans leur exécution ;
- la réinsertion du condamné qui repose, pour une large partie, sur les efforts effectués par ce dernier au cours de sa peine, si bien que les modalités d'exécution de celle-ci doivent contribuer à son amendement ;
- enfin, la protection des intérêts de la victime, qui ne saurait aller sans une véritable lisibilité de la peine et de ses modalités d'exécution.
C'est pour évaluer l'efficacité du droit actuel et de sa mise en oeuvre dans l'atteinte de ces objectifs que la commission des lois a lancé, en février 2024, une mission d'information sur l'exécution des peines dont la responsabilité a été confiée aux trois rapporteures Elsa Schalck, Laurence Harribey et Dominique Vérien. Celles-ci se sont attachées à mener un contrôle complet de la mise en oeuvre des sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté9(*), prononcées à l'encontre des personnes physiques, mineures comme majeures, en matières correctionnelle et criminelle.
À l'issue de leurs réflexions - nourries par 21 auditions qui leur ont permis d'entendre 75 personnes, et par deux déplacements, dont l'un aux Pays-Bas -, les rapporteures n'ont pu que constater que l'exécution des peines restait un pan largement sinistré du système pénal français et ce, en dépit des nombreuses initiatives du législateur en la matière depuis une dizaine d'années.
Alors que deux lois d'orientation et de programmation pour la justice ainsi qu'un nombre conséquent de lois pénales ont été adoptées depuis l'adoption en 2018 du rapport d'information de la commission des lois « Nature, efficacité et mise en oeuvre des peines : en finir avec les illusions ! »10(*), la mission d'information aurait en effet pu reprendre à son compte la quasi-intégralité de ses conclusions. « Droit des peines devenu illisible », exécution des peines « déconnectée de leur prononcé », « instrumentalisation des aménagements de peine » (et plus largement de tous les leviers d'exécution) pour lutter contre la surpopulation carcérale, « défaillance systématique dans l'évaluation de l'efficacité des peines » : ces formules demeurent d'une troublante actualité, ce qui atteste que les réformes récemment conduites ont fait long feu.
La France, pour autant, n'est pas un pays laxiste. Les chiffres montrent qu'elle se distingue par un fort taux de répression, traduit par l'extension continue de ce qui est communément appelé le « filet pénal » puisque cette extension concerne tant le milieu fermé que le milieu ouvert. Notre pays est, ainsi, à la fois l'un de ceux qui incarcèrent le plus en Europe, mais aussi l'un des premiers aux classements sur le taux de probation (donc de recours aux mesures de milieu ouvert) ; les sanctions y sont par ailleurs rigoureuses, puisque l'emprisonnement constituait une large part (48 %) des condamnations définitives prononcées en 2021 par les juridictions correctionnelles et criminelles.
Ce paradoxe, selon lequel, en dépit de peines statistiquement fréquentes et sévères, la justice reste perçue comme indulgente, voire permissive à l'encontre des délinquants, s'explique à l'évidence par un décalage entre les sanctions prononcées et la réalité de leur exécution. Ce décalage est de nature à miner la confiance des citoyens envers les institutions, c'est-à-dire non seulement la justice, mais aussi le législateur - Gouvernement et Parlement - qui n'a pas su trouver la réponse idoine pour faire exécuter les peines. Il ne saurait être plus longtemps toléré.
Les multiples difficultés recensées par la mission ne seront pas résorbées par des mesures strictement quantitatives ou capacitaires qui, pratiquées par le passé, ont toutes connu de cinglants échecs. L'état dégradé de l'exécution des peines appelle, tout à l'inverse, un changement profond de philosophie.
C'est dans cet état d'esprit que la mission d'information a élaboré, au terme de ses travaux, 20 propositions articulées autour de cinq principes directeurs : réaffirmer le sens de la peine auprès du condamné et de la société ; replacer la réinsertion au coeur de la peine ; juguler enfin la surpopulation carcérale ; garantir l'exécution rapide et effective des sanctions pénales ; assurer un traitement adapté des mineurs condamnés.
I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE INACCEPTABLE DÉFAILLANCE
L'exécution des peines en matière pénale concerne les modalités selon lesquelles sont mises en application les sanctions pénales prononcées par les juridictions. Son lien avec la peine elle-même ou les procédures ayant conduit à son prononcé est donc réel, mais indirect.
Les sanctions pénales peuvent connaître plusieurs formes d'exécution. Outre le cas où elles sont mises en oeuvre d'une manière en tout point conforme à la décision du juge du fond - cette hypothèse étant de plus en plus rare, à l'exception notable mais marginale de la perpétuité réelle -, elles peuvent ainsi faire l'objet :
- d'un aménagement, mesure qui ne concerne que la peine de prison ferme et par laquelle il est décidé, à quelque stade de l'exécution de la peine que ce soit (dès la condamnation, pendant l'exécution ou en fin de peine), que la peine sera exécutée en-dehors de la détention, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une semi-liberté ;
- d'une conversion, qui permet de faire exécuter la peine de prison ferme (ou son reliquat) de moins de six mois sous la forme d'un sursis probatoire avec suivi renforcé, de jours-amende, d'un travail d'intérêt général ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
- d'une suspension ou d'un fractionnement, lorsque la peine de prison ferme (ou son reliquat) est inférieure à deux ans.
La question de l'exécution des peines recouvre donc des sujets divers : elle interroge l'effectivité des sanctions11(*) autant que l'efficacité des peines12(*) (mais aussi de leur forme éventuellement aménagée) pour l'intérêt général ; elle touche par ailleurs à l'enjeu des délais d'exécution et des moyens dédiés au suivi des condamnés.
Or, les travaux menés par les rapporteures ont démontré que l'exécution des peines était marquée par une triple défaillance : d'abord, le droit est singulièrement peu lisible et les dispositions applicables, incohérentes entre elles dans leurs objectifs comme dans leurs effets ; ensuite, le dramatique délabrement du milieu fermé - c'est-à-dire, à titre principal, des prisons - atteint un niveau tel qu'on ne peut que s'interroger sur la vocation réelle de la détention, qui n'est aujourd'hui plus en mesure de répondre aux légitimes attentes de la société ; enfin, le milieu ouvert demeure le « parent pauvre » de la matière, le suivi des condamnés n'étant à la hauteur ni de leurs besoins ni des impératifs d'une juste répression. Cette situation n'épargne pas les mineurs condamnés, en milieu ouvert comme en milieu fermé : bien que soumis à des règles de droit spécifiques, ils ne bénéficient en pratique que d'un suivi lacunaire, voire défaillant.
A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS DÉBOUSSOLÉS
Les principes généraux fixant l'exécution des peines pénales sont inscrits à l'article 707 du code de procédure pénale, qui énonce cinq objectifs cardinaux :
- la mise à exécution, « sauf circonstances insurmontables, [...] de façon effective » des peines prononcées par les juridictions pénales ;
- la mise à exécution « dans les meilleurs délais » de ces peines ;
- la préparation de « l'insertion ou de la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société » ;
- la prévention de « la commission de nouvelles infractions » ;
- et l'adaptation de l'exécution de la peine « au fur et à mesure [...], en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières », ce qui peut donner lieu, par la suite, à l'aménagement de la peine.
Ces objectifs consensuels ont cependant perdu de leur acuité avec le temps. Certes, outre les enjeux juridiques que recèle le droit de l'exécution des peines, de nombreux déterminants extra-normatifs affectent défavorablement cette matière - on pense, par exemple, à l'engorgement des juridictions13(*) ou à la surpopulation carcérale14(*) : il serait donc illusoire d'engager une réflexion sur l'exécution des peines en faisant l'économie d'un examen des moyens qui lui sont dédiés15(*).
Il est toutefois manifeste que la complexité, voire l'illisibilité du droit a largement contribué à rendre l'exécution des peines plus difficile pour les praticiens : l'évolution de la loi depuis une quinzaine d'années témoigne ainsi d'une forme d'irréflexion qui, elle-même, a conduit à l'adoption de réformes contradictoires entre elles, déboussolant les multiples acteurs qui concourent à la mise en oeuvre des sanctions pénales.
1. Une succession irréfléchie de réformes contradictoires
L'adoption successive de plusieurs réformes a provoqué une préoccupante complexification du droit de l'exécution des peines qui, difficilement lisible, a par ailleurs été réformé dans des directions souvent contradictoires.
a) Un récent amoncellement de réformes parfois contradictoires a aggravé les modalités d'exécution des peines en France
L'exécution des peines entendue au sens large repose sur une diversité de dispositions, qui concernent tant le quantum des peines prévues par le droit pénal français que leurs modalités juridiques d'application.
L'exécution des peines a connu depuis l'orée des années 2000 une juridictionnalisation croissante, portée spécialement par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La première de ces lois a procédé à la juridictionnalisation de l'exécution des peines ; la seconde, à son organisation juridictionnelle. L'article 712-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré » et que « l'appel est porté [...] devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel [...] ou devant le président de cette chambre »16(*).
Le droit de l'exécution des peines a par ailleurs - et surtout - fait l'objet depuis près de deux décennies de réformes dont les objectifs respectifs paraissent difficilement conciliables, sinon contradictoires. Avec une unanimité notable, toutes les personnes et entités auditionnées par la mission d'information (juristes, magistrats, personnels pénitentiaires et de probation, forces de sécurité intérieure, etc.) ont décrit le droit en vigueur comme résultant d'un empilement de réformes s'étant succédé sans conception d'ensemble. L'Union syndicale des magistrats (USM) a, à titre d'exemple, souligné que « les réformes successives réalisées à moyens constants et sans vision globale ont créé de nombreuses incohérences, notamment au regard des objectifs antagonistes poursuivis ».
Les principales réformes récentes du droit de l'exécution des peines
- loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
- loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
- loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
- loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
- loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Source : commission des lois
Le professeur Muriel Giacopelli a distingué devant les rapporteures plusieurs séquences législatives pour décrire les évolutions récentes du droit de l'exécution des peines. Cette approche permet de dégager les différentes orientations suivies par le législateur depuis plusieurs années - qu'il s'agisse de la volonté de développer l'effet dissuasif de la peine, spécialement en aggravant les peines encourues, ou au contraire d'étoffer les modalités d'aménagement des peines, notamment pour remédier à la surpopulation carcérale.
Le Parlement a ainsi adopté plusieurs textes qui visaient à augmenter le quantum des peines, soit en allongeant les peines encourues, soit en établissant de nouvelles circonstances aggravantes. Il en va spécialement ainsi de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui instaura des « peines plancher » pour les récidivistes, et de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a, quant à elle, restreint les modalités d'aménagement de peine pour les individus reconnus coupables d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
Dès cette période, le législateur s'est également montré soucieux d'assurer « une meilleure régulation des flux carcéraux », selon les mots du professeur Muriel Giacopelli. La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire en fournit un éloquent exemple : outre ses dispositions relatives au droit pénitentiaire, qu'elle a largement étayées et érigées au rang législatif, la loi pénitentiaire a favorisé l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement jusqu'à deux ans, au lieu d'une année auparavant, et introduit l'exécution systématique, sous surveillance électronique, des fins de peine de quatre mois.
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales représente l'acmé de la démarche de régulation carcérale, voire un changement de paradigme tendant à prioriser le milieu ouvert et la probation par rapport à la détention, comme l'illustrent tout particulièrement :
- l'abrogation des « peines plancher », qui avaient été introduites par la loi du 10 août 2007 précitée ;
- la création de la contrainte pénale, c'est-à-dire d'une peine alternative à la prison, qui était régie par l'article 131-4-1 du code pénal et qui emportait « pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, [...] à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » ;
- l'introduction à l'article 720 du code de procédure pénale d'une libération sous contrainte (LSC) aux deux tiers de la peine pour prévenir les « sorties sèches » de détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ;
- l'encadrement des dispositifs de justice restaurative.
La libération sous contrainte
La libération sous contrainte est un dispositif régi par l'article 720 du code de procédure pénale, qui permet à un détenu d'effectuer sa peine hors de prison - et vise ainsi à préparer de façon progressive et encadrée le retour à la liberté des personnes condamnées.
Seuls les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans qui ont déjà purgé deux tiers de leur peine peuvent en bénéficier. Le recours à cette procédure suppose donc la réunion de deux critères cumulatifs relatifs respectivement au quantum et au reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée.
Le juge de l'application des peines (JAP) doit examiner la situation des détenus qui satisfont à ces critères et peut décider, après avis de la commission d'application des peines (CAP), que le reliquat de peine soit exécuté sous le régime :
- de la libération conditionnelle ;
- de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
- du placement à l'extérieur ;
- ou, enfin, de la semi-liberté.
Le JAP ne peut refuser l'octroi d'une LSC que si ses conditions d'exécution compromettent les exigences établies par l'article 707 du code de procédure pénale. Il est par ailleurs loisible à un détenu de refuser de faire l'objet d'une LSC.
Au surplus, si le JAP n'examine pas la situation d'un détenu parvenu aux deux tiers de sa peine, « le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte ».
Source : commission des lois
Les évolutions ultérieures du droit de l'exécution des peines sont toutefois marquées par une ambiguïté, elle-même liée à l'imparfaite compatibilité entre les objectifs poursuivis simultanément par le législateur. Si 120 infractions ont été créées ou ont vu leurs peines encourues augmenter durant la législature 2017-202217(*), plusieurs dispositifs qui tendent en pratique à la réduction de la surpopulation carcérale ont été adoptés au cours de la même période.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à une vaste réforme du droit de la peine, mieux connue sous l'appellation « bloc peines ».
Elle a ainsi interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois et consacré l'aménagement de peine ab initio - qui est désormais obligatoire pour les peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué en principe pour les peines d'emprisonnement de six mois à un an.
En effet, outre la règle fixée par l'article 132-19 du code pénal, selon lequel l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé « qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate », le droit impose un aménagement des peines fermes inférieures à six mois « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » ainsi que des peines comprises entre six et douze mois « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ». Une motivation spéciale de la décision est par ailleurs exigée en cas de mandat d'arrêt ou de dépôt, donc dans le cas où l'emprisonnement ferme est effectivement exécuté.
En d'autres termes, l'aménagement est obligatoire de jure lorsque la peine de prison ferme présente une durée inférieure à six mois ; du fait de dispositions théoriquement incitatives mais en pratique contraignantes18(*), il est par ailleurs devenu la norme pour les peines dont la durée est comprise entre six mois et un an.
La réforme de 2019 a également supprimé le principe de l'automaticité de l'examen de tous les condamnés non incarcérés par le juge de l'application des peines, en créant le mandat de dépôt à effet différé19(*), qui a pour conséquence d'ordonner que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
La loi précitée du 23 mars 2019 a, enfin, remodelé l'office du juge correctionnel, pour que la détermination des modalités d'exécution de la peine lui incombe largement, et développé les peines alternatives à la peine d'emprisonnement. Aussi, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) a été substituée au placement sous surveillance électronique et le sursis probatoire renforcé, à la contrainte pénale ; enfin, le sursis probatoire a remplacé à la fois le sursis avec mise à l'épreuve (SME) et le sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (STIG). La volonté de favoriser l'individualisation de la peine s'est au surplus manifestée par une modification de l'échelle des peines et une réforme des possibilités de leur conversion.
La réforme de l'aménagement ab initio des peines a été précisée - et de facto durcie - par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 11 mai 202120(*), la chambre criminelle a en effet opté pour une interprétation stricte de l'articulation des mesures adoptées en 2019, en indiquant que « l'aménagement des peines relève désormais à titre principal de l'office du juge correctionnel qui doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine ». La chambre criminelle de la Cour de cassation considère ainsi qu'une peine d'emprisonnement ferme « sèche » supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 12 mois ne peut plus être prononcée, celle-ci devant être soit aménagée (en son principe ou en précisant la mesure), soit assortie d'un mandat de dépôt à effet différé, ce qui correspond à une lecture extensive de l'article 464-2 du code de procédure pénale21(*).
Par un arrêt du 28 juin 202122(*), la chambre criminelle a par ailleurs considéré que les incitations législatives à l'aménagement des peines (en l'espèce, une exigence de motivation spéciale pour refuser l'aménagement d'une peine de moins d'un an) devaient être respectées même dans le cas où la personne mise en cause n'est pas comparante ou ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier la pertinence d'une solution de milieu ouvert : cette lecture de la loi, critiquée par les praticiens, limite drastiquement la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'aménagement des peines de prison ferme23(*). Cet arrêt marque un important revirement et posé de nouvelles exigences en cas de motivation spéciale prévue par la loi.
Il en est résulté une forte augmentation des aménagements ab initio, au détriment notamment de ceux qui sont à la main du juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
24(*)
La loi du 23 mars 2019 pourrait, à cette aune, être analysée comme une réforme allant dans le sens d'un moindre recours à l'incarcération et favorisant le développement des solutions de milieu ouvert. Tel n'est pas le cas, puisque la loi précitée est, dans le même temps, « revenue sur l'une des principales avancées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 », selon les mots employés par le docteur en droit Francis Habouzit au cours de son audition : en effet, seules les peines égales ou inférieures à une année font aujourd'hui l'objet d'un aménagement ab initio - seuil que la loi pénitentiaire avait porté à deux ans en 2009. D'après celui-ci, cette évolution constitue « l'une des principales causes de la très forte augmentation de la surpopulation carcérale » depuis lors.
Par-delà cet abaissement du quantum d'aménagement des peines, le caractère trop contraignant des seuils prévus par le dispositif a eu de graves effets pervers. Alors qu'elle prétendait lutter contre la surpopulation carcérale, la loi du 23 mars 2019 en est devenue le creuset.
En effet, et comme le rappelait Stéphane Le Rudulier dans un récent rapport sénatorial sur la proposition de loi, issue de l'Assemblée nationale, visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, la LOPJ de 2019 est à l'origine d'« effets de bord non-maîtrisés et contraires à l'objectif poursuivi ». Alors même que la loi tendait à favoriser les aménagements de peine pour éviter le recours effectif à l'incarcération lorsqu'une courte peine de prison ferme est prononcée, les juridictions de jugement semblent avoir contourné cette contrainte en recourant de manière plus fréquente à des peines de plus longue durée. C'est ainsi que l'obligation presqu'absolue de recourir à l'aménagement pour les peines de prison de moins de six mois s'est traduite par une augmentation significative des peines comprises entre six mois et un an entre 2019 et 2024 (de 27 786 à 41 947) ; dans le même temps, les peines de moins de six mois voyaient leur prononcé chuter de plus de 20 % (de 86 564 en 2019 à 67 702 en 2024).
Source : commission des lois à partir des
références
statistiques de la justice 2025,
« Les
personnes condamnées écrouées »
Ces éléments méritent d'être interprétés au regard de la situation qui prévalait auparavant. La comparaison atteste en effet d'une modification substantielle de la répartition des peines de prison ferme selon leur durée : entre 2019 et 2025, les peines de moins de six mois sont passées de 25 % à moins de 10 % des condamnations à une peine de prison ferme, et les peines comprises entre un et deux ans ont connu une augmentation de 7 points de pourcentage.
Source : commission des lois à partir des
références
statistiques de la justice 2019,
« Les
personnes condamnées écrouées »
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a, quant à elle, embrassé la logique esquissée par la LSC créée en 2014 ; la libération sous contrainte de plein droit (LSC-D) qu'elle a introduite s'apparente, en effet, à « un mécanisme assumé de régulation des flux » carcéraux, selon l'expression du professeur Giacopelli, dans la mesure où ce dispositif revêt un caractère automatique dont était dépourvue la LSC instaurée par la loi du 15 août 2014.
Or, en dépit de l'ambition avancée par le Gouvernement dans l'étude d'impact jointe à la loi du 22 décembre 2021, l'automaticité de la LSC-D trahit la primauté de l'objectif de la régulation carcérale sur celui de la préparation à la sortie des détenus écroués pour de courtes peines. L'application de ce dispositif a ainsi emporté des effets regrettables et directement contraires à l'intention du législateur.
La libération sous contrainte de plein droit
Ce dispositif a été introduit au II de l'article 720 du code de procédure pénale. Dans l'étude d'impact attachée audit texte, le Gouvernement indiquait que la LSC introduite par la loi du 15 août 2014 « n'[avait] pas produit les effets escomptés faute d'une appropriation suffisante par les professionnels ».
Ce constat avait donc conduit le Gouvernement à proposer de compléter les dispositions relatives à la LSC afin de la rendre plus systématique en fin de peine pour les personnes condamnées à de courtes peines et, partant, de ménager pour ces détenus une transition entre l'emprisonnement et la fin de peine de manière à éviter les « sorties sèches ».
Le nouveau mécanisme se distingue à plusieurs égards de la libération sous contrainte :
- les détenus concernés par la LSC-D purgent une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, pour laquelle demeure un reliquat à exécuter égal ou inférieur à trois mois (contre, pour la LSC, une durée de cinq ans et un reliquat d'un tiers) ;
- contrairement à la LSC, la LSC-D s'applique, comme son nom l'indique, de plein droit, « sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement ». L'appréciation du JAP est en conséquence réduite au choix de la mesure d'exécution et d'éventuelles obligations et interdictions y afférentes ;
- plusieurs cas d'exclusion du dispositif sont énumérés au III de l'article 720 du code de procédure pénale. Il en va notamment ainsi des détenus condamnés pour un crime, des actes de terrorisme, des violences intrafamiliales et pour ceux qui ont fait l'objet, durant leur détention, de certaines sanctions disciplinaires (par exemple, pour des violences physiques exercées contre un membre du personnel de l'établissement ou à l'encontre d'un détenu) ;
- le JAP peut, en cas de méconnaissance de la mesure et des obligations qui lui sont attachées, « ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne ».
Source : commission des lois
La mise en place de la LSC-D s'est, en effet, effectuée en même temps qu'une réforme allant dans une direction inverse en matière de réductions de peine.
L'extension de la LSC a été décidée en contrepartie d'une réforme des modalités d'octroi des réductions de peine, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ayant supprimé le mécanisme d'octroi automatique desdites réductions (qui étaient auparavant accordées à tous les détenus, sauf en cas de mauvais comportement25(*)) pour ne laisser subsister que les réductions dites « supplémentaires », liées à des « efforts sérieux de réadaptation sociale »26(*). Or, comme le soulignait le professeur Muriel Giacopelli à l'occasion de son audition, « le bon comportement du condamné n'est pas équivalent à l'absence d'incident » : en d'autres termes, parce qu'il repose sur la « bonne conduite »27(*) du condamné et non plus sur un retrait en cas de violation des règles de discipline en détention, le nouveau régime est nettement plus sévère que le précédent.
Le régime des réductions de peine
Le précédent système, établi par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, était assis sur un régime dual, qui permettait de cumuler des crédits de réduction de peine (CRP), accordés automatiquement mais qui pouvaient être retirés en cas de mauvaise conduite en détention, et des réductions supplémentaires de peine (RSP), qui étaient accordées sur décision du JAP en fonction des efforts de réinsertion du détenu.
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire lui substitua un régime de réductions de peine dont les modalités figurent aux articles 721 à 721-4 du code de procédure pénale.
Toute réduction de peine est désormais accordée sur décision du JAP, après avis de la commission de l'application des peines, à condition que le condamné ait donné des preuves suffisantes de bonne conduite et manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Il est enfin précisé que « cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an » - et prévu que la situation de chaque condamné doit être examinée au moins une fois par an.
Source : commission des lois
Illustrant l'absence de cohérence du corpus juridique, l'ensemble des personnes entendues par la mission a par ailleurs considéré que la loi du 22 décembre 2021 avait été pensée sans coordination ou articulation avec les autres pans du droit de la peine ou de son exécution. Cette mesure engendre ainsi des « situation[s] ubuesque[s] », selon les termes du conseil national des barreaux (CNB), ou « incompréhensibles », selon ceux de la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ), « dans lesquelles un juge de l'application des peines révoque un sursis mais doit ensuite mettre en place une libération sous contrainte »28(*).
La mise en place de la LSC-D a, en outre, été décidée sans qu'il soit tenu compte de ses conséquences sur les aménagements de peine - et ce, alors même que les deux mesures s'incarnent dans les mêmes instruments de suivi, la LSC ayant vocation à se traduire par un suivi analogue à celui qui s'applique en cas d'aménagement29(*). Les conséquences pratiques de cette situation seront commentées dans une partie dédiée du présent rapport ; néanmoins, au plan strictement juridique, on ne peut que déplorer que notre droit fasse désormais coexister deux leviers similaires dans leurs effets, mais opposés dans leurs causes, puisque la LSC est « de plein droit » alors que l'aménagement repose sur l'évaluation préalable du profil du condamné et sur les efforts qu'il aura accomplis au cours de sa détention.
Plus largement, le principe même sur lequel repose la LSC-D, celui de l'automaticité, est en contradiction manifeste avec la réforme simultanée des réductions de peine. Alors que ces dernières reposent désormais sur les initiatives individuelles du condamné, notamment en matière de réinsertion, le systématisme qui s'attache à la LSC-D n'incite en rien les personnes condamnées à « justifier du moindre effort » (USM) ou à engager une démarche de désistance30(*).
b) Le droit de l'application des peines connaît en conséquence une complexification croissante, qui altère la bonne exécution des peines
L'exécution des peines, entendue au sens large, a donc connu ces dernières années de nombreuses réformes, qui empruntèrent tant à la volonté d'affermir les peines encourues et prononcées qu'au souci de contenir, voire de résorber la surpopulation carcérale. Il découle de cette séquence législative une complexification significative de la matière, que les praticiens et la doctrine jugent soumise à des mouvements contradictoires : les représentants de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ont ainsi considéré devant les rapporteures que « ces réformes ont [...] porté le droit positif dans des directions opposées » et ont affirmé que « c'est tout autant le droit positif dans ses contradictions et sa technicité que ses évolutions constantes qui rendent la matière complexe ».
Les travaux de la mission d'information montrent que cette illisibilité mâtinée d'incohérence, outre les difficultés qu'elle pose à la doctrine et aux praticiens, s'est avérée préjudiciable au bon fonctionnement du système pénal français.
Les rapporteures ont recueilli au long de leurs travaux différents exemples des difficultés soulevées par les précédentes réformes législatives en matière d'exécution des peines, qu'il s'agisse du milieu ouvert, de la semi-liberté ou du milieu carcéral. Outre les illustrations concrètes de ces difficultés, qui ont nourri le diagnostic de la mission et qui seront abordées dans les parties thématiques du présent rapport, un constat général s'impose : le droit de l'exécution des peines constitue l'un des pans les plus opaques du droit pénal et de la procédure pénale.
Cette opacité a été critiquée, avec constance et vivacité, par l'intégralité des personnes qu'elle a auditionnées.
Lors de son audition, la CNPTJ a ainsi observé que « la multiplicité des réformes empêche une mise en oeuvre cohérente des dispositifs et fait obstacle à la réalisation des objectifs destinés à rendre les sanctions plus efficaces, c'est-à-dire [susceptibles de conduire] à la désistance des auteurs d'infractions ». Le CNB a considéré, de manière convergente, que « les réformes se succèdent souvent sans évaluation des réformes précédentes et sans considération pour l'existant ».
L'évolution rapide et peu cohérente du droit a également des effets sur les conditions de travail des acteurs de la justice, dans la mesure où la succession de réformes insuffisamment articulées entre elles provoque une inévitable insécurité juridique dans leur application. Ce manque de clarté du droit de l'exécution des peines est, comme l'a résumé le CNB, « préjudiciable tant pour les professionnels de la justice que pour les justiciables », qu'il s'agisse des victimes ou des personnes condamnées.
L'USM a alerté les rapporteures à ce sujet, en leur indiquant que « ces réformes incessantes ne sont pas suivies de la mise à jour des applicatifs métiers avant leur entrée en vigueur ». Cette observation corrobore ainsi les travaux conduits par la commission des lois du Sénat, qui ont à plusieurs reprises conclu ces dernières années à la qualité insuffisante de la politique numérique de la Chancellerie31(*).
Les injonctions contradictoires auxquelles le
système pénal français est soumis n'ont pas seulement un
effet délétère sur la cohérence d'ensemble du droit
de la peine ou sur la charge de travail des praticiens. Elles
conduisent également à des situations individuelles
paradoxales, voire kafkaïennes, comme en témoignent les
exemples donnés aux rapporteures au cours de
leurs auditions
s'agissant des conséquences concrètes, pour les condamnés
comme pour les magistrats chargés de statuer sur leur sort, de
l'évolution du quantum des peines aménageables.
Illustration pratique des effets de la modification du quantum des peines aménageables
Exemple soumis par l'USM aux rapporteures
« Soit un condamné à plusieurs peines de prison pour un quantum total de treize mois et inséré professionnellement et socialement. Il ne pourra pas voir sa peine aménagée dans le cadre de la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale compte tenu de l'actuel quantum des peines aménageables (un an maximum). Il devra donc être incarcéré. Mais, dès son premier jour de détention, sa situation devient de facto « aménageable », dans la mesure où l'aménagement de peine en milieu fermé est possible pour les peines inférieures à deux ans d'emprisonnement. En admettant qu'il dépose sa requête en aménagement de peine et que le juge d'application des peines arrive à l'audiencer dans les délais prévus par la loi (quatre mois), il aura néanmoins passé plusieurs mois en prison, au risque de perdre son emploi et son logement faute de ressources, en n'ayant rien pu mettre en place en détention au regard des conditions carcérales actuelles. »
Source : commission des lois, d'après les éléments transmis par l'USM
En troisième lieu, les rapporteures relèvent que l'illisibilité et le caractère confus du droit des peines et de leur exécution ont des effets directs - et désastreux - sur la perception qu'ont les citoyens de l'efficacité du système pénal et, partant, de la justice dans son ensemble. Il en résulte une expansion dans l'opinion publique de l'idée suivant laquelle le système pénal français serait « laxiste ».
Cette idée, majoritaire parmi les citoyens32(*), a pourtant été largement démentie au cours des auditions menées par la mission d'information.
Les organisations représentatives de magistrats et la DAP ont unanimement affirmé devant les rapporteures que le quantum des peines a connu une augmentation constante ces dernières années. L'aggravation de la surpopulation carcérale résulte en conséquence de peines plus longues et non d'un plus grand nombre de détenus, selon l'essentiel des personnes entendues durant les travaux de la mission d'information (voir infra). L'USM estime au surplus qu'en dépit des difficultés précitées « et contrairement aux idées reçues, les peines sont très largement exécutées en France ».
Plusieurs facteurs expliquent toutefois que le
système pénal français puisse être
considéré comme « laxiste » ou vu comme
incompréhensible. La principale explication tient à ce que
les peines sont, dans leur immense majorité - et de
plus en plus fréquemment -, exécutées sous une
forme
qui n'est pas celle qui a été
décidée par le juge du fond. Ce décalage a
été aggravé par les réformes récentes, et
notamment par la généralisation des aménagements ab
initio sous l'effet du « bloc peines ».
S'ajoute à ce décalage entre la nature de peine prononcée et celle de la sanction réellement exécutée, un décrochage entre la sévérité apparente de la loi pénale et un système d'exécution des peines qui, à la fois pour lutter contre la surpopulation carcérale et pour garantir le respect du principe d'individualisation des peines, conduit à la mise en oeuvre de sanctions souvent perçues comme « légères » par l'opinion publique.
Certes, et comme l'universitaire Francis Habouzit l'a rappelé lors de son audition par les rapporteures, « la peine encourue n'a pas pour objet d'être prononcée systématiquement, il s'agit d'un maximum. L'emprisonnement est la peine étalon de notre pénalité, et non la peine de principe ; bien au contraire, la loi dispose qu'il s'agit d'une sanction de dernier recours ».
En pratique, le quantum des peines prononcées apparaît faible par rapport à celui qui est encouru. L'association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) a à cet égard cité les travaux d'Arnaud Philippe, qui dans son ouvrage La fabrique des jugements observe qu'en matière délictuelle et en moyenne, 7 % des peines encourues sont prononcées - ce qui induit, toujours selon l'ANJAP, « le sentiment d'une justice laxiste pour la société, les victimes ou les auteurs ».
Au-delà, le rapport de notre société à la sanction pénale est affecté par « l'aggravation des formes de délinquance, avec des actes de plus en plus violents sous-tendus par des mobiles paradoxalement de moins en moins graves », comme l'a remarqué la CNPTJ auprès des rapporteures.
c) L'impossible évaluation de l'exécution des peines
Dans son récent rapport public thématique sur la surpopulation carcérale33(*), la Cour des comptes déplore « un suivi et une évaluation lacunaires » des peines de prison ferme, rendant difficile une analyse précise des évolutions de la population incarcérée et de ses causes et qui tient à la fois aux évolutions trop fréquentes de la loi (qui brouille les catégorisations statistiques) et à l'état délabré des moyens informatiques du ministère. Comme le résume la Cour avec autant de synthèse que de clarté :
« Cette situation traduit les évolutions d'un cadre juridique maintes fois amendé et dont la complexité est excessive. Elle est aggravée par l'organisation du suivi statistique au sein du ministère de la justice, opéré à partir des applicatifs ``métiers'' de ses différentes directions. Les données produites correspondent aux besoins de pilotage et de gestion de ces directions et ne recouvrent pas nécessairement les catégorisations retenues par les orientations successives de la politique pénale. Ces orientations étant nombreuses et les catégorisations changeantes, les adaptations de leur suivi se sont faites au fil de l'eau, par ajustements successifs, sans permettre toujours de consolidation. Celle-ci est d'autant plus ardue que les applicatifs ne communiquent pas entre eux et que des appariements de données sont requis. Quand ils sont possibles, ils sont à la fois complexes à opérer et souvent insuffisamment fiables. Le problème est de surcroît aggravé par les défaillances, et parfois l'obsolescence, de certains applicatifs du ministère. »
Sans que soit en cause la bonne volonté des services du ministère, qui sont les premières victimes de l'état dégradé des applicatifs de la Chancellerie et composent comme ils le peuvent avec l'existant dans l'attente de l'achèvement de l'ambitieux projet « procédure pénale numérique » (PPN), les rapporteures se sont heurtées à de lourdes difficultés pour obtenir des chiffres de nature à éclairer leurs travaux.
C'est ainsi qu'elles n'ont pu obtenir aucune statistique exploitable sur les sujets suivants :
- l'ampleur des réductions de peine accordées aux détenus ;
- les délais d'exécution des peines « alternatives » à l'incarcération, à l'exception des travaux d'intérêt général : dit autrement, il n'est pas à ce jour possible de savoir dans quel délai sont posés les bracelets qui accompagnent les DDSE, ni à quelle échéance sont effectivement suivis les divers stages qui peuvent être prononcés par les juges du fond. Cette carence est particulièrement inquiétante, dans la mesure où la proximité entre l'infraction et sa sanction est par nature un gage de l'effet « éducatif » de la peine, et donc de la prévention de la récidive ;
- les caractéristiques des peines effectuées par les sortants de prison après 2020 : les données disponibles en la matière sont, en effet, la résultante d'un rapprochement de deux fichiers (Genesis34(*), lui-même renseigné à la main, et le Casier judiciaire national) dont les délais de production sont conséquents, d'autant plus au vu des difficultés liées à la récupération de l'ensemble des condamnations définitives pour une année donnée : ce n'est ainsi qu'au printemps 2026 que le ministère sera en mesure de produire des chiffres sur les sortants de prison de 2021.
S'ajoute à ce constat, la défaillance - maintes fois commentée par la commission des lois - des applicatifs du ministère en ce qui concerne les mineurs, c'est-à-dire le logiciel PARCOURS. Il n'existe pas, en l'état, d'outil permettant de suivre (individuellement comme statistiquement) le parcours pénal des mineurs de manière fiable et exhaustive. La mission renvoie, sur ce sujet essentiel, aux travaux de la rapporteure Laurence Harribey sur les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, par lesquels elle se fait chaque année l'écho du déploiement contrarié de cet outil.
Le logiciel PARCOURS : anatomie d'un naufrage
Depuis plusieurs années déjà, la commission des lois profite de son avis budgétaire sur les crédits de la PJJ pour établir un point d'étape sur l'avancée du déploiement de l'applicatif PARCOURS.
Celui-ci doit permettre, à terme, d'atteindre un objectif dont on pourrait s'étonner qu'il ne soit pas acquis en l'état : assurer le suivi de tous les mineurs confiés à la PJJ, en recensant tous les actes pris à leur égard par l'ensemble des acteurs compétents (magistrats, associations du SAH, éducateurs et personnels administratifs), y compris en ce qui concerne leur suivi en réinsertion à la sortie des services et établissements de la PJJ.
Initié en 2019, le projet reste à ce jour inabouti et insatisfaisant ; il s'avère par ailleurs extraordinairement coûteux, au point que l'on peut s'interroger sur le degré de lucidité du ministère de la justice quant à la déroute dans laquelle il semble engagé.
En effet, alors que la première version de PARCOURS a été mise en service en mai 2021, il semble que, depuis cette date, le projet ne parvienne pas à progresser.
PARCOURS reste, en premier lieu, incomplet à deux égards :
- il n'est accessible qu'aux personnels du secteur public - ce qui exclut les personnels du SAH. Or, en l'absence d'une couverture complète des établissements et structures de la PJJ, les données relatives aux jeunes suivis par le secteur associatif habilité doivent être « re-saisies » par des agents du secteur public, ce qui constitue une lacune importante sur le plan quantitatif, impose aux équipes une tâche chronophage et peu gratifiante et crée mécaniquement le risque d'erreurs dans la retranscription des informations transmises [...] ;
- ensuite, la centralisation et l'analyse des données renseignées dans PARCOURS supposent la mise en place d'un nouvel infocentre « InfoDPJJ » qui ne sera opérationnel qu'à l'aboutissement du travail, toujours en cours, de reprise des bases de données depuis 2004. Plusieurs fois présenté comme imminent, l'achèvement de ce travail est désormais prévu pour la fin 2024. En 2025, le contenu de l'infocentre devra être complété des données relatives aux parcours scolaires et d'insertion, ainsi qu'au partenariat Justice / Armée, ce qui doit permettre le calcul des « indicateurs politiques prioritaires du Gouvernement ».
La phase suivante du projet a été mise en développement en 2023. Néanmoins, il n'est pas possible, au vu des éléments transmis par le Gouvernement, de comprendre ou d'analyser les étapes à venir [...] - ce qui semble confirmer les conclusions de la Cour des comptes : celle-ci avait estimé que, toutes choses égales par ailleurs, PARCOURS ne serait pas déployé avant 203235(*).
PARCOURS présente, en deuxième lieu, un fonctionnement peu satisfaisant pour ses utilisateurs. Les organisations syndicales ont unanimement décrit un outil informatique peu intuitif, inutilement lourd (il impose par exemple de renseigner les arrivées et les départs, aucune interconnexion avec les bases RH du ministère n'étant opérationnelle ; à défaut, les statistiques se trouvent intégralement faussées) et davantage pensé pour dimensionner les plafonds d'emplois dans les structures et établissements de la PJJ que pour contribuer au bon suivi des mineurs et de leurs particularités. De son côté, le ministère concède pudiquement que « [le] déploiement [de PARCOURS] nécessite un accompagnement soutenu des professionnels et des mises à jour permanentes » et que « sa fiabilisation sera indispensable pour rendre compte de la réalité des parcours des mineurs et de l'efficacité de la mission, mais également pour allouer des moyens humains et budgétaires adaptés ».
[...] PARCOURS est, enfin, un projet particulièrement onéreux, et qui menace désormais de se transformer en gouffre financier. Estimé à 10 millions l'année passée par la rapporteure, le coût du chantier s'élève en réalité, à ce jour, à près du double.
Source :
avis n°
150 (2024-2025) de Laurence Harribey,
tome VIII,
déposé le 21 novembre 2024
Ces facteurs contribuent à rendre fastidieuse toute évaluation quantitative de l'exécution des peines et expliquent que, dans de nombreux cas, il ne soit possible d'évaluer avec précision ni l'impact des réformes pénales à venir ni, de manière inquiétante, l'effet réel de celles déjà entrées en vigueur.
2. Une chaîne d'acteurs variés et dévoués, mais souvent dépassés
L'article 707 du code de procédure pénale, déjà cité, place l'exécution de la peine « sous le contrôle des autorités judiciaires », qu'elles appartiennent au siège ou au parquet.
Cette exécution mobilise toutefois, à diverses étapes, de nombreux acteurs de la chaîne judiciaire ou extrajudiciaire : outre les magistrats et les équipes qui les entourent, au premier rang desquelles figurent les agents du greffe, interviennent, sans que l'énumération ne soit exhaustive, l'administration pénitentiaire, dont dépendent les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, les forces de sécurité intérieure, des associations ou encore les avocats. Les auditions conduites par la mission d'information ont confirmé que tous avaient à coeur de mettre en oeuvre les objectifs énoncés par le législateur, et les rapporteures tiennent à rendre hommage à leur engagement.
Néanmoins, dans la pratique, la complexité du droit de l'exécution et de l'application des peines, ses trop nombreuses réformes, souvent dans des directions opposées, l'insuffisance des moyens et une coordination difficile entre les acteurs entravent l'atteinte de ces objectifs consensuels.
a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens de la peine
Les professionnels des juridictions sont les acteurs de première ligne de l'exécution des peines. Sous l'effet des évolutions contradictoires de la loi comme d'un manque de moyens qui n'est que partiellement résorbé par les lois successives d'orientation et de programmation adoptées par le législateur, ils sont néanmoins non moins que les autres acteurs de la peine confrontés à une perte de sens et à une dégradation tangible des conditions d'exercice de leurs missions.
(1) L'exécution de la peine relève à titre principal du parquet
Comme l'a souligné la conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) auprès des rapporteures, « c'est l'exécution des peines qui donne sens à l'ensemble du processus judiciaire pénal » : elle est ainsi l'un des principaux facteurs de crédibilité pour l'institution judiciaire, et singulièrement pour les parquets puisque « l'exécution des peines est un élément majeur des priorités de politique pénale arrêtées par les procureurs généraux et mis en oeuvre par les procureurs de la République ».
En effet, conformément à l'article 707-1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ». Dans le cas des poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur ou sur des biens meubles ou immeubles, interviennent également dans l'exécution de la peine le comptable public compétent et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), mais au nom du procureur de la République.
Le parquet doit ainsi veiller à la célérité d'ensemble des délais d'exécution liés aux circuits de la phase juridictionnelle per se, ce qui comprend notamment la rédaction des jugements, la transmission des pièces d'exécution d'un service à l'autre, la saisine des commissaires de justice, etc., ainsi qu'aux délais de prise en charge du condamné jusqu'à ce que la peine soit entièrement exécutée.
Pour exercer ces fonctions, le procureur de la République peut requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution de la sentence pénale (voir infra).
Il s'appuie surtout sur « un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines », comme le dispose l'article D. 48-1 du code de procédure pénale. Tous les parquets comprennent par conséquent un service de l'exécution des peines. Outre le suivi de l'exécution des peines prononcées dans son ressort, le secrétariat-greffe assiste le procureur de la République dans l'établissement, imposé par l'article 709-2 du même code, du « rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal ». Ce rapport « est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin ». Toutefois, la publicité de ce rapport - en pratique transmis au procureur général, à l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité, au préfet, au bâtonnier et aux diverses autorités de l'administration pénitentiaire et des forces de sécurité intérieure - a été limitée par l'arrêté du 17 février 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines : si celui-ci prévoit que le rapport peut être « librement consulté par toute personne qui en fait la demande », il n'est pas publié sur le site internet des juridictions.
Depuis 2014 et le vote de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le code de procédure pénale impose également, en son article 709-1, l'institution « d'un bureau de l'exécution des peines [...] dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel »36(*). Le législateur a confié à ces bureaux (BEX) la « charg[e] de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées ». Le rôle et la composition de ces bureaux a ensuite été précisé par décret37(*).
Ces bureaux d'exécution des peines ne constituent pas, toutefois, des bureaux d'investigation ni n'assurent un suivi proactif de l'exécution des peines prononcées dans le tribunal. Ils sont principalement consacrés à l'accompagnement des personnes condamnées et, dans certains tribunaux, des victimes38(*). Ils ont ainsi pour mission prioritaire d'informer la personne condamnée sur la décision pénale rendue à son encontre (peines prononcées, voies de recours, etc.) et de l'inciter à accepter un premier acte de mise à exécution de la peine ainsi qu'à s'acquitter volontairement des dommages et intérêts dus aux parties civiles39(*).
La plupart d'entre eux sont dotés d'un terminal de paiement, leur permettant d'offrir à la personne condamnée la possibilité de s'acquitter immédiatement de l'amende prononcée (cette dernière pouvant alors bénéficier d'un abattement de 20 % du montant de cette amende, conformément à l'article 707-2 du code de procédure pénale).
Les bureaux de l'exécution des peines sont également le lieu où peut être remise à la personne condamnée et qui n'est pas incarcérée une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai maximal de 30 jours, et, le cas échéant, devant le juge de l'application des peines dans un délai de 20 jours40(*).
Ce dispositif, qui est systématisé depuis plus d'une dizaine d'années, « a montré sa pertinence » et est « désormais parfaitement inscrit dans le mode de fonctionnement des juridictions », selon la CNPTJ. Malgré ce jugement positif, cette dernière regrette que, faute d'effectifs en nombre suffisant pour assurer des horaires élargis, « les bureaux de l'exécution des peines ne fonctionnent que pendant une partie de l'audience seulement, puisqu'ils ferment généralement à 18 heures, et pas pour toutes les audiences ».
(2) Un fonctionnement bousculé par le partage croissant de l'aménagement des peines entre juge correctionnel et juge de l'application des peines
Si le ministère public est chargé d'exécuter la peine, l'aménagement de la peine, qu'elle soit effectuée ab initio ou en cours d'exécution, relève des magistrats du siège.
Deux catégories de magistrats du siège interviennent en matière d'aménagement de la peine : le juge correctionnel, dans une proportion croissante, et le juge de l'application des peines, dont l'office a évolué pour s'éloigner de la date du prononcé de la peine initiale.
Le droit actuel résulte ainsi d'un mouvement d'ensemble de juridictionnalisation progressive de l'exécution des peines depuis les années 2000. Les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ont conféré une nature juridictionnelle à de nombreuses décisions du juge de l'application des peines, qui étaient auparavant des mesures d'administration judiciaire. En conséquence, à ces décisions s'appliquent les grands principes régissant toute décision judiciaire, tels que le caractère contradictoire des débats, la motivation des décisions, la possibilité de faire un recours, etc.
Le juge de l'application des peines, dont la fonction a été créée en 1958, s'est donc vu progressivement confier l'essentiel des interventions judiciaires sur la sanction, après la condamnation. Son rôle a été défini par le législateur, à l'article 712-1 du code de procédure pénale, comme celui d'un juge « du premier degré » chargé « de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Il est « avisé, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en oeuvre par ces services » et il peut « faire procéder aux modifications qu'[il] juge nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine ». Dit autrement, et pour reprendre les termes employés par l'ANJAP lors de son audition par les rapporteures, la mission des 430 juges de l'application des peines en exercice est « le suivi des personnes condamnées, dans l'objectif d'assurer leur réinsertion et de prévenir la récidive tout en préservant les intérêts des victimes et en tenant compte des conditions d'occupation des établissements pénitentiaires ». Pour cela, ils s'appuient - notamment - sur les commissions d'application des peines, une instance consultative ayant vocation à apporter des éclairages au juge de l'application des peines sur la situation des condamnés détenus.
Ce rôle de suivi judiciaire des personnes condamnées a toutefois connu une évolution majeure en 2019, à l'occasion du vote de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a accru la place du juge correctionnel dans l'aménagement des peines, en rendant plus systématique l'aménagement dit « ab initio », c'est-à-dire prononcé dès la condamnation. D'optionnels, ces aménagements ab initio sont devenus obligatoires de jure pour les peines de moins de six mois, mais aussi quasi-impératifs de facto pour les peines comprises entre six mois et un an (voir supra), limitant strictement les leviers de décision des juges de l'application des peines au stade de la condamnation.
Les aménagements de peine ab
initio
(articles 132-25, 132-26 et 132-27 du code
pénal)
Les aménagements de peine ab initio relèvent de quatre régimes distincts :
- le régime de la semi-liberté prévoit que le condamné est astreint à demeurer dans l'établissement pénitentiaire, à l'exception du temps nécessaire à la conduite des activités en raison desquelles il a été admis au régime de la semi-liberté (activité professionnelle, recherche d'un stage ou d'un emploi, suivi d'une formation, participation à la vie familiale, conduite d'un projet d'insertion ou de réinsertion) ;
- le placement à l'extérieur astreint le condamné à effectuer, sous le contrôle de l'administration, des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire ;
- la détention à domicile sous surveillance électronique implique pour le condamné une interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines, en dehors des plages horaires et des périodes fixées par ce dernier. Ce régime emporte en outre l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines ;
- le régime du fractionnement prévoit l'exécution d'une peine par fractions, sur une période ne pouvant excéder quatre ans et sans qu'une fraction soit inférieure à une durée de deux jours.
Source : commission des lois41(*)
Le juge de l'application des peines demeure, en revanche, pleinement compétent auprès des condamnés détenus, lui seul pouvant décider d'une sortie anticipée de détention et des modalités de cette dernière.
La réforme législative de 2019, couplée aux évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de cassation, a profondément modifié la répartition des rôles entre le juge de l'application des peines et le juge correctionnel. Force est de constater, six ans après sa mise en oeuvre, qu'elle ne fait pas l'unanimité sur le terrain et qu'elle demeure partiellement incomprise.
Comme le relève la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, « le juge de l'application des peines devient, de moins en moins, le juge du prononcé de l'aménagement de la peine mais davantage le juge du suivi des mesures d'aménagement de peine prononcées par le tribunal correctionnel, ce qui revient à le mobiliser sur la gestion des incidents », une tâche reconnue comme « chronophage ».
Ce constat est partagé par l'ANJAP, qui estime « indispensable de freiner le mouvement consistant à faire du juge de l'application des peines un juge de l'incident, alors qu'il se révèle bien plus efficace en juge du suivi, intervenant en début de mesure pour en fixer le contenu et en déterminer les orientations, en cours de mesure pour faire des points d'étape et, en cas de difficulté, d'éventuelle sanction, puis à la fin pour la clôturer ou non, et en faire un bilan ».
Plus globalement, de nombreux intervenants, à l'instar de la conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel, ont signalé aux rapporteures que la généralisation des aménagements ab initio avait eu pour conséquence un alourdissement du travail du juge correctionnel, sans pour autant que le juge de l'application des peines n'ait vu sa charge de travail diminuer. L'ANJAP rapporte ainsi que les juges de l'application des peines sont de plus en plus saisis de peines aménagées ab initio, notamment parce que « le tribunal correctionnel ne peut pas être dans une appréciation globale de la situation du condamné s'agissant de la peine, puisqu'il juge d'abord des faits » et qu'il dispose de moins d'informations socio-économiques sur le condamné. À ce titre, la Cour des comptes a récemment mis en exergue le fait que « les magistrats qui, au parquet comme au siège, doivent décider de plus en plus fréquemment dans le cadre de procédures rapides sur un nombre croissant de dossiers, ne disposent pas des outils nécessaires pour appréhender la situation sociale et pénale des mis en cause »42(*).
Ces avis mitigés rejoignent les réserves qu'avait émises le Sénat lors de l'examen de la réforme en 2019. Les rapporteurs de la commission des lois, François-Noël Buffet et Yves Détraigne avaient ainsi « regretté que ce dispositif illisible privilégie une approche de gestion des flux d'incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d'essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d'exécution de la peine n'est de nature ni à renforcer l'efficacité des peines ni leur sens »43(*).
Quoi qu'il en soit, ce nouveau partage des tâches a eu, malgré les réticences, des effets tangibles, démontrant que les magistrats se sont appropriés cette réforme, bon gré, mal gré. Deux effets principaux peuvent être cités : l'augmentation de la proportion de peines aménagées avant l'incarcération et, en pratique, la forte hausse du recours à la détention à domicile sous surveillance électronique qui est l'aménagement de peine privilégié par les juges correctionnels.
Sur le premier point, les aménagements de peine et les conversions de peine - toutes catégories confondues - ont crû pour atteindre, selon le ministère de la justice, le chiffre de 41,3 % des peines de prison ferme mises à exécution, soit une hausse de 8 points de pourcentage entre 2015 et 202344(*). Cette évolution est le reflet des réformes législatives déjà commentées.
Source : ministère de la justice
Toutefois, outre que des débats existent quant à l'interprétation de ces données, notamment en ce qu'elles portent sur les aménagements et conversions de peine accordés à un condamné laissé libre à l'issue de l'audience et non sur la totalité des peines d'emprisonnement ferme, il convient de noter, à l'instar de l'ANJAP, que la hausse des aménagements de peine peut aussi résulter du prononcé, par le tribunal correctionnel, de peines fermes aménagées ab initio là où il prononçait auparavant une alternative à l'incarcération.
Focus sur un modèle d'aménagement des peines qui diffère du modèle français : l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines aux Pays-Bas
Le système néerlandais se caractérise par l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines et le rôle prédominant de l'administration dans les décisions d'aménagement de peines45(*). Cette spécificité a été renforcée par la loi sur l'exécution des décisions pénales46(*) qui, à compter du 1er janvier 2020, a transféré la responsabilité de l'exécution des peines du ministère public (Openbaar Ministerie, OM) vers le ministre de la justice et de la sécurité - qui a délégué cette tâche à l'Agence des établissements pénitentiaires (Dienst Justitiële Inrichtingen, DIJ)47(*). Le parquet demeure compétent en matière de libération conditionnelle.
(a) La libération conditionnelle
La décision de libération conditionnelle relève de la responsabilité d'un service spécialisé du ministère public : le service central pour la libération conditionnelle (Centrale Voorziening voorwardelijke invrijheidstelling, CVv.i.)48(*). Ce service consulte obligatoirement le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service de probation avant de prendre une décision (article 6:2:12) et peut également consulter les services de police, le procureur général et les experts ayant traité l'affaire. Le CVv.i. doit aussi demander aux victimes ou à leurs proches s'ils ont des souhaits à formuler en cas de libération conditionnelle.
Dans certains cas graves et complexes, le CVv.i. peut faire appel au Comité consultatif sur la libération conditionnelle (Adviescollege voorwaardelijke invrijheidstelling, AVI)49(*), qui a été créé par une décision du Conseil des procureurs généraux. L'AVI se compose de onze juristes et experts et fournit un avis indépendant sur les décisions de la CVv.i50(*). Cet avis n'est pas juridiquement contraignant.
(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire
Dans la plupart des cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire où le détenu est incarcéré décide de l'octroi d'une permission de réinsertion, d'une permission de capacité ou de la participation au programme pénitentiaire.
S'agissant des permissions de réinsertion, le directeur d'établissement doit préalablement recueillir des informations auprès de la commission des libertés de l'établissement et du fonctionnaire chargé de la sélection de l'agence DIJ51(*). Dans certains cas, le directeur est tenu de demander l'avis préalable du ministère public, par exemple en cas de délit grave contre les moeurs, de délit grave avec violence ou de traite d'êtres humains52(*). Pour les détenus condamnés à perpétuité, ce n'est pas le directeur qui décide de la demande de permission, mais le fonctionnaire chargé de la sélection (selectiefunctionaris) de l'agence DIJ53(*).
Source : note de la division de la législation comparée (voir annexe 1)
Sur le second point, les chiffres sont éloquents : 92 % des aménagements de peine ab initio sont des détentions à domicile sous surveillance électronique54(*). Cette catégorie d'aménagement est ainsi devenue un réflexe pour les juges correctionnels. Or, comme le relève la conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel, cette tendance n'est pas nécessairement positive, dans la mesure où « elle ne doit pas occulter que le bracelet écrase les autres modes d'aménagement souvent plus qualitatifs en termes de suivi » et que « les tribunaux correctionnels prononcent ces peines là où une peine de milieu ouvert aurait peut-être été suffisante, voire plus utile » : cet enjeu fera l'objet de développements spécifiques ci-après.
b) Les acteurs intervenant principalement en post-sentenciel : des missions essentielles dont la réalisation est obérée par un sentiment de submersion
Une fois la peine prononcée, éventuellement sous une forme aménagée, par l'autorité judiciaire, plusieurs acteurs interviennent pour assurer sa bonne exécution. Outre les forces de sécurité intérieure (voir infra), sont notamment mobilisées l'administration pénitentiaire, à laquelle appartiennent les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et des associations oeuvrant auprès des personnes placées sous main de justice.
Le législateur ou le pouvoir réglementaire leur ont confié des missions essentielles à la crédibilité de la justice, d'une part, et à l'accompagnement social des condamnés, d'autre part.
De façon générale, ils concourent, à leur échelle, à l'application des principes cardinaux régissant l'exécution des peines énoncés à l'article 707 du code de procédure pénale (mise à exécution effective et rapide, prévention de la récidive, adaptation de l'exécution de la peine au profil du condamné et préparation de la réinsertion - voir supra).
(1) Les personnels de surveillance, dont le nombre a crû moins rapidement que celui des détenus, assurent l'exécution des peines d'emprisonnement
L'administration pénitentiaire, prise dans son ensemble, est historiquement chargée de l'exécution des peines de privation de liberté, que la détention ait lieu au domicile du condamné55(*) ou dans un centre pénitentiaire (maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale ou centre de semi-liberté). C'est également elle qui effectue le suivi des personnes ayant été condamnées au port d'un bracelet anti-rapprochement56(*).
Outre les personnels de direction et les personnels administratifs et techniques, ces tâches sont principalement assurées par les personnels de surveillance, qui sont « au contact de la population pénale »57(*) et constituent « l'une des forces dont dispose l'État pour assurer la sécurité intérieure »58(*). À ce titre, ils veillent à l'accomplissement de la peine d'emprisonnement - c'est-à-dire à la prévention des évasions - mais aussi « au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté », autrement dit au maintien de l'ordre et de la discipline au sein de l'établissement pénitentiaire. Ils « participent » en outre « à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion », notamment par leurs contacts quotidiens avec les détenus, qui leur permettent de les informer sur leurs droits et devoirs, de relayer les décisions prises par la direction de l'établissement pénitentiaire, et d'aider les détenus à exprimer leurs demandes. Ils peuvent être assistés de surveillants adjoints, âgés de 18 à 30 ans et recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois59(*).
L'administration pénitentiaire compte plus de 30 600 personnels60(*) de surveillance, soit approximativement un agent pour trois détenus. Conséquence de l'augmentation de la population carcérale et de la construction de nouvelles places de prison, la tendance est à la hausse de l'effectif des personnels de surveillance, puisqu'en dix ans, leur nombre a crû de 13 %61(*). Toutefois, cette hausse des recrutements a suivi un rythme plus lent que la hausse de la population détenue, puisque cette dernière a augmenté de 27,3 % sur la même période62(*), aggravant la dégradation du ratio de « couverture » carcérale (soit le rapport entre le nombre de surveillants et le nombre de détenus au sein de chaque quartier ou établissement).
(2) Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, chevilles ouvrières surchargées de l'individualisation et du suivi des peines
Héritiers des comités de probation et d'assistance aux libérés (CPAL) chargés, dès leur création en 1958, de suivre les peines de sursis avec mise à l'épreuve, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ont été formellement créés par décret en 199963(*) et ont vu les tâches qui leur sont confiées s'accroître au fil des réformes législatives.
Les SPIP sont ainsi « chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice »64(*), qu'elles soient prévenues ou condamnées, incarcérées ou en milieu ouvert.
Pour ce faire, les SPIP doivent « mett[re] en oeuvre les politiques d'insertion et prévention de la récidive, assure[r] le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et prépare[r] la sortie des personnes détenues »65(*). Afin d'individualiser l'exécution de la peine, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire66(*), dans lequel figure l'intégralité des condamnations pénales.
Conformément au principe d'adaptation de l'exécution des peines, les SPIP « procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge »67(*). Ces modalités de prise en charge de la personne condamnée doivent être communiquées par le SPIP à la juridiction de l'application des peines68(*).
Plus concrètement, pour mettre en oeuvre leurs missions, les SPIP travaillent avec les personnes condamnées pour accompagner leur parcours d'exécution de la peine, définir certaines mesures prononcées par l'autorité judiciaire - notamment les travaux d'intérêt général69(*) -, s'assurer que certaines mesures judiciaires sont exécutées, à l'instar des obligations de soins ou de recherche d'emploi, mais aussi préparer la fin de la peine, dans un objectif de réinsertion sociale. À cet accompagnement à caractère social, qui s'appuie notamment sur l'emploi de personnels spécialisés tels que des psychologues ou des assistants de service social, s'ajoute une fonction de contrôle de la probation et des autres mesures alternatives à la privation de liberté. À ce titre, le juge de l'application des peines peut ordonner au SPIP de « s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire »70(*). Dans une logique similaire, le SPIP doit veiller « au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire »71(*).
Le suivi du SPIP commence tôt dans le parcours d'exécution de la peine, puisque les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, hors délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé par le tribunal correctionnel, sont convoquées devant le SPIP dans un délai maximal de trente jours72(*) suivant la condamnation.
Enfin, les SPIP sont les chefs de file en matière de justice restaurative.
Les SPIP constituent donc, indéniablement, un rouage essentiel de l'exécution des peines.
Parallèlement, les SPIP interviennent au stade pré-sentenciel : ils peuvent être mobilisés pour l'élaboration des enquêtes sociales censées éclairer les magistrats dans leur prise de décision en leur permettant d'apprécier la situation du prévenu ou, pour les aménagements de peine, du condamné. Ainsi, le SPIP peut être chargé, à la demande du procureur de la République, « de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête », « la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine » ou encore « le bien-fondé des déclarations d'une personne de nationalité étrangère quant à sa situation personnelle ». Le SPIP est en outre habilité à proposer « les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de la personne intéressée »73(*). Le juge d'instruction peut s'appuyer, de façon similaire, sur les SPIP pour évaluer la situation du prévenu74(*).
En-dehors des difficultés liées à la surpopulation carcérale et au suivi des peines alternatives à la privation de liberté, qui seront examinées infra, quatre principaux freins à la mise en oeuvre des missions des SPIP ont été identifiés par la mission d'information.
En premier lieu, s'oberve une méconnaissance non pas généralisée mais fréquente du rôle des SPIP de la part des juridictions de jugement, en particulier pour ce qui concerne les peines en milieu ouvert. En sus des nombreuses alertes en ce sens émises par les organisations syndicales des SPIP, le ministère de la justice lui-même, par la voix de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), a reconnu l'existence d'une « mauvaise connaissance de l'action des SPIP » de la part des juges correctionnels, malgré la mise à disposition de « fiches correctionnelles » aux présidents de chambres correctionnelles, qui présentent l'offre de peines actualisée des SPIP. Même les représentants des juges de l'application des peines, qui travaillent pourtant étroitement avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, relèvent que « si les rôles de chacun sont clairs dans l'ensemble [...], des tensions peuvent exister [localement] sur certaines attributions »75(*), notamment les délégations horaires au SPIP pour les aménagements de peine. Inversement, les SPIP qui, comme le souligne la DAP, « ne disposent pas de locaux au sein des juridictions, connaissent mal les conditions de prononcé des peines ». Il ressort en effet des auditions de la mission d'information que les SPIP sont, dans l'ensemble, relativement éloignés des tribunaux, comparativement au rôle que leur attribue la législation.
En deuxième lieu, et comme l'ont fait valoir plusieurs organisations syndicales, l'exercice des missions du SPIP est obéré par la vétusté et l'inadéquation de leurs locaux. Certains SPIP sont ainsi hébergés dans des locaux non seulement anciens mais, surtout, qui ne permettent pas l'accueil du public ou sa prise en charge adaptée, ce qui constitue une difficulté majeure alors que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont amenés à rencontrer à de nombreuses reprises les personnes placées sous main de justice qu'ils accompagnent.
En troisième lieu, les effectifs des SPIP sont, malgré une timide amélioration, encore insuffisants pour respecter les standards européens fixés notamment par le Conseil de l'Europe76(*), c'est-à-dire 60 personnes placées sous main de justice par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. D'après les chiffres les plus récents transmis aux rapporteures par le ministère de la justice, ce ratio a diminué à l'échelle nationale, passant de 81 personnes placées sous main de justice par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en 2018 à 65,5 en avril 2025 - un ratio désormais stable depuis deux ans. Cette diminution est liée, d'une part, à l'embauche de 970 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation entre 2018 et 2022, mais également au recours de 320 contractuels, qui représentent 8 % de l'ensemble des conseillers, d'autre part. Sans ce renfort ponctuel, le ratio de personnes placées sous main de justice par conseiller atteindrait 71. Ces chiffres, déjà supérieurs aux normes européennes, sont contestés par les organisations syndicales auditionnées par les rapporteures. En premier lieu, ils ne tiendraient pas compte des arrêts de travail et des temps partiels, le ratio effectif atteignant alors 90 personnes à suivre par conseiller. En second lieu, comme le reconnaît d'ailleurs la direction de l'administration pénitentiaire elle-même, les chiffres nationaux sont une moyenne qui ne saurait masquer « la situation plus dégradée d'un certain nombre de services », certains SPIP affichant un ratio supérieur à 100 personnes placées sous main de justice par conseiller. Cela est d'autant plus vraisemblable que certaines structures, à l'instar des quartiers d'évaluation de la radicalisation ou les unités pour détenus violents disposent d'effectifs renforcés de conseillers, au titre de leur doctrine et de la spécificité des publics qu'elles accueillent, ce qui fait diminuer la moyenne.
En conséquence de ces effectifs encore insuffisants, les SPIP ne peuvent pas assurer avec autant de soin qu'il serait souhaitable - malgré une motivation souvent sans faille - l'entièreté de leurs missions, ce qui nécessite parfois des arbitrages. Comme l'observent de nombreux acteurs externes aux SPIP, à l'instar de l'association Aurore, « la surcharge des services pénitentiaires d'insertion et de probation nuit à la personnalisation du suivi [de la peine] ». Le réseau d'associations Permis de construire relève quant à lui qu'il est « illusoire », alors que « le SPIP se trouve en tension entre deux missions : le contrôle de l'exécution de la peine et l'accompagnement socio-éducatif », « d'attendre qu'un même professionnel assure pleinement ces deux fonctions ». Dans les faits, cette tension amène la plupart des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à privilégier la mission d'accompagnement socio-éducatif, au détriment du contrôle de l'exécution de la peine. La direction de l'administration pénitentiaire reconnaît à cet égard « [qu']une partie des professionnels des SPIP reste très attachée à la mission d'accompagnement social ».
Enfin, les agents des SPIP semblent unanimement souffrir de la concurrence avec le secteur associatif, qui est même qualifiée « d'intrusion » par certaines organisations syndicales. Ce sentiment de concurrence résulte partiellement du manque d'effectifs ; il découle également de la conception par les CPIP de leurs fonctions, vues comme la traduction d'une mission régalienne qui ne saurait être externalisée.
(3) Des acteurs associatifs au rôle mal défini, et donc variable
Des associations spécialement habilitées interviennent aux côtés des SPIP, sur saisine d'un magistrat.
En milieu ouvert, elles sont chargées (concurremment avec les SPIP) d'effectuer des enquêtes sociales rapides, de suivre des contrôles judiciaires ou un sursis probatoire, ou encore de réaliser des stages post-sentenciels. Selon les éléments recueillis par les rapporteures auprès des représentants syndicaux des SPIP, mais aussi auprès des associations habilitées, l'intervention des acteurs associatifs est variable selon les territoires et dépend étroitement de la confiance qui leur est accordée par les magistrats du ressort : il n'existe, en effet, aucun cadre national d'intervention.
En dépit de la rivalité déjà évoquée entre SPIP et associations, il est peu probable que la place grandissante accordée à ces dernières soit à l'avenir amenuisée, la direction de l'administration pénitentiaire considérant qu'« en tout état de cause, la réalisation des missions de réinsertion sociale nécessite, pour l'administration pénitentiaire, de s'appuyer sur un réseau associatif et plus globalement sur la société civile ». Preuve d'une forme d'imprécision et d'un cadre encore trop flou, elle a ajouté que « la répartition des compétences entre les SPIP et les associations mériterait d'être questionnée » et évoqué auprès des rapporteures « l'illisibilité » de cette répartition en matière d'enquêtes sociales rapides.
En milieu fermé, les associations interviennent principalement dans l'accompagnement social des condamnés, constituant un appui utile en matière d'accès à certains droits, de soutien administratif ou d'aide à la recherche d'un hébergement dans la phase de préparation à la sortie de détention. Ici encore, les représentants associatifs auditionnés par la mission d'information ont pointé la grande variabilité des pratiques entre les établissements pénitentiaires, le degré de présence et d'investissement des associations demeurant tributaire de la place que leur confie l'administration pénitentiaire auprès des condamnés détenus.
c) Les forces de sécurité intérieure : une participation à géométrie variable, malgré des initiatives louables
(1) Les forces de sécurité intérieure sont, en théorie, un rouage essentiel de l'exécution des peines
En tant que détentrices de la force publique, la police et la gendarmerie nationales concourent elles aussi à l'exécution des peines.
Si le cadre légal de ce concours est défini, parfois avec précision, par le code de procédure pénale, celui-ci permet toutefois une organisation souple de la mobilisation des forces de sécurité intérieure en disposant, en son article 709, que « le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer [l']exécution » des sentences pénales. Fait notable, cet article fixant le cadre général de l'intervention des forces de sécurité intérieure demeure inchangé depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale, en mars 1959.
Similairement, le code de la justice pénale des mineurs confie aux forces de sécurité intérieure le soin d'assister les juges des enfants pour l'exécution des peines qu'ils prononcent à l'encontre des mineurs, conformément à l'article L. 113-5 dudit code selon lequel « les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur [...] ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé ».
Outre ce cadre général, le code de procédure pénale habilite plus précisément les forces de sécurité intérieure à intervenir à diverses étapes de l'exécution, ou plutôt de l'inexécution, d'une peine.
En premier lieu, les forces de sécurité intérieures peuvent être mobilisées dès l'étape de la notification des jugements, afin de rendre ceux-ci exécutoires. Lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme l'a été après notification à personne d'une convocation devant la juridiction de jugement - notamment par un commissaire de justice - et qu'elle ne s'est pas présentée, le procureur de la République peut ordonner à un officier ou à un agent de police judiciaire de « procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé »77(*). Une fois que l'officier ou l'agent de police judiciaire a découvert l'adresse de la personne condamnée, il doit « lui donne[r] connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ». Autrement dit, nonobstant des réserves jurisprudentielles - substantielles - liées au délai d'appel78(*), l'intervention de la police judiciaire contribue à l'acquisition de la force exécutoire d'un jugement, et donc, le cas échéant, à l'incarcération de la personne.
Si la personne condamnée n'est pas localisée par la police judiciaire, un procès-verbal des recherches est transmis au parquet, qui inscrit ladite personne au fichier des personnes recherchées (FPR).
Une fois la personne condamnée par un jugement ayant force exécutoire, le procureur de la République et le procureur général peuvent « autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci », dans le but « d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion », conformément à l'article 716-5 du code de procédure pénale.
Plus généralement, les forces de sécurité intérieures sont chargées de l'exécution des divers mandats émis par les autorités judiciaires. À ce titre, l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées habilite certains agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale à consulter le fichier des personnes recherchées, dans lequel sont notamment inscrits « les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne »79(*) ainsi que diverses peines et interdictions prononcées par l'autorité judiciaire. Lorsque les forces de sécurité intérieure procèdent à des contrôles ou à des interpellations, même inopinés et sans saisine préalable du parquet, celles-ci sont censées consulter le fichier des personnes recherchées et suivre les instructions du magistrat mandant afin de permettre l'exécution de la peine. En parallèle du FPR, la police nationale s'appuie sur l'outil d'investigation et de communication opérationnelle de police (ODICOP) et la gendarmerie nationale sur le logiciel de partage de l'information opérationnelle (PIO), qui permettent la diffusion et l'échange d'informations à l'échelon départemental, éventuellement étendu aux départements limitrophes. De manière analogue, l'article 74-2 du code de procédure pénale confie aux officiers de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République et dans certains cas déterminés80(*), des prérogatives importantes81(*) aux fins de « rechercher et découvrir une personne en fuite », notamment en cas de crime ou de délit flagrant. Les forces de sécurité intérieure peuvent également être sollicitées par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République lorsque ceux-ci délivrent un mandat d'amener82(*).
Enfin, les forces de sécurité intérieures interviennent en cas de manquements aux obligations ou interdictions résultant d'une condamnation par l'autorité judiciaire.
Conformément à l'article 709-1-1 du code de procédure pénale, « lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne condamnée [pour non-respect d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une peine complémentaire convertie en peine principale ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines] n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation », les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, « [l']appréhender » et la placer en retenue judiciaire pendant vingt-quatre heures au plus « afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations ». À l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines.
Suivant une logique identique, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez une personne condamnée à une interdiction de détention d'une arme, « lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile »83(*). De même, les forces de sécurité intérieure disposent de prérogatives particulières, telles que la localisation d'une personne ou d'un véhicule, sans le consentement de son propriétaire, ou l'interception et l'enregistrement de correspondances électroniques, pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation à certains crimes et délit « lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, [la] personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés »84(*). Cette perquisition ou ce contrôle du respect d'une interdiction de contact ou de paraître ne peuvent avoir lieu d'office et sont soumis à l'accord ou à l'instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines.
Bien que le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique soit assuré par les agents de l'administration pénitentiaire, les services de police et les unités de gendarmerie jouent également un rôle en matière de respect de l'exécution de cette peine, dans la mesure où ils « peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines »85(*). Il en va de même pour le respect des obligations résultant du port d'un bracelet anti-rapprochement, utilisé lorsqu'une interdiction de contact a été ordonnée par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales : bien que ce dispositif relève principalement de l'administration pénitentiaire, les officiers ou agents de police judiciaire habilités sont autorisés à accéder aux données personnelles afférentes « pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée »86(*).
(2) Deux brigades spécialisées concourent à l'exécution des décisions de justice
Pour assurer une part des missions précitées, la préfecture de police de Paris et la direction nationale de la police judiciaire ont toutes deux créé dans les années 2000 des brigades dédiées, respectivement la brigade de l'exécution des décisions de justice (BEDJ), créée en 2000 et devenue une brigade centrale en 2011, et la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), créée en 200687(*). Il n'existe en revanche aucune brigade dédiée exclusivement à ces missions au sein de la gendarmerie nationale. Ces brigades diffèrent des bureaux de l'exécution des peines (voir supra), qui relèvent de l'autorité judiciaire et n'ont pas de fonction d'investigation.
La BEDJ est compétente à la fois pour les condamnations prononcées par les tribunaux de Paris et des départements de la petite couronne, mais aussi pour tout fugitif susceptible de se trouver sur ces territoires, quelle que soit la juridiction de condamnation. Elle est désormais constituée de 60 agents (hors administratifs et réservistes), soit un triplement par rapport aux effectifs initiaux du début des années 2000, dont 42 agents répartis dans les 6 groupes d'enquête généralistes, et 14 dans trois « groupes spéciaux ». Le premier de ces groupes spéciaux est consacré au contrôle pénal. Il effectue principalement des enquêtes sur saisine du juge de l'application des peines et traite des demandes d'agrément d'accès en prison. Le second groupe est chargé de l'exécution et des éventuelles violations commises par les individus inscrits sur les fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d'infractions terroristes ou sexuelles et ayant un domicile à Paris intra-muros. Enfin, le troisième groupe a pour mission de retrouver les domiciles des témoins et exceptionnellement des victimes convoquées par la cour d'assises de Paris exclusivement.
La BEDJ est traditionnellement saisie par les parquets - éventuellement, mais dans des proportions marginales88(*), des parquets non franciliens -, la saisine pouvant toutefois se faire à son initiative propre lorsqu'une information spécifique sur un fugitif lui parvient, ou à la demande d'un partenaire étranger89(*), à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt international.
Le nombre de saisines de la BEDJ - hors activité des groupes spéciaux - oscille, sur les trois dernières années, entre 3 157 saisines, en 2022, et 2 048 saisines, en 2024. Sur l'année 2024, 881 saisines ont donné lieu à une rétention judiciaire.
La brigade nationale de recherche des fugitifs a quant à elle un ressort territorial plus large, mais un périmètre de compétences plus resserré. Rattachée à l'office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) et composée d'une vingtaine de policiers répartis en trois groupes d'enquête, elle exerce deux missions principales. En premier lieu, elle est chargée, sur le fondement de l'article 74-2 du code de procédure pénale précité, d'enquêter sur les dossiers les plus complexes ou sensibles de recherche de fugitifs liés au crime organisé, notamment en cas d'évasion avec violence, qu'il s'agisse de personnes condamnées ou non. En second lieu, elle assure un rôle d'interlocuteur privilégié pour les échanges internationaux en lien avec la recherche de fugitifs. Elle représente également les forces de sécurité intérieure françaises au sein de l'European network of fugitive active search teams (ENFAST). C'est pourquoi, lorsque la BEDJ détecte qu'un fugitif dont elle est saisie se trouve à l'étranger, elle en informe la BNRF, qui prend attache avec les autorités concernées.
À l'instar de la BEDJ, la BNRF est principalement saisie par les parquets, d'autres offices de police judiciaire et les partenaires internationaux. Elle reçoit à ce titre approximativement 1 500 demandes annuelles d'arrestations issues de pays étrangers. Elle agit aussi à sa propre initiative, notamment à travers un travail de veille du fichier des personnes recherchées.
Sans nier l'importance et la qualité du travail fourni, notamment au regard des effectifs dont elle dispose, son activité demeure toutefois modeste, le nombre d'arrestations effectuées chaque année se situant en moyenne autour d'une vingtaine.
Source : commission des lois,
d'après
les données transmises par la direction générale de la
police nationale
(3) Faute de moyens et d'un intérêt pour les missions liées à l'exécution des peines, l'investissement des forces de sécurité intérieure demeure minimal
À l'exception des deux brigades précitées, l'investissement des forces de sécurité intérieure apparaît bien en-deçà du rôle que leur confie le code de procédure pénale.
En premier lieu, les missions liées à l'exécution des peines sont peu connues des services concernés. À titre d'exemple, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a indiqué aux rapporteures que, « pour les services d'enquête, le droit des peines et les cadres légaux de leur intervention en cette matière sont de plus en plus complexes, souvent mal appréhendés [et] ne sont pas maîtrisés ». La DGGN mentionne, en guise d'illustration, que sur les plus de 40 fiches de procédure pénale constituant le fonds documentaire pour l'examen d'officier de police judiciaire, une seule traite des mandats de justice et extraits de jugement. En conséquence, « le cadre légal [résultant de l'article 709-1-1 précité] est méconnu des enquêteurs ». De même, « les mesures prévues par les articles 709-1-2 et 709-1-3 du code de procédure pénale ne sont que rarement utilisées faute d'être connues des enquêteurs ».
Cette méconnaissance trouve partiellement sa source dans le désintérêt des forces de sécurité intérieure pour les missions liées à l'exécution des peines, qu'elles ne perçoivent pas comme prioritaires en comparaison des autres tâches, nombreuses, qui leur incombent. Interrogée par les rapporteures, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice a estimé que « les forces de sécurité intérieure sont réticentes à pleinement investir les prérogatives que la loi leur confie en matière d'exécution des peines, celles-ci considérant qu'elles relèvent, pour partie, de tâches qui s'éloignent de leurs missions premières ». Ce constat est corroboré par les observations transmises aux rapporteures par la DGGN et la direction générale de la police nationale (DGPN). La première relève notamment que « les unités de gendarmerie [...] demeurent culturellement tournées vers des missions de voie publique ou de police judiciaire destinées à présenter à l'autorité judiciaire les auteurs de crimes ou délits ; elles se mobilisent dès lors moins sur l'exécution des peines » ; de même, la seconde considère que « le coeur du métier [de policier], c'est l'enquête, plus que l'exécution de la peine ».
In fine, la contribution des forces de sécurité intérieure aux missions liées à l'exécution des peines est bien évidemment quantitativement importante lorsqu'il s'agit d'exécuter un mandat d'arrêt ou un jugement - la police nationale a ainsi contribué à l'exécution de 28 773 jugements en 2024 - ou, surtout, de le notifier90(*). Pour autant, ni la gendarmerie nationale ni la police nationale n'ont développé de stratégie autonome de contrôle de l'exécution des peines, celui-ci s'effectuant principalement lors des contrôles fortuits (contrôles d'identité, patrouilles, etc.) ou à la suite d'alertes émises à l'aide de téléphones grave danger ou par un bracelet anti-rapprochement91(*). Concernant les fugitifs, la DGPN relève par exemple que « certains malfaiteurs [...] continuent sans difficulté leur cavale tout en faisant l'objet de recherches de moins en moins actives de la part des forces de l'ordre. Ainsi, passé un certain temps [...], sans véritable travail pro-actif de recherche, l'interpellation des fugitifs peut survenir lors d'un passage de frontière, d'un contrôle de voie publique ou d'une implication dans une autre affaire judiciaire ». Or, si des dispositifs permettant aux forces de sécurité intérieure d'agir de leur propre initiative sont prévus par le code de procédure pénale92(*), ils ne sont que rarement mobilisés de façon spontanée par les forces de sécurité intérieure.
Les mêmes difficultés ont été observées par les juges des enfants. Ainsi, l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) a indiqué aux rapporteures qu'« il conviendrait que les forces de l'ordre puissent, de façon effective, apporter leur concours à certains placements en centre éducatifs fermés, notamment à l'issue d'un défèrement. Actuellement, ce sont quasiment toujours les éducateurs de permanence qui se chargent de conduire un mineur en foyer à l'issue de son défèrement, sans aucune contrainte possible, avec un nombre conséquent de fugues immédiates et de mineurs qui ne rejoignent jamais le foyer où ils sont placés. Si le code de la justice pénale des mineurs prévoit la possibilité pour le juge des enfants de requérir le concours de la police ou de la gendarmerie pour accompagner le mineur sur le lieu de placement, [ce concours] se heurte le plus souvent à un refus ou une impossibilité de le faire ».
B. UNE SURPOPULATION CARCÉRALE PARADOXALEMENT AGGRAVÉE PAR LES TENTATIVES DE « GESTION DES FLUX »
La prison demeure, comme l'ont unanimement relevé les personnes auditionnées par la mission d'information, la peine de référence du logiciel pénal français. Elle est la sanction à partir de laquelle toutes les autres sont conçues, comme en témoigne l'appellation commune qui fait de toutes les peines prévues par notre code pénal (stages, placement sous surveillance électronique, travail d'intérêt général, etc.) des « alternatives » à l'emprisonnement.
Au coeur de la conception française du droit pénal, la prison est un outil clé dans l'arsenal répressif. Le recours à l'emprisonnement ferme n'a eu de cesse de se renforcer avec le temps : ainsi, alors que la population augmentait de 18 % entre 1990 et 2024, le nombre de personnes détenues connaissait, quant à lui, une croissance de 67 %.
Ce constat interroge pour plusieurs motifs. La prison, si elle présente l'évidente vertu de neutraliser, pendant un laps de temps prédéfini, les personnes dangereuses, coûte cher : la Cour des comptes rappelle qu'une journée d'incarcération coûte 105 euros par détenu, là où la semi-liberté est deux fois moins onéreuse (50 euros) et la surveillance électronique, dix fois moins (10 euros). Dans le même temps, son bénéfice à long terme pour la société n'est pas établi : 34,6 % des sortants de prison de l'année 2016 ont à nouveau été condamnés pour une infraction commise dans l'année de leur libération ; parallèlement, plus de la moitié (55,4 %) de la même cohorte a commis une nouvelle infraction dans les 3 ans. Dans les cinq ans, le taux de récidive atteint le taux vertigineux de 62,9 %93(*).
En somme, la centralité de la prison ne signifie pas - loin s'en faut - que son rôle, son fonctionnement et les moyens qui lui sont dédiés fassent l'objet d'une vigilance suffisante. La France est, plus que jamais, malade de ses prisons. En dépit du travail accompli à tous niveaux par les personnels impliqués dans la surveillance, la gestion et le suivi des détenus, à l'investissement desquels les rapporteures tiennent à rendre hommage, et dans un contexte de surpopulation carcérale extrême, le milieu fermé échoue désormais à remplir l'une de ses fonctions essentielles : l'amendement des condamnés et, partant, la lutte contre la délinquance par le double biais de la dissuasion et de la réinsertion.
1. Des prisons surpeuplées, dégradées et insuffisamment différenciées
La France est aujourd'hui confrontée à une surpopulation carcérale d'une ampleur sans précédent. Résultant de causes multiples, cette situation a de lourdes conséquences sur le système pénitentiaire et, plus largement, pénal : entassés dans des établissements sur le seul critère de leur statut pénal et de la géographie, donc sans qu'il soit tenu compte de leur profil, les détenus exécutent leurs peines dans des conditions dégradées de prise en charge. À cette difficulté s'ajoutent, pour ceux qui n'étaient pas incarcérés avant l'audience de jugement, des délais d'exécution qui mettent en cause le sens même de la peine.
a) La surpopulation carcérale : une ampleur inédite, des conséquences dramatiques
(1) La surpopulation carcérale, un mal endémique
Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires atteint, à ce jour, des sommets préoccupants - ce qui témoigne, certes, de la fermeté des juridictions pénales, mais aussi d'un recours plus fréquent que la moyenne européenne à l'emprisonnement ferme.
En effet, comme le rappelle le rapport de la mission d'urgence sur l'exécution des peines instituée par le ministre de la justice en novembre 2024 et dont les conclusions ont été rendues publiques en mars 2025, la France se plaçait au 1er janvier 2024 au troisième rang des 53 pays du Conseil de l'Europe en termes de densité carcérale et n'était devancée sur ce terrain que par Chypre et par la Slovénie. Au 5 juin 2025, les prisons françaises comptaient 84 363 détenus, contre 77 889 à la même date l'année précédente, pour une capacité opérationnelle de seulement 62 566 places. Dans les prisons de l'hexagone, ce sont, selon la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), 5 234 détenus qui dorment sur des matelas placés à même le sol.
L'outre-mer connaît une situation particulièrement catastrophique, avec une densité carcérale de 144 % (contre 128 % en moyenne dans l'hexagone).
Cette augmentation de près de 6 500 détenus en une seule année n'est pas répartie de manière homogène et a des conséquences particulièrement lourdes dans certains établissements, à l'image de la prison de Fleury-Mérogis, plus grand établissement pénitentiaire d'Europe, dans lequel on dénombre 4 507 détenus pour 3 254 places (soit un taux d'occupation proche de 140 %).
Nombre de détenus condamnés et condamnés-prévenus en 2022, 2023 et 2024
Source : ministère de la justice,
« Statistique
des établissements et des personnes écrouées en
France »
Doit également être commenté le cas des maisons d'arrêt (MA) et quartiers « maison d'arrêt » (QMA). Y sont accueillis non seulement des prévenus, qui ne sont pas concernés par le présent rapport, mais aussi des condamnés prévenus pour d'autres faits et, surtout, des personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement : 7 personnes détenues sur 1094(*) sont ainsi en MA ou en QMA ; au 1er avril 2024, 61 % des personnes incarcérées dans ces structures étaient des condamnés. Or, la situation des MA et des QMA est extrêmement critique : on y comptait 57 960 personnes en juin 2025, en dépit d'une capacité théorique de seulement 35 032 places, portant le taux d'occupation à un record de 163,2 %.
Cette situation dramatique découle, de toute évidence, de l'insuffisance des capacités du système pénitentiaire français et des difficultés rencontrées par l'administration pour ouvrir de nouvelles places de détention95(*). Mais elle trouve également sa source dans des facteurs juridiques et dans des choix de plus en plus sévères de politique pénale.
En premier lieu, sur un plan strictement statistique, il apparaît que l'augmentation du taux d'occupation des prisons est liée à la croissance de la durée des peines prononcées davantage qu'à l'évolution du nombre des condamnations. En d'autres termes, non seulement les magistrats du fond prononcent régulièrement des peines de prison ferme96(*), mais surtout, lorsqu'ils font ce choix, ils font montre d'une fermeté croissante dans la durée des condamnations. D'après la DAP, depuis 2014, le quantum moyen prononcé est ainsi passé de 8 à 10,2 mois, tandis que la durée moyenne de détention passait de 11,2 à 11,4 mois.
L'augmentation du quantum moyen prononcé constitue un paradoxe, car elle est en contradiction avec la volonté affichée depuis une quinzaine d'années par le législateur comme par les ministres de la justice successifs de permettre l'exécution des peines d'emprisonnement hors du cadre de la détention afin de « dé-saturer » les prisons - dont la surpopulation est tout aussi ancienne que chronique.
Les travaux menés par les rapporteures pour comprendre cette contradiction attestent que la hausse des quantums prononcés et exécutés est, elle-même, le reflet de plusieurs phénomènes conjugués. Elle découle, en effet, de :
- la plus grande sévérité de la justice face à des contentieux autrefois sous-évalués. Tel est, en particulier, le cas pour les violences intrafamiliales : de manière convergente, la DAP souligne que la répression des infractions conjugales représentait 5 % des années d'emprisonnement ferme en 2017 et 12 % en 2023 , tandis que la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) rappelle que, pour le seul contentieux des violences sur conjoint, « on a recensé 6 000 années d'emprisonnement ferme supplémentaires prononcées annuellement entre 2022 et 2023, par rapport à 2018-2019 », cette hausse « expliqu[ant], à [elle] seul[e], deux tiers de l'accroissement total constaté » des années d'emprisonnement ferme prononcées. Plus largement, selon l'Union syndicale des magistrats, ce sont les infractions dans leur ensemble qui se trouveraient sanctionnées avec une fermeté croissante : entendus par les rapporteures, ses représentants soulignaient ainsi que l'indicateur de gravité des peines prononcées (qui correspond au nombre d'années prononcées divisées par celui des années encourues) était passé de 5,4 à 5,6 entre 2021 et 2023 ;
- l'élargissement, par le droit et par la pratique, du recours aux modes de poursuite dits « rapides » (et notamment à la comparution immédiate) qui favorisent statistiquement le prononcé non seulement de peines d'emprisonnement, mais aussi de quantums plus importants ;
- l'absence de « vases communicants » entre le milieu ouvert et le milieu fermé : la volonté affichée par le législateur de développer les peines alternatives à l'incarcération est demeurée sans effet sur le niveau du recours à l'emprisonnement. En témoigne le bilan décevant des tentatives de « régulation carcérale souple », tendant à privilégier le recours à des peines alternatives à l'emprisonnement ferme lorsque les établissements du ressort atteignent un taux d'alerte, et dont l'efficacité se limite au strict court terme ;
L'inefficacité de la régulation carcérale « souple »
Plusieurs ressorts se sont inscrits dans la dynamique initiée par la loi de programmation de la justice de 2019 et ont impulsé des mécanismes de régulation carcérale « souple » au niveau local. C'est le cas notamment à Grenoble et Marseille.
Forts de l'expérience de la crise sanitaire où une action concertée avait permis de réduire drastiquement le niveau local de surpopulation carcérale, les acteurs se sont engagés dans une démarche plus durable et non contraignante en vue de maintenir des taux d'occupation à un niveau « acceptable » (130 % dans l'établissement de Grenoble-Varces et 175 % au quartier maison d'arrêt hommes de l'établissement des Baumettes à Marseille). Lorsque les seuils d'alerte sont atteints, chacun doit mobiliser ses outils pour contenir la dégradation. Le parquet doit ainsi mettre les peines à exécution de façon hiérarchisée, en recourant par exemple aux mandats de dépôt à effet différé. Le SPIP doit repérer les détenus susceptibles de faire l'objet d'une libération anticipée. Le juge de l'application des peines doit examiner de façon anticipée la situation des condamnés ainsi repérés et recourir, le cas échéant, à des procédures allégées. L'établissement pénitentiaire doit enfin accélérer l'affectation des détenus dans d'autres structures [...].
Ces initiatives se sont inscrites dans des contextes locaux de fort engagement en faveur de la nouvelle politique des peines. Ainsi, à Marseille, les juges de l'application des peines ont participé de façon intensive aux audiences de comparution immédiate afin de sensibiliser l'ensemble des magistrats siégeant en audiences correctionnelles aux enjeux et procédures de l'aménagement des peines ab initio. À Grenoble, la nouvelle organisation et la note qui l'a mise en place ont permis de mobiliser magistrats et greffiers autour d'une politique de juridiction clairement définie.
Dans les deux cas, les résultats sont tangibles et se traduisent par un taux d'aménagement de peine ab initio élevé. [...] Pourtant, en dépit de ces résultats, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires concernés ne s'est pas durablement stabilisé.
À Grenoble, le taux de prononcé de peines d'emprisonnement ferme reste similaire à celui atteint au niveau national : 40 % en 2021 et 37 % en 2022 (contre 37 % au niveau national en 2021 ou 2022). Surtout, le nombre de personnes condamnées à des peines de moins de six mois et incarcérées est en constante augmentation depuis 2018, tout comme celui des personnes incarcérées pour des peines allant de six mois à un an. Le taux d'occupation a progressivement remonté et dépassé le seuil de 130 % dès mai 2021. Il atteignait 142 % en 2021 et 156 % au 1er décembre 2022. Des matelas au sol ont dû être réintroduits en septembre 2022.
À Marseille, les résultats ont eux aussi été décevants. Comme à Grenoble, le taux d'occupation carcérale a rapidement remonté pour atteindre 175 % en novembre 2022, ce qui affecte fortement le fonctionnement de l'établissement des Baumettes. Fin 2022, les cellules du quartier arrivant étaient par exemple « triplées » et la durée de séjour y était excessivement longue.
Source : rapport précité de la Cour
des comptes
sur la surpopulation carcérale (octobre 2023)
- les dysfonctionnements des systèmes d'information dont disposent les magistrats, et qui ne leur permettent pas de connaître avec précision l'effet des peines qu'ils prononcent. Ces lacunes, régulièrement dénoncées auprès des rapporteures sous le vocable de « purge des casiers judiciaires », signifient en pratique que le juge du fond n'a pas connaissance, à date, de l'intégralité de la situation pénale de la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel. Il ne peut, par conséquent, pas mesurer l'impact des peines avec sursis qu'une nouvelle condamnation viendra faire mécaniquement « tomber » : le rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines pointe ainsi le cas des « condamné[s] à une peine aménagée qui se retrouve[nt] finalement en détention » du fait de la purge, non-anticipée à l'audience, de leur situation pénale, ce qui préjudicie à l'exécution de leur peine et obère le sens de celle-ci.
De manière inquiétante, il est par ailleurs apparu aux rapporteures que l'augmentation des quantums prononcés - de laquelle découle pour une large partie la surpopulation carcérale - était également le fruit des effets pervers, et non-anticipés, de certaines évolutions législatives pourtant destinées à limiter le recours à l'incarcération. Tel est spécialement le cas de la généralisation des aménagements ab initio par la LOPJ du 23 mars 2019 - qui, comme la mission l'a déjà rappelé, a eu pour principal effet non pas de limiter l'engorgement des prisons en facilitant le recours au milieu ouvert, mais de pousser les juges du fond à prononcer des peines plus lourdes pour échapper aux seuils interdisant la mise en oeuvre effective d'une incarcération.
Les fortes incitations à l'aménagement, par le biais d'une motivation spéciale particulièrement exigeante en cas de placement en détention, pour les peines d'une durée comprise entre six mois et un an a elle aussi eu des effets nets sur l'occupation des prisons : le nombre de détenus condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre un et deux ans, c'est-à-dire juste au-dessus du « seuil » actuel d'aménagement des peines, est en effet passé de 10 640 en 2020 à 14 000 au 1er janvier 202597(*).
Nombreux sont ainsi les facteurs qui convergent pour alourdir la population carcérale, sans que le bénéfice de cette situation pour la société soit apparent : comme les rapporteures l'ont relevé ci-dessus, le taux de récidive se maintient ainsi à un niveau bien trop élevé (plus de 60 % à cinq ans).
Faisant le lien entre la surpopulation carcérale et la récidive, Gérald Darmanin, ministre de la justice, lors de son audition par la commission des lois du Sénat le 28 mai 2025, déclarait ainsi que « le constat fondamental [...] est celui d'une surpopulation carcérale qui gêne énormément la réinsertion des détenus. Je rappelle que notre système enregistre à peu près 70 % de récidive - et on peut présumer que le taux de réitération est plus élevé encore. »
Aux yeux des rapporteures, ce « décrochage » entre la sanction et son utilité finale témoigne d'une dissolution du lien entre la peine et sa signification, entre la prison et l'objectif de relèvement moral et social du condamné : l'incarcération n'assure plus, aujourd'hui, que ses fonctions de « neutralisation » temporaire des personnes qui représentent un danger pour leurs concitoyens ou de punition des comportements les plus contraires aux normes collectives, mais ne permet plus l'investissement sur l'avenir - donc sur la réinsertion - dont elle doit en théorie être la garante.
(2) La création de nouvelles places à l'épreuve du réel : un « plan 15 000 » contrarié, une administration qui peine à recruter
Ainsi que les rapporteures l'ont souligné, l'enjeu de la surpopulation carcérale est intimement lié à celui de la capacité opérationnelle du système pénitentiaire français - capacité que l'État tente d'augmenter depuis plusieurs années.
L'insuffisance du nombre de places en détention soulève, en effet, deux difficultés :
- la principale est évidemment celle de la dignité des détenus, puisque la surpopulation met en cause l'accès de ces derniers à des droits essentiels et qu'elle empêche un suivi personnalisé, garant de la prévention de la récidive (voir infra). La surpopulation contribue, de surcroît, au vieillissement accéléré des établissements, créant par endroits des situations de vétusté avancée qui posent, au-delà du « confort » minimal que les prisons doivent assurer pour les personnes incarcérées comme pour les surveillants pénitentiaires, des problèmes d'hygiène, de santé et de sécurité ;
- la seconde concerne les effets de la surpopulation sur les décisions prises par les juridictions, étant notamment rappelé que le manque de places en détention ne présente pas la même gravité en tous points du territoire. Les représentants des procureurs généraux et des procureurs de la République ont ainsi cité, lors de leur audition par les rapporteures, l'exemple du ressort de la cour d'appel de Grenoble où, en dépit d'une criminalité et d'une délinquance intenses, il n'existe que 64 places pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est à 94 : cette disparité par rapport à la moyenne correspond à un « manque » de 600 places, indépendamment même de la situation générale de surpopulation carcérale existante. Selon les conférences, les particularités locales ne sont pas dénuées de conséquences sur les choix des magistrats : « Il est évident que les décisions des juges sont influencées par une telle situation, les magistrats professionnels étant particulièrement sensibles aux difficultés d'extractions judiciaires qui s'ensuivent ».
C'est dans ce contexte que l'État s'est fixé l'objectif d'accroître les capacités d'accueil des prisons françaises.
Annoncé dès 2017, le « plan 15 000 » visait, comme son nom l'indique, à la création d'environ 15 000 nouvelles places de prison (15 887 places brutes, pour 15 838 places nettes après fermeture des établissements les plus vétustes), dont 7 000 devaient être livrées à l'horizon 2022.
Selon la DAP, en juillet 2025, le bilan du « plan 15 000 » s'établissait de la manière suivante :
- 22 établissements ont été livrés, pour un total de 4 521 places nettes (soit 6 494 places brutes, « défalquées » des fermetures subséquentes d'établissements vétustes) ;
- neuf établissements (sur 28 opérations engagées et restant à livrer) sont en travaux, dont trois devraient être livrés en 202598(*) : ces neuf établissements représenteront 2 917 places nettes - les rapporteures relèvent toutefois qu'il n'est pas possible de préciser leur calendrier effectif de mise en service ;
- neuf opérations sont au stade de l'appel d'offres en vue du choix d'un groupement de construction (notamment à Toulouse, à Nîmes et à Wallis-et-Futuna) ;
- cinq opérations (qui concernent quatre centres pénitentiaires et une structure d'accompagnement à la sortie - SAS) sont en phase d'études de conception, parmi lesquelles la rénovation de prison de Perpignan-Rivesaltes - dont la maison d'arrêt atteint le taux « record » d'occupation de 270 % -, celle du centre de Crisenoy qui comptera un millier de places et celle du centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni ;
- cinq opérations sont au stade des études préalables : elles portent sur trois centres pénitentiaires (à Pau, Magnanville et Saint-Saulve) et deux structures d'accompagnement à la sortie, ou « SAS » (à Lille-Loos et à Châlons-en-Champagne).
L'aspect financier du « plan 15 000 » a été abondamment commenté par Antoine Lefèvre, rapporteur spécial du Sénat sur les crédits de la mission « Justice », dans un rapport de 202399(*) qui a mis en lumière des dérapages budgétaires et calendaires, largement provoqués par des facteurs exogènes (voir infra). Ce rapport décrivait également certains cas particuliers, à l'instar de la rénovation du centre pénitentiaire de Basse-Terre, dont les travaux ont vu leur durée plus que doubler : « alors que la reconstruction aurait dû durer 73 mois, pour s'achever en 2017 - elle ne devrait finalement s'achever qu'au bout de 157 mois (13 ans), à la fin de l'année 2024 ».
Les données obtenues par les rapporteures attestent que les constats formulés par Antoine Lefèvre n'ont rien perdu de leur actualité. Ainsi, en dépit de la situation intenable au sein de cet établissement, les travaux de Bordeaux-Gradignan ne seront toujours pas terminés en 2025, alors même que l'opération accusait déjà deux ans et demi de retard en 2023 et que sa livraison était alors prévue pour 2024.
Outre cet exemple éclairant, les éléments transmis à la mission d'information montrent que le « plan 15 000 » continue de pâtir de difficultés financières et logistiques. Le programme subit en effet des retards ; ceux-ci sont liés, pour une large partie, à l'allongement des délais d'approvisionnement et à la pénurie de certains matériels et matériaux sous l'effet d'abord de la crise sanitaire, puis du contexte international, mais également à la difficulté - initialement sous-estimée - des recherches foncières pour identifier des terrains à construire et à l'engagement de démarches contentieuses qui continuent de bloquer certains chantiers, comme ceux de Muret ou de Magnanville.
Au total, selon la DAP, le calendrier actualisé du plan prévoit un achèvement des chantiers en 2031. Des prévisions récentes (y compris celles transmises fin 2023 à Antoine Lefèvre) visaient pourtant une livraison des 15 000 places en 2027, soit un « recalage » qui repousse de quatre ans l'échéance de livraison des plus de 10 000 places encore attendues.
Le « plan 15 000 » a également présenté de substantiels surcoûts, générés à titre principal par la hausse des coûts des matériels par l'indemnisation au titre de l'imprévision des titulaires des marchés de construction déjà lancés : l'administration estime désormais le coût total du programme à 5,7 milliards d'euros, contre environ 4,3 milliards prévus lors du lancement de l'opération. Les annonces récentes du ministre de la justice quant à la construction prochaine de prisons moins onéreuses100(*) pourraient avoir un impact déflationniste sur ces prévisions : leur impact budgétaire n'a cependant pas encore évalué à ce jour.
Mais le « plan 15 000 » pose un autre problème, de nature structurelle. Quand bien même ce plan serait achevé dans les délais désormais prévus, il apparaît en effet qu'il ne sera pas suffisant pour contenir l'augmentation tendancielle du nombre de détenus. L'addition de la capacité actuelle des établissements français (soit 62 566 places) et des places restant à construire donne, en effet, un total de 73 883 places à l'horizon 2031, ce qui est nettement inférieur au nombre réel des détenus (84 363, pour mémoire). Pour reprendre l'exemple, déjà cité, du centre de Bordeaux-Gradignan, son taux d'occupation se maintient à des niveaux inquiétants : plus de 230 % dans l'ancien bâtiment, mais aussi plus de 200 % dans le nouveau, ouvert en mai 2024101(*).
Le « plan 15 000 » est donc d'ores et déjà obsolète et ne correspond plus à la réalité des besoins du système carcéral français : ce constat a de quoi alarmer.
Aux obstacles rencontrés pour faire croître le nombre de places de détention au même rythme que celui des détenus, s'ajoutent des difficultés tenant au recrutement de personnels dans l'administration pénitentiaire. La France ne dispose pas d'un nombre suffisant de surveillants pour assurer le fonctionnement normal des prisons. Là encore, le constat est largement connu et documenté : les travaux du Sénat (notamment budgétaires) s'en font l'écho. Comme le synthétisait Louis Vogel dans son plus récent rapport pour avis sur les crédits de l'administration pénitentiaire au titre du projet de loi de finances pour 2025102(*) :
« Il y a actuellement 30 600 agents de surveillance au sein de l'administration pénitentiaire ; ce nombre est doublement insuffisant. D'une part, au regard de l'organigramme de référence, qui, s'il était respecté, aboutirait à 2 600 postes supplémentaires pour couvrir les besoins de surveillance de 60 000 détenus avec des personnels travaillant 39 heures par semaine. Insuffisant d'autre part, et peut-être surtout, au regard de la réalité de la situation, qui conduit l'administration à estimer que ce ne sont pas 2 600 mais 6 000 postes qui lui manquent. »
Ces postes « manquants » sont particulièrement préoccupants dans un contexte où l'administration pénitentiaire est, elle aussi victime des conséquences d'une surpopulation carcérale qui rend l'exercice de leur métier par ses agents de plus en plus pénible, difficile et dangereux.
Ainsi, et en dépit des efforts engagés par le ministère (revalorisation statutaire des surveillants et création du statut contractuel de surveillants adjoints, notamment), la couverture de la population carcérale demeure trop restreinte.
b) Des délais d'incarcération excessifs pour les condamnés qui n'entrent pas immédiatement en détention
L'importance accordée à la prison par le système français n'implique pas que les peines d'emprisonnement soient exécutées avec davantage de rapidité ou de diligence que les autres peines. Tout à l'inverse, en dépit de la généralisation des BEX (bureaux de l'exécution des peines) ou du développement de l'exécution provisoire, les délais d'exécution des peines d'emprisonnement ferme pour les condamnés qui ne font pas l'objet d'une exécution immédiate103(*) atteignent des niveaux alarmants. Selon la DAP, et toujours en excluant le cas de l'exécution immédiate, le délai moyen d'exécution des peines d'emprisonnement ferme s'établit ainsi à 13,5 mois.
Cette situation est peu cohérente en droit, les mandats judiciaires de toute nature - et notamment les mandats de dépôt - étant par définition exécutoires immédiatement, sans que l'appel ait sur eux un effet suspensif.
Il n'est compréhensible ni pour la société, ni pour le condamné lui-même qu'une peine de prison ferme, par nature prononcée pour des faits graves, mette en moyenne plus d'un an à être mise à exécution dès lors que la condamnation n'a pas été immédiatement suivie d'effet.
Les rapporteures relèvent en outre qu'une part non-négligeable des peines de prison ferme restent inexécutées après cinq ans : cette proportion avoisine les 10 %.
Source : statistiques du ministère de la justice pour 2024
La mission n'a pas obtenu de chiffres précis sur le nombre total de peines de prison ferme restant en attente d'exécution. Lors de leur audition commune par les rapporteures, la CNPR et la CNPG rappelaient à cet égard que les parquets n'avaient « pas connaissance du nombre des condamnés à des peines d'emprisonnement ferme qui attendent la mise à exécution, la conversion ou l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ». Pire encore, elles ont dévoilé que, sans que ce constat ait une valeur nationale, certains procureurs généraux avaient constaté dans leurs ressorts que « le nombre de peines d'emprisonnement devant être mis à exécution dépass[ait] parfois celles qui sont en cours d'exécution ». Cette grave alerte, qui témoigne de réelles lacunes dans le pilotage et la gestion du système carcéral, doit être considérée avec le plus grand sérieux.
Il est par ailleurs frappant d'observer que le taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme à cinq ans connaît de nettes variations104(*) en fonction du parcours des condamnés. Le délai diffère en effet selon :
- le mode de comparution du mis en cause : les personnes qui comparaissent sur convocation d'un officier de police judiciaire sont ainsi soumises à un taux d'exécution de seulement 60 % à l'horizon d'un an, et inférieur à 90 % à 5 ans (cette durée étant la limite des statistiques établies par le ministère de la justice) ;
- le quantum prononcé : de manière relativement logique, l'exécution est d'autant plus rapide que la peine est longue (47 % d'exécution immédiate et 90 % d'exécution à 5 ans pour une peine inférieure à six mois, contre 89 % d'exécution immédiate et 95 % d'exécution à 5 ans pour les peines de plus de deux ans) ;
- l'état, ou non, de récidive légale : en 2022, 65 % des peines étaient immédiatement mises à exécution pour les condamnés en état de récidive légale (contre 51 % pour non-récidivistes) et 94 % étaient exécutées à 5 ans (contre 89 % pour les autres condamnés) ;
- la nature de l'infraction commise : des « circuits courts » ont été mis en place par certains parquets pour accélérer l'exécution des peines : tel est notamment le cas en matière de violences intrafamiliales.
Mais le principal facteur de variation des taux d'exécution concerne le mode de signification du jugement. En effet, les jugements contradictoires à signifier (c'est-à-dire les décisions prononcées en l'absence de la personne mise en cause) sont - pour d'évidentes raisons - rarement mis à exécution de manière immédiate, alors même qu'ils représentent plus de 20 % des jugements rendus par les tribunaux correctionnels105(*). Cependant, et sans que cette situation puisse s'expliquer avec la même clarté, elles sont beaucoup moins mises à exécution à terme que les autres peines d'emprisonnement ferme : leur taux d'exécution à 5 ans pour 2024 n'est, en effet, que de 76 %, contre 95 % pour les autres types de jugements.
Il y a, en d'autres termes, un intérêt objectif pour les mis en cause à ne pas comparaître : s'ils sont condamnés à une peine de prison ferme mais qu'ils ne se rendent pas à l'audience, ils ont une chance sur cinq de ne jamais être incarcérés.
Selon les personnes entendues par la mission d'information, cette situation s'explique par deux facteurs : en premier lieu, l'insuffisante implication des forces de sécurité intérieure, déjà débordées par leurs autres missions106(*) ; en second lieu, et en pleine cohérence avec les statistiques commentées ci-avant, les obstacles rencontrés dans la signification des jugements.
Les rapporteures ont déjà évoqué107(*) les obstacles rencontrés par les forces de sécurité intérieure pour s'approprier leurs tâches en matière d'exécution des peines.
S'y ajoutent des difficultés, plus structurelles encore, liées à la convocation des mis en cause afin d'assurer leur comparution devant les juridictions pénales, puis à la signification des jugements lorsque ceux-ci ont été rendus en l'absence du condamné. Comme le résume la DACG, « La qualification des jugements a un impact sur les délais d'exécution des condamnations, en particulier lorsqu'il s'agit de jugements nécessitant une signification pour revêtir un caractère exécutoire. Les délais d'exécution et d'acquisition du caractère définitif sont d'autant allongés que les diligences de signification par les commissaires de justice sont longues et les notifications à personne distantes de la condamnation ».
La mission d'urgence sur l'exécution des peines pointe, de manière convergente mais avec davantage de clarté, « la difficulté de mettre à exécution rapidement [l]es peines prononcées hors la présence du prévenu, le processus actuel donnant le sentiment d'une absence de maîtrise de la phase post-sentencielle ».
Sont ainsi en cause les « circuits » par lesquels, d'une part, le mis en cause est convoqué pour être jugé - étant rappelé que la présence du condamné à l'audience est, statistiquement et matériellement, un gage d'exécution plus rapide d'une éventuelle condamnation à une peine de prison ferme - et, d'autre part, la condamnation est ultérieurement signifiée au condamné qui n'a pas comparu à son jugement.
S'agissant du premier des termes de cette équation, l'envoi par courrier des citations à comparaître semble avoir atteint ses limites - comme en témoigne le taux, déjà cité, de jugements rendus en l'absence du mis en cause, qui est supérieur à 20 %. Bien que les services du Gouvernement aient mis en avant, auprès des rapporteures, les progrès liés à la plateforme « Mon suivi justice » (qui permet d'émettre des rappels dématérialisés en amont de certaines convocations), force est de constater que celle-ci présente deux limites : premièrement, elle n'est déployée que dans certains tribunaux judiciaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation ; deuxièmement (et principalement), elle n'est opérationnelle qu'au stade post-sentenciel et ne permet pas encore de favoriser la présence des mis en cause à l'audience de jugement.
Sur le second point, la signification des jugements, la situation est préoccupante. Ainsi que le rappelle la mission d'urgence sur l'exécution des peines, les commissaires de justice, en première ligne dans pour signifier les jugements de condamnation aux mis en cause qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont qu'un accès restreint aux données administratives qui permettent de localiser les condamnés (et notamment aux fichiers fiscaux et sociaux), donnant lieu à des situations inextricables en cas de changement d'adresse. Il existe, certes, depuis la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire de 2021108(*), une possibilité de signification des condamnations pénales par voie électronique. Cette disposition est toutefois restée lettre morte : après la publication, bien tardive, du décret requis109(*), un applicatif dédié appelé Notidoc aurait dû être déployé pour assurer la transmission des jugements à signifier par voie électronique. Toutefois, le Gouvernement n'a pas pris l'arrêté technique nécessaire pour autoriser une telle méthode de signification : la signification dématérialisée, pourtant promue par le législateur depuis près de quatre ans, reste donc inutilisable pour les commissaires de justice.
C'est ainsi que, en 2023, la signification des jugements a fréquemment dépassé le délai maximal de 45 jours fixé par l'article 559-1 du code de procédure pénale (seules 43 % des significations, donc une minorité, ont respecté ce délai), la majorité d'entre elles ayant bénéficié de la possibilité, théoriquement dérogatoire, d'une augmentation de délai accordée par le procureur de la République et pouvant aller jusqu'à trois mois110(*).
Plus généralement, la mission rappelle que la rédaction actuelle du code de procédure pénale impose à l'autorité judiciaire, comme condition sine qua non de toute transmission électronique en matière pénale, d'obtenir le consentement exprès de la personne mise en cause : cette formule n'est aujourd'hui que rarement utilisée, les juridictions n'ayant pas acquis le réflexe de recueillir ce consentement - ni a fortiori celui de demander à la personne poursuivie de déclarer ses coordonnées numériques.
En somme, ni les FSI, faute de temps et d'investissement, ni les commissaires de justice, faute d'outils techniques adaptés, ne disposent des moyens requis pour assurer l'exécution effective des peines de prison ferme. Dans un contexte où le nombre de condamnations prononcées en l'absence du condamné demeure important, ces deux facteurs ont conduit à une dégradation substantielle du délai moyen d'exécution des peines de prison ferme, posant la double question de la juste sanction des infractions commises par les condamnés et de la crédibilité de la justice aux yeux des citoyens.
c) Des conditions de détention qui font obstacle à la réinsertion des condamnés
Incarcérés, parfois tardivement, dans des prisons saturées (et pour certaines insalubres), les détenus n'y bénéficient pas d'un suivi permettant de favoriser leur réinsertion dans la société à leur libération - et cette situation n'est, de toute évidence, qu'aggravée par la surpopulation carcérale.
(1) L'insuffisante différenciation des établissements pénitentiaires, obstacle à la réinsertion
Le premier obstacle à la réinsertion tient au fait que les prisons françaises ne permettent pas, en pratique, une prise en charge différenciée selon le profil des détenus.
La population carcérale présente, en effet, une diversité notable, en particulier si l'on s'essaie à une classification des détenus non pas en fonction de leur statut pénal (prévenu ou détenu), comme le prévoit le droit actuellement en vigueur, mais selon la nature de l'infraction commise. Lors d'une table ronde d'universitaires menée par les rapporteures, Francis Habouzit, maître de conférences de l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) soulignait que les personnes condamnées pour des atteintes aux biens, à la circulation et pour des infractions financières et sociales représentaient 33,6 % des personnes écrouées en 2023 et 32 % de la population pénale totale, tandis que les personnes ayant commis des atteintes aux personnes représentaient « seulement » 49 % de cette même population.
De toute évidence, les détenus pour des infractions au code de la route ou pour des atteintes aux biens ne présentent pas la même dangerosité que ceux qui ont été condamnés pour des violences contre les personnes, et ils ne relèvent pas du même parcours de peine et de réinsertion. Cette analyse est soutenue par le droit puisque, en théorie, les condamnés font l'objet d'une orientation personnalisée en fonction de leur profil et doivent être affectés dans les établissements dans lesquels ils bénéficieront des meilleures chances d'accompagnement et de prise en charge.
Les règles d'orientation des personnes condamnées à une peine de prison ferme
Concernant les condamnés, conformément à la circulaire du 21 février 2012 relative à l'orientation des personnes détenues, la dangerosité demeure le critère principal de détermination de l'affectation des condamnés. La direction de l'administration pénitentiaire dispose d'un parc d'établissement pour peine diversifiés allant des structures d'accompagnement vers la sortie aux maisons centrales dont le régime est orienté vers la sécurité, en passant par des centres de détentions présentant des niveaux de sécurité passives et dynamiques différents. Dès lors, les seules limites à l'affectation demeurent aujourd'hui la disponibilité des places et le respect du droit au maintien des liens familiaux qui peut être source de contentieux malgré le développement des dispositifs de visiophonie et de téléphonie. [...]
Dans les faits, si l'administration pénitentiaire est sollicitée en amont de l'incarcération d'une personne détenue identifiée pour sa dangerosité, il est possible de pouvoir proposer une affectation conforme aux profils de l'intéressé.
À ce titre, la direction de l'administration pénitentiaire établit par voie de note, des listes d'établissement identifiés spécifiquement pour l'accueil de certains profils.
Pour les personnes prévenues pour des faits de terrorisme en lien avec l'islam radical, l'administration pénitentiaire a établi en 2020 et réactualisé en 2023, une liste d'établissements présentant un niveau de sécurité adapté et des possibilités de prise en charge conformes à la stratégie de lutte contre la radicalisation violente.
L'existence d'une juridiction de compétence nationale a également permis de développer des chaînes de communication fluides et efficaces permettant aux magistrats de disposer en temps réel des informations nécessaires à la détermination du lieu d'incarcération.
Une liste des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt adaptés à l'incarcération des personnes détenues appartenant à la criminalité organisée a également été diffusée le 10 octobre 2024 conformément aux recommandations de l'IGJ (Inspection générale de la justice) suite au drame d'Incarville.
Source : direction de l'administration pénitentiaire
Ces éléments théoriques ne sont toutefois que peu respectés en pratique : la mission d'urgence sur l'exécution des peines rappelait à ce titre que « les prises en charge spécifiques ne concernent qu'un petit nombre de condamnés incarcérés ».
En effet, pour des raisons tenant notamment - et légitimement - à la préservation des liens entre les personnes condamnées et leurs proches pendant la durée d'exécution de la peine, des détenus aux profils très divers se trouvent incarcérés dans les mêmes établissements, voire dans les mêmes quartiers.
Hors même du contexte de surpopulation carcérale, nombre de parcours destinés à des détenus aux profils particuliers sont, ainsi, insuffisamment exploités. À titre d'illustration, et sur le sujet particulier des auteurs d'infractions à caractère sexuel, les rapporteures renvoient aux récents travaux de la mission commune de contrôle de la commission des lois et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes : celle-ci avait démontré, dans son rapport « Prévention de la récidive du viol : prendre en charge les auteurs pour éviter de nouvelles victimes »111(*), que seule une minorité d'auteurs d'infractions sexuelles (environ un tiers) étaient effectivement orientés vers l'un des 22 établissements « fléchés » pour les accueillir (car offrant un suivi médical et psychologique adapté) et que, parallèlement, plus de la moitié de ces établissements n'accueillaient qu'une faible proportion de tels délinquants (moins de la moitié, voire moins de 20 % pour trois d'entre eux).
A contrario, en dépit de la diversité théorique des établissements et des parcours, certains besoins ne sont pas pris en compte par le système carcéral. Au cours des travaux de la mission d'information, des difficultés ont été « remontées » par les acteurs de terrain quant à l'insuffisance du nombre des établissements (ou des quartiers) adaptés aux profils des auteurs de violences conjugales. Souvent mieux insérés socialement que les autres détenus, susceptibles d'être soumis à des dispositifs de sécurité simplifiés, les auteurs de telles violences doivent cependant être soumis à un suivi socio-éducatif renforcé ; or, le nombre de places permettant un tel suivi est extrêmement limité112(*). Ce déficit de l'« offre » carcérale pose de réelles difficultés dans un contexte où, comme on l'a relevé ci-avant, le nombre de condamnations à des peines de prison ferme en matière de violences intrafamiliales connaît depuis plusieurs années une augmentation forte et continue.
Ce délétère « mélange des genres » ne peut être qu'amplifié par la surpopulation carcérale : comme l'ont confirmé les praticiens entendus par la mission d'information, celle-ci interdit une gestion fine des occupants des différents quartiers (et a fortiori des différentes cellules) et impose dans de nombreux cas des choix d'affectation à flux tendu. Certains magistrats entendus par les rapporteures ont ainsi décrit le cas de condamnés pour conduite en état d'ivresse se trouvant dans la même cellule que des délinquants au profil lourd, faute d'une autre solution au vu de la saturation des établissements pour peines - notamment dans plusieurs collectivités territoriales d'outre-mer. De manière plus préoccupante encore, dans un contexte de promiscuité qui rend plus fréquentes les violences entre détenus, la Cour des comptes relevait que des affectations qui favorisent la commission de nouvelles infractions pouvaient être mises en place pour maintenir une forme de « paix civile » dans les prisons : « le souci de préserver le calme en détention peut ainsi conduire à placer ensemble des détenus qui partagent une même origine géographique, une même langue, voire un même cercle de sociabilité, ce qui constitue un facteur aggravant de la récidive »113(*).
Au-delà de la gestion des détenus d'un même établissement, la surpopulation a des conséquences particulièrement néfastes sur le maintien des spécificités de chaque quartier ou établissement. Ce constat, qui vaut notamment pour les quartiers « arrivants »114(*), est particulièrement criant s'agissant des prisons tournées vers la lutte contre la récidive, détournées de leur vocation. Ainsi, « alors que les établissements ou quartiers spécifiques orientés vers la sécurité [à l'image des quartiers dédiés à l'évaluation ou à la prévention de la radicalisation ou, plus récemment, des quartiers de lutte contre la criminalité organisée] ne sont pas impactés par la surpopulation, certains de ceux tournés vers l'insertion sont menacés », à l'image des structures de préparation à la sortie (SAS) et des quartiers (ou centres) de semi-liberté115(*) qui accueillent désormais des détenus qui n'ont pas le profil idoine, dans le seul but de soulager la maison d'arrêt la plus proche.
Désormais tournée non plus vers l'individualisation des peines, mais vers la prise en charge de l'urgence le désengorgement des établissements les plus surpeuplés, la gestion des affectations génère en outre des transferts qui aggravent la situation de l'administration pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires en charge des transfèrements sont ainsi dans une situation de perpétuelle tension qui désorganise l'ensemble de la chaîne logistique : c'est ainsi que les équipes nationales spécialisées dans la prise en charge d'opérations de haute sécurité ont été mobilisées par la DAP pour gérer les désencombrements de la prison de Toulouse-Seysses116(*), parmi les plus saturées de France (elle était occupée à près de 160 % au 1er juillet 2025, la moyenne nationale s'établissant alors à 135 %), ce qui en retour nourrit les difficultés rencontrées pour les autres extractions, y compris judiciaires.
La surpopulation carcérale vient ainsi « met[tre] en échec toute politique d'orientation crédible des détenus, hormis ceux classés dangereux, c'est-à-dire la minorité des publics accueillis »117(*).
(2) Des moyens faméliques de suivi, de formation et de soin en détention
Au-delà de l'enjeu de l'orientation des détenus dans des établissements adaptés à leur profil, les rapporteures observent que les moyens de prise en charge sont insuffisants dans la plupart des prisons. Suivi social, formation professionnelle, soins de toute nature (médicaux, psychologiques ou psychiatriques). Malgré l'engagement des personnels de l'administration pénitentiaire, des soignants et des associations qui interviennent en détention, les lacunes sont criantes dans tous les domaines.
S'agissant, tout d'abord, du suivi individuel des détenus, les rapporteures rappellent que les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) manquent cruellement d'effectifs et de moyens118(*). Cette situation est aggravée par le faible nombre, documenté par la Cour des comptes, de personnels spécialisés (psychologues et les assistants de service social) au sein des SPIP.
Par-delà ces moyens restreints, les conseillers d'insertion et de probation (CPIP) ne sont pas dotés d'une doctrine adaptée au milieu fermé : le référentiel de pratiques professionnelles sur lequel ils s'appuient, le RPO1, est inspiré du suivi en milieu ouvert et fonde leur intervention sur des entretiens en face à face réguliers, permettant notamment d'évaluer le risque de récidive et de mettre en place des actions proportionnées à l'intensité de ce dernier. Or, l'importance des flux d'arrivants en détention et la durée très variable des peines ne permettent pas une mise en oeuvre effective de cette méthodologie.
Ce constat est préoccupant dans une situation où les détenus se trouvent, pour nombre d'entre eux, dans une précarité sociale qui rend indispensable les actions d'insertion et de prise en charge sociale au cours de la détention. La DAP indiquait ainsi aux rapporteures que 53 % des personnes détenues n'avaient pas de qualification professionnelle, que près d'un quart étaient sans ressources et que 10 % d'entre elles étaient sans domicile fixe lors de leur entrée en détention ; par ailleurs, 40 % de détenus n'ont pas de solution d'hébergement à la sortie.
Alors même que les prisons prennent en charge des « publics » plus fragiles que la moyenne, l'accompagnement des détenus reste ainsi obéré par de lourdes difficultés :
- des freins persistent en matière d'accès au travail et à la formation en détention. Alors que le travail pénitentiaire joue, de l'aveu même de l'administration, « un rôle essentiel dans la réinsertion », seule une minorité de détenus (43 %) y a accès - et ce, en dépit de la réforme intervenue en 2021 avec la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire119(*). Le taux d'emploi est encore plus bas pour les condamnés à des courtes peines, qui sont pourtant les plus nombreuses : selon le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le taux de personnes détenues ayant occupé un emploi est inférieur à 15 % lorsque la peine exécutée présente une durée inférieure à six mois120(*). Des progrès sont toutefois à l'oeuvre : la DAP a ainsi indiqué aux rapporteures que, entre 2023 et mi-2025, 78 nouvelles entreprises se sont implantées en détention, avec des « activités plus diversifiées et adaptées ». Des avancées analogues peuvent être relevées en matière de formation professionnelle, avec une hausse de 23 % du nombre de places offertes entre 2020 et 2024 ; le volume brut de ces places reste toutefois limité (11 800), ce qui ne permet qu'à 12,5 % des détenus d'en bénéficier, avec - là encore - de fortes disparités selon les régions ;
- les moyens déployés en matière d'éducation demeurent inadaptés aux enjeux. Alors que plus de la moitié des détenus majeurs n'a aucune qualification professionnelle (voir supra) et que, selon la DAP, 9 % d'entre eux sont illettrés ou en grande difficulté avec l'écrit, seuls 30 % des majeurs bénéficient d'un temp d'enseignement en détention, et seuls 765 ETP sont mis à la disposition de l'administration pénitentiaire par le ministère de l'éducation nationale pour l'accompagnement des détenus, majeurs comme mineurs ;
- l'intégration du secteur associatif aux actions sociales menées en détention reste trop variable selon les territoires : les associations d'accompagnement rencontrées par les rapporteures ont ainsi pointé d'importantes disparités qui semblent, trop souvent, liées à une méconnaissance, voire à une défiance à l'égard du secteur social de la part des acteurs institutionnels. Cette situation ne peut qu'être déplorée, tant l'utilité des associations est grande pour la préparation des détenus à la sortie, notamment en matière d'accès à l'hébergement.
Si la réinsertion sociale et professionnelle présente des lacunes, le domaine le plus sinistré est celui du soin en prison. Récemment entendu par la commission des lois121(*), Gérald Darmanin, ministre de la justice, estimait à 25 % le nombre de personnes atteintes de troubles psychiatriques en détention ; la direction de l'administration pénitentiaire présente des chiffres plus élevés encore, indiquant à la mission que « les troubles psychiatriques ou les troubles liés à l'usage de substance [i.e., de stupéfiants] touchent deux tiers des hommes et trois quarts des femmes (49% étaient déjà suivis en psychiatrie ou addictologie ; 20% avaient déjà été hospitalisés en psychiatrie) ».
Selon le Cese, le diagnostic est plus lourd encore : ce seraient ainsi huit hommes sur dix et sept femmes sur dix qui souffriraient d'au moins un trouble psychiatrique.
Au-delà des chiffres, lors de son audition, le ministre de la justice déclarait : « nous enfermons les fous, et c'est une indignité pour tout le monde : pour les personnes concernées - l'enfermement dans une cellule de 9 mètres carrés n'étant pas susceptible d'apaiser leurs troubles psychiatriques -, pour les agents pénitentiaires, qui subissent d'importantes difficultés, et pour la société ».
Or, non seulement la France enferme des fous, mais surtout elle ne leur permet pas de se soigner au cours de leur peine. Plusieurs chiffres en témoignent, à l'instar du nombre important de suicides en prison (125 en 2022, soit six fois plus qu'en population générale) ou du taux de prévalence des addictions à l'issue de l'exécution de la peine (malgré des dispositions qui prévoient expressément le déploiement des outils de réduction des risques et des dommages en milieu carcéral122(*), 39 % des sortants de prison sont dépendants aux drogues, à l'alcool ou aux psychotropes).
Mais, au-delà de la santé mentale, c'est l'ensemble des soins médicaux qui pose difficulté. Selon les indications transmises aux rapporteures par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, un défaut d'accès aux soins est régulièrement constaté lors des visites d'établissements pénitentiaires. Les moyens sont en effet sous-dimensionnés : les effectifs de soignants au sein des unités sanitaires sont attribués en fonction non pas du nombre réel de détenus, mais du nombre de places théoriques dans les établissements. Les unités sanitaires n'ont ainsi d'autre choix que de « prioriser, chaque jour, les soins les plus urgents, ce qui constitue une perte de chance pour les autres patients »123(*).
Outre des effectifs insuffisants, les unités sanitaires ne sont pas assez dotées en compétences spécialisées124(*). Dès lors, de nombreuses consultations (pour des soins dentaires, ophtalmologiques, dermatologiques, oncologiques, gynécologiques, ORL, d'imagerie médicale, etc.), doivent être effectuées à l'extérieur des établissements. Comme le résume un récent rapport de la CGLPL, cette situation emporte deux conséquences néfastes : tout d'abord, les consultations extérieures imposent des extractions, lourdes en effectifs pour l'administration pénitentiaire. Nombreux sont ainsi les rendez-vous médicaux annulés, le détenu n'ayant pas pu être convoyé jusqu'à la structure médicale compétente en raison d'un manque de disponibilité des surveillants pénitentiaires, requis par d'autres impératifs. Corrélativement, le suivi médical des personnes détenues intervient tardivement, et certaines se trouvent confrontées pendant de longues périodes à « l'impossibilité d'obtenir une paire de lunettes, des appareils auditifs ou des prothèses dentaires, dont le besoin, bien que banal, est de ceux auquel on ne peut se soustraire ».
2. Les aménagements de peine et la libération sous contrainte : des solutions de facilité ?
Les rapporteures ont décrit, ci-avant, les incohérences du droit en vigueur s'agissant des aménagements de peine et des diminutions de la durée effective de la détention (par le biais des réductions de peine et des libérations sous contrainte) : ces outils sont ceux d'une régulation carcérale qui ne dit pas son nom.
Outre les aspects juridiques du sujet, déjà évoqués, les travaux de la mission attestent que les plus récentes réformes législatives se sont traduites en pratique par une stricte logique de « gestion des flux », facteur de sorties sèches (donc de fragilisation de la lutte contre la récidive) et de perte de sens pour les condamnés comme pour les citoyens.
a) Une logique de « gestion des flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...
Plusieurs séries de dispositions convergent pour limiter, parfois de manière purement mécanique, la surpopulation carcérale : il s'agit, d'une part, de celles qui incitent à l'aménagement ab initio (donc dès le prononcé de la condamnation et de la sanction associée) des peines de prison ferme et, d'autre part, de celles qui visent à raccourcir la durée réelle de la peine.
S'agissant, tout d'abord, des aménagements de peine, ceux-ci ont été - comme on l'a vu - renforcés par la LOPJ du 23 mars 2019 : la loi se cumulant avec un revirement de jurisprudence particulièrement contraignant125(*), ils sont désormais obligatoires (sauf cas exceptionnels) non seulement pour les peines de moins de six mois, comme l'avait souhaité le législateur, mais aussi pour celles dont la durée est comprise entre six mois et un an.
Ces évolutions ont eu des effets visibles sur la pratique des juges du fond :
- 41 % des peines d'emprisonnement ont fait l'objet d'un aménagement ou d'une conversion avant toute incarcération en 2023, contre 33 % en 2019126(*) ;
- les aménagements sont particulièrement fréquents pour les peines dont la durée est comprise entre trois et six mois : environ 43 % de ces peines sont aménagées à quelque stade que ce soit127(*), contre 33 % des peines de moins de trois mois, 39 % des peines comprises entre six mois et un an et moins de 6 % des peines supérieures à un an.
Les statistiques publiées par le ministère de la justice montrent, par ailleurs, que 81 % de ces aménagements ont pris la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique en 2023, les représentants des juges de l'application des peines estimant pour leur part que le taux actuel de recours à la DDSE dépasse les 90 %.
Les rapporteures ne peuvent que constater que ces dispositions ont, dans les faits, échoué à atteindre leur objectif de désengorgement des prisons.
La mission a déjà décrit l'effet de « contournement » qui a conduit les juges du fond à prononcer des peines de prison ferme plus longues pour échapper à des aménagements devenus quasiment automatiques pour toute peine de moins d'un an (voir supra). Les rapporteures constatent par ailleurs que, moins souvent prononcé, l'emprisonnement ferme a été plus souvent mis à exécution. Selon les chiffres communiqués par la DACG, l'augmentation des aménagements et la réduction concomitante de l'emprisonnement (60 %, contre 67 % dans la période antérieure à la réforme) ont été « gagées » par une forte croissance des incarcérations immédiates à l'audience : celles-ci passent de 51 % en 2019 à 65 % en 2023128(*), amenuisant les effets attendus de la réforme en matière de lutte contre la surpopulation carcérale.
Non moins décevantes sont les réformes récentes de la fin de peine, et en particulier la modification des conditions d'octroi des réductions de peine et des libérations sous contrainte que les rapporteures ont décrites ci-dessus129(*).
Comme le rappelle la Cour des comptes130(*), alors que l'étude d'impact de la loi du 15 août 2014 estimait entre 14 000 et 29 000 le nombre de détenus susceptibles de se voir accorder une libération sous contrainte, seules 3 000 mesures environ ont été mises en oeuvre entre 2015 et 2018 (soit près de dix fois moins que les prévisions les plus optimistes, et cinq fois moins que les plus pessimistes). Les réformes postérieures n'ont pas davantage permis la « massification » escomptée : les modifications impulsées par la LOPJ de 2019 n'ont porté qu'à 6 000 le nombre de LSC octroyées annuellement entre 2019 et 2021.
Outre son bilan qualitatif préoccupant (voir infra), la systématisation des LSC, devenues « de plein droit » (LCS-D) en 2021, n'a pas complètement résolu les difficultés observées par le passé. Ces libérations se sont en effet affirmées comme un outil de gestion des flux plutôt que comme un levier de meilleure gestion des fins de peine. En témoigne le croisement des statistiques présentées, d'une part, par le ministère de la justice et, d'autre part, par la mission d'urgence sur l'exécution des peines : alors que les premières131(*) témoignent d'un taux d'aménagement avant libération qui avoisinerait désormais les 50 % (le taux est, pour 2024, de 58 % pour les condamnés criminels et de 47 % pour les condamnés pour délits, nettement plus nombreux - 53 400 sorties correctionnelles contre 2 400 sorties criminelles), les secondes pointent un taux d'aménagement de fin de peine de 23,8 % hors LSC-D132(*). En d'autres termes, et par déduction, ce seraient environ 26 % des sorties qui se feraient sous la forme de LSC-D, soit 14 500 sorties en 2024 : ce chiffre correspond à peine au niveau des projections les moins favorables faites par le Gouvernement lors de la création de la mesure, en 2014, semblant montrer que la mesure peine à trouver son public.
Plus largement, « le ratio entre les détenus éligibles à la LSC-D et ceux auxquels elle bénéficie montre un dispositif souvent inadapté voire en quête de sens »133(*) : il était de 63 % en février 2024, bien loin du principe selon lequel cette libération doit être accordée à tous les détenus, qu'ils y consentent ou non, dès lors qu'ils disposent d'une solution d'hébergement134(*).
L'effet aggravateur de la LSC-D sur la surpopulation carcérale a déjà été commenté par les rapporteures, qui ont mis en lumière la plus grande sévérité du nouveau régime par rapport au précédent, à rebours des objectifs affichés par le Gouvernement comme de l'intention du législateur. Il apparaît, en complément, que l'échec de la LSC-D tient à la nouvelle temporalité de l'examen des réductions de peine, plus précoce et moins fréquente que par le passé. L'USM rappelait ainsi à la mission que, « sur les petites et moyennes peines, l'examen [des éventuelles réductions de peine] est très anticipé et donc ne permet pas d'apprécier les efforts fournis. [...] Le système actuel des réductions de peines implique, pour les courtes peines, un examen des situations pénales dans les premières semaines ou les premiers mois d'incarcération, ce qui n'est nullement révélateur du parcours du condamné et de son évolution. Ainsi, les juges d'application des peines sont obligés de statuer ``à l'aveugle'' sur une période non encore exécutée ».
La conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires a appuyé ce constat, considérant que « le nouveau système de réduction de peines conduit à examiner très en amont de la sortie la situation d'un condamné et à ``parier'' ou ``anticiper'' sur ses efforts ».
À l'évidence, cette incertitude ne favorise pas l'octroi d'une réduction fondée sur la volonté de réinsertion, a fortiori dans un contexte où la surpopulation carcérale génère de réelles difficultés dans l'accès aux soins et aux activités en détention - qui sont pourtant autant d'indicateurs des « efforts de réadaptation » exigés par la loi...
Le système des réductions de peine semble, dès lors, s'être transformé en serpent qui se mord la queue : les mesures mises en place pour lutter contre la surpopulation viennent en pratique l'aggraver, et cette aggravation vient en retour nourrir l'inefficacité des modifications décidées par le législateur.
b) ... qui favorise les sorties « sèches » et prive la sanction de son sens
Outre ses effets quantitatifs décevants, puisqu'elles n'ont pas réussi à endiguer la surpopulation carcérale - voire l'ont renforcée -, les réformes législatives récentes posent des problèmes qualitatifs majeurs. Non seulement elles rendent plus difficile la gestion de la fin de peine (date de libération plus incertaine, proportion encore forte de « sorties sèches », etc.), mais elles viennent aussi contribuer au « brouillage » du sens de la peine pour les condamnés et pour les citoyens.
(1) Les effets pervers des aménagements de peine
La hausse du recours aux aménagements de peine, ab initio ou en fin de peine, ne va pas sans difficultés, dans la mesure où la forme qu'ils empruntent a un net impact sur leurs effets en matière de lutte contre la récidive.
S'agissant tout d'abord des aménagements ab initio (donc de ceux qui sont prononcés dès l'audience de jugement et évitent toute incarcération à des personnes condamnées à des peines de prison ferme de courte durée), force est de constater qu'ils sont fréquemment retenus sans que le juge du fond ne dispose d'éléments suffisants sur la situation économique, sociale, familiale et personnelle du condamné. Cette situation tient à la fois à la « disparité [...] en termes de qualité » des enquêtes sociales rapides menées par les associations et à l'absence d'intervention des CPIP lors de la phase pré-sentencielle135(*). Agissant à l'aveugle, ou a minima dans un brouillard plus ou moins dense, le juge du fond est poussé à privilégier des modes d'exécution génériques et peu personnalisables, comme la détention à domicile sous surveillance électronique qui représente plus de 80 % de tels aménagements. L'étude des statistiques sur le temps long témoigne ainsi de la marginalité, en proportion comme en valeur absolue, des placements à l'extérieur et des semi-libertés, l'essentiel de la croissance des aménagements ayant été absorbée par les libérations conditionnelles et, surtout, les DDSE.
Répartition des aménagements de peine et des libérations sous contrainte
Source : Cour des comptes, sur la base des
données du ministère de la justice,
rapport
précité sur la surpopulation carcérale, octobre
2023
Cette évolution est préoccupante car, comme l'a rappelé l'ANJAP aux rapporteures, les placements sous bracelet électronique n'ont « pas toujours beaucoup de contenu, d'autant moins au vu de leur nombre actuel qui ne permet plus un suivi qualitatif ». En attestent des études selon lesquelles la capacité du bracelet électronique à contenir la récidive a décru au fur et à mesure de la montée en puissance de la mesure, son développement s'étant accompagné d'une baisse des mesures d'accompagnement136(*).
Corrélativement, et comme l'ont unanimement observé les personnes entendues par la mission d'information, la généralisation des aménagements s'est faite au détriment de modes d'exécution des peines permettant un accompagnement individualisé mais qui supposent par nature une évaluation et une préparation en amont que l'aménagement ab initio ne semble pas permettre.
Le développement des aménagements de peine ab initio, qui limite l'intervention des magistrats spécialisés aux cas de placement effectif en détention, conduit également à une marginalisation progressive des juges de l'application des peines, déjà évoquée, dont le rôle tend à devenir celui de « juge de l'incident ».
Il se traduit également, comme l'indique la CNPTJ, par un accroissement de la charge de travail des juridictions correctionnelles : l'obligation pour le juge du fond de rechercher un aménagement, dans le contexte dégradé et incertain qui a déjà été décrit, constitue ainsi « une des explications de la diminution constante du nombre de dossiers jugés à chaque audience correctionnelle ».
(2) La libération sous contrainte de plein droit, facteur d'illisibilité sur le déroulé de la peine et d'augmentation des « sorties sèches »
La libération sous contrainte de plein droit génère, elle aussi, de lourdes défaillances dans la gestion de la peine. Elle a été critiquée, avec une remarquable unanimité, par l'intégralité des acteurs entendus par les rapporteures, qui y ont vu une forme de régulation carcérale à peine dissimulée, sans lien avec l'intérêt du détenu ou la promotion de sa réinsertion.
Les personnes auditionnées par la mission ont également rappelé que la mise en place que la LSC-D était, en matière de lutte contre la surpopulation carcérale, un échec. Plusieurs universitaires entendus ont ainsi estimé que la loi du 22 décembre 2021 avait eu pour effet d'aggraver cette surpopulation, la LSC-D ayant conduit à un nombre de mises en liberté nettement inférieur aux maintiens générés par la suppression des crédits automatiques de réduction de peine.
Cette analyse est corroborée par l'étude
d'impact jointe à la loi précitée, qui attestait que
l'effet du texte était favorable aux personnes détenues
pour des courtes peines - donc pour celles qui sont les
plus
susceptibles d'être aménagées et de ne pas
donner lieu à un placement effectif en détention... -
mais globalement défavorable dès lors que la peine de
prison ferme était strictement supérieure à un
an137(*).
Au cours de son audition par les rapporteures, l'ANJAP a dressé un bilan particulièrement complet, et non moins défavorable, de la LSC-D. Celle-ci mène ainsi à :
- une augmentation de la charge de travail pesant sur les JAP, les greffes et l'administration pénitentiaire ;
- l'octroi d'aménagements de peine non préparés qui, « en réalité, ne sont souvent que des sorties sèches un peu anticipées sans venir constituer des sorties réellement accompagnées, faute d'une anticipation réelle et d'un temps de suivi suffisant » ;
- une perte de sens pour les condamnés, mais aussi pour les juges de l'application des peines, l'intervention automatique d'une sortie plus précoce privant de tout leur intérêt les efforts que les condamnés peuvent faire au cours de leur détention, à rebours de l'objectif de responsabilisation des détenus ;
- une dissonance - voire une absurdité - encore plus grande pour les condamnés écroués à la suite du retrait d'un précédent aménagement de peine dont ils n'ont pas respecté les termes, et qui se trouvent malgré tout éligibles à la LCS-D (hors le cas de certaines infractions visées par la loi, ce qui exclut tout surcroît d'individualisation)138(*) ;
- enfin, voire surtout, une forte proportion d'échec des aménagements octroyés sur le fondement d'une LSC-D : le consentement du condamné étant désormais indifférent, des détenus peuvent être libérés sans qu'il soit tenu compte de leur fragilité ou du risque de récidive. Toutes les personnes entendues par la mission ont alerté les rapporteures sur l'augmentation subséquente du nombre d'échecs, les condamnés concernés ne parvenant pas à se réinsérer sereinement dans la société et retrouvant rapidement, pour beaucoup d'entre eux, le chemin des tribunaux.
(3) Une rivalité objective entre LSC-D et aménagements de fin de peine qui dégrade l'efficacité de ces derniers dans la lutte contre la récidive
S'ajoutent aux défauts intrinsèques de la LSC-D ses effets néfastes sur les aménagements de fin de peine « classiques ».
Au-delà de l'hypothèse où ils sont décidés dès le début de l'exécution de la peine de prison ferme, les aménagements ont en effet un rôle essentiel pendant cette exécution. Ils permettent, en fin de peine, de réhabituer le détenu à la vie à l'extérieur de la prison, lui permettent de suivre une formation ou de prendre un emploi, et évitent les « sorties sèches » qui, elles-mêmes, sont un facteur fort de récidive - et qui continuent à représenter, hors LSC-D, plus de 60 % des libérations, selon les chiffres précités établis par la mission d'urgence sur l'exécution des peines.
La mission a déjà fait état des incohérences qui affectent notre droit, et qui conduisent notamment à ce qu'un condamné incarcéré pour une longue peine bénéficie d'un régime d'aménagement plus « favorable » que celui d'un condamné non encore placé en détention (aménagement à deux ans de la fin de la peine, soit le double du plafond d'un an de prison ferme pour l'aménagement au stade du prononcé).
Or, les aménagements sont désormais en rivalité objective avec la LSC-D, les outils à déployer et les personnes chargées du suivi des condamnés en fin de peine étant dans les deux cas identiques - ce qui pose, de toute évidence, un problème capacitaire. L'ANJAP a ainsi insisté auprès des rapporteures sur le fait que la combinaison de la LSC-D et du nouveau régime de réductions de peine « ne favorise pas les procédures d'aménagement de peine classiques, pourtant souvent mieux préparées, et n'incite pas les détenus, dans le cadre de courtes peines, à s'investir dans la préparation de leur sortie ».
Les rapporteures ont déjà commenté le cas particulier des DDSE, dont l'efficacité s'est amenuisée au fur et à mesure de leur déploiement, l'augmentation des effectifs chargés du suivi des condamnés placés sous bracelet électronique ne s'étant pas faite à due concurrence de celle du recours aux bracelets eux-mêmes. Le même phénomène s'observe pour d'autres formes d'aménagement de peine, et notamment pour la semi-liberté.
D'une part, par un effet de « vases communicants », les cas où le détenu est éligible à la LSC-D mais n'a pas de solution d'hébergement ont mené à une embolie des quartiers de semi-liberté, où sont désormais placés des personnes pour lesquelles cette solution n'est ni souhaitée, ni adaptée - au détriment des autres profils.
Ce phénomène a été abondamment documenté à l'occasion des échanges entre les rapporteures et les responsables du centre de semi-liberté de Villejuif : la mise en place de la LSC-D a fait arriver en semi-liberté des profils fortement précarisés, souffrant plus fréquemment que par le passé de troubles psychiatriques ou d'addictions139(*), parfois violents (d'où la montée des agressions entre détenus, voire envers les surveillants, CPIP et intervenants) dont la durée de présence est réduite (ce qui ne permet pas le déploiement d'une prise en charge adaptée) ; elle a également provoqué un afflux de ressortissants étrangers, pour certains soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui doivent en toute logique être expulsés à l'issue de leur détention - ce qui pose la question de l'intérêt, pour les intéressés, d'une démarche de réinsertion dans la société française.
D'autre part, l'attractivité de la semi-liberté a été remise en cause par la LSC-D, puisqu'il suffit souvent à un condamné d'attendre quelques semaines pour être libéré sans aucune obligation plutôt que de soumettre au régime - exigeant - de la semi-liberté.
Plus généralement, les rapporteures ont été alarmées par un constat extrêmement préoccupant : celui de la perte d'efficacité des aménagements de peine en matière de lutte contre la récidive sous l'effet de la LSC-D.
Jusqu'à une période récente, on estimait en effet que l'absence de « sortie sèche » (donc la mise en oeuvre d'un aménagement de fin de peine) était un facteur essentiel de prévention de la récidive. Selon un avis du Cese de 2019, et donc antérieur aux dernières réformes législatives140(*), 63 % des détenus libérés en « sortie sèche » étaient récidivistes, contre 39 % de ceux ayant bénéficié d'une libération conditionnelle.
Cet écart doit être interprété avec discernement, car il reflète autant l'impact des aménagements sur la réinsertion des détenus qu'un « effet de sélection », les juges de l'application des peines offrant des aménagements aux détenus qui ont les meilleures chances de respecter leurs engagements et de s'inscrire durablement dans un parcours de réadaptation. Il s'agit, cela étant, d'un indicateur important quant à l'efficacité de la gestion de la détention sur la lutte contre la récidive.
Or, l'écart entre les condamnés ayant subi une « sortie sèche » et les autres condamnés s'est considérablement réduit. Aux termes d'une étude récemment publiée par le ministère de la justice141(*), il n'est plus aujourd'hui que de six points (33,6 % de récidive à un an pour les « sorties sèches » contre 27,7 % dans les autres cas) soit, comme l'écrivait déjà la Cour des comptes dans son rapport de 2023, un contraste notable avec des études antérieures montrant un écart d'au moins douze points, voire davantage.
La Cour écrit, avec une saisissante pondération, que « ce résultat pourrait suggérer une moindre efficacité de ces aménagements aujourd'hui du fait d'un moindre accompagnement et/ou d'un moins bon profilage des condamnés concernés sous l'effet de la massification, des détentions à domicile sous surveillance électronique notamment ». Aux yeux des rapporteures, il constitue à tout le moins un véritable signal d'alarme qui impose aux pouvoirs publics de s'interroger sur l'efficacité, la pertinence et les effets de la LSC-D.
(4) Une perte de sens généralisée
Détentions conduites dans des conditions dégradées de prise en charge, aménagements ab initio décidés dans l'urgence et sans éléments suffisants de contexte, effets délétères de la LSC-D, solutions tendant à la régulation carcérale qui viennent en pratique alourdir la surpopulation : tout converge pour faire perdre son sens à la peine de prison ferme.
Les rapporteures constatent, aux côtés de la CNPG que « la seule certitude que l'on peut avoir lorsque vient d'être prononcée une peine d'emprisonnement ferme est que la loi interdit qu'elle soit exécutée telle qu'elle vient d'être prononcée ». Il ne peut en résulter qu'une triple incompréhension.
Incompréhension des acteurs institutionnels de la peine (magistrats et administration pénitentiaire), tout d'abord, qui voient la loi contredire les effets de leurs décisions : en témoigne l'exemple, déjà cité, des révocations de sursis conduisant à un placement en détention, ce placement se trouvant remis en cause - parfois seulement quelques semaines après sa mise à exécution - par l'application de la LSC-D. Cette incompréhension touche, d'ailleurs, ceux qui ont vu leur charge de travail augmenter sous l'effet des réformes intervenues depuis 2019 (magistrats correctionnels, greffes correctionnels, administration pénitentiaire) non moins que pour ceux dont le rôle est remis en cause (juges de l'application des peines).
Incompréhension des condamnés, ensuite, soumis à un droit d'une particulière complexité et qui les met dans une situation où ils ont, en de nombreuses matières, intérêt au moindre effort : il est ainsi plus simple (et parfois plus « favorable » s'agissant de la date à laquelle la peine cesse de produire des effets) pour un détenu d'attendre de faire l'objet d'une LSC-D que de produire des efforts pour bénéficier d'une solution de fin de peine plus adaptée, mais aussi plus astreignante.
Incompréhension, enfin, des citoyens, qui ont le sentiment que la justice ne fait jamais ce qu'elle dit, ce qui ne peut que nourrir une forme de défiance vis-à-vis de l'autorité judiciaire. Les résultats du sondage commandé par la commission des lois du Sénat, rendus publics en septembre 2021, en attestent avec éloquence : la justice était ainsi « opaque » selon 69 % de l'échantillon interrogé, et « laxiste » pour 68 % des sondés; les juges de l'application des peines étaient les acteurs judiciaires les moins « bien vus » de tous (61 %, contre 84 % pour les avocats et 72 % pour les juges des enfants, par exemple)142(*) ; la crainte que la décision rendue ne soit pas appliquée ou respectée était le quatrième motif de non-recours à la justice, derrière le coût, la longueur puis le caractère chronophage des procédures ; 94 % des sondés étaient favorables à une amélioration de l'exécution effective des décisions rendues en matière pénale et 84 % à une augmentation du nombre de places de prison (ce qui témoigne, assez directement, du souhait d'un recours plus fréquent à l'incarcération).
Ce constat n'est pas seulement celui des rapporteures : il est également celui des magistrats. À titre d'illustration, la CNPTJ a affirmé à la mission percevoir « combien est parfois incomprise, voire considérée comme injustifiée, la latitude laissée aux juridictions d'application des peines dans la conversion de certaines peines » ; elle a considéré que, si chacun peut concevoir une évolution de la gestion de la peine au cours de son exécution, en fonction du parcours du condamné, « il ne peut qu'être difficilement compris de permettre une modification radicale de la nature de la peine prononcée, par exemple en convertissant une peine d'emprisonnement ferme en jours-amende ou en travail d'intérêt général ».
La mission n'a pu qu'être alertée par la gravité de ce diagnostic : la peine de prison ferme est visiblement touchée par une perte de sens généralisée, ce qui interroge quant à la crédibilité et à la robustesse du système pénal dans son ensemble.
C. LES PEINES ALTERNATIVES, PARENT PAUVRE DE LA SANCTION
Bien que l'article 132-9 du code pénal prévoit qu'une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée « qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate », la justice pénale française donne une place centrale à la prison. Pour corriger ce déséquilibre, la politique pénale a progressivement affirmé la place du milieu ouvert, entendu comme « l'ensemble des mesures alternatives à la détention qui répondent à une démarche de responsabilisation du condamné »143(*).
L'essor du milieu ouvert répond à une double ambition : limiter la surpopulation carcérale et renforcer les chances de réinsertion, tout en réduisant le coût de l'exécution des peines. Ces sanctions présentent en effet à « une réelle utilité, aussi bien pour le délinquant que pour la communauté, puisque le délinquant est à même de continuer à exercer ses choix et à assumer ses responsabilités sociales »144(*).
Les peines alternatives à l'emprisonnement n'emportent pas de placement en détention et sont d'une autre nature que la peine de prison ferme. Prononcées à titre principal, elles permettent au tribunal d'écarter le recours à l'incarcération pour les délits passibles d'emprisonnement, sans toutefois s'appliquer aux crimes, pour lesquels le code pénal n'a prévu aucune alternative.
1. Les alternatives à la prison : une exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à une efficacité contestée et difficilement mesurable
a) Une grande diversité de peines permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de la peine
Depuis leur essor au cours des années 1970, de nombreuses modalités alternatives à l'incarcération ont été mises en place.
Leur développement a en effet été amorcé avec la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal qui a créé, pour la première fois, des peines de substitution à l'emprisonnement, comme le retrait du permis de conduire, avec l'objectif de lutter contre les courtes peines d'emprisonnement. La loi du 10 juin 1983145(*) en allongea la liste, avec la création des peines de jours-amende et de travail d'intérêt général (Tig).
Les peines alternatives ont vocation à se substituer à la peine principale encourue, qu'il s'agisse d'emprisonnement ou d'amende. Celles qui se substituent à l'emprisonnement sont réservées aux situations où la détention apparaît inutilement désocialisante et peu efficace en matière de prévention de la récidive.
Un grand nombre de peines alternatives coexistent aujourd'hui :
- la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), qui consiste à assigner le condamné dans son domicile ou dans un lieu déterminé, avec obligation de porter un dispositif de surveillance électronique. Cette peine peut être prononcée pour une durée comprise « entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru »146(*). Elle permet à la personne placée sous main de justice de continuer à travailler, suivre une formation, rechercher un emploi ou encore de maintenir ses obligations familiales, tout étant soumis à une contrainte significative puisque ses allées et venues sont limitées à celles qui ont été expressément autorisées par le juge de l'application des peines ;
- les jours-amende147(*) sont une peine qui consiste à fixer un nombre de jours et un montant journalier, que la personne condamnée devra acquitter au Trésor public. Ce montant est « déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu » et « ne peut excéder 1 000 euros », tandis que le nombre de jours-amende lui-même est « déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction » et « ne peut excéder trois cent soixante » ;
La peine de jours-amende
Entre l'amende et l'emprisonnement : distinction avec la peine pécuniaire classique
En droit pénal français, l'amende constitue l'une des peines principales de droit commun. Prévue, pour les délits, à l'article 131-3, 4° du code pénal et, pour les contraventions, à l'article 131-13 du même code, elle consiste dans l'obligation pour le condamné de verser au Trésor public une somme forfaitaire dont le montant maximum est fixé par le code pénal. Ce montant, déterminé par le juge, doit être fixé en considération des ressources et des charges du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-20 du code pénal.
La peine de jours-amende, instituée par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 et aujourd'hui prévue aux articles 131-3, 5° et 131-5 du code pénal, se présente quant à elle comme une peine alternative à l'emprisonnement correctionnel. Cette peine repose sur un double calcul :
- le nombre de jours, fixé par le juge dans la limite de 360, en fonction des circonstances de l'infraction ;
- le montant de la contribution journalière, qui ne peut excéder 1 000 euros, déterminé en fonction des ressources et des charges du prévenu.
Par cette dissociation des paramètres de calcul, le jour-amende apparaît comme un instrument de personnalisation accrue de la sanction pécuniaire - un délit sanctionné par 10 jours-amende fixé à 100 euros ne revêt pas la même signification qu'un délit puni de 100 jours-amende fixé à 10 euros. Si le montant total exigé demeure identique, la seconde hypothèse traduit une plus grande gravité des faits, mais commis par un auteur dont la situation économique apparaît plus modeste.
La jurisprudence a qualifié le jour-amende de modalité particulière de l'amende, relevant de la même nature que celle-ci (Crim., 26 sept. 1990). C'est pourquoi l'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe leur cumul. Toutefois, si cette peine se présente comme une sanction pécuniaire soumise au régime de recouvrement de l'amende classique, le défaut de paiement en modifie la portée puisqu'il implique une privation de liberté soumise, pour sa part, au régime des peines d'emprisonnement. L'article 131-25, alinéa 2, prévoit en effet que le défaut de paiement, total ou partiel, entraîne l'incarcération du condamné pour une durée équivalente au nombre de jours impayés.
Ainsi, la spécificité de cette peine réside dans ce lien direct entre inexécution pécuniaire et incarcération : le défaut de paiement éteint la dette par l'exécution d'une privation de liberté, tandis que le paiement durant l'incarcération entraîne la libération.
Toutefois, d'un point de vue procédural, si, en principe, le non-paiement du jour-amende emporte incarcération du condamné pour la durée des jours impayés, la procédure d'exécution implique l'intervention successive de plusieurs acteurs. Le Trésor public adresse au condamné une mise en demeure dans le mois suivant la date d'exigibilité du montant des jours-amende. À l'expiration d'un délai de cinq jours, il transmet au ministère public une demande tendant à la mise en oeuvre de la contrainte judiciaire. Le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines, lequel peut soit ordonner l'exécution de l'emprisonnement encouru, soit accorder au condamné un délai supplémentaire de paiement n'excédant pas six mois.
Les jours-amende, une peine « hybride » marginalement employée par les juridictions
Cette peine correctionnelle ne concerne que les personnes physiques majeures et uniquement pour les délits passibles d'emprisonnement. Elle n'est pas applicable aux mineurs, étant supposé que ceux-ci ne disposent pas d'une autonomie financière suffisante pour en supporter la charge.
Selon les données statistiques du ministère de la justice, le jour-amende représentait en 2023 6,6 % des condamnations délictuelles, soit 33 796 décisions, part en progression depuis 2017. En 2022, la durée moyenne prononcée s'élevait à 85 jours, pour un montant journalier de 8,80 euros.
Source : commission des lois, d'après les
données du ministère de la justice
(Références
statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
En dépit de cette évolution, le jour-amende demeure peu prononcé en chiffres absolus. Son efficacité est contestée, notamment en raison d'un taux de recouvrement inférieur à 40 %, selon les chiffres du rapport d'information n° 1539 (XVIe législature) déposé le 19 juillet 2023 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Son caractère inégalitaire peut également être souligné, ses effets pesant non seulement sur le condamné, le plus souvent en situation de précarité, mais également sur sa famille.
La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2025 (Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération), relève que le jour-amende est associé à un taux de récidive de 54 % à cinq ans et de 63 % à dix ans, contre respectivement 64 % et 72 % pour l'emprisonnement ferme. Ce résultat, bien qu'indicatif de l'intérêt du dispositif, doit toutefois être relativisé en raison d'un biais de sélection lié au profil des condamnés auxquels cette peine est appliquée.
Le jour-amende demeure un dispositif ambigu et peu étudié, qualifié de « peine hybride inclassable ». (Desportes et Gunehec, 1994). Sa nature est d'autant plus incertaine que son cumul avec une peine d'emprisonnement est possible depuis 2004. Dès lors, il n'apparaît plus comme une alternative autonome à l'incarcération, mais plutôt comme une peine intermédiaire dont la place exacte dans l'arsenal répressif reste à clarifier.
Source : commission des lois
- les stages148(*) peuvent, comme la peine de jours-amende, être prescrits « à la place ou en même temps que l'emprisonnement ». Cette peine impose à la personne condamnée de suivre, dans un délai de six mois après la décision devenue définitive et pour une durée maximale d'un mois, un stage dont la nature est précisée par la juridiction. La nature de ces stages peut varier afin de s'adapter au délit commis par la personne condamnée : stages de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ou encore au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement. Le code pénal prévoit en outre des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi que de responsabilité parentale ;
- les peines privatives ou restrictives de liberté149(*) regroupent un large éventail de mesures, comme la suspension ou le retrait du permis de conduire ou de chasser, l'interdiction de détenir ou porter une arme, la confiscation ou l'immobilisation d'un véhicule, l'interdiction d'exercer une profession ou de paraître dans certains lieux. Elles visent à limiter la capacité de l'auteur à réitérer une infraction en restreignant l'accès à des droits ou à des moyens liés au délit commis. L'article 131-7 du code pénal prévoit que ces peines peuvent également être prononcées à la place de l'amende, pour les délits punis seulement par celle-ci ;
- le travail d'intérêt général (Tig)150(*) consiste en l'exécution, sans rémunération, d'un travail au profit d'une personne morale de droit public, d'une collectivité, d'un service de l'État ou d'une association habilitée. Le nombre d'heures effectuées par la personne condamnée peut varier entre vingt et quatre cents, en fonction de la gravité des faits. Cette peine n'est exécutée qu'avec l'accord du condamné : par écrit s'il est absent, et tacitement s'il est présent et ne s'y oppose pas ;
- la peine de sanction-réparation150(*) repose quant à elle sur une logique plus directement tournée vers la victime. Elle permet à la juridiction d'ordonner au condamné d'indemniser le préjudice de la victime, soit en argent, soit en nature, par exemple en remettant en état un bien détérioré à l'occasion de la commission de l'infraction. Lorsque les parties sont d'accord, la réparation en nature est possible et favorise une forme de justice restaurative. Afin de garantir l'exécution, la juridiction fixe un plafond d'emprisonnement - six mois maximum - ou d'amende - jusqu'à quinze mille euros - qui pourra être appliqué en cas de manquement du condamné.
b) Une exécution complexe et partielle, sans réels effets sur la réduction de la population carcérale
(1) Des outils peu mobilisés par les magistrats malgré une volonté politique affichée
Malgré une volonté politique constamment réaffirmée par les gouvernements successifs ces dernières années de promouvoir un véritable changement de paradigme de la politique pénale française, le recours aux peines alternatives demeure particulièrement limité.
Ainsi, la circulaire du 25 mars 2019151(*) relative à la première présentation des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice indiquait que : « pour redonner sens et efficacité à la peine, la réforme poursuit l'objectif de sortir du `systématisme' de la peine d'emprisonnement lorsque celle-ci n'est pas la sanction la plus adaptée à la nature de l'infraction, à sa gravité, à son auteur et à la situation dans laquelle il se trouve, en développant d'autres peines autonomes, et en facilitant les conditions de leur prononcé. Prononcer une peine adaptée à l'acte de délinquance commis et à la personnalité de l'auteur est au coeur de la lutte contre la récidive ». La loi précitée a, en effet, profondément remanié le régime juridique des peines alternatives, notamment en élargissant les conditions de recours au travail d'intérêt général et en diversifiant l'offre de postes disponibles, en instituant la peine autonome de DDSE ainsi qu'en unifiant le régime applicable à l'ensemble des peines de stage.
Alors ministre de la justice, Nicole Belloubet recommandait en 2020 aux juridictions de mettre « en place, au sein de [leurs] ressorts, une véritable politique des peines en [s']appuyant sur les nouveaux outils prévus par la loi ». Ainsi, « la peine de détention à domicile sous surveillance électronique » devait être « privilégiée au terme des réquisitions prises à l'audience correctionnelle » et « la peine unique de stage ou de travail d'intérêt général [devait être] requise dans les situations où une peine comportant une forte dominante pédagogique et citoyenne paraît adaptée »152(*).
Le recours aux peines alternatives n'a toutefois pas connu de progression significative au cours des dernières décennies. En effet, si le nombre de personnes suivies en milieu ouvert s'élevait à 180 972 en 2024, contre 71 210 en 1980 et 135 020 en 2000153(*), cette évolution est davantage liée au développement et à la systématisation des dispositifs d'aménagements de peine qu'à un recours plus fréquent aux peines alternatives au stade de la condamnation.
Nombre de peines alternatives prononcées
Source : commission des lois, d'après les données du ministère de la justice (Références statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
L'évolution globale du prononcé des peines alternatives recouvre des dynamiques contrastées. On peut mentionner à ce titre que :
- les peines principales de DDSE, mises en place à compter de 2020, sont passées de près de 3 000 en 2021 à moins de 1 000 en 2023 - une dynamique inverse au prononcé des peines de DDSE en aménagement ab initio154(*) ;
- 33 796 peines de jours-amende ont été prononcées en 2023, pour une durée moyenne de 85 jours. Malgré une progression continue depuis 2017, le jour-amende demeure peu prononcé - 6,60% des condamnations délictuelles -, notamment du fait d'un faible taux de recouvrement - moins de 40 % ;
- 2 169 obligations de stage ont été prononcées en 2024, contre seulement 74 en 2017 ;
- le nombre de Tig a stagné entre 2015 et 2022, se maintenant autour de 15 000 par en dépit de la création en 2018 de l'Agence du Tig et de l'insertion professionnelle (Atigip). Cette situation offre un singulier contraste avec celle de nos voisins européens, plusieurs d'entre eux ayant fait en sorte que les Tig soient investis par les juridictions pénales.
Le travail d'intérêt général : une alternative à l'emprisonnement mobilisée dans de nombreux pays
Le « trabajo en beneficio de la comunidad » en Espagne
Le travail d'intérêt général (trabajo en beneficio de la comunidad) constitue l'une des principales peines alternatives à l'emprisonnement en Espagne. Il peut être prononcé en tant que peine principale ou en tant que condition d'une suspension de peine, notamment dans le cadre des articles 80 à 84 du code pénal. Dans les deux cas, il ne peut être imposé qu'avec le consentement du condamné, conformément à l'article 49 du code pénal.
Le TIG consiste à faire participer la personne condamnée, de manière non rémunérée, à des activités utiles à la société, en lien ou non avec la nature de l'infraction. Il peut s'agir de travaux de réparation, d'aide aux victimes, ou de la participation à des programmes de rééducation, de formation professionnelle, culturelle, de sensibilisation routière, sexuelle ou environnementale, entre autres. La durée maximale est fixée à huit heures par jour.
L'exécution de la peine relève des SGPMA (Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Ces services coordonnent l'affectation du condamné dans des entités publiques ou associatives partenaires et transmettent au juge de surveillance pénitentiaire les informations nécessaires à son suivi. Celui-ci peut constater l'inexécution en cas d'absences injustifiées, de manque manifeste de rendement, de refus répété d'exécuter les tâches confiées, ou de comportement incompatible avec le maintien dans le centre d'affectation (article 49 §6). En cas de manquement, le juge peut décider de changer le lieu d'exécution ou de constater l'inexécution de la peine, susceptible d'entraîner des poursuites (article 468 du code pénal).
Les personnes effectuant un TIG bénéficient du statut juridique protecteur applicable aux personnes détenues, notamment en matière de sécurité sociale, et le TIG ne peut être utilisé à des fins économiques (article 49 §4 et §5). Il s'est imposé depuis une vingtaine d'années comme l'une des peines alternatives les plus développées et les plus utilisées, en raison de sa souplesse d'application et de son potentiel de réhabilitation.
Des dispositions d'application plus détaillées sont fixées par le décret royal n° 840/2011 du 17 juin 2011. Le texte précise les modalités concrètes d'exécution du TIG et encadre notamment la procédure de désignation du poste de travail, l'élaboration du plan d'exécution individualisé, les obligations de suivi par l'administration et la possibilité d'adapter la peine aux contraintes personnelles du condamné. Il consacre également le rôle central des SGPMA et formalise la coordination entre les acteurs publics ou associatifs impliqués, tout en maintenant le contrôle de légalité du juge de surveillance.
Le « taakstraf » aux Pays-Bas
Les situations dans lesquelles une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée à titre exclusif sont énoncées à l'article 22 b du code pénal. Il s'agit par exemple de condamnations pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement de six ans ou plus et qui ont entraîné une atteinte grave à l'intégrité physique de la victime, ou si le condamné s'est vu infliger, au cours des cinq années précédant les faits qu'il a commis, une peine de travail d'intérêt général pour un délit similaire. La durée maximale d'une peine de travail d'intérêt général est de 240 heures.
Si le condamné n'exécute pas ou pas correctement la peine de travail d'intérêt général, une peine de détention de substitution est prononcée. Pour chaque tranche de deux heures de peine de travail d'intérêt général non exécutée, la peine maximale est d'un jour de privation de liberté.
En 2019, le juge avait prononcé une peine de travail d'intérêt général en tant que peine principale dans près de 30 000 affaires pénales et, dans 66 % de ces affaires, la peine de travail d'intérêt général n'était associée à aucune autre sanction.
En 2024, 28 500 peines de travaux d'intérêt général ont été exécutées en tout ou partie, selon le service de probation. 16 % des peines de travail d'intérêt général ont été interrompues prématurément et 10 % n'ont pas pu être entamées pour cause de renvoi devant la justice. Les peines de travail d'intérêt général prononcées par un juge avaient une durée moyenne de 74 heures contre 45 heures en moyenne pour les travaux d'intérêt général prononcés par ordonnance pénale du ministère public.
Les recherches menées par le WDOC en 2021 montrent que les personnes ayant effectué un travail d'intérêt général ont 47 % de risques en moins de récidiver que les condamnés ayant effectué une peine d'emprisonnement.
Source : note de législation comparée sur l'exécution des peines (voir annexe 1)
(2) Le développement des peines alternatives s'est fait sans effet de substitution sur la prison ferme
Malgré cette volonté politique et les évolutions législatives récentes, le développement des peines alternatives n'a pas eu d'incidence sur le volume des peines d'emprisonnement ferme prononcées.
Ainsi, interrogée par la mission sur ce point, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) considère que « le développement des peines alternatives à l'incarcération n'emporte pas une baisse du recours à l'emprisonnement ». Elle souligne par ailleurs qu'entre 1984 et 2024, la population française a progressé de 20 %, tandis que la population détenue augmentait de 107 % et que celle suivie en milieu ouvert connaissait une croissance de 200 %. Ce constat est également partagé par la mission d'urgence sur l'exécution des peines, laquelle relève que « les aménagements de peine ou les alternatives à l'incarcération, bien que nombreux, ne réduisent pas la surpopulation pénale ». Ce phénomène révèle, pour reprendre les termes utilisés par une large partie des praticiens comme des universitaires auditionnés par les rapporteures, un élargissement du « filet pénal » dans lequel les peines alternatives ne viennent pas réduire le nombre d'incarcérations, mais intégrer à la répression pénale de personnes qui n'auraient probablement pas fait l'objet de poursuites s'il n'avait pas été possible de prononcer à leur encontre une sanction autre que la prison.
Le recours aux peines alternatives demeure en définitive très minoritaire dans l'ensemble des peines prononcées en matière correctionnelle : le rapport du casier judiciaire publié en 2024 indique en effet qu'elles représentent moins de 20 % des peines principales prononcées.
Peines principales prononcées en 2023
Source : commission des lois, d'après les
données du ministère de la justice
(Références
statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
Source : commission des lois, d'après les
données du ministère de la justice
(Références
statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
L'objectif de réduction de la population carcérale n'est toutefois pas le seul poursuivi par le développement des peines alternatives. Celles-ci visent également à éviter l'incarcération de certains profils particulièrement vulnérables, dont la situation pourrait s'aggraver de manière significative pendant et à l'issue d'une détention. L'association Aurore, chargée d'accueillir et d'accompagner vers l'autonomie les personnes en situation de précarité et d'exclusion, souligne ainsi que le développement de ces peines est « souhaitable, en particulier pour les profils présentant des problématiques d'addiction ou d'errance », pour lesquels « l'emprisonnement peut être totalement contre-productif », dans la mesure où il tend à aggraver les problèmes d'addiction des détenus.
Les peines alternatives contribuent également à prévenir les phénomènes de rupture et de désocialisation inhérents à l'incarcération. Certaines d'entre elles, à l'image des travaux d'intérêt général, participent directement à la réinsertion en soumettant la personne condamnée à des obligations d'ordre professionnel. D'autres, comme la détention à domicile sous surveillance électronique, permettent au contraire de préserver les liens familiaux et professionnels.
c) Des ambitions contrariées par des difficultés structurelles
Pour constituer des réponses pénales efficaces, ces peines doivent être adaptées au profil des personnes condamnées, leur sens doit être compris par celles-ci, et leur exécution doit faire l'objet d'un suivi réel, encadré, contrôlé et, le cas échéant, sanctionné par les autorités compétentes. Or, les travaux d'investigation menés par la mission, comme les témoignages recueillis, aboutissent à une même conclusion : le prononcé, l'exécution, le suivi et le contrôle des peines alternatives demeurent insuffisants.
Cette insuffisance découle de facteurs hétérogènes :
- en premier lieu, la diversité des peines alternatives apparaît, paradoxalement, comme un frein à leur prononcé. En effet, garantir une adéquation entre le profil de la personne condamnée et la peine alternative la plus appropriée demeure en effet une tâche complexe. Le choix de la mesure adaptée requiert du temps, dont les juges de première instance manquent souvent, d'autant plus que les enquêtes de personnalité (ESR) disponibles sont jugées trop imprécises : à ce titre, la CNPP a précisé à la mission d'information que « les enquêtes de personnalité préalables à l'audience sont bien souvent réalisées par des personnels peu formés aux dispositifs d'aménagement et de conversion - les SPIP étant en pratique rarement en charge de l'enquête - et que leurs rapports ne permettent pas d'éclairer suffisamment le tribunal » ;
- en second lieu, lorsque des éléments sur la personnalité du condamné sont transmis au juge du fond, ils s'avèrent régulièrement peu compatibles avec les sujétions qu'implique une peine alternative à l'emprisonnement. La CNPR souligne ainsi que de nombreux condamnés ne sont pas en mesure de respecter les contraintes strictes qu'impose la détention à domicile sous surveillance électronique, étant rappelé que celle-ci impose le strict respect d'horaires scrupuleusement définis. Pour les personnes en situation de désinsertion totale, il apparaît ainsi difficile d'identifier une peine alternative qui soit à la fois pertinente, réaliste et véritablement utile ;
- l'impossibilité d'opter pour une peine alternative peut, en troisième lieu, découler de la nature de l'infraction commises. La DACG a ainsi rappelé, au cours de son audition, que certaines situations rendaient les peines alternatives en milieu ouvert inadaptées, que ce soit en raison de la gravité ou de la nature des faits commis -- en particulier dans les affaires de violences intrafamiliales - ou des caractéristiques du profil du condamné - notamment en cas de danger immédiat pour les personnes ou les biens, ou encore un risque de fuite ;
- enfin, les rapporteures estiment que les peines alternatives ont pu se trouver « cannibalisées » par l'expansion des aménagements ab initio : leurs auditions les ont convaincues qu'une large partie des juges du fond préféraient prononcer une peine de prison aménagée sous la forme d'un DDSE, formule qui leur semble offrir davantage de garanties de respect de la mesure (notamment parce que le condamné risque155(*) l'incarcération immédiate en cas de violation de ses obligations) plutôt qu'un DDSE-peine, pour lequel les contrôles seront potentiellement moins rigoureux.
La crédibilité d'une peine dépend aussi de la rapidité avec laquelle elle est mise en oeuvre ; or, les délais d'exécution des peines alternatives soulèvent en deuxième lieu une difficulté persistante. Concernant les travaux d'intérêt général, des progrès sont à noter : entre 2023 et 2024, les SPIP ont réduit de 7,9 à 6,9 mois156(*) le délai moyen entre leur saisine et l'affectation à un poste. La situation globale reste toutefois préoccupante : la Cour des comptes rappelait ainsi en mai 2025 que le délai moyen d'exécution des Tig restait de 16,7 mois157(*) et que 16 % d'entre eux n'avaient été ni exécuté, ni convertis trois ans après leur prononcé158(*).
Le suivi et le contrôle de l'exécution des peines alternatives apparaissent, en troisième lieu, insuffisants. Or, de même que pour les délais, la crédibilité de ces mesures repose sur la garantie donnée à la personne condamnée, à la victime et à leurs proches que les interdictions imposées au probationnaire sont effectivement contrôlées, que ses manquements sont rapidement détectés et qu'ils entraînent une réponse judiciaire appropriée.
Les mesures alternatives à l'incarcération sont suivies par les SPIP et peuvent, en cas de violation des obligations, donner lieu à une convocation devant le juge de l'application des peines (JAP). Les SPIP doivent également s'assurer de la bonne mise en oeuvre des suivis socio-judiciaires, encadrés par l'article 132-44 du code pénal.
Articles 132-43 et suivants du code pénal
Obligations découlant du régime de la probation
Article 132-43. Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Article 132-44. Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
Article 132-45. La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations [...].
Néanmoins, selon les éléments recueillis par les rapporteures auprès de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), le suivi de l'exécution des peines alternatives à l'emprisonnement présente d'importantes lacunes.
Les missions de contrôle sont nombreuses et particulièrement chronophages. La Cour des comptes, dans le rapport précité159(*), a mis en évidence les lacunes des dispositifs de suivi des obligations imposées aux personnes condamnées à des peines alternatives, à travers l'exemple de la gestion des alarmes de « retard » liées aux DDSE, déclenchées lorsqu'un horaire d'assignation à résidence n'est pas respecté. Ces alarmes font l'objet de filtrages successifs qui aboutissent à une situation préoccupante : le CPIP ne contacte la personne placée sous main de justice qu'après plusieurs incidents, et le juge de l'application des peines (JAP) n'est averti qu'en cas de répétition d'incidents, ce qui compromet la systématisation du rappel des obligations par un magistrat.
Les insuffisances du contrôle de l'exécution des peines alternatives tiennent en partie au manque de moyens humains, constaté par la quasi-totalité des acteurs entendus par la mission et déjà mentionné160(*).
Au-delà de ce déficit en effectifs, le manque de connaissance, par les acteurs de la chaîne pénale, des dispositifs existants en matière de peines alternatives à l'incarcération et de leur disponibilité constitue également un frein à leur prononcé. Les Tig, par exemple, ont longtemps pâti d'une insuffisance, voire d'une absence, de lieux de placement sur le territoire, entraînant retards et lacunes dans leur exécution. Cette situation s'est toutefois améliorée grâce à la création de l'Atigip et au déploiement de la plateforme TIG 360°, qui a permis d'accroître considérablement l'offre. Tout en relevant qu'en 2023, près de 38 000 places étaient disponibles161(*), la Cour des comptes soulignait ainsi la plateforme demeurait peu utilisée par les magistrats, 42 % d'entre eux déclarant avoir peu ou pas connaissance des places offertes en Tig162(*).
Nombre de Tig en cours et capacités d'accueil
Source : Cour des comptes d'après données SDSE (APPI) et Atigip (TIG360°)
Notes : nombre de places au 31 décembre de l'année et encore actives sur TIG360° en août 2023
Enfin, l'absence de sanctions effectives en cas de non-respect des obligations assorties aux peines alternatives nuit à leur crédibilité. La direction générale de la gendarmerie nationale a ainsi indiqué aux rapporteures que les évasions de quelques heures de personnes placées sous surveillance électronique à domicile, tout comme les non-exécutions de stages - bien qu'ils constituent un délit - donnaient rarement lieu à des poursuites pénales.
L'ensemble de ces insuffisances dans l'exécution des peines alternatives fragilise la confiance que leur accordent tant les acteurs de la chaîne pénale que la population, et demeure un frein à leur prononcé. Tant que ces limites ne seront pas levées, il sera difficile de s'affranchir d'un paradigme centré sur la prison.
D. LES MINEURS DÉLINQUANTS, DES CONDAMNÉS COMME LES AUTRES ?
Malgré un régime pénal spécifique, les mineurs condamnés se trouvent globalement confrontés aux mêmes difficultés que les majeurs en matière d'exécution des peines : à l'exception notable de la surpopulation carcérale, eux aussi pâtissent d'un déficit d'individualisation des peines et d'un manque de moyens en milieu ouvert comme en milieu fermé.
1. Un cadre pénal spécifique
a) Un corpus juridique pour partie autonome
Le droit pénal des mineurs fut longtemps régi par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui a établi les principes cardinaux de l'exécution des peines auxquels obéit désormais le code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
La spécificité de l'exécution des peines prononcées contre les mineurs tient principalement à l'atténuation de la responsabilité pénale de ces derniers, qui est l'un des principes structurants de cette matière. Ce principe se traduit par une diminution des peines pouvant effectivement être prononcées à leur encontre. Ainsi, l'article L. 11-5 du CJPM prévoit que « les peines encourues par les mineurs sont diminuées », fondant légalement ce qui est communément désigné par l'expression « excuse de minorité ».
Ce principe constitue au surplus un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 portant sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice - et s'impose par conséquent au législateur.
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises ne peuvent ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue ou de vingt ans de prison lorsque ladite peine encourue est la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité163(*). De la même manière, il « ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros »164(*).
Les peines infligées aux mineurs doivent en outre observer le primat de l'éducatif sur le répressif et, partant, le caractère exceptionnel de l'incarcération.
Le droit pénal applicable aux mineurs a fait l'objet de plusieurs révisions législatives ces dernières années. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a par exemple étayé la compétence du juge des enfants, qui peut assurer le suivi de l'exécution des peines appliquées à un mineur au-delà de sa majorité, jusqu'à ses vingt et un ans. Il lui est toutefois loisible de se dessaisir au bénéfice du juge de l'application des peines compte tenu de la nature de la mesure ou de la personnalité du condamné165(*).
Une réforme d'ampleur du droit pénal des mineurs a été engagée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Son article 93 habilitait le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :
« a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
« b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
« c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
« d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes. »
Il revint à cette occasion au Gouvernement de compiler les dispositions en question au sein d'un nouveau code de la justice pénale des mineurs, qui s'est donc substitué à l'ordonnance de 1945 précitée. La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a ensuite ratifié le CPJM.
Entré en vigueur le 1er octobre 2021, le CJPM avait pour objectif de « remplacer l'ordonnance de 1945 par un ensemble cohérent de mesures susceptible de clarifier les procédures applicables et d'apporter une réponse plus efficace aux infractions commises par les mineurs »166(*), avec notamment une innovation de taille : la césure du procès pénal en deux phases, soit une audience sur la culpabilité et une seconde, six à neuf mois plus tard, sur la peine.
Dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi de finances pour 2025, la commission des lois du Sénat a adopté l'avis budgétaire relatif au programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » de la rapporteure Laurence Harribey qui dresse un premier bilan de cette réforme.
Du point de vue des juridictions, les indicateurs disponibles dessinent un résultat globalement positif, marqué notamment par la baisse des délais moyens de jugement (17,2 mois entre la commission des faits et le jugement en 2023, contre plus de 21 mois en 2021) comme de la proportion de mineurs en détention provisoire dans l'ensemble des mineurs détenus (77 % au 1er octobre 2021, contre 64 % au mois d'août 2024), ainsi que par un recours fréquent à la nouvelle « mesure éducative judiciaire » créée par le CJPM.
L'AFMJF a estimé devant les rapporteures que cette réforme n'avait pas « [modifié] l'économie générale » de cette matière et qu'elle avait « permis de diviser par deux, voire trois les délais de jugement ». Cette appréciation est largement partagée par les syndicats représentatifs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) que les rapporteures ont auditionnés.
b) Des acteurs spécialisés
(1) Le rôle particulier du juge des enfants, juge du fond et de l'application des peines
Le Conseil constitutionnel a consacré, à plusieurs reprises, un « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs », duquel résulte « notamment la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées »167(*).
Ce principe de spécificité de la justice des mineurs s'attache également à l'exécution et à l'application des peines prononcées à leur encontre, dont certaines règles diffèrent de la justice applicable aux adultes.
La principale différence, bien que sa portée ait été réduite par la réforme de l'aménagement des peines ab initio évoquée précédemment, repose sur la compétence étendue du juge des enfants, qui exerce aussi bien la fonction de juge du fond que de juge de l'application des peines. Pour ce faire, il est assisté de greffiers, qui sont notamment chargés, comme pour les juridictions de droit commun, de finaliser les jugements et d'en assurer l'exécution.
Conformément au principe de continuité personnelle du juge des enfants, ce dernier suit l'application de la peine qu'il a prononcée, permettant - théoriquement168(*) - au mineur jugé de ne relever que d'un seul magistrat tout au long de son parcours judiciaire. Lors de la rédaction, en 2021, du code de la justice pénale des mineurs, ce principe, datant de 2004 et adopté à l'initiative du Sénat169(*), a été retranscrit aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code, lesquels disposent respectivement que « lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants [qui] peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée » et que « lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines [...] jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans ».
Deux exceptions peuvent toutefois être portées à ce principe de continuité personnelle du juge des enfants. En premier lieu, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné atteint l'âge de dix-huit ans, « en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée »170(*). En second lieu, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, c'est le juge de l'application des peines qui est compétent pour le suivi de la condamnation, « sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent »171(*).
Nonobstant ces deux exceptions, le juge des enfants exerce donc les fonctions de juge de l'application des peines pour la plupart des mineurs dont il est saisi, qu'il prononce une peine d'enfermement ou une mesure éducative. Suivant un mouvement relativement analogue à l'aménagement des peines ab initio qui a concerné le juge correctionnel pour les majeurs, un glissement de l'intervention du juge des enfants s'est donc opéré au cours des dernières années « du pré-sentenciel vers le post-sentenciel », comme le relève l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF). Ce glissement est considéré comme positif par les juges des enfants, l'AFMJF notant « [qu']il est important que [le juge des enfants] tienne son rôle tout au long du processus judiciaire, d'autant plus que beaucoup de mineurs suivis après le prononcé de la sanction font parallèlement l'objet de nouvelles procédures en cours ». Ce rôle au long cours du juge des enfants permet audit juge de disposer « d'une grande latitude pour aménager ou refuser d'aménager, notamment dans l'hypothèse d'un risque identifié de réitération », dans la mesure où « la situation du mineur est très connue des juges des enfants ».
Toutefois, comme les juges correctionnels pour adultes, la mise en oeuvre de la réforme des aménagements ab initio des peines par les tribunaux pour enfants a été source « de nombreux incidents » mais « les juridictions affinent progressivement leurs pratiques afin d'en faire des leviers supplémentaires sur le plan éducatif et la lutte contre la récidive ».
In fine, la double fonction des juges des enfants - juge correctionnel et juge de l'application des peines - n'est pas remise en question par les acteurs de terrain et paraît donc être une spécificité de la justice des mineurs qu'il convient de préserver.
Par ailleurs, la création, suivant le vote de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, de 56 postes de juges des enfants, soit plus de 10 % des effectifs de magistrats des tribunaux pour enfants, et d'approximativement autant d'agents du greffe, devrait faciliter le suivi de l'exécution des peines et des mesures éducatives prononcées par ces tribunaux.
(2) La protection judiciaire de la jeunesse, actrice de l'exécution des peines
À l'instar du prononcé des peines à l'encontre des mineurs, l'exécution de ces peines - prises au sens large et incluant les mesures éducatives - est spécialisée et repose donc sur des acteurs distincts de l'exécution des décisions de la justice pour les adultes.
L'exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre de mineurs repose principalement sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), éventuellement assistée d'associations habilitées : peuvent lui être confiées « la mise en oeuvre des décisions [prises par le juge des enfants] aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse »172(*). Il s'agit des établissements de placement éducatif, des établissements de placement éducatif et d'insertion et des centres éducatifs renforcés ou fermés. À ces établissements de la protection judiciaire de la jeunesse s'ajoutent les quartiers et établissements pénitentiaires pour mineurs, destinés à ceux qui ont été condamnés à une peine de prison ferme et dans lesquels interviennent les éducateurs de la PJJ.
Les services de la PJJ exercent ainsi des missions plus larges que celles qui sont dévolues au SPIP pour les majeurs, puisqu'ils gèrent directement des établissements dédiés à l'exécution des décisions de justice. Leur rôle au stade pré-sentenciel est par ailleurs plus développé.
De façon synthétique, les services de la PJJ assurent cinq grandes missions liées à l'exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre des mineurs173(*) :
- ils aident à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions et par la formulation de propositions éducatives. Ils peuvent, à ce titre, mettre en oeuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire. Leur concours permet ainsi au juge du fond de prendre des décisions adaptées, et donc de faciliter leur exécution ;
- ils mettent en oeuvre les décisions de l'autorité judiciaire civile et pénale, en particulier en assurant un suivi des mesures d'investigation, des mesures éducatives, des mesures de sûreté et des peines et des aménagements de peines prononcées à l'encontre du mineur, mais aussi des mesures d'assistance éducative prononcées à l'égard des parents ;
- ils assurent la formation continue des mineurs détenus ;
- ils mettent en oeuvre, à la demande de l'autorité judiciaire, des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et organisent, sous la forme d'activités de jour, un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;
- enfin, ils accueillent et informent les mineurs et les familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs, y compris lorsque ces demandes concernent des décisions déjà prononcées.
Les éducateurs de la PJJ assurent donc à la fois un rôle de mise en oeuvre des décisions de justice et d'accompagnement du mineur et de sa famille, dans une optique autant de réinsertion et de prévention de la récidive que de soutien à l'autorité parentale.
Les services de la PJJ sont, dans l'ensemble, confrontés à des difficultés analogues à celles que peuvent connaître les SPIP. Ils rencontrent néanmoins des problèmes spécifiques : plusieurs organisations syndicales ont ainsi signalé aux rapporteures « l'insuffisante connaissance des missions de la PJJ par les différents interlocuteurs » de la justice des mineurs, certains magistrats étant accusés de ne jamais « visiter les lieux », de « ne pas prendre en compte les contraintes de la PJJ », notamment en termes de disponibilité en places dans ses établissements, et de « ne pas tenir compte des recommandations éducatives formulées par les éducateurs de la PJJ ».
Sans se prononcer sur la véracité de ce « fossé entre les tribunaux et les services de la PJJ », lequel, sans être inexistant, doit être relativisée compte tenu de la spécialisation des juges des enfants, les rapporteures notent que ces tensions semblent vraisemblablement liées à une charge de travail élevée, autant du côté des juges des enfants que des services de la PJJ.
À l'instar des SPIP, les personnels de la PJJ font en effet face à un phénomène de saturation. Malgré les créations de postes des dernières années - le ministère de la justice chiffre à 522 le nombre de postes d'éducateurs créés entre 2017 et le début de l'année 2025174(*), la loi de finances pour 2025 ayant fixé un plafond d'emplois de 5 611 éducateurs175(*) -, tous les ratios d'encadrement ne sont pas respectés, notamment en milieu ouvert, qui fixe un ratio glissant de 25 mineurs par éducateur mais dépasserait 30 dans certains services. En matière pénale, la protection judiciaire de la jeunesse a assuré le suivi de 193 945 mesures au cours de l'année 2025 - soit un ratio de 35 mesures par éducateur -, auxquelles s'ajoutent 37 731 mesures confiées au secteur associatif176(*).
c) Un droit commun de l'exécution des peines aux conséquences particulièrement néfastes sur les mineurs
Les réformes du droit général de l'exécution des peines ont eu des effets regrettables sur la justice pénale des mineurs. Ces conséquences néfastes sont identiques, à quelques nuances près, à celles évoquées précédemment pour les majeurs ; s'y ajoutent cependant deux éléments saillants.
Tout d'abord, la loi du 23 mars 2019 précitée a interdit le prononcé des peines d'emprisonnement de moins d'un mois. Or, frappées d'une large désaffection pour ce qui concerne les majeurs177(*), les peines très courtes demeuraient appréciées par les juges des enfants pour l'effet de « choc carcéral » qui pouvait s'avérer bénéfique auprès de certains profils d'adolescents commençant à s'ancrer dans la délinquance.
La suppression des peines de prison ferme de moins d'un mois aurait ainsi engendré un effet « cliquet » négatif pour les mineurs, selon l'AFMJF, dans la mesure où elle aurait « conduit à un doublement des peines minimales jusque-là prononcées : les peines d'un mois sont devenues des peines de deux mois de manière habituelle ».
Ensuite, les effets de la LSC-D sont particulièrement désastreux sur les mineurs. Adoptée sans qu'il soit suffisamment tenu compte de ses conséquences spécifiques sur les jeunes condamnés, la réforme tendant à rendre automatique la libération aux deux tiers de la peine génère, pour la justice des mineurs, d'importantes perturbations. L'AFMJF a ainsi indiqué aux rapporteures craindre « que la LSC n'ait entraîné, dans certains cas, un alourdissement des sanctions prononcées afin de garantir un maintien minimal du mineur en détention, le temps de construire un projet de sortie adapté »178(*). Plus largement, l'association a relevé que la LSC n'était pas forcément adaptée aux mineurs, notamment au regard de la durée limitée des peines prononcées à leur égard - celle-ci étant réduite de moitié sous l'effet de l'application du principe constitutionnel d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Par conséquent, de telles libérations n'ont que « peu de sens » pour les jeunes incarcérés et favorisent leur sortie de détention sans projet de réinsertion adapté.
2. Les mineurs en milieu ouvert : des outils insuffisamment mobilisables faute de moyens
La justice pénale des mineurs repose en théorie sur une philosophie éducative, dans laquelle l'incarcération doit constituer une réponse exceptionnelle. En milieu ouvert, une palette de mesures et de sanctions vise à favoriser la responsabilisation du jeune auteur d'infractions tout en évitant la rupture que constitue la détention.
Parmi ces dernières, les mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP) et les mesures éducatives judiciaires (MEJ) tendent à proposer un accompagnement éducatif, aussi bien en amont qu'à l'issue d'une éventuelle condamnation. Prévue par l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), cette catégorie de mesures se caractérise par sa souplesse et son adaptabilité aux besoins spécifiques du jeune concerné.
Elles peuvent en effet être assorties de différents modules, tels que l'insertion scolaire ou professionnelle, la réparation envers la victime, la prise en charge sanitaire ou encore le placement dans une structure éducative adaptée. Elles s'accompagnent également de contraintes juridiques visant à encadrer le comportement du mineur : interdictions, par exemple, de rencontrer la victime ou de se rendre sur les lieux de l'infraction, mais aussi obligations, comme la remise d'un objet utilisé lors des faits ou la participation à un stage de formation civique.
Lorsqu'une problématique de santé est identifiée, la mesure éducative peut prévoir une orientation spécifique vers un dispositif de soins, voire un placement en établissement de santé ou médico-social179(*).
En parallèle de ces dispositifs spécifiques, les mineurs peuvent être condamnés à des sanctions pénales « classiques » exécutées en milieu ouvert. La plus courante est le Tig, qui associe sanction et utilité sociale. L'amende peut également être prononcée, bien qu'elle soit rarement appliquée compte tenu de la situation financière des mineurs.
Les peines de jours-amende ne sont, en revanche et en vertu de l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, pas applicables aux mineurs. Enfin, depuis le 24 mars 2020, le tribunal pour enfants (TPE) peut prononcer une peine de stage à titre principal.
Peines et mesures prononcées à titre principal à l'encontre des mineurs en 2023
Source : commission des lois, d'après les données du ministère de la justice (Références statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
Peines et mesures prononcées à titre principal à l'encontre des mineurs
Source : commission des lois, d'après les
données du ministère de la justice
(Références
statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)
Les sanctions alternatives à la détention revêtent une importance particulière lorsqu'elles concernent des mineurs, car elles offrent un cadre éducatif permettant non seulement d'encourager la réflexion personnelle, mais aussi de renforcer l'estime de soi et la responsabilisation. Elles créent un espace où les jeunes peuvent prendre la mesure des conséquences concrètes de leurs actes et comprendre les effets de leurs comportements sur autrui. Dans cette perspective, certains modules de réparation, en sollicitant l'expression du jeune délinquant et en instaurant un dialogue adapté avec la victime, rejoignent la logique de la justice restaurative. Ils favorisent un véritable travail de prise de conscience, à la fois sur le plan moral et relationnel, et contribuent à prévenir la récidive en donnant aux mineurs les moyens de se réinscrire dans un parcours plus constructif.
Les peines alternatives à destination des mineurs pâtissent toutefois, à l'instar de celles à destination des personnes majeures, de grandes difficultés d'exécution, notamment du fait d'un manque de moyens - en partie humains - alloués à cette dernière.
Outre les moyens insuffisants dont dispose la PJJ180(*), ce déficit s'explique par :
- une « offre » insuffisante au sein des unités éducatives en milieu ouvert (UEMO), qui constituent pourtant des maillons essentiels de la justice des mineurs. Chargées d'assurer l'application concrète des mesures éducatives décidées par les juridictions compétentes - juges des enfants, juges d'instruction ou parquet -, elles ont vocation (contrairement aux établissements d'hébergement collectif, où les jeunes sont placés hors de leur domicile) à inscrire leur intervention dans le quotidien des adolescents, sans rupture du lien avec la cellule familiale et l'environnement social : elles sont donc en première ligne pour la mise en oeuvre des mesures de réparation ou de travaux d'intérêt général. Toutefois, l'offre reste très insuffisante au regard des besoins : le nombre de places disponibles ne permet pas de répondre à l'ensemble des décisions judiciaires, si bien que de nombreux mineurs doivent attendre de longs mois avant qu'une prise en charge puisse débuter. Comme l'ont souligné les représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), il « existait des listes d'attente [...], certaines prises en charge attendant plus de six mois » ;
- un retrait progressif du secteur associatif habilité qui, là encore selon l'AFMJF, « ne demande quasiment plus d'habilitation dans le champ pénal, préférant accueillir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou des mineurs non accompagnés (MNA) ».
Cumulé avec l'accroissement du stock total de mesures en cours ces dernières années, ce déficit de moyens conduit, par un « effet ciseaux », à une augmentation du nombre de mesures en attente d'application181(*).
Les rapporteures ont en outre été alertées sur le manque d'adaptation de certaines peines alternatives à la situation spécifique des mineurs, ce qui en limite l'attrait pour les juges des enfants. Ainsi, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) relevait que « la mesure des Tig est insuffisamment centrée sur un contenu adapté aux enfants et trop sur le nombre d'heures à effectuer » : cette inadaptation contribue à limiter le poids des mesures de milieu ouvert pour les condamnés mineurs.
3. Les mineurs en milieu fermé : des affectations erratiques, un suivi lacunaire
Les mineurs condamnés à une peine de milieu fermé sont soumis à un régime distinct de celui des majeurs ; il ne se limite d'ailleurs pas à la prison, celle-ci ne devant de jure être qu'un choix de dernier recours faisant l'objet d'une motivation spéciale.
Les mineurs condamnés à une peine privative de liberté peuvent ainsi être placés :
- dans des structures carcérales spécifiques, les établissements pour mineurs (EPM) et les quartiers pour mineurs (QM), qui dépendent de l'administration pénitentiaire. On dénombre aujourd'hui six EMP et 40 QM dans l'hexagone, ainsi que huit QM (mais aucun EPM) outre-mer ;
- dans des centres éducatifs fermés (CEF), forme la plus « contenante » du placement et dernière étape avant l'incarcération : théoriquement réservés aux profils les plus durs (ayant commis des faits graves, présentant une dangerosité particulière, ayant un ancrage déjà marqué dans la délinquance...), ils sont au nombre de 52 dans l'hexagone et trois en outre-mer.
Si, sous l'effet notamment de l'entrée en vigueur à la fin de l'année 2023, des nouvelles procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs, les peines de milieu fermé prononcées à l'encontre des mineurs ne présentent pas de retards d'exécution particuliers182(*), le bilan de leur mise en oeuvre conduit à identifier des failles analogues à celles qui ont déjà été recensées pour les majeurs : diversité médiocre de l'« offre » spécialisée, affectation selon une logique de gestion des flux, mélange dans les mêmes structures de condamnés aux profils divergents et insuffisance des activités proposées aux jeunes.
a) Les mineurs en prison : des détenus comme les autres ?
Les QM et, a fortiori, les EPM (créés en 2002183(*) face aux carences de la prise en charge des mineurs en QM) accueillaient, au 1er décembre 2024, environ 850 mineurs prévenus ou détenus, en nette augmentation depuis 2022.
Nombre de mineurs détenus en 2022, 2023 et 2024
Source : ministère de la justice,
« Statistique
des établissements et des personnes écrouées en
France »
Les mineurs condamnés représentent toutefois une large minorité des mineurs placés en détention : ils étaient 327 au 1er décembre 2024, soit 39 % des mineurs détenus, les 61 % restants étant des prévenus.
Les structures pénitentiaires dédiées aux mineurs poursuivent un triple objectif :
- permettre la prise en charge, dans le régime pénal particulier qui s'applique à la matière et dont les spécificités relèvent pour une large partie du niveau constitutionnel, des mineurs les plus dangereux et/ou multi-réitérants. Cette catégorie pénale tend à s'étendre : sollicité par les rapporteures, le pédopsychiatre Maurice Berger rappelait ainsi que « le nombre de mineurs poursuivis pour assassinat, meurtre, coups mortels ou violence aggravée a presque doublé en six ans, passant de 1 207 par an en 2017 à 2 095 en 2023 », ce phénomène concernant en outre « des mineurs violents de plus en plus jeunes » et étant, selon lui, susceptible d'être sous-estimé en raison d'une requalification des faits les plus graves ;
- séparer les mineurs des majeurs détenus, conformément aux engagements internationaux de la France (partie à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le principe de cette séparation) : par nature assurée en EPM, cette étanchéité ne paraît toujours pas totalement garantie en QM ;
- leur offrir dans ce cadre une prise en charge tournée autant vers la sanction que vers l'éducation : y est notamment assurée « la continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée », dans les conditions de droit commun fixées par le code de l'éducation184(*).
Or, ces trois objectifs ne sont qu'imparfaitement atteints.
En premier lieu, en QM comme en EPM, les conditions de détention des mineurs présentent de réelles carences.
Certes, les EPM et QM ne sont pas frappés par la surpopulation carcérale observée pour les majeurs : le taux d'occupation moyen y était de 62 % au 1er janvier 2024, pour un total de 788 mineurs détenus sous des statuts divers (prévenus ou condamnés)185(*).
Ce taux global marque toutefois de fortes disparités : en excluant le cas des structures n'accueillant aucun mineur, les taux d'occupation marquent ainsi un échelonnement important, compris entre 22,2 % à Épinal et 100 % à Pau. Le taux d'occupation des EPM est sensiblement plus haut que la moyenne (73,6 %), leur capacité opérationnelle étant de 327 places. En outre, la situation des structures pour mineurs s'est, comme pour les majeurs, progressivement dégradée, conduisant l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) à indiquer aux rapporteures qu'en Île-de-France, les QM et EPM sont désormais saturés, « conduisant à des éloignements de mineurs détenus, source de rupture de lien éducatif et de rupture avec la famille ».
La gestion des affectations est, au demeurant, particulièrement complexe pour au moins deux motifs : d'une part, les juges des enfants ne sont pas spécialisés en application des peines, ce qui est de nature à rendre plus difficile la mise en oeuvre d'un droit devenu singulièrement complexe ; d'autre part, faute de possibilité technique de disposer d'un suivi en temps réel de la situation des établissements, les magistrats n'ont qu'une connaissance imparfaite de la réalité des places disponibles pour les mineurs, structure par structure, dans leur ressort.
Les modalités d'exécution des peines sont, par ailleurs, restreintes. Les mineurs ne disposent pas de quartiers de semi-liberté, que ce soit en QM ou en EPM. Au vu du nombre limité de structures, l'affectation individualisée des mineurs selon leur profil est matériellement difficile, voire impossible ; or, la question d'une gestion différenciée des mineurs selon leur profil est devenue prégnante dans un contexte marqué par la montée de la mise en cause des plus jeunes dans les violences sexuelles et dans le narcotrafic.
S'agissant des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, qui devraient pourtant relever d'une prise en charge sanitaire adaptée pour éviter la récidive, le rapport précité de la mission commune de contrôle du Sénat sur la prévention de la récidive du viol avait indiqué que les mineurs incarcérés pour des violences sexuelles n'étaient pas prioritairement dirigés vers des EPM, alors même qu'ils pourraient y faire l'objet d'une prise en charge plus efficace. Plus généralement, ces travaux révélaient qu'aucun établissement spécifique n'avait été mis en place pour limiter la récidive des infractions sexuelles, à l'inverse de la pratique des établissements « fléchés » pour les majeurs. Ce constat a de quoi préoccuper dans un contexte où les mineurs représentaient 21 % de la population, mais 28 % des mis en cause pour des violences sexuelles - et même un tiers des mis en cause pour viol ou pour atteinte sexuelle - en 2023.
Le diagnostic n'est pas meilleur en matière de criminalité organisée. Selon une note de la directrice de la PJJ du 5 décembre 2024186(*), 8 160 mineurs avaient été mis en cause en 2023 pour une infraction relevant du trafic de stupéfiants, soit près de 20 % des mises en cause liées à ce trafic. En dépit de leur dangerosité réelle, ils ne relèvent pas, eux non plus, d'une affectation dans des établissements dédiés ; ils peuvent donc se trouver en contact avec une population de mineurs moins dangereux, mais plus fragiles, qui risquent de subir leur influence et de sombrer eux aussi dans la grande délinquance.
En second lieu, la séparation entre les mineurs détenus en QM et les majeurs n'est toujours pas assurée : de manière révélatrice, la mission d'urgence sur l'exécution des peines recommandait d'« assurer l'étanchéité entre les quartiers mineurs et ceux accueillant des majeurs », témoignant du respect très imparfait des dispositions de l'article L. 124-2 du CJPM - aux termes desquelles les QM doivent « [garantir] une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs ».
Ainsi, et alors que l'objectif de la loi de 2002, selon le rapport annexé, était « à terme [...] de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés [i.e. les EPM] », la part des mineurs détenus en EPM reste minoritaire et n'a augmenté que de cinq points (de 35 à 40 %) entre 2014 et 2022187(*).
Sur le troisième volet, celui de la prise en charge, les difficultés sont nombreuses. Plus exigeante que pour les majeurs du fait - notamment - de la présence de la PJJ et d'une offre éducative obligatoire, cette prise en charge reste frappée par les mêmes imperfections que celles déjà relevées pour les majeurs (manque de personnel de soin, notamment), mais aussi par des lacunes spécifiques :
- l'accès à l'éducation demeure insuffisant, alors même que les jeunes incarcérés présentent statistiquement davantage de difficultés - scolaires comme tierces (familiales, d'addiction, de santé, etc.) - que les autres mineurs. Fondé sur de nombreuses visites de « terrain », un avis de la CGLPL publié en janvier 2024188(*) atteste de grandes lacunes, plus saillantes encore dans les QM : enseignement rassemblant des mineurs aux profils hétérogènes en âge ou en niveau scolaire ; nombre d'heures d'éducation trop restreint, y compris par rapport à sa durée théorique (12 heures hebdomadaires en QM et 20 heures en EPM en théorie, et respectivement 6 heures et 15 heures en pratique) ; salles de classe trop exiguës - voire partagées avec des majeurs - dans les QM ; impossibilité de passer un examen ou d'obtenir un diplôme dans les EPM comme dans les QM, etc. ;
- comme on l'a vu, la préparation à la sortie reste complexe, en particulier en l'absence de solutions de semi-liberté accessibles aux mineurs. Le pédopsychiatre Maurice Berger indiquait plus largement aux rapporteures qu'il n'était pas rare de voir « des jeunes violents [...] terminer leur séjour en établissement sans qu'un projet de sortie ait été élaboré avec eux » ;
- l'affectation des surveillants pénitentiaires « par roulement » dans les QM et les EPM ne permet pas une gestion des mineurs adaptée aux particularités de leurs profils. De manière inquiétante, la mission d'urgence sur l'exécution des peines relève que le taux de formation préalable est extrêmement faible. Celle-ci écrit ainsi que, « concernant les EPM et pour cette même année 2024, les chiffres indiquent que sur les 25 surveillants convoqués pour une formation obligatoire d'adaptation à l'emploi, seuls 11 s'y sont rendus, soit 44 %. Ce chiffre est le plus bas depuis 2017. [...] Quant aux QM, la situation reste très hétérogène et tributaire des configurations propres aux ressources humaines » : cette situation va à l'encontre de l'objectif de stabilisation et de professionnalisation des équipes qui interviennent auprès des mineurs ;
- enfin et surtout, il apparaît - comme le confirment les travaux de la Cour des comptes - que l'affectation des mineurs en QM ou en EPM ne répond à aucune logique de « fléchage » en fonction des profils, mais traduit à l'inverse une stricte logique capacitaire, liée aux places disponibles au moment de l'incarcération. Si cette situation s'explique probablement par la répartition inégale des EPM sur le territoire hexagonal, illustrée par la carte ci-dessous, elle génère une inégalité forte entre les mineurs.
Source : agence pour l'immobilier de la justice
La prise en charge est, en effet, très différente entre EPM et QM. En témoigne la différence de coût, très nette, entre une journée en EPM et une journée en QM : le ministère de la justice estimait, en 2021, le premier à 601 euros contre 144 pour le second (qui, lui-même, excède légèrement le coût d'une journée de détention pour un majeur, ce qui fait écho à l'investissement spécifique de la protection judiciaire de la jeunesse - PJJ - au sein des QM)189(*). Or, comme l'écrit la Cour des comptes, cette différence du simple au quadruple interroge, car « rien n'indique que les profils des mineurs qui y sont incarcérés sont différents ».
Il paraît évident que les coûts de construction et de fonctionnement des EPM ont été un frein à leur développement après la première « vague » de mise en service de tels établissements en 2007-2008, empêchant la généralisation de ces établissements et la fermeture subséquente des QM. Cependant, tout comme la Cour dans son rapport précité, les rapporteures alertent quant aux disparités entre EPM et QM, qui se traduisent notamment par :
- la place marginale de la PJJ et de l'Éducation nationale dans les QM, là où ces acteurs sont au coeur de l'organisation et du fonctionnement des EPM (notamment grâce au « binômage » entre administration pénitentiaire et PJJ) ;
- la différence, déjà citée, de temps consacré à l'enseignement (dans les faits, 6 heures par semaine en QM et plus du double - 15 heures - en EPM) ;
- le taux de couverture en personnel très inégal (cinq mineurs détenus pour un éducateur en QM, contre 1,7 mineur détenu pour un éducateur en EPM ; un nombre de personnels de surveillance près de cinq fois supérieur par détenu en EPM par rapport à ce qu'on observe dans les « grands » QM, avec en outre une formation préalable plus longue pour les surveillants appelés à intervenir en EPM) ;
- la gestion de la santé mentale est facilitée en EPM par la présence constante d'un psychologue de la PJJ, une telle présence n'étant assurée que dans un tiers des QM.
Ces divergences ont de quoi surprendre dans un contexte où les mineurs incarcérés en EPM ne présentent pas un profil différent de ceux qui sont détenus en QM - qu'il s'agisse de leur statut pénal (condamné ou prévenu), de la durée de la peine, de leur âge ou encore de la gravité des infractions commises.
Par ailleurs, malgré les moyens importants dont ils disposent, les EPM présentent un bilan contrasté : tous ne sont pas dotés des moyens matériels et humains idoines, et des atteintes graves aux droits des détenus ont pu y être relevés - comme en témoigne l'exemple de l'établissement de La Valentine, dans les Bouches-du-Rhône, qui a fait l'objet de recommandations en urgence de la CGLPL en août 2025190(*) pour remédier au « surenfermement » des mineurs, soumis à une pratique appelée « mise en grille »191(*) et, plus largement, incarcérés dans des conditions de prise en charge très dégradées à tous les niveaux.
b) Les centres éducatifs fermés : un placement qui favorise désormais la réitération ?
Mis en place pour offrir à la justice une solution intermédiaire entre le milieu ouvert et l'incarcération, en particulier en direction des jeunes multi-réitérants ou n'ayant pas respecté les mesures éducatives qui leur étaient imposées à la suite d'une infraction, les centres éducatifs fermés (CEF) sont soumis à deux modes de gestion différents : une majorité (37 sur 55) relève du secteur associatif habilité (SAH), les autres (soit 18 centres) relevant d'une gestion directe par la PJJ - dite « secteur public » (SP).
Les CEF accueillent des mineurs placés sous contrôle judiciaire ou soumis à un sursis probatoire, ainsi que ceux qui bénéficient d'un placement extérieur ou d'une libération conditionnelle. Y sont en l'état placés des mineurs mis en cause principalement pour vol (35 % en 2024), violences volontaires (37 %) ou pour une infraction à la législation sur les stupéfiants (29 %)192(*).
Les CEF ne sont pas confrontés à la surpopulation ; ils paraissent, au contraire, sous-exploités, leur taux d'occupation s'élevant à 63 % en septembre 2024193(*) contre une « cible » fixée à 85 % et permettant à la fois un accueil correct des mineurs placés et une gestion sereine des flux.
De même que pour les majeurs, ce taux global cache de lourdes disparités territoriales, les centres d'Île-de-France et d'outre-mer accueillant 22 % de la totalité des mineurs placés en CEF alors qu'ils ne concentrent que 13 % des capacités opérationnelles nationales.
Source : mission thématique sur les CEF, mars 2025
Or, parallèlement au « plan 15 000 », a été lancé en 2017 un plan de construction de 20 nouveaux CEF, dont cinq dans le SP et quinze dans le SAH. Deux CEF s'y sont été ajoutés sur demande du ministre de la justice : celui de Mayotte, promis à une gestion publique, et celui de Villeneuve-Loubet, en gestion associative.
Comme le « plan 15 000 », et globalement pour les mêmes motifs, le programme de construction de nouveaux CEF demeure aujourd'hui inabouti : fin 2024, seuls quatre CEF étaient déjà ouverts ; quatre doivent ouvrir en 2025 et cinq entre 2027 et 2028, le calendrier de mise en service des centres restants n'étant pas connu194(*).
La construction de ces nouveaux centres pose question dans la mesure où, d'une part, elle apparaît en décalage avec le taux d'occupation effectif des centres déjà en service et où, de l'autre, elle ne s'appuie pas sur un schéma rationnel tenant compte de l'« offre » existante de placement, comme ont eu l'occasion de le déplorer tant la Cour des comptes dans son rapport de 2023 que la rapporteure Laurence Harribey dans ses avis précités.
Les ressorts, le déroulement et les effets du placement en CEF charrient, en effet, plusieurs interrogations.
Les causes d'un tel placement ne sont, en premier lieu, pas définies avec netteté et semblent varier d'une direction interrégionale à l'autre. La mission thématique sur les CEF relève à cet égard que « La proportion de jeunes placés en CEF sur l'ensemble des jeunes placés au pénal varie considérablement d'une direction interrégionale à l'autre, entre 14 % dans le Grand Centre et 53 % dans le Sud-Ouest, pour un nombre de jeunes suivis au pénal sensiblement identique. Le rapport entre le lieu d'implantation des CEF et l'effectif de jeunes placés au pénal n'est pas clairement établi » : on peut, là encore, voir dans ce constat le reflet d'un placement devenu au fil du temps une simple « gestion des flux », les mineurs étant - comme les majeurs - affectés selon les places disponibles et la proximité des établissements plutôt qu'en fonction de leur profil ou de leurs besoins.
Plus largement, et de même que l'orientation du mineur condamné vers un EPM ou un QM ne semble pas répondre à un quelconque profilage des affectations, le placement en CEF ne paraît pas s'inscrire dans une logique clairement établie de gestion des mineurs condamnés. Ainsi que la commission le souligne depuis plusieurs années dans ses rapports pour avis sur les crédits budgétaires attribués à la PJJ, les CEF semblent être devenus une solution de placement par défaut, y compris pour des mineurs qui ne correspondent pas au profil théorique des placements dans de tels centres : le nombre de journées en CEF a ainsi explosé entre 2005 et 2022, passant de 32 000 à plus de 100 000 sans que la démographie ou la délinquance des mineurs aient évolué à due concurrence ; à l'inverse, l'hébergement dit « diversifié », c'est-à-dire hors CEF ou centres éducatifs renforcés, s'est effondré, passant de 300 000 à 138 000 journées195(*).
La rapporteure Laurence Harribey écrivait ainsi, dès 2023 :
« Le risque est ainsi que les créations de places en CEF ou en CER soient ``gagées'' par des suppressions dans les autres structures. Selon les représentants du SAH, cette évolution peut s'expliquer à la fois par la plus grande facilité de gestion de ces centres (qui, financés par un seul intervenant, sont d'un pilotage plus simple que les autres structures qui font l'objet d'une gestion conjointe) comme par la méconnaissance, de la part des éducateurs et des magistrats, de la richesse des autres possibilités existantes en matière de placement. »
La sortie de CEF se heurte, quant à elle, à l'insuffisance des liens entre milieu fermé et milieu ouvert : les outils disponibles pour bâtir un projet de sortie existent, mais sont sous-exploités, puisque seuls 15 % des projets s'accompagnent d'un programme de prise en charge conjointe en lien avec le milieu ouvert ; de même, les possibilités d'aménagement créées par la LOPJ du 23 mars 2019 ne sont mises en oeuvre que dans 16 % des cas, alors même qu'elles doivent permettre un accueil temporaire constituant un « sas » bienvenu entre l'environnement contraignant des CEF et le retour à des cadres extérieurs plus souples ; enfin, faute de moyens, le nombre de jeunes faisant l'objet d'une prise en charge renforcée en sortie de CEF est extrêmement restreint (moins de 10 %).
Le contenu du placement charrie, lui aussi, son lot de carences.
Tout d'abord - et, là encore, ce constat est abondamment documenté par les travaux du Sénat comme de la Cour des comptes -, les professionnels affectés dans les CEF sont insuffisamment nombreux et formés. Ces centres souffrent, en effet, d'un manque d'attractivité au sein de la PJJ. Ce phénomène, ancien, se maintient à un niveau préoccupant dans le secteur public : d'après la mission d'urgence sur l'exécution des peines, le taux de couverture des postes par le biais de mobilités internes reste particulièrement bas (10 postes sur 68 en 2024, soit un taux de seulement 15 %), obligeant à recourir à des sortants d'école ou à des contractuels peu formés - voire dépourvus de toute formation spécifique. Selon la même source, « cette problématique est encore plus importante dans les deux tiers des CEF gérés par le SAH »196(*).
Ces difficultés de recrutement et de « fidélisation » contribuent d'ailleurs, et de manière éminente, au faible taux d'occupation des CEF : il n'est ainsi pas rare que les places ne soient pas pourvues faute de personnel pour prendre en charge les mineurs placés.
Pour en revenir au contenu du placement, le récent rapport de la mission thématique sur les CEF lancée par le cabinet du ministre de la justice, dont les conclusions ont été rendues publiques en mars 2025, permet de dresser un bilan du fonctionnement de ces centres - étant rappelé que, en raison notamment de l'absence de statistiques globales et consolidées, les CEF n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation globale de leur efficacité.
Or, ce diagnostic a de quoi inquiéter. La mission met en évidence :
- des contenus de prise en charge « hétérogènes », avec des activités de jour « aléatoires », parfois des « incohérences » liées aux divergences entre les professionnels des centres et, surtout, un objectif de scolarisation non atteint : alors que les mineurs placés en CEF doivent suivre chaque semaine 15 heures d'enseignement, ce quota est loin d'être respecté car « les jeunes ont le plus souvent une séquence scolaire par jour, de 1h à 2h en moyenne, ce qui fait un total de 5h à 10h par semaine mais le plus souvent dans la fourchette basse ». La CGLPL, dans son avis précité, estime pour sa part à moins de 5 heures hebdomadaires la durée moyenne des enseignements dispensés en CEF ;
- un pilotage national et interrégional perfectible, un pilotage territorial disparate et un nombre insuffisant de contrôles menés sur les CEF. Les rapporteures déplorent particulièrement cette situation, peu compréhensible dans un contexte où les risques de dysfonctionnements, attestés par des fermetures nombreuses de CEF en 2017 et 2018 à la suite de violences graves, sont élevés au vu de la sensibilité du public accueilli et des difficultés de ressources humaines déjà évoquées ;
- une durée de placement trop brève (4 mois en moyenne en 2024), nettement inférieure au délai « cible » de prise en charge, fixé à six mois, avec au surplus une différence sensible entre la durée moyenne de placement dans les centres du SAH (4,6 mois en 2024) et ceux gérés par la PJJ (3,1 mois). Cette différence se reflète dans le taux de mineurs ayant suivi un parcours de placement complet, donc d'au moins six mois, qui s'établit à 63 % dans le SAH et à seulement 39 % pour le SP. Les divergences entre SAH et SP, bien que majeures, n'ont pas pu être expliquées par la mission.
Ce décalage entre le délai « cible » et le délai effectif de placement en CEF, qui découle des conséquences - non anticipées - de l'entrée en vigueur du CJPM et du raccourcissement des délais entre les jugements sur la culpabilité et sur la peine, n'est pas une nouveauté. La commission des lois s'inquiétait ainsi, fin 2024, que la durée du placement en CEF soit inférieure à 6 mois dans 81 % des cas, et même à 3 mois dans 48 % des cas, à la fois du fait de mainlevées anticipées et de « fragilités des établissements en termes de ressources humaines »197(*) : cette contradiction entre le projet directeur des CEF et la réalité de leur fonctionnement depuis l'entrée en vigueur du CJPM témoigne d'une contradiction entre le « temps éducatif », dont la longueur permet des ruptures parfois salvatrices entre le mineur et son milieu d'origine, et le rythme accéléré des décisions pénales.
Toujours sur le plan qualitatif, est posée depuis plusieurs années la question de l'efficacité des CEF en matière de lutte contre la récidive, cette interrogation n'ayant jamais été soldée en dépit des demandes réitérées - voire insistantes - des deux chambres du Parlement.
Le rapport précité de la mission thématique apporte, pour la première fois, une réponse partielle à cette question, issue d'une étude menée par la PJJ en 2008 (et dont on peut s'étonner qu'elle n'ait jamais été transmise aux assemblées parlementaires, en dépit des sollicitations successives qu'elles ont adressé au ministère) ; elle n'est toutefois pas rassurante. Menée sur les mineurs placés dans 13 CEF entre 2003 et 2007, elle tend à montrer que les placements en CEF de moins de quatre mois augmentent le risque de réitération, tandis que ceux de plus de six mois tendent à l'inverse à le faire diminuer ; elle conclut également que les incidents survenus au cours du placement n'ont un effet aggravant sur la réitération que dans le cas où celui-ci est court. En somme, si les CEF assurent leur fonction de prévention de la récidive et de la réitération, ce n'est qu'à la condition que le placement dure au moins six mois ; ils ont à l'inverse un effet néfaste lorsque le placement dure moins de quatre mois.
On peut en déduire, au vu des statistiques déjà présentées, que les CEF sont actuellement sans effet dans la lutte contre la récidive dans plus de 80 % des cas, et qu'ils contribuent à la réitération dans au moins 50 % des cas.
II. RÉFORMER SANS SURSEOIR : CINQ AXES POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DES PEINES
Les travaux menés par la mission ont mis au jour les multiples défaillances qui affectent l'exécution des peines, suscitant l'incompréhension des praticiens, des condamnés et des citoyens dans leur ensemble.
Les rapporteures estiment nécessaire d'engager, sans délai, une réforme ambitieuse procédant d'un véritable changement de philosophie et rapprochant, autant que faire se peut, la condamnation de la peine exécutée. Loin des injonctions paradoxales auxquelles le législateur - avec, certes, une relative opacité quant à l'effet prévisionnel de ses choix - a accepté par le passé de soumettre les acteurs de la peine, et en rupture avec des textes trop contraignants qui n'ont en pratique produit que des conséquences inverses à leur objectif, elles plaident pour redonner à chaque acteur la capacité d'agir en conscience, dans l'entier périmètre de ses responsabilités et en disposant d'un nombre suffisant de leviers de souplesse, mais aussi d'une véritable visibilité sur le déroulé de la peine.
Elles plaident pour traduire ce nouveau paradigme en cinq axes :
- redonner du sens à la peine, non seulement en rétablissant la possibilité pour le juge du fond de prononcer de très courtes peines de prison ferme à l'encontre des profils pour lesquels une telle sanction paraît adéquate, mais aussi en promouvant une individualisation effective des peines ;
- replacer la réinsertion au coeur de la peine, ce qui passera en particulier par une revalorisation des peines alternatives à la détention ;
- juguler la surpopulation carcérale en bâtissant, enfin, une alternative crédible à la détention, en augmentant les capacités opérationnelles de nos prisons, mais aussi facilitant le prononcé de peines plus courtes en évitant l'actuelle « escalade » vers les longues peines ;
- favoriser une exécution plus rapide des peines et permettre un véritable contrôle de cette exécution, y compris en permettant à l'autorité judiciaire de s'appuyer sur une véritable police de la probation ;
- garantir enfin un traitement adapté des condamnés mineurs en faisant de la sanction un levier efficace de lutte contre la récidive.
A. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES
La peine constitue le coeur de la réponse pénale. Elle incarne, à la fois, la réprobation sociale attachée à la violation de la loi et la volonté de l'État de prévenir la réitération des comportements délictueux. Or, les constats dressés dans la première partie de ce rapport ont mis en évidence une érosion progressive du sens de la peine, perceptible tant pour la société dans son ensemble que pour les justiciables eux-mêmes. L'écart croissant entre les peines théoriques encourues et celles effectivement prononcées, l'absence de lisibilité de certaines sanctions et les difficultés persistantes à assurer un accompagnement propice à la réinsertion contribuent à fragiliser la crédibilité de la justice pénale et à alimenter un sentiment d'ineffectivité de la sanction.
Dans ce contexte, la mission considère indispensable de redonner toute sa portée à la peine, afin qu'elle remplisse pleinement les fonctions qui lui ont été assignées par le législateur : sanctionner l'acte commis, protéger la société, prévenir la récidive et favoriser la réinsertion de la personne condamnée. Il s'agit, autrement dit, de rétablir l'équilibre entre la dimension symbolique et la dimension opérationnelle de la peine, en veillant à ce qu'elle soit à la fois compréhensible, proportionnée et exécutable dans des conditions garantissant son efficacité.
Aux yeux des rapporteures, cet impératif doit connaître une double traduction dans notre droit : en premier lieu, il s'agit d'assurer une cohérence entre la peine encourue, prononcée et exécutée, donc de renforcer l'effectivité et la lisibilité des sanctions pénales ; il est nécessaire, en second lieu, de garantir enfin l'adéquation entre l'auteur, la gravité de l'infraction et la peine, en promouvant une individualisation renforcée de la peine.
1. Garantir une meilleure adéquation entre les peines encourues, les peines prononcées et leur exécution effective
a) Rétablir la signification de la sanction prononcée
Les travaux menés par la mission ont conduit à mettre en évidence la multiplicité des dispositifs d'aménagement de peine offerts aux personnes condamnées. Cette pluralité de mécanismes, qui reflète la volonté du législateur de favoriser l'exécution des peines en milieu ouvert, soulève toutefois des interrogations quant à la lisibilité et à la cohérence du système pénal. Il convient à cet égard de rappeler qu'avant même toute incarcération effective, plus de 40 %198(*) des peines privatives de liberté prononcées sont soit aménagées, soit converties, traduisant une pratique largement répandue d'adaptation de la sanction.
Les aménagements et réductions de peine participent de l'individualisation de la sanction, et ne devraient pas être assimilés à une logique de clémence systématique. Les rapporteures observent toutefois que le principe, désormais inscrit dans la loi, du caractère obligatoire de l'aménagement de la peine ab initio a profondément modifié la philosophie de la sanction. En pratique, l'octroi d'un tel aménagement est devenu un droit pour le condamné, qui n'a plus à démontrer le moindre effort en matière de réinsertion, ni à manifester une prise de conscience quant au préjudice causé à la victime ou au risque de récidive, à travers une réflexion sur son passage à l'acte. Cette évolution suscite des critiques, notamment de la part de l'Union syndicale de la magistrature (USM), qui relève que « cette automaticité fait perdre l'individualisation nécessaire dans le suivi des personnes condamnées et le sens donné aux peines ». Les rapporteures partagent pleinement ce constat et estiment que la peine, en perdant sa dimension d'adaptation au profil et au parcours de l'auteur, tend à devenir une mécanique procédurale, au détriment de sa vocation à protéger la société et à favoriser une réintégration durable.
Parallèlement, les rapporteures ont été convaincues au cours de leurs travaux que les modifications fréquentes et parfois contradictoires apportées par le législateur au cadre juridique de l'exécution des peines ont altéré la lisibilité de ces dernières.
Cette perte de sens se trouve favorisée, voire accentuée, par le fait que les juridictions de jugement et les juges de l'application des peines sont fortement incités par le droit et par les contraintes matérielles qui s'imposent à eux à privilégier certaines modalités d'aménagement ou certaines mesures, qui sont généralement les moins individualisées.
Le législateur doit, dès lors, s'attacher à résorber le décalage significatif entre la peine telle qu'elle est prononcée par la juridiction de jugement et celle qui est effectivement exécutée par le condamné. Ce décalage alimente, en effet, un questionnement récurrent sur l'efficacité réelle de la sanction et sur sa capacité à remplir les différentes fonctions qui lui sont assignées, qu'il s'agisse de punir l'auteur, de protéger la société ou de prévenir la récidive. À cet égard, le syndicat Unité Magistrats FO rappelait opportunément que « la question du sens de la peine se pose lorsque celle-ci change de nature à plusieurs reprises, rendu possible par la législation actuelle autorisant divers aménagements successifs, ou encore lorsqu'un quantum d'emprisonnement est prononcé mais que le condamné est libéré bien avant le terme initialement fixé, situation parfois incompréhensible, voire illisible, pour nombre de nos concitoyens ».
Ce constat met en évidence la nécessité de repenser le paradigme même de la peine, en particulier des peines d'emprisonnement ferme. Cette réforme devrait viser à réduire l'écart existant entre la sanction prononcée par la juridiction et celle qui est effectivement exécutée par la personne condamnée, afin de renforcer la crédibilité de la décision judiciaire et de garantir une meilleure intelligibilité de la réponse pénale.
Les rapporteures partagent entièrement l'analyse dressée dans le rapport adopté par la commission des lois199(*) sur la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, qui insiste sur « la nécessité, d'une part, de redonner des marges de manoeuvre aux magistrats et, d'autre part, de mettre fin à la confusion des rôles entre la juridiction de jugement (donc le tribunal correctionnel) et le juge de l'application des peines, facteur d'illisibilité pour les condamnés et de moindre efficacité pour la réponse pénale ».
La mission d'information recommande donc de restaurer la cohérence des différents dispositifs d'aménagement des peines, tant pour rétablir la liberté d'appréciation du juge, que pour remédier aux effets pervers que les seuils actuels induisent.
L'essentiel des représentants de magistrats auditionnés par les rapporteures partage cette appréciation. L'USM, l'ANJAP, Unité magistrats exprimèrent chacun explicitement leur souhait que le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio soit levé.
La CNPP, qui rejoint cette considération générale, appelle toutefois le législateur à la mesure, en estimant que « si l'aménagement de principe de toutes les peines inférieures à un an est discutable, l'inverse le serait tout autant ».
Les rapporteures partagent ces analyses et estiment que les nombreuses et fastidieuses obligations de motivation spéciale auxquelles doivent se soumettre les juges du fond pour voir la peine appliquée telle qu'ils l'ont prononcée nuisent gravement à la lisibilité et à la crédibilité des sanctions pénales. Elles estiment, par voie de conséquence, nécessaire de supprimer la motivation spéciale qui s'impose aujourd'hui au juge du fond pour écarter l'aménagement de la peine200(*).
Proposition n° 1
Rapprocher le prononcé des peines de leur exécution effective en limitant les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge correctionnel.
L'illisibilité du droit de l'exécution des peines tient également à ses trop fréquentes évolutions. Les rapporteures ont exposé les évolutions qui ont conduit, à deux reprises, à une modification du quantum d'aménagement ab initio des peines201(*) - par les lois n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Comme on s'en souvient, le législateur a établi en 2019 différents seuils contraignants pour le juge, lesquels limitent par définition la liberté d'appréciation de ce dernier et en conséquence les modalités d'individualisation des peines ; l'aménagement ab initio étant désormais obligatoire pour les peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué en principe pour celles de six mois à un an.
Or, il apparaît que cette réduction de la liberté d'appréciation du juge a eu pour effet pervers l'augmentation des peines prononcées par ce dernier, dans une stricte logique de contournement d'un seuil contraignant.
Le constat établi ci-dessus est implacable202(*) : le nombre de peines de six mois à un an prononcées a significativement augmenté entre 2019 et 2024 (de 27 786 à 41 947), tandis que celui des peines de moins de six mois diminuait sur la même période de plus de 20 % (de 86 564 en 2019 à 67 702 en 2024).
Plus, les contraintes établies au prononcé d'une incarcération de six mois à un an, qui exige désormais une motivation spéciale, ont vraisemblablement provoqué la hausse des condamnations d'un à deux ans ; le nombre des détenus incarcérés pour une telle peine, qui s'élevait à 10 640 en 2020, atteignit 14 000 au 1er janvier 2025.
Les rapporteures jugent ainsi crucial de rétablir la cohérence des dispositifs d'aménagement des peines, en revenant sur les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en la matière. Ces dernières ont en effet abouti au résultat inverse à celui escompté par le législateur ; l'aménagement comme l'individualisation des peines n'en ont pas été améliorés, la lisibilité de la sanction en a été gravement altérée et la surpopulation carcérale s'est accentuée.
La mission préconise donc, en complément de la suppression déjà évoquée des dispositions imposant une motivation spéciale pour l'exécution des peines de prison ferme, de rétablir la faculté du juge d'aménager ab initio les peines d'une durée inférieure ou égale à deux ans.
Les rapporteures estiment, par ailleurs, qu'un aménagement ab initio ne devrait être décidé par le tribunal correctionnel que s'il dispose d'une enquête sociale suffisamment étayée ; en d'autres termes, la peine ne doit être aménagée que sur le fondement d'éléments permettant d'apprécier avec précision la situation personnelle, familiale et sociale du condamné. Dans tous les autres cas, il doit appartenir au JAP de se prononcer dans un second temps (donc après une courte période d'incarcération) sur l'opportunité comme sur la faisabilité d'un aménagement de la peine.
Ces révisions législatives, soutenues par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, permettraient d'après les rapporteures de restaurer ensemble la cohérence des dispositifs d'aménagement des peines, la liberté d'appréciation des juges et les modalités d'individualisation des peines. Elles contribueraient donc, de manière éminente, à redonner son sens à la peine, désormais clairement établie dès son prononcé. Elles évacueraient en outre les effets pervers engendrés par des contraintes législatives que les juridictions de jugement contournent actuellement au détriment tant de l'individualisation des peines que de la régulation de la population carcérale.
Proposition n° 2
Supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et les rendre possibles pour le juge du fond, sur la base d'une enquête sociale étayée, pour toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à deux ans.
b) Réajuster le quantum des peines prononcées au regard du quantum encouru
Les auditions menées par la mission ont par ailleurs révélé une distorsion croissante entre le quantum des peines encourues et celui des peines effectivement prononcées. Comme précisé en première partie du rapport, la loi prévoit des maxima toujours plus élevés, tandis que les juridictions correctionnelles n'appliquent en moyenne que 7 % du quantum théorique.
Les durées de peine d'emprisonnement ferme sont, à cet égard, globalement faibles par rapport aux peines encourues. Si, par exemple, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement est théoriquement « punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende »203(*), en pratique, plus de 50 % des personnes condamnées le sont à moins de 540 jours de prison ferme et seules 10 % d'entre elles le sont à une durée de trois ans ou plus d'après les chiffres communiqués à la mission d'information. La distorsion est encore plus marquante s'agissant de la détention non autorisée de stupéfiants, que le code pénal punit de dix ans d'emprisonnement204(*) : 90 % des personnes condamnées le sont, en pratique, à moins de deux ans d'incarcération.
Cette situation produit deux difficultés. Premièrement, et comme l'a rappelé le professeur Anne Ponseille lors de son audition par les rapporteures, « l'écart important entre le maximum encouru et le quantum qui est prononcé par le juge [peut] avoir une incidence négative sur le taux de récidive. »
Cette situation nourrit en outre dans l'opinion publique le sentiment d'une justice laxiste, alors même que les peines prononcées sont très largement exécutées. Il paraît donc essentiel que puissent être identifiés les cas dans lesquels l'écart entre peines encourues et peines prononcées est important, et analysées les causes de cet écart. Un tel écart est susceptible, par exemple, de procéder d'une insuffisante application ou d'une mauvaise rédaction des lois pénales en vigueur, notamment pour celles d'entre elles qui sont marquées par un nombre important de conditions légales restrictives ou de circonstances aggravantes.
Proposition n° 3
Évaluer les causes d'écart entre le quantum encouru et le quantum prononcé, afin de renforcer la crédibilité de la sanction.
2. Réintroduire les très courtes peines, leviers d'efficacité de la réponse pénale
Comme les rapporteures l'ont relevé ci-avant, la politique pénale française se caractérise par un allongement continu de la durée des incarcérations - pour mémoire, 11,3 mois en moyenne, contre 4,6 en Allemagne - sans que cette sévérité accrue ne contribue à résorber la surpopulation carcérale ou à lutter contre la récidive. Ce paradoxe fragilise la lisibilité et l'efficacité de la réponse pénale.
Dans ce contexte, la réintroduction de très courtes peines apparaît comme un levier permettant de rétablir la cohérence du système en apportant une réponse pénale plus rapide et adaptée, notamment face à la récidive. Cette réforme suppose naturellement que les aménagements de peine ab initio aient été rendus facultatifs pour le juge du fond, conformément à la proposition n° 2.
La question des très courtes peines d'emprisonnement, c'est-à-dire en l'espèce des peines inférieures à un mois de détention (interdites par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), soulève des enjeux spécifiques tant pour l'efficacité de la réponse pénale que pour le fonctionnement du service public pénitentiaire.
Depuis quelques années exclues de l'arsenal des sanctions privatives de liberté en raison de leur supposée inefficacité, ces peines connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt dans le débat public. Elles apparaissent en effet comme un outil susceptible de concilier deux objectifs a priori contradictoires : assurer une réponse rapide, visible et proportionnée face à certains comportements délictueux, tout en évitant l'encombrement durable des établissements pénitentiaires. Leur pertinence doit ainsi être appréciée au regard de leur faisabilité pratique, des conditions de leur exécution et des garanties qu'elles offrent en matière de prévention de la récidive.
Bien que de nombreux magistrats, qu'ils soient praticiens ou théoriciens du droit, revendiquent la possibilité de recourir à une gamme de sanctions la plus étendue possible afin de garantir une meilleure individualisation des peines, la question des « très courtes peines » continue de susciter des débats en France. Le rapport de la mission d'urgence sur l'exécution des peines205(*) relevait ainsi « une absence de consensus en dépit de l'ancienneté du débat ».
Il est en effet avéré que les peines de courte durée - en l'espèce, comprises entre un et six mois - présentent un caractère désocialisant et se révèlent inefficaces en matière de prévention de la récidive et de réinsertion. La conférence nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation (CNDPIP) a ainsi attiré la vigilance des rapporteures sur les risques que présente une incarcération de courte durée : « ces petits quantums de peine d'emprisonnement sont particulièrement néfastes en termes d'insertion : deux mois, c'est assurément perdre son emploi et son hébergement, c'est risquer une phase suicidaire au quartier arrivant, c'est risquer la rupture des liens familiaux et des droits sociaux, alors que la peine pourrait être effectuée en milieu libre ».
Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, « le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ». Or, les courtes peines ne permettent pas aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) d'assurer un accompagnement efficace. C'est pourtant ce travail sur le passage à l'acte, les comportements délictueux et la réinsertion sociale et professionnelle qui confère sa pleine utilité à la peine d'emprisonnement.
Ce constat a de quoi inquiéter, étant rappelé que plus de 20 % des condamnés écroués sont aujourd'hui en détention en raison d'une peine comprise entre un et six mois206(*).
Les travaux scientifiques consacrés aux « très courtes peines », entendues comme des peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois - voire limitée à quelques jours seulement -, apparaissent en revanche plus encourageants. Si la question de la transposabilité de leurs conclusions demeure posée au regard des spécificités propres à chaque système national, plusieurs études internationales207(*) tendent toutefois à démontrer que des peines d'une dizaine de jours pourraient se révéler plus efficaces que certaines sanctions alternatives, telles que les travaux d'intérêt général.
Si la plus grande efficacité des très courtes peines sur certaines peines alternatives effectuées en milieu ouvert reste sujette à débat, il ressort néanmoins avec une certaine clarté que le prononcé d'une peine d'une durée très réduite constitue une option préférable aux courtes peines de quelques mois. En effet, dès lors qu'elles sont exécutées dans des conditions qui permettent leur anticipation - par le biais, par exemple, d'un mandat de dépôt à effet différé -, de telles sanctions n'entraînent pas de véritable effet désocialisant et ne compromettent pas la situation professionnelle de la personne condamnée, tout en produisant un « choc carcéral » bref mais suffisamment dissuasif pour contribuer à la prévention de la récidive.
Le débat sur la suppression des peines d'emprisonnement ferme de moins d'un mois
En l'état de sa rédaction, l'article 132-19 prévoit, en son premier alinéa, que le sursis est possible pour tout ou partie de la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction ; parallèlement, il interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Insérée par la loi précitée du 23 mars 2019, cette interdiction était alors justifiée par la baisse tendancielle du prononcé de telles peines [10 000 en 2015 et 5 500 en 2020, selon les chiffres obtenus par Loïc Kervran, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale (rapport n° 1187, déposé le 26 mars 2025)] et, sur le fond, par le fait que « des peines fermes d'aussi courte durée [présentaient] un effet désocialisant majeur et prédispos[ai]ent à la récidive » (exposé des motifs de la loi n° 2019-222 précitée).
Le Sénat avait fait, lors de l'examen de LOPJ, fait preuve d'une certaine perplexité face à l'efficacité d'une telle mesure : les rapporteurs du texte, François-Noël Buffet et Yves Détraigne, estimaient ainsi que la suppression des peines de moins d'un mois « n'aurait vraisemblablement qu'une incidence limitée dès lors que seulement 9 100 peines d'une durée inférieure ou égale à un mois ont été prononcées en 2017 et seulement un peu plus de 600 d'entre elles faisaient l'objet d'un mandat de dépôt. L'étude d'impact estime sa portée, sur une année, à une diminution de 300 détenus ». Ils émettaient, en outre, une crainte importante, jugeant qu'« une telle disposition pourrait surtout présenter des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner cette interdiction, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une peine courte d'emprisonnement devront fixer un quantum minimal de deux mois, au lieu d'un, au risque d'allonger la durée moyenne d'incarcération ».
Source :
rapport
n° 780 (2024-2025) fait par Stéphane Le
Rudulier
au nom de la commission des lois
Les rapporteures se sont en outre rendues à La Haye, où elles ont rencontré les autorités néerlandaises afin d'échanger sur les modalités concrètes de mise en oeuvre et d'exécution du régime des très courtes peines institué aux Pays-Bas. Ce déplacement leur a permis d'observer directement un dispositif judiciaire dans lequel près de 70 % des peines prononcées chaque année par les juridictions sont des peines privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Elles ont pu constater que ce modèle présente des résultats significatifs, tant en matière de lutte contre la surpopulation carcérale que dans la prévention de la petite et moyenne délinquance.
Toutefois, les autorités néerlandaises reviennent sur la politique des très courtes peines après l'avoir plébiscitée durant plusieurs années. Elles ont signalé à la mission que les très courtes peines d'emprisonnement ne favorisent pas réellement l'atteinte des objectifs classiquement assignés à une condamnation : d'une part, le niveau de récidive des condamnés soumis à de telles peines reste comparable, voire supérieur, à celui observé avec des peines non privatives de liberté ; d'autre part, l'effet dissuasif d'une condamnation certes faible mais plus systématique paraît relativement limité en comparaison d'autres sanctions.
L'abandon par les Pays-Bas de la politique des très courtes peines repose également sur une volonté de durcir la répression pénale, et donc de prononcer des peines plus longues à l'encontre des délinquants208(*).
Ce bilan mitigé incite à faire preuve de prudence quant à la généralisation des très courtes peines. Il ne résout cependant pas la question d'une réintroduction dans notre droit de telles sanctions, aujourd'hui purement et simplement prohibées par le code pénal.
Les rapporteures considèrent, comme la commission des lois l'a relevé à l'occasion de ses récents travaux sur la proposition de loi visant à faire exécuter les peines de prison ferme, que les peines d'une durée inférieure ou égale à quinze jours pourraient s'avérer utiles sous quatre conditions :
- la première tient à leur temporalité dans le parcours de délinquance de l'auteur d'une infraction : les très courtes peines doivent, à l'évidence, être proscrites pour les condamnés les plus endurcis et ne semblent efficaces que si elles interviennent en amont d'un ancrage durable dans la délinquance. Comme le rappelle la mission d'urgence sur l'exécution des peines209(*), « [la] réceptivité [des publics peu aguerris] aux vertus pédagogiques et dissuasives prêtées au choc carcéral est documentée dans des études anglo-saxonnes » : il s'agit donc d'un outil qui peut contribuer à prévenir la récidive et à éviter toute « escalade » dans la délinquance ;
- la deuxième concerne les caractéristiques du condamné, les courtes peines devant être destinées aux délinquants jeunes ou socialement bien insérés. Il convient à cet égard de rappeler que les juges des enfants210(*), qu'on ne saurait soupçonner de « sécuritarisme », déplorent eux-mêmes de ne plus pouvoir prononcer de très courtes peines à l'encontre des mineurs délinquants, alors même que celles-ci pouvaient être précieuses « en situation de crise pour mettre fin à un emballement »211(*) ;
- la troisième concerne leurs conditions d'exécution, qui ne doivent pas aggraver les éventuelles fragilités préexistantes ou, pire encore, en créer de nouvelles. Le mandat de dépôt à effet différé devra ainsi être utilisé dès que nécessaire pour limiter l'effet désocialisant de la détention et la déstabilisation de la situation personnelle du condamné, qui pourrait se trouver à exécuter sa peine dans une période de congés, pour ceux qui ont un emploi, ou de vacances, pour ceux qui suivent une formation ;
- enfin et surtout, les très courtes peines doivent se dérouler dans des établissements adaptés non seulement en termes de sécurité (puisqu'elles s'adresseront à des publics dont la dangerosité est faible), mais aussi en termes de suivi et de prise en charge : de telles peines n'auront en effet de sens que si elles s'accompagnent de mesures permettant au condamné de prendre conscience de la gravité de son geste et lui accordant, si nécessaire, le soutien social dont il a besoin pour engager sa réhabilitation. Plus encore qu'adaptés, ces établissements devront être dédiés pour prévenir tout « mélange » entre les détenus condamnés à une très courte peine et des profils plus ancrés dans la délinquance. La piste consistant à créer des quartiers spécifiques semble, en revanche, devoir être abordée avec réserve au vu de la situation des établissements existants, déjà saturés212(*).
À la lumière de ces constats, la mission recommande de rétablir en droit français la faculté, pour les magistrats, de prononcer des peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Proposition n° 4
Rétablir la possibilité, pour le juge du fond, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, ces très courtes peines étant destinées aux condamnés bien insérés et non encore ancrés dans la délinquance, mineurs comme majeurs, et exécutées dans des établissements spécialisés.
3. Promouvoir une individualisation des peines plus effective
L'individualisation des peines constitue l'un des ressorts fondamentaux du régime d'exécution de ces dernières, en ce qu'elle garantit la bonne articulation entre les deux fonctions que l'article 130-1 du code pénal attache à la sanction pénale ; l'individualisation permet en effet de « sanctionner l'auteur de l'infraction » autant qu'elle « [favorise] son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Parce qu'elle permet de tenir compte des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'auteur de l'infraction, elle est un facteur essentiel du sens de la peine non seulement pour le condamné, mais aussi pour les victimes et pour la société.
Les travaux de la mission ont toutefois abouti à l'accablant constat que l'individualisation des peines est actuellement soit dévoyée pour des raisons tant juridiques que pratiques, soit insuffisante compte tenu des conditions dans lesquelles les aménagements de peine sont accordés.
Il apparaît ainsi que notre système d'exécution des peines ne favorise pas suffisamment le prononcé de peines adaptées à la personnalité des condamnés. Cela résulte tant de causes directes, comme le manque d'informations dont dispose la juridiction de jugement sur la personnalité des condamnés, que de causes plus indirectes, comme l'impact de la surpopulation carcérale qui impose une affectation des détenus au seul regard des places disponibles et non de leur profil.
Les récentes évolutions du droit ont, en outre, entendu favoriser l'aménagement des peines de courte durée au moyen de contraintes juridiques qui reposent sur le quantum de la peine prononcée. Ces dispositions, qui oeuvrent en creux à réguler la population carcérale, nuisent cependant en pratique tant à l'individualisation des peines qu'à l'objectif qu'elles poursuivent.
La mission a donc formulé des recommandations susceptibles de réduire les écueils sur lesquels échoue aujourd'hui l'individualisation des peines, qu'il s'agisse de l'affectation des détenus aux différents types d'établissement d'incarcération, des modalités juridiques de l'aménagement des peines ou encore des ressorts des décisions prises quant à l'application de ces dernières.
a) Garantir les moyens matériels de l'individualisation des peines
L'une des conséquences les plus insidieuses de la surpopulation carcérale tient à ce qu'elle compromet, voire empêche l'individualisation des peines d'emprisonnement et, partant, favorise la récidive.
Cette dynamique trace le contour d'un cercle vicieux dans lequel l'essentiel des personnes entendues par les rapporteures juge que le système carcéral français est enfermé.
La mission recommande ainsi d'assurer l'affectation des détenus au sein d'établissements carcéraux dont les caractéristiques correspondent à leur personnalité. Les circonstances actuelles conduisent en effet à un gâchis de ressources périlleux en ce qu'il fragilise les équilibres du système carcéral français.
Proposition n° 5
Assurer l'adéquation entre l'établissement d'incarcération et la personnalité des personnes détenues pour favoriser leur réinsertion en sortie de peine.
L'atteinte de cet objectif sera indéniablement facilitée par le déploiement d'outils, par ailleurs réclamé par les rapporteures213(*), permettant aux magistrats de connaître le volume et la nature des places de détention disponibles dans leur ressort.
Les travaux de la mission d'information ont permis d'identifier plusieurs volets de mise en oeuvre de cette recommandation générale.
La recherche d'un meilleur appariement entre les établissements pénitentiaires et les condamnés a récemment conduit à l'institution d'un type nouveau d'incarcération. Il est en effet apparu au législateur que les modalités de détention en maison centrale ne correspondaient pas aux caractéristiques actuelles de la criminalité organisée.
La création récente, par l'article 61 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, de quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) répond ainsi pleinement à l'objectif d'une affectation individualisée des condamnés, dans la mesure où les spécificités de ces établissements carcéraux ont été pensées au regard du profil des détenus qui ont vocation à y purger leur peine. La mise en service des QLCO permet aussi - voire surtout - de limiter les contacts entre les criminels de haut vol et les petits délinquants et, partant, d'éviter l'expansion des réseaux de narcotrafic, habitués à recruter leurs « petites mains » en prison.
La réévaluation annuelle de la décision d'affectation au sein de tels quartiers, qui fut portée par le Sénat, garantit en outre l'appréciation fréquente de cette dernière - et, partant, sa proportionnalité.
D'une manière générale, il importe de respecter la destination des différents types d'établissements pour que les détenus soient affectés à ceux qui correspondent le mieux à leur profil. Or, les rapporteures ont constaté au cours de leurs travaux que la décision d'affectation d'un détenu dans un établissement répondait souvent davantage à des facteurs géographiques ou d'occupation carcérale, qu'à la logique d'adéquation entre le type d'établissement et la personnalité du condamné concerné.
Le rapport précité de la Cour des comptes sur la surpopulation carcérale mentionne notamment le centre de semi-liberté d'Écrouves, que des condamnés dont le reliquat de peine à purger était inférieur à neuf mois ont intégré sans autre objectif que de soulager la maison d'arrêt où ils étaient jusqu'alors affectés.
Or, pour aboutir à la réinsertion des détenus, le régime de semi-liberté suppose non seulement une incarcération longue, mais une adéquation entre ses principes structurants et la personnalité des condamnés qui y sont incarcérés.
De la même manière, comme l'a déjà évoqué le présent rapport214(*), lorsqu'un détenu éligible à la LSC-D ne dispose pas d'un hébergement, il est placé dans un établissement de semi-liberté, suivant une logique de régulation des flux carcéraux préjudiciable au bon fonctionnement de ce dispositif.
Il apparaît en outre que les centres de semi-liberté, qui présentent d'évidentes qualités pour la réinsertion, souffrent tant d'un nombre insuffisant de places que d'une localisation souvent éloignée des bassins d'emploi.
Le développement de centres de semi-liberté, spécialement au sein d'agglomérations pourvoyeuses d'emplois, pourrait ainsi favoriser ensemble l'individualisation des peines et la réinsertion des condamnés.
Les rapporteures partagent à ce titre l'appréciation de l'ANJAP, suivant laquelle il importe de concevoir un enfermement différent des établissements carcéraux traditionnels, « avec des structures plus petites et intégrées dans un environnement urbain et sociétal ».
La mission recommande à cet égard d'augmenter et de sanctuariser les places dans les structures qui oeuvrent à la réinsertion des détenus. Il serait ainsi précieux que les personnes condamnées à une peine en milieu fermé puissent - lorsque leur personnalité y est adaptée - bénéficier de projets porteurs ou innovants, à l'instar des actuelles structures d'accompagnement à la sortie (SAS) ou du futur programme InSERRE (Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi) lancé en 2020.
Les structures de réinsertion en milieu fermé
Le programme InSERRE vise à créer des établissements dans lesquels la totalité des détenus disposerait d'un emploi, d'une formation ou d'un parcours professionnalisant, en partenariat avec « des entreprises à forte valeur ajoutée en investissant en particulier les métiers du numérique, du développement durable et les services à distance porteurs de débouchés », et qui se distingueraient par une préparation à la sortie renforcée, notamment assise sur le développement des liens entre les personnes incarcérées et le monde extérieur. L'ambition affichée est celle de la responsabilisation des détenus et de leur réinsertion via l'emploi - et ce, dès le début de leur incarcération.
Les structures d'accompagnement à la sortie (SAS), créées en 2022 en remplacement de structures analogues préexistantes, ont quant à elles pour but d'éviter les « sorties sèches » et de « favorise[r] la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en oeuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé » (article D. 112-21 du code pénitentiaire).
Source : commission des lois
Elles accueillent des personnes condamnées à des peines inférieures à un an - y compris les détenus ayant purgé des peines de moyenne ou de longue durée et dont le reliquat de peine est inférieur à cette durée - ainsi que celles qui bénéficient d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur.
Soutenant sans réserve le principe d'une meilleure réinsertion des détenus et le développement des SAS comme des établissements InSERRE, les rapporteures déplorent vivement l'ampleur limitée de ces initiatives.
On ne dénombre en effet aujourd'hui que 13 SAS pour l'ensemble du territoire national et le projet InSERRE connaît un important retard ; les trois établissements de 180 places chacun qui devaient être livrés en 2023 pour mettre en oeuvre ce nouveau programme n'accueillent pas encore de détenus.
La mission ne saurait se satisfaire de ce diagnostic : les rapporteures appellent le Gouvernement à prioriser, dans la mise en oeuvre du « plan 15 000 », la mise en service de nouvelles SAS et des structures dédiées au projet InSERRE.
b) Améliorer les décisions relatives à l'individualisation des peines
Outre les moyens matériels et les dispositifs juridiques nécessaires à la bonne individualisation des peines, il importe de veiller à la qualité même des décisions prises en la matière en instaurant des dispositifs susceptibles de parfaire l'adéquation entre la peine prononcée et la personnalité du condamné.
La mission a en effet constaté que le juge du fond se prononce souvent sur des aménagements de peine sans disposer d'éléments suffisants relatifs à la situation économique, sociale, familiale et personnelle du condamné, favorisant le recours à des aménagements génériques et peu individualisés.
Plusieurs des personnes et entités auditionnées par les rapporteures - à l'instar des représentants du réseau Permis de construire - ont ainsi suggéré de systématiser l'évaluation sociale ou l'entretien de positionnement avec les services d'insertion, qu'il s'agisse des SPIP ou d'associations partenaires, ce dès avant l'audience correctionnelle.
Les rapporteures considèrent que cette logique vertueuse devrait être promue, dans la mesure où elle faciliterait l'individualisation des peines prononcées - et par la suite, le respect des décisions prises lors du jugement tout au long de l'application de la sanction.
L'appréciation de la personnalité des prévenus pourrait ainsi reposer sur des enquêtes sociales préalables à l'audience correctionnelle.
À défaut d'éléments suffisants lors du prononcé de la peine, un renvoi au juge de l'application des peines pour définir les modalités d'exécution des peines prononcées devrait être systématique. De la même manière, et comme l'ont préconisé de nombreuses personnes entendues par la mission d'information, l'octroi d'un aménagement de peine ab initio devrait pouvoir être écarté lorsque le prévenu n'est pas comparant.
Cette évolution, que le Sénat a portée dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, gagnerait selon les rapporteures à être définitivement adoptée par le législateur.
Du point de vue institutionnel, la mission d'urgence relative à l'exécution des peines, qui a remis au garde des sceaux son rapport en mars 2025, préconise d'instaurer un « plateau technique pluridisciplinaire » à qui il reviendrait notamment d'évaluer les personnes mises en cause. Cet organe permettrait aux différents acteurs de l'exécution des peines d'exploiter l'ensemble des réponses qu'offre le droit pénal français.
Ladite mission d'urgence suggère ainsi de lui confier quatre missions structurantes :
- évaluer la situation des prévenus pour favoriser leur orientation dès avant l'audience ;
- individualiser la décision de justice ;
- faciliter l'exécution de la peine prononcée ;
- mettre à jour les situations pénales215(*).
La bonne réalisation des missions qui incomberaient à ce plateau technique reposerait sur la logique pluridisciplinaire à laquelle il obéirait. Le rapport précité souligne en effet que « l'évaluation [repose] essentiellement sur l'échange et la mutualisation d'informations ainsi que sur des regards et analyses croisés » - soit sur deux éléments qui font aujourd'hui largement défaut.
La composition de ce plateau technique en garantirait la pluridisciplinarité. La mission d'urgence envisage de réunir notamment :
- les personnels de greffe anciennement affectés au BEX, dans la mesure où ce dernier intégrerait le plateau technique. La CNPTJ a convaincu les rapporteures que le bureau d'exécution des peines apparaît « désormais parfaitement inscrit dans le mode de fonctionnement des juridictions [et] a montré sa pertinence et justifierait une extension ». Son intégration audit plateau serait susceptible d'améliorer la célérité et la qualité de la réponse pénale ;
- des représentants du SPIP, qui pourraient tant recueillir des informations relatives à la personnalité du condamné, que présenter l'éventail des réponses pénales dont dispose le magistrat au regard des mesures disponibles (détention à domicile sous surveillance électronique, Tig, etc.) ;
- un personnel de surveillance, qui serait par exemple susceptible de réaliser une enquête de faisabilité ou d'établir un DDSE ;
- l'avocat, qui aurait accès aux informations portant sur la personnalité du prévenu et pourrait favoriser le recueil de certains éléments relatifs à la situation de son client ;
- un assistant social, pour fluidifier les échanges avec les acteurs médicaux et sociaux ;
- un représentant de l'association d'aide aux victimes, pour procéder à l'analyse comparée des enquêtes sociales renforcées et des enquêtes réalisées par les victimes ;
- un agent de probation, dans l'hypothèse où cette fonction, évoquée infra, serait créée.
Comme le précise la mission d'urgence, suivant une approche que les rapporteures partagent, l'instauration du plateau technique pluridisciplinaire supposerait de repositionner le SPIP en pré-sentenciel, dans la mesure où son expertise est particulièrement précieuse dans cette séquence de la chaîne pénale.
Un tel plateau aurait une immense utilité pour garantir l'adéquation entre le profil du condamné et la peine retenue à la fois dans sa nature (peine alternative ou de prison ferme) et dans son exécution (aménagement ou non des peines de prison ferme). Il contribuerait à promouvoir un usage efficace autant que raisonné des aménagements de peine et des peines alternatives à la détention. La meilleure individualisation des peines, de leur prononcé à leur application, concourrait au surplus à la prévention de la récidive, dans la mesure où elle améliorerait la réinsertion, voire l'insertion des condamnés.
Proposition n° 6
Favoriser la meilleure individualisation de la peine et de son exécution en acquérant une meilleure connaissance de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle, grâce au renforcement du rôle des SPIP en phase pré-sentencielle.
Le présent rapport a par ailleurs mis en évidence la fréquente méconnaissance du rôle des SPIP par les juridictions de jugement et l'existence de tensions locales sur certaines attributions entre les CPIP et les JAP216(*).
Plusieurs personnes auditionnées par les rapporteures ont ainsi préconisé de clarifier les rôles respectifs du JAP et du SPIP, pour améliorer les conditions de l'application des peines.
Les représentants de la DAP se sont ainsi dits « favorable[s] à une évolution des missions du juge de l'application des peines, permettant de repenser les attributions respectives des JAP et des SPIP et d'en clarifier la répartition, en renforçant les pouvoirs d'individualisation des premiers, sans remettre en cause l'autonomie des seconds, afin notamment de ne pas réduire l'office du JAP à la gestion des incidents ».
L'ANJAP souhaite par exemple à cette fin que soit écartée la double convocation devant le JAP et devant le SPIP que le bureau d'exécution des peines est tenu de remettre à un condamné non incarcéré217(*).
De la même manière, certaines personnes auditionnées par les rapporteures suggèrent de confier à l'administration pénitentiaire ou au SPIP certaines compétences du JAP. Cela rejoint l'une des préconisations d'un précédent rapport d'information du Sénat218(*) ; il était suggéré de déléguer aux directeurs des services pénitentiaires certaines prérogatives actuellement dévolues aux magistrats afin d'affiner l'adaptation de l'exécution des peines (renouvellement des permissions de sortie, habilitation de structures offrant des travaux d'intérêt général, etc.).
Le Sénat recommanda ainsi, dans un rapport d'information ultérieur sur l'évaluation des services pénitentiaires d'insertion et de probation219(*), que le nouvel équilibre trouvé en matière de Tig220(*) puisse, le cas échéant, inspirer de nouveaux transferts de compétences, qui allègeraient quelque peu la lourde charge de travail des JAP tout en donnant de nouvelles responsabilités aux DPIP. L'ANJAP proposait par exemple à ce titre de confier de nouvelles compétences au SPIP en matière d'aménagement de peine ab initio : une fois le principe de l'aménagement de peine décidé, le SPIP pourrait « utilement déterminer les horaires, date d'écrou et le lieu d'assignation. De la même manière, en cas de changement de lieu d'assignation durant la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, le SPIP pourrait avoir compétence pour faire lui-même la modification ».
Le même rapport suggérait d'expérimenter en outre une permanence des SPIP au sein des tribunaux correctionnels pour favoriser la connaissance mutuelle entre ces différents acteurs. Cette expérimentation, portée dans le cadre des États généraux de la justice, faciliterait l'information rapide du condamné sur les suites concrètes de sa condamnation - et serait de surcroît nécessaire à l'établissement du plateau technique pluridisciplinaire évoqué supra.
Les rapporteures préconisent ainsi d'entreprendre une démarche de clarification des fonctions respectives du JAP et du SPIP, assise tant sur la meilleure ventilation des compétences entre ces derniers, que sur la meilleure compréhension de la répartition de leurs rôles respectifs auprès de l'ensemble des acteurs de l'exécution des peines, au premier rang desquels les magistrats du tribunal correctionnel.
Enfin, et comme l'a souligné la mission d'urgence relative à l'exécution des peines précitée, une telle démarche permettra de restaurer la mission de garant de la continuité du parcours de réinsertion et de prévention de la récidive qui incombe au JAP - et, partant, de remédier aux effets pervers des récentes réformes, qui ont réduit sa liberté d'appréciation et l'ont mobilisé sur la gestion des incidents.
Proposition n° 7
Clarifier les rôles respectifs du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
B. REPLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA PEINE
La peine, quelle que soit sa nature, ne saurait être pleinement efficace, et donc effectivement exécutée, que dans la mesure où elle satisfait aux fonctions qui lui sont assignées par le législateur. Celles-ci sont énoncées à l'article 130-1 du code pénal, lequel dispose qu'« afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions [...] de sanctionner l'auteur de l'infraction ; [...] de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » Or, les rapporteures ont observé, au cours de leurs travaux, un certain nombre de dysfonctionnements structurels et matériels qui compromettent le respect de cette seconde fonction, essentielle à la portée de la peine, à savoir l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée.
1. Donner à l'incarcération une finalité constructive
a) Renforcer la présence et la formation des personnels pénitentiaires
La réinsertion des personnes confiées à l'administration pénitentiaire fait partie de ses missions depuis la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, dont le premier article disposait que : « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ».
La mission relève toutefois que la réinsertion demeure l'un des maillons les plus fragiles de l'exécution des peines, en raison d'une prise en charge en détention notoirement insuffisante. Qu'il s'agisse du suivi social, de l'accès à la formation professionnelle ou de l'accompagnement sanitaire, les moyens alloués restent en deçà des besoins constatés. Les SPIP, acteurs centraux de la réinsertion, souffrent d'un déficit structurel d'effectifs qui ne permet pas de garantir un suivi individualisé conforme aux standards européens. Le ratio de personnes suivies par conseiller excède largement les recommandations internationales, ce qui limite la capacité d'intervention en détention, en dépit de la hausse d'effectif considérable de leurs effectifs au cours de la dernière décennie.
La hausse des effectifs des SPIP au cours de la dernière décennie
Les effectifs des SPIP ont connu une hausse significative depuis une dizaine d'années. Cette augmentation a eu pour point de départ l'engagement pris, le 9 octobre 2013, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de créer 1 000 postes sur trois ans, qui s'est effectivement traduit par la création de ces postes dans la loi de finances pour 2014.
Dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2015, le sénateur Jean-René Lecerf prenait acte « de la promesse tenue du Gouvernement de renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de milieu ouvert avec la création de 1 000 emplois en 2014 dont 650 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ». Il regrettait, toutefois, le caractère encore insuffisant de cette augmentation au regard de la charge de travail des SPIP. Cette hausse des moyens s'est inscrite dans un contexte marqué par un renforcement de l'ensemble des moyens du ministère de la justice, destiné notamment à lutter plus efficacement contre le terrorisme et la radicalisation.
La seconde augmentation significative des moyens humains des SPIP a été consécutive à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ). Ambitionnant de redonner du sens à la peine, les concepteurs de la LPJ ont jugé indispensable de renforcer les moyens des SPIP afin de permettre un meilleur accompagnement des PPSMJ. À partir de 2020, l'accroissement des moyens est également venu conforter la démarche voulue par le Gouvernement de Jean Castex de construction d'une « justice de proximité ».
Ainsi, pris dans leur globalité, les effectifs des SPIP ont connu une augmentation de 21 % depuis 2018, passant de 5 576 équivalents temps plein travaillé (ETPT) en 2018 à 6 736 en 2022. Comme le souligne la direction de l'administration pénitentiaire, si cette hausse a bénéficié à l'ensemble des corps affectés dans les SPIP, elle a principalement concerné le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CLIP), qui est le plus nombreux, et les agents non titulaires. Le nombre de CPIP est ainsi passé de 3 102 ETP en 2018 à 3 702 en 2022. Celui des « non-titulaires social, médico-social et culture » a crû de 406 à 540 ETP sur la même période. L'accent mis sur le recrutement des CPIP est logique au regard de leur rôle central dans le fonctionnement des services.
Source :
rapport
d'information n° 353 (2022-2023)
fait par Marie Mercier et
Laurence Harribey au nom de la commission des lois
Cette fragilité est accentuée par l'insuffisance de personnels spécialisés, tels que psychologues ou assistants de service social, dont la présence apparaît pourtant indispensable pour appréhender la complexité des situations rencontrées. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer significativement les moyens humains des SPIP, condition préalable à une meilleure effectivité des missions de réinsertion.
Proposition n° 8
Accroître les moyens humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de réduire le nombre de personnes suivies par conseiller et d'assurer un accompagnement social et professionnel adapté.
Par ailleurs, la mission souligne que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) intervenant en milieu fermé ne disposent pas d'une doctrine professionnelle adaptée aux réalités de la détention. Le référentiel actuel, inspiré du milieu ouvert, repose principalement sur des entretiens réguliers et prolongés, difficilement conciliables avec les contraintes de l'univers carcéral, marquées par des flux d'arrivants importants et des durées de peines très variables.
Faute de méthodologie spécifique, l'accompagnement proposé perd en pertinence et en efficacité, alors même que la population carcérale se caractérise par une forte précarité sociale : absence de qualification professionnelle pour plus de la moitié des détenus, pauvreté ou absence de ressources pour un quart d'entre eux, et, pour certains, absence de solution d'hébergement à l'entrée comme à la sortie de détention.
Cette situation appelle l'élaboration d'une doctrine professionnelle claire et adaptée pour les CPIP intervenant en milieu fermé, afin de garantir la cohérence et l'efficacité de leur action.
En milieu carcéral, les SPIP peuvent en outre s'appuyer sur le concours des associations d'accompagnement social. Les rapporteures constatent toutefois que l'implication du secteur associatif demeure très variable selon les territoires. Cette hétérogénéité, qui traduit parfois une reconnaissance institutionnelle insuffisante de leur rôle, fragilise un partenariat pourtant déterminant pour préparer efficacement la sortie de détention, notamment en matière d'accès au logement. Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer et de faciliter l'intervention de ces structures au sein des établissements pénitentiaires.
Les pratiques étant disparates d'un territoire à l'autre, il est également indispensable que les modalités d'intervention des associations fassent l'objet de directives au niveau national, ce qui permettra tout à la fois d'inciter le SPIP à solliciter les acteurs associatifs et de rassurer, grâce à une définition claire des rôles respectifs de chacun, les services qui perçoivent l'intervention des associations comme une ingérence dans leurs missions.
Proposition n° 9
Unifier la doctrine d'intervention des associations d'accompagnement social en détention, afin de réduire les disparités territoriales constatées par la mission.
b) Garantir une prise en charge sanitaire digne et effective
La question des soins en détention constitue aujourd'hui l'un des points les plus préoccupants de l'exécution des peines. La prévalence des troubles psychiatriques et des addictions y atteint des niveaux particulièrement élevés, affectant une majorité de personnes détenues.
Pourtant, l'accès effectif aux soins demeure largement défaillant. Les unités sanitaires souffrent d'un sous-dimensionnement chronique, leurs effectifs étant calculés sur la capacité théorique des établissements et non sur leur population réelle. Elles ne disposent pas non plus de l'ensemble des compétences spécialisées nécessaires, ce qui contraint à recourir massivement à des consultations extérieures, souvent annulées faute de personnels disponibles pour assurer les escortes.
Ces dysfonctionnements entraînent des retards importants dans la prise en charge et se traduisent, pour de nombreux détenus, par une perte de chance en matière de santé, y compris pour des besoins médicaux élémentaires. Cette situation, qualifiée d'« indignité » par le garde des sceaux lui-même, fragilise non seulement les personnes concernées, mais aussi les personnels pénitentiaires et, plus largement, la société.
Dès lors, il apparaît indispensable de repenser en profondeur l'organisation de la prise en charge sanitaire en détention, afin de mieux adapter les moyens aux besoins réels et d'assurer une réponse effective aux pathologies somatiques, psychiatriques et addictives.
Proposition n° 10
Assurer un accès effectif à la santé en détention en :
- développant les partenariats avec les hôpitaux pour des interventions, dans la mesure du possible, au sein des établissements pénitentiaires pour la médecine spécialisée ;
- fixant les effectifs des unités sanitaires non pas selon le nombre théorique de places, mais selon la moyenne d'occupation des cinq dernières années ;
- garantissant la prise en charge de la santé mentale et des troubles addictifs, avec la présence permanente de professionnels dédiés auprès des détenus et de l'administration pénitentiaire.
2. Donner un véritable contenu aux peines alternatives
Les peines alternatives à l'incarcération constituent un instrument utile de réinsertion et de lutte contre la récidive. Pour les condamnés bien insérés et n'ayant pas commis d'infractions graves ou réitérées, elles favorisent le maintien des repères familiaux, sociaux et professionnels, tout en imposant un cadre d'obligations qui participe à leur responsabilisation.
Encore faut-il que ces mesures soient véritablement individualisées, dotées d'un contenu effectif et accompagnées d'un contrôle rigoureux. À défaut, elles perdent non seulement en efficacité mais aussi en crédibilité, fragilisant l'adhésion des justiciables comme de la société à la sanction pénale.
Les rapporteures ont rappelé, en première partie du présent rapport, que les aménagements ab initio destinés à éviter l'incarcération pour les courtes peines reposent aujourd'hui de manière quasi-exclusive sur la détention à domicile sous surveillance électronique.
Or, le recours massif au bracelet électronique, devenu une réponse par défaut, s'est accompagné d'un appauvrissement de son contenu et d'un suivi moins qualitatif, réduisant sensiblement son efficacité en matière de prévention de la récidive. Cette tendance illustre plus largement les limites des aménagements de peine génériques, dont l'expansion n'a pas été soutenue par les moyens humains nécessaires pour en assurer la pertinence et la valeur « réinsérante ».
Partant de ce constat, les rapporteures appellent à une plus grande prudence dans le recours à la DDSE, afin d'en renforcer le caractère individualisé et d'assurer un suivi plus exigeant des personnes placées sous ce régime. Elles estiment qu'il pourrait même être envisagé de réserver à terme le prononcé de cette mesure au juge de l'application des peines, en cessant de l'utiliser comme aménagement ab initio, afin d'éviter tout usage de la DDSE comme solution « de facilité », sans gain ni pour le condamné ni pour la société.
Proposition n° 11
Redonner une véritable consistance à la détention à domicile sous surveillance électronique et, à défaut, ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.
Au-delà de la difficulté à adapter la peine au profil du condamné, se pose également la question de l'effectivité de son exécution. Le suivi et le contrôle des peines alternatives demeurent insuffisants alors même que leur crédibilité dépend de la certitude que les obligations imposées sont effectivement respectées et que tout manquement entraîne une réaction judiciaire rapide et proportionnée. Dans la pratique, les SPIP, confrontés à une charge particulièrement lourde, ne peuvent assurer une surveillance systématique, ce qui conduit à des détections tardives et inégales selon les territoires. Pour la surveillance électronique notamment, les incidents liés au non-respect des horaires sont souvent traités après plusieurs répétitions, amoindrissant l'effet dissuasif de la mesure. Les rapporteures appellent en ce sens à renforcer le suivi et le contrôle des peines alternatives à l'incarcération221(*).
C. JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE
La surpopulation carcérale atteint des niveaux tragiques ; elle ne saurait être plus longtemps tolérée et appelle des solutions déterminées, mais aussi innovantes, de la part des pouvoirs publics.
La mission propose, à cet égard, un véritable changement de philosophie de la peine de prison ferme.
Les rapporteures n'ont pu que constater que les expériences de régulation carcérale « par les flux » n'étaient efficaces qu'à court terme - voire à très court terme -, et qu'elles ne constituaient en rien une réponse structurelle permettant, à long terme, de retrouver un taux d'occupation normal dans les prisons. En effet, les alternatives existantes à la prison se heurtent désormais, pour reprendre une expression employée par la Cour des comptes, à un « plafond de verre »222(*) : si les magistrats, pourtant bien placés pour mesurer les conséquences dramatiques de la surpopulation carcérale, continuent à prononcer autant de peines d'incarcération, c'est bien parce que les faits ou les prévenus concernés ne peuvent pas donner lieu - en l'état de la répression pénale - à une peine de milieu ouvert.
Au-delà de la régulation carcérale assumée qui s'exerce dans certaines directions interrégionales, les initiatives du législateur pour limiter le recours à l'incarcération ou pour en limiter la durée effective sont, de toute évidence, des échecs. Non seulement les réformes successives n'ont pas permis de mettre fin à la surpopulation, mais elles ont même aggravé le phénomène, dégradant les conditions de vie des détenus - et les conditions de travail des personnels -, nuisant à l'efficacité de leur prise en charge et renforçant le risque de récidive.
Ce diagnostic invite à une réflexion ambitieuse ; il doit pousser le législateur à ne plus se limiter à une gestion quantitative de la détention, mais à proposer une évolution qualitative prenant en compte les besoins de tous les acteurs de la chaîne pénale.
La surpopulation carcérale est, en effet, un élément clé de la réflexion menée par la mission d'information. Sa résorption est, à l'évidence, la principale condition de faisabilité de nombreuses mesures proposées par les rapporteures, notamment en ce qui concerne l'individualisation de l'exécution des peines, la revalorisation de la réinsertion ou encore la mise en place de très courtes peines de prison ferme.
La lutte contre la surpopulation carcérale est ainsi la mère de toutes les batailles : à défaut pour nos prisons de retrouver un taux d'occupation acceptable, le législateur ne pourra garantir ni la dignité des détenus ni leur suivi effectif - ni in fine l'efficacité de la peine ; plus largement, tant que la surpopulation carcérale n'est pas enfin jugulée, la loi restera impuissante à améliorer l'exécution des sanctions pénales. C'est dans cette optique que les rapporteures ont forgé leurs recommandations, en gardant à l'esprit trois objectifs :
- le nécessaire rétablissement d'une cohérence entre la peine prononcée et la peine réellement exécutée, à la fois pour contribuer à renforcer le sens de la peine (voir supra) et pour limiter les stratégies de contournement de la loi qui ont, en pratique, été observées lors de la mise en oeuvre de chaque modification législative récente en matière d'exécution des peines ;
- corrélativement, l'indispensable affirmation d'une pleine confiance envers les magistrats, premiers responsables du choix de la peine et de ses modalités d'exécution, qu'il convient cependant de doter des outils requis pour assumer pleinement ce rôle ;
- enfin et surtout, la remise en cause de la centralité de la peine de prison ferme grâce à un renforcement de la crédibilité des mesures de milieu ouvert, qui passe en priorité par la revalorisation de la probation sous la forme d'une peine autonome.
La mission n'ignore pas que ces choix auront un coût, en particulier en personnel. Elle souhaite que les moyens prévus par la dernière loi d'orientation et de programmation pour la justice du 20 novembre 2023223(*) soient pleinement mobilisés au service de la réforme proposée, et elle rappelle que l'investissement ainsi consenti sera une source d'économies pour l'avenir, tant est grand le coût de la délinquance pour notre pays et tant l'intérêt bien compris de la société dans son ensemble est de mener une lutte résolue contre la récidive et pour la sécurité.
1. Créer une véritable peine de probation
Le recours, encore fréquent, aux peines de prison ferme a une origine simple : en l'état du droit, l'incarcération est le seul levier dont disposent les magistrats pour réprimer des infractions graves ou pour garantir la mise à l'écart de profils susceptibles de commettre un nouveau délit.
Ce constat explique les pratiques observées par la mission s'agissant tant de l'aménagement des peines (avec une augmentation sensible, depuis 2020, des peines dont la durée est immédiatement supérieure au seuil en deçà duquel l'aménagement est obligatoire) que des libérations anticipées (avec un taux de mise en oeuvre de la LSC-D qui reste en net décalage avec son caractère théoriquement automatique).
Outre les recommandations spécifiquement relatives à ces deux enjeux, qui feront l'objet de développements ci-après, il convient de tirer toutes les conséquences de cette réalité en offrant aux acteurs de la peine de nouveaux leviers pour traiter le cas des condamnés qui sont aujourd'hui envoyés en prison non pas en raison de leur fort ancrage dans la délinquance ou du risque avéré de récidive, mais parce qu'ils présentent des fragilités sociales ou sanitaires qui pourraient, avec des moyens adaptés, être pris en charge à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Il s'agit, en d'autres termes, de mettre en place une mesure plus sévère - mais aussi plus crédible dans ses effets sur le condamné - de milieu ouvert pour, en retour, favoriser son prononcé par les magistrats en lieu et place de la prison ferme, ce en quoi les peines alternatives existantes ont échoué.
Tel est le sens de la peine autonome de probation dont la mission propose la création en remplacement de l'actuel sursis probatoire.
Proposition n° 12
Créer une peine autonome de probation.
Une telle orientation avait déjà été envisagée par la commission des lois du Sénat en 2018. Dans un rapport intitulé « Nature, efficacité et mise en oeuvre des peines : en finir avec les illusions ! », Jacques Bigot et le président François-Noël Buffet plaidaient ainsi pour la mise en place d'une peine de probation permettant le prononcé d'une large palette de mesures (injonction de soins, travail d'intérêt général, accompagnement socio-éducatif renforcé, etc.) et pouvant être assortie d'une peine de prison ferme ; ils proposaient que sa durée soit fixée par le juge du fond, et que les obligations auxquelles le condamné est soumis puissent évoluer au cours de l'exécution de la peine grâce à un suivi étroit et rigoureux permettant de mesurer toute modification dans la situation personnelle, familiale, sociale ou économique du condamné. Ils soulignaient que, pour être efficace, une telle peine devait pouvoir être aisément révoquée (c'est-à-dire donner lieu au placement en détention du condamné), faute de quoi elle se heurterait - comme l'ancienne contrainte pénale, abrogée par la loi d'orientation et de programmation du 23 mars 2019 - à un déficit d'appropriation par les magistrats.
La commission avait maintenu sa position lors de l'examen de la LOPJ précitée : son attachement à la peine de probation l'avait conduite à accepter que ce désaccord - conjugué à d'autres - se traduise par une adoption finale du texte selon la procédure du « dernier mot » donné à l'Assemblée nationale.
Cette peine de probation présenterait des connexités avec le placement à l'épreuve auprès des services sociaux italien, distinct du sursis et qui, déjà ancien, semble faire l'objet d'un « retour d'expérience » positif.
Le placement à l'épreuve auprès des services sociaux (Italie)
L'article 47 [de la loi du 26 juillet 1975] prévoit la mesure alternative de placement à l'épreuve auprès des services sociaux (affidamento in prova al servizio sociale), qui permet à certains condamnés d'exécuter leur peine hors de prison, sous supervision et contrôle. Elle est ouverte lorsque la peine à purger ne dépasse pas trois ans (ou quatre ans dans certains cas), selon une appréciation individualisée visant à favoriser la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive. Cette durée s'entend de la peine résiduelle effectivement à exécuter, comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle224(*).
La mesure est accordée sur la base d'un rapport d'observation de la personnalité, effectué en détention ou, pour les personnes libres, par le bureau d'exécution pénale externe (ufficio di esecuzione penale esterna - UEPE). Le placement peut aussi être accordé aux personnes ayant déjà exécuté une partie de leur peine en détention ou sous contrôle judiciaire (§3-bis), ainsi qu'aux condamnés à des peines substitutives de semi-liberté ou de détention à domicile (§3-ter).
La demande est présentée au juge de surveillance (magistrato di sorveglianza) - équivalent du juge d'application des peines français. En cas d'urgence, celui-ci peut accorder l'application provisoire. Si la mesure est acceptée, un protocole est établi, définissant les obligations : lieu de résidence, emploi, interdictions de fréquentation, engagement envers la victime et obligations familiales. Ces prescriptions peuvent être adaptées en cours d'exécution.
Les services sociaux assurent le suivi du condamné, rendent compte de son comportement, et l'accompagnent dans sa réinsertion. En cas de manquement grave, la mesure est révoquée. À l'inverse, son bon déroulement entraîne l'extinction de la peine et des effets pénaux (hors peines accessoires perpétuelles), avec une possible remise complémentaire de peine en cas de réinsertion effective.
Source : étude de législation comparée ( voir annexe 1)
Parce qu'elle suppose la mise en place d'une véritable « police de la probation », dotée tant d'une culture de la réinsertion que d'une composante répressive en cas de manquement et s'appuyant sur des moyens matériels et humains correctement dimensionnés (voir infra), la peine autonome de probation suppose un effort financier que les rapporteures ne sauraient sous-estimer. Elles considèrent néanmoins que cet effort est justifié par les multiples avantages que présente une telle évolution.
Tout d'abord, la peine de probation permettra, lorsqu'elle est prononcée en assortiment d'une peine de prison ferme, de penser la fin de peine dès le début de la détention. Les obligations auxquelles le condamné sera soumis à l'issue de son incarcération seront, en effet, fixées dès le prononcé du jugement par le tribunal correctionnel, ce qui donnera enfin une visibilité au juge du fond sur l'ensemble du parcours d'exécution de la peine : cette continuité ne pourra que rassurer les magistrats sur la crédibilité de la mesure.
Pour aller encore plus loin, les rapporteures estiment que le juge du fond devrait également être en charge de la définition des modalités de mise en oeuvre des obligations qu'il impose au condamné, y compris lorsque la peine de probation n'est pas conjuguée avec une peine de prison ferme : le tribunal correctionnel pourrait ainsi avoir la responsabilité, s'il dispose des éléments requis, de fixer le rythme du suivi exercé par le service de probation et de prévoir, s'il le souhaite, un accompagnement complémentaire du condamné par des structures associatives habilitées225(*).
Crédible pour les magistrats, la peine de probation doit également l'être pour les condamnés grâce à une procédure souple de révocation et à des dispositions légales assumant les pleines conséquences des manquements constatés. Ainsi, alors que le droit en vigueur prévoit une simple faculté de révocation du sursis probatoire en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect des obligations imposées au condamné, la loi pourrait faciliter l'incarcération de ceux des condamnés qui manquent à leurs devoirs et, surtout, qui ne témoignent pas d'une volonté réelle de sortir de la délinquance et commettent au cours de la probation un nouveau délit. Cette modification crédibilisera le milieu ouvert en tant que forme effective de répression, étant rappelé qu'aujourd'hui, les manquements ne donnent que rarement lieu à des sanctions sérieuses : à titre d'illustration, selon les études conduites par les services du Sénat, les condamnations à une peine de prison ferme prononcées pour une « évasion » dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique présentaient à la fois un volume limité (on en dénombre 40 entre 2012 et 2024 sur plus de 1 500 infractions enregistrées - soit seulement 2,6 % d'infractions ayant effectivement mené à une peine de prison ferme) et une faible durée (la moitié d'entre elles étaient inférieures à trois mois, ce qui suggère un faible taux de placement effectif en détention).
La création d'une peine de probation conduira, en outre, à une réévaluation de l'échelle des peines. Sanction d'une nature nouvelle, à la croisée de la prison et du milieu ouvert, elle permettra :
- d'atténuer la place centrale de l'emprisonnement comme peine de référence du droit pénal français ;
- de limiter le prononcé des peines de prison ferme - et notamment celles qui sont aujourd'hui promises à l'aménagement du fait de leur courte durée, attestant que le juge du fond souhaite à la fois donner une chance au milieu ouvert mais se doter d'une « corde de rappel » en milieu fermé en cas d'échec - et, partant, de lutter contre la surpopulation carcérale ;
- de promouvoir une individualisation renforcée des peines, le juge disposant dans ce cadre d'une palette particulièrement large d'obligations susceptibles d'être imposées au condamné : le Sénat avait ainsi souhaité, dès 2019, que la peine de probation puisse obliger le condamné à répondre aux convocations du JAP et à recevoir les visites des CPIP, mais aussi à se soigner, à exercer un emploi, à établir sa résidence en un lieu déterminer, à justifier qu'il contribue aux charges familiales, à réparer les dommages causés par l'infraction, à s'abstenir d'exercer certaines activités ou de paraître en certains lieux, ou encore à accomplir un stage pénal ou un travail d'intérêt général ;- de favoriser la plus grande intégration, par ailleurs souhaitée par la mission, des SPIP au stade pré-sentenciel, puisque leur concours sera indispensable à l'identification des prévenus susceptibles d'être soumis à la probation comme à la définition des obligations associées (voir infra) ;
- de mieux traiter le cas de condamnés actuellement soumis à des peines de prison ferme pour des motifs qui ne tiennent pas à leur dangerosité objective, mais à leur situation personnelle fragile et qui rendent aujourd'hui leur suivi à l'extérieur difficile, voire impossible : absence de garanties de représentation (logement, attaches sociales ou familiales, etc.), troubles addictifs ou psychologiques, grande précarité, etc.
2. Faire enfin de la peine de prison ferme une sanction efficace et dissuasive
Rendue à sa juste place sous l'effet de la création d'une peine de probation, la peine de prison ferme restera essentielle pour les condamnés fortement ancrés dans la délinquance comme pour les infractions les plus graves et les moins tolérables pour la société - violences contre les personnes, infractions sexuelles, trafics... Il faut donc la rétablir comme une sanction efficace et réellement dissuasive.
L'accomplissement de cet objectif passe par la mise à niveau des capacités opérationnelles du parc pénitentiaire française, dont l'insuffisance est attestée par le caractère à la fois pérenne et ancien de la surpopulation carcérale. La mission souhaite, dans ce contexte, que le « plan 15 000 » soit mené à bien dans les plus brefs délais, donc sans nouveau retard d'ici à 2031.
Au-delà du calendrier, le coût de l'opération est un enjeu d'importance dans une période de raréfaction des deniers publics. Pour ne pas obérer le bon achèvement du programme, il appartiendra au Gouvernement, en lien avec les propositions de la mission sur la nécessaire orientation des condamnés au sein des établissements selon leurs besoins et leurs profils, d'évaluer l'étendue des économies budgétaires qui pourraient être permises par la construction de prisons « à sécurité allégée » destinées aux détenus qui présentent un risque sécuritaire modéré au cours de leur incarcération : auteurs de violences intrafamiliales, d'atteintes simples aux biens, etc.
Proposition n° 13
Mener à bien le « plan 15 000 », en s'interdisant tout nouveau retard et en tenant compte de la nécessaire diversification des établissements en fonction des profils des détenus.
Dans le même ordre d'idées, les rapporteures n'ont pu que constater que les quartiers destinés aux profils les plus « durs » (radicalisés, condamnés pour terrorisme, membres de réseau de délinquance ou de criminalité organisée...) pouvaient être un facteur d'aggravation de la surpopulation carcérale, car ils sont en général largement sous-occupés. La recherche d'une juste modularité, mais aussi l'impératif consistant à garantir des conditions dignes de détention aux condamnés incarcérés en maison d'arrêt ou en QMA ne peuvent que conduire à réclamer l'évaluation régulière du nombre de détenus susceptibles de relever de ces quartiers « sécuritaires », afin de libérer des places pour les autres détenus et de réduire la pression qui pèse aujourd'hui sur les quartiers « classiques ».
Toujours dans la même optique, les auditions conduites par les rapporteures ont permis de montrer qu'une partie non négligeable de la surpopulation carcérale découlait du phénomène de « purge des situations pénales », c'est-à-dire découle de sursis dont le juge du fond n'avait pas connaissance au moment du prononcé de la peine et qui « tombent », sans anticipation, au début de la mise à exécution. Sollicité par la mission, le ministère de la justice fait savoir qu'il n'était pas en mesure de quantifier - même approximativement - la prégnance statistique de ce phénomène, ni même de définir avec précision la proportion des emprisonnements résultant d'une révocation de sursis au prononcé d'une nouvelle peine.
Quelle que soit l'ampleur effective de ces situations, il
n'est ni cohérent, ni justifiable que le tribunal correctionnel ne
dispose pas d'outils lui permettant de peser, avec autant de précision
que de certitude, les conséquences de ses jugements. Pour mettre
fin à cette anomalie, la mission d'urgence sur l'exécution des
peines a recommandé la mise en place
d'un « plateau technique
pluridisciplinaire » plus largement chargé de
l'évaluation du condamné au stade pré-sentenciel,
et qui serait notamment compétent pour reconstituer
l'intégralité de sa situation pénale à jour (voir
supra). La mission d'urgence souligne ainsi que la purge des
situations
pénales, « partie
intégrante » de l'évaluation du condamné,
est au coeur de « la cohérence du parcours
d'exécution de peine et doit être réalisée à
tous les stades de la procédure », donc dès le
début de celle-ci.
Les rapporteures s'associent à cette suggestion pertinente, déjà évoquée à l'occasion des développements relatifs au sens de la peine. À défaut de voir un tel plateau mis en place à court terme, elles estiment indispensable qu'un outil technique, même limité au suivi en temps réel des situations pénales, soit rapidement déployé et mis à la disposition de tous les acteurs du prononcé et de l'exécution de la peine.
Non moins essentielle est la nécessité de doter les magistrats d'un instrument de suivi des places de détention disponibles dans leur ressort par nature de quartier ou d'établissement, afin d'affermir l'anticipation du déroulé de la peine dès son prononcé et d'orienter au mieux les condamnés dès le début de l'exécution de leur peine. Couplée à la sanctuarisation des places de réinsertion, que les rapporteures appellent par ailleurs de leurs voeux, cette amélioration permettrait au surplus de limiter la pratique des transfèrements de détenus à des fins de régulation carcérale, déstabilisatrice pour les intéressés226(*) et particulièrement consommatrice en effectifs pour l'administration pénitentiaire.
3. Ne plus utiliser la fin de peine comme un levier de régulation carcérale
Les travaux menés par la mission ont montré que l'utilisation des dispositifs de fin de peine comme un levier de régulation carcérale s'étaient avérés non seulement inefficaces, mais aussi néfastes à la lisibilité de l'exécution - et, partant, défavorables à la prévention de la récidive.
Dans ce contexte, les rapporteures jugent indispensable d'opter pour un bouleversement de la philosophie qui guide notre droit et de redonner aux magistrats les marges de manoeuvre requises pour maîtriser, de manière effective, le parcours de détention des condamnés.
Pour ce faire, elles proposent tout d'abord de supprimer la LSC de plein droit, dont elles ont déjà décrit la portée contre-productive et déstabilisatrice. Rare mesure à avoir été recommandée à la quasi-unanimité des personnes auditionnées, cette suppression permettra d'éviter l'érosion des peines de prison ferme, source d'incompréhension pour les condamnés comme pour les citoyens. Elle permettra, de plus, de revenir sur une mesure source de difficultés insurmontables dans le suivi des détenus et dans la gestion de la fin de peine.
La mission ne souhaite pas, pour autant, un retour au droit ex ante, c'est-à-dire aux réductions automatiques de peine qui, bien que moins décriées par les praticiens, posent comme la LSC-D le problème de l'érosion mécanique de la peine. Elle prône à l'inverse un système de réductions de peine exclusivement fondé sur des critères individuels, tenant compte à la fois du comportement du condamné et de ses efforts de réinsertion.
Sans autre changement législatif, la probabilité serait élevée de voir cette recommandation se traduire par un surcroît de surpopulation carcérale. Pour éviter un tel effet de bord, la mission propose de faciliter l'octroi des réductions de peine, mais aussi des aménagements, conversions et placements en semi-liberté en fin de peine.
L'objectif est, comme en matière de probation, de faire confiance aux magistrats et de leur permettre d'investir pleinement leur office en faisant en sorte que, sauf exception, la durée réellement exécutée corresponde à la durée prononcée. Il s'agit là d'une révolution copernicienne qui, loin de répondre à une logique strictement répressive, doit inciter les juges du fond à prononcer des peines moins artificiellement sévères, car reposant sur l'assurance qu'elles seront exécutées dans les formes et conditions qu'ils ont prescrites.
Pour que soit respectée la philosophie des rapporteures, il conviendra que le bénéfice de telles mesures soit accordé par le juge de l'application des peines au cas par cas, sur une base individuelle. Il semble toutefois possible de modifier les conditions d'octroi des réductions de peine dans un double sens.
Premièrement, le Sénat avait légitimement plaidé, lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, pour qu'il soit tenu compte du risque de récidive dans toute décision d'octroi ou de refus d'une libération anticipée. Ce principe, aujourd'hui absent du code de procédure pénale s'agissant des réductions de peine227(*), gagnerait à être affirmé.
Deuxièmement, il semble possible d'envisager une libéralisation des conditions dans lesquelles les réductions de peine sont octroyées, selon une double orientation.
Sur le fond, ces réductions reposent en l'état du droit sur deux critères cumulatifs : les efforts d'insertion du condamné et son bon comportement. Il serait judicieux que ces critères soient rendus alternatifs, notamment parce qu'ils sont en partie redondants.
Sur la forme, les réductions sont octroyées selon des procédures strictes, voire lourdes qui, en particulier, prévoient l'intervention de la commission d'application des peines (saisie pour avis) et obligent à ce que les réductions soient octroyées en une seule fois pour les peines de moins d'un an. Il paraît pertinent d'envisager que les réductions de peine puissent être octroyées par le seul juge de l'application des peines, sans avis collégial, lorsque leur quantum est limité ; on peut, de même, raisonnablement envisager que les réductions de peine puissent faire l'objet de plusieurs examens successifs, y compris pour les peines courtes, permettant au JAP de tenir compte de l'évolution de la situation des condamnés.
Proposition n° 14
Mettre fin à la libération sous contrainte de plein droit pour privilégier des mécanismes individuels, tenant compte des efforts accomplis par le condamné pendant sa détention.
En contrepartie, faciliter les aménagements, conversions, placements en semi-liberté en fin de peine par les JAP, ainsi que l'octroi des réductions de peine, sur une base individuelle.
Les rapporteures considèrent que cette mesure ne supposera pas mécaniquement la création de nouveaux postes de JAP. Elles rappellent à ce titre que la LSC-D, loin de permettre des gains de temps, est un facteur d'alourdissement de leur office228(*) et que son cumul avec le nouveau régime des réductions de peine complexifié la préparation et l'enrôlement des commissions d'application des peines : la suppression de la LSC-D permettra donc de dégager des marges pour une plus forte personnalisation des réductions de peine. Contribuera aussi à rééquilibrer la charge de travail des JAP, l'évolution de la répartition des missions entre ces magistrats et les SPIP par ailleurs proposée par la mission d'information229(*).
Il convient, au surplus, que l'évolution du droit redonne au JAP, à l'administration pénitentiaire et aux SPIP une visibilité sur la date effective de remise en liberté des personnes incarcérées, sans quoi aucune politique crédible de suivi des détenus ne pourra être mise en oeuvre.
Pour ce faire, les rapporteures estiment nécessaire :
- d'une part, d'assurer un examen plus régulier des réductions et aménagements de peine dont les condamnés sont susceptibles de bénéficier, selon un rythme qui ne peut qu'avoir vocation à varier en fonction de la durée de la peine prononcée ;
- d'autre part, de permettre au JAP d'anticiper au mieux les modalités de mise en oeuvre des aménagements de fin de peine en mettant à sa disposition des outils de suivi des moyens disponibles dans son ressort en semi-liberté, en DDSE, en placement extérieur, etc.
4. Se donner les moyens d'un diagnostic objectif de l'état du milieu fermé et de l'efficacité des peines qui s'y accomplissent
Selon une tradition dont le caractère à la fois ubuesque et frustrant n'empêche pas qu'elle soit désormais bien établie, la mission a eu les plus grandes difficultés à obtenir des statistiques de nature à éclairer ses réflexions. La faute n'en revient pas aux services du ministère, pleinement investis et eux-mêmes victimes de cette insuffisance, mais à des applicatifs vieillissants, incomplets, peu exploitables, voire vétustes pour nombre d'entre eux, qui interdisent toute vision globale et dynamique de l'exécution des peines de prison ferme230(*).
Les rapporteures veulent croire que l'ambitieux projet « procédure pénale numérique » (PPN) viendra, à terme, combler cette immense lacune. D'ici là, elles souhaitent vivement que la pleine information du Parlement et, au-delà, des citoyens, soit mieux assurée.
Deux leviers pourraient être mobilisés à cette fin.
Il est, en premier lieu, indispensable que les assemblées parlementaires soient dûment informées du taux d'occupation des prisons et, surtout, des causes supposées de son évolution.
En second lieu, le ministère de la justice doit établir, puis rendre publiques, des statistiques permettant de mesurer les effets des modes d'exécution des peines de prison ferme (ou de milieu fermé, pour les mineurs) sur le parcours pénal des condamnés dans le temps long. La définition étroite des notions de « récidive » et de « réitération » limite, en effet, la pertinence analytique des chiffres disponibles, et seules des études thématiques ponctuelles s'intéressent à l'impact de la peine sur la commission d'une nouvelle infraction : il doit être mis fin à cette carence, qui contribue à l'opacité de la matière et, plus encore, au manque de rationalité qui marque trop régulièrement les débats sur la prison et sur le sort que la France entend réserver à ses détenus.
Proposition n° 15
Garantir la pleine information du Parlement et du grand public sur l'occupation des prisons, les causes de son évolution et l'effet de l'emprisonnement sur le parcours pénal des condamnés.
D. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE
L'ambitieuse réforme que les rapporteures souhaitent impulser passe, enfin, par une amélioration des délais d'exécution des peines et des contrôles exercés en milieu ouvert, gages de la crédibilité de l'arsenal pénal pour les citoyens comme de la robustesse des alternatives à la détention pour les condamnés et les professionnels du droit.
La mission d'information appelle ainsi à une revalorisation du rôle des forces de sécurité intérieure en matière d'exécution des peines, à une réduction des délais de mise en oeuvre des sanctions et, surtout, à la création d'une véritable police de la probation.
1. Développer une culture de l'exécution des peines au sein des forces de sécurité intérieure
Comme décrit précédemment, les missions relatives à l'exécution des peines concernent une multitude d'acteurs, au premier chef desquels l'administration pénitentiaire, dont relèvent les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les magistrats et les agents du greffe.
S'il est normal et même souhaitable que cette répartition des tâches ne donne pas aux forces de sécurité intérieure le premier rôle en matière d'exécution des peines, en particulier en milieu fermé, le décalage observé lors des auditions de la mission d'information entre les nombreuses missions que confie le code de procédure pénale aux forces de sécurité intérieure et la conscience que ces dernières ont de leur rôle en matière d'exécution des peines est pour le moins déconcertant. Il doit en outre être remédié à la trop grande négligence dont ils font preuve, et qu'ils admettent, dans la mise en oeuvre de ces dispositions légales.
Tout en saluant les initiatives louables déjà mises en oeuvre, à l'image de la création - désormais ancienne - de la brigade de l'exécution des décisions de justice et la brigade nationale de recherche des fugitifs, il ne peut être satisfaisant de constater qu'il n'existe pas de véritable ligne directrice au sein des forces de sécurité intérieure quant au contrôle de l'exécution des peines, notamment des peines alternatives à l'emprisonnement, qui s'opère concrètement par le biais de contrôles fortuits.
Sans qu'une réforme législative ne soit nécessaire, et tout en ayant conscience que les missions des forces de sécurité intérieure sont nombreuses, la mission d'information appelle ainsi à un changement de culture en leur sein, a minima pour que ces dernières assimilent que les missions liées à l'exécution des peines font partie intégrante de leur coeur de métier, qui n'est pas limité aux missions de voie publique et de police judiciaire. Au demeurant, la notification et l'exécution des peines ne devraient pas être vues comme une charge indue ou non prioritaire mais, au contraire, être pleinement investies par les officiers de police judiciaire s'ils considèrent que celle-ci donne du sens à leur travail d'enquêteur préalable aux condamnations.
Des améliorations pratiques pourraient en outre être mises en oeuvre afin de faciliter le travail des forces de sécurité intérieure.
Ainsi, bien que l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoie que « les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription », la brigade de l'exécution des décisions de justice et la DGGN ont signalé aux rapporteures que cela n'était pas toujours le cas lorsque la personne recherchée est incarcérée ou lorsque le motif d'inscription est caduc (par exemple si la peine a déjà été effectuée). Cette remarque est loin d'être négligeable, alors que plus de 110 000 personnes étaient inscrites au FPR au début de l'année 2025. À titre d'exemple, la DGGN a indiqué aux rapporteures que, sur un échantillon de 211 personnes inscrites au FPR dont la recherche était jugée « prioritaire » par les unités de gendarmerie de l'Oise, « 85 fiches étaient caduques » - soit un ratio spectaculaire de 40 %. La « radiation systématique » par l'autorité judiciaire des fiches contenues dans le FPR à chaque fois qu'une personne recherchée est incarcérée constituerait ainsi, selon la BEDJ, « un vrai gain de temps pour les services de police », qui se conçoit aisément. Une alerte à destination de tous les enquêteurs pourrait alors être émise lors de la radiation de la fiche.
De même, le travail des forces de sécurité intérieure serait facilité si les inscriptions des personnes condamnées au FPR gagnaient en célérité. À ce titre, le recours accru aux fonctionnalités du bureau pénal numérique, déployé depuis peu, qui permet aux magistrats, greffiers et agents de justice habilités d'accéder à un formulaire d'inscription proposant une saisie guidée des données nécessaires, serait opportun.
2. Accélérer l'exécution de la peine en favorisant la présence du prévenu aux audiences et en modernisant les voies de signification des jugements
Il a été exposé précédemment que les jugements sont proportionnellement davantage exécutés lorsque le prévenu se présente aux audiences. La présence du prévenu aux audiences permet - notamment - de respecter les exigences liées au principe du contradictoire et ainsi de rendre exécutoire la décision de l'autorité judiciaire. Outre qu'elle facilite la signification du jugement et évite la mobilisation des forces de sécurité intérieure, la présence du prévenu aux audiences permet aussi sa prise en charge rapide une fois sa condamnation acquise, puisqu'il peut être reçu physiquement par le bureau de l'exécution des peines afin que lui soit présenté son parcours judiciaire.
L'un des moyens pour accélérer l'exécution des peines est donc d'améliorer l'information des prévenus, aussi bien en amont pour qu'il soit présent lors des audiences, qu'en aval pour que les jugements contradictoires à signifier soient transmis avec célérité.
L'objectif est ainsi d'éviter que le prévenu ait intérêt à ne pas se présenter à l'audience, d'une part, ou à développer une stratégie d'évitement de la signification du jugement, d'autre part.
Sur le premier point, la mission d'information fait sienne la suggestion émise par la direction des affaires criminelles et des grâces lors de son audition et par la mission d'urgence sur l'exécution des peines, consistant à généraliser et étendre le rappel automatique et dématérialisé des dates d'audiences et des convocations, qui est actuellement expérimenté dans un peu moins d'une centaine de tribunaux judiciaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ce mécanisme permet l'envoi de SMS et de notifications via la plateforme Mon suivi justice et concerne principalement les convocations émises par les juges de l'application des peines et les CPIP. La généralisation de cette pratique serait plus qu'opportune. De même, l'extension de cet outil ou, à défaut, la création d'un nouvel outil similaire, pour procéder à un rappel automatique des convocations émises au stade pré-sentenciel paraît prioritaire, bien que le ministère de la justice estime que cela nécessiterait des développements informatiques lourds.
Proposition n° 16
Généraliser le mécanisme de rappel des convocations devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'étendre dès que possible au stade pré-sentenciel.
Sur le second point, les rapporteures partagent le constat assez unanime quant à l'inadaptation du cadre juridique régissant les voies de signification des jugements, notamment aux fins de les rendre exécutoires.
Une révision de la doctrine d'emploi des forces de sécurité intérieure pour l'exercice de ces fonctions paraît à ce titre souhaitable. Comme mentionné supra, la participation des forces de sécurité intérieure aux missions liées à l'exécution des peines correspond, dans une écrasante majorité en termes de nombre d'heures dédiées, à la signification de jugements, une situation qui ne peut perdurer en l'état. Les forces de sécurité intérieures sont ainsi assimilées trop systématiquement et parfois sans réelle plus-value aux commissaires de justice, les tâches associées étant certes essentielles au service public de la justice mais chronophages et relevant du coeur de métier de ces officiers publics ministériels.
Des progrès, au moins théoriques, ont été réalisés ces derniers temps, notamment grâce au vote de l'article 14 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire231(*) et à la publication du décret n° 2023-332 du 3 mai 2023 relatif à la signification par voie électronique en matière pénale, évoqués précédemment. Toutefois, l'ensemble de la chaîne pénale reste en attente de l'arrêté technique qui permettra la pleine utilisation de l'applicatif dédié à cette signification électronique, appelé Notidoc, une situation pour le moins inadmissible et incompréhensible, quatre ans après le vote de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et deux ans et demi après la publication du décret d'application précité.
Malgré ces progrès d'ensemble - encore incomplets -, la mission d'information appelle, à l'instar des constats et recommandations dressés en mars 2025 par la mission d'urgence relative à l'exécution des peines menée par l'inspection générale de la justice, à ce que la réflexion sur la modernisation des voies de signification des jugements soit poursuivie, voire accélérée.
La participation des forces de sécurité intérieure à la signification des jugements ne doit ainsi pas être écartée, mais rendue mieux ciblée et plus rapide.
Pour ce faire, pourrait être renforcée l'incitation du prévenu à se rendre aux audiences, afin qu'il n'y ait pas de stratégie délibérée de ralentissement de l'obtention du caractère exécutoire d'une décision de justice. En pleine cohérence avec l'idée, déjà exprimée, selon laquelle les aménagements de peine ab initio doivent pouvoir être écartés lorsque le prévenu n'est pas comparant, cet objectif pourrait être partiellement atteint en donnant à la décision d'emprisonnement ferme inférieur à un an non aménagé la valeur d'un ordre de recherche et d'arrestation à destination des officiers de police judiciaire.
Enfin, alors que l'article 803-1 du code de procédure pénale prévoit que les convocations et documents judiciaires ne puissent être adressés de façon numérique qu'à « la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure », ce principe pourrait être renversé afin, sous réserve des garanties renforcées de sécurité inhérentes à toute communication dématérialisée des documents judiciaires, de considérer que, sauf mention contraire, le consentement à la transmission dématérialisée des documents est réputé acquis232(*). Cette évolution faciliterait la signification des jugements, et donc l'acquisition de son caractère exécutoire ; elle diminuerait, en outre, la mobilisation des forces de sécurité intérieure.
Pour donner corps à cette proposition, il pourrait également être envisagé de rendre obligatoire la communication des coordonnées numériques, lorsque le justiciable en dispose.
3. Donner confiance dans les peines alternatives à l'emprisonnement par l'accroissement des contrôles de la probation
Lors des auditions conduites par les rapporteures, de nombreux intervenants ont dénoncé un « réflexe » qu'auraient développé les magistrats français, consistant à privilégier les peines d'emprisonnement, et donc à délaisser les peines alternatives à l'emprisonnement, notamment les peines probatoires. Sans se prononcer sur la véracité et l'ampleur de cette assertion qui irrigue, au demeurant, un débat ancien, il semble fondé de considérer qu'une part non négligeable des magistrats exprime une « méfiance »233(*) quant à l'effectivité du contrôle de ces peines et s'en saisit par conséquent moins.
Diverses réformes234(*) ont été menées au cours des dernières décennies pour développer ces peines alternatives à la prison, notamment dans une optique de réduction de la population carcérale. Malgré le développement incontestable des peines en milieu ouvert, force est de constater qu'au regard du nombre actuel de détenus qu'accueillent les établissements pénitentiaires français, cet objectif n'a pas été atteint.
L'une des solutions pouvant contribuer, si elle n'est pas prise isolément, à l'atteinte de cet objectif consiste à veiller à ce que les magistrats aient davantage confiance dans la bonne exécution des peines alternatives à l'emprisonnement qu'ils prononcent. Il en va également d'un souci de crédibilité de la justice pénale.
Cette confiance pourrait se construire, d'une part, par un investissement accru des forces de sécurité intérieure dans les missions que leur confie déjà le code de procédure pénale, comme évoqué supra.
D'autre part, sous réserve des conclusions des États généraux de l'insertion et de la probation qui se tiennent au cours du second semestre de l'année 2025, une mesure a reçu un soutien quasi-unanime : il s'agit du renforcement des contrôles des mesures de probation et autres peines alternatives à l'emprisonnement, notamment à travers la création d'une police de la probation ou par la spécialisation d'agents du SPIP sur les fonctions de probation.
Cette police ou ces agents ne seraient pas dédiés à un accompagnement des personnes condamnées, mais au contrôle du respect de leurs obligations.
Concrètement, ces agents ou cette police de probation pourraient effectuer des contrôles physiques sur le lieu de travail ou le domicile, comme les y autorise déjà l'article D. 530-5 du code pénitentiaire, qui dispose que « les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation [...] peuvent être faites au domicile ou à la résidence de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail ». Ces contrôles sur place, qui semblent être peu effectués en l'état des pratiques des SPIP, faute de temps, permettraient de veiller au respect des obligations et interdictions prononcées par le juge - par exemple la réalité d'une recherche d'emploi ou l'application d'une interdiction de contact.
Ces agents dédiés au contrôle des mesures de probation pourraient en outre assurer une articulation entre les services pénitentiaires et les services de police et de gendarmerie pour ce qui concerne le contrôle des peines en milieu ouvert.
La mise en oeuvre de cette mesure permettrait par ailleurs de rappeler que les deux missions principales confiées au SPIP, décrites supra et relevant du contrôle de l'exécution de la peine et de l'accompagnement socio éducatif, doivent être assurées avec la même attention, les SPIP ne devant pas s'apparenter seulement à un service d'assistance sociale. Ce rappel pourrait a minima être effectué lors des États généraux de l'insertion et de la probation.
Proposition n° 17
Créer une police de la probation ou spécialiser certains agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur le contrôle des mesures de probation.
Naturellement, l'instauration d'une telle police ou de cette spécialisation ne pourrait s'effectuer à effectifs constants des agents du SPIP, alors que ceux-ci ont déjà un nombre moyen de dossiers au-dessus des normes européennes (voir supra), a fortiori si la création de cette police de la probation a pour effet - escompté - une hausse du nombre de peines probatoires prononcées. Des embauches ou la réaffectation d'agents au sein de la fonction publique serait donc nécessaire. La mission d'urgence relative à l'exécution des peines précitée, qui préconise elle aussi la création d'une fonction d'agent de probation, a en outre proposé que soient mobilisés la réserve pénitentiaire ou les retraités des forces de gendarmerie ou de police, une piste intéressante dans un contexte de tension sur les finances publiques, mais qui ne saurait être souhaitable sur le long terme si l'objectif est une professionnalisation de cette police de la probation.
E. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES CONDAMNÉS MINEURS
Outre la proposition de la mission sur le rétablissement des très courtes peines, qui concerne en particulier les condamnés mineurs235(*), la mission estime nécessaire, autant qu'urgent, de repenser les outils spécifiques aux jeunes délinquants afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de relèvement moral et de lutte contre la récidive.
1. Construire pour les mineurs condamnés un parcours éducatif et responsabilisant
Les centres éducatifs fermés (CEF) sont au coeur du dispositif de prise en charge des mineurs délinquants. Mais leur généralisation progressive et le placement en leur sein de jeunes dont le profil ne correspond pas à la vocation première de ces centres, théoriquement réservés aux délinquants mineurs « durs », suscitent de vives réserves : loin de constituer une réponse de dernier recours, ils tendent désormais à s'imposer comme solution par défaut, au détriment d'alternatives pourtant plus adaptées à certains profils. Cette situation interroge autant les critères de placement que l'efficacité réelle des CEF, et appelle à un examen lucide de leur fonctionnement comme de leur apport en matière de réinsertion.
L'augmentation spectaculaire du nombre de journées de placement en CEF au cours des deux dernières décennies contraste avec l'effondrement parallèle de l'hébergement diversifié, pourtant mieux à même de répondre à certains besoins spécifiques. Les représentants des syndicats de la PJJ auditionnés par les rapporteures ont ainsi suggéré de « diversifier et augmenter la capacité de prise en charge en placement pénal de différentes sortes (hébergement diversifié, internats, séjours de rupture habilités pénal, foyers, CER, CEF, etc.), afin de trouver plus facilement des alternatives à l'incarcération ».
Cette évolution traduit un déséquilibre croissant dans la palette des réponses éducatives offertes aux magistrats. Ce constat est, d'ailleurs, de longue date au coeur des travaux de la commission des lois sur les mineurs en milieu fermé.
Développer les alternatives au milieu fermé
[Un] levier négligé est celui des alternatives au milieu fermé. Témoigne, entre autres, de cette négligence la faiblesse du recours à la justice restaurative (qui est à la fois une alternative au milieu fermé, mais aussi un « module » ouvert en parallèle d'un placement en CEF ou en CER) : alors que 27 M€ avaient été prévus par le projet de loi de finances pour 2021, seuls 13 M€ sont aujourd'hui affectés à la justice restaurative.
Insuffisamment utilisée par les magistrats, elle est au demeurant peu accessible dans la mesure où elle n'a pas été déployée sur l'ensemble du territoire. Alors que la réparation était au coeur des ambitions du CJPM, il semble que celui-ci a au contraire incité à privilégier le placement en milieu fermé (notamment parce que, désormais moins longs, les placements semblent considérés comme « moins graves » par les magistrats) et n'est pas parvenu à stimuler le recours à des formes pourtant innovantes de réponse pénale.
La rapporteure appelle le Gouvernement à prendre toute la mesure de cette situation et à suivre les judicieuses recommandations de la Cour des comptes en reconnaissant l'impérieuse nécessité, « avant de lancer de nouveaux projets de CEF au-delà de ceux déjà engagés, d'établir les besoins à satisfaire, en se fondant sur une évaluation de l'offre existante et la réalisation de schémas régionaux tenant compte des autres dispositifs de placement de la PJJ et intégrant les conséquences de la réforme de la justice pénale des mineurs ».
Elle ajoute que cette réflexion devra tenir compte de la nécessité d'inscrire les CEF dans une « palette » de réponses possibles et s'éloigner de la logique actuelle qui tend à faire des CEF une solution « par défaut », loin de leur philosophie initiale qui en faisait un dernier recours.
Source :
avis
n°134 (2023-2024) présenté par Laurence Harribey
au nom de la commission des lois
Les rapporteures estiment nécessaire de rééquilibrer les modalités de placement des mineurs en développant des alternatives aux centres éducatifs fermés. Un tel élargissement de l'offre permettrait d'adapter plus finement la réponse éducative au profil et aux besoins du jeune, d'éviter que le placement en CEF ne devienne une solution par défaut et de préserver la diversité des prises en charge. Il s'agit, en somme, de garantir que le choix du dispositif de placement soit guidé par des considérations éducatives et de réinsertion, plutôt que par la seule disponibilité des structures.
Réciproquement, et comme le rappelle la commission des lois à l'occasion de chacun de ses avis budgétaires sur les crédits alloués à la PJJ, il convient que les CEF, devenus une solution de placement « par défaut », soient recentrés sur leur objectif de prise en charge des mineurs multi-réitérants. Dans le cas contraire, il est à craindre qu'ils deviennent, pour les profils les plus fragiles, une école de la délinquance plutôt qu'un levier de prévention de la récidive.
Proposition n° 18
Développer les possibilités de placement hors centre éducatif fermé (CEF) et recentrer ces derniers sur le placement des mineurs ancrés dans la délinquance.
Au-delà des interrogations relatives aux critères de placement, c'est le fonctionnement même des centres éducatifs fermés qui appelle aujourd'hui une appréciation lucide. Or, près de vingt ans après leur création, aucun bilan global et consolidé n'a été mené, laissant subsister une zone d'ombre sur leur efficacité réelle. Les constats récemment établis par la mission thématique conduite par le ministère de la justice sont pourtant préoccupants : contenus éducatifs disparates et souvent réduits à quelques heures de scolarisation par semaine, pilotage national et territorial insuffisant, contrôles trop rares alors même que les incidents graves ne sont pas exceptionnels, et durée de placement généralement inférieure au seuil de six mois pourtant jugé indispensable pour assurer un véritable temps éducatif.
Ces fragilités, déjà soulignées à plusieurs reprises par la commission des lois, mettent en évidence un décalage croissant entre l'ambition assignée aux CEF et la réalité de leur mise en oeuvre. Les rapporteures considèrent ainsi qu'une évaluation globale s'impose : elle seule permettra d'apprécier leur apport réel en matière de prévention de la récidive et de définir, sur des bases objectives, les critères de placement pertinents pour chacun de ces centres.
Ce diagnostic conduit les rapporteures à considérer que le programme de construction de 22 nouveaux centres doit, quant à lui, être mis en pause et faire l'objet d'une réévaluation. Réclamée par la Cour des comptes depuis 2023, sans que le ministère ait pris la peine depuis lors de justifier ses choix, cette évaluation devra permettre, d'une part, de déterminer avec précision la nature et le volume des solutions existantes de placement dans chaque direction interrégionale et, d'autre part, d'établir une cartographie précise des besoins, par nature de structure, pour l'ensemble du territoire : ce n'est que sur cette base qu'un programme immobilier sérieux pourra être conçu, puis mis en oeuvre.
À ces constats s'ajoute une interrogation persistante sur l'efficacité des centres éducatifs fermés en matière de prévention de la récidive. Malgré les demandes réitérées du Parlement, aucune réponse claire n'a jusqu'à présent été apportée par le ministère de la justice. Comme mentionné précédemment dans le rapport, la mission thématique sur les CEF conduite en 2025 par l'Inspection générale de la justice a toutefois révélé l'existence d'une étude ancienne de la PJJ, restée confidentielle, qui apporte un éclairage partiel mais essentiel : le placement en CEF ne produit d'effet bénéfique certain que s'il dure au moins six mois. Les séjours inférieurs à quatre mois, loin d'aider à la réinsertion, tendent au contraire à accroître le risque de réitération.
Ce constat rejoint celui, déjà formulé, d'une durée effective de placement très inférieure aux objectifs et souvent limitée à quelques mois. En pratique, les CEF se révèlent ainsi inefficaces dans la grande majorité des cas et peuvent même, par leur brièveté, aggraver le risque de récidive. Les rapporteures souhaitent dès lors garantir des durées de placement suffisamment longues pour que ces structures puissent remplir leur mission, et explorer les voies permettant d'élargir leur usage, que ce soit en fin de peine (par exemple, pour créer un dispositif de semi-liberté dédié aux mineurs, étant rappelé que ces derniers ne peuvent pas en bénéficier à ce jour) ou comme mode d'exécution d'une sanction pénale d'au moins six mois, avec dans cette hypothèse un enjeu essentiel de continuité du placement par-delà la « césure » du procès.
Proposition n° 19
Garantir une durée de placement en CEF de six mois au moins, en élargissant le recours à ces centres en fin de peine de prison, voire en envisageant une extension de leur utilisation en tant que sanction ou comme équivalent de semi-liberté.
En outre, la prise en charge éducative et psychologique des mineurs incarcérés demeure très en-deçà des besoins. Les jeunes concernés présentent pourtant, de manière statistiquement avérée, davantage de fragilités que leurs pairs : parcours scolaires lacunaires, difficultés familiales, addictions, troubles de santé. Or, les dispositifs de soutien psychologique sont trop souvent absents ou irréguliers, alors même que l'accompagnement thérapeutique est une condition indispensable de toute démarche éducative.
À ces carences s'ajoutent les limites du dispositif scolaire. Dans les quartiers mineurs comme dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, le volume d'enseignement dispensé reste inférieur aux prescriptions réglementaires, déjà modiques, les heures effectives étant fréquemment divisées par deux.
Ces insuffisances apparaissent également dans les CEF, qui devraient pourtant constituer des structures de réinsertion privilégiées. Le quota de 15 heures hebdomadaires d'enseignement fixé par les textes y est rarement atteint, les jeunes bénéficiant au mieux de cinq à dix heures de cours, le plus souvent dans la fourchette basse. Cette situation compromet directement l'objectif de rescolarisation et d'acquisition de compétences, pourtant au coeur du projet des CEF.
La mission considère que la réhabilitation des mineurs délinquants est une impérieuse nécessité et doit être érigée au rang de priorité, ce qui implique un effort déterminé en matière de santé et d'éducation. Elles appellent dès lors le Gouvernement à garantir, grâce à des moyens suffisants, la présence permanente d'un psychologue dans chaque structure accueillant des mineurs et à veiller, en parallèle, au respect des obligations minimales d'enseignement. Ces deux évolutions sont une condition sine qua non de l'efficacité de ces établissements et doivent être mises en oeuvre sans délai.
2. Rééquilibrer les moyens entre les structures de milieu fermé
La situation des mineurs détenus, si elle appelle pour partie des recommandations analogues à celles formulées pour les majeurs, soulève également des enjeux spécifiques.
De même que pour les détenus majeurs, il convient tout d'abord de faciliter l'exercice de son office par le juge des enfants - qui assure, pour mémoire, à la fois les fonctions dévolues au juge du fond et au JAP - en matière d'exécution des peines. Celui-ci doit ainsi se voir doté d'outils garantissant sa parfaite information sur les places disponibles dans les différentes structures de milieu fermé, mais aussi ouvert (centres éducatifs renforcés, foyers éducatifs...) ainsi que sur la nature des suivis proposés dans les différents établissements, quartiers ou centres dans lesquels le mineur est susceptible d'être affecté.
Si les mesures proposées par la mission étaient traduites dans la loi, les mineurs se trouveraient par ailleurs soumis au même régime que les majeurs en matière de probation236(*) et de réductions de peine. Ils en tireraient les mêmes avantages que les adultes, pour peu que le contenu des peines alternatives au milieu fermé soit enrichi pour faire face à leurs besoins spécifiques en s'inspirant des « modules » déjà prévus par le code de la justice pénale des mineurs.
À ces recommandations de portée générale doivent, toutefois, s'ajouter des mesures particulières. En pleine cohérence avec les constats qu'elles ont formulés, les rapporteures proposent ainsi plusieurs mesures visant à améliorer la situation des mineurs incarcérés.
Elles appellent ainsi à un rééquilibrage global entre les QM et les EPM, dont le fonctionnement est aujourd'hui trop disparate au regard de la similarité des profils des mineurs détenus au sein de ces deux types de structures.
Ce rééquilibrage suppose d'abord que soit enfin assurée une complète étanchéité entre les mineurs placés en QM et les majeurs affectés dans les autres quartiers de l'établissement, conformément aux engagements conventionnels de la France. Le ministère de la justice doit, sans délai, définir la nature et le coût des travaux requis pour atteindre cet objectif, afin que les opérations immobilières correspondantes puissent être engagées par ordre de priorité et rapidement menées à terme.
Il implique, ensuite, qu'une évaluation globale des QM et des EPM soit menée par une entité indépendante. Les divergences constatées entre les quartiers d'une part et les établissements de l'autre, immenses, ne sauraient perdurer indéfiniment et sans justification valable. S'il semble qu'il ait été décidé de mettre fin à la mise en service de nouveaux EPM en raison de leur coût élevé de fonctionnement237(*), encore faut-il que cette décision soit justifiée par un bilan exhaustif des avantages et des inconvénients de ces établissements, bilan dont il appartiendra au Parlement de tirer les conséquences lors de la prochaine loi de programmation et d'orientation pour la justice.
Proposition n° 20
Opérer un rééquilibrage entre quartiers « mineurs » et établissements pour mineurs, fondé sur une évaluation précise de leur fonctionnement actuel.
En complément de ce rééquilibrage, les rapporteures rappellent que l'enjeu de la fin de peine doit faire, pour les mineurs, l'objet d'une vigilance particulière.
Comme on l'a vu, l'application aux mineurs de la LSC-D a eu des conséquences dévastatrices, unanimement dénoncées par les professionnels du secteur. La suppression de cette mesure, préconisée à titre général par la mission, doit conduire à repenser la gestion de la fin de peine pour les mineurs délinquants. Il importe ainsi d'utiliser les CEF en fin de peine, pour une durée minimale de six mois, comme les rapporteures le recommandent par ailleurs (voir supra).
Cette recommandation n'étant valable que pour les peines relativement longues, d'autres solutions doivent être trouvées pour les mineurs condamnés à des peines plus courtes. Considérant que les mineurs constituent « une population prioritaire dans la lutte contre la récidive », les rapporteures estiment, à l'instar de la CNPTJ, qu'ils doivent bénéficier d'« aménagements de peines de nature différente » : elles préconisent ainsi l'extension, pour les mineurs, des aménagements de fin de peine « sous forme de Tig, de stages et d'autres mesures de nature plus éducative passé le temps de l'incarcération ».
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je vous propose à présent d'examiner le rapport d'information sur l'exécution des peines. Je laisse la parole à nos trois rapporteures.
Mme Elsa Schalck, rapporteure. - Mes chers collègues, le premier constat que la mission d'information a pu dresser à l'issue de ses travaux a été, sans surprise, hélas ! celui de l'insuffisance des données disponibles. Les applicatifs du ministère de la justice, obsolètes, ont laissé subsister des angles morts autour desquels nous n'avons pu que tourner : le délai d'exécution des peines alternatives à la prison ou encore la durée des peines effectivement exécutées par les détenus libérés après 2020 nous sont ainsi restés inconnus. Notre rapport sera donc, une nouvelle fois, l'occasion d'appeler la Chancellerie à établir enfin des données fiables, complètes, à jour et exploitables : ce manque de transparence, même involontaire, n'a que trop duré.
Notre deuxième observation porte sur l'éclatement des acteurs de l'exécution des peines, par ailleurs entravés, pour certains d'entre eux, par un manque criant de moyens. Les juges du fond sont désormais pleinement investis de la mission d'aménagement des peines, ce qui alourdit les audiences correctionnelles et marginalise d'autant le rôle, pourtant essentiel, du juge de l'application des peines (JAP). Les services d'insertion et de probation (Spip) restent surchargés : malgré des renforts successifs en effectifs qui ont permis de nettes améliorations, nous n'avons pas encore réussi à nous conformer au standard européen de soixante dossiers par conseiller. Enfin, les forces de sécurité intérieure ne sont pas, faute de temps, suffisamment mobilisées sur les missions qui leur incombent en matière d'exécution des peines.
Notre troisième constat a été celui de l'incapacité des lois récemment adoptées à concilier deux impératifs opposés : d'une part, la demande croissante de fermeté qui émane de la société à l'heure où les sondages, les uns après les autres, montrent combien la justice est perçue comme « laxiste » ; d'autre part, la nécessité de juguler une surpopulation carcérale devenue hors de contrôle et qui fait aujourd'hui dormir plus de 5 000 détenus sur des matelas, à même le sol.
Ainsi que notre collègue Stéphane Le Rudulier l'a rappelé l'été dernier à l'occasion de nos travaux sur la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, la logique de « gestion des flux » qui prévaut à ce jour n'est pas une solution : elle n'a fait qu'aggraver le mal qui ronge nos prisons. La généralisation des aménagements ab initio pour les peines de moins d'un an a poussé les juges correctionnels à prononcer des sanctions plus lourdes afin d'obtenir l'incarcération effective des délinquants qu'ils jugent dangereux ; quant à la libération sous contrainte de plein droit, qui a été unanimement décriée lors de nos auditions, elle a favorisé les « sorties sèches » et rendu la fin de peine moins prévisible, sans pour autant que ses effets suffisent à compenser la suppression des crédits de réduction de peine automatiques qui lui préexistaient. Nos prisons sont au bord du précipice, et cette situation ne saurait être plus longtemps tolérée : la lutte contre la surpopulation carcérale est, à nos yeux, la mère de toutes les batailles.
Le quatrième point saillant de nos travaux porte, justement, sur les modalités d'exécution des peines de prison ferme. Il y aurait beaucoup à dire, mais, compte tenu du temps qui m'est imparti, je me contenterai de quelques constats. Tout d'abord, le raisonnement capacitaire est mis en échec par la gravité de la situation : le « plan 15 000 », qui vise à mettre en service autant de nouvelles places de détention, est déjà obsolète. En effet, ce sont non pas 15 000, mais 20 000 places qui manquent désormais. Par ailleurs, les tentatives de régulation carcérale « souple » n'ont pas produit d'effets tangibles au-delà du court terme. Ensuite, la surpopulation carcérale aggrave les difficultés que rencontre l'administration pénitentiaire depuis de nombreuses années : le suivi des détenus est famélique, ce qui pose la question de la réinsertion des condamnés et de leur préparation au retour dans la société ; l'accès à l'emploi ou à la formation est plus que restreint ; l'accès aux soins, notamment en santé mentale, est très largement inférieur aux besoins. « Nous enfermons des fous », disait le ministre de la justice lors d'une récente audition ; nous ajouterons, à la lumière de nos travaux, que nous les enfermons en prenant le risque de les rendre plus malades encore, puisque nous ne les soignons pas. En somme, la peine de prison ferme a perdu tout son sens pour les condamnés comme pour la société : des magistrats nous ont ainsi déclaré que la seule certitude qu'ils avaient lorsqu'ils prononcent une peine de prison ferme est qu'elle ne sera pas exécutée telle qu'elle a été prononcée, car la loi l'interdit...
Le cinquième constat, guère plus rassurant
que ceux qui précèdent, porte sur les peines dites
« alternatives » à la prison. Celles-ci nous sont
apparues comme le parent pauvre de la sanction. Je serai là encore
très synthétique et me bornerai à indiquer que ces
alternatives, en dépit d'une grande diversité qui devait en faire
un levier d'individualisation des sanctions, ne sont que peu mobilisées
par les magistrats : les juges préfèrent aménager une
peine de prison ferme plutôt que d'opter pour une sanction alternative,
car l'aménagement les assure de l'incarcération immédiate
du condamné en cas de non-respect de ses obligations. De plus, ces
peines ne semblent pas exécutées assez rapidement : nous ne
disposons de statistiques que pour les travaux d'intérêt
général (Tig), dont le délai moyen d'exécution est
extrêmement élevé : 16,7 mois ! Enfin, le
suivi de l'exécution des peines alternatives présente
d'importantes lacunes, relevées par toutes les personnes qui ont
été auditionnées : les alarmes émises en cas
de non-respect des horaires lors d'un placement en détention à
domicile sous surveillance électronique
sont si filtrées
que ce n'est qu'après un nombre considérable de retards que
le condamné est réellement convoqué par le Spip. La
sanction ne saurait être crédible dans de telles conditions.
Dernier point, et non des moindres : la situation particulière des mineurs condamnés. Je ne reviendrai pas sur les spécificités du droit pénal des mineurs, que notre commission a eu l'occasion d'évoquer, mais je formulerai trois observations.
La première concerne l'insuffisance de la prise en charge des mineurs en milieu fermé, en matière d'accès aux soins comme d'enseignement : cette défaillance est grave, car elle signifie que nous ne traitons pas les mineurs condamnés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire de futurs adultes dont il faut prévenir l'ancrage dans la délinquance.
Ma deuxième observation porte sur les mineurs placés en centre éducatif fermé (CEF). Des études, certes anciennes, montrent que le placement en CEF favorise la récidive s'il est inférieur à quatre mois alors qu'il la prévient, à l'inverse, s'il est supérieur à six mois ; or la durée moyenne de placement est tombée à quatre mois, ce qui veut dire, concrètement, que dans de trop nombreux cas les CEF ne jouent plus leur rôle de réinsertion.
Ma troisième observation porte sur les mineurs incarcérés : non seulement la prise en charge est très différente selon l'affectation - le coût moyen est de 600 euros par jour en établissement pénitentiaire pour mineurs contre 150 euros en quartier « mineurs » -, mais, surtout, cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif : les mineurs sont orientés indifféremment dans l'une ou l'autre de ces structures sans qu'il soit tenu compte de leur profil.
Je laisse à présent mes collègues rapporteures vous présenter les propositions de la mission d'information. Dans De l'Esprit des lois, Montesquieu rappelait que la cause de tous les relâchements était non pas la modération des peines, mais l'impunité des crimes : cet adage a inspiré nos recommandations.
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - Mes chers collègues, à partir de ce constat, vous comprendrez que nos recommandations se concentrent en premier lieu sur le sens de la peine : une peine qui n'est pas exécutée, ou qui l'est sans correspondre au jugement prononcé, perd de son sens et suscite de fait l'impression d'une justice laxiste. Il est aujourd'hui nécessaire, après plusieurs années, voire des décennies d'érosion, de redonner du sens à la peine. Nombreux sont aujourd'hui nos concitoyens qui ne font plus confiance à la justice et, au-delà, qui ne comprennent plus les décisions rendues. Redonner du sens à la peine, c'est non seulement garantir la bonne exécution des sanctions pénales, mais c'est aussi restaurer la légitimité même du système pénal français.
Nos travaux ont montré qu'une incohérence s'était progressivement installée entre la peine encourue, la peine prononcée et la peine exécutée. Cette situation nuit tant à l'effectivité qu'à la lisibilité des peines pénales. Nous préconisons donc d'évaluer les causes de ces écarts afin de les corriger et, ce faisant, de rétablir la crédibilité de la sanction, son exécution et son sens. L'analyse de ces écarts est aujourd'hui quasiment impossible en raison des lacunes statistiques de la Chancellerie, qui sont régulièrement rappelées par la commission des lois.
Tous les acteurs de la chaîne pénale s'accordent par exemple sur un fait : le droit de l'exécution des peines se complexifie de réforme en réforme, notamment parce que les textes visent souvent des objectifs contradictoires. A été pointé notamment, lors des auditions, l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement. L'instauration de seuils contraignants a eu l'effet pervers d'inciter les magistrats à alourdir les peines prononcées afin de les contourner, contribuant ainsi à la surpopulation carcérale. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio pour les peines de moins d'un an et d'écarter les exigences de motivation spéciale qui s'imposent aux juges du fond s'ils souhaitent voir la peine appliquée telle qu'ils l'ont prononcée. L'observation d'Elsa Schalck est tout à fait juste : souvent, les magistrats optent pour l'incarcération de préférence aux peines alternatives, lesquelles souffrent d'un manque de moyens et sont insuffisamment connues, et dont, par ailleurs, l'effectivité n'est pas garantie par un suivi régulier. Voilà qui alimente la surpopulation carcérale tout autant que l'incompréhension à l'égard du système.
Conformément aux choix qu'a faits notre commission dans un passé récent, nous proposons également de rendre aménageables toutes les peines de moins de deux ans. Ni nos auditions, dans leur quasi-totalité, ni les statistiques - sur ce point, elles existent ! - n'ont montré un quelconque laxisme : la durée moyenne des incarcérations augmente très nettement en France. Elle s'élève à 11,3 mois, contre 4,6 mois, par exemple, en Allemagne : plus du double ! Pour améliorer l'efficacité de la réponse pénale, nous suggérons de rétablir la possibilité, pour les magistrats, de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, mais uniquement dans des conditions très précises et pour une population ciblée, à savoir les condamnés qui ne sont pas ancrés dans la délinquance et notamment les plus jeunes d'entre eux. Il faudrait veiller, bien entendu, à ce que ces personnes ne présentent pas de fragilité face à l'incarcération. L'idée est aussi que ces peines soient effectuées dans des établissements spécifiques : de l'avis de tous, une incarcération dans les conditions actuelles ne servirait strictement à rien.
Je le souligne à mon tour : la surpopulation carcérale est le noeud du problème, si nous voulons redonner efficacement du sens à la peine. En particulier, il importe de différencier les courtes peines, dont la durée est comprise entre un et six mois et qui sont largement décrites comme « désocialisantes », des très courtes peines qui, sans employer le terme de « choc carcéral », peuvent conduire les primodélinquants à une prise de conscience : il s'agit d'éviter la récidive et de ne pas entrer dans l'engrenage de la délinquance.
La logique plus générale qui sous-tend cette mesure est la nécessité d'améliorer l'individualisation des peines. Aussi, nous recommandons de réunir tous les acteurs de la chaîne pénale au sein d'un plateau technique pluridisciplinaire qui serait chargé d'évaluer la personnalité des accusés. La mission des Spip, selon leur référentiel professionnel, consiste essentiellement à mesurer le risque de récidive. Or c'est impossible si ce travail en amont n'est pas fait. Cette démarche d'échange et de connaissance mutuelle entre les différents acteurs de l'exécution des peines devrait être poursuivie par la clarification de leurs rôles respectifs : nous avons trop souvent constaté que les fonctions des Spip étaient mal connues et mal intégrées au processus. Enfin, l'individualisation des peines suppose des moyens matériels. Nous insistons donc sur la nécessité de garantir l'adéquation entre la nature des établissements d'incarcération et la personnalité des détenus, sans quoi ce travail d'amélioration de la connaissance des accusés et des acteurs de l'exécution des peines ne porterait pas ses fruits.
J'en viens au deuxième axe directeur de nos recommandations : la nécessité de placer la réinsertion au coeur de la peine pour lutter efficacement contre la récidive. Cet objectif se décline en deux volets principaux.
En premier lieu, il convient d'écarter les obstacles à la réinsertion qui existent aujourd'hui en prison. Nous avons constaté tout au long de nos travaux que les moyens manquaient pour assurer un véritable suivi des détenus. Or ce suivi est nécessaire pour préparer la fin de peine et asseoir les conditions d'une vie nouvelle. Nous suggérons donc d'augmenter les effectifs des Spip pour qu'ils puissent exercer pleinement leurs fonctions et investir le champ pré-sentenciel. Il s'agit là de la seule proposition capacitaire de notre rapport : nous connaissons la situation budgétaire et nos autres propositions pourront être mises en oeuvre à moyens constants.
En second lieu, il apparaît nécessaire de donner un véritable contenu aux peines alternatives existantes. Si leur grande diversité - stages, travaux d'intérêt général, surveillance électronique - est a priori favorable à l'individualisation des peines et donc à la réinsertion, leur portée demeure en effet limitée. Ainsi, les peines alternatives représentent moins de 20 % des peines prononcées, leur mise en oeuvre étant jugée lente et leur contenu léger. Le recours à ces peines, en particulier à la surveillance électronique, est en outre souvent dévoyé. Nos travaux ont montré que les peines alternatives et les aménagements de peine étaient utilisés non pas comme des outils visant à individualiser la peine et à lui donner du sens, mais comme des outils de régulation carcérale. Cela pose problème.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Je tiens tout d'abord à remercier mes deux corapporteures pour la qualité de nos travaux. L'ambiance dans laquelle nous les avons menés a été particulièrement plaisante : il est agréable de travailler ainsi et de trouver des points d'accord aussi facilement au sein d'une équipe pourtant transpartisane.
Si notre mission a mis en lumière l'illisibilité de notre droit de l'exécution des peines, elle a surtout révélé une urgence : celle de restaurer la crédibilité de la sanction pénale, et de lui redonner toute sa force protectrice et réparatrice. Or, comme l'a rappelé Elsa Schalck, cet objectif restera hors d'atteinte tant que ne sera pas résolu le problème de la surpopulation carcérale. Alors que les prisons françaises affichent un taux d'occupation de près de 135 %, la surpopulation carcérale n'est plus un simple dysfonctionnement ; elle est devenue un scandale national qui fragilise à la fois les détenus, les personnels et, en définitive, la société tout entière. On ne répare pas bien dans ce contexte.
Nous avons voulu le dire avec clarté : la logique de « gestion des flux » a échoué. Les mécanismes automatiques, qu'ils soient d'aménagement ou de libération sous contrainte, ont brouillé la lisibilité de la peine sans résoudre la crise. Il faut rompre avec cette approche comptable pour refonder une politique pénale lisible, crédible et ferme. Cela suppose, bien sûr, de tenir enfin nos engagements en matière de construction de places de prison. Le « plan 15 000 », lancé en 2017, doit enfin aboutir. Nous savons toutefois qu'il ne suffira pas. Il faut aller plus loin : diversifier les établissements, différencier les parcours et, surtout, créer une véritable peine de probation. Diversifier les établissements peut permettre d'aller plus vite. S'il est nécessaire de prévoir une protection renforcée pour détenus très dangereux, tous ne sont pas susceptibles de s'évader en hélicoptère. Aussi, nous devons réfléchir à la construction de prisons plus légères, moins coûteuses et plus rapides à mettre en oeuvre.
Il faut donc, j'y insiste, diversifier les établissements, différencier les parcours et, surtout, créer une véritable peine de probation, ainsi que le propose le Sénat depuis 2018. Le ministre démissionnaire de la justice a repris récemment cette idée. Même s'il a fallu attendre sept ans, nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir été enfin entendus. La peine de probation permettra un suivi étroit, exigeant, mais aussi réactif, via la possibilité d'incarcérer immédiatement la personne en cas de manquement. Susceptible d'intervenir en complément d'une peine de prison ferme ou d'être prononcée seule, elle reposera sur une large palette de mesures contraignantes. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons réduire durablement la surpopulation tout en rendant crédible la réponse pénale.
Cette exigence de crédibilité suppose également que les peines soient exécutées rapidement et effectivement. Trop souvent, les condamnations restent lettre morte ou interviennent après un délai tel qu'elles perdent leur sens. Comment accepter qu'aujourd'hui encore plus d'un cinquième des jugements correctionnels soient rendus dans le silence de l'absence du prévenu ? Cette carence n'est pas seulement regrettable, elle mine l'autorité de la justice elle-même, étant établi que les décisions prononcées en l'absence de l'intéressé connaissent des taux d'exécution significativement plus faibles. Là encore, des solutions existent : généraliser les rappels automatiques et dématérialisés de convocation ou encore donner à certaines décisions d'emprisonnement ferme la valeur d'un véritable ordre de recherche et d'arrestation. De telles mesures impliquent non pas des révolutions juridiques, mais une volonté politique claire : celle de faire comprendre que, dans notre République, une peine prononcée doit être une peine exécutée.
L'exécution ne vaut toutefois que par le contrôle. Si les magistrats continuent de recourir si largement à la peine d'emprisonnement, c'est aussi parce qu'ils demeurent profondément sceptiques quant à l'effectivité réelle des sanctions exécutées en milieu ouvert. Cette défiance affaiblit la crédibilité même des alternatives à l'incarcération. Nous devons donc lever ce doute en renforçant les contrôles, en imaginant une véritable police de la probation ou, à défaut, en spécialisant certains agents des Spip. Il s'agit tout simplement de s'assurer que la probation est perçue non comme une formalité, mais bien comme une sanction à part entière, assortie d'obligations précises et vérifiées. Là encore, la crédibilité de la justice est en jeu.
Enfin, je dirai un mot des mineurs condamnés. C'est peut-être là en effet que se joue l'avenir. La délinquance des jeunes se durcit, se rajeunit, et nos réponses ne sont pas toujours à la hauteur. Les centres éducatifs fermés, conçus pour les multirécidivistes, sont devenus un outil par défaut, au détriment de la diversité des prises en charge. Il nous faut les recentrer sur leur mission première et redonner souffle aux alternatives éducatives. Il nous faut aussi rééquilibrer les moyens entre quartiers mineurs et établissements pénitentiaires pour mineurs, dont les coûts et les pratiques divergent sans justification. Et, surtout, il nous faut investir dans l'accompagnement éducatif et psychologique : garantir la présence de psychologues, respecter les normes de scolarisation, offrir à ces jeunes autre chose qu'une simple privation de liberté. C'est ainsi que nous éviterons la récidive et que nous leur donnerons une chance réelle de réinsertion.
Mes chers collègues, au terme de cette mission, nous n'avons pas seulement formulé des constats. Nous avons voulu tracer une perspective. Il ne s'agit pas de choisir entre sévérité et réinsertion, entre protection de la société et dignité des condamnés. Il s'agit de tenir ensemble ces exigences, car elles sont indissociables. Redonner sens et force à la peine, c'est restaurer la confiance des citoyens dans leur justice. Et c'est, au fond, rendre à la République l'un de ses fondements les plus précieux : la certitude que la loi s'applique à tous, avec clarté, avec fermeté, mais aussi avec humanité.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Merci beaucoup, mesdames les rapporteures, pour ce travail de qualité.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Mesdames les rapporteures, je vous remercie pour ce rapport aussi accablant qu'éclairant. Il nous indique des pistes à suivre, même si l'aspect budgétaire reste à considérer. Le délai d'exécution des travaux d'intérêt général - 16,7 mois - dépend-il des tribunaux ou des communes ? Quelle a été son évolution ? Par ailleurs, pourriez-vous nous présenter rapidement le modèle hollandais, que vous avez étudié et qui est souvent cité en exemple s'agissant de « vider les prisons » ?
M. Louis Vogel. - Je félicite à mon tour les trois rapporteures, qui ont formulé des propositions nombreuses et concrètes. Leur constat est évidemment partagé et le Sénat a rappelé plusieurs fois au Gouvernement qu'il était temps de prendre des mesures. Cette situation ne peut plus durer. Pour avoir visité de nombreuses prisons, je peux vous dire que l'on sent la température monter : il faut trouver des solutions.
L'une des difficultés qui obèrent la mise en oeuvre des peines alternatives réside dans la mentalité des magistrats : pour eux, la peine de prison reste la reine des peines. De surcroît, elle est plus simple. Il faut donc imaginer des façons d'inciter les magistrats à passer à autre chose. Ils ne le feront - vous l'avez dit vous-mêmes - que si l'on prévoit un encadrement des peines alternatives, lesquelles exigent par ailleurs - je songe au travail d'intérêt général - un énorme travail d'organisation préalable, notamment dans les collectivités locales, et sont très difficiles à mettre en place. Si l'on veut que de telles peines soient prononcées, il faut les avoir préparées. Des problèmes pratiques expliquent donc la situation actuelle. Les peines alternatives sont pourtant une voie à emprunter pour résoudre le problème de la surpopulation.
Par ailleurs, comment imaginez-vous concrètement le plateau technique qui a été évoqué ? Quelles seraient sa composition et ses modalités de travail ?
M. Alain Marc. - Je félicite à mon tour les trois coauteures de ce rapport.
En tant qu'ancien rapporteur pour avis du budget de l'administration pénitentiaire, je savais qu'il serait impossible de construire 15 000 nouvelles places de prison. Nous avons tous rencontré des maires, dans les communes rurales notamment, qui se disent prêts, une fois les élections municipales passées, à accueillir des prisons sur leur territoire. Lorsque j'avais évoqué cette question avec le directeur de l'administration pénitentiaire, il m'avait expliqué qu'il fallait toujours construire les prisons à proximité des lieux de délinquance, afin notamment de permettre aux familles de visiter les détenus. Cela pose de nombreuses difficultés - pétitions de riverains, difficultés d'accès à l'immobilier en raison de son coût - qui, cumulées, entraînent des retards qui ne satisfont personne. Je souhaite que nous atteignions un jour l'objectif des 20 000 places supplémentaires, mais cela sera extrêmement difficile.
Dans ce contexte, la philosophie qui consiste à vouloir absolument construire des prisons à proximité des lieux de délinquance n'est-elle pas quelque peu dépassée ? Alors que la délinquance augmente, ne serait-il pas judicieux d'écouter les maires volontaires pour accueillir une prison sur leur territoire ? Certes, les familles ne pourraient pas visiter leur proche immédiatement. Mais n'est-ce pas aussi cela le sens de la peine ? Ayons certes de l'humanité, mais gardons-nous des excès. Il y a là, me semble-t-il, une voie d'avenir à creuser.
Mme Elsa Schalck, rapporteure. - Comme indiqué dans notre rapport, les délais d'exécution des travaux d'intérêt général - plus de seize mois en moyenne - stagnent. Si les offres sont de plus en plus nombreuses, grâce notamment aux partenariats qui sont noués avec les communes, un long travail de fond est en effet nécessaire pour que ces peines puissent être prononcées Or, les travaux d'intérêt général sont une partie de la solution : d'où notre recommandation de donner de la consistance aux peines alternatives et aux aménagements de peine.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous nous sommes rendues aux Pays-Bas, car les courtes peines y sont nombreuses ; elles sont censées permettre un turnover plus important, donc des fermetures de prisons. À cette occasion, nous n'avons pas obtenu les réponses que nous espérions : en réalité, cet État en revient aux peines longues, notamment pour faire face à son problème endémique de narcotrafic.
Néanmoins, l'accompagnement des prisonniers y est bien plus prononcé que dans notre pays. Il est nécessaire si l'on veut que la prison ait un sens.
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - Nos interlocuteurs nous ont assuré que le taux de récidive chez les condamnés à de très courtes peines ne différait pas fondamentalement de celui qui est observé après un travail d'intérêt général.
Selon eux, les très courtes peines, pour avoir un intérêt, doivent être destinées à un public spécifique et ne pas s'appliquer dans les conditions de la détention carcérale traditionnelle. Aux Pays-Bas, les primodélinquants suivent en quelque sorte un stage de citoyenneté renforcé, destiné à favoriser les prises de conscience et à éviter le cycle infernal de la récidive, celui qui fait parfois de la prison une simple préparation au devenir-caïd...
Les peines d'un à six mois sont celles qui posent problème dans ce cas d'espèce : elles sont désocialisantes et ne permettent ni évaluation ni réinsertion. L'accompagnement des détenus, dans ce cadre, est pratiquement abandonné : on estime que cela n'en vaut pas la peine, la durée étant trop courte et la sanction susceptible d'aménagement. À rebours de l'objectif, cet état de fait favorise, comme la libération sous contrainte de plein droit, les sorties sèches. Les très courtes peines doivent donc s'inscrire dans un cadre précis. Nous indiquons dans le rapport que leur rôle est limité.
La création d'un plateau technique pluridisciplinaire, qui permettrait d'évaluer les personnes mises en cause, figure parmi les recommandations du rapport de la mission d'urgence relative à l'exécution des peines. L'idée provient donc de l'inspection générale de la justice (IGJ), qui commence à considérer la régulation carcérale comme le noeud du problème. Nous avons repris cette préconisation.
Concrètement, les Spip interviendraient durant la période pré-sentencielle, ce qui induirait une collaboration plus intégrée entre ces services et les magistrats : assistant social, agent de probation, avocat... L'interdisciplinarité permettrait d'évaluer le risque de récidive et d'individualiser la peine. Je suis un peu éberluée quand, à l'occasion d'une autre mission, dans un milieu fermé consacré aux mineurs, quelqu'un me dit : « Je ne sais pas ce que devient celui-ci, parce que ce n'est plus mon problème... » Cela me paraît effarant !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La prison pour femmes de Rennes est située au pied de la gare TGV. Il est logique que l'on dispose d'un noeud ferroviaire pour accéder aux prisons dédiées aux longues peines.
Toutefois, des établissements un peu différents, prévus pour de très courtes peines, pourraient être situés dans d'autres endroits. Je sais que le Gouvernement et la Chancellerie y réfléchissent. Rechercher en province des lieux offrant un accès via les transports en commun ne me paraît pas forcément logique : d'une part, les déplacements s'y font surtout en voiture, d'autre part, une visite familiale n'est pas forcément nécessaire quand les peines sont aussi courtes. Il faut réfléchir à mieux mailler le territoire afin de ne pas obliger les personnes vivant dans les territoires ruraux à aller purger leur peine à la ville sous prétexte qu'il s'y trouve une desserte ferroviaire.
Mme Marie Mercier. - Comment empêcher la récidive ? Au cours de nos travaux d'information sur l'évaluation des Spip et la lutte contre la récidive, Laurence Harribey et moi-même avons constaté combien le personnel pénitentiaire est investi dans sa mission, mais aussi combien l'information circule difficilement. Celle-ci est cloisonnée : les agents ne sont pas concernés par l'après.
Depuis le drame d'Incarville, une bascule s'est produite. Les détenus sont de plus en plus violents. Les agents de l'administration pénitentiaire se trouvent aussi confrontés à de nouvelles règles qui leur sont imposées. Ainsi, le personnel chargé du ménage, faute de savoir qu'il se trouve dans une cellule dans laquelle est prévue une trousse de prévention destinée aux usagers de drogues, risque de se piquer au contact d'une telle « Stéribox ».
Mesdames les rapporteures, avez-vous auditionné M. Berger, pédopsychiatre, au sujet des peines très courtes pour les mineurs ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ce travail transpartisan contient des propositions pragmatiques, mais il ne faut pas croire en ses rêves : ces recommandations sont malheureusement aussi équilibrées qu'un peu irréalistes... Et leur traduction dépendra essentiellement des arbitrages budgétaires. Les agents des Spip n'ont déjà pas le temps d'accomplir leur travail : comment imaginer de leur confier une autre tâche ?
Par ailleurs, ce rapport est totalement orthogonal aux positions que la majorité sénatoriale exprime en général dans l'hémicycle. Je le garde donc en mémoire dans la perspective des prochains débats ! En effet, sur les moyens à mettre en oeuvre pour faire face à la délinquance, il s'écarte d'une vision que l'on peut parfois qualifier de binaire.
Je remercie Laurence Harribey d'avoir précisé la proposition n° 4, « Rétablir la possibilité, pour le juge du fond, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ». Sans la suite de la phrase - « ces très courtes peines étant destinées aux condamnés bien insérés et non encore ancrés dans la délinquance, mineurs comme majeurs, et exécutées dans des établissements spécialisés » -, j'y serais totalement défavorable, car une telle mesure serait désocialisante.
Nous avons tous reçu l'avant-projet de loi du garde des sceaux pour une sanction utile, rapide et effective (Sure). Peut-être le gouvernement à venir présentera-t-il ce texte relatif au choc carcéral et aux très courtes peines ? Quoi qu'il en soit, les établissements spécialisés dédiés à ces peines-là n'existent pas et n'existeront jamais, faute des moyens et de l'état d'esprit nécessaires. Laurence Harribey a raison de préciser que la Chancellerie évoque à présent, dans ses travaux internes, la question de la régulation. Nous avons elle et moi déposé une proposition de loi visant à instaurer un mécanisme contraignant de régulation carcérale, car nous savons qu'il n'y aura pas d'autre solution.
Nous ne mentionnons pas l'éléphant dans la pièce : personne, ce matin, n'aborde la question de l'exécution provisoire. Vu les débats depuis quelques jours, il est presque gênant que nous n'en parlions pas, d'autant que le président du Sénat, de manière assez imprudente et sortant de son rôle, s'est exprimé sur le sujet. C'est la deuxième fois, après l'épisode de la condamnation de Marine Le Pen, que cette question surgit dans le débat public. Madame la présidente, peut-être serait-il utile de communiquer aux collègues des chiffres à ce sujet, car l'exécution provisoire est devenue, dans la majorité des cas, le corollaire des peines de prison de première instance. Plus la peine est lourde, plus l'exécution provisoire est prononcée. Dans 89 % des cas, une peine de prison ferme de plus de vingt-quatre mois se traduit par une incarcération immédiate.
Ce débat n'est pas indigne, car l'exécution
provisoire percute non pas tant la présomption d'innocence que le
principe du double degré de juridiction. Cela dit, aborder le sujet de
la manière dont il a été traité dans
le débat public depuis quelques jours me semble dangereux :
cette façon de
faire heurte notre conception de l'État
de droit. Par ailleurs, sans faire d'ironie excessive, supprimer
l'exécution provisoire réglerait le problème de
la surpopulation carcérale !
Mme Patricia Schillinger. - Dans le département où je suis élue, nous avons depuis 2021 une nouvelle prison : Mulhouse-Lutterbach. J'observe, ces dix dernières années, que la population carcérale évolue : certaines personnes emprisonnées le sont pour des faits très lourds. Lorsque j'étais maire, j'ai accueilli à plusieurs reprises des détenus pour des travaux d'intérêt général : je conseille la démarche aux élus.
Le problème est le suivant : quand un établissement est conçu pour 500 personnes et que 700 y sont incarcérées, l'effectif de l'administration pénitentiaire reste pourtant le même. Au mois de mars dernier, deux agents ont été condamnés à des peines d'emprisonnement, car, en raison de la fatigue, ils ont commis des violences sur des détenus - que je n'excuse nullement. La situation du personnel contribue donc à la multiplication des mauvais traitements dans les prisons. Par conséquent, il est indispensable d'envisager une augmentation des effectifs pénitentiaires.
Mme Lauriane Josende. - Pour rendre la justice et l'exécution des peines efficaces, l'essentiel est de simplifier les procédures. Ce matin, un rapport de contrôle budgétaire sur les frais de justice était présenté devant la commission des finances : l'objectif de simplification ne doit jamais être perdu de vue. En effet, les juges, les agents de probation ou les agents pénitentiaires affirment tous que le moindre sujet à traiter implique pour eux des difficultés administratives, lesquelles polluent leur quotidien et les démotivent. Avocate de métier, je sais bien que les procédures protègent les droits, mais il faut trouver un juste milieu.
La simplification s'impose notamment dans la construction des prisons. Les Pyrénées-Orientales en attendent une depuis dix ans ! Même quand les maires donnent leur accord, entre le ZAN, les compensations environnementales et tout le reste, on n'en voit jamais le bout ! Il faut faire en sorte de construire plus rapidement.
M. David Margueritte. - Je me sens pleinement en phase avec le rapport. Exécution des peines, sortie de prison... : rien d'« orthogonal » avec nos orientations habituelles. En outre, la formation professionnelle en prison me semble donner du sens à la peine. Cette compétence a été transférée aux régions en 2014, dans des conditions extrêmement minimalistes. Comme j'ai pu l'expérimenter en Normandie, cet outil fonctionne. Il s'agit souvent de formations d'initiation aux métiers du bâtiment. Le détenu, qui a consenti à cet apprentissage, en ressort souvent transformé.
La question de la formation a-t-elle été abordée lors des auditions ? Le transfert de compétence a-t-il été évalué ? L'ensemble fonctionne, mais le budget est extrêmement limité. Le ratio en Normandie était le suivant : 1,4 million d'euros de dépenses pour un budget de formation de 127 millions d'euros.
Mme Elsa Schalck, rapporteure. - La complexité des procédures est l'un des constats que nous mettons en lumière dans le rapport et que nous devons avoir à l'esprit en tant que législateurs. Le droit de l'exécution des peines est devenu illisible, du fait notamment de réformes parfois contradictoires. Nous l'avons bien vu avec le « bloc peine » issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : ce texte a eu pour objet la mise en place d'aménagements plus importants alors même que la demande de répression est plus forte. Il convient donc de s'interroger sur notre propre responsabilité.
Le constat a été unanime lors des auditions : il faut marquer une pause dans les mesures. Pourtant, nous les enchaînons, sans obtenir de résultat. Dans leur rapport d'information fait en 2018 au nom de la commission des lois et intitulé Nature, efficacité et mise en oeuvre des peines : en finir avec les illusions !, nos anciens collègues François-Noël Buffet et Jacques Bigot faisaient déjà le constat d'un décalage de plus en plus fort entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines effectivement exécutées. Le quantum des peines est systématiquement accru dans les textes, quand bien même nous savons bien qu'in fine la sanction ne sera jamais appliquée telle quelle.
Je rappelle un chiffre édifiant : le taux de commission d'une nouvelle infraction est de 60 % dans les cinq ans qui suivent la sortie de prison. Redonner du sens à la peine est donc un enjeu majeur. Même en période de restriction budgétaire, l'État doit assumer cette mission régalienne : résoudre le problème de la surpopulation carcérale et allouer des moyens humains aux Spip. Les mesures que nous préconisons convergent toutes dans cette direction.
Par ailleurs, Maurice Berger a bel et bien contribué à notre rapport, lui dont nous connaissons les travaux et l'expertise sur les mineurs délinquants. Nous avons suivi sa recommandation d'instaurer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, pour les majeurs comme pour les mineurs.
Mme Laurence Harribey, rapporteure. - Il ne faut pas, en augmentant le nombre de postes indéfiniment, participer à l'inflation de l'incarcération. Pourvoir ceux qui sont ouverts serait déjà une bonne chose, car les taux de vacance dans les établissements pénitentiaires sont assez effrayants. Par conséquent, la question est moins celle du nombre de postes existants que celle du nombre de postes effectivement occupés.
Le recrutement pose problème en raison d'un manque d'attractivité. J'étais la semaine dernière à Draguignan pour une cérémonie d'hommage aux agents pénitentiaires gravement blessés ou décédés dans l'exercice de leurs fonctions : l'ensemble du personnel m'a confirmé que la situation était tendue, entre absentéisme et vacances de postes dues au non-recrutement. Il en va de même pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : 80 % des éducateurs d'une promotion sont reçus sur les postes ouverts, mais, à la fin de la formation, il n'en reste plus que 50 %. Mieux vaut travailler à améliorer ce point que d'opter pour des solutions artificielles en augmentant des lignes budgétaires qui ne résolvent pas tout !
Concernant la complexification, nous recommandons de supprimer les motivations spéciales.
Il est véritablement problématique que seuls 20 % des détenus travaillent. La formation professionnelle est donc fondamentale. Pourtant, lorsqu'elle est mise en place, elle est hachée. Comme nous l'avons constaté lors de précédents déplacements à Marseille et à Avignon, hors du cadre de la présente mission d'information, les mineurs peuvent bien suivre un cursus, mais, au moment de passer les examens, il arrive fréquemment qu'ils aient changé d'endroit : tout leur parcours s'en trouve interrompu. Je note toutefois qu'à la maison centrale de Poissy nous avons rencontré un détenu qui avait passé sa licence de droit !
L'une des faiblesses de notre travail est peut-être que nous ne nous sommes pas suffisamment préoccupées de l'évaluation du transfert aux régions de la compétence relative à la formation professionnelle des détenus.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Objectivement, simplifier permet d'agir sur la surpopulation carcérale, même sans argent supplémentaire. En effet, nous nous sommes rendu compte que l'exigence de motivation spéciale qui s'impose au juge pour les peines inférieures à un an de prison avait pour conséquence le prononcé par les magistrats de peines de plus d'un an, visant à s'assurer de l'exécution de la sanction. Tel n'était évidemment pas l'effet attendu.
Le « plan 15 000 » prévoyait déjà la création de différentes sortes de structures. Les établissements spécifiques pour les peines inférieures à quinze jours pourraient y être inclus, d'autant qu'ils coûteraient moins cher que les prisons traditionnelles : le risque d'évasion par hélicoptère est assez faible quand la peine dure aussi peu !
L'exécution provisoire ne fait pas partie des
sujets que nous avons étudiés. Toutes les peines
supérieures à deux ans de prison qui sont prononcées sont
immédiatement exécutoires. Par ailleurs, 77 % des
prévenus condamnés en première instance à des
peines d'au moins cinq ans de prison et immédiatement
incarcérés étaient déjà placés en
détention provisoire
au moment du prononcé. Il
faut aussi s'interroger sur la délinquance en col blanc : pourquoi
voler de l'argent ne serait-il pas sanctionné par une peine de prison,
comme c'est le cas pour le vol de biens matériels ?
Mme Muriel Jourda, présidente. - Le rapport a porté sur les difficultés révélées par les auditions ; comme personne ne s'est jamais plaint d'une exécution trop rapide d'une décision de justice, l'exécution provisoire n'a pas été en discussion.
Il faut distinguer l'exécution provisoire qui est liée par définition au mandat de dépôt et celle qui est induite par d'autres outils. Tout reste à la discrétion du juge, à condition qu'il motive sa décision en fonction de l'infraction et de la personnalité de la personne condamnée, conformément au droit commun en matière pénale.
J'ai eu hier soir une conversation avec un ancien magistrat de la Cour de cassation à propos d'un éventuel alignement du pénal sur le civil : au civil, l'exécution provisoire peut être suspendue par un magistrat de la cour d'appel saisi de la question. Nous pourrions peut-être réfléchir à ce type de recours, qui passerait, par exemple, par une saisine du président de la chambre de l'instruction. Quoi qu'il en soit, ce sujet n'a été soulevé par aucune des personnes auditionnées : la question n'a absolument pas été perçue comme l'éléphant dans la pièce.
Avant de procéder au vote des recommandations, je vous informe que le titre proposé pour le rapport est le suivant : L'exécution à la peine - 20 propositions pour mieux exécuter et donner du sens aux sanctions pénales.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
Table ronde des professeurs de droit
M. Jean-Paul Céré, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de Pau et des Pays de l'Adour
Mme Muriel Giacopelli, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université Aix-Marseille
M. Francis Habouzit, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Panthéon-Sorbonne
Mme Martine Herzog-Evans, professeur de droit pénal à l'université de Reims
M. Édouard Verny, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas
Table ronde d'organisations
représentatives des personnels
d'insertion et de
probation
Confédération générale du travail (CGT) Insertion - Probation
M. Eneko Etcheverry, secrétaire national
Mme Margaux Le Gallo, secrétaire nationale
Force ouvrière (FO) Justice - Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP)
Mme Farida Ed-Dafiri, secrétaire générale adjointe
Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) - Union nationale des syndicats autonomes (UNSa) - Justice
M. Luciano Ducceschi, secrétaire général adjoint
M. Simon-Pierre Lagouche, secrétaire national, référent de la filière insertion probation
Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire - Fédération syndicale unitaire (SNEPAP-FSU)
Mme Annabelle Bouchet, secrétaire générale adjointe
Mme Maïté Galopin, membre du bureau national
Table ronde des syndicats des magistrats
Union syndicale des magistrats (USM)
M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint
Mme Rachel Beck, secrétaire nationale
Unité magistrats
Mme Valérie Dervieux, déléguée générale
Mme Delphine Blot, déléguée générale adjointe
Table ronde des syndicats de directeurs pénitentiaires
Syndicat national pénitentiaire (SNP) - Force ouvrière Direction
M. Ivan Gombert, secrétaire national
Union nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (UNDPIP-CFE-CGC)
Mme Laura Soudre, secrétaire générale
Syndicat national des directeurs pénitentiaires - Confédération française démocratique du travail (SNDP-CFDT)
M. Jean-François Fogliarino, secrétaire général
Mme Bérangère Cusanno, secrétaire générale adjointe
Conférence nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation (CNDPIP)
M. Sébastien Dumont, président
Mme Delphine Deneubourg, secrétaire nationale
Table ronde des syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse
Confédération générale du travail - Protection judiciaire de la jeunesse (CGT-PJJ)
Mme Aurélie Posadzki, représentante
M. Jili Biet, représentant
Force ouvrière - Protection judiciaire de la jeunesse (FO-PJJ)
Mme Soraya Mehdaoui, représentante
Table ronde d'associations du secteur habilité
Citoyens et justice - Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss)
Mme Sophie Diehl, responsable du pôle justice des enfants et des adolescents
Mme Florence Laufer, directrice de Prison Insider
Convention nationale des associations de protection de l'enfance (CNAPE)
Mme Marlène Viallet, responsable justice des mineurs
Association Jean Cotxet
M. Patrick Beau, président
Groupe SOS
M. Philippe Caumartin, directeur général adjoint secteur jeunesse, délégué à la justice pénale des mineurs
M. Geoffroy Kaczmarek, chargé de mission pénal
Table ronde des associations
intervenant auprès des personnes placées sous main de
justice
Association Aurore
M. Florian Guyot, directeur général
Association permis de construire
M. Ludovic Dardenne, directeur
M. Pierre Rouille-Patrier, responsable de la communication et du plaidoyer
Association Groupe pour l'Emploi des Probationnaires (GREP)
M. Bertrand Mortamet, directeur
Table ronde sur la thématique « outre-mer »
M. Ghislain Roussel, directeur par intérim du centre pénitentiaire de Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Mme Carmellita Dijoux, substitut du procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion
Mme Laure Camus, présidente du Tribunal de première instance de Papeete
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Mme Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté
Mme Maria de Castro Cavalli, adjointe à la directrice des affaires juridiques
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
M. Serge Procédès, chef du bureau de la délinquance générale
Mme Julie Bernier, conseiller du directeur général de la gendarmerie nationale
Direction générale de la police nationale (DGPN)
Mme Séraphia Scherrer, sous-directrice adjointe en charge de la stratégie et du pilotage territorial
Mme Estelle Davet, conseillère au cabinet du directeur général de la police nationale
Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)
Mme Émilie Rayneau, présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel (CNPP)
M. Jean-François Beynel, premier président de la cour d'appel de Versailles
Mme Isabelle Gorce, première présidente de la cour d'appel de Bordeaux
Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP)
Mme Céline Bertetto, présidente
Mme Cécile Delazzari, secrétaire générale
Conférence nationale des procureurs généraux de cour d'appel (CNPG)
M. Christophe Barret, procureur général de Grenoble
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
M. Arnaud Faugere, procureur de Fontainebleau
Mme Céline Visiedo, procureure de Bourges
Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)
Mme Muriel Eglin, vice-présidente
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Amélie Morineau, présidente de la commission libertés et droit de l'Homme
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Observatoire international des prisons - Section française (OIP-SF)
M. Jean-Claude Mas, directeur
Direction de l'administration pénitentiaire (DAP)
M. Emmanuel Razous, directeur adjoint
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Mme Sophie Maquart-Moulin, directrice adjointe
Mme Cécile Gressier, sous-directrice de la justice pénale générale
Mme Camille Digneau, adjointe au chef de département des parcours de peine
Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes
Mme Rachel Collin, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes
Mme Mathilde Zunino, directrice de détention, responsable de la structure d'accompagnement vers la sortie
Mme Elodie Triplet, directrice de détention
M. Cyrille Capponi, responsable du greffe de l'établissement
M. Jean-François Desire, adjoint à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes
Mme Carole Chevalier, directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône
M. Gauthier Schont, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, chef de l'antenne locale d'insertion et de probation d'Aix-Salon
Mme Claire Loez, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, en charge de la structure d'accompagnement vers la sortie et du quartier de semi-liberté
Centre pénitentiaire de Marseille - Les Baumettes
M. Jean-Marie Landais, directeur du centre pénitentiaire de Marseille - Les Baumettes
Mme Manon Faber, directrice responsable de la structure d'accompagnement vers la sortie
Mme Claire Bousquet, directrice responsable du travail et de la formation professionnelle
Mme Carole Chevalier, directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Syndicat de la magistrature
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Mme Anne Ponseille, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Montpellier
Mme Virginie Peltier, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de Bordeaux
Préfecture de police de Paris - Direction de la police judiciaire - Brigade de l'exécution des décisions de justice
M. Maurice Berger, psychanalyste
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES EN DÉPLACEMENT
LUNDI 5 MAI 2025
Maison centrale de Poissy
Mme Isabelle Brizard, chef d'établissement et directrice
Mme Alexandrine Borgeaud, directrice du SPIP des Yvelines
Mme Melanie Flament, cheffe d'antenne du SPIP des Yvelines
LUNDI 26 MAI 2025
Ambassade de France aux Pays-Bas
M. François Alabrune, ambassadeur de France aux Pays-Bas
Mme Isabelle Noret, conseillère politique
Mme Marie Regnier-Pellat, magistrate de liaison aux Pays-Bas
MARDI 27 MAI 2025
Ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas
Mme Maryse Groen, directrice-adjointe du département de l'Union européenne
M. Toon Molleman, directeur adjoint de la division de l'administration pénitentiaire
Mme Carolina van der Veen, conseillère en gestion stratégique
Mme Anna Linmans, coordinatrice, direction générale des sanctions et de la protection
M. Mark Verstappen, coordinateur, direction générale des sanctions et de la protection
Mme Regien van Uden, direction générale des sanctions et de la protection
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES |
||||
|
Garantir une meilleure adéquation entre les
peines encourues, les peines prononcées |
||||
|
1 |
Rapprocher le prononcé des peines de leur exécution effective en limitant les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge correctionnel. |
Parlement |
2025-2026 |
Loi |
|
2 |
Supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et les rendre possibles pour le juge du fond, sur la base d'une enquête sociale étayée, pour toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à deux ans. |
Parlement |
2025-2026 |
Loi |
|
3 |
Évaluer les causes d'écart entre le quantum encouru et le quantum prononcé, afin de renforcer la crédibilité de la sanction. |
Ministère de la justice Parlement |
2026 |
Rapport |
|
Réintroduire les très courtes peines, leviers d'efficacité de la réponse pénale |
||||
|
4 |
Rétablir la possibilité, pour le juge du fond, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, ces très courtes peines étant destinées aux condamnés bien insérés et non encore ancrés dans la délinquance, mineurs comme majeurs, et exécutées dans des établissements spécialisés. |
Parlement |
2025-2026 |
Loi Administration pénitentiaire |
|
Promouvoir une individualisation des peines plus effective |
||||
|
5 |
Assurer l'adéquation entre l'établissement d'incarcération et la personnalité des personnes détenues pour favoriser leur réinsertion en sortie de peine. |
Ministère de la justice |
Immédiat |
Organisation administrative |
|
6 |
Favoriser la meilleure individualisation de la peine et de son exécution en acquérant une meilleure connaissance de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle, grâce au renforcement du rôle des SPIP en phase pré-sentencielle. |
Ministère de la justice Parlement |
2025-2026 |
Loi et décret Organisation administrative |
|
7 |
Clarifier les rôles respectifs du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
Ministère de la justice Parlement |
2025-2026 |
Loi et décret |
|
REPLACER LA RÉINSERTION AU COEUR DE LA PEINE |
||||
|
Donner à l'incarcération une finalité constructive |
||||
|
8 |
Accroître les moyens humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation afin de réduire le nombre de personnes suivies par conseiller et d'assurer un accompagnement social et professionnel adapté. |
Ministère de la justice Parlement |
2026 |
Loi de finances |
|
9 |
Unifier la doctrine d'intervention des associations d'accompagnement social en détention afin de réduire les disparités territoriales constatées par la mission. |
Ministère de la justice Associations habilitées |
2026 |
Organisation administrative |
|
10 |
Assurer un accès effectif à la santé en détention en : - développant les partenariats avec les hôpitaux pour des interventions, dans la mesure du possible, au sein des établissements pénitentiaires pour la médecine spécialisée ; - fixant les effectifs des unités sanitaires non pas selon le nombre théorique de places, mais selon la moyenne d'occupation des cinq dernières années ; - garantissant la prise en charge de la santé mentale et des troubles addictifs, avec la présence permanente de professionnels dédiés auprès des détenus et de l'administration pénitentiaire. |
Ministère de la justice Ministère en charge de la santé et de l'accès aux soins |
2026 |
Organisation administrative |
|
Donner un véritable contenu aux peines alternatives |
||||
|
11 |
Redonner une véritable consistance à la détention à domicile sous surveillance électronique et, à défaut, ne plus la privilégier comme aménagement ab initio. |
Ministère de la justice |
2025-2026 |
Organisation administrative |
|
JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE |
||||
|
Créer une véritable peine de probation |
||||
|
12 |
Créer une peine autonome de probation. |
Parlement |
2025-2026 |
Loi |
|
Faire enfin de la peine de prison ferme une sanction efficace et dissuasive |
||||
|
13 |
Mener à bien le « plan 15 000 », en s'interdisant tout nouveau retard et en tenant compte de la nécessaire diversification des établissements en fonction des profils des détenus. |
Ministère de la justice |
Immédiat |
Organisation administrative |
|
Ne plus utiliser la fin de peine comme un levier de régulation carcérale |
||||
|
14 |
Mettre fin à la libération sous contrainte de plein droit pour privilégier des mécanismes individuels, tenant compte des efforts accomplis par le condamné pendant sa détention. En contrepartie, faciliter les aménagements, conversions, placements en semi-liberté en fin de peine par les JAP, ainsi que l'octroi des réductions de peine, sur une base individuelle. |
Parlement |
2025-2026 |
Loi |
|
Se donner les moyens d'un diagnostic objectif de
l'état du milieu fermé |
||||
|
15 |
Garantir la pleine information du Parlement et du grand public sur l'occupation des prisons, les causes de son évolution et l'effet de l'emprisonnement sur le parcours pénal des condamnés. |
Ministère de la justice |
2026 |
Rapport |
|
ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE |
||||
|
Accélérer l'exécution de la peine
en favorisant la présence du prévenu |
||||
|
16 |
Généraliser le mécanisme de rappel des convocations devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'étendre dès que possible au stade pré-sentenciel. |
Ministère de la justice Parlement |
2025-2026 |
Loi, décret et organisation administrative |
|
Donner confiance dans les peines alternatives à
l'emprisonnement |
||||
|
17 |
Créer une police de la probation ou spécialiser certains agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur le contrôle des mesures de probation. |
Ministère de la justice |
2025-2026 |
Loi, décret et organisation administrative |
|
GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES CONDAMNÉS MINEURS |
||||
|
Construire pour les mineurs condamnés un parcours éducatif et responsabilisant |
||||
|
18 |
Développer les possibilités de placement hors centre éducatif fermé (CEF) et recentrer ces derniers sur le placement des mineurs ancrés dans la délinquance. |
Ministère de la justice Parlement |
2026 |
Loi |
|
19 |
Garantir une durée de placement en CEF de six mois au moins, en élargissant le recours à ces centres en fin de peine de prison, voire en envisageant une extension de leur utilisation en tant que sanction ou comme équivalent de semi-liberté. |
Ministère de la justice Parlement |
2026 |
Loi et organisation administrative |
|
Rééquilibrer les moyens entre les structures de milieu fermé |
||||
|
20 |
Opérer un rééquilibrage entre quartiers « mineurs » et établissements pour mineurs, fondé sur une évaluation précise de leur fonctionnement actuel. |
Ministère de la justice |
2026 |
Redéploiement à moyens constants |
ANNEXE 1
LÉGISLATION COMPARÉE
NOTE SUR
L'EXÉCUTION DES PEINES
2025
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
L'EXÉCUTION DES PEINES
_____
Canada (Québec) - Espagne - Italie - Pays-Bas
_____
Cette note a été réalisée en
juin 2025 à la demande
de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
SOMMAIRE
2. Canada et province du Québec 217
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 217
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 217
(a) La libération d'office 218
(b) La liberté conditionnelle 218
(d) La permission de sortir 220
(2) Les autorités compétentes 221
(a) La libération d'office 222
(b) La libération conditionnelle 222
(d) La permission de sortir 222
(3) Les statistiques disponibles en matière d'aménagements de peines 223
(a) Statistiques générales 223
(b) Libération conditionnelle 223
b) Les alternatives à l'emprisonnement 224
(2) Les travaux compensatoires 225
(3) Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + 225
c) Le recours à la justice restaurative 226
(a) La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 227
(b) Les programmes de réinsertion 228
(c) Le programme de mesures de rechange général 228
(d) Les organismes indépendants spécialisés 229
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 230
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 230
(a) La suspension de l'exécution de la peine (articles 80 à 87 du code pénal) 231
(b) La liberté conditionnelle (articles 90 à 92 du code pénal) 232
(c) Les permissions de sortie (articles 47 et 48 de la loi organique générale pénitentiaire) 234
(2) Les autorités compétentes 234
(3) Les données statistiques 236
b) Les alternatives à l'emprisonnement 237
(1) Le régime carcéral du troisième degré, dit régime « ouvert » (articles 80 à 88 du règlement pénitentiaire) 237
(2) Le travail d'intérêt général (article 49 du code pénal) 238
(3) La peine d'assignation à résidence (article 37 du code pénal) 239
(4) La liberté surveillée (article 106 du code pénal) 240
c) Le recours à la justice restaurative 241
(1) Principes, objectifs et cadre juridique 241
(2) Acteurs et modalités de mise en oeuvre 242
(3) Typologie des délits et volume d'activité 242
(4) Effets, bénéfices et limites des processus restauratifs 243
(5) Perspectives d'évolution et recommandations institutionnelles 243
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 245
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier 245
(a) Les permissions de sortie à titre de récompense (articles 30-ter et 30-quater) 246
(b) Le placement à l'épreuve auprès des services sociaux (article 47) 246
(c) La détention à domicile (article 47-ter) 247
(d) La semi-liberté (article 48) 249
(e) La libération anticipée (article 54) 249
(f) La suspension du procès avec mise à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de procédure pénale) 250
(2) Les autorités compétentes 250
(3) Les données statistiques 252
b) Les alternatives à l'emprisonnement 253
(1) Un nouveau régime de peines substitutives prononcées ab initio 253
(2) Une réforme conçue pour faire face à la crise de l'exécution pénale 253
(3) Les limites du dispositif et les perspectives d'amélioration 254
c) Le recours à la justice restaurative 255
(1) Contexte et origine de la réforme 255
(2) Esprit et contenu du décret de 2022 255
(3) Principales dispositions et modalités de fonctionnement de la justice restaurative 256
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme 260
(1) Les différentes formes d'aménagement de peine 260
(2) Les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine 263
(a) La libération conditionnelle 263
(b) La permission de réinsertion 265
(c) La permission de capacité sous surveillance électronique 267
(d) La détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire 268
(3) Les autorités compétentes 269
(a) La libération conditionnelle 270
(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire 270
(4) Les données statistiques 271
b) Les alternatives à l'emprisonnement 273
(2) Le travail d'intérêt général 273
(3) Les peines avec sursis 274
(4) Les critiques relatives aux courtes peines d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances pénales 275
c) Le recours à la justice restaurative 277
(1) La médiation restaurative 278
(3) Les mesures de médiation et de réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt) 280
(4) L'évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale 280
À la demande de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, la division de la Législation comparée a réalisé une étude sur les dispositifs permettant d'adapter l'exécution des peines privatives de liberté, de développer des alternatives à l'incarcération et de promouvoir la justice restaurative dans quatre pays : le Canada (Québec), l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme témoignent, dans les quatre pays étudiés, d'une volonté partagée de favoriser une exécution individualisée, modulée dans le temps, tenant compte à la fois de la gravité de l'infraction, de la personnalité du condamné et de sa capacité de réinsertion. Tous les pays étudiés prévoient ainsi une libération conditionnelle fondée sur l'exécution préalable d'une fraction de la peine avec des modalités d'accès qui varient selon les systèmes. Parallèlement, tous les systèmes recourent à des permissions de sortie, encadrées dans leur durée et leurs motifs, souvent mobilisées à l'approche de la libération. L'existence de régimes de semi-liberté administrés par l'administration pénitentiaire est également commune, avec des variations notables.
Les alternatives à l'emprisonnement prennent des formes diversifiées, mais relèvent d'une logique partagée de responsabilisation du condamné, de préservation des liens sociaux et de lutte contre la récidive. Dans tous les cas, les services de probation assurent le suivi des mesures et peuvent intervenir en cas de manquement. Le bracelet électronique est couramment utilisé pour encadrer certaines permissions, en particulier aux Pays-Bas et en Espagne.
Enfin, le recours à la justice restaurative s'est renforcé dans les quatre pays, également à des degrés variables. Généralement, la confidentialité, le volontariat, et l'implication active des parties constituent des principes communs, bien que les effets juridiques sur la peine demeurent hétérogènes.
1. 1. Tableau de synthèse
|
Canada (Québec) |
Espagne |
Italie |
Pays-Bas |
|
|
Seuil d'accès à la libération conditionnelle |
Du tiers à la moitié de la peine (fédéral), un tiers à la moitié selon durée (Québec) |
Trois quarts de la peine, classement en 3e degré requis |
De la moitié aux deux tiers de la peine (selon gravité), 20 ans pour perpétuité |
Aux deux tiers de la peine et pour une durée maximale de 2 ans, |
|
Libération d'office automatique |
Oui, automatique aux deux tiers de la peine (sauf perpétuité) |
Non, mais libération conditionnelle accessible sous conditions |
Non, uniquement sur décision de l'autorité judiciaire |
Non, fin de l'automaticité depuis 2021. Décision du ministère public |
|
Permissions de sortie |
Oui, maximum 60 jours, motifs médicaux, familiaux ou réinsertion |
Oui, maximum 7 jours, jusqu'à 48 jours/an, après un quart de la peine |
Oui, jusqu'à 15 jours consécutifs, maximum 45 jours/an |
Oui, permissions de courte ou longue durée, liées au plan de réinsertion |
|
Régime de semi-liberté ou ouvert |
Oui, semi-liberté avec retour en établissement, 6 mois maximum |
Oui, régime ouvert pour détenus en 3e degré, encadré par l'administration |
Oui, semi-liberté pour travail ou formation, nuit en établissement |
Oui, via unités BBA (semi-liberté), sous conditions strictes |
|
Détention à domicile |
Oui, pour peines = 90 jours (fins de semaine), ou domicile |
Oui, assignation à résidence ou semi-liberté, selon le type d'aménagement |
Oui, pour peines = 18 mois ou publics vulnérables (parents, malades...) |
Oui, dans cadre du programme pénitentiaire ou de la permission de capacité (jusque fin 2025). |
|
Suspension |
Oui, pour peines < 2 ans, sauf infractions graves |
Oui, pour peines = 2 ans ; étendue jusqu'à 5 ans en cas de toxicomanie |
Oui, possible mise à l'épreuve ou peine substitutive au jugement |
Non (ou marginal), suspension ab initio non centrale dans le dispositif |
|
Peines substitutives ab initio |
Non prononcées au jugement, mais travaux d'intérêt général (TIG) possibles dans le cadre d'une mise à l'épreuve |
Oui, un TIG peut être la peine principale ou condition de suspension |
Oui, depuis la réforme de 2022 (jusqu'à 4 ans de prison) |
Oui, TIG ou amende substitutive prononcés dès le jugement ou via ordonnance pénale |
|
Usage du bracelet électronique |
Oui, possible pour certaines permissions ou peines avec sursis |
Oui, en assignation ou liberté surveillée |
Oui, notamment en détention à domicile ou en semi-liberté |
Oui, très développé (3 500 bracelets posés en 2024) |
|
Cadre juridique de justice restaurative |
Oui, cadre légal aux niveaux fédéral et au Québec |
Oui, loi organique encadrant la médiation restaurative |
Oui, décret législatif encadrant la justice restaurative |
Oui, code de procédure pénale et lignes directrices juridiquement non contraignantes |
|
Effets de l'accord restauratif sur la peine |
Oui, prise en compte possible dans les décisions judiciaires (réduction ou classement) |
Oui, possible classement ou réduction de peine selon accord restauratif |
Oui, effet possible sur atténuation de peine ou mesures de faveur |
Oui, le juge ou procureur tient compte de l'accord dans la décision finale |
1. 2. Canada et province du Québec
Au Canada, les peines d'emprisonnement relèvent à la fois du droit fédéral et du droit provincial. L'aménagement de peine peut prendre plusieurs formes : libération d'office, liberté conditionnelle, peine discontinue et « permission de sortir ». La libération d'office intervient aux deux tiers de la peine et impose des obligations strictes. La liberté conditionnelle, totale ou en semi-liberté, au niveau fédéral, permet une sortie surveillée après un temps de mise à l'épreuve variable. Au Québec, une seule forme est prévue, pour les peines d'au moins six mois, selon des délais différenciés. La peine discontinue s'applique aux peines de 90 jours ou moins, souvent durant les fins de semaine. Les permissions de sortir, encadrées par des textes fédéraux et provinciaux, sont possibles pour motifs médicaux, humanitaires ou de réinsertion.
Plusieurs mécanismes permettent d'éviter l'emprisonnement, notamment pour les peines courtes ou les publics vulnérables. Le sursis permet de purger une peine de moins de deux ans dans la collectivité sous condition, sauf pour les peines minimales obligatoires ou les peines maximales de dix ans, quatorze ans ou à perpétuité. Au Québec, le programme de travaux compensatoires (PTC) s'adresse aux personnes insolvables ne pouvant payer leurs amendes. Il s'agit d'une alternative à l'incarcération, distincte des travaux communautaires, encadrée par le ministère de la Justice. Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + s'adresse aux accusés majeurs présentant des troubles mentaux ou cognitifs. Après évaluation, un plan d'intervention de 12 à 18 mois est mis en place.
La justice restaurative canadienne favorise la communication entre victimes, délinquants et communauté afin de réparer les torts causés. Au niveau fédéral, le Service correctionnel du Canada promeut la médiation entre victime et délinquant ou l'organisation de conférences incluant les parties concernées. La loi sur le système correctionnel du Québec institue des fonds de soutien à la réinsertion sociale dans chaque établissement de détention. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des comités de justice pour la jeunesse. Des programmes permettent des échanges entre victimes et délinquants ou proposent des alternatives aux procédures judiciaires.
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
Au Canada, le régime des peines dépend aussi bien du droit fédéral que du droit provincial. Selon le type de peine, peuvent s'appliquer soit des dispositions fédérales (principalement issues du code criminel), soit des dispositions provinciales (issues notamment du code de procédure pénale du Québec238(*)). De façon générale, les peines de moins de deux ans d'emprisonnement sont purgées dans les établissements de détention provinciaux, tandis que les peines d'emprisonnement supérieures à deux ans sont généralement purgées dans un pénitencier fédéral239(*).
Des aménagements de peines sont prévus par les textes fédéraux et provinciaux. Ils permettent aux délinquants de purger leur peine en dehors de l'établissement de détention. Les principaux types d'aménagement sont la libération d'office, la libération conditionnelle, la peine discontinue et la permission de sortir.
(a) La libération d'office
Les dispositions relatives à la libération d'office sont encadrées par la loi fédérale sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC)240(*).
Le texte prévoit que les délinquants condamnés par une cour fédérale à une peine d'emprisonnement sont mis en liberté sous surveillance une fois que deux tiers de la peine ont été purgés241(*) et demeurent en liberté jusqu'à l'expiration légale de la peine (à l'exception des détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité).
Un délinquant qui bénéficie de la libération d'office doit respecter des conditions énoncées par l'article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition242(*). Il doit notamment se rendre directement à sa résidence et se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle (a), rester au Canada (b) et porter sur lui son certificat de mise en liberté (e). En outre, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) peut imposer de nouvelles conditions, comme par exemple l'interdiction de consommer de l'alcool243(*). Un non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension de la liberté et la réincarcération. Le cas échéant, le Service correctionnel du Canada réexamine le cas et détermine si le délinquant peut être maintenu en liberté d'office sous surveillance.
(b) La liberté conditionnelle
(i) Au niveau fédéral
La liberté conditionnelle est une mise en liberté sous condition permettant aux délinquants de purger leur peine dans la collectivité, sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC). Ce mode de libération graduelle et contrôlée permet une réinsertion progressive du délinquant dans la société.
La LSCMLC prévoit deux types de liberté conditionnelle : la libération conditionnelle totale et la semi-liberté.
· La libération conditionnelle totale
Prévue et encadrée par les articles 119 et suivants de LSCMLSC244(*), la libération conditionnelle totale permet au délinquant d'être mis en liberté sous surveillance pendant l'exécution de sa peine245(*).
Pour être admissible, le délinquant doit d'abord purger un temps d'épreuve correspondant à un tiers de la peine, dans la limite de sept ans (article 120(1)). Pour les peines de réclusion à perpétuité sans période minimale, ce délai est de sept ans, réduit du temps passé en détention avant la condamnation (article 120(2)). En cas de peines multiples imposées le même jour, le temps d'épreuve correspond à la somme des temps requis pour chaque partie de la peine (article 120.1(1)a)-b)). Pour les peines supplémentaires consécutives, le temps d'épreuve s'ajoute à celui déjà en cours (article 120.1(1)). Un plafond de quinze ans est fixé pour diverses configurations de peines (article 120.3).
Certains délinquants peuvent toutefois bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée : en phase terminale (article 121(1)a)), en cas de risque grave pour leur santé physique ou mentale (b)), de contrainte excessive imprévisible (c)) ou en cas d'extradition imminente (d)). Ces exceptions ne s'appliquent pas aux condamnés à perpétuité comme peine minimale, ni à ceux dont la peine de mort a été commuée ou qui purgent une peine indéterminée.
· La semi-liberté
La semi-liberté permet à un délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité, tout en réintégrant régulièrement un lieu de détention -- établissement résidentiel communautaire, pénitencier ou centre correctionnel -- selon des modalités fixées par décision administrative246(*). Elle vise à préparer la libération conditionnelle totale ou la libération d'office. La demande doit être formulée auprès de la CLCC. La mesure est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois après réexamen du dossier (article 122(5)). Le délinquant peut retirer sa demande dans les quatorze jours précédant son dépôt247(*).
L'admissibilité varie selon la nature de la peine. Elle intervient après un délai d'un an pour les peines de détention préventive prononcées avant octobre 1977, trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale pour les autres cas visés, six mois pour les peines de deux ans ou plus (hors exceptions), ou à la moitié de la peine pour les peines plus courtes (article 119(1)). Pour les mineurs, des règles particulières s'appliquent (article 119(1.2)).
(ii) Au Québec
Au Québec, la liberté conditionnelle constitue un mode d'exécution de la peine applicable aux personnes condamnées à une peine d'au moins six mois, régi par les articles 143 et suivants de la loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ)248(*). Contrairement au régime fédéral, la législation québécoise ne distingue pas liberté conditionnelle totale et semi-liberté. La durée de la mesure correspond au reliquat de la peine à purger, augmenté du temps de réduction de peine acquis (article 144).
L'admissibilité varie selon la nature et la durée de la peine (article 145) : après sept ans pour les peines à perpétuité comme peine maximale, après la moitié de la peine pour les peines de plus de deux ans, et après le tiers pour les autres cas. Des exceptions sont prévues pour les personnes gravement malades, soumises à des contraintes excessives ou visées par un arrêté d'extradition (article 149). Avant de statuer, l'autorité compétente prend en compte divers éléments (article 155) : niveau de risque pour la société, gravité de l'infraction, degré de responsabilisation, antécédents judiciaires, personnalité, ressources sociales et qualité du projet de réinsertion.
(c) La peine discontinue
La peine discontinue permet de purger un emprisonnement de 90 jours ou moins selon un régime aménagé, souvent en fin de semaine, afin de favoriser le maintien des liens familiaux, professionnels ou sociaux249(*). Elle est assortie d'une ordonnance de probation encadrant les modalités de cette liberté partielle. Le délinquant peut solliciter à tout moment auprès du tribunal l'autorisation de convertir cette peine en un emprisonnement continu (article 732(2) du code criminel)250(*).
Pour être admissible, la peine prononcée ne doit pas excéder 90 jours (article 732(1)). Avant d'accorder ce régime, le tribunal évalue l'âge et la réputation du délinquant, la nature et les circonstances de l'infraction, ainsi que la disponibilité d'un établissement adapté.
(d) La permission de sortir
(i) Au niveau fédéral
Les articles 7 et suivants de la loi sur les prisons et les maisons de correction (LPMC) permettent aux détenus d'obtenir une permission de sortir temporairement afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale251(*). Cette permission est accordée pour une durée maximale de soixante jours, renouvelable après réexamen du dossier (article 7.4(1)), sauf pour les sorties pour raisons médicales, dont la durée peut être indéterminée (article 7.4(2)). Les motifs d'octroi, définis à l'article 7.3(1), incluent des raisons médicales, humanitaires ou liées à la réinsertion. La permission peut aussi être accordée pour des motifs prévus par une loi provinciale, s'ils respectent les principes de la LPMC. Les conditions d'admissibilité relèvent du droit provincial (article 7.3(2)).
(ii) Au Québec
Au Québec, la LSCQ252(*) comporte également des dispositions sur la permission de sortir. Elle précise notamment les dispositions de la loi fédérale quant aux motifs de la sortie (article 42), les autorités compétentes ainsi que certaines modalités.
Les permissions de sortir peuvent être accordées à des fins médicales (article 42 et suivants), des fins de participation aux activités d'un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités spirituelles (article 45), à des fins humanitaires comme une naissance, un baptême ou un mariage de son enfant (article 49 et suivants), ou encore à des fins de réinsertion sociale (article 53 et suivants).
La permission de sortir préparatoire à la liberté conditionnelle peut être accordée après que la personne contrevenante ait purgé au moins un sixième de sa peine d'emprisonnement. Sa durée maximale est de 60 jours253(*), comme au niveau fédéral.
(2) Les autorités compétentes
Au niveau fédéral, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)254(*) est l'organisme compétent pour la plupart des règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme, en particulier pour décider d'un aménagement à la demande des détenus.
Le Québec, à l'instar d'autres
provinces, a son propre organisme dédié, la Commission
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). En
vertu de l'article 112(1) de la LSCMLSC255(*), les commissions
provinciales ont compétence en matière de libération
conditionnelle des condamnés purgeant une peine d'emprisonnement dans un
établissement correctionnel provincial,
à l'exception de ceux condamnés à l'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, ou qui ont bénéficié d'une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité, ou qui purgent une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée.
(a) La libération d'office
S'agissant de la libération d'office, l'autorité de référence est le Service correctionnel du Canada (SCC), qui agit comme « gardien » des délinquants en liberté d'office. À ce titre, c'est le SCC qui ordonne la liberté d'office. C'est également à lui que les condamnés doivent se présenter régulièrement durant la période de libération.
La CLCC peut également intervenir, à la demande du SCC, notamment pour les cas particuliers dans lesquels des conditions spéciales doivent être mises en place256(*), pour annuler une suspension de la liberté ordonnée par le SCC, pour révoquer la libération d'office et dans certaines circonstances, pour ordonner que le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu'à la fin de sa peine.257(*)
(b) La libération conditionnelle
Au niveau fédéral, l'autorité compétente est la CLCC.
Au Québec, les services correctionnels du Québec sont compétents pour accorder la liberté conditionnelle, et plus précisément, la CQLC prend la décision de remettre en liberté sous conditions les personnes purgeant une peine entre six mois et deux ans moins un jour (article 119 LSCQ258(*)).
(c) La peine discontinue
Le tribunal ayant prononcé la peine est l'autorité compétente pour organiser la peine discontinue.
(d) La permission de sortir
Au niveau fédéral, le lieutenant-gouverneur est responsable de la désignation, pour sa province, des personnes ou organismes responsables de l'octroi des permissions de sortir (article 7.2(1) de la loi sur les prisons et les maisons de correction). L'autorité désignée comme compétente peut suspendre, annuler ou révoquer la permission de sortir si une de ces mesures paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d'une des conditions ou pour empêcher une telle violation (article 7.5(a) LPMC), ou encore si les motifs de la décision d'accorder la permission ont changé ou n'existent plus, ou enfin si le dossier a été réexaminé à la lumière de nouveaux éléments.
Au Québec, le directeur de l'établissement de détention est compétent pour octroyer une décision de sortie à un délinquant, par une décision écrite et motivée suivant la réception d'une recommandation non contraignante (article 62 LSCQ) d'un comité d'étude des demandes de sortie (article 64 LSCQ). Ce comité est composé de trois membres désignés par le directeur (article 58 LSCQ). Les permissions de sortir (sauf celles à des fins médicales, celles préparatoires et celles pour visites à la famille), doivent être précédées d'une recommandation de ce comité (article 59 LSCQ).
(3) Les statistiques disponibles en matière d'aménagements de peines
(a) Statistiques générales
Selon les statistiques publiées par le gouvernement du Canada, 12 136 personnes ont été incarcérées en 2020-2021. Parmi elles, 9 875 personnes sous responsabilité fédérale sont en liberté sous condition, dont 2 245 au Québec259(*).
(b) Libération conditionnelle
Selon les données publiées par le gouvernement du Canada :
- le taux d'octroi de libération conditionnelle totale de ressort fédéral est de 33 % des demandes et le taux d'octroi de semi-liberté de ressort fédéral est de 71 % ;
- le taux d'achèvement des périodes de mises en liberté sous condition de délinquants sous responsabilité fédérale est de 93 % pour les régimes de semi-liberté, et 88 % pour les régimes de liberté conditionnelle ;
- 93 % des délinquants à qui la CLCC a accordé la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale n'ont pas commis d'infraction pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle260(*) ;
- 99 % des condamnés n'ont pas commis d'infraction avec violence durant leur période de liberté conditionnelle261(*) ;
- le taux de récidive en libération conditionnelle en 2017-2018 était de 1,68 %262(*).
(c) La peine discontinue
Selon les données du gouvernement du Québec relatif au profil des personnes condamnées à une peine discontinue durant l'année 2022-2023263(*) :
- au total, 2 254 personnes ont séjourné en établissements de détention à la suite d'une peine discontinue, soit une baisse de 40 % par rapport à la période 2018-2019264(*) ;
- 89 % des personnes concernées sont des hommes ;
- la moyenne d'âge des prévenus est de 38 ans. 10,2 % se situent dans la tranche 18 à 24 ans, 70,4 % dans la tranche 25 à 49 ans et enfin, 19,4 % se situent dans la tranche 50 ans et plus265(*) ;
- 60,3 % des personnes ont des antécédents judiciaires, soit une hausse de 20 % environ266(*) sur la période considérée.
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Outre les aménagements de peine applicables durant l'incarcération, les législations fédérale et québécoise prévoient plusieurs mécanismes permettant d'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté, en particulier pour les peines courtes ou les publics vulnérables.
(1) Le sursis
Conformément aux articles 742 et suivants du code criminel267(*), le droit fédéral permet au tribunal, sous certaines conditions, de condamner une personne à purger dans la collectivité une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans (emprisonnement avec sursis). Le sursis est exclu pour diverses infractions graves (tentative de meurtre, torture, génocide, terrorisme ou infractions d'organisation criminelle punies de dix ans ou plus). Le tribunal doit s'assurer que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et respecte les objectifs de la peine. Avant d'octroyer le sursis, il vérifie l'applicabilité d'interdictions relatives aux armes à feu. L'ordonnance de sursis comporte des conditions obligatoires : bonne conduite, comparution aux convocations, présence auprès de l'agent de surveillance, maintien de résidence dans le ressort du tribunal, information sur les changements personnels. Elle peut aussi comprendre des conditions facultatives : abstention de drogues ou d'alcool, contrôle par prélèvements de substances corporelles, interdictions de contacts ou de lieux, interdiction d'armes, obligations familiales, service communautaire, suivi de traitements, autres conditions jugées nécessaires.
(2) Les travaux compensatoires
Au Québec, il existe un programme de travaux compensatoires (PTC). Celui-ci constitue « une mesure légale, substitutive à l'incarcération, qui s'adresse principalement aux personnes démunies financièrement et incapables d'acquitter une dette judiciaire issue d'une ou plusieurs amendes reçues pour une ou plusieurs infractions à une loi ou à un règlement provincial ou municipal, au Code criminel et à toute autre loi fédérale »268(*).
Les travaux compensatoires ne sont pas des travaux communautaires (travaux d'intérêt général). Le site du gouvernement du Québec indique que « Le programme de travaux compensatoires, offert par un percepteur des amendes, est sous la responsabilité du ministère de la Justice, alors que les heures de service communautaire, imposées par un juge, sont plutôt sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique »269(*).
Pour y être éligible, le défendeur doit être dans l'impossibilité de payer l'amende imposée par la cour dans le cadre de son incrimination dans le délai prévu par le code de procédure pénale (30 jours, suivi de délais additionnels, de possibilité de paiements différés et de saisies). Le défendeur peut accepter ou refuser l'offre d'effectuer des travaux compensatoires par un percepteur d'amendes. Le nombre d'heures de travail compensatoire à effectuer est déterminé par une table d'équivalence annexée au code de procédure pénale québécois270(*).
(3) Le programme d'accompagnement justice et santé mentale +
Le programme d'accompagnement justice et santé mentale + (PAJ-SM+), en permettant à l'accusé d'éviter une peine de détention271(*), vise à « offrir un traitement judiciaire adapté à la réalité des accusé(e)s qui présentent des vulnérabilités, notamment sur le plan mental ou cognitif. Cette réponse du système judiciaire se traduit par un suivi global de l'accusé(e) afin d'élaborer un plan d'intervention qui permettra de favoriser sa réinsertion sociale et de réduire ou éviter les risques de récidive tout en contribuant à la protection des personnes plaignantes, des victimes et de la société »272(*).
Pour être admissible au programme, la personne accusée, âgée d'au moins 18 ans273(*), doit présenter un trouble de santé mentale, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble lié à l'utilisation de substances ou un trouble consécutif à un traumatisme crânien274(*). Elle doit en outre avoir commis une infraction admissible dans un district où le programme est implanté, se reconnaître responsable de l'acte, être volontaire, apte et pénalement responsable, capable d'acquérir de nouveaux savoir-faire, et renoncer à faire valoir ultérieurement que le temps consacré au programme aurait causé des délais judiciaires excessifs justifiant l'arrêt des procédures. Les infractions graves, telles que les crimes ayant entraîné la mort ou les infractions sexuelles contre des enfants, sont exclues du dispositif275(*).
Après référencement par un intervenant, évaluation par le procureur et test clinique d'admissibilité276(*), la personne accusée intégrée au PAJ-SM+ suit un plan d'intervention de 12 à 18 mois277(*), dont l'issue peut conduire à une peine individualisée ou au rejet des accusations278(*). En 2020, 750 personnes en ont bénéficié, avec un taux de réussite de 80 %279(*).
c) Le recours à la justice restaurative
Selon les services correctionnels du Canada, la justice restaurative, aussi appelée « justice réparatrice », est une approche de la justice qui favorise la communication entre les victimes, les délinquants et la collectivité afin de réparer les torts causés par un crime. Elle met l'accent sur le rétablissement des victimes et la responsabilisation des délinquants280(*).
S'il existe différentes modalités de mise en oeuvre au niveau fédéral, le Québec dispose de programmes et de lois au niveau provincial qui lui sont propres.
(1) Au niveau fédéral
L'agence gouvernementale Service Correctionnel Canada présente les « valeurs » que suivent l'ensemble des procédures des différentes formes de justice réparatrice dans tout le pays, notamment la reconnaissance du préjudice causé, l'inclusion, la responsabilisation ou encore l'approche holistique281(*). L'agence met en avant deux modes d'application de la justice réparatrice :
- la mise en place d'une communication entre la victime et le délinquant par un médiateur qualifié et impartial afin de « se faire entendre, de poser des questions restées sans réponses et de répondre à ces questions, de s'occuper de besoins insatisfaits et, dans la mesure du possible, de tenter de réparer les torts causés ». Ces échanges peuvent conduire à des accords contenant des paramètres de sécurité et des ententes de restitution ou de réparation282(*) ;
- la mise en place d'une conférence faisant participer les principaux concernés, mais aussi d'autres personnes, comme des membres de la collectivité, touchées par l'infraction ou des représentants du domaine pénal concerné. Le but de cette conférence est de parvenir à un consensus en vue d'une réparation283(*).
L'article 76 de la LSCMLC prévoit que les services pénitentiaires doivent offrir une gamme de programmes pour contribuer à la réinsertion sociale des délinquants. Des programmes adaptés aux femmes doivent également être mis en place (article 77). Pour encourager la participation des délinquants à ces programmes, le commissaire du Service correctionnel du Canada (c'est-à-dire le chef de cette administration fédérale284(*)) peut autoriser leur rétribution (article 78).
(2) Au Québec
Au Québec, la justice restaurative ne vise que les personnes mineures, à travers sur un ensemble de dispositifs de natures diverses, visant à favoriser la réparation des torts causés par l'infraction, la réinsertion des personnes contrevenantes et la participation active des victimes et de la communauté.
(a) La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Celle-ci définit le cadre d'intervention judiciaire à suivre à l'égard des adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis une infraction au code criminel et à d'autres lois fédérales285(*). L'article 18 de la loi prévoit que le procureur général du Canada, d'une province ou toutes autorités compétentes puisse établir des « comités de citoyens » dits « comités de justice pour la jeunesse » chargés de prêter leur concours à l'exécution de la loi ainsi qu'à tout service ou programme pour l'adolescent286(*). Ces comités peuvent notamment « soutenir la victime de l'infraction reprochée à l'adolescent en s'informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l'adolescent »287(*).
(b) Les programmes de réinsertion
Au Québec, le programme « Possibilité de justice réparatrice » est en vigueur depuis 2005. Il s'agit d'une médiation entre une victime et un délinquant288(*). Le Service correctionnel du Canada (SCC) est en charge de ce programme qui donne aux personnes touchées par un crime la possibilité de communiquer avec le délinquant à l'origine du préjudice. Le programme prend des formes variées : rencontre entre les deux parties, échanges de lettres ou de messages vidéo ou autre.
(c) Le programme de mesures de rechange général
Le Programme de mesures de rechange général pour adultes de la Cour du Québec et des cours municipales (PMRG), entré en vigueur le 8 mai 2023, prévoit la possibilité de recourir à des mesures de rechanges plutôt qu'aux procédures judiciaires traditionnelles289(*). En vertu de l'article 716 du code criminel du Canada, une mesure de rechange est une mesure prise « à l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. »290(*). L'article 717 prévoit que de telles mesures doivent faire partie d'un programme de mesures de rechanges autorisé291(*).
À ce titre, il existe un « programme de mesures de rechange général » qui poursuit des objectifs de justice restaurative comme « l'implication des personnes victimes et lorsque possible, s'assurer qu'elles puissent obtenir plus facilement une juste réparation pour les dommages subis »292(*). Le programme exclut certaines infractions (paragraphe 4.2), telles que les infractions d'ordre sexuel, les infractions relatives aux armes à feu ou encore les infractions relatives au non-respect d'ordonnances judiciaires.
Si le programme est suivi jusqu'à son terme avec succès, le poursuivant peut demander au tribunal le rejet de l'accusation (paragraphe 5.1).
(d) Les organismes indépendants spécialisés
De nombreux organismes spéciaux spécialisés interviennent en matière de justice restaurative au Québec. Ils sont généralement des organismes à but non lucratif :
- le réseau Equijustice293(*) est une association provinciale à but non lucratif qui offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Il centralise les programmes existants et les informations sur le sujet ;
- le Centre de justice réparatrice de Québec294(*) est également un organisme à but non lucratif et a pour mission de « Promouvoir la compréhension de la justice réparatrice et mettre en oeuvre des programmes de justice réparatrice comme solution à des crises personnelles et sociétales, tout en offrant un soutien psycho-social » ;
- et le Centre de service de justice réparatrice295(*), également un organisme à but non lucratif, a pour mission de « Réparer la toile humaine grâce à des rencontres improbables, là où des liens de confiance ont été brisés ». Cette entité organise des rencontres et des évènements autour de la justice restaurative.
3. Espagne
En Espagne, l'aménagement des peines d'emprisonnement repose sur deux dispositifs principaux : la suspension ab initio et la liberté conditionnelle. La première s'applique aux peines n'excédant pas deux ans, sous conditions (primo-délinquance, indemnisation, absence de risque de récidive), et peut comporter des obligations comme des interdictions de contact ou des travaux d'intérêt général. Elle est modulable en cas de toxicomanie ou de pathologie grave. La liberté conditionnelle, accordée par le juge de surveillance, suppose l'exécution des trois quarts de la peine, une bonne conduite et un classement en troisième degré. La réforme de 2015 a unifié et assoupli ces régimes.
Des alternatives permettent aussi une exécution hors des murs. Le régime ouvert autorise une semi-liberté avec hébergement encadré ou surveillance électronique. Le travail d'intérêt général, soumis au consentement du condamné, consiste en des activités non rémunérées sous supervision des services compétents. L'assignation à résidence impose de rester dans un lieu défini, parfois avec contrôle électronique. La liberté surveillée, mesure postpénale, impose des obligations de suivi (présentations, traitements, interdictions).
La justice restaurative, reconnue en 2025, repose sur le volontariat, la confidentialité et la gratuité. Elle permet un dialogue encadré entre auteur et victime, pouvant conduire à un accord réparateur et, parfois, à un classement ou un allègement de la peine.
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
En Espagne, les principales formes d'aménagement des peines privatives de liberté sont la suspension de l'exécution de la peine (suspensión de la ejecución de la pena) et la liberté conditionnelle (libertad condicional). Ces deux régimes ont des fondements juridiques, des logiques temporelles et des conditions distincts. La suspension intervient ab initio, c'est-à-dire avant l'entrée effective en prison, tandis que la liberté conditionnelle suppose une exécution partielle préalable de la peine.
Le cadre juridique de ces mesures est le résultat d'une réforme substantielle qui s'est matérialisée dans la loi organique n°1/2015 du 30 mars 2015296(*), sous forme de refonte du code pénal. Cette réforme visait notamment à améliorer l'efficacité du système d'exécution des peines, en simplifiant les régimes antérieurs de suspension et de substitution, désormais intégrés dans un régime unique de suspension aux modalités multiples, plus flexible et cohérent. Elle a également redéfini le régime de la liberté conditionnelle en l'alignant davantage sur les règles applicables à la suspension, au point que la jurisprudence et la doctrine ont pu parfois critiquer une certaine confusion des régimes ou une « dénaturation » de la liberté conditionnelle dans sa fonction de dernier stade de l'exécution pénitentiaire297(*).
(a) La suspension de l'exécution de la peine (articles 80 à 87 du code pénal298(*))
L'article 80 du code pénal autorise le juge à suspendre l'exécution des peines privatives de liberté n'excédant pas deux ans, s'il estime que cette exécution n'est pas nécessaire pour prévenir la récidive (§1). Il doit apprécier les circonstances de l'infraction, les caractéristiques du condamné, ses antécédents, son comportement postérieur (notamment ses efforts de réparation), sa situation familiale et sociale, ainsi que les effets prévisibles de la suspension.
Trois conditions sont requises pour accorder la suspension (§2) : le condamné doit être primo-délinquant, certains antécédents étant exclus du calcul, la peine (ou le cumul des peines) ne doit pas dépasser deux ans (hors amendes impayées) et les responsabilités civiles et les confiscations prononcées doivent être satisfaites, ou un engagement de paiement dans un délai fixé par le juge doit être pris, assorti éventuellement de garanties.
À titre exceptionnel, le juge peut suspendre une peine de prison ne dépassant pas deux ans même si les deux premières conditions ne sont pas réunies, lorsque les circonstances du condamné, sa conduite et ses efforts de réparation le justifient (§3). La suspension est alors subordonnée à la réparation effective du dommage ou à l'exécution d'un accord, et à l'accomplissement d'au moins une mesure alternative.
Une suspension sans condition est prévue pour les condamnés atteints de maladies très graves et incurables (§4). En cas de délit lié à une toxicomanie, la suspension est possible jusqu'à cinq ans de peine, si le condamné est désintoxiqué ou en traitement (§5). Enfin, la victime doit être entendue dans les délits poursuivis sur plainte (§6).
S'agissant de la durée de la suspension, celle-ci est fixée par le juge entre deux et cinq ans pour les peines de prison jusqu'à deux ans, et entre trois mois et un an pour les peines légères (article 81). En cas de suspension liée à une toxicomanie (article 81 §5), la durée est de trois à cinq ans. Le juge fonde son choix sur les critères de l'article 80 (§1).
Le juge peut subordonner la suspension de peine à des obligations destinées à prévenir la récidive, à condition qu'elles soient proportionnées (article 83 §1). Ces obligations peuvent être notamment l'interdiction d'approcher la victime, une restriction de résidence, des comparutions périodiques ou la participation à des programmes de rééducation ou de désintoxication. Ces mesures sont obligatoires en cas de violences contre une femme par un conjoint ou ex-conjoint, ainsi que pour les infractions sexuelles, les mariages forcés, mutilations génitales et la traite d'êtres humains (article 83 §2).
En outre, le juge peut conditionner la suspension de peine à l'accomplissement de certaines mesures (article 84 §1), telles que le respect d'un accord issu d'une médiation, le paiement d'une amende ou la réalisation de travaux d'intérêt général, notamment comme forme de réparation symbolique.
Pendant la durée de la suspension, le juge peut, en cas de changement de circonstances, et à tout moment, adapter les mesures imposées en les levant, les modifiant ou en les remplaçant par d'autres moins contraignantes (article 85).
Conformément à l'article 87, si, à l'issue du délai de suspension, le condamné n'a commis aucun nouveau délit et a respecté les obligations imposées, le juge prononce la remise de la peine (§1). Pour les suspensions liées à une toxicomanie (article 80 §5), la remise suppose que le condamné soit désintoxiqué ou poursuive son traitement. Sinon, la peine est exécutée, sauf si le juge accorde une prorogation de la suspension, d'au plus deux ans, en fonction des rapports reçus (article 87 §2).
(b) La liberté conditionnelle (articles 90 à 92 du code pénal)
Depuis la réforme introduite par la loi organique de 2015 (cf. supra), la liberté conditionnelle a perdu son statut de quatrième degré d'exécution des peines au sens de la loi organique générale pénitentiaire (LOGP)299(*). Elle n'est plus considérée comme une phase finale d'exécution, mais comme une modalité autonome de suspension de peine, soumise à des conditions spécifiques (article 90 du code pénal). Ce changement implique notamment que, en cas de révocation, le temps passé en liberté conditionnelle n'est plus déduit de la peine restant à purger (article 90 §6).
La mesure consiste en la suspension du reliquat de la peine de prison, décidée par le juge de surveillance pénitentiaire, lorsqu'un pronostic favorable de réinsertion peut être établi. Trois conditions légales cumulatives sont exigées (article 90 §1) : 1° le condamné est classé en troisième degré300(*) ; 2° il a exécuté les trois quarts de sa peine ; 3° il a observé une bonne conduite. Le juge apprécie également la personnalité, les antécédents, les circonstances de l'infraction, la situation familiale et sociale du condamné, ainsi que les effets prévisibles de la suspension. L'octroi est subordonné au paiement effectif ou à l'engagement au paiement de la responsabilité civile, conformément à l'article 72 (§5 et §6) de la LOGP.
Contrairement à la suspension classique régie par l'article 80, la liberté conditionnelle s'applique à toute peine privative de liberté, quelle qu'en soit la durée, et indépendamment du statut du condamné (primo-délinquant ou récidiviste). Elle n'est donc pas réservée aux peines brèves ni aux profils dits « réinsérables » ab initio.
Deux régimes dérogatoires permettent une libération conditionnelle anticipée :
- le premier (article 90 §2) s'adresse aux condamnés ayant purgé deux tiers de leur peine, à condition qu'ils aient participé à des activités structurées (travail, éducation, traitement etc.) ayant transformé positivement leur situation personnelle, et qu'ils remplissent les autres critères du §1. Le juge peut alors anticiper la libération jusqu'à 90 jours par année de détention, si le condamné a en outre suivi des programmes de réparation ou de désaccoutumance en cas de toxicomanie ;
- le second (article 90 §3) vise les primo-condamnés à une peine n'excédant pas trois ans, ayant exécuté la moitié de leur peine et participé à des activités de réinsertion. Ce régime est exclu pour les infractions sexuelles.
Le juge peut refuser la libération conditionnelle en cas d'inexactitude ou d'opacité sur le patrimoine du condamné, d'inexécution des obligations civiles ou en présence de fraude à l'administration (article 90 §4).
La durée de la mesure est de deux à cinq ans, sans pouvoir être inférieure au reliquat de peine. Elle prend effet à la date de mise en liberté effective (article 90 §5). Pendant cette période, le juge peut modifier, compléter ou supprimer les obligations imposées, ou révoquer la mesure si les conditions de départ disparaissent (articles 83, 86, 87 et 90 §5-6). Le suivi est assuré par les services de gestion des peines et mesures alternatives (servicios de gestión de penas y medidas alternativas - SGPMA), déconcentrés de l'administration pénitentiaire301(*).
La libération conditionnelle est accordée sur demande du condamné. En cas de refus, une nouvelle demande ne peut être déposée avant un délai de six mois, prolongeable à un an (article 90 §7).
En matière de terrorisme ou de criminalité organisée, des conditions renforcées sont exigées : désengagement avéré, collaboration avec les autorités, demande de pardon aux victimes, et évaluation technique favorable. Dans ces cas, les régimes anticipés (§2 et §3) sont inapplicables (article 90 §8).
Les personnes âgées de 70 ans ou plus ou atteintes d'une maladie très grave incurable peuvent obtenir la libération conditionnelle sans avoir exécuté la durée minimale de peine normalement exigée. La condition médicale doit être dûment attestée par des rapports médicaux, appréciés par le juge (article 91).
Enfin, l'article 92 encadre les conditions de suspension de la peine de réclusion à perpétuité révisable (prisión permanente revisable). Le tribunal peut suspendre l'exécution de la peine si trois conditions sont réunies : 1° le condamné a purgé au moins 25 ans de prison (sauf exceptions prévues à l'article 78 bis) ; 2° il est classé en troisième degré ; 3° un pronostic favorable de réinsertion est établi, sur la base d'une évaluation globale incluant personnalité, antécédents, gravité des faits, conduite en détention et rapports spécialisés. Pour les faits de terrorisme, il faut en plus une rupture avérée avec la violence, une coopération active avec les autorités et une demande de pardon aux victimes, attestées par des rapports techniques. La suspension dure de 5 à 10 ans, pendant lesquels des obligations peuvent être imposées, modifiées ou levées. En cas de modification défavorable des circonstances, la mesure peut être révoquée. Enfin, le tribunal doit vérifier tous les deux ans si les conditions sont toujours remplies et peut refuser d'examiner une nouvelle demande pendant un an après un rejet.
(c) Les permissions de sortie (articles 47 et 48 de la loi organique générale pénitentiaire)
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un aménagement de peine, mais de mesures ponctuelles d'assouplissement du régime de détention, des permissions de sortie (permisos de salida) sont également prévues par les articles 47 et 48 de la LOGP, notamment en cas de circonstances graves (décès ou maladie grave d'un proche, naissance d'un enfant, etc.). De même, des permissions à finalité préparatoire à la vie en liberté, d'une durée maximale de sept jours, peuvent être accordées aux condamnés classés en deuxième ou troisième degré, dans la limite de 36 ou 48 jours par an. Elles sont subordonnées à l'exécution d'au moins un quart de la peine et à l'absence de mauvaise conduite (article 47 §2). Les détenus provisoires peuvent également en bénéficier, sous réserve de l'approbation expresse du juge compétent (article 48).
(2) Les autorités compétentes
Les autorités compétentes en matière d'aménagement des peines privatives de liberté varient selon la nature de la mesure envisagée.
· S'agissant de la suspension de l'exécution de la peine
La suspension de l'exécution de la peine relève du juge ou du tribunal ayant prononcé la condamnation. Celui-ci statue, dans la mesure du possible, dans le jugement de condamnation lui-même ; à défaut, il se prononce par une décision ultérieure une fois la peine devenue définitive, après audition des parties (article 82 §1 du code pénal). Le ministère public est consulté mais ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Cette compétence juridictionnelle s'accompagne d'une marge d'appréciation, notamment pour évaluer les circonstances personnelles du condamné, le pronostic de réinsertion et l'adéquation des mesures imposées302(*). En cas de suspension fondée sur la toxicomanie ou une pathologie grave, le juge peut ordonner des vérifications médicales et exiger la transmission d'un rapport de pronostic (article 80 §5 du code pénal ; article 200 du règlement pénitentiaire303(*)).
Certaines obligations ou interdictions associées à la suspension relèvent d'autorités distinctes pour leur mise en oeuvre. Ainsi, les forces et corps de sécurité de l'État (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) sont chargés de faire respecter les interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes, de se rendre dans certains lieux, ou d'en quitter d'autres sans autorisation (article 83 §3 du code pénal). À l'inverse, la mise en oeuvre et le suivi des obligations de participation à des programmes éducatifs, culturels, sociaux ou de désaccoutumance, ou encore de travaux d'intérêt général, relèvent des services de gestion des peines et mesures alternatives de l'administration pénitentiaire (SGPMA), services déconcentrés de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas (articles 83 §4 et 84 §1 du code pénal)304(*). D'autres mesures, comme l'obligation de se présenter régulièrement devant le juge, le paiement d'une amende ou l'exécution d'un accord de médiation, relèvent du juge lui-même ou du service qu'il désigne, sans qu'un contrôle spécifique ne soit systématiquement mis en place305(*).
· S'agissant de la liberté conditionnelle
La libération conditionnelle relève de la compétence exclusive du juge de surveillance pénitentiaire (juez de vigilancia), conformément à l'article 90 (§1) du code pénal. La demande peut être initiée par le condamné ou faire suite à une proposition de l'administration pénitentiaire (article 205 du règlement pénitentiaire). Le juge se prononce sur le fondement des rapports émis par la commission de traitement (junta de tratamiento), du ministère public et, le cas échéant, des services d'insertion. L'octroi repose sur un ensemble de critères légaux, mais leur évaluation reste soumise à l'appréciation individualisée du juge306(*). Le juge est également compétent pour statuer sur la révocation de la liberté conditionnelle (article 90 §6 du code pénal et article 76 §2 b LOGP).
· S'agissant de la réclusion à perpétuité révisable
La compétence revient au tribunal ayant prononcé la condamnation, qui statue à l'issue d'une procédure orale contradictoire, en présence du ministère public et du condamné assisté d'un avocat (article 92 §1 du code pénal). La décision est fondée sur les rapports du centre pénitentiaire et des experts désignés. En cas de condamnation pour terrorisme ou criminalité organisée, la loi impose en outre une vérification du désengagement du condamné, de sa collaboration effective avec les autorités, et une demande de pardon aux victimes, le tout étayé par des rapports techniques, en application de l'article 92 §2 du code pénal307(*).
Le juge compétent peut assortir toute mesure d'aménagement de peine d'obligations spécifiques : interdictions de contact, participation à des programmes, contraintes géographiques ou comportementales (article 83 du code pénal). Il peut ensuite les modifier, les renforcer ou les supprimer en fonction de l'évolution de la situation du condamné (articles 85 et 90 §5). Il conserve également la faculté de révoquer la suspension ou la liberté conditionnelle en cas de manquement ou de modification des circonstances (articles 86 et 90 §6)308(*). Le suivi du respect des obligations est assuré par les services sociaux pénitentiaires, qui informent périodiquement le juge (articles 200 et 204 du règlement pénitentiaire).
· S'agissant des permissions de sortie
Les permissions de sortie prévues aux articles 47 et 48 du règlement pénitentiaire relèvent de la commission de traitement, dans le cadre de l'administration pénitentiaire. Pour les personnes en détention provisoire, une autorisation judiciaire préalable est requise (article 48).
(3) Les données statistiques
Selon le rapport général 2023 du Secrétariat général des institutions pénitentiaires (service rattaché au ministère de l'Intérieur)309(*), au 31 décembre 2023, les établissements pénitentiaires relevant de l'administration générale de l'État espagnol comptaient 47 083 personnes détenues, soit une hausse de 615 détenus par rapport à 2022 (+1,3 %). Cette augmentation résulte exclusivement de la population préventive, qui a crû de 685 personnes (+9,3 %), tandis que la population condamnée a légèrement diminué (-0,2 %, soit 70 personnes de moins). La population carcérale moyenne sur l'année s'établit à 46 892 détenus, avec une hausse plus marquée chez les femmes (+0,8 %).
S'agissant des simples permissions de sortie, entre 2002 et 2015, celles-ci sont passées de 67 417 à 117 697 ; après une chute à 62 796 en 2020, elles sont remontées à 82 296 en 2023, avec un indice de 0,55 permission par personne ces trois dernières années.
En 2023, 3 374 personnes étaient suivies sous surveillance électronique (control telemático), principalement des hommes (85 %), pour une durée moyenne de 180 jours. 62 personnes ont bénéficié d'un congé avec surveillance GPS, et 83 étaient placées en liberté surveillée avec géolocalisation, principalement pour des infractions sexuelles ou terroristes.
En 2023, les services de gestion des peines et mesures alternatives ont traité 129 507 décisions judiciaires, dont 105 506 concernaient des travaux d'intérêt général (TIG) et 24 001 des suspensions ou substitutions de peine. Le volume global est en léger recul par rapport à 2022 (-4 %), principalement en raison de la baisse du nombre de TIG (-4,7 %), tandis que les suspensions sont restées stables, voire en légère hausse (+0,4 %).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Plusieurs dispositifs permettent d'exécuter tout ou partie d'une peine en dehors des murs de la prison, dans une logique de responsabilisation et de réinsertion sociale. Si ces alternatives à l'emprisonnement répondent à des objectifs différenciés, elles s'inscrivent néanmoins dans la même dynamique de réduction du recours à l'incarcération stricte, tout en assurant le suivi, le contrôle et la réadaptation progressive des personnes condamnées.
(1) Le régime carcéral du troisième degré, dit régime « ouvert » (articles 80 à 88 du règlement pénitentiaire)
Le régime ouvert (regimen abierto) s'applique aux personnes détenues classées en troisième degré de traitement, c'est-à-dire jugées aptes à exécuter leur peine en milieu ouvert, dans des conditions de semi-liberté (article 74 §2 du règlement pénitentiaire). Il constitue une mesure de réinsertion qui, bien que juridiquement distincte, est parfois assimilée à une forme de probation, dans la mesure où il permet au condamné d'évoluer dans des conditions proches de la liberté conditionnelle310(*).
Trois types de structures peuvent accueillir les personnes soumises à ce régime : les centres ouverts ou centres d'insertion sociale, les sections ouvertes rattachées à un établissement mixte, et les unités dépendantes, situées hors du milieu carcéral, souvent en logements ordinaires et gérées par des entités externes en partenariat avec l'administration pénitentiaire (article 80). Le programme individualisé de traitement détermine l'affectation en fonction du parcours personnel, des ressources disponibles et de l'environnement familial du détenu (article 81).
L'objectif du régime ouvert est de favoriser la réinsertion progressive en mobilisant les capacités d'autonomie, de responsabilité et d'intégration sociale du condamné. Il repose sur des principes de normalisation, de cohérence avec les services communautaires et de coordination institutionnelle (article 83). La commission de traitement peut proposer différentes conditions et modes de vie, adaptés aux besoins de chaque personne, au sein du régime ouvert (article 84), notamment un régime restreint pour celles présentant des vulnérabilités particulières (article 82).
En règle générale, le condamné doit passer au moins huit heures par jour dans l'établissement et y passer la nuit (article 86). Toutefois, s'il accepte un dispositif de contrôle télématique (bracelet électronique), il peut ne s'y rendre que pour les activités prévues dans son programme. Ce régime peut aussi inclure des formes de contrôle allégé : entretiens périodiques, appels téléphoniques, tests de dépistage311(*). Le week-end, des permissions encadrées sont prévues, généralement du vendredi 16h au lundi 8h, avec extensions possibles en cas de jours fériés (article 87).
Le régime ouvert peut également inclure des modalités spécifiques telles que le troisième degré avec internement dans une communauté thérapeutique, principalement pour les personnes toxicomanes, ou le troisième degré en unité dépendante, visant à offrir un accompagnement renforcé en matière de logement, formation et emploi. Ces dispositifs sont gérés par des associations ou organismes non pénitentiaires, sous supervision de l'administration pénitentiaire312(*).
L'ensemble de ce régime, y compris les modalités dérogatoires, est entièrement administré par l'administration pénitentiaire, sans intervention judiciaire, une fois la classification en troisième degré prononcée.
(2) Le travail d'intérêt général (article 49 du code pénal)
Le travail d'intérêt général (trabajo en beneficio de la comunidad) constitue l'une des principales peines alternatives à l'emprisonnement en Espagne. Il peut être prononcé en tant que peine principale ou en tant que condition d'une suspension de peine, notamment dans le cadre des articles 80 à 84 du code pénal313(*). Dans les deux cas, il ne peut être imposé qu'avec le consentement du condamné, conformément à l'article 49 du code pénal.
Le TIG consiste à faire participer la personne condamnée, de manière non rémunérée, à des activités utiles à la société, en lien ou non avec la nature de l'infraction. Il peut s'agir de travaux de réparation, d'aide aux victimes, ou de la participation à des programmes de rééducation, de formation professionnelle, culturelle, de sensibilisation routière, sexuelle ou environnementale, entre autres. La durée maximale est fixée à huit heures par jour.
L'exécution de la peine relève des SGPMA (Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire314(*). Ces services coordonnent l'affectation du condamné dans des entités publiques ou associatives partenaires et transmettent au juge de surveillance pénitentiaire les informations nécessaires à son suivi. Celui-ci peut constater l'inexécution en cas d'absences injustifiées, de manque manifeste de rendement, de refus répété d'exécuter les tâches confiées, ou de comportement incompatible avec le maintien dans le centre d'affectation (article 49 §6). En cas de manquement, le juge peut décider de changer le lieu d'exécution ou de constater l'inexécution de la peine, susceptible d'entraîner des poursuites (article 468 du code pénal).
Les personnes effectuant un TIG bénéficient du statut juridique protecteur applicable aux personnes détenues, notamment en matière de sécurité sociale, et le TIG ne peut être utilisé à des fins économiques (article 49 §4 et §5). Il s'est imposé depuis une vingtaine d'années comme l'une des peines alternatives les plus développées et les plus utilisées, en raison de sa souplesse d'application et de son potentiel de réhabilitation315(*).
Des dispositions d'application plus détaillées sont fixées par le décret royal n° 840/2011 du 17 juin 2011316(*). Le texte précise les modalités concrètes d'exécution du TIG et encadre notamment la procédure de désignation du poste de travail, l'élaboration du plan d'exécution individualisé, les obligations de suivi par l'administration et la possibilité d'adapter la peine aux contraintes personnelles du condamné. Il consacre également le rôle central des SGPMA et formalise la coordination entre les acteurs publics ou associatifs impliqués, tout en maintenant le contrôle de légalité du juge de surveillance.
(3) La peine d'assignation à résidence (article 37 du code pénal)
Parmi les peines privatives de liberté définies à l'article 35 du code pénal, on compte également l'assignation à résidence (localización permanente).
Définie et encadrée par l'article 37 du code pénal, elle consiste à obliger le condamné à demeurer à son domicile ou dans un lieu déterminé par le juge, pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois (§1). Elle peut être prononcée à titre principal ou dans le cadre d'une suspension de peine, et constitue alors une alternative à l'incarcération, notamment lorsque le maintien au domicile permet de préserver les liens familiaux et sociaux. Toutefois, la loi prévoit qu'en cas de récidive, et si le texte applicable le prévoit expressément, la peine peut être exécutée les week-ends et jours fériés en établissement pénitentiaire, ce qui l'éloigne alors de la logique probatoire317(*).
L'assignation à résidence peut être aménagée, sur demande du condamné et après avis du ministère public, pour être exécutée uniquement les samedis et dimanches ou de manière non continue (article 37 §2). Son contrôle est assuré par les forces de sécurité de l'État (police ou Guardia Civil), sur la base d'un plan d'exécution transmis par le juge, qui peut en outre ordonner l'utilisation de dispositifs électroniques de géolocalisation pour garantir le respect des obligations (article 37 §4). En cas de manquement, le juge peut engager des poursuites pour inexécution de peine (article 37 §3).
(4) La liberté surveillée (article 106 du code pénal)
Définie comme une mesure non privative de liberté par l'article 96 (§3) du code pénal, la liberté surveillée (libertad vigilada) est encadrée par l'article 106 du même code.
Elle peut être imposée après l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas expressément prévus par le code pénal, ou être appliquée à des personnes pénalement irresponsables ou partiellement responsables. Dans sa version postpénitentiaire, elle repose sur une proposition du juge de surveillance adressée au juge du fond, accompagnée d'un rapport technique de l'administration pénitentiaire, transmis avant la fin de la peine (§2).
La mesure consiste à soumettre le condamné à un contrôle judiciaire, par l'imposition d'une ou plusieurs obligations ou interdictions énumérées à l'article 106 §1 : port d'un dispositif électronique de localisation, présentation régulière à un lieu désigné, signalement des changements de domicile ou d'emploi, interdictions d'approcher ou de contacter la victime, restrictions de déplacement ou de résidence, obligation de suivre un traitement médical ou de participer à des programmes éducatifs. Ces mesures sont similaires à celles prévues dans le cadre de la suspension de peine (article 83), mais relèvent ici du régime des mesures de sûreté318(*).
Le code pénal ne précise pas l'autorité chargée de l'exécution pratique de chaque obligation, mais la doctrine propose une répartition fonctionnelle319(*) :
- le contrôle électronique (bracelet) relève de l'administration pénitentiaire, qui dispose des moyens techniques nécessaires ;
- les interdictions de territoire, d'approche ou de contact sont contrôlées par cette même administration lorsqu'un dispositif de localisation est utilisé, ou par les forces de sécurité (FCSE) dans les autres cas ;
- les programmes éducatifs ou de traitement sont assurés par les SGPMA ;
- les obligations de présentation ou de déclaration sont suivies par le tribunal ou un service désigné par le juge.
Le juge peut modifier, réduire ou lever la mesure à tout moment, en fonction de l'évolution du condamné (article 106 §3). En cas de manquement grave ou répété, il peut engager des poursuites pour inexécution de peine (article 106 §4). La liberté surveillée, lorsqu'elle donne lieu à un suivi effectif, peut être rapprochée de la probation, mais certaines de ses formes - notamment l'expulsion ou la surveillance familiale prévues à l'article 96 (§3) échappent à la logique de réinsertion320(*).
c) Le recours à la justice restaurative
(1) Principes, objectifs et cadre juridique
La justice restaurative (justicia restaurativa) repose sur une série de principes fondamentaux désormais codifiés en droit espagnol. La loi organique n° 1/2025 du 2 janvier 2025321(*) a introduit dans la législation relative à la procédure pénale une neuvième disposition additionnelle (DA)322(*) définissant clairement ses fondements : le volontariat, la gratuité, le caractère officiel du dispositif intégré au processus pénal et la confidentialité des échanges. Les participants doivent être préalablement informés de leurs droits et des conséquences éventuelles de leur engagement.
La participation est libre et révocable à tout moment, sans impact sur le procès pénal. Les informations échangées au cours du processus sont strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées que si les parties en conviennent expressément. Le juge ne peut en avoir connaissance qu'une fois la procédure achevée, par la remise éventuelle d'un acte de réparation.
Le juge peut proposer une orientation vers un processus restauratif en tenant compte des circonstances de l'affaire, à tout moment de la procédure, sauf dans les cas interdits par la loi. Ce renvoi ne suspend pas l'enquête, mais dans les affaires de délits mineurs, il interrompt la prescription. Le juge fixe un délai de trois mois maximum, prorogeable une fois, pour la conduite de la procédure, et autorise les médiateurs à consulter le dossier.
Si l'une des parties refuse ou se retire, les services le notifient immédiatement au juge, et la procédure pénale reprend. En cas de déroulement complet, les services rendent un rapport confidentiel et, en cas de succès, y annexent l'acte de réparation signé. Ce rapport n'inclut ni propos tenus, ni jugements de valeur.
Enfin, si un accord a été trouvé, le juge, après audition des parties et du ministère public, peut selon le cas : classer l'affaire (pour un délit mineur ou un délit relevant du pardon), ordonner la conclusion de l'instruction, engager un procès en procédure simplifiée, intégrer les accords dans une sentence de conformité, ou encore statuer sur la suspension de la peine ou des travaux d'intérêt général.
Cette reconnaissance procédurale constitue une évolution majeure, consolidant des pratiques déjà présentes depuis une dizaine d'années dans certaines communautés autonomes, notamment en Navarre, en Catalogne et au Pays basque323(*) (voir encadré infra).
(2) Acteurs et modalités de mise en oeuvre
Dans un rapport d'avril 2023 sur la justice restaurative, la section espagnole du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME España) identifie un ensemble hétérogène d'acteurs engagés dans la justice restaurative : administrations publiques (Catalogne, Navarre, La Rioja), associations conventionnées ou structures hybrides (unités intrajudiciaires à Madrid ou Murcie)324(*). Ces services opèrent soit en milieu judiciaire (phases d'instruction ou d'exécution), soit en milieu pénitentiaire, soit de façon extrajudiciaire325(*).
La majorité des interventions reposent sur un travail préparatoire individuel avec les parties (victime et auteur), suivi, en cas d'accord, d'un ou plusieurs entretiens conjoints326(*). Les méthodes employées incluent la médiation pénale directe, la facilitation indirecte (via une tierce personne), les cercles restauratifs et les conférences de groupe familial327(*).
Les facilitateurs sont souvent des professionnels du droit, de la psychologie ou du travail social, ayant suivi une formation spécifique de 100 à plus de 300 heures328(*). La co-médiation est fréquente, et le travail s'effectue en équipe pluridisciplinaire.
(3) Typologie des délits et volume d'activité
La majorité des programmes traitent de délits légers et d'une faible gravité, bien que certains soient ouverts à des infractions plus graves, y compris des violences intrafamiliales, des délits sexuels ou économiques329(*). L'activité varie fortement selon les structures : de 25 à plus de 1 000 cas par an selon les entités330(*). En moyenne, un peu plus de la moitié des affaires initiées mènent à un accord de réparation331(*).
Les taux d'adhésion varient également, avec des taux d'acceptation du processus oscillant entre 21 % et plus de 80 %, et des taux d'accord allant jusqu'à 75 % pour les procédures engagées332(*). Ces résultats illustrent l'adhésion croissante des participants, malgré la faible notoriété du dispositif dans la population333(*).
(4) Effets, bénéfices et limites des processus restauratifs
Selon le ministère de l'Intérieur, les processus restauratifs visent, du côté de la victime, à l'écoute, la reconnaissance du préjudice, une éventuelle demande de pardon et la possibilité de tourner la page334(*). Pour l'auteur, il s'agit de favoriser la prise de conscience, la responsabilisation, et la réintégration dans la société335(*).
Les autorités pénitentiaires tiennent compte, sous conditions, de la participation à ces programmes dans l'évaluation du traitement pénitentiaire, mais la peine prononcée n'est pas formellement modifiée336(*). L'administration rappelle que seuls les participants démontrant un véritable cheminement personnel peuvent être admis337(*).
En revanche, certaines limites demeurent. Le manque de services sur tout le territoire, l'hétérogénéité des dispositifs et l'absence de moyens pérennes nuiraient à l'égalité d'accès338(*). La supervision des facilitateurs resterait marginale, hormis en Catalogne339(*). Par ailleurs, la collaboration avec les bureaux d'assistance aux victimes (Oficinas de Asistencia a las Víctimas - OAV) serait encore trop peu développée, bien que de nombreuses recommandations institutionnelles insistent sur son importance340(*).
(5) Perspectives d'évolution et recommandations institutionnelles
Le rapport présenté par GEMME España en 2023 propose plusieurs axes d'amélioration : l'adoption d'un cadre normatif national (recommandation désormais mise en oeuvre), la généralisation des services publics gratuits sur l'ensemble du territoire, le renforcement des moyens humains et budgétaires, la formation renforcée des facilitateurs, l' intégration systématique des OAV dans le processus, la production de rapports annuels et le développement d'indicateurs de qualité341(*). Ces recommandations rejoignent d'autres sources, qui insistent sur la nécessité d'une impulsion étatique pour éviter une justice restaurative à deux vitesses, dépendante du lieu de résidence342(*).
Le modèle navarrais de justice restaurative : une initiative pionnière
En mars 2023, la Navarre est devenue la première communauté autonome d'Espagne à se doter d'un cadre juridique spécifique pour la justice restaurative, par l'adoption de la loi forale n° 4/2023 du 9 mars 2023343(*). Ce texte innovant fonde un service public autonome et universel de justice restaurative, intégré à la politique judiciaire territoriale.
L'article 15 de la loi garantit l'accès gratuit au service de justice restaurative de Navarre (Servicio de Justicia Restaurativa de Navarra) à toute victime ou auteur présumé d'une infraction, à tous les stades de la procédure, pour tout type d'infraction, sauf exceptions légales (article 13). Le service est chargé de mettre en oeuvre des processus fondés sur la participation des parties, la reconnaissance du tort, la réparation et la réinsertion (article 14), en veillant à la sécurité des victimes et à la prévention de la « revictimisation ».
Plusieurs techniques sont encadrées : médiation pénale, conférences restauratives, cercles restauratifs, ateliers ou programmes spécifiques (articles 20 à 24). Les résultats doivent faire l'objet d'un plan de réparation, basé sur un accord libre, juste et proportionné, dont le contenu peut être moral, symbolique, matériel ou social (article 25).
Le texte consacre des principes structurants : volontariat, égalité, confidentialité, impartialité, bonne foi, flexibilité et compétence des facilitateurs (article 3). Il impose une planification stratégique (plans quadriennal et biennal), des garanties de qualité, de territorialité et d'accessibilité (articles 4 à 6), et une prise en compte renforcée de la perspective de genre et des droits de l'enfant (articles 8 et 9).
Enfin, la loi forale va au-delà du champ pénal, en réglementant la médiation civile et les « pratiques communautaires restauratives » (prácticas restaurativas comunitarias), définies comme outils de cohésion sociale pour gérer les conflits en amont, dans les écoles, les familles ou les quartiers (articles 44 à 50).
4. Italie
Le droit italien prévoit plusieurs formes d'aménagement des peines d'emprisonnement fondées sur la loi du 26 juillet 1975 et ses réformes ultérieures : permissions de sortie à titre de récompense, placement à l'épreuve auprès des services sociaux, détention à domicile, régime de semi-liberté et libération anticipée. La suspension du procès avec mise à l'épreuve permet au prévenu d'éviter la condamnation, en suivant un programme personnalisé. Le juge et le tribunal de surveillance sont compétents pour accorder ces mesures, avec l'appui du parquet et des services techniques de probation pour l'évaluation et le suivi.
La réforme de la justice de 2022 a instauré un régime de peines substitutives directement prononcées au jugement, pour les peines inférieures ou égales à quatre ans. Le juge peut désormais opter pour la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général ou l'amende. Cette réforme vise à réduire le nombre de personnes condamnées laissées en liberté dans l'attente d'un aménagement.
La même réforme a également intégré la justice restaurative dans le droit italien, en lui conférant un cadre autonome applicable à toutes les phases du procès, y compris l'exécution des peines. Fondée sur le dialogue volontaire entre auteur, victime et communauté, elle vise la réparation et la réinsertion. Le décret législatif de 2022 définit les modalités d'accès, le rôle des centres spécialisés et la conduite des programmes (médiation directe, indirecte, dialogue communautaire).
L'exécution des peines répond à un double objectif : assurer la mise en oeuvre concrète des décisions de justice, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes condamnées. L'article 27 de la Constitution344(*) dispose en effet que « les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sens de l'humanité » et qu'elles « doivent tendre à la rééducation du condamné ». Cette exigence constitutionnelle confère une orientation résolument rééducative à l'exécution des sanctions pénales. Elle justifie le recours à diverses formes d'aménagement de peine, à des mesures alternatives à l'incarcération ainsi qu'au développement d'une justice restaurative (giustizia riparativa).
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
(1) Les formes d'aménagement de peine et les conditions pour en bénéficier
Le système italien prévoit plusieurs formes d'aménagement de la peine d'emprisonnement, conçues pour permettre une exécution modulée et progressive. Ces aménagements reposent principalement sur la loi n° 354 du 26 juillet 1975 établissant des règles relatives au système pénitentiaire et à l'exécution des mesures privatives et restrictives de liberté345(*), réformée en profondeur par la loi n° 663 du 10 octobre 1986346(*), afin d'assouplir les conditions d'accès aux mesures alternatives à la détention347(*).
(a) Les permissions de sortie à titre de récompense (articles 30-ter et 30-quater)
Les articles 30-ter et 30-quater de la loi du 26 juillet 1975 encadrent l'octroi des permissions de sortie à titre de récompense (permessi premio) aux condamnés détenus. Le bénéfice de ces permissions, d'une durée maximale de 15 jours consécutifs et de 45 jours par an, est réservé aux détenus ayant eu une conduite régulière et ne présentant pas de dangerosité sociale. Les mineurs bénéficient de plafonds supérieurs (30 jours par permission, 100 jours par an). L'octroi est subordonné à l'intégration de la permission dans le programme de réinsertion, sous suivi d'éducateurs pénitentiaires et de services sociaux externes.
Les délais d'accès varient selon la gravité des peines : les permissions peuvent être octroyées immédiatement pour les peines légères (inférieures ou égales à quatre ans), après avoir purgé un quart de la peine pour les condamnés à une peine supérieure à quatre ans, après la moitié de la peine pour les délits graves visés à l'article 4-bis, et après 10 ans de détention pour les peines à perpétuité.
L'article 30-quater prévoit des délais plus stricts pour les récidivistes au sens de l'article 99, alinéa 4, du code pénal : un tiers, la moitié ou les deux tiers de la peine selon la catégorie.
(b) Le placement à l'épreuve auprès des services sociaux (article 47)
L'article 47 prévoit la mesure alternative de placement à l'épreuve auprès des services sociaux (affidamento in prova al servizio sociale), qui permet à certains condamnés d'exécuter leur peine hors de prison, sous supervision et contrôle. Elle est ouverte lorsque la peine à purger ne dépasse pas trois ans (ou quatre ans dans certains cas), selon une appréciation individualisée visant à favoriser la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive. Cette durée s'entend de la peine résiduelle effectivement à exécuter, comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle348(*).
La mesure est accordée sur la base d'un rapport d'observation de la personnalité, effectué en détention ou, pour les personnes libres, par le bureau d'exécution pénale externe (ufficio di esecuzione penale esterna - UEPE). Le placement peut aussi être accordé aux personnes ayant déjà exécuté une partie de leur peine en détention ou sous contrôle judiciaire (§3-bis), ainsi qu'aux condamnés à des peines substitutives de semi-liberté ou de détention à domicile (§3-ter).
La demande est présentée au juge de surveillance (magistrato di sorveglianza) - équivalent du juge d'application des peines français. En cas d'urgence, celui-ci peut accorder l'application provisoire. Si la mesure est acceptée, un protocole est établi, définissant les obligations : lieu de résidence, emploi, interdictions de fréquentation, engagement envers la victime et obligations familiales. Ces prescriptions peuvent être adaptées en cours d'exécution.
Les services sociaux assurent le suivi du condamné, rendent compte de son comportement, et l'accompagnent dans sa réinsertion. En cas de manquement grave, la mesure est révoquée. À l'inverse, son bon déroulement entraîne l'extinction de la peine et des effets pénaux (hors peines accessoires perpétuelles), avec une possible remise complémentaire de peine en cas de réinsertion effective.
(c) La détention à domicile (article 47-ter)
L'article 47-ter encadre la possibilité d'exécuter certaines peines privatives de liberté sous le régime de la détention à domicile (detenzione domiciliare). Ce régime peut s'appliquer à toute peine, sauf exceptions (infractions sexuelles graves, criminalité organisée), lorsque le condamné est âgé d'au moins 70 ans et ne présente pas de profil de récidiviste aggravé349(*).
Le régime s'applique également aux peines jusqu'à quatre ans si le condamné est, par exemple, une femme enceinte, un parent d'enfant de moins de dix ans, une personne gravement malade ou âgée de plus de 60 ans partiellement inapte. Plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont étendu ce champ : au père en cas d'impossibilité de la mère350(*), au parent d'enfant lourdement handicapé351(*) et aux militaires gravement malades352(*).
Une disposition spéciale (1-bis) permet l'octroi de la mesure pour toute peine jusqu'à deux ans, en l'absence d'alternative possible et de risque de récidive. En cas de grave préjudice, le juge de surveillance peut statuer en urgence. La mesure est toutefois révoquée en cas d'inobservation des règles, notamment si le condamné quitte le domicile. La Cour constitutionnelle a toutefois limité les cas de révocation automatique à des absences prolongées353(*).
Par ailleurs, la loi n° 199 du 26 novembre 2010354(*) a institué un régime autonome d'exécution des peines privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à dix-huit mois à domicile. À la différence de l'article 47-ter de la loi de 1975, ce régime ne repose pas sur des critères personnels (âge, santé, situation familiale), mais exclusivement sur le quantum de la peine. Il permet l'exécution à domicile d'une peine ferme - même s'il s'agit du reliquat d'une peine plus longue - dans le domicile du condamné ou dans une structure publique ou privée d'accueil, de soins ou d'assistance. Le juge de surveillance statue rapidement, dès lors qu'il dispose des informations nécessaires, notamment sur le caractère adéquat du lieu au regard de la sécurité et de la protection des victimes (idoneità del domicilio).
L'accès à ce régime est néanmoins limité par des incompatibilités légales. En sont exclus les condamnés pour les infractions visées à l'article 4-bis de la loi de 1975 (terrorisme, crime organisé, violences sexuelles notamment), les délinquants professionnels ou habituels, les détenus sous régime de surveillance spéciale (article 14-bis), et ceux dont le risque de fuite ou de récidive est avéré. La mesure est également inapplicable en l'absence d'un domicile adéquat. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les toxicomanes ou alcooliques engagés dans un programme thérapeutique.
Enfin, deux articles de la loi de 1975 adaptent la détention à domicile à certaines situations sociales :
- l'article 47-quater prévoit que les mesures alternatives à la détention prévues aux articles 47 et 47-ter peuvent être accordées, même au-delà des seuils habituels de peine, aux personnes atteintes du sida déclaré ou d'une grave immunodéficience, sous réserve d'un programme de soins en cours ou envisagé. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de l'état de santé et de la faisabilité du traitement. Le juge peut refuser ou révoquer la mesure en cas d'abus antérieur ou de nouvelle infraction grave. En cas de refus, le détenu est placé dans un établissement doté d'un service médical adapté ;
- l'article 47-quinquies permet la détention à domicile spéciale (detenzione domiciliare speciale) pour les mères d'enfants de moins de dix ans, même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun. Elle peut être accordée après un tiers de peine, à condition que la reprise de la vie familiale soit possible et qu'il n'existe pas de risque de récidive. Elle peut être exécutée à domicile, en lieu d'accueil ou en maison familiale protégée. Les pères peuvent aussi en bénéficier. Le tribunal fixe les modalités et les services sociaux assurent le suivi. La mesure est révocable et peut être prolongée après les dix ans de l'enfant.
(d) La semi-liberté (article 48)
Le régime de semi-liberté (semilibertà) permet au condamné ou à l'interné de passer une partie de la journée hors de l'établissement pénitentiaire afin de participer à des activités professionnelles, éducatives ou utiles à sa réinsertion. Il est hébergé dans une section spécifique ou un établissement adapté, en tenue civile.
Selon l'article 50, la semi-liberté est possible pour les peines de réclusion ou de courte durée (arresto) n'excédant pas six mois si l'intéressé n'est pas déjà placé sous un autre régime alternatif. Au-delà, elle n'est accordée qu'après exécution de la moitié de la peine, ou des deux tiers pour les délits les plus graves (article 4-bis), sauf exception en cas d'inadmissibilité au régime prévu à l'article 47 (cf. supra). Le condamné à perpétuité peut y accéder après vingt ans. L'admission dépend de l'évolution du détenu et de sa capacité de réinsertion. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux mères de jeunes enfants (moins de trois ans), qui peuvent être accueillies dans des structures dédiées.
La Cour constitutionnelle a censuré plusieurs limitations du dispositif, notamment l'exclusion systématique des étrangers en situation irrégulière355(*), et l'impossibilité pour le juge de surveillance d'accorder une semi-liberté provisoire dans certains cas356(*).
Enfin, l'article 51 encadre la suspension et la révocation du régime : le bénéfice peut être retiré en cas d'inaptitude ou d'infractions aux règles, notamment en cas d'absence non justifiée de plus de douze heures (condamnés) ou trois heures (internés), ces faits pouvant entraîner des poursuites pénales et la révocation automatique du régime en cas de condamnation.
(e) La libération anticipée (article 54)
L'article 54 institue la libération anticipée (liberazione anticipata), une mesure de réduction de peine accordée aux condamnés à une peine privative de liberté qui démontrent une participation effective à leur réinsertion. Ce mécanisme vise à favoriser leur réinsertion sociale en réduisant la durée d'incarcération : 45 jours sont retranchés pour chaque semestre effectivement purgé, y compris les périodes passées en détention provisoire ou en détention à domicile.
La mesure est attribuée ou refusée par le juge de surveillance, qui en informe le parquet auprès de la juridiction ayant prononcé la peine. En cas de comportement postérieur incompatible, notamment si le condamné est ultérieurement reconnu coupable d'un délit non intentionnel commis pendant l'exécution, la libération anticipée peut être révoquée. Toutefois, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la révocation automatique fondée sur la seule condamnation, exigeant une appréciation fondée sur la gravité de la conduite du condamné357(*).
Par ailleurs, la réduction de peine obtenue au titre de la libération anticipée est considérée comme déjà exécutée pour calculer les seuils d'accès à d'autres mesures comme les permessi premio, la semi-liberté ou la libération conditionnelle. Cette règle vaut aussi pour les condamnés à perpétuité, uniquement dans le cadre de l'évaluation du seuil d'accès aux mesures358(*).
(f) La suspension du procès avec mise à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de procédure pénale)
Le mécanisme de suspension du procès avec mise à l'épreuve (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), issu des articles 168-bis à 168-quater du code pénal et 464-bis à 464-septies du code de procédure pénale, permet à un prévenu, pour certains délits punis d'une peine maximale de quatre ans, de demander à interrompre le procès afin de se soumettre à un programme de réinsertion encadré. La demande peut émaner du prévenu ou du parquet, à divers stades de la procédure, y compris durant les enquêtes préliminaires.
La mise à l'épreuve implique l'élaboration d'un programme personnalisé, en collaboration avec l'UEPE, comprenant des obligations en matière de comportement, des travaux d'intérêt général non rémunérés (au moins dix jours), des actions de réparation (dommages, excuses, médiation), ainsi qu'un suivi social. La durée maximale est fixée à deux ans (ou un an si seule une amende est prévue). L'exécution est suivie par l'autorité judiciaire, qui peut adapter les prescriptions.
Pendant cette période, la prescription est suspendue. En cas de succès - évalué à partir du comportement et d'un rapport final du service de probation - le juge prononce l'extinction du délit. À défaut, la procédure reprend. La mesure n'est accordée qu'une fois, mais la Cour constitutionnelle a reconnu sa possible extension aux infractions connexes déjà incluses dans une autre mise à l'épreuve359(*). Le juge veille à la conformité du programme, à la protection de la victime et peut recueillir des preuves dont le recueil ne peut être différé pendant la suspension.
(2) Les autorités compétentes
L'exécution et l'aménagement des peines privatives de liberté en Italie relèvent d'un ensemble d'autorités judiciaires spécialisées, dont les compétences sont encadrées par la loi de 1975 et le code de procédure pénale. Les deux autorités centrales dans ce dispositif sont :
- d'une part, le tribunal de surveillance (tribunale di sorveglianza) qui est compétent pour accorder ou refuser la plupart des aménagements de peine postérieurs à la condamnation définitive. L'article 70 de la loi de 1975 précise que ce tribunal statue notamment sur l'octroi, la modification ou la révocation des différents régimes d'aménagements de peine ainsi que sur l'admission aux mesures alternatives pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (ergastolo). Il se prononce aussi sur les suspensions de peine pour raisons de santé ou en cas de grave danger (article 71). Composé de magistrats professionnels et de membres experts issus de disciplines psycho-sociales, il délibère collégialement360(*) ;
- d'autre part, le juge de surveillance (magistrato di sorveglianza) qui est compétent pour statuer seul sur les mesures d'application plus directe ou moins complexes. L'article 69 de la loi de 1975 lui confie la compétence pour accorder la libération anticipée, contrôler l'exécution des régimes de détention à domicile et décider des prescriptions particulières imposées aux condamnés. Il veille à la légalité de l'exécution, à la protection des droits des personnes détenues et peut être saisi en cas de conflit sur les modalités d'exécution361(*).
Par ailleurs, le parquet (pubblico ministero) joue un rôle central dans l'initiation et le contrôle de l'exécution des peines. En application de l'article 656 du code de procédure pénale, il ordonne l'exécution des condamnations et, lorsque la peine est inférieure aux seuils prévus, il suspend l'exécution afin de permettre au condamné de solliciter une mesure alternative. Il transmet alors la demande au juge de surveillance, seul compétent pour statuer (§ 5 et § 6). Dans certains cas, il doit également transmettre les actes pour une éventuelle détention à domicile provisoire - par exemple lorsque le condamné est âgé d'au moins 70 ans - dans l'attente de la décision du juge (§9-bis). Lorsque la personne condamnée présente une demande d'aménagement, le procureur peut formuler ses observations, proposer un rejet ou faire appel d'une décision favorable rendue par le juge ou le tribunal de surveillance362(*). Il peut également intervenir en cas de violation des obligations par le bénéficiaire de la mesure, en saisissant l'autorité judiciaire afin d'en obtenir la révocation (article 51 de la loi de 1975).
Dans le cadre de la suspension du procès avec mise à l'épreuve (sospensione del procedimento con messa alla prova), l'autorité compétente varie selon la phase procédurale. L'article 464-bis du code de procédure pénale prévoit que la décision revient au juge saisi à ce stade : juge d'instruction (giudice per le indagini preliminari), juge de l'audience préliminaire (giudice dell'udienza preliminare) ou juge du débat (giudice del dibattimento), selon les cas. Le procureur peut lui-même proposer cette mesure à l'audience ; dans ce cas, l'imputé peut demander un délai, dans la limite de vingt jours, pour présenter sa demande (§1 et §2).
Les décisions d'aménagement sont également préparées par les services techniques extérieurs de la Justice. Les UEPE sont chargés de l'élaboration des programmes individuels de traitement dans les cas de mise à l'épreuve ou de placement auprès des services sociaux. Ils évaluent la situation familiale, professionnelle et sociale du condamné et proposent au juge un plan de réinsertion personnalisé. Les agents de probation assurent le suivi de la mesure, la transmission de rapports réguliers au juge et signalent éventuellement les manquements363(*).
(3) Les données statistiques
Au 15 novembre 2023, 133 631 personnes étaient suivies par les UEPE, dont 84 023 au titre de mesures pénales (contre 49 608 pour des enquêtes ou activités de conseil). Les hommes représentaient environ 89 % des personnes suivies au titre de mesures (74 521 sur 84 023)364(*).
Parmi les mesures appliquées à cette date, on relève notamment :
|
Placement à l'épreuve |
27 730 |
|
Détention à domicile |
11 855 |
|
Mise à l'épreuve |
26 257 |
|
Libération anticipée |
4 847 |
Entre le 1er janvier et le 15 novembre 2023, 221 008 personnes ont été suivies, dont 142 359 pour des mesures, et 118 735 pour des enquêtes ou des activités de conseil (des doubles comptes sont possibles entre ces catégories)365(*).
Durant cette même période, les principales mesures appliquées ont été :
|
Placement à l'épreuve auprès des services sociaux |
43 856 |
|
Détention à domicile |
22 343 |
|
Mise à l'épreuve |
51 591 |
|
Libération anticipée |
6 178 |
|
Travail d'intérêt général
|
16 501 |
Enfin, en termes de nouvelles affectations au cours de l'année 2023 (jusqu'au 15 novembre), on dénombre 76 345 nouvelles mesures, dont 22 620 placements à l'épreuve, 12 228 détentions à domicile, 27 886 mises à l'épreuve, 1 966 libertés surveillées et 8 912 sanctions de type communautaire, dont 8 073 travaux d'intérêt général pour infractions routières366(*).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
(1) Un nouveau régime de peines substitutives prononcées ab initio
Le décret législatif n° 150 du 10 octobre 2022367(*), dit Riforma Cartabia (du nom de la ministre de la Justice qui l'a portée), a instauré un régime nouveau de peines substitutives ab initio aux peines privatives de liberté brèves (inférieures ou égales à quatre ans), désormais applicables directement par le juge du fond, au moment du jugement. Avant cette réforme, des mesures telles que la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général ou encore l'amende de substitution n'étaient accessibles qu'en phase d'exécution, sur décision du juge de surveillance. Le décret a rompu cette dichotomie entre cognition et exécution, en érigeant ces sanctions en véritables peines, insérées aux articles 20-bis à 20-quater du code pénal :
- selon l'article 20-bis, quatre types de peines peuvent se substituer à l'incarcération : la semi-liberté, la détention à domicile, le travail d'intérêt général et la peine pécuniaire. L'article fixe également les cas d'exclusion, comme la récidive qualifiée ou certaines infractions graves ;
- l'article 20-ter impose au juge de choisir la peine substitutive en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur, de sa situation sociale et des perspectives de réinsertion ;
- l'article 20-quater précise les modalités d'exécution, en s'appuyant notamment sur les UEPE pour la mise en oeuvre des mesures non pécuniaires.
Ce nouveau régime s'articule avec des modifications apportées à la loi de 1975 : les articles 47, 47-ter et 48 ont été révisés pour permettre que la semi-liberté et la détention à domicile soient directement prononcées comme peines substitutives, et non plus seulement comme aménagements. Par ailleurs, l'article 545 du code de procédure pénale a été modifié pour imposer que la peine substitutive soit expressément mentionnée dans le dispositif du jugement, ce qui permet son exécution immédiate sans nouvelle intervention du juge de l'exécution.
(2) Une réforme conçue pour faire face à la crise de l'exécution pénale
Le nouveau dispositif vise à
désengorger le système d'exécution des
peines, en particulier à lutter contre le
phénomène structurel des liberi
sospesi. Ce terme désigne les personnes condamnées
laissées en liberté en vertu de la suspension de
l'exécution prévue par l'article 656, alinéa 5
du code de procédure pénale, dans l'attente d'une décision
du juge de surveillance sur une demande de mesure alternative. Ce
phénomène touchait plus de 90 000 personnes selon les
chiffres officiels de décembre 2022.
Selon certaines sources, ces situations, parfois prolongées de plusieurs années, affectaient la lisibilité du droit pénal, compromettaient l'objectif de réinsertion368(*), et avaient suscité un contentieux européen sur le fondement de l'article 8 CEDH369(*).
La réforme cherche à atténuer ce phénomène en transférant au juge du fond le pouvoir de statuer immédiatement sur l'alternative à la détention, rompant ainsi la séquence classique entre jugement au fond puis exécution370(*). Ce modèle d'inspiration anglo-saxonne repose sur l'idée que l'efficience de la justice pénale suppose une décision complète dès le jugement371(*). La Cour constitutionnelle a confirmé cette orientation, soulignant que ce changement permet un meilleur contrôle de la dangerosité sociale du condamné, et évite de le maintenir dans une incertitude prolongée372(*).
(3) Les limites du dispositif et les perspectives d'amélioration
L'une des critiques majeures adressées à la réforme concerne l'absence, dans le catalogue des peines substitutives, du placement à l'épreuve. Son exclusion, dictée par des arbitrages politiques au moment de l'élaboration de la loi de délégation, a eu pour effet de détourner certains prévenus des peines substitutives ab initio, au profit d'une attente stratégique de la décision du juge de surveillance373(*).
L'analyse de la peine pécuniaire substitutive souffre quant à elle d'un manque de données. Elle n'est pas comptabilisée dans les rapports du ministère de la Justice car aucun système statistique ne permet actuellement d'en suivre l'application. Le décret prévoit pourtant, à l'article 79, que le ministre de la Justice présente chaque année au Parlement un rapport de suivi sur cette mesure.
Si le nombre de peines substitutives prononcées reste modeste, leur progression est significative. À titre de comparaison, seules 109 peines substitutives avaient été appliquées en 2022 dans le cadre du régime antérieur374(*). Cette multiplication par plus de dix du volume d'utilisation suggère une évolution réelle, bien que contrastée selon les peines.
Les analyses du dispositif mettent toutefois en lumière des obstacles structurels. Les UEPE seraient en sous-effectif chronique, les juridictions de surveillance surchargées, et le suivi des mesures resterait difficile à organiser375(*).
c) Le recours à la justice restaurative
(1) Contexte et origine de la réforme
La justice restaurative (giustizia riparativa) a connu un développement progressif en Italie avant d'être consacrée par la « réforme Cartabia » de 2022 (cf. supra). Dès le milieu des années 1990, des expérimentations ont été lancées376(*). Ces initiatives se sont élargies au cours des années 2000, notamment dans la phase d'exécution des peines pour adultes, sous l'impulsion du Département de l'administration pénitentiaire377(*). Elles ont été largement guidées par les recommandations d'organismes internationaux. Plusieurs textes du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des Nations Unies ont encouragé, dès les années 1980 et 1990, le recours à la médiation pénale et à la justice restaurative, et de façon plus significative la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes378(*). Ces normes ont joué un rôle structurant dans l'émergence d'un modèle italien, dans un contexte où la justice pénale classique était souvent perçue comme insatisfaisante, tant pour les auteurs que pour les victimes379(*).
L'Italie a intégré le concept de justice restaurative dans son droit positif avec l'adoption du décret législatif n° 150 du 10 octobre 2022380(*). Ce texte donne à la justice restaurative un cadre normatif autonome, applicable à tout le territoire, en cohérence avec les recommandations européennes et les engagements internationaux de l'Italie381(*).
(2) Esprit et contenu du décret de 2022
L'article 42 du décret définit la justice restaurative comme « tout programme permettant à la victime d'une infraction, à la personne désignée comme auteur de l'infraction et à d'autres membres de la communauté de participer librement, de manière consensuelle, active et volontaire, à la résolution des questions découlant de l'infraction, avec l'aide d'un tiers impartial, dûment formé, appelé médiateur ». L'objectif est de favoriser le dialogue, la responsabilisation, la réparation (symbolique ou matérielle) et, in fine, de restaurer un pacte de citoyenneté rompu par l'infraction382(*).
La justice restaurative s'insère à tous les moments du processus pénal, y compris en phase d'exécution de la peine ou après la libération, sans condition liée à la gravité de l'infraction ni à la qualification procédurale383(*). Elle se veut donc accessible, transversale et respectueuse des principes constitutionnels, notamment celui de la finalité rééducative de la peine384(*).
Le décret législatif distingue clairement la justice restaurative des simples conduites réparatrices (dommages, restitutions, etc.), en ce qu'elle repose sur une démarche de dialogue, volontaire, centrée sur les personnes et non sur le quantum de la réparation385(*). Elle se différencie également de la seule fonction rééducative de la peine, même si les deux démarches peuvent se renforcer mutuellement386(*).
(3) Principales dispositions et modalités de fonctionnement de la justice restaurative
Le décret législatif de 2022 encadre l'accès et le déroulement des programmes de justice restaurative, en les consacrant dans ses articles 42 à 67. L'article 44 dispose que ces programmes peuvent être proposés à tout moment, indépendamment de la phase du procès, y compris pendant l'exécution de la peine. La demande peut émaner de l'auteur présumé, de la victime, de leurs représentants ou encore de l'autorité judiciaire, y compris d'office. Conformément à l'article 43, toute participation repose nécessairement sur la liberté, la volonté expresse, le consentement informé et la participation active de toutes les parties concernées. Le principe de confidentialité est garanti tout au long du processus.
Le juge ou le parquet, saisis d'une telle demande, peuvent ordonner une transmission au centre pour la justice restaurative (Centro per la giustizia riparativa) compétent afin d'en évaluer la faisabilité, à condition qu'il n'existe aucun risque concret pour les personnes ou pour l'établissement des faits (article 44). Cette transmission ne vaut en aucun cas obligation de participer : l'adhésion au programme reste toujours libre et volontaire, même en cas d'initiative judiciaire (article 54).
Les centres pour la justice restaurative, définis à l'article 42 (g), sont des structures publiques instituées auprès des collectivités territoriales, chargées d'assurer l'organisation, la gestion et l'exécution des activités de justice restaurative. Ils sont animés par des médiateurs répondant à des critères de formation définis par voie réglementaire387(*).
L'article 53 distingue plusieurs types de programmes restauratifs : la médiation directe entre victime et auteur ; la médiation indirecte, par exemple avec une victime d'un délit analogue ; le dialogue restauratif (dialoghi riparativi) impliquant la communauté ou la famille ; ou encore d'autres formes de dialogues encadrées par des médiateurs, dans l'intérêt des participants. L'article 43 reconnaît également que peuvent participer aux programmes, outre la victime et l'auteur, des membres de la communauté ou des personnes ayant un intérêt légitime à y prendre part.
Le déroulement du programme est articulé en plusieurs étapes, précisées aux articles 54 à 57. Après l'envoi au centre compétent, une phase préliminaire s'ouvre avec des entretiens individuels (article 54), destinés à vérifier le consentement des parties, à les informer et à évaluer la faisabilité du programme. En cas d'accord, s'ensuivent les rencontres de médiation, conduites par deux médiateurs (article 55), dans des lieux garantissant neutralité et sécurité. L'issue du programme peut consister en une réparation symbolique (excuses, engagements, actions publiques, restrictions comportementales) ou matérielle (dommages, restitutions, mesures de réparation concrètes), définies à l'article 56.
À l'issue du parcours, les médiateurs rédigent un rapport à destination de l'autorité judiciaire ayant ordonné le renvoi. Ce document, prévu par l'article 57, décrit les activités réalisées et, le cas échéant, l'accord atteint. Il ne peut contenir aucun élément du dialogue entre les participants sans leur consentement explicite, dans le respect strict de la confidentialité. L'article 58 précise enfin que l'autorité judiciaire apprécie librement l'impact du programme restauratif sur les décisions relevant de sa compétence, mais que l'échec du programme ou le refus d'y participer ne peut entraîner aucun effet négatif pour les parties.
En revanche, une issue positive peut produire plusieurs effets juridiques. En phase de jugement, elle peut justifier l'application d'une circonstance atténuante nouvelle prévue à l'article 62 du code pénal, ou permettre la suspension conditionnelle spéciale de la peine, introduite à l'article 163 du code pénal. Elle peut aussi entraîner la remise tacite de la plainte dans les délits poursuivis à l'initiative de la victime (article 153 du code pénal) lorsque la personne lésée a participé au programme et que l'accord a été exécuté. Pendant l'exécution de la peine, l'article 15-bis de l'ordinamento penitenziario, modifié par la réforme, prévoit que la participation à un programme de justice restaurative peut être prise en compte pour l'octroi de mesures favorables : travail à l'extérieur, permissions, mesures alternatives ou libération conditionnelle.
La réforme établit ainsi un équilibre fonctionnel entre les compétences du médiateur, chargé de la facilitation du dialogue et de la rédaction du rapport, et celles du juge, qui conserve l'appréciation souveraine sur les effets juridiques. Ce dernier ne peut en revanche utiliser le contenu du programme à charge, ni tirer de conséquences négatives du refus d'y participer (article 58).
Selon les sources, l'efficacité du dispositif dépendra de sa mise en oeuvre effective sur le territoire : financement pérenne des centres, formation continue des professionnels du droit388(*) ainsi que la coordination entre magistrature, avocats, services sociaux et collectivités territoriales389(*).
5. Les Pays-Bas
Les Pays-Bas ont largement recours à l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme en vue de préparer la réinsertion des détenus. Il existe trois formes principales d'aménagement : la libération conditionnelle, la permission de réinsertion (de courte ou de longue durée) et la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire. La loi « punir et protéger » adoptée en 2021 a mis fin à la quasi-automaticité de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine et cherché à responsabiliser davantage les détenus. À rebours de cette réforme, une « permission de capacité » sous surveillance électronique a été introduite à titre temporaire en 2023 pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de moins d'un an afin d'atténuer les tensions sur les capacités d'accueil du système pénitentiaire.
Les principales alternatives à l'emprisonnement sont les amendes, le travail d'intérêt général et les peines avec sursis. Afin de réduire le nombre de courtes peines de prison (70 % des peines prononcées chaque année par le juge sont des peines d'emprisonnement de moins de trois mois), le ministère public a annoncé, en février 2025, son intention d'utiliser plus largement les ordonnances pénales pour les infractions de droit commun (en particulier les vols).
Le recours à la justice restaurative tend à se développer aux Pays-Bas, depuis l'introduction de ce concept dans le code de procédure pénale en 2011. Les deux principaux instruments de justice restaurative sont la médiation pénale, qui consiste en un renvoi vers une médiation durant la procédure pénale, et la médiation restaurative, qui peut intervenir à tout moment.
Pour mémoire, les Pays-Bas sont divisés en onze tribunaux de district, quatre cours d'appel et une Cour suprême. La plupart des affaires commencent devant un tribunal de district. Chaque tribunal de district est composé de cinq secteurs au maximum comprenant le droit administratif, le droit civil, le droit pénal et des sous-secteurs comme, par exemple, les affaires familiales ou le droit des étrangers390(*). La police mène l'enquête sous l'autorité du ministère public (Openbaar Ministerie, OM). En cas de délits graves, un juge d'instruction (rechter-commissaris) peut être désigné. Le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite, proposer une transaction (schikking) ou une ordonnance pénale (strafbeschikking - amende ou travail d'intérêt général, sans passage devant le juge) ou citer l'accusé à comparaître devant le tribunal391(*).
a) Les règles d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme
La loi « punir et protéger » (Wet straffen en beschermen)392(*), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a réformé les modalités d'exécution des peines aux Pays-Bas, notamment en rendant les conditions d'aménagement plus restrictives.
(1) Les différentes formes d'aménagement de peine
Aux Pays-Bas, l'aménagement des peines privatives de liberté s'inscrit dans une tradition d'« échelonnement de la détention » (detentiefasering)393(*), combinant des réductions de peine conditionnelles et des régimes de détention assouplis au fil du temps. Les principales formes d'aménagement de peine sont :
- la libération conditionnelle (voorwaardelijke invrijheidstelling), régie par le livre 6, chapitre 2, titre 2 du code de procédure pénale394(*). Elle peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme de plus d'un an. Elle vise à réduire le risque de récidive, en réinsérant graduellement le condamné en fin de peine. Depuis la réforme introduite par la loi « punir et protéger », la libération conditionnelle n'est plus automatique aux deux tiers de la peine : le détenu peut être libéré sous conditions pour le reliquat de sa peine, sous réserve de remplir certaines conditions (cf. infra) ;
- la permission ou autorisation de sortie de réinsertion (re-integratieverlof), prévue à l'article 26 de la loi pénitentiaire (Penitentiaire beginselenwet)395(*) et dont les modalités sont précisées par le règlement sur les sorties temporaires de l'établissement pénitentiaire396(*). Elle peut intervenir durant la dernière phase de détention afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs figurant dans le plan de détention et de réinsertion du détenu (plan D&R)397(*). Ces objectifs sont souvent liés aux « cinq conditions de base pour la réinsertion », à savoir : être en possession d'une pièce d'identité en règle, avoir des revenus et un travail, ainsi qu'un logement, s'être acquitté de ses éventuelles dettes et, si nécessaire, suivre un programme de soins. L'exécution de la peine se poursuit durant la durée de la permission de réinsertion. Il existe quatre types de permissions de réinsertion398(*) :
• la permission de réinsertion de courte durée pour travailler sur les « cinq conditions de base ». Ce type de permission de courte durée commence et se termine le même jour et ne doit pas être plus long que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel il a été accordé. La permission de courte durée peut être effectuée seul ou accompagné par un agent de sécurité ;
• la permission de réinsertion de courte durée pour maintenir son réseau social. Celle-ci ne peut être accordée qu'une fois par trimestre et commence et se termine le même jour ;
• la permission de réinsertion de longue durée pour entretenir le réseau social ou pour mettre en place une intervention spécifique. Ce type de permission peut être accordé une fois par trimestre et se déroule sur une période continue maximale de 76 heures et tout au plus trois nuits ;
• la permission de réinsertion pour effectuer un travail hors les murs, tout en demeurant dans une unité à sécurité limitée (Beperkt Beveiligde Afdeling - BBA). À la suite de la réforme de 2021, les BBA ont remplacé les institutions sécurisées restreintes ou très restreintes (zeer beperkt beveiligde inrichting - ZBBI). Il en existe aujourd'hui huit, répartis sur le territoire néerlandais399(*). Le placement en BBA est une forme de régime de détention en semi-liberté : entre 7 heures et 21 h 45, le détenu est autorisé à se rendre au travail ou à des activités quotidiennes. En dehors de ces horaires, il doit rester dans sa chambre400(*) ;
- la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire (extramurale detentie en penitentiair programma). Prévu à l'article 4 de la loi pénitentiaire, le programme pénitentiaire est un ensemble d'activités à suivre par le détenu, dans le cadre d'une détention à domicile, généralement sous surveillance électronique (elektronische monitoring)401(*). Seuls les détenus condamnés à de courtes peines de prison entre six mois et un an au maximum peuvent en bénéficier, pour une durée correspondant à un sixième de la peine (soit au minimum 4 semaines et 2 mois maximum)402(*). Les détenus bénéficiant du programme pénitentiaire sont en principe exclus de la permission de réinsertion hors les murs au sein d'une BBA403(*).
Enfin, de façon temporaire entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025, les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée compris entre quatre semaines et un an, ayant déjà purgé les deux tiers de leur peine, peuvent bénéficier d'une « permission de capacité » sous surveillance électronique (capaciteitsverlof onder elektronisch toezicht)404(*). Selon le ministère de la Justice, il s'agit d'une « mesure d'urgence temporaire » jugée nécessaire pour réduire la pression sur les capacités des établissements pénitentiaires405(*).
Les mesures prises par les autorités néerlandaises pour répondre aux problèmes de capacité du système pénitentiaire
À partir de l'automne 2023, une « pénurie structurelle de cellules disponibles »406(*) est apparue au sein du système pénitentiaire des Pays-Bas. Les causes de cette pénurie sont multiples : le manque de personnel, en raison de tensions sur le marché du travail néerlandais et d'un taux d'absentéisme élevé ; la hausse du taux d'occupation des prisons, en constante augmentation depuis juin 2023 ; la concomitance de rénovations immobilières de grande ampleur qui ont également un impact négatif sur la capacité du système et le manque de place dans les établissements psychiatriques spécialisés, conduisant un grand nombre de détenus à rester dans le système pénitentiaire général en attendant d'être pris en charge.
Diverses mesures ont été mises en place par le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire pour atténuer ces problèmes de capacité et éviter au maximum le temps d'attente pour exécuter les peines, parmi lesquelles figurent :
- la réduction des heures de travail des détenus, afin que les détenus passent plus d'heures dans les cellules et que moins de déploiement de personnel soit nécessaire ;
- entre le 6 décembre 2023 et le 1er janvier 2025407(*), la suspension de l'admission en prison des personnes condamnées à des peines de prison se présentant d'elles-mêmes à la suite d'une convocation d'incarcération (statut d'« autodéclarant », zelfmelders408(*)) ;
- l'élargissement temporaire des critères de placement en unité à sécurité limitée (BBA) ;
- l'introduction d'une nouvelle variante de permission : la permission de capacité sous surveillance électronique (capaciteitsverlof).
En septembre 2024, l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice ont également indiqué étudier la possibilité de réexaminer l'utilisation de cellules partagées à plusieurs personnes (cf. données statistiques infra), ainsi que la possibilité de placer des détenus dans des prisons étrangères, notamment en Estonie.
Sources : Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van deinrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen et DJI.
(2) Les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine
De façon générale, la loi « punir et protéger » de 2021 a durci les conditions d'obtention des aménagements de peine : les détenus doivent désormais « mériter » les plus grandes libertés qui leur sont accordées, en faisant preuve de motivation et de bonne conduite409(*). L'objectif de cette réforme était de répondre au sentiment d'injustice d'une partie de la population, liée notamment à la libération conditionnelle quasiment automatique d'un grand nombre de condamnés, aux deux tiers de leur peine410(*).
(a) La libération conditionnelle
Avant l'entrée en vigueur de la loi « punir et protéger » en 2021, tout condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ayant purgé au moins les deux tiers de sa peine ou à une peine comprise entre un et deux ans ayant purgé au moins un an et un tiers de la durée de détention restante était éligible à la libération conditionnelle, sauf décision contraire d'un juge, sur demande du ministère public411(*). La libération conditionnelle anticipée était ainsi la règle : sur la période 2012-2016, près de 90 % des 1 100 détenus éligibles à la libération conditionnelle avaient bénéficié de cet aménagement412(*).
Depuis le 1er juillet 2021, la libération conditionnelle relève d'une décision discrétionnaire du ministère public (cf. infra concernant les autorités compétentes). Les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an demeurent théoriquement admissibles à la libération conditionnelle après une certaine durée de détention mais une décision explicite est requise et le détenu ne peut contester celle-ci devant un juge (article 6:2:13 de la loi « punir et protéger »).
Plus précisément, les seuils de durée de détention applicables pour être éligible à la libération conditionnelle sont les suivants (article 6:2:10) :
- pour les peines comprises entre un et deux ans, la condition de durée de détention reste identique et doit correspondre à au moins un an, plus un tiers de la peine restant à purger. Par exemple, pour une peine d'emprisonnement d'un an et neuf mois, la libération conditionnelle peut avoir lieu après un an et trois mois ;
- pour les peines de plus de deux ans, la libération conditionnelle peut intervenir après avoir purgé les deux tiers de la peine mais pour une durée maximale de deux ans. Par exemple, une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de neuf ans ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé sept ans (contre six ans avant 2021).
La loi de 2021 maintient la durée minimale de probation d'un an en cas de libération conditionnelle. Ainsi, pour une peine d'emprisonnement de 30 mois, la période de probation est d'un an bien que le reliquat (10 mois) après avoir purgé les deux tiers de la peine d'emprisonnement (20 mois), reste inférieur à un an.
Une fois le seuil de durée de détention atteint, le ministère public s'appuie sur trois critères pour déterminer si une personne peut bénéficier d'une libération conditionnelle (article 6:2:10) :
- le comportement en détention : le détenu doit « mériter » la libération conditionnelle en se comportant bien tout long de la période d'incarcération et en faisant des efforts actifs en vue de sa réinsertion ;
- les risques pour la société : le condamné ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que si les risques peuvent être réduits « au minimum » grâce à certaines conditions (par exemple, le port du bracelet électronique, l'interdiction de contacter la victime) ;
- les intérêts des victimes : s'il y a des victimes et/ou des parents survivants dans une affaire, le ministère public doit prendre en compte leur souhait. Par exemple, il peut imposer une interdiction de contacter la victime ou de se rendre dans certains lieux comme condition à la libération conditionnelle.
Si la libération conditionnelle n'est pas accordée, le détenu doit atteindre au moins six mois avant d'introduire une nouvelle demande (article 6:2:13).
La libération conditionnelle est accordée à la condition générale que le condamné ne commette pas d'infraction pénale avant la fin de la période probatoire (article 6:2:11). Comme indiqué supra, elle peut en outre être assortie de conditions particulières relatives au comportement du condamné, dont le respect est suivi par le service de probation (Reclassering Nederland). Les conditions particulières peuvent comprendre notamment : l'interdiction d'entrer en contact ou de permettre à d'autres personnes d'entrer en contact avec certaines personnes ou institutions, l'obligation d'être présent ou de se présenter dans un lieu déterminé à des moments déterminés ou pendant une période déterminée, l'interdiction de consommer des stupéfiants ou de l'alcool et l'obligation de se soumettre à des analyses de sang ou d'urine, le placement du détenu dans un établissement de soins pendant une durée déterminée, le séjour dans un établissement d'hébergement accompagné ou d'accueil social pendant une durée déterminée, l'interdiction d'exercer certaines activités bénévoles, une restriction du droit de quitter les Pays-Bas, le remboursement total ou partiel du préjudice causé par l'infraction ou la mise en place d'un arrangement pour le paiement de l'indemnisation en plusieurs versements ou encore l'obligation de déménager d'une certaine région. De plus, toute condition particulière peut être assortie d'une surveillance électronique.
Si la personne condamnée commet une nouvelle infraction durant la période de probation, le ministère public peut révoquer la décision de libération conditionnelle et ordonner la poursuite de l'exécution de la peine. Cette décision s'ajoute à la peine infligée pour la nouvelle infraction. La personne condamnée peut contester cette décision de révocation devant le juge (article 6:2:13a).
En outre, en cas de violation des conditions particulières durant la période de probation, le ministère public a trois possibilités : émettre un avertissement, modifier ou renforcer les conditions ou bien révoquer totalement ou partiellement la libération conditionnelle (article 6:2:13b). L'option choisie dépend de la gravité de l'infraction et du comportement de la personne condamnée413(*).
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, il est possible de prolonger la période de probation des personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle de deux ans maximum (article 6:6:19). Pour les délits violents et sexuels graves, il est possible de prolonger plusieurs fois le délai de probation de deux ans au maximum. Le ministère public examine cette possibilité lorsque certains objectifs nécessaires à la réinsertion n'ont pas été atteints (par exemple, le traitement du détenu n'est pas terminé ou celui-ci n'a pas encore trouvé de logement convenable). La demande de prolongation de la période probatoire doit être soumise par le parquet au juge, pour décision414(*).
(b) La permission de réinsertion
À l'exception des personnes condamnées à perpétuité (cf. infra), tous les détenus sont en principe éligibles à une permission de réinsertion. Le moment à partir duquel des permissions de courte ou de longue durée peuvent être accordées varie cependant en fonction de la durée de la peine415(*) :
- en cas de peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six ans, la permission de réinsertion de courte durée est accessible après avoir purgé au moins six semaines de prison lorsqu'il s'agit de préparer l'une des cinq conditions de base à la réinsertion ou au moins quatre mois ainsi que la moitié de la peine s'il s'agit d'entretenir le réseau social ou pour une permission de longue durée. Dans tous les cas, une condition supplémentaire de proximité de la possibilité de libération conditionnelle s'applique : les permissions de réinsertion de courte ou de longue durée ne peuvent être accordées que dans une période variant de 18 à 12 mois avant une éventuelle libération conditionnelle ;
- en cas de peine d'emprisonnement de plus de six ans, la permission de réinsertion de courte durée peut être accordée, au plus tôt, six mois avant la date à laquelle le détenu peut prétendre à une permission de réinsertion de longue durée, ce dernier étant lui-même possible à partir d'une période minimale avant l'éventuelle libération conditionnelle (correspondant à 12 mois, plus un mois et demi par année complète de peine d'emprisonnement au-delà de six ans).
Depuis la réforme de 2021, l'octroi de permissions de réinsertion aux détenus est moins évident et assorti de davantage de conditions. Ainsi, la permission n'est désormais accordée qu'en vue d'atteindre les objectifs de réinsertion des détenus fixés dans le plan de détention et de réinsertion. Pour tous les types de permission de réinsertion, la décision d'accorder une permission doit tenir compte des critères suivants : le comportement du détenu durant la durée de sa détention et son aptitude à se réinsérer, les risques éventuels pour la société liés à sa permission, les intérêts des victimes et/ou de leurs proches ainsi que les efforts déployés par le détenu pour réparer les dommages causés par l'infraction416(*).
Des conditions spécifiques s'appliquent aux permissions de réinsertion hors les murs en BBA : celui-ci ne concerne que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et ne peut être accordé que pour une durée ne dépassant pas un sixième de la peine prononcée, dans la limite de douze mois417(*). De façon temporaire, entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025, la durée du séjour en BBA peut atteindre jusqu'à un tiers de la peine prononcée (cf. encadré supra). Ce type d'aménagement de peine n'est accordé qu'à la condition d'avoir une formation et/ou un emploi régulier, ce qui nécessite une préparation en amont. Au plus tôt, le placement en BBA est possible après cinq mois de détention418(*).
Le directeur d'établissement pénitentiaire ou le ministère de la Justice et de la Sécurité, responsables de la décision d'octroi de permission de réinsertion (cf. infra), peuvent refuser la demande de permission notamment pour les motifs suivants : un soupçon sérieux que le suspect ne reviendra pas en détention, un risque de trouble grave à l'ordre public, de troubles sociaux, de commission d'infraction pénale, de confrontation non désirée avec la ou les victimes, de danger pour le détenu lui-même ou encore en l'absence d'une adresse acceptable durant la permission419(*).
En pratique, un plan de détention et de réinsertion comprend souvent plusieurs permissions de réinsertion de courte ou de longue durée, en vue d'atteindre les objectifs visés.
Par ailleurs, des règles spécifiques s'appliquent pour certaines catégories de détenus :
- les détenus séjournant dans des établissements pénitentiaires pour « multirécidivistes » (stelselmatige daders). La durée de la permission de réinsertion est de deux heures minimum à maximum 52 heures par semaine420(*) ;
- les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer la durée restante de la peine, ce groupe de détenus ne peut en principe pas bénéficier de permissions de réinsertion de courte ou de longue durée. Cependant, après avoir purgé 25 ans de peine, un condamné à perpétuité peut introduire une demande de permission de réinsertion auprès du ministre de la justice et après avis du conseil consultatif pour les condamnés à perpétuité421(*). Si la permission est accordée, il est dans ce cas systématiquement soumis à une condition de surveillance électronique422(*).
L'un des principaux objectifs de la permission de réinsertion est d'apprendre au détenu à gérer à nouveau ses libertés et ses responsabilités. Selon l'agence des établissements pénitentiaires DIJ, il n'est donc pas exclu qu'un détenu ne revienne pas à temps de sa permission, voire qu'il s'enfuie423(*). Il s'agit alors d'une absence non autorisée. Dans ce cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut révoquer ou reporter tout ou partie des permissions suivantes, imposer des conditions particulières pour la prochaine permission (accompagnateur, surveillance électronique) ou encore demander le transfert du détenu dans un autre établissement424(*). Le nombre d'absences non autorisées s'établissait entre 0,03 % et 0,06 % du nombre total de permissions octroyées au cours des cinq dernières années425(*).
(c) La permission de capacité sous surveillance électronique
Conçue comme une mesure temporaire en raison de problèmes de capacité au sein du système pénitentiaire, la permission de capacité sous surveillance électronique peut être octroyée par un directeur de prison depuis le 1er juin 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Comme indiqué précédemment, les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement comprise entre quatre semaines et un an sont éligibles à la permission de capacité, à condition d'avoir purgé deux tiers de leur peine. Les détenus multirécidivistes et les détenus violents (identifiés à partir des résultats d'un texte de dépistage du risque de violence) ne sont pas éligibles à ce type de permission426(*).
Le directeur de l'établissement pénitentiaire décide, après coordination avec le service de probation, quels détenus bénéficient d'une permission de capacité, sur la base de deux critères principaux : le comportement du détenu et la durée de la peine restant à purger (plus la durée résiduelle est courte, plus un détenu a de chance de bénéficier d'une permission de capacité). Le directeur de la prison détermine également la durée de la permission (au maximum un tiers de la peine prononcée), en tenant compte de la durée prévue des problèmes de capacité427(*).
La permission de capacité est accordée dans les conditions suivantes428(*) :
- le placement systématique sous surveillance électronique ;
- la non-commission d'infraction durant la durée de la permission ;
- la présence obligatoire du détenu à l'adresse de résidence, sauf durant les heures de sorties autorisées par le directeur d'établissement pénitentiaire (au maximum deux heures par jour) ;
- l'absence de consommation d'alcool ou de drogue, contrôlée au moyen d'analyses d'urine ;
- la coopération du détenu au contrôle du respect de ces conditions par le service de probation.
(d) La détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire
La réforme pénale de 2021 a restreint les conditions d'accès au programme pénitentiaire. Alors que les détenus condamnés à des peines d'une durée supérieure à un an pouvaient auparavant en bénéficier, seuls ceux devant purger une peine d'emprisonnement ferme comprise entre six mois et un an sont désormais éligibles. La durée du programme pénitentiaire correspondant à un sixième de la peine prononcée, soit entre 4 semaines et 2 mois. Le programme pénitentiaire concerne donc essentiellement les détenus qui ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle en raison de la durée restreinte de leur peine429(*).
Comme les permissions de réinsertion, le programme pénitentiaire n'est autorisé que s'il contribue430(*) à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du plan personnel de détention et réinsertion du détenu. Il s'agit d'un programme sur mesure, comprenant au moins 26 heures d'activités hebdomadaires431(*) en vue d'obtenir un travail, un revenu et un logement, et qui fournit un cadre pour préparer progressivement les détenus à leur retour dans la société. Le détenu doit rester à son domicile la nuit, a minima de 23 heures à 6 heures.
L'octroi du programme pénitentiaire par le directeur d'établissement pénitentiaire se fonde sur trois critères : le comportement du détenu, les risques qu'il représente et les intérêts de la victime. Le comportement du détenu a toutefois un poids déterminant dans la décision (80 %). Des avis du service de probation, de la police (en particulier pour vérifier l'adresse de résidence et/ou de l'employeur) et dans certains cas du ministère public sont requis432(*).
Faisant partie de l'exécution de la peine, le programme pénitentiaire se déroule sous la responsabilité du directeur d'établissement pénitentiaire et peut être assorti de conditions particulières, comme la surveillance électronique en cas de risques identifiés et/ou de nécessité pour protéger les victimes. Chaque détenu bénéficiant du programme pénitentiaire est suivi par un gestionnaire (case manager) vérifiant le respect des conditions et suivant les progrès en termes de réinsertion433(*).
Enfin, en cas de violation des conditions générales ou particulières ou de non-participation au programme, le directeur peut, en fonction de la gravité du comportement, donner un avertissement au détenu, modifier ou prévoir de nouvelles conditions particulières, mettre fin au programme voire en cas d'urgence, le replacer immédiatement en détention434(*).
(3) Les autorités compétentes
Le système néerlandais se caractérise par l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines et le rôle prédominant de l'administration dans les décisions d'aménagement de peines435(*). Cette spécificité a été renforcée par la loi sur l'exécution des décisions pénales436(*) qui, à compter du 1er janvier 2020, a transféré la responsabilité de l'exécution des peines du ministère public (Openbaar Ministerie, OM) vers le ministre de la Justice et de la Sécurité - qui a délégué cette tâche à l'Agence des établissements pénitentiaires (Dienst Justitiële Inrichtingen, DIJ)437(*). Le parquet demeure compétent en matière de libération conditionnelle.
(a) La libération conditionnelle
La décision de libération conditionnelle relève de la responsabilité d'un service spécialisé du ministère public : le service central pour la libération conditionnelle (Centrale Voorziening voorwardelijke invrijheidstelling, CVv.i.)438(*). Ce service consulte obligatoirement le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service de probation avant de prendre une décision (article 6:2:12) et peut également consulter les services de police, le procureur général et les experts ayant traité l'affaire. Le CVv.i. doit aussi demander aux victimes ou à leurs proches s'ils ont des souhaits à formuler en cas de libération conditionnelle.
Dans certains cas graves et complexes, le CVv.i. peut faire appel au Comité consultatif sur la libération conditionnelle (Adviescollege voorwaardelijke invrijheidstelling, AVI)439(*), qui a été créé par une décision du Conseil des procureurs généraux. L'AVI se compose de onze juristes et experts et fournit un avis indépendant sur les décisions de la CVv.i440(*). Cet avis n'est pas juridiquement contraignant.
(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire
Dans la plupart des cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire où le détenu est incarcéré décide de l'octroi d'une permission de réinsertion, d'une permission de capacité ou de la participation au programme pénitentiaire.
S'agissant des permissions de réinsertion, le directeur d'établissement doit préalablement recueillir des informations auprès de la commission des libertés de l'établissement et du fonctionnaire chargé de la sélection de l'agence DIJ441(*). Dans certains cas, le directeur est tenu de demander l'avis préalable du ministère public, par exemple en cas de délit grave contre les moeurs, de délit grave avec violence ou de traite d'êtres humains442(*). Pour les détenus condamnés à perpétuité, ce n'est pas le directeur qui décide de la demande de permission, mais le fonctionnaire chargé de la sélection (selectiefunctionaris) de l'agence DIJ443(*).
(4) Les données statistiques
· Contexte
Les Pays-Bas se distinguent par la proportion très importante de peines d'emprisonnement de courte durée. Selon un rapport du centre de recherche et de données (WODC)444(*) du ministère de la Justice et de la Sécurité publié en 2023 et mis à jour en 2025, chaque année, les tribunaux néerlandais prononcent 20 000 peines privatives de liberté445(*), dont 70 % sont inférieures à 3 mois446(*).
Le taux de récidive deux ans après la sortie était de 26,6 % en 2023 selon l'administration pénitentiaire447(*), tandis que le Bureau central des statistiques indique que 6 détenus sur 10 avaient déjà été incarcérés par le passé448(*).
S'agissant du système pénitentiaire, en décembre 2024, les prisons néerlandaises disposaient d'environ 11 000 places, avec un taux d'occupation de 80 %449(*). Cependant, 1 781 places (16 %) étaient inutilisables en raison de problèmes liés au manque de personnel ou à des conditions de détention inadaptées450(*). À cet égard, il convient de noter que la détention en cellule individuelle est en principe la norme aux Pays-Bas depuis 2002, bien que la détention en cellule partagée soit admise. En 2023, sur 8 963 détenus, 69 % étaient incarcérés en cellule individuelle et 31 % en cellule partagée (quasi exclusivement à deux personnes)451(*).
Malgré les problèmes de capacité du système pénitentiaire rencontrés depuis 2023, la population carcérale demeure relativement faible aux Pays-Bas avec un taux d'incarcération de 45 pour 100 000 habitants en 2023, parmi les plus faibles d'Europe (contre 65 pour 100 000 en Allemagne et 110 pour 100 000 en Angleterre et au Pays de Galles)452(*).
Après une période de baisse très importe du nombre de personnes incarcérées (environ 50 000 en 2005) et l'atteinte d'un niveau historiquement bas en 2020 (27 300 personnes), celui-ci s'est stabilisé autour de 30 000 personnes incarcérées par an depuis 2021453(*). En raison du nombre très important de courtes peines et du recours important aux aménagements de peine, le système reste caractérisé par un fort taux de rotation des détenus au sein des établissements.
· Les libérations conditionnelles
Les données publiées par le ministère public indiquent qu'entre 2016 et 2020, environ 1 100 nouvelles libérations conditionnelles étaient accordées en moyenne chaque année454(*), ce qui correspondait à environ 90 % des personnes éligibles455(*). Le nombre total de détenus sous libération conditionnelle était de 2 643 au 31 décembre 2020.
Les recherches n'ont pas permis d'identifier de données consolidées récentes permettant de mesurer les effets de la réforme de 2021 sur le nombre de libérations conditionnelles. Toutefois, selon les données du service de probation (Reclassering Nederland), environ 380 nouvelles ordonnances de contrôle ont été imposées en 2024 dans le cadre de la libération conditionnelle456(*). Ce chiffre ne reflète qu'une partie de l'ensemble des décisions de libération conditionnelle, car toutes ne s'accompagnent pas d'une surveillance de la probation.
· Les permissions de réinsertion et la détention à domicile dans le cadre du programme pénitentiaire
Les chiffres publiés par l'agence DIJ ne font pas état de statistiques concernant le nombre de permissions de réinsertion demandées et octroyées par l'administration pénitentiaire, ni concernant le nombre de participants au programme pénitentiaire.
On peut toutefois noter qu'en 2024, selon le service de probation (Reclassering Nederland), 3 500 personnes différentes ont fait l'objet d'une mesure de surveillance électronique (à l'aide d'un bracelet électronique)457(*).
b) Les alternatives à l'emprisonnement
Outre les peines privatives de liberté, le droit pénal néerlandais prévoit deux types de peines principales : l'amende (geldboet) et le travail d'intérêt général (taakstraf) (article 9 du code pénal)458(*). Les peines avec sursis (voorwaardelijke straffen) constituent également une alternative (article 14a du code pénal)459(*).
(1) Les amendes
Le montant minimal des amendes pénales est de 3 euros et peut aller jusqu'à 1,03 million d'euros pour les amendes de sixième catégorie460(*).
En 2019, le juge a prononcé une amende à titre de peine principale dans plus de 20 000 affaires pénales. Dans 86 % de ces affaires, seule une amende a été infligée à titre de peine principale, dans 9 % des cas l'amende était combinée à une peine d'emprisonnement et dans 5 % des cas l'amende était associée à une peine de travail d'intérêt général461(*).
(2) Le travail d'intérêt général
Les situations dans lesquelles une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée à titre exclusif sont énoncées à l'article 22 b du code pénal462(*). Il s'agit par exemple de condamnations pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement de six ans ou plus et qui ont entraîné une atteinte grave à l'intégrité physique de la victime, ou si le condamné s'est vu infliger, au cours des cinq années précédant les faits qu'il a commis, une peine de travail d'intérêt général pour un délit similaire. La durée maximale d'une peine de travail d'intérêt général est de 240 heures463(*).
Si le condamné n'exécute pas ou pas correctement la peine de travail d'intérêt général, une peine de détention de substitution est prononcée. Pour chaque tranche de deux heures de peine de travail d'intérêt général non exécutée, la peine maximale est d'un jour de privation de liberté464(*).
En 2019, le juge avait prononcé une peine de travail d'intérêt général en tant que peine principale dans près de 30 000 affaires pénales et, dans 66 % de ces affaires, la peine de travail d'intérêt général n'était associée à aucune autre sanction.
En 2024, 28 500 peines de travaux d'intérêt général ont été exécutées en tout ou partie, selon le service de probation. 16 % des peines de travail d'intérêt général ont été interrompues prématurément et 10 % n'ont pas pu être entamées pour cause de renvoi devant la justice. Les peines de travail d'intérêt général prononcées par un juge avaient une durée moyenne de 74 heures contre 45 heures en moyenne pour les travaux d'intérêt général prononcés par ordonnance pénale du ministère public465(*).
Les recherches menées par le WDOC en 2021 montrent que les personnes ayant effectué un travail d'intérêt général ont 47 % de risques en moins de récidiver que les condamnés ayant effectué une peine d'emprisonnement466(*).
(3) Les peines avec sursis
Aux termes de l'article 14a du code pénal, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, à une peine de détention (hechtenis) - à l'exclusion de la peine de substitution, à un travail d'intérêt général ou à une amende, le juge peut décider que la condamnation ou une partie de la condamnation ne sera pas exécutée. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et inférieure ou égale à quatre ans, la durée de la peine transformée en peine avec sursis ne peut excéder deux ans. Le juge peut en outre décider que les peines supplémentaires ne seront pas exécutées en tout ou en partie.
Les peines avec sursis sont généralement accompagnées d'une période de probation pouvant aller jusqu'à trois ans467(*). En plus de la condition générale de ne pas commettre de nouvelle infraction pénale, des conditions particulières peuvent être imposées telles que la réparation totale ou partielle du dommage causé, l'interdiction de contact, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de consommer de l'alcool et/ou des drogues ou encore l'obligation de traitement et la participation à une intervention comportementale (gedragsinterventie)468(*).
Si une condition particulière est imposée lors du sursis probatoire, le condamné est tenu de coopérer, aux fins d'établir son identité, et de se soumettre à la prise d'une ou plusieurs empreintes digitales ou de présenter un document d'identité lors des inspections de contrôle et de se présenter aussi souvent que nécessaire au service de probation, Reclassering Nederland.
En outre, une condition particulière peut être assortie de la surveillance électronique469(*).
Reclassering Nederland a opéré la surveillance de 14 000 personnes condamnées ou en attente de jugement, dont 3 000 nouvelles décisions de sursis probatoire prononcées en 2024470(*).
(4) Les critiques relatives aux courtes peines d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances pénales
Dans un rapport d'évaluation de 2023, le WDOC a conclu que les courtes peines privatives de liberté n'ont généralement pas l'effet escompté. Après une courte peine privative de liberté, les personnes sont en fait plus susceptibles de récidiver qu'après une amende, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté avec sursis. Selon ce même rapport, « une courte peine privative de liberté semble n'avoir aucun effet dissuasif, ou seulement un effet dissuasif limité, par rapport à d'autres sanctions ». De plus, « les personnes condamnées perçoivent les courtes peines privatives de liberté comme étant aussi sévères que les peines non privatives de liberté légèrement plus longues »471(*).
Pendant une courte peine d'emprisonnement, l'offre d'activités de réinsertion est en effet limitée et les professionnels de la réinsertion sont peu accessibles, alors même qu'une courte peine d'emprisonnement peut avoir un impact négatif. En particulier, les hommes condamnés à une peine de courte durée continuent d'être confrontés, après leur condamnation à une combinaison de problèmes liés à l'alcool ou aux drogues, au mal-logement ou à des difficultés financières et/ou psychologiques472(*).
Les experts du WODC recommandent de recourir plus souvent à d'autres types de peines, jugées plus efficaces, telles que les amendes, les travaux d'intérêt général ou les peines de prison avec sursis473(*).
Tenant compte de ces conclusions et des problèmes de capacité du système pénitentiaire, le président du conseil des procureurs généraux du ministère public a annoncé, le 17 février 2025, un recours plus important aux sanctions extra-judiciaires, via les ordonnances pénales (Openbaar Ministerie strafbeschikking - OMSB)474(*). Le document intitulé « Punition et exécution : entre idéal juridique et pratique juridique »475(*) présente une nouvelle politique pénale du ministère public consistant à renvoyer moins d'affaires devant le juge :
« Nous voulons faire le meilleur usage possible des possibilités offertes par l'ordonnance pénale - que le procureur peut imposer sans intervention du tribunal. En d'autres termes, nous allons délivrer moins de citations à comparaître et plus d'ordonnances pénales. Non pas parce que nous prenons à notre charge les problèmes de capacité du pouvoir judiciaire et du système judiciaire, mais conformément aux objectifs initiaux du législateur. En 2008, ce dernier nous a donné le pouvoir d'utiliser les ordonnances pénales (OMSB) pour traiter nous-mêmes les infractions plus légères. Certes, l'objectif principal était de soulager le pouvoir judiciaire, mais ce n'est pas ce que nous avons envisagé ;
« L'ordonnance pénale existe depuis 17 ans et pendant tout ce temps, nous n'avons pas exploité au maximum son potentiel. Dans de trop nombreux cas, en particulier dans les affaires de police, nous avons continué à citer à comparaître inutilement. Nous allons procéder différemment. Il est temps que l'ordre des sanctions grandisse. Pour les affaires criminelles de droit commun, à commencer par les vols simples, les citations à comparaître deviendront l'exception476(*) » ;
« Par conséquent, ces délits seront moins souvent sanctionnés par une peine de prison - car celle-ci est et reste le monopole du juge - et plus souvent par une amende ou un travail d'intérêt général. D'autres formes de criminalité de droit commun, ainsi que des délits plus graves - passibles d'une peine maximale de six ans d'emprisonnement - peuvent, en vertu de la loi, être réglés par une ordonnance pénale et donc être punis différemment d'une peine d'emprisonnement. Nous voulons aussi y recourir davantage. Ce faisant, nous devons toujours garder à l'esprit que ces infractions ne concernent évidemment pas le meurtre et l'homicide involontaire. Les voies de fait graves, par exemple, sont passibles d'une peine maximale de huit ans. Dans ce cas, l'ordonnance de sanction n'est pas une option. Nous porterons toujours ces affaires devant les tribunaux. Mais pour le vol ou l'agression simple, des délits passibles d'une peine maximale de quatre et deux ans respectivement, la situation est donc différente »477(*).
Les ordonnances pénales du ministère public (OMSB)
Selon l'article 257a du code de procédure pénale478(*), les procureurs du ministère public peuvent imposer une ordonnance pénale pour les infractions et délits passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans. Il s'agit des infractions telles que les voies de fait simples, le vol à l'étalage, l'ivresse publique, les menaces, la conduite en état d'ivresse, les troubles à l'ordre public, la mendicité et le vandalisme.
Les peines et mesures suivantes peuvent être prononcées dans le cadre d'une ordonnance pénale :
- une peine de travail d'intérêt général d'une durée maximale de 124 heures ;
- une amende ;
- le retrait du permis de conduire ;
- l'obligation de verser à l'État une somme d'argent au profit de la victime ;
- l'interdiction de conduire des véhicules à moteur pendant six mois au maximum.
En outre, l'ordonnance pénale peut contenir des instructions que le prévenu doit respecter. Elles peuvent comprendre la renonciation aux objets saisis et susceptibles d'être confisqués, le paiement d'une somme d'argent ou la remise des objets saisis en vue de la confiscation totale ou partielle de l'avantage illégalement obtenu ou encore le versement d'une somme d'argent à déterminer au fonds pour les crimes violents ou à une institution qui a pour but de défendre les intérêts des victimes d'infractions pénales.
Certaines infractions faisant l'objet d'une ordonnance pénale (vol, ivresse sur la voie publique, conduite sans assurance et/ou sans permis et mise en danger sur la route)479(*) sont inscrites au casier judiciaire.
Selon l'article 257 e du code de procédure pénale480(*), une ordonnance pénale peut être contestée dans un délai de quatorze jours à compter de la date de remise en mains propres. Si l'ordonnance pénale a été prononcée dans les quatre mois suivant l'infraction et que l'amende n'excède pas 340 euros, il est possible de contester la sanction jusqu'à six semaines après la date d'envoi de l'ordonnance. Après ces six semaines, il n'est plus possible de s'opposer. La contestation peut être faite par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
En 2022, sur environ 185 décisions prises par le ministère public dans des affaires pénales, environ 35 000 ordonnances pénales ont été prononcées (contre seulement 12 700 en 2010)481(*).
c) Le recours à la justice restaurative
Le concept de droit à réparation (herstelrecht), que l'on peut également nommer « justice restaurative » en français, a été introduit en droit pénal néerlandais en 2011, à l'article 51 h du code de procédure pénale482(*).
Aux termes de cet article, :
« 1 [...] le ministère public encourage la police à informer le plus tôt possible la victime et l'accusé des possibilités de justice restaurative (herstelrechtvoorzieningen), y compris de médiation (bemiddeling).
« Si la médiation entre la victime et l'accusé a abouti à un accord, le juge, s'il prononce une peine et une mesure, en tient compte.
« Le ministère public favorise la médiation entre la victime et l'accusé ou la personne condamnée, après s'être assuré du consentement de la victime ».
L'article renvoie au pouvoir réglementaire pour adopter d'autres règles relatives à la justice restaurative.
En 2020, un « Cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale »483(*) a été adopté. Ce document juridiquement non contraignant fournit aux professionnels des lignes directrices et vise à harmoniser les pratiques. Il définit la justice restaurative comme des mesures permettant à une victime et un suspect ou un condamné de participer activement, sur une base volontaire et avec l'aide d'un tiers impartial, à un processus de réparation et à éliminer autant que possible les conséquences préjudiciables d'une infraction pénale484(*).
Il existe trois principaux instruments de justice restaurative aux Pays-Bas : la médiation restaurative (herstelbemiddeling), la médiation dans le cadre des affaires pénales (mediation in strafzaken) et les mesures de médiation et de réparation spécifiques aux mineurs délinquants dans le cadre du programme extra-judiciaire « Halt ».
(1) La médiation restaurative
La médiation restaurative consiste en des entretiens visant à la médiation et à la guérison émotionnelle, indépendamment de toute procédure pénale. Les parties s'engagent volontairement dans un dialogue sous la direction d'un tiers indépendant qui joue le rôle de médiateur. En principe, la médiation réparatrice peut avoir lieu à tout moment souhaité par les parties485(*).
Aux Pays-Bas, cette forme de médiation est conduite par la fondation à but non lucratif Perspectief Herstelbemiddeling486(*), qui est financée à cette fin par le ministère de la Justice.
Fin 2016, un cadre politique intitulé « Médiation restaurative au profit des victimes »487(*) a été élaboré : celui-ci vise notamment à encadrer la médiation réparatrice entre les victimes et les suspects ou les condamnés.
(2) La médiation pénale
Dans le cadre de la médiation pénale, le procureur ou le juge, à la demande ou non d'un partenaire de la chaîne pénale, du suspect ou de la victime, renvoie une affaire en cours devant les tribunaux à la médiation. Cette affaire est alors enregistrée auprès du bureau de médiation (mediationbureau) du tribunal488(*).
La participation à la médiation est volontaire tout au long du processus. Sous la direction d'un médiateur pénal489(*), des entretiens individuels sont d'abord organisés avec les parties. Si les parties le souhaitent, une réunion commune est ensuite organisée. Ces entretiens sont confidentiels et se déroulent dans la salle de médiation du tribunal.
La médiation pénale vise principalement à réparer les conséquences psychologiques et matérielles d'une infraction pénale. Elle offre la possibilité de conclure des accords et de les consigner dans un accord écrit, signé par les parties. Cet accord, appelé « accord de règlement », est joint au dossier pénal. Le procureur et/ou le juge tiennent ensuite compte de l'accord de règlement conformément à l'article 51 h du code de procédure pénale lorsqu'ils prennent une décision finale sur l'affaire pénale ou lorsqu'ils rendent leur jugement.
Une médiation pénale dure environ six semaines490(*). Elle est gratuite pour la victime, comme pour le suspect.
Comparaison entre la médiation restaurative et la médiation pénale
|
Médiation pénale |
Médiation restaurative (herstelbemiddeling) |
|
Uniquement possible pendant la procédure pénale. |
Possible à tout moment. En cas de procédure pénale, le recours à la médiation restaurative n'est possible qu'après que l'option de médiation pénale ait été examinée et jugée impossible ou non souhaitable. |
|
Seul un procureur ou un juge peut renvoyer à la médiation. |
Les victimes, les suspects, les auteurs d'infractions ou les condamnés peuvent faire une demande (en ligne) ou avec l'aide d'un professionnel. |
|
Commence dès que les deux parties sont d'accord. |
Commencer par la notification d'une partie motivée. |
|
Se déroule pendant une période définie (selon les lignes directrices : six semaines). |
Aucun délai d'exécution. |
|
Supervisée par le(s) médiateur(s) pénal(aux) |
Supervisée par un médiateur. |
|
Le contact entre le suspect et la victime se fait par le biais d'une conversation. |
Outre une conversation, d'autres formes de contact sont également possibles, par exemple une correspondance, plusieurs conversations ou une réunion en groupe. |
|
L'entretien se déroule dans un palais de justice. |
Les contacts entre les parties prenantes ont lieu dans les lieux choisis par les participants, en coordination avec le médiateur. |
|
Les points d'entente sont consignés dans un accord final écrit, joint au dossier pénal. |
Un rapport sur le contenu de la médiation (qui peut être partagé avec des tiers) est possible si les participants le souhaitent. |
|
Le procureur ou le juge prend en compte le résultat de la médiation. |
|
|
Lors de la réunion de médiation, les parents ou les personnes de confiance (professionnels) peuvent être présents. |
Outre la victime et le suspect ou l'auteur de l'infraction, les personnes de leur propre entourage et/ou des travailleurs sociaux peuvent être impliqués dans le processus. |
Source : Ministère de la Justice, https://perspectiefherstelbemiddeling.nl/sites/default/files/2021-12/211210_Informatieblad+Herstelrecht+na+een+strafbaar+feit.pdf
(3) Les mesures de médiation et de réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt)
Les mineurs qui commettent une infraction non grave peuvent être orientés vers un règlement extra-judiciaire dans le cadre du programme Halt491(*). Il s'agit notamment de permettre au jeune de faire face aux conséquences de leurs actes et de s'en excuser, soit par écrit, soit au cours d'une conversation avec la victime, tout en évitant des poursuites et une mention de l'infraction au casier judiciaire492(*).
Halt joue également le rôle de médiateur entre la victime et le jeune. Cette forme de réparation dans les affaires pénales impliquant des mineurs est généralement proposée avant l'engagement de poursuites judiciaires. Cependant, le procureur peut toujours décider de renvoyer l'affaire à Halt.
Le recours au programme Halt est limité à certaines infractions, fixées par décret, et prévoit des mesures d'une durée maximale de 20 heures493(*).
(4) L'évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale
Une évaluation du cadre de la politique de justice restaurative en matière pénale, adopté en 2020, a été présentée à la Chambre basse du Parlement néerlandais fin 2023494(*).
Selon la majorité des parties prenantes consultées, ce document a permis de clarifier l'articulation des deux principaux dispositifs - médiation restaurative et médiation pénale - aux différents stades de la procédure pénale, conformément à l'objectif visé495(*). Cependant, l'évaluation a révélé plusieurs sources de préoccupation :
- la possibilité de médiation restaurative dans une affaire pénale en cours n'est pas suffisamment garantie. La médiation pénale devrait quant à elle exclusivement avoir lieu durant la phase de poursuites par le ministère public ou durant la phase de jugement ;
- les professionnels qui peuvent informer les victimes, les suspects et les condamnés sur la possibilité de recourir à la justice restaurative ne connaissent pas encore suffisamment les différentes possibilités offertes et les méthodes de travail correctes ; cela nuit en particulier au « consentement éclairé » des victimes ;
- les liens entre les mesures de justice restaurative mises en place par la fondation Perspectief Herstelbemiddeling et les possibilités de médiation pénale ne sont pas assez développés (par exemple, une médiation restaurative peut être entamée au stade de l'enquête policière, puis donner lieu à une médiation pénale ultérieurement). Une meilleure coopération entre la fondation et le ministère public est souhaitable496(*).
ANNEXE 2
RAPPORT DE LA
MISSION D'URGENCE RELATIVE
À L'EXÉCUTION DES
PEINES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LE CONTRÔLE EN CLAIR
POUR CONSULTER LA PAGE DE LA MISSION
D'INFORMATION
https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-des-lois/execution-des-peines.html
* 1 68 % selon le sondage (CSA - Sénat) sur le rapport des Français à la justice, septembre 2021.
* 2 Rapport du casier judiciaire 2024.
* 3 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
* 4 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
* 5 L'acronyme CPIP désigne les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
* 6 Chiffres communiqués à la mission par la direction des affaires pénitentiaires.
* 7 OEuvres complètes, Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1857, p. 232.
* 8 Sondage (CSA - Sénat) sur le rapport des Français à la justice, septembre 2021.
* 9 Ce qui exclut les amendes.
* 10 Rapport d'information n° 713 (2017-2018), déposé le 12 septembre 2018.
* 11 C'est-à-dire la réalité de leur mise en oeuvre.
* 12 Soit leur capacité à atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été prononcées.
* 13 À cet égard, plusieurs organisations représentatives des magistrats auditionnées par les rapporteures, au premier rang desquelles la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires et l'association nationale des juges de l'application des peines, ont souligné que les difficultés actuellement constatées en matière d'exécution des peines découlaient moins du cadre juridique de cette dernière, que des délais d'audiencement et d'exécution du système juridictionnel et carcéral français.
* 14 Voir la partie C du titre Ier du rapport d'information.
* 15 Cet enjeu fera, d'ailleurs, l'objet d'une analyse approfondie dans la suite du présent rapport.
* 16 L'évolution du rôle des juges de l'application des peines fait l'objet de développements spécifiques ci-après (partie 1, B, 1).
* 17 Conseil économique, social et environnemental, avis, « Le sens de la peine », 2023, NOR : CESL1100022X.
* 18 Voir infra.
* 19 Article 464-2 du code de procédure pénale.
* 20 Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576
* 21 Toutefois, la Cour de cassation a également reconnu la possibilité de prononcer le principe de l'aménagement de peine sans déterminer la mesure attachée à celui-ci.
* 22 Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-82.981. La chambre criminelle considérait, avant cet arrêt - donc avant l'intervention de la LOPJ du 23 mars 2019 - que l'exigence de motivation pouvait être allégée lorsque certains éléments étaient absents ou insuffisants, par exemple pour apprécier la situation personnelle du prévenu (Cass. crim., 28 novembre 2012, n°s 12-81-140 et 12-80.639), ou encore sa situation matérielle, familiale et sociale ou son évolution (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 16-83.108).
* 23 Aux termes de cet arrêt, il appartient en effet à la juridiction de jugement, qui ne peut pas « refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée », d'ajourner le prononcé de la peine si le prévenu est présent et, en son absence, de « rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné ».
* 24 Source : mission d'information, sur la base des chiffres transmis par le ministère de la justice.
* 25 Les crédits de réduction de peine « automatiques » représentaient, selon l'étude d'impact du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, 8 284 319 jours effectivement crédités en 2019.
* 26 Article 721-1 du code de procédure pénale.
* 27 Article 721 du code de procédure pénale.
* 28 L'USM a précisé que ce phénomène se produit également lors « de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général ou à la suite du retrait d'un précédent aménagement de peine ».
* 29 Voir supra, encadré sur la libération sous contrainte.
* 30 La désistance désigne le processus par lequel un auteur d'infraction abandonne la délinquance ou la criminalité ; elle s'oppose donc à la récidive.
* 31 Rapport d'information n° 216 (2024 - 2025) sur l'intelligence artificielle et les professions du droit, fait par Christophe-André Frassa et Marie-Pierre de La Gontrie au nom de la commission des lois ; avis n°150 (2024 - 2025) sur le projet de loi de finances, tome VII, justice judiciaire et accès au droit, présenté par Lauriane Josende et Dominique Vérien au nom de la commission des lois.
* 32 Selon un sondage de 2022 cité par le Conseil économique, social et environnemental dans un récent rapport sur le sens de la peine, 65 % des citoyens estiment que les juges « ne mettent pas assez de sévérité dans leur action ».
* 33 Rapport précité.
* 34 Gestion Nationale des personnes Écrouées pour le Suivi Individualisé et la Sécurité.
* 35 Observations définitives de la Cour des comptes sur les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs, rendues publiques en juillet 2023. Lors de son audition [budgétaire], le ministre de la justice a indiqué souhaiter que le projet aboutisse en 2025, ce qui apparaît parfaitement irréaliste et constitue une source de préoccupation supplémentaire quant au pilotage du projet.
* 36 Ces bureaux étaient régis par le décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, mais n'avaient pas de base législative et n'avaient pas été institués dans l'ensemble des tribunaux concernés.
* 37 En particulier, le décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines.
* 38 L'information des parties civiles sur leurs droits est de plus en plus prise en charge par des bureaux exclusivement consacrés à l'aide aux victimes.
* 39 Les bureaux de l'exécution des peines sont notamment chargés d'expliquer au condamné les conséquences du non-paiement volontaire des dommages et intérêts.
* 40 Article 474 du code de procédure pénale.
* 41 Rapport précité sur la LOPJ du 23 mars 2019.
* 42 Rapport de la Cour des comptes du 4 mars 2025 « d'évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération : le travail d'intérêt général et la détention à domicile sous surveillance électronique ».
* 43 Rapport n° 11 (2018 - 2019) de François-Noël Buffet et Yves Détraigne, précité.
* 44 Service de la statistique, des études et de la recherche du ministère de la justice, Infos rapides justice n° 17 (24 septembre 2024), intitulé « Plus de 40 % des peines de prison ferme aménagées ou converties avant incarcération ».
* 45 Delphine Agoguet, Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie), Criminocorpus, revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, 2013.
* 46 Consulter la loi sur l'exécution des décisions pénales.
* 47 Consulter la page (consultée le 16 mai 2025).
* 48 Consulter la page (consultée le 20 mai 2025).
* 49 Consulter la page du Comité.
* 50 L'AVI a rendu des avis dans 45 affaires d'ici 2024.
* 51 Consulter la page (consultée le 20 mai 2025).
* 53 Ibid.
* 54 Source : Association nationale des juges de l'application des peines.
* 55 Conformément à l'article L. 622-2 du code pénitentiaire, « l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique. [...] Pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée. »
* 56 Article L. 631-1 du code pénitentiaire.
* 57 Article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
* 58 Article L. 113-4 du même code.
* 59 Ibid.
* 60 Source : ministère de la justice : consulter le rapport.
* 61 En 2015, l'administration pénitentiaire employait 26 734 personnels de surveillance. Source : ministère de la justice - Les chiffres clés de l'administration pénitentiaire au 1er janvier 2015.
* 62 Au premier janvier 2015, la France comptait 66 270 personnes détenues (Ibid).
* 63 Par le décret n°99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale.
* 64 Article L. 113-5 du code pénitentiaire.
* 65 Idem.
* 66 Article L. 113-7 du même code.
* 67 Article L. 113-5 du même code.
* 68 Article L. 113-6 du même code.
* 69 Conformément à l'article L. 623-1 du code pénitentiaire.
* 70 Article L. 621-1 du code pénitentiaire.
* 71 Article L. 626-1 du code pénitentiaire.
* 72 Article 474 du code de procédure pénale.
* 73 Article L. 611-1 du code pénitentiaire.
* 74 Conformément à l'article L. 611-2 du code pénitentiaire.
* 75 Source : ANJAP.
* 76 Recommandation CM/Rec (2010)1 du Comité des ministres aux États membres sur les règles du Conseil de l'Europe relatives à la probation, 20 janvier 2010
* 77 Article 560 du code de procédure pénale.
* 78 La Cour de cassation a en effet limité la portée de l'article 560 du code de procédure pénale, en arrêtant que cet article ne s'appliquait pas à la signification des jugements contradictoires énumérés à l'article 498 du même code, suivant lequel « le délai d'appel court, en pareil cas et sans exception, à compter de la signification quel qu'en soit le mode » (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1973, pourvoi n° 72-91.173).
* 79 Article 230-19 du code de procédure pénale.
* 80 Cette fonction de recherche s'applique aux personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ; aux personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ; aux personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ; aux personnes ayant manqué à une obligation dans le cadre d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou sexuelles ; aux personnes ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une révocation d'un aménagement de peine.
* 81 Ces prérogatives sont listées aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale, relatifs aux enquêtes et aux contrôles d'identité et aux articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, relatifs aux interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques.
* 82 Conformément aux articles D. 49-30 et D. 49-35-2 du code de procédure pénale.
* 83 Article 709-1-2 du code de procédure pénale.
* 84 Article 709-1-3 du code de procédure pénale.
* 85 Article 723-9 du code de procédure pénale.
* 86 Article R. 631-10 du code pénitentiaire.
* 87 La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a également créé une brigade chargée de l'exécution des peines.
* 88 En 2024, seules 0,68 % des saisines de la BEDJ ont émané de tribunaux judiciaires situés hors de Paris et de la petite couronne.
* 89 En 2024, 3,91 % des saisines de la BEDJ ont émané de partenaires étrangers.
* 90 La DGPN estime que 74 % des inscriptions au fichier des personnes recherchées mobilisant les forces de sécurité intérieure relèvent « d'une mission de commissaire de justice afin de notifier une condamnation judiciaire ».
* 91 Les unités de gendarmerie ont, par exemple, effectué 5 071 interventions en lien avec un téléphone grave danger ou un bracelet anti-rapprochement en 2024.
* 92 À l'instar du contrôle, mentionné à l'article 709-1-1 précité, des obligations résultant de certaines condamnations, ou de la constatation, que permet l'article 723-9 précité, de l'absence irrégulière d'un condamné placé sous surveillance électronique.
* 93 Étude sur les sortants de prison 2016, réalisée par le service statistique du ministère de la justice et publiée en décembre 2024.
* 94 Bien que l'article L. 211-3 du code pénitentiaire prévoie un délai de neuf mois pour le transfert en établissement pour peine de toute personne condamnée, détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, les travaux du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont montré que ce délai était fréquemment excédé : ainsi, selon son rapport de 2024 sur les incarcérations de longue durée et les atteintes aux droits des détenus, « Parmi les personnes libérées en 2019 après avoir été condamnées à une ou plusieurs peines supérieures à cinq ans, la durée de leur affectation en maison d'arrêt a été en moyenne de 917 jours (soit deux ans et demi), dont 141 jours en détention provisoire et 776 dans l'attente de leur transfert ».
* 95 Ces enjeux sont évoqués par les rapporteures ci-après.
* 96 On constate toutefois une très nette augmentation du recours aux peines de prison ferme prononcées sur le temps long : selon le rapport public thématique de la Cour des comptes « Une surpopulation carcérale persistante, une politique d'exécution des peines en question » d'octobre 2023, 54 000 années de prison ferme étaient prononcées en 2000, contre 90 000 en 2019.
* 97 Rapport n° 780 (2024-2025), déposé le 25 juin 2025, sur la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme.
* 98 Il s'agit d'un accroissement de capacité pour la maison d'arrêt de Nîmes, du centre pénitentiaire dit « Baumettes 3 » et d'une structure d'accompagnement à la sortie à Ducos (Martinique).
* 99 Rapport d'information n° 37 (2023-2024), déposé le 18 octobre 2023.
* 100 Gérald Darmanin déclarait, lors de son audition par la commission des lois du Sénat le 28 mai 2025 : « Des prisons d'un nouveau type vont [...] être construites rapidement, trois fois plus vite que la normale, en dix-huit à vingt-deux mois. La première structure conçue sur ce modèle sera ouverte dans l'Aube, à Troyes. La place de prison y coûte deux fois moins cher : 200 000 euros la place contre 400 000 aujourd'hui - le premier appel d'offres a été lancé. »
* 101 Sud-Ouest (Florence Moreau), « Prison de Bordeaux-Gradignan : déjà 55 cellules à trois dans le nouveau bâtiment censé combattre la surpopulation », 10 septembre 2024,
* 102 Avis n° 150 (2024-2025), tome VI, déposé le 21 novembre 2024.
* 103 L'exécution immédiate des peines d'emprisonnement ferme concerne les condamnés qui avaient été placés en détention provisoire (et qui étaient donc déjà incarcérés avant l'audience) et ceux à l'encontre desquels est émis un mandat de dépôt à effet immédiat.
* 104 Les chiffres qui suivent sont issus des statistiques précitées du ministère de la justice pour l'année 2024 et portent, sauf indication contraire, sur l'année 2023.
* 105 Selon le rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines, les jugements contradictoires à signifier représentaient 21,9 % des jugements rendus par les tribunaux correctionnels en 2023, soit un chiffre brut de 69 812 jugements - auxquels on peut ajouter les 9 817 jugements rendus par défaut.
* 106 Voir supra, partie I, A, 2.
* 107 Voir supra, partie I, A, 2, c.
* 108 Article 14 de la loi n° 2021-1729 précitée.
* 109 Il s'agit du décret n° 2023-332 du 3 mai 2023.
* 110 Rapport de la mission d'urgence sur l'exécution des peines.
* 111 Rapport d'information n° 650 (2024-2025), déposé le 21 mai 2025.
* 112 De manière convergente, Carmellita Dijoux, substitut du procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion, indiquait lors de son audition par les rapporteures que son ressort comptait seulement 6 places pour le placement extérieur des condamnés pour des violences intrafamiliales, alors que ceux-ci représentent environ 30 % des détenus.
* 113 Rapport précité.
* 114 Certains quartiers raccourcissent la durée de présence des détenus en raison de flux entrants trop importants, tandis que d'autres y maintiennent les détenus au-delà de la durée de référence pour éviter d'ajouter à l'embolie des quartiers « maison d'arrêt ».
* 115 Dans son rapport précité sur la surpopulation carcérale, la Cour des comptes rappelait que le taux moyen d'occupation des quartiers de prévention de la radicalisation était inférieur à 50 % et que le taux d'« encadrement » par des personnels pénitentiaires y était largement plus élevé qu'en maison centrale (avec une différence du simple au triple, par exemple, à Vendin-le-Vieil).
* 116 Rapport précité de la Cour des comptes sur la surpopulation carcérale.
* 117 Mission d'urgence sur l'exécution des peines.
* 118 Voir supra, partie I, B, 2.
* 119 Loi n° 2021-1729 précitée.
* 120 Rapport précité sur le sens de la peine.
* 121 Audition précitée du 28 mai 2025.
* 122 Article L. 3411-8 du code de la santé publique.
* 123 Rapport « Incarcérations de longue durée et atteintes aux droits », rendu public en janvier 2024.
* 124 Interrogée par les rapporteures, la DAP avouait d'ailleurs ne pas connaître le nombre de personnels de soins affectés dans les établissements pénitentiaires et renvoyait, sur ce point, au ministère de la santé.
* 125 Par un arrêt du 28 juin 2022 (Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-82.981), la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la juridiction de jugement ne pouvait ni « refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée », ni même « refuser d'aménager la peine en se fondant sur [la] seule absence [du prévenu] », ce qui rend dans les faits difficile, voire impossible, de refuser l'aménagement à la personne condamnée.
* 126 Infos rapides Justice n° 17, publié le 24 septembre 2024.
* 127 C'est-à-dire soit ab initio par la juridiction de jugement, soit par le juge de l'application des peines.
* 128 Ce chiffre s'établit à 63 % entre janvier et avril 2025, selon les statistiques communiquées par la DAP.
* 129 Partie I, A, 1.
* 130 Rapport précité sur la surpopulation carcérale.
* 131 Infos Rapides justice n° 25, avril 2025.
* 132 Rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines.
* 133 Audition de la CNPTJ par la mission.
* 134 DAP, citée par l'avis pour un mécanisme contraignant de régulation carcérale (A - 2024 - 4) rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et publié le 31 mai 2024.
* 135 Rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines.
* 136 Anaïs Henneguelle, Benjamin Monnery, 2017, Prison, peines alternatives et récidive, in Revue française d'économie, Presses de Sciences-Po, vol. 0(1), pages 169-207.
* 137 Tableau présenté dans l'étude d'impact sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, avril 2021, p. 170.
* 138 La CNPTJ rappelle que le même type de contradiction se produit en cas de révocation de sursis : « La LSC de plein droit conduit à des situations incompréhensibles dans lesquelles un JAP révoque un sursis mais doit ensuite mettre en place une LSC ».
* 139 Rappelons qu'aucun médecin n'est affecté dans les quartiers ou centres de semi-liberté.
* 140 Avis sur la réinsertion économique des personnes détenues, novembre 2019.
* 141 Étude sur la récidive des sortants de prison après un an, avril 2025.
* 142 Sondage sur le rapport des Français à la justice (CSA - Sénat), septembre 2021.
* 143 Ministère de la justice, L'exécution et l'application des peines, édition 2023
* 144 Recommandation R (92) 16 du Comité des ministres aux États membres relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté adoptée le 19 octobre 1992.
* 145 Loi n°83-466 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale
* 146 Article 131-4-1 du code pénal.
* 147 Article 131-5 du même code.
* 148 Article 131-5-1 du même code.
* 149 Article 131-6 du même code.
* 150 Article 131-8-1 du même code.
* 151 Circulaire n° JUSD1908819 C / CRIM N°2018-00018
* 152 Circulaire n° JUSD2006590C du 24 mars 2020 relative à la présentation des dispositions relatives aux peines et entrant en vigueur le 24 mars 2020 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-22 et de réforme pour la justice, et des décrets n° 2020-81, 2020-128, 2020-187 des 3 et 18 février et 3 mars 2020
* 153 Direction de l'administration pénitentiaire, Séries statistiques des personnes placées sous main de justice 1980-2024.
* 154 Chiffres clés de la Justice.
* 155 En théorie, comme en témoignent les développements consacrés infra (partie II, C, 1) à la peine autonome de probation.
* 156 Données communiquées à la mission par la DACG.
* 157 Cour des comptes, Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025
* 158 75 % des TIG sont exécutés dans les trois ans après leur prononcé, 9 % sont convertis en une autre peine et 16 % ne sont pas ou ont débouché sur un échec imputable au condamné (Cour des comptes, 2025).
* 159 Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025.
* 160 Partie I, A, 2.
* 161 Contre un peu de moins de 17 000 en 2019.
* 162 Cour des comptes, Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025
* 163 Article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs.
* 164 Article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs.
* 165 La spécificité de l'office du juge des enfants en matière d'exécution des peines est présentée avec précision dans la partie du rapport qui lui est dédiée (I, B, a).
* 166 Rapport n° 291 (2020-2021) d'Agnès Canayer sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
* 167 Voir par exemple la décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 sur la loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
* 168 Le mineur peut toutefois être suivi par un autre juge des enfants se prononçant sur l'application de sa peine, notamment lorsqu'il ne s'agit pas du même ressort territorial. À titre d'exemple, l'article L. 611-9 du code de la justice pénale prévoit que « le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat ».
* 169 La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs avait préconisé, dans son rapport n° 340 (2001 - 2002) du 27 juin 2002, de « faire du juge des enfants le juge de l'application des peines », ce dernier étant jusqu'alors compétent lorsque le mineur était incarcéré. Cette préconisation a été intégrée à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, par l'adoption d'un amendement du rapporteur de la commission d'enquête, M. Jean-Claude Carle.
* 170 Article L. 611-5 du code de la justice pénale des mineurs.
* 171 Article L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs.
* 172 Article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs.
* 173 Toutes ces missions sont mentionnées à l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs.
* 174 Réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 1760 (XVIIe législature) déposée par la députée Anaïs Belouassa-Cherifi.
* 175 Projet annuel de performances du programme 182, dédié à la protection judiciaire de la jeunesse.
* 176 Source : ministère de la justice, Les chiffres clés de la justice, édition 2024. Voir également l' avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.
* 177 Selon le rapport établi par François-Noël Buffet et Yves Détraigne sur la LOPJ du 23 mars 2019 ( rapport n° 11 (2018-2019), tome I, déposé le 3 octobre 2018), 9 100 peines d'une durée inférieure ou égale à un mois avaient été prononcées en 2017, dont seules 600 avaient fait l'objet d'un mandat de dépôt.
* 178 Une crainte analogue a été exprimée par l'association s'agissant de la suppression, par la LOPJ du 23 mars 2019, des peines de moins d'un mois (voir supra).
* 179 Article L. 112-1 du code de la justice pénale des mineurs.
* 180 Voir supra, partie I, A, 2.
* 181 Avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.
* 182 Rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines (annexe 2) ; avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.
* 183 Loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.
* 184 Article R. 124-13 du code de la justice pénale des mineurs
* 185 Les chiffres qui suivent sont, sauf mention contraire, issus des statistiques rendues publiques par le ministère de la justice.
* 186 Note citée par le rapport, précité, de la mission d'urgence sur l'exécution des peines (annexe 2).
* 187 Rapport précité de la Cour des comptes.
* 188 CGLPL, avis du 17 novembre 2023 relatif à l'accès des mineurs enfermés à l'enseignement, Journal officiel du 31 janvier 2024.
* 189 Rapport de la Cour des comptes sur les établissements pour mineurs et les centres éducatifs fermés, octobre 2023.
* 190 CGLPL, recommandations en urgence publiées le 29 août 2025.
* 191 Cette appellation désigne le fait « d'enfermer un adolescent, dans un des trois locaux barreaudés, dépourvus d'assise, de point d'eau potable et de WC, situés dans le bâtiment disciplinaire, où aucune surveillance continue n'est assurée. Deux adolescents s'y trouvaient le 7 juillet après-midi, dont un depuis plusieurs heures et l'un d'eux avait uriné sur le sol. La durée de cette mesure varierait d'une demi-heure à cinq heures ».
* 192 D'après la récente mission thématique de l'IGJ sur les centres éducatifs fermés.
* 193 Idem.
* 194 Idem.
* 195 Avis n° 134 (2023-2024), tome VIII, de Laurence Harribey, déposé le 23 novembre 2023.
* 196 La mission thématique de l'IGJ soulignait que 46 % des personnes affectés en CEF étaient des contractuels, dont 86 % étaient en CDD, ce qui ne saurait aller sans poser des problèmes plus larges de stabilité des équipes.
* 197 Avis budgétaire précité sur les crédits de la PJJ au PLF pour 2024.
* 198 Infos rapides Justice n° 17, 2024 (précité).
* 199 Rapport n° 780 (2024 - 2025) sur la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, fait par Stéphane le Rudulier au nom de la commission des lois.
* 200 Il importe, pour les mêmes raisons, d'éviter à l'avenir d'introduire une exigence particulière de motivation en cas d'aménagement, les motivations spéciales étant en pratique très dissuasives pour les magistrats.
* 201 Voir la partie B du titre Ier du rapport d'information.
* 202 Voir la partie B du titre Ier du rapport d'information.
* 203 Article 450-1 du code pénal.
* 204 Article 222-37 du même code.
* 205 Inspection générale de la justice, Mission d'urgence relative à l'exécution des peines, mars 2025.
* 206 Voir supra, partie 1, A, 1.
* 207 Villettaz et al., The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge, Campbell systematic reviews, 2006
Killias et al., How damaging is imprisonment in the long-term? A controlled experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sentences on re-offending and social integration, Journal of Experimental Criminology, 2010
Hauswirth-Cazzaro, L'impact de la peine sur la récidive : Une expérimentation naturelle à partir des réformes du Code pénal suisse, Université de Lausanne, 2023
* 208 La France affiche à l'inverse une durée moyenne d'emprisonnement élevée, comme les rapporteures l'ont déjà souligné.
* 209 Celle-ci, toutefois, ne préconise pas la réintroduction dans notre droit des peines de prison ferme de moins d'un mois.
* 210 Cités par la mission d'urgence sur l'exécution des peines.
* 211 Rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines. Cette analyse est corroborée par le pédopsychiatre Maurice Berger : celui-ci faisait valoir auprès des rapporteures « l'importance des peines imposées rapidement, sans césure, incluant 15 jours de prison ferme et le reste sous la forme d'un sursis probatoire important » jouant le rôle d'une « épée de Damoclès ».
* 212 L'inadaptation de l'actuel « processus arrivant » aux très courtes peines, pointé par la DAP, milite de même pour que celles-ci soient exécutées dans des établissements dédiés plutôt que dans les quartiers d'établissements accueillant d'autres profils de condamnés.
* 213 Voir infra, proposition n° 20.
* 214 Voir la partie B du titre Ier du rapport d'information.
* 215 L'enjeu de la « purge » des situations pénales fait l'objet de développements spécifiques en sous-partie C de la présente partie.
* 216 Voir la partie A du titre Ier du rapport d'information.
* 217 Article D. 48-2 du code de procédure pénale.
* 218 Rapport d'information n° 713 (2017 - 2018) sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre, fait par Jacques Bigot et François-Noël Buffet au nom de la commission des lois.
* 219 Rapport d'information n° 353 (2022 - 2023) sur l'évaluation des services pénitentiaires d'insertion et de probation, fait par Marie Mercier et Laurence Harribey au nom de la commission des lois.
* 220 La loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice et de proximité et de la réponse pénale a ainsi transféré des JAP aux DPIP le soin de décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un Tig, sauf dans l'hypothèse où le JAP aurait décidé de les déterminer lui-même.
* 221 Voir infra, proposition n° 30.
* 222 Rapport précité sur la surpopulation carcérale et l'exécution des peines.
* 223 Loi n° 2023-1059 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023.
* 224 Corte costituzionale, sent. n. 386/1989 ; n. 22/1992.
* 225 Dans cette hypothèse, le suivi ne pourrait être modulé par le JAP qu'à la hausse, en réponse à une évolution négative de la situation du condamné, les modulations à la baisse ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai initial minimal.
* 226 En termes de suivi, d'accès à l'emploi, de liens personnels et familiaux, etc.
* 227 Article 721 du code de procédure pénale.
* 228 Le taux d'octroi de la LSC-D, qui s'établit à 63 % en dépit de son caractère théoriquement automatique, atteste d'un réexamen au cas par cas par les JAP et du caractère chronophage de cet exercice.
* 229 Proposition n° 7.
* 230 Voir supra, partie 1, A, d.
* 231 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
* 232 Bien qu'il fût saisi de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a modifié l'article 803-1 du code de procédure pénale pour intégrer les dispositions précitées, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur une éventuelle obligation de recueillir un consentement écrit du justiciable pour recevoir des documents judiciaires. Voir la décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015.
* 233 Le terme a notamment été employé par Anne Ponseille, maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit et de sciences politique de l'université de Montpellier.
* 234 À titre d'exemple, peut être citée la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a remplacé le sursis avec mise à l'épreuve par le sursis probatoire.
* 235 Voir supra, proposition n° 4.
* 236 La peine de probation serait en effet applicable aux mineurs ; des adaptations seraient vraisemblablement à prévoir s'agissant des modalités de révocation de la mesure, l'incarcération immédiate soulevant de réelles difficultés juridiques au vu des principes dégagés par le Conseil constitutionnel en matière de droit pénal des mineurs.
* 237 Certaines des personnes auditionnées par la mission d'information ont par ailleurs, à l'instar de Maurice Berger, critiqué le fonctionnement actuel des EPM : certains d'entre eux seraient ainsi marqués par un faible investissement des éducateurs, par une circulation aisée de produits stupéfiants et par l'absence de rupture des mineurs condamnés avec leur environnement délinquanciel, des jeunes retrouvant parfois leurs connaissances au sein des établissements.
* 238 Ministère de la Sécurité publique , Guide de calcul des peines, 2021, p. 7.
* 239 https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/peine-sentencing/imposees-imposed.html (consulté le 30 avril 2025).
* 240 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( LSCMLSC), article 127 et suivants.
* 241 Commission des libérations conditionnelles du Canada, La libération d'office et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
* 242 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, (DORS/92-620), article 161.
* 243 Commission des libérations conditionnelles du Canada, op. cit.
* 244 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 119 et suivants.
* 245 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 99.
* 246 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 99.
* 247 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 119.
* 248 Loi sur le système correctionnel du Québec, article 143 et suivants.
* 249 https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/peine-sentencing/imposees-imposed.html, (consulté le 30 avril 2025).
* 250 Code criminel du Canada, article 732(1).
* 251 Loi sur les prisons et les maisons de correction (L. R. C. (1985), ch. P-20), article 7 et suivants.
* 252 Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1.
* 253 https://www.cqlc.gouv.qc.ca/decisions/mesures-de-mise-en-liberte-sous-condition.html
(consulté le 30 mai 2025).
* 254 La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), tribunal indépendant rattaché au ministère de la Sécurité publique, statue sur la libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine de deux ans ou plus. Elle comprend 60 membres nommés par le gouverneur en conseil. Ses compétences incluent notamment l'octroi, la révocation et la suspension de la libération conditionnelle, ainsi que l'examen de certains cas militaires. Les peines inférieures à six mois échappent à sa compétence.
* 255 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L. C. 1992, chapitre 20.
* 256 Commission des libérations conditionnelles du Canada, op. cit.
* 257 Ibid.
* 259 https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/organisation/publications-et-formulaires/statistiques-liberation-conditionnelle-pardons-et-clemence.html
(consulté le 29 avril 2025).
* 260 https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/services/liberation-conditionnelle/qu-est-ce-que-la-liberation-conditionnelle.html (consulté le 30 avril 2025).
* 261 Ibid.
* 262 https://www.cqlc.gouv.qc.ca/decisions/mesures-de-mise-en-liberte-sous-condition.html
(consulté le 10 juin 2025).
* 263 Gouvernement du Québec, Profil des personnes condamnées à une peine discontinue, 2022-2023.
* 264 Ibid. p. 3.
* 265 Ibid. p. 3.
* 266 Ibid. p. 4.
* 267 Code criminel, articles 742 et suivants.
* 268 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/travaux-compensatoires,
(consulté le 3 juin 2025).
* 269 Ibid.
* 270 Code de procédure pénale du Québec, Annexe.
* 271 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/sante-mentale-alternative-emprisonnement (consulté le 3 juin 2025).
* 272 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 3 juin 2025).
* 273 Gouvernement du Québec, « Mieux comprendre le PAJ-SM+ ».
* 274 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 4 juin 2025).
* 275 Ibid.
* 276 Gouvernement du Québec, op. cit.
* 277 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
(consulté le 4 juin 2025).
* 278 Gouvernement du Québec, op. cit.
* 279 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/sante-mentale-alternative-emprisonnement (consulté le 4 juin 2025).
* 280 Service correctionnel Canada, Qu'est-ce que la justice réparatrice ?, 2023.
* 281 Ibid.
* 282 Ibid.
* 283 Ibid.
* 284 En vertu de l'article 5 f) de la LSCMLC.
* 285 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/programmes-lsjpa-pmrg-et-travaux-compensatoires
(consulté le 3 juin 2025).
* 287 LSJPA, article 18(2)a)(ii).
* 288 https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/services/scc-vous/justice-reparatrice/programme-possibilites-justice-reparatrice-mediation-entre-victime-delinquant.html
(consulté le 30 mai 2025).
* 289 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/programmes-lsjpa-pmrg-et-travaux-compensatoires
(consulté le 3 juin 2025).
* 290 Code criminel, article 716.
* 291 Code criminel, article 717.
* 292 Gouvernement du Québec, Programme de mesures de rechange général, paragraphe 2.1.
* 293 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice
(consulté le 3 juin 2025).
* 294 https://justicereparatricedequebec.org/
(consulté le 3 juin 2025).
(consulté le 3 juin 2025).
* 296 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
* 297 Andrea Moya Oreste, La libertad condicional en la legislación española: especial referencia a los penados extranjeros, mémoire de fin d'études dirigé par M José Bernuz Beneitez, Université de Saragosse, 2021, pp. 15-16.
* 298 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
* 299 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
* 300 En droit pénal espagnol, le troisième degré (tercer grado) correspond au régime de détention le plus ouvert dans le système de classification pénitentiaire, régi par la LOGP et le règlement pénitentiaire.
* 301 Esther Montero Pérez de Tudela, Le système de probation en Espagne, Les Cahiers de la Justice n° 48-49, janvier 2020.
* 302 Amaya Merchán González, La suspensión de la ejecución de la pena de prisión, ElDerecho.com, août 2022, pp. 7-8.
* 303 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
* 304 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 305 Ibid.
* 306 Andrea Moya Oreste, op. cit., p. 17.
* 307 Ibid., p. 20.
* 308 Ibid., pp. 24-25.
* 309 Les données statistiques décrites dans cette partie sont toutes issues du rapport général 2023 du secrétariat général des institutions pénitentiaires rattaché au ministère de l'Intérieur.
* 310 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 311 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 312 Ibid.
* 313 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 314 Ibid.
* 315 Ibid.
* 316 Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.
* 317 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 318 Esther Montero Pérez de Tudela, op. cit.
* 319 Ibid.
* 320 Ibid.
* 321 Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
* 322 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
* 323 Ollero Perán, Jorge Elías, Apuntes sobre la importancia de la primera regulación procesal de la justicia restaurativa en España, Diario La Ley, 10 janvier 2025, pp. 4-5.
* 324 GEMME España, Mapa preliminar de Justicia Restaurativa en España, avril 2023, pp. 69-70.
* 325 Ibid. pp. 3-5.
* 326 Ministerio del Interior, Justicia Restaurativa, Secretaría General Técnica, 2020, Brochure institutionnel publié par l'Administration pénitentiaire espagnole, p. 4.
* 327 GEMME España, op. cit. p. 8.
* 328 GEMME España, op. cit. p. 70.
* 329 Ibid. p. 69.
* 330 Ibid. pp. 56-58.
* 331 Ministerio de Justicia, Justicia Restaurativa - Servicio Público de Justicia, Gouvernement espagnol, janvier 2025, p. 2.
* 332 GEMME España, op. cit. p. 56.
* 333 Ibid., p. 69.
* 334 Ministerio del Interior, op. cit., p. 2.
* 335 Ibid., p. 3.
* 336 Ibid.
* 337 Ibid., p. 1.
* 338 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 4.
* 339 GEMME España, op. cit. p. 70.
* 340 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 7.
* 341 GEMME España, op. cit. pp. 70-73.
* 342 Ollero Perán, Jorge Elías, op. cit. p. 9.
* 343 Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.
* 344 Constitution, article 27.
* 345 LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
* 346 LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
* 347 Marie Moreau, Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013, p. 2.
* 348 Corte costituzionale, sent. n. 386/1989 ; n. 22/1992.
* 349 Cette restriction a toutefois été partiellement annulée par la Cour constitutionnelle ( sent. n. 56/2021), qui a jugé illégitime l'exclusion automatique liée à la récidive.
* 350 Corte costituzionale, sent. n. 215/1990.
* 351 Corte costituzionale, sent. n. 350/2003.
* 352 Corte costituzionale, sent. n. 414/1991.
* 353 Corte costituzionale, sent. n. 177/2009 et n. 211/2018.
* 354 LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)).
* 355 Corte costituzionale, sent. n. 78/2007.
* 356 Corte costituzionale, sent. n. 74/2020.
* 357 Corte costituzionale, sent. n. 186/1995.
* 358 Corte costituzionale, sent. n. 274/1983
* 359 Corte costituzionale, sent. n. 174/2022.
* 360 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023, p. 7.
* 361 Ibid., p. 8.
* 362 Andrea Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, in Sistema Penale, décembre 2023, p. 25.
* 363 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023, p. 8.
* 364 Ibid.
* 365 Ibid.
* 366 Ministero della Giustizia, Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, novembre 2023.
* 367 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
* 368 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 6.
* 369 CEDH (Quatrième section), Valerio Santoro c. Italie, Requête n° 44466/98, 1er mars 2001.
* 370 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 14.
* 371 Ibid.
* 372 Corte costituzionale, sent. 84/2024.
* 373 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, pp. 16-17.
* 374 Andrea Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, Sistema Penale, décembre 2023, p. 24.
* 375 Fabio Fiorentin, La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi, mars 2025, p. 20.
* 376 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, pp. 5-6.
* 377 Ibid.
* 378 DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
* 379 Ibid.
* 380 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
* 381 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023, p. 1.
* 382 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, pp. 15-16.
* 383 Gianluca Ruggiero, La giustizia riparativa nella fase esecutiva. Un'insolita pronuncia della Cassazione, 2024, p. 3.
* 384 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023, p. 6.
* 385 Ibid. p. 8.
* 386 Ibid. p. 7.
* 387 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa, p. 31.
* 388 Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, 2023.
* 389 F. Brunelli, C. Evangelista, A. Maniscalco, S. Tirrito, Vademecum - Giustizia riparativa.
* 390 https://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system-and-legislation/Districtcourts/Paginas/default.aspx
(consulté le 23 mai 2025).
* 391 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking (consulté le 23 mai 2025).
* 392 Wet straffen en beschermen
* 393 https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/detentiefasering/detentiefasering/ (consulté le 16 mai 2025)
* 394 Tweede titel Wetboek van Strafvordering
* 395 Penitentiaire beginselenwet
* 396 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 397 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 16 mai 2025).
* 398 Ibid.
* 399 https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen/regimes-en-doelgroepen/index-bba (consulté le 16 mai 2025).
* 400 Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
* 401 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/elektronische-monitoring (consulté le 19 mai 2025).
* 402 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 403 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 404 Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, kenmerk 5296720, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen
* 405 https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/capaciteitsverlof-voor-gedetineerden-van-start/ (consulté le 21 mai 2025).
* 406 Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2024, kenmerk 5296720, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen, Toelichting.
* 407 https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2024/09/27/begin-2025-worden-kortgestrafte-zelfmelders-weer-opgeroepen (consulté le 23 mai 2025)
* 408 https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen/zelfmelder (consulté le 23 mai 2025).
* 409 https://magazines.dji.nl/djizien/2021/06/wet-straffen-en-beschermen (consulté le 19 mai 2025).
* 410 Ibid.
* 411 https://www.om.nl/onderwerpen/voorwaardelijke-invrijheidstelling (consulté le 20 mai 2025).
* 412 Wet straffen en beschermen, Memorie van toelichting, p. 23
* 413 https://www.om.nl/onderwerpen/voorwaardelijke-invrijheidstelling (consulté le 20 mai 2025).
* 414 Ibid.
* 415 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, articles 19 à 20.
* 416 Ibid., article 15.
* 417 Ibid. article 20 bis.
* 418 Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
* 419 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 4.
* 420 Ibid., article 20 quater.
* 421 Ibid., article 20 quinquies.
* 422 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 21 mai 2025)
* 423 Ibid.
* 424 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 10.
* 425 Dienst Justitiële Inrichtingen, Jaarverslag 2023, p. 10
* 426 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, article 33 quater.
* 427 Ibid.
* 428 Ibid.
* 429 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 430 Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
* 431 Ibid.
* 432 Ibid.
* 433 Ibid.
* 434 Ibid.
* 435 Delphine Agoguet, Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie), Criminocorpus, revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, 2013.
* 436 Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
* 437 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 16 mai 2025).
* 438 https://www.om.nl/organisatie/ressortsparket/centrale-voorziening-voorwaardelijke-invrijheidstelling-cvv.i (consulté le 20 mai 2025).
* 439 Staatscourant 2021 nr. 37284
* 440 L'AVI a rendu des avis dans 45 affaires d'ici 2024.
* 441 https://www.dji.nl/justitiabelen/onderwerpen/verlof/verlof-voor-gedetineerde-volwassenen (consulté le 20 mai 2025).
* 442 Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
* 443 Ibid.
* 444 Le Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) est un institut de recherche indépendant, rattaché administrativement au ministère de la Justice et de la Sécurité.
* 445 Essentiellement des peines d'emprisonnement bien que cela comprenne également la détention provisoire (hechtenis).
* 446 https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2025/03/25/wetenschap-over-vrijheidsstraf-en-capaciteit et https://www.wodc.nl/documenten/publicaties/2025/3/31/one-pager-korte-vrijheidsstraffen
(consulté le 20 mai 2025).
* 447 https://www.dji.nl/over-dji/documenten/publicaties/2023/05/30/infographic-gevangeniswezen (consulté le 20 mai 2025).
* 448 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/38/in-2023-zaten-6-van-de-10-gedetineerden-al-eerder-in-detentie (consulté le 20 mai 2025).
* 449 https://www.nrc.nl/nieuws/2025/03/06/onbruikbare-cellen-weinig-personeel-en-steeds-meer-gedetineerden-hoe-nederlandse-gevangenissen-overbelast-raakten-a4885430 (consulté le 22 mai 2025).
* 450 Ibid.
* 451 Tweede Kamer, Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de dood van een gedetineerde in een meerpersoonscel, 2023
* 452 https://www.dji.nl/over-dji/documenten/publicaties/2023/05/30/infographic-gevangeniswezen (consulté le 20 mai 2025).
* 453 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/38/in-2023-zaten-6-van-de-10-gedetineerden-al-eerder-in-detentie
(consulté le 20 mai 2025).
* 454 https://www.om.nl/organisatie/ressortsparket/centrale-voorziening-voorwaardelijke-invrijheidstelling-cvv.i
(consulté le 20 mai 2025).
* 455 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2012D08327#:~:text=%5BPDF%5D%20Voorwaardelijk%20vrij%20,tig
(consulté le 20 mai 2025).
* 456 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/
(consulté le 20 mai 2025).
* 457 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/
(consulté le 22 mai 2025).
* 458 Artikel 9 Wetboek van Strafrecht
* 459 Artikel 14a Wetboek van Strafrecht
* 460 Artikel 23 Wetboek van Strafrecht
* 461 WODC, Cahier 2023-7, Korte vrijheidsstraffen, p. 32
* 462 Artikel 22b Wetboek van Strafrecht
* 463 Artikel 22c Wetboek van Strafrecht
* 464 Artikel 22d Wetboek van Strafrecht
* 465 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/ (consulté le 22 mai 2025).
* 466 Ibid.
* 467 Artikel 14b Wetboek van Strafrecht
* 468 Artikel 14c Wetboek van Strafrecht
* 469 Ibid.
* 470 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/organisatie/cijfers-en-feiten/ (consulté le 22 mai 2025).
* 471 https://www.wodc.nl/documenten/publicaties/2025/3/31/one-pager-korte-vrijheidsstraffen
(consulté le 22 mai 2025).
* 472 Ibid.
* 473 Ibid.
* 474 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 23 mai 2025).
* 475 Openbaar Ministerie, Straf en executie: tussen wettelijk ideaal en de rechtspraktijk, 2025
* 476 Sauf dans certains cas d'escroquerie avec abus de confiance.
* 477 https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking/nieuws/2025/02/17/het-openbaar-ministerie-gaat-strafbeschikking-meer-benutten (consulté le 23 mai 2025).
* 478 Artikel 257a Wetboek van Strafvordering
* 479 https://www.justid.nl/onderwerpen/strafblad-en-het-justitieel-documentatie-systeem/overtreding-en-uitzonderingen (consulté le 23 mai 2025).
* 480 Artikel 257e Wetboek van Strafvordering
* 481 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83944NED" \l "TotaalBeslissingenDoorOM_2
(consulté le 23 mai 2025).
* 482 Artikel 51h Wetboek van Strafvordering
* 483 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces
* 484 Ibid., p. 3.
* 485 Ibid.
* 486 https://perspectiefherstelbemiddeling.nl/ (consulté le 23 mai 2025).
* 487 Beleidskader herstelbemiddeling ten behoeve van slachtoffers
* 488 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, p. 4.
* 489 En pratique, presque toutes les médiations pénales se déroulent en présence de deux médiateurs. https://www.om.nl/onderwerpen/mediation (consulté le 23 mai 2023).
* 490 https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/mediation-in-strafzaken (consulté le 23 mai 2025).
* 491 https://www.halt.nl/ (consulté le 23 mai 2025).
* 492 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, p. 3.
* 493 Pour plus d'informations sur le fonctionnement du programme Halt, voir l'étude de législation comparée LC n° 344, « La lutte contre la délinquance juvénile », mars 2025.
* 494 Tweede Kaamer, Kaamerstukk 29279-829, Brief regering : Evaluatie Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, 2023
* 495 Ibid.
* 496 Ibid.