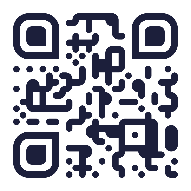- L'ESSENTIEL
- I. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : UN
PRÉREQUIS FONDAMENTAL DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE
- II. UNE DÉTECTION DES IDENTITÉS
FICTIVES QUI NE SUPPOSE PAS NÉCESSAIREMENT LA CRÉATION D'UN
FICHIER (ARTICLE 2)
- III. LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES FONDS LORS
DE LA CESSION AMIABLE : UNE PRATIQUE VERTUEUSE MAIS QUI NE PEUT
ÊTRE GÉNÉRALISÉE (ARTICLE 3)
- IV. LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :
UN RÔLE IMPORTANT DANS LE DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT QUI PEUT
ÊTRE RENFORCÉ (ARTICLES 8 ET 9)
- I. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : UN
PRÉREQUIS FONDAMENTAL DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 2
Création d'un fichier des identités fictives et des prête-noms
- Article 3
Justification de l'origine des fonds en cas de cession amiable
d'une société commerciale
- Article 8
Procédure de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés
- Article 9
Accès des greffiers des tribunaux de commerce à la documentation cadastrale
- Article 2
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 86
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2025
AVIS
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment,
Par M. Hervé REYNAUD,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Lauriane Josende, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, MM. Marc Séné, Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir le numéro :
|
Sénat : |
877 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi n° 877 (2024-2025) pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment déposée par Nathalie Goulet et Raphaël Daubet traduit certaines des recommandations qu'ils ont formulées dans le rapport de leur commission d'enquête n° 757 (2024-2025) « Ces dizaines de milliards qui gangrènent notre société » du 28 juin 2025. Si la proposition de loi a été renvoyée au fond à la commission des finances, celle-ci a délégué à la commission des lois l'examen au fond de quatre de ses neuf articles. Il s'agit, de :
· L'article 2, qui procède à la création d'un fichier recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment ;
· L'article 3, qui prévoit une obligation de justification lors de toute cession amiable de l'origine des fonds par l'acheteur d'une société commerciale ;
· L'article 8, qui entend étendre les prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles procédures de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS) introduites par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
· L'article 9, qui propose, à titre expérimental, d'ouvrir un accès direct aux données cadastrales détenues par la direction générale des finances publiques (DGFip) à trois greffes de tribunaux de commerce.
L'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée repose largement sur la capacité des autorités à « frapper au portefeuille », en démantelant les réseaux de blanchiment qui permettent aujourd'hui trop souvent aux criminels de réinjecter le produit de leur action dans l'économie réelle. D'importants progrès législatifs ont récemment été réalisés dans le domaine, à l'initiative du Sénat, avec notamment l'adoption de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 précitée visant à sortir la France du piège du narcotrafic ou de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Pour autant, la commission d'enquête de Raphaël Daubet et Nathalie Goulet a démontré que des marges de progrès subsistaient et que le perfectionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment demeurait un enjeu prioritaire, notamment dans sa dimension législative.
Réunie le 28 octobre sous la présidence de Muriel Jourda (Les Républicains - Morbihan), la commission s'est donc pleinement associée à la volonté des auteurs de la proposition de loi de se saisir de cet enjeu. À l'initiative de son rapporteur Hervé Reynaud (Les Républicains - Loire), elle a adopté quatre amendements visant à sécuriser juridiquement les rédactions proposées (article 9), à en supprimer les éléments redondants avec le droit existant (article 8) ou, lorsque cela était nécessaire, à leur substituer d'autres mécanismes d'action potentiellement plus efficaces (articles 2 et 3).
I. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : UN PRÉREQUIS FONDAMENTAL DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
La commission d'enquête précitée du 18 juin 2025 de Raphaël Daubet et Nathalie Goulet dressait le constat d'un dispositif anti-blanchiment encore insuffisamment efficace face à la masse des flux financiers illicites aujourd'hui observée. Cette vulnérabilité est d'autant plus préoccupante que, aux termes du rapport, « le blanchiment constitue en réalité le crime qui permet tous les autres ; en effet la réinjection de l'argent de la criminalité organisée dans l'économie réelle est le but ultime des trafiquants, quelle que soit leur " activité " ; par conséquent, lutter contre le blanchiment est la seule manière efficace de priver la criminalité de sa raison d'être et de l'empêcher de contaminer l'ensemble de l'économie et de la société ». Parmi les lacunes identifiées dans les mécanismes de lutte contre le blanchiment figuraient notamment :
· L'insuffisante appropriation, par les personnes assujetties de leurs obligations destinées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) (avec des déclarations de soupçons parfois peu nombreuses et à la qualité aléatoire) ;
· La régulation défaillante de certains secteurs particulièrement exposés au risque LCB-FT, en particulier le secteur immobilier ;
· Une sous-utilisation des dispositifs légaux existants, par exemple les possibilités de confiscation des avoirs criminels ;
· Un manque d'attractivité chronique de la filière économique et financière pour les enquêteurs, provoqué pour partie par des conditions de travail notoirement difficiles.
La conjugaison de ces éléments engendre un retard préoccupant des autorités publiques vis-à-vis de réseaux disposant de moyens quasi-illimités et capables d'exploiter chacune des failles de la législation pour mener à bien leur activité criminelle de blanchiment. S'il est difficile d'estimer de manière fiable les montants en jeu, le rapport rappelle que la Cour des comptes européenne évaluait en 2021 le blanchiment de capitaux à 1,3 % du PIB européen (soit 38 milliards d'euros par an dans le cas de la France). Dans ce contexte, la commission s'est pleinement associée à la volonté des auteurs de la proposition de loi de se doter d'outils supplémentaires pour la lutte contre le blanchiment, qui doit incontestablement être érigée en priorité.
II. UNE DÉTECTION DES IDENTITÉS FICTIVES QUI NE SUPPOSE PAS NÉCESSAIREMENT LA CRÉATION D'UN FICHIER (ARTICLE 2)
L'article 2 reprend la recommandation n° 6 de la commission d'enquête et insère dans le code de commerce un nouveau chapitre intitulé « du fichier national des identités fictives et des prête-noms ». Il autorise le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à créer un fichier recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment.
Les auditions du rapporteur ont confirmé que l'usage de prête-noms et d'identités fictives était monnaie courante dans les réseaux de blanchiment, complexifiant d'autant la détection des opérations illicites par les autorités de contrôles compétentes. Pour autant, elles ont également révélé que la création d'un fichier créerait probablement davantage de difficultés qu'elle n'en résoudrait. D'un point de vue opérationnel, un tel fichier serait facilement contournable par la multiplication d'identités fictives à usage unique. Par ailleurs, il pourrait avoir des effets collatéraux sur les victimes d'usurpation d'identité, qui peuvent devenir des « prête-noms » malgré elles. En conséquence, la commission lui a, à l'initiative du rapporteur, substitué une extension du champ des appels à la vigilance aujourd'hui émis par Tracfin en application de l'article L. 561-26 du code monétaire et financier (CMF). Le service pourrait désormais non seulement explicitement désigner aux personnes assujetties des personnes physiques particulièrement à risque mais également leur signaler les identités fictives et les prête-noms qu'elles utilisent ou sont susceptibles d'utiliser. Cet enrichissement de l'information apportée aux personnes assujetties aux règles LCB-FT leur permettra de cibler davantage leurs contrôles et de repérer au plus vite des cas de fraude documentaire.
III. LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES FONDS LORS DE LA CESSION AMIABLE : UNE PRATIQUE VERTUEUSE MAIS QUI NE PEUT ÊTRE GÉNÉRALISÉE (ARTICLE 3)
L'article 3 reprend la recommandation n° 11 de la commission d'enquête : « rendre systématique la vérification de l'origine des fonds avant la reprise d'une entreprise, en particulier dans les secteurs ciblés par les investissements de la criminalité organisée ». Dans le détail, il rétablit un article L. 141-1 au code de commerce pour prévoir une justification obligatoire de l'origine des fonds par l'acheteur dans le cadre de toute cession amiable d'une société commerciale. Cette justification serait remise au professionnel chargé de la rédaction de l'acte ou au greffier du tribunal de commerce, celui-ci étant alors tenu d'opérer une déclaration de soupçon à Tracfin « s'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liés au financement du terrorisme ». Il est par ailleurs prévu une application systématique de ce dispositif lorsque l'entreprise exerce une activité dans un secteur à risque ou lorsque le montant de la cession excède un seuil déterminé.
Les personnes auditionnées par le rapporteur ont unanimement confirmé que les cessions amiables de société commerciale représentaient un facteur de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. Pour autant, l'obligation de justification systématique telle qu'elle était proposée soulevait plusieurs difficultés. Comme cela a été souligné par la direction générale du trésor au cours de son audition, « la création de cette nouvelle obligation apparaît [tout d'abord] peu conforme à l'objectif général de simplification pour les entreprises ». De surcroît, cette obligation conduirait probablement à l'envoi massif de déclarations de soupçons d'un intérêt limité à Tracfin, au risque de saturer ses capacités d'investigation. La définition d'entreprises à risque ou d'un seuil d'activation de cette obligation ne semble pas de nature à surmonter ces difficultés. La désignation officielle de secteurs à risque pourrait être contreproductive en incitant les criminels à s'en détourner pour investir des champs économiques où la vigilance est moindre. Il en va de même de la fixation d'un seuil : la sous-évaluation des prix de vente étant une pratique courante en matière de blanchiment, celui-ci serait probablement rapidement vidé de toute portée.
Partageant l'objectif d'une plus grande vigilance sur les cessions amiables de sociétés commerciales, la commission a donc, à l'initiative du rapporteur, substitué à l'obligation prévue la création d'une nouvelle mesure de vigilance complémentaire applicable aux personnes assujetties aux règles LCB-FT. Concrètement, les professionnels en charge de la rédaction de l'acte de cession, en particulier les notaires ou les greffiers des tribunaux de commerce, auraient l'obligation de se renseigner auprès de l'acquéreur de l'origine des fonds lorsque le risque de blanchiment leur apparaît élevé. Cette approche par les risques serait plus adaptée qu'une obligation déclarative systématique particulièrement lourde. Elle s'insère par ailleurs mieux dans le cadre préexistant des mesures de vigilance complémentaire, qui est connu et maîtrisé par les acteurs et est par là même gage d'une plus grande efficacité.
IV. LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE : UN RÔLE IMPORTANT DANS LE DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT QUI PEUT ÊTRE RENFORCÉ (ARTICLES 8 ET 9)
L'article 8 apporte trois modifications au code du commerce et au CMF dans un objectif de renforcement des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce en matière de lutte contre le blanchiment :
· Il précise que les contrôles des titres d'identité étrangers qu'ils opèrent dans le cadre d'une demande d'immatriculation au RCS visent à « prévenir les risques de fraude ». La commission n'a pas remis en cause cette précision, dont le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a considéré qu'elle reconnaissait formellement « le rôle de tiers de confiance du greffier au coeur du dispositif national de transparence économique » et qu'elle renforçait ainsi « la légitimité du contrôle exercé par les greffes et la sécurité des procédures de publicité légale ». Elle a néanmoins relevé que lesdits contrôles pouvaient poursuivre d'autres objectifs, tels que la préservation de la qualité de l'information publiée, et a, à l'initiative du rapporteur et pour éviter tout risque d'a contrario, adopté un amendement précisant que la prévention de la fraude n'était pas leur finalité exclusive ;
· Il propose que l'institut national de la propriété industrielle (Inpi) soit informé au même titre que le ministère public des décisions de radiation d'office du RCS prises en application de l'article L. 561-47 du CMF ;
· Il prévoit explicitement la possibilité que, dans le cadre de cette procédure, « la société ou l'entité [puisse] demander au greffier de rapporter la radiation après régularisation, dans des conditions précisées par décret ».
La commission a, à l'initiative du rapporteur, supprimé ces deux derniers éléments qui sont satisfaits par le droit existant. L'Inpi est en effet déjà informé des radiations en sa qualité de teneur du registre national des entreprises, tandis que l'article L. 561-47 du CMF prévoit explicitement la possibilité de rapporter une radiation.
L'article 9 prévoit enfin la désignation, à titre expérimental de trois greffes de tribunaux de commerce qui pourraient accéder, pour une durée de deux ans, aux données cadastrales des immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort.
La commission n'a pas remis en cause cette expérimentation, qui reprend une recommandation du livre blanc des greffiers des tribunaux de commerce. Sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, elle a à ce stade, à l'initiative du rapporteur, adopté un amendement visant à sécuriser les conditions de sa mise en oeuvre. Ledit amendement limite premièrement cet accès aux seules finalités de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il prévoit deuxièmement que les modalités de mise en oeuvre de cet accès sont organisées de manière à garantir la traçabilité des consultations. Il impose troisièmement la conclusion d'une convention entre l'administration fiscale et les trois greffes expérimentateurs définissant les conditions d'accès aux données. La création d'un accès direct aux données cadastrales supposant par ailleurs d'importants travaux préparatoires, il prévoit par ailleurs une entrée en vigueur différée à partir du 1er janvier 2027.
*
* *
La commission a proposé à la commission des finances d'adopter les articles 2, 3, 8 et 9 ainsi modifiés.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
Création d'un fichier des identités fictives et des
prête-noms
L'article 2 crée un fichier national des identités fictives et des prête-noms tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Considérant qu'un tel fichier serait aisément contournable et pourrait avoir des effets collatéraux sur les victimes d'usurpation d'identité, la commission lui a, à l'initiative du rapporteur, substitué une extension du champ des appels à la vigilance émis par Tracfin en application de l'article L. 561-26 du code monétaire et financier afin d'y inclure explicitement la possibilité de signaler des identités fictives et des prête-noms utilisés par les personnes suspectées de blanchiment.
La commission a demandé à la commission des finances d'adopter cet article ainsi modifié.
1. La création d'un fichier des identités fictives et des prête-noms
L'article 2 de la proposition de loi insère un nouveau chapitre VIII bis au titre II du livre Ier du code de commerce, intitulé « du fichier national des identités fictives et des prête-noms ». Celui-ci autorise le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) à créer un fichier recensant les identités fictives et les prête-noms « impliqués dans des affaires de blanchiment » dans des conditions fixées après décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Les modalités pratiques de gestion du fichier et les garanties associées reprennent pour l'essentiel celles figurant aux articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce pour le fichier national des interdits de gérer (FNIG). Pour rappel, celui-ci est également tenu par le CNGTC et recense « les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ». Le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure est explicitement mentionné dans le fichier.
À l'instar de ce qui est actuellement prévu pour le FNIG, les greffiers des tribunaux de commerce disposeraient donc d'un accès permanent aux données contenues dans le fichier des identités fictives et des prête-noms prévu à l'article 2. Ces données seraient par ailleurs communiquées sur simple demande et sans frais aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux services du ministère de la justice pour l'exercice de leur mission (1° et 2°), à une liste de représentants de l'administration définies par décret dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes (3°) ainsi qu'aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région (4°).
L'article 2 prévoit par ailleurs une traçabilité de toutes les consultations et prohibe toute interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice.
Il s'agit de la reprise de la recommandation n° 6 de la commission d'enquête sénatoriale précitée de Raphaël Daubet et Nathalie Goulet sur le blanchiment1(*). Si celle-ci faisait le constat d'une multiplication de déclarations frauduleuses effectuées à partir de fausses identités ou d'identités usurpées - impliquant parfois l'usage de noms de personnes décédées. Les apports attendus d'un fichier dédié n'y sont toutefois que brièvement développés.
Rapport n° 757 (2024-2025) de
M. Raphaël Daubet et Mme Nathalie Goulet,
« Ces dizaines de milliards qui gangrènent la
société », 18 juin 2025 (extraits)
Si les déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs permettent en principe d'identifier les véritables personnes qui contrôlent la société, l'information sur l'identité communiquée est purement déclarative, ce qui ouvre la voie à de fausses déclarations. Cette situation plaide pour un renforcement des moyens de contrôle de greffiers. Or, l'open data, qui se traduit par une diffusion large et gratuite des données sur internet, facilite d'autant plus la falsification des documents et l'usurpation des identités et qualités, particulièrement utilisés dans la constitution de sociétés éphémères. Pour Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, « cet open data insuffisamment régulé (...) constitue un terreau propice à la fraude ».
À titre d'illustration, il arrive que certaines personnes décédées continuent de figurer dans les registres tenus par les greffiers. Or, ces derniers n'ont pas la possibilité de croiser les données de ce registre avec celles du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Dès lors, pour créer une société éphémère, il suffit tout simplement de prendre l'identité de l'une de ces personnes décédées, sans qu'aucun soupçon ne soit éveillé. Il serait utile de permettre aux greffiers, sous réserve d'une consultation de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), d'accéder au RNIPP afin de croiser les données de ce registre avec celles du RBE et du RCS (...).
Enfin, le rapporteur estime qu'il serait utile que les greffiers de tribunaux de commerce puissent disposer d'un fichier central contentant l'identité des prête-noms ou des faux papiers d'identité utilisés pour la création de sociétés éphémères, afin de prévenir les comportements récidivistes.
Recommandation n° 6 : Créer un fichier central diffusé entre les greffiers de tribunaux de commerce contentant l'identité des prête-noms ou des faux papiers d'identité utilisés pour la création de sociétés éphémères.
2. La position de la commission : une extension du périmètre des appels à la vigilance émis par Tracfin potentiellement plus efficace
Les auditions du rapporteur ont confirmé que l'usage de prête-noms et d'identités fictives était monnaie courante dans les réseaux de blanchiment, complexifiant d'autant la détection des opérations illicites par les autorités de contrôles. À titre d'exemple, la direction générale du Trésor (DGT) a confirmé que, bien qu'elle soit par nature difficile à quantifier, « la fraude documentaire est [bien] identifiée comme une problématique centrale de la lutte contre le blanchiment de capitaux ». Le CNGTC a quant à lui fait valoir que « les greffiers des tribunaux de commerce sont confrontés à l'utilisation d'identités fictives ou de prête-noms lors des demandes d'immatriculation ; ces pratiques visent principalement à créer des sociétés-écrans ou “ sociétés relais ” destinées à dissimuler des activités frauduleuses, détourner des fonds publics ou recycler des capitaux d'origine illicite ; les secteurs les plus touchés sont ceux à forte rotation d'entreprises et à flux financiers rapides, tels que le bâtiment, le commerce en ligne ou la logistique ; ces fraudes restent minoritaires au regard du volume total des formalités, mais leur impact économique et réputationnel est significatif, justifiant une vigilance renforcée ».
Pour autant, les auditions du rapporteur ont également révélé que la création d'un fichier créerait probablement davantage de difficultés qu'elle n'en résoudrait.
D'un point de vue opérationnel, un tel fichier serait premièrement facilement contournable par la multiplication d'identités fictives à usage unique.
Il pourrait deuxièmement avoir des effets collatéraux sur les victimes d'usurpation d'identité, qui peuvent devenir des « prête-noms » malgré elles. Les conséquences juridiques d'une inscription au fichier n'étant pas explicitée dans l'article 2, il ne peut être exclu que des victimes d'usurpation d'identité se voient ainsi privées de la possibilité de créer une société ou d'en poursuivre la gestion.
Troisièmement, il a été relevé que la rédaction de l'article 2 comprenait d'importantes imprécisions quant aux modalités d'alimentation du fichier. À l'inverse du FNIG, qui est alimenté par des décisions de justice déterminées et insusceptibles de recours, le fichier prévu à l'article recenserait des identités fictives « impliquées dans des affaires de blanchiment », ce terme étant particulièrement vague. L'autorité compétente pour décider, in fine, d'une inscription n'est par ailleurs pas précisée.
La Cnil a fait part au rapporteur d'une analyse similaire sur le sujet, estimant que « la notion d'implication ne semble pas définie de sorte à ce que les conditions d'inscription dans le fichier ne sont pas clairement établies : il n'est notamment pas possible de savoir si l'inscription est conditionnée à l'ouverture d'une procédure judiciaire (qui irait avec des garanties procédurales) ». La Cnil a par ailleurs émis plusieurs autres réserves tenant à l'inadaptation de la finalité prévue2(*), ainsi qu'à l'absence ou l'insuffisance de précision sur les modalités d'information des personnes inscrites et leurs voies de recours3(*) ou sur les modalités d'accès aux données du fichier4(*).
S'il a considéré que la création du fichier prévue à l'article 2 « permettrait [potentiellement] de centraliser les informations issues des fraudes avérées et d'éviter la réutilisation d'identités suspectes dans de nouvelles immatriculations et constituerait un outil de prévention en amont, complémentaire aux registres existants », le CNGTC n'en a pas moins également émis des réserves importantes au cours de son audition par le rapporteur. Si la plupart sont similaires à celles exposées précédemment, le CNGTC a également estimé que « pour être opérationnel, ce fichier devrait être interconnecté avec le RCS, le FNIG, le RBE et les bases fiscales ou judiciaires pertinentes », ce que le texte ne prévoit pas. Il s'est également inquiété du risque de créer un doublon avec les éléments existants, sans réelle valeur ajoutée, voire de générer des divergences d'informations entre registres. Il a enfin exprimé sa préoccupation vis-à-vis du fait que « si le greffier devait être amené à signaler ou inscrire une personne sur ce fichier sans base judiciaire préalable, sa responsabilité civile pourrait être engagée en cas d'erreur ou de contestation compte tenu du caractère des informations à inscrire ».
Dans ce contexte, le rapporteur a jugé préférable de travailler à partir des instruments préexistants de la lutte contre le blanchiment plutôt que de créer un nouveau fichier dont la plus-value n'est pas démontrée. Pour rappel, le code monétaire et financier soumet d'ores et déjà les professionnels à d'importantes obligations visant à lutter contre le recours aux identités fictives. Les professionnels assujettis aux règles LCB-FT sont ainsi tenus d'identifier leurs clients et leurs bénéficiaires effectifs5(*). Comme l'a rappelé la direction générale du Trésor au cours de son audition, les exigences de vérifications à mettre en place en cas de relation d'affaires à distance seront en outre durcies avec l'entrée en application du nouveau cadre européen anti-blanchiment au 10 juillet 20276(*).
En conséquence, la commission a, à l'initiative du rapporteur, substitué au fichier prévu une extension du champ des appels à la vigilance aujourd'hui émis par Tracfin en application de l'article L. 561-26 du CMF. La direction générale du Trésor a confirmé au cours de son audition que cet outil « contribuait [effectivement] à détecter le recours à ces identités usurpées ». Il est toutefois nécessaire d'aller plus loin en étendant le champ des informations communiquées par ce canal aux professionnels assujettis. Selon l'amendement COM-4 adopté par la commission, Tracfin pourrait donc désormais non seulement désigner aux personnes assujetties des personnes physiques particulièrement à risque mais également leur signaler expressément les identités fictives et les prête-noms qu'elles utilisent ou sont susceptibles d'utiliser.
Cet enrichissement de l'information apportée aux personnes assujetties aux règles LCB-FT leur permettra de cibler davantage leurs contrôles et de repérer au plus vite des cas de fraude documentaire. Ce mécanisme pallie les carences du fichier proposé par l'article 2 tout en adaptant les outils existants de la lutte contre le blanchiment aux enjeux spécifiques liés à la multiplication du recours aux identités fictives.
La commission a proposé à la commission des finances d'adopter l'article 2 ainsi modifié.
Article
3
Justification de l'origine des fonds en cas de cession amiable
d'une
société commerciale
L'article 3 impose une justification obligatoire de l'origine des fonds par l'acheteur dans le cadre de toute cession amiable d'un fonds de commerce, de parts sociales ou d'actions d'une société commerciale. Si les cessions amiables représentent effectivement une vulnérabilité en matière de lutte contre le blanchiment, le caractère systématique de cette obligation pourrait excessivement entraver la vie économique et se traduirait probablement par l'envoi massif de déclarations de soupçons d'un intérêt limité à Tracfin.
À l'initiative de son rapporteur, la commission a donc adopté un amendement lui substituant la création d'une nouvelle mesure de vigilance complémentaire applicable aux personnes assujetties aux règles LCB-FT.
Elle a demandé à la commission des finances d'adopter cet article ainsi modifié.
1. L'article 3 : une obligation administrative de justification de l'origine des fonds en cas de cession amiable
L'article 3 de la proposition de loi rétablit un article L. 141-1 du code de commerce pour prévoir une justification obligatoire par l'acheteur de l'origine des fonds utilisés dans le cadre d'une cession amiable de fonds de commerce ou de parts sociales ou d'actions entraînant le changement de contrôle d'une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (I). Cette justification est remise, selon des modalités précisées par décret, au professionnel chargé de la rédaction de l'acte ou au greffier du tribunal de commerce (II). Celui-ci est alors tenu d'opérer une déclaration de soupçon à Tracfin « s'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liés au financement du terrorisme ». L'article 3 prévoit enfin une application systématique de ce dispositif lorsque l'entreprise exerce une activité dans un secteur à risque défini par décret ou lorsque le montant de la cession excède un seuil fixé par voie réglementaire (III).
Cet article reprend une recommandation de la commission d'enquête sénatoriale précitée du 18 juin 2025 de Raphaël Daubet et Nathalie Goulet du 18 juin 20257(*), qui estimait que « la priorité est de dissuader autant que faire se peut et au plus tôt les organisations criminelles, en amont, de prendre le contrôle d'entreprises, dans la mesure où plus l'économie est gangrénée par la présence d'entreprises légales criminelles, plus il est difficile de rétablir un marché fonctionnel ». Si les auteurs rappelaient l'importance de ne pas entraver l'activité économique par un surcroît de formalités administratives imposées aux entreprises, ils indiquaient néanmoins que les secteurs les plus ciblés par la criminalité organisée étaient peu soumis à une nécessité de fluidité des capitaux et qu'il existait donc des marges de manoeuvre pour mieux les contrôler.
Comme l'a souligné la direction générale du Trésor (DGT), le code de commerce prévoit principalement, dans les quinze jours suivant la date de la cession amiable d'un fonds de commerce, une obligation de publication d'un extrait ou avis dans un journal d'annonces légales dans le ressort du fonds de commerce et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales8(*). Les cessions de parts sociales doivent être enregistrés auprès de l'administration fiscale dans un délai d'un mois9(*). Le dépôt des statuts mis à jour doit ensuite être effectué auprès du greffe du tribunal de commerce, aux fins de mise à jour du RCS. Si l'enregistrement fiscal demeure obligatoire, le dépôt au greffe n'est en revanche pas systématique dans le cas d'une cession amiable d'action. Seules les cessions impliquant une modification statutaire sont soumises à une telle formalité.
2. La position de la commission : une démarche utile mais qui ne peut être généralisée
Les personnes auditionnées par le rapporteur ont unanimement confirmé que les cessions amiables de société commerciale représentaient un facteur de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. Tracfin a ainsi indiqué que « l'acquisition de parts sociales ou d'actions constitue un vecteur privilégié de blanchiment des fonds d'origine criminelle », tandis que la direction générale du Trésor a confirmé que « la phase de création d'un commerce (rachat du fonds de commerce et travaux d'installation) est particulièrement exposée aux risques de blanchiment de capitaux ».
Pour autant, le rapporteur a considéré que l'obligation de justification systématique de l'origine des fonds proposée à l'article 3 soulevait plusieurs difficultés.
La rédaction proposée est tout d'abord caractérisée par une ambiguïté sur l'ensemble de cette obligation. Son I prévoit une obligation générale applicable à l'intégralité des cessions amiables. A contrario, son II laisse entendre que celle-ci ne s'appliquerait que pour certaines cessions déterminées, soit parce qu'elles seraient supérieures à un certain montant soit parce qu'elles concerneraient une entreprise relevant de secteurs désignés comme à risque.
Les deux hypothèses soulèvent des difficultés de nature différente. D'un point de vue opérationnel, une obligation générale peut apparaître disproportionnée. Comme cela a été souligné par la DGT au cours de son audition, « la création de cette nouvelle obligation apparaît peu conforme à l'objectif général de simplification pour les entreprises ». La direction des affaires civiles et du sceau (DACS) a partagé ce constat, exprimant la crainte « que cette nouvelle obligation pesant sur les acquéreurs ne conduise à ralentir les cessions tout en renchérissant leur coût, allant à l'encontre de la volonté de simplification de la vie économique ». De surcroît, cette obligation conduirait probablement à l'envoi massif de déclarations de soupçon d'un intérêt limité à Tracfin, au risque de saturer les capacités d'investigation du service.
La définition d'entreprises à risque ou d'un seuil d'activation de cette obligation ne semble pas de nature à surmonter ces difficultés. La désignation officielle de secteurs à risque pourrait être contreproductive en incitant les criminels à s'en détourner pour investir des champs économiques où la vigilance est moindre. De plus, la désignation explicite de certains secteurs à risque pourrait engendrer des conséquences disproportionnées pour l'activité économiques de la vaste majorité de leurs opérateurs, qui se conforment à leurs obligations légales. La fixation d'un seuil de prix n'apparaît pas plus pertinente. La sous-évaluation des prix de vente étant une pratique courante en matière de blanchiment, celui-ci serait probablement rapidement privé d'effets. La DGT a ainsi rappelé au cours de son audition que « du point de vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les typologies comprennent notamment la sous-évaluation du prix dans l'acte de vente, compensée par un versement d'espèces non-déclaré », ce qui implique que « les opérations à risque ne sont pas forcément celles affichant des montants importants ».
Par prolongation, cette question entraîne celle de l'intensité du contrôle qui serait effectué par les professionnels en charge de la rédaction de l'acte de cession, à savoir, selon les cas, les notaires, avocats, greffiers ou experts-comptables. La DACS a insisté sur le fait que la conduite systématique de diligences poussées alourdirait immanquablement la charge administrative pesant sur les acteurs économiques, et ce d'autant plus que la vérification des justificatifs présentés peut être délicate dans certains cas de figure. La DACS a ainsi cité le cas de « la constitution d'une épargne dont l'origine résulte, par hypothèse, de revenus non dépensés, et suppose, en toute rigueur de se faire produire les pièces utiles (relevés de comptes bancaires) et de procéder à leur analyse ». A contrario, un contrôle purement formel aurait probablement peu d'impact sur la lutte contre le blanchiment, sans que son coût administratif ne soit neutre pour autant.
La rédaction proposée soulève également une difficulté juridique en ce qu'elle crée une nouvelle obligation de transmission de déclaration de soupçon à Tracfin. Comme l'a rappelé la DGT au cours de son audition le champ de l'obligation de déclaration de soupçon découle toutefois directement du droit européen et des normes internationales, et couvre l'ensemble des situations identifiées dans la loi puisque l'obligation porte sur toute « opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme »10(*).
Les professionnels chargés de la rédaction des actes de cession amiable sont enfin déjà assujettis aux règles de vigilance et de signalement LCB-FT en application du 19° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Pour toute opération anormalement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou qui paraît injustifié économiquement, les déclarants doivent effectuer un examen renforcé, au titre de l'article L. 561-10-2, qui implique une vérification de l'origine des fonds auprès du client. Dès lors, la rédaction proposée de l'article 3 pourrait introduire une ambiguïté sur la portée de cette obligation.
Partageant l'objectif d'une plus grande vigilance sur les cessions amiables de sociétés commerciales, la commission a donc, à l'initiative du rapporteur, substitué à l'obligation prévue la création d'une nouvelle mesure de vigilance complémentaire applicable aux personnes assujetties aux règles LCB-FT. Concrètement, l'amendement COM-5 adopté par la commission prévoit que les professionnels en charge de la rédaction de l'acte de cession ont l'obligation de se renseigner auprès de l'acquéreur de l'origine des fonds lorsque le risque de blanchiment leur apparaît élevé. Cette nouvelle obligation ne dispense en aucun cas les professionnels des diligences prévues à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier mais constitue une obligation de vigilance complémentaire autonome dont le seuil de déclenchement par le professionnel est plus faible, eu égard au risque particulier de blanchiment constaté lors des cessions amiables.
Cette approche par les risques apparaît plus adaptée qu'une obligation déclarative systématique, particulièrement lourde. Elle s'insère par ailleurs mieux dans le cadre préexistant des mesures de vigilance complémentaire, qui est connu et maîtrisé par les acteurs et est par là même gage d'une plus grande efficacité.
La commission a proposé à la commission des finances d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article
8
Procédure de radiation d'office du registre du commerce et des
sociétés
Le I de l'article 8 précise que le contrôle des titres d'identité étranger opéré par les greffiers des tribunaux de commerce vise à prévenir la fraude. La commission ne s'est pas opposée à une mention des finalités de la démarche, tout en estimant nécessaire de préciser que celles-ci ne relèvent pas exclusivement de la lutte contre la fraude.
Le II de l'article 8 propose que l'institut national de la propriété industrielle (Inpi) soit obligatoirement informé des radiations d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS) opérées par les greffiers des tribunaux de commerce et que ceux-ci puissent rapporter une radiation en cas de régularisation. La commission a constaté que ces deux éléments figuraient déjà l'article L. 561-47 du code monétaire et financier et qu'ils pourraient en conséquence être supprimés. La commission a demandé à la commission des finances d'adopter cet article ainsi modifié.
1. Le I de l'article 8 : un contrôle des titres d'identité étranger par les greffiers des tribunaux de commerce qui répond à de multiples finalités
L'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a complété l'article L. 123-2 du code de commerce par un alinéa autorisant les greffiers des tribunaux de commerce à « vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies » dans le cadre d'une demande d'immatriculation au RCS. Cette disposition avait été introduite lors de l'examen du texte en commission en première lecture à l'Assemblée nationale via un amendement du groupe socialiste11(*).
Il s'agissait à l'origine d'une recommandation émise par le CNGTC dans son « Livre blanc : 15 propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité financière » du 4 novembre 2024. Le CNGTC estimait ainsi primordial, « dans le cadre du renforcement de la lutte contre les sociétés fictives et éphémères [...] de permettre l'identification des fraudeurs le plus tôt, en amont de la création de la société, quelle que soit la situation de résidence du dirigeant étranger afin de supprimer toute possibilité d'utiliser la société à des fins irrégulières ». Il ajoutait qu'il « conviendrait de permettre au greffier de disposer des moyens techniques pour vérifier la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies, de sorte que le contrôle de police économique effectué par le greffier en vertu de l'article L. 123-2 du code de commerce soit étendu ».
Livre blanc du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce12(*)
Explications sur la proposition n° 2
« Les pièces justificatives à produire pour le dirigeant personne physique d'une société de droit français ou de droit étranger sont limitativement prévues à l'annexe 1-1 à l'article A. 123-45 du code de commerce. Elles diffèrent selon que le dirigeant est français (ou ressortissant européen) ou étranger, résidant ou non en France.
« Le dirigeant français ou ressortissant européen doit produire à l'appui de sa demande d'inscription au RCS une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité et une attestation sur l'honneur de non-condamnation, faisant apparaître la filiation.
« Le dirigeant étranger résidant en France, lorsqu'il dirige une société civile doit fournir tout document justifiant de son identité et une attestation sur l'honneur de non-condamnation faisant apparaître la filiation.
« Lorsqu'il dirige d'autres types de société, le dirigeant étranger résidant en France doit produire une copie d'un titre de séjour et une attestation de non-condamnation, faisant apparaître la filiation.
« Les greffiers des tribunaux de commerce vérifient l'authenticité des pièces d'identité et des titres de séjour délivrés en France. Cette vérification est rendue possible par l'interrogation des bases de données détenues par le ministère de l'Intérieur via le dispositif DOCVERIF.
« Le dirigeant étranger ne résidant pas en France peut diriger une société inscrite au RCS, y compris de droit français, en conservant sa résidence à l'étranger. Dans ce cas, il doit fournir une copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité et une attestation sur l'honneur de non-condamnation, faisant apparaître la filiation.
« Il ressort des pièces justificatives fournies que les contrôles sont moins étendus dans le cas de documents produits par les dirigeants étrangers non-résidents alors même que les greffiers des tribunaux de commerce doivent faire face à une montée en puissance de la fraude documentaire. »
Dans ce contexte, le I de l'article 8 de la proposition de loi précise que ledit contrôle de la cohérence et de la validité des pièces d'identité étrangères fournies est effectué « pour prévenir les risques de fraude ».
Au cours de son audition par le rapporteur, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a estimé que cette précision en apparence symbolique permettait de « reconnaître formellement le rôle de tiers de confiance du greffier au coeur du dispositif national de transparence économique » ainsi que de « conférer une base juridique claire à une mission déjà exercée dans les faits, renforçant ainsi la légitimité du contrôle exercé par les greffes et la sécurité des procédures de publicité légale ».
Si la commission ne s'est pas opposée à ce que les finalités de ce contrôle soient mentionnées à l'article L. 123-2 du code de commerce, elle a néanmoins été sensible aux arguments exposés notamment par la direction générale du Trésor quant au risque de lecture a contrario de la rédaction proposée. Le contrôle de la validité et de la cohérence des pièces d'identités étrangères répond en effet à une pluralité d'objectifs, parmi lesquels la prévention de la fraude mais également la fiabilisation de l'information légale des entreprises publiée dans les différents registres. Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-6 de son rapporteur précisant que la lutte contre la fraude n'était pas la finalité exclusive desdits contrôles.
2. Le II de l'article 8 : une nouvelle procédure de radiation du RCS prévue à l'article L. 561-47 du CMF dont les contours sont déjà suffisamment précis
Les sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 561-45-1 du CMF sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leur bénéficiaire effectif. Les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client (1°), soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée13(*). Le pouvoir réglementaire a précisé le cas prévu au 1°, en désignant comme bénéficiaire effectif « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce »14(*).
Ces informations sont portées au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ainsi qu'au RCS. Elles figurent également au registre national des entreprises tenu par l'Inpi en application de l'article L. 123-37 du code de commerce. Elles font au préalable l'objet d'un contrôle effectué par les greffiers des tribunaux de commerce.
L'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a complété l'article L. 561-47 du CMF afin de prévoir la possibilité pour les greffiers des tribunaux de commerce de radier d'office du RCS une société ou une entité n'ayant pas déclaré ou mis en confirmé dans un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs. Deux autres cas de radiation d'office sont par ailleurs prévus, lorsque le signalement d'une divergence n'a pas donné lieu à une régularisation15(*) ou dans le cas où une société ne défère pas à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer ou rectifier les données relatives à ses bénéficiaires effectifs16(*).
Les auditions du rapporteur n'ont pas permis d'obtenir de premiers éléments de bilans. De fait, ces nouveaux mécanismes de radiation d'office du RCS ne sont entrées en vigueur qu'au 13 juin de cette année et prévoient un délai de trois mois avant l'exécution de la mesure. Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a ainsi indiqué au cours de son audition que les premières vagues de courrier avaient été adressées début septembre et que, compte tenu de ce délai, d'éventuelles opérations de radiation ne pourraient intervenir qu'au début du mois de décembre.
Dans ce contexte, l'article 8 propose, d'une part, que l'Inpi soit informé des décisions de radiation d'office prises en application de l'article L. 561-47 du CMF et, d'autre part, que « la société ou l'entité [puisse] demander au greffier de rapporter la radiation après régularisation, dans des conditions précisées par décret ». Comme l'a rappelé la direction générale du Trésor au cours de son audition, le rapport de radiation permet au teneur de registre de mettre à jour le registre tout en conservant les données existantes de l'entreprise. Cette démarche est donc plus simple pour le déclarant et lui permet de conserver les données de son entreprise sans avoir à effectuer une nouvelle formalité.
Le rapporteur a relevé à l'issue de ces auditions que ces deux éléments étaient satisfaits par la rédaction actuelle de l'article L. 561-47 du CMF. L'Inpi est en effet mentionné comme destinataire des décisions de radiation d'office en sa qualité de teneur du registre national des entreprises tandis que la dernière phrase du dernier alinéa de cet article mentionne explicitement la possibilité pour les greffiers des tribunaux de commerce de rapporter une radiation17(*) dans des conditions prévues par décret. La direction générale du Trésor a confirmé au cours de son audition que celui-ci serait publié à l'échéance annoncée de septembre 2025.
En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-6 du rapporteur supprimant le II de l'article 8.
La commission a proposé à la commission des finances d'adopter l'article 8 ainsi modifié.
Article
9
Accès des greffiers des tribunaux de commerce à
la documentation cadastrale
L'article 9 ouvre, à titre expérimental, un accès direct aux données cadastrales aux greffiers de trois tribunaux de commerce. Considérant qu'un tel accès était potentiellement de nature à renforcer l'action des greffiers des tribunaux de commerce en matière de prévention de la fraude et de lutte contre le blanchiment, la commission n'a pas remis en cause l'article 9. Sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, elle a adopté l'amendement du rapporteur introduisant trois garanties supplémentaires pour la mise en oeuvre de cette expérimentation. La commission a demandé à la commission des finances d'adopter cet article ainsi modifié.
1. L'état du droit : deux régimes d'accès distincts à la documentation cadastrale
La documentation cadastrale recense et identifie les propriétés foncières du territoire national18(*). Son régime juridique est fixé par le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, dont la dernière modification remonte à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. La documentation cadastrale a une vocation exclusivement fiscale, en ce qu'elle sert de base de calcul aux impôts locaux et ne s'apparente en aucun cas à un fichier des titres de propriété. Concrètement, elle rassemble deux types de documents distincts :
- le plan cadastral : il est défini par les ministères économiques et financiers comme une « représentation graphique d'une commune qui dresse l'inventaire de ses propriétés foncières ainsi que l'emprise au sol des bâtiments qui les occupent ». Il ne comprend aucune donnée nominative ;
- la matrice cadastrale : ce document établi annuellement complète les informations figurant dans le plan cadastral. Il agrège les relevés de propriété indiquant l'identité des propriétaires de chaque terrain ou immeuble bâti répertorié au sein du plan cadastral. Dans le détail, il mentionne pour chaque propriétaire, selon la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), « son adresse, sa date et son lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune, identifiées par leur numéro et leur adresse, éventuellement, la description du bâti par “unité d'évaluation”, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe »19(*).
La direction générale des finances publiques est l'administration en charge de la tenue et de la diffusion de la documentation cadastrale, en particulier à destination des communes.
Le principe de la libre communication des documents cadastraux est un principe ancien remontant à l'origine à la loi du 7 Messidor an II puis confirmé par la jurisprudence administrative20(*). En l'état du droit, les conditions d'accès aux données cadastrales différent néanmoins selon la nature des données.
Dans le cas du plan cadastral, le principe de libre-communication s'applique de manière extensive. Il s'applique à toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire sur le territoire de la commune d'implantation des parcelles ou propriétés faisant l'objet de la demande. Cette libre-communication s'exerce vis-à-vis de l'ensemble des administrations détenant le cadastre. Ainsi, le plan cadastral peut être consulté via le centre des impôts ou en mairie, sur place ou par l'intermédiaire d'une demande de renseignement cadastral effectuée par courrier. Il est également librement disponible sur le site internet21(*). La délivrance du plan cadastral est par ailleurs payante dans la plupart des cas, selon des tarifs fixés par un arrêté du 16 mars 201122(*).
Les conditions d'accès à la matrice cadastrale sont quant à elle plus strictes. Les propriétaires ont le droit à la communication de l'intégralité des relevés de leurs propriétés, sous réserve de justifier de cette qualité. Les tiers ne peuvent quant à eux obtenir la communication d'informations cadastrales concernant des parcelles déterminées que de manière ponctuelle. Ces règles sont aujourd'hui fixées aux articles L. 107 A et R. 107 A-1 à R. 109-2 du livre des procédures fiscales. La demande de communication est effectuée par écrit et est traitée par les services de l'administration fiscale et des communes. La CADA rappelle par ailleurs que « sont seuls communicables aux tiers le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière ; toute autre information, notamment la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que les motifs d'exonération fiscale, doit être occultée avant la communication »23(*).
Article L. 107 du livre des procédures fiscales
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.
Article R. 107 A-1 du livre des procédures fiscales
La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.
Article R. 107 1-2 du livre des procédures fiscales
La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
Article R. 107 A-3 du livre des procédures fiscales
I. - Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
II. - La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
Article R. 107 A-7 du livre des procédures fiscales
Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
2. L'article 9 : expérimenter un accès direct des greffiers des tribunaux de commerce à l'intégralité des données cadastrales
Dans ce contexte, l'article 9 de la proposition de loi prévoit la désignation, à titre expérimental de trois greffes de tribunaux de commerce qui pourraient accéder, pour une durée de deux ans, aux données cadastrales des immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort. Il est précisé que ces données ne pourraient être cédées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales. La remise d'un rapport au Parlement est prévu six mois avant la fin de l'expérimentation, celui-ci devant mentionner le nombre de demandes effectuées ainsi que les cas de fraude ou d'anomalie détectés.
Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'objectif est de répondre au « manque d'interconnexion entre les registres économiques et les bases foncières, qui empêche de détecter certaines incohérences ou montages frauduleux ». Cette question particulière des données cadastrales n'est néanmoins que marginalement abordée dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale précitée de Raphaël Daubet et Nathalie Goulet24(*).
Il s'agit en revanche de l'une des recommandations effectuées par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans son « Livre blanc : 15 propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité financière » du 4 novembre 2024. Afin d'éviter la création de structures fictives, celui-ci estimait nécessaire, en amont d'une immatriculation au RCS, « de vérifier que l'adresse [du siège social] déclaré a une réelle existence et qu'elle est compatible avec l'activité déclarée par la personne morale ». En conséquence, la proposition n° 4 invite à « mettre en oeuvre une expérimentation de connexion entre les greffiers des tribunaux de commerce et les bases de données de la Poste ou du cadastre afin de pouvoir détecter les adresses qui seraient inexistantes » et précise que « cette possibilité d'interrogation renforcerait la fiabilisation des créations d'entreprises et, intervenant en amont du processus, elle éviterait la création de structures fictives ou frauduleuses ».
Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a confirmé cette position au cours de son audition par le rapporteur. Il a estimé que le dispositif proposé par l'article 9 « constituerait un outil de vérification précieux pour les greffiers des tribunaux de commerce dans leur mission de lutte contre la fraude et le blanchiment » et qu'il « permettrait de confirmer la réalité des sièges sociaux en identifiant les adresses fictives fréquemment utilisées dans les montages frauduleux ». Il a enfin précisé que l'expérimentation « permettrait de fiabiliser les immatriculations et de bloquer en amont la création de structures fictives par une interrogation automatique ».
3. La position de la commission : sécuriser les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation
Sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, la commission n'a pas remis en cause l'expérimentation prévue par l'article 9. Si l'article R. 107 A-7 du livre des procédures fiscales est de nature à faciliter l'accès aux données cadastrales pour les greffiers des tribunaux de commerce vis-à-vis des tiers de droit commun, il est vrai qu'aucun accès direct aux données de la matrice cadastrale ne leur est actuellement octroyé par les textes. Or, ces derniers peuvent, dans le cadre de leurs opérations de contrôle préalables à une immatriculation et dans un objectif notamment de lutte contre la fraude, avoir besoin d'accéder à des données cadastrales. Les modalités actuelles de consultation sont toutefois difficilement compatibles avec l'exigence légitime de célérité auxquels ils sont astreints dans le processus d'immatriculation, de manière à garantir la fluidité de la vie économique.
Dès lors, il n'est pas illégitime d'envisager la création d'un accès direct aux données cadastrales au bénéfice des greffiers des tribunaux de commerce. La documentation cadastrale comprenant les données nominatives d'une partie importante de la population française, le rapporteur a néanmoins estimé qu'une telle évolution devait s'envisager avec prudence et que la voie de l'expérimentation était de rigueur en la matière. De surcroît, il a estimé a minima nécessaire de sécuriser les conditions de l'expérimentation.
À son initiative, la commission a donc adopté son amendement COM-7 introduisant trois nouvelles garanties au dispositif. Il limite premièrement cet accès aux données cadastrales aux seules finalités de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il prévoit deuxièmement que les modalités de mise en oeuvre de cet accès sont organisées de manière à garantir la traçabilité des consultations. Il impose troisièmement la conclusion d'une convention entre l'administration fiscale et les trois greffes expérimentateurs définissant les conditions d'accès aux données.
La création d'un accès direct aux données cadastrales supposant par ailleurs d'importants travaux techniques, il est enfin proposé une entrée en vigueur différée à partir du 1er janvier 2027.
La commission a proposé à la commission des finances d'adopter l'article 9 ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous allons examiner le rapport pour avis de notre collègue Hervé Reynaud sur la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment. Quatre articles ont été délégués au fond à la commission des lois. Nous accueillons Nathalie Goulet, auteur de ce texte.
Mme Nathalie Goulet, auteur de la proposition de loi. - Il y a quelques mois, la commission d'enquête sur la criminalité organisée, dont notre collègue Hervé Reynaud était membre, rendait ses conclusions. Celles-ci suivaient d'excellents travaux sur le narcotrafic. Ce dernier n'est qu'une partie de la criminalité organisée, dont il est important d'examiner tous les aspects, tels que la contrefaçon ou les cartes prépayées. En bref, tout cela constitue une énorme fabrique d'argent sale, lequel est ensuite blanchi. Or l'ensemble des services constate que blanchir l'argent est devenu un métier détachable de la criminalité.
Parmi ces blanchisseurs, l'on retrouve une structure très connue : les entreprises éphémères, qui se constituent rapidement, utilisent des banques en ligne, ont un chiffre d'affaires qui monte rapidement etc. Et puis elles disparaissent... C'est l'outil principal notamment du carrousel de TVA, l'un des principaux vecteurs de blanchiment qui représente à lui seul un manque à gagner de 25 milliards d'euros, mais aussi des fraudes aux aides publiques, qui atteignent entre 20 milliards et 40 milliards d'euros. Ces entreprises éphémères sont donc le véritable cheval de Troie de la criminalité.
Face à cette situation, le Livre blanc des greffiers des tribunaux de commerce comporte des propositions, dont un renforcement du contrôle des greffes sur les pièces d'identité et une expérimentation sur les données cadastrales.
De ces travaux est née une proposition de loi d'une trentaine d'articles. Cependant, l'espoir de la voir inscrite à l'ordre du jour était mince. C'est la raison d'être du texte que vous examinez, qui ne comprend plus que neuf articles portant sur la sécurisation juridique des structures économiques, dont quatre sont délégués au fond à la commission des lois : les articles 2, 3, 8 et 9.
Je souscris pleinement aux modifications apportées par le rapporteur, qui améliore sensiblement le texte, tout en en conservant l'esprit : plus d'éléments pour contrôler les entités économiques, plus de pouvoir pour les greffes. Bien sûr, cela s'inscrira dans un ensemble plus grand avec, en particulier, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, que nous examinerons dans quelques semaines. J'espère que nous pourrons également travailler sur le blanchiment dans ce cadre.
Rien ne justifie que l'on renonce à quelque sorte de contrôle sur des entreprises au simple motif que l'on rallonge des délais. Vous savez très bien que l'ensemble des actes exécutés pour une entreprise en formation peuvent être repris par une autre. Mieux vaut donc contrôler ab initio que de laisser en l'état un Kbis devenu un permis de frauder pour bon nombre d'entreprises, notamment éphémères. Tel est, madame la présidente, l'esprit de cette proposition de loi.
Nathalie Goulet quitte la salle de la commission.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - La proposition de loi que nous examinons s'appuie sur les recommandations du rapport de la commission d'enquête sur le blanchiment, intitulé Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société.
Je ne peux que m'associer aux conclusions de notre collègue Nathalie Goulet quand elle estime que la lutte contre les réseaux de blanchiment doit être érigée au rang de priorité dans l'action des pouvoirs publics. De fait, l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée repose largement sur la capacité des autorités à « frapper au portefeuille », en démantelant les réseaux de blanchiment qui permettent aux criminels de réinjecter le produit de leur action dans l'économie réelle. Je rappelle que la Cour des comptes européenne évaluait récemment le blanchiment de capitaux à environ 38 milliards d'euros pour la France.
D'importants progrès ont été réalisés sur la période récente, souvent à l'initiative du Sénat, à commencer par la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui renforce assez radicalement notre dispositif anti-blanchiment. Je pense également à la loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dont Muriel Jourda était la rapporteur. Nathalie Goulet a également été rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, reprenant d'autres recommandations de notre commission d'enquête. Peut-être des textes compartimentés seront-ils plus faciles à adopter qu'un seul texte trop volumineux.
D'importantes marges de progrès subsistent, soulignées par les travaux de la commission d'enquête, dont la régulation défaillante de secteurs particulièrement exposés aux risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ainsi, diverses lacunes persistent, par exemple les cas de cession amiable d'une société, ou encore les difficultés à s'adapter aux méthodes évolutives des criminels, notamment par des détections rapides de l'usage de fausses identités. Or c'est au départ que l'on peut arrêter la lessiveuse ; une fois que le processus de blanchiment touche l'économie réelle, les perspectives de retracer les mouvements financiers sont faibles.
Dans ce contexte, la proposition de loi que nous examinons est bienvenue. Elle comprend neuf articles, dont quatre nous sont délégués au fond. Je partage la philosophie qui sous-tend ces dispositions, lesquelles partent de constats consensuels que la commission d'enquête a parfaitement documentés. Fort heureusement, la lutte contre le blanchiment fait partie de ces sujets qui nous rassemblent plus qu'ils ne nous divisent.
Je vous présenterai quatre amendements visant à sécuriser juridiquement les rédactions proposées, comme à l'article 9, à supprimer des éléments redondants avec le droit existant, s'agissant de l'article 8, ou à y substituer d'autres mécanismes plus efficaces, concernant les articles 2 et 3.
M. Olivier Bitz. - Je remercie le rapporteur et l'auteur du texte. Cela confirme le rôle du Sénat comme centre d'impulsion politique dans la lutte contre la criminalité organisée.
M. Hussein Bourgi. - Je remercie à mon tour Nathalie Goulet et Hervé Reynaud. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souscrit aux éléments qui nous sont proposés. Bien souvent, une fois le rapport d'une commission d'enquête publié, se pose la question de la suite. En l'espèce, les travaux de la commission d'enquête sur le blanchiment, auxquels j'ai pris part, se révèlent fort utiles, cette proposition de loi étant l'expression de bon augure d'un droit de suite. Notre collègue Nathalie Goulet a agi vite, ce dont nous ne pouvons tirer que fierté et satisfaction.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je partage votre opinion, mon cher collège. Il en allait d'ailleurs de même pour la proposition de loi sur le narcotrafic. Il est bel et bon de produire des rapports, mais encore faut-il en tirer les conséquences.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - Vous me confortez dans la volonté d'avancer sur ce sujet. Cette proposition de loi, reformulée, marque une volonté pragmatique et opérationnelle. Mais de l'idée à la concrétisation législative, il était nécessaire de la recentrer et d'y apporter des précisions juridiques, compte tenu notamment des auditions menées la semaine dernière.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Selon l'usage, il me revient, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, de vous présenter le périmètre indicatif de la proposition de loi s'agissant des articles qui nous sont délégués. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux leviers d'action contre l'usage d'identités fictives ou de prête-noms à des fins de blanchiment, à la sécurisation du processus de cession amiable des sociétés commerciales face au risque de blanchiment et au rôle des greffiers des tribunaux de commerce dans le dispositif de lutte contre le blanchiment.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - Dans sa rédaction initiale, l'article 2 reprend la recommandation n° 6 de la commission d'enquête en prévoyant l'autorisation, pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de créer un nouveau fichier recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment. L'intuition de nos collègues est la bonne : tous les acteurs auditionnés nous ont confirmé leurs difficultés face à la prolifération de fausses identités. Malheureusement, il n'est guère difficile de créer un faux Iban ou d'en usurper un vrai...
Cependant, la création d'un fichier créerait probablement plus de difficultés qu'elle n'en résoudrait. Tout d'abord, d'un point de vue opérationnel, le dispositif serait facilement contournable par la multiplication d'identités fictives à usage unique. Ensuite, il pourrait avoir des effets collatéraux sur les victimes d'usurpation d'identité, qui deviennent bien souvent des prête-noms malgré elles. Juridiquement enfin, les modalités de son alimentation apparaissaient trop imprécises, de même que les conséquences d'une potentielle inscription pour les personnes concernées.
Tout en poursuivant le même objectif, je vous propose donc, avec l'amendement COM-4, de nous appuyer sur un outil déjà existant : les appels à la vigilance de Tracfin. En effet, en application de l'article L. 561-26 du code de monétaire et financier, Tracfin peut déjà désigner aux personnes assujetties aux règles LCB-FT, dont les greffiers des tribunaux de commerce, les noms de personnes physiques particulièrement à risque. Nous pourrions ainsi étendre explicitement cette possibilité aux identités fictives qu'elles utilisent ou sont susceptibles d'utiliser. Cet enrichissement de l'information aiderait à cibler davantage les contrôles et accélérerait la détection des cas de fraude documentaire.
L'amendement COM-4 est adopté.
La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 2 ainsi rédigé.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - L'article 3 tend à mettre en oeuvre la recommandation n° 11 de la commission d'enquête, laquelle porte sur la justification obligatoire de l'origine des fonds par l'acheteur dans le cadre de toute cession amiable d'une société commerciale. Toutes les personnes auditionnées nous ont confirmé que les cessions amiables de sociétés commerciales représentaient un facteur de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. Il y a donc matière à légiférer.
Néanmoins, la solution proposée n'est que partiellement satisfaisante. En effet, elle créerait tout d'abord une charge administrative supplémentaire et systématique pour les acteurs économiques. Cette obligation conduirait ensuite à l'envoi massif de déclarations de soupçons d'un intérêt limité à Tracfin, au risque de saturer ses capacités d'investigation. Il me semble donc peu opportun de créer une nouvelle obligation.
À la place, je vous propose une nouvelle fois, avec l'amendement COM-5, de nous inspirer d'un outil existant : les mesures de vigilance complémentaire. Elles sont bien connues des personnes assujetties aux obligations LCB-FT qui, en présence de situations à risque, peuvent être contraintes d'effectuer des investigations supplémentaires.
En l'espèce, il est opportun de prévoir, pour les professionnels chargés de la rédaction de l'acte de cession, en particulier les notaires ou les greffiers des tribunaux de commerce, l'obligation de se renseigner auprès de l'acquéreur de l'origine des fonds lorsque le risque de blanchiment leur apparaît élevé. Cette approche par les risques, plus adaptée qu'une obligation déclarative systématique, a le mérite de s'appuyer sur un dispositif maîtrisé par les acteurs, gage d'efficacité. Bien évidemment, il s'agirait d'une obligation de vigilance complémentaire autonome, ne dispensant en rien du respect du cadre général de lutte contre le blanchiment.
L'amendement COM-5 st adopté.
La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 3 ainsi rédigé.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - L'article 8 apporte trois modifications au code de commerce et au code monétaire et financier, dans un objectif de renforcement des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce en matière de lutte contre le blanchiment.
Or deux d'entre elles sont déjà satisfaites. Je vous propose donc, au travers de mon amendement COM-6, de supprimer les dispositions relatives à l'information de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) des décisions de radiation d'offices du registre du commerce et des sociétés (RCS) prises en application du nouveau dispositif créé par la loi narcotrafic, ainsi qu'à la possibilité pour le greffier de rapporter la radiation en cas de régularisation. En effet, ces deux éléments figurent déjà à l'article L. 561-47 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l'article comprend la précision selon laquelle les contrôles des titres d'identité étrangers opérés par les greffiers dans le cadre d'une demande d'immatriculation au RCS visent à « prévenir les risques de fraude ». D'après nos auditions, cette mention renforcerait la légitimité du contrôle opéré par les greffiers. Je vous propose donc de ne pas nous y opposer, sous réserve d'une modification rédactionnelle précisant que la prévention de la fraude n'est pas la finalité exclusive de ces contrôles ; je pense notamment à la fiabilité de l'information publiée au RCS.
L'amendement COM-6 est adopté.
La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 8 ainsi modifié.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - Enfin, l'article 9 prévoit la désignation, à titre expérimental, de trois greffes de tribunaux de commerce. Ceux-ci pourraient accéder, pour une durée de deux ans, aux données cadastrales des immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort.
Comme vous le savez, le plan cadastral est librement accessible sur internet. En revanche, la matrice cadastrale, qui comprend les données nominatives, doit être demandée à l'administration fiscale ou à la mairie, modalité peu compatible avec l'exigence de célérité imposée aux greffiers dans leurs contrôles précédant une immatriculation au RCS. Dans les faits, faute de temps, ils ne font pas de contrôle a priori de l'existence ou de la concordance des adresses déclarées, se contentant d'un contrôle a posteriori si nécessaire.
Il n'est donc pas infondé d'envisager une expérimentation pour leur offrir un accès direct aux données cadastrales. À tout le moins, il est nécessaire de sécuriser les conditions de l'expérimentation, afin d'en discuter en séance sur une base saine.
Dans ce contexte, l'amendement COM-2 de notre collègue Marc Séné tend à intégrer à l'expérimentation une chambre commerciale d'un tribunal judiciaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Or il me semble préférable de nous en tenir à trois tribunaux de commerce désignés par décret et exerçant sous le même régime juridique, afin préserver la cohérence de l'expérimentation. Traditionnellement, nous laissons le soin au pouvoir réglementaire d'identifier les expérimentateurs les plus appropriés. Par cohérence, il semble également préférable de débuter une expérimentation dans des tribunaux de droit commun, le risque étant sinon de ne pouvoir en tirer que peu d'enseignements. Avis défavorable.
Mme Patricia Schillinger. - Cet amendement aurait pu être déposé par le prédécesseur de notre collègue Séné, André Reichardt, qui est très attaché au droit local alsacien-mosellan. Il n'a en tout cas pas été rédigé sur un coup de tête.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Puisque le choix des tribunaux expérimentateurs est renvoyé à la voie réglementaire, en définir certains dans la loi n'aurait pas de sens. En outre, il serait judicieux de retenir des tribunaux relevant du droit commun, et non exorbitants de celui-ci, car dans ce dernier cas, nous ne pourrions en tirer de conclusions utiles. Il appartiendrait donc aux Alsaciens-Mosellans de s'adresser directement au pouvoir réglementaire.
Mme Patricia Schillinger. - Nous n'avons pas de tribunal de commerce.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Précisément. Le système local alsacien-mosellan est rare. Une expérimentation selon le droit commun est donc plus judicieuse en l'espèce.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-2.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - La procédure de demande de la matrice cadastrale est lourde pour les greffiers, dont les contrôles peuvent exiger des vérifications à la fois rapides et massives. Mon amendement COM-7, sans remettre en cause l'expérimentation, a donc pour objet de procéder à plusieurs ajustements visant à sécuriser le dispositif : mention explicite des finalités du dispositif, conclusion d'une convention avec l'administration fiscale sur les modalités de mise en oeuvre et traçabilité des consultations.
Je vous propose, par ailleurs, une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027, afin de laisser le temps de procéder aux aménagements techniques nécessaires.
L'amendement COM-7 est adopté.
La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 9 ainsi modifié.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis. - Au travers de son amendement COM-1, notre collègue Nathalie Goulet propose que les associations exerçant une activité économique fassent l'objet d'une inscription au RCS. Certes, ces associations peuvent constituer une vulnérabilité du point de vue du risque LCB-FT, mais cet amendement appelle plusieurs réserves.
Tout d'abord, quelle en serait la finalité ? Le RCS rassemble les entités commerciales afin, notamment, de permettre la délivrance d'un Kbis nécessaire à leur activité. Les associations n'en ont pas besoin. Le risque serait donc de porter atteinte à la cohérence du fichier en y intégrant des milliers d'entités supplémentaires au statut différent.
Ensuite, nombre d'associations sont déjà assujetties à l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes, lui-même soumis aux règles LCB-FT et, depuis 2024, de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Les mailles du filet sont donc déjà serrées.
Enfin, de manière générale, il est irréaliste de légiférer par un simple amendement dans un tel domaine, qui n'a fait l'objet ni d'auditions ni d'un examen par la commission d'enquête. La proposition de loi aux fins de sécurisation du secteur des associations exerçant une activité économique, récemment déposée, serait l'occasion de traiter le sujet en profondeur.
Je vous propose donc d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-1.
La commission émet un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi, sous réserve de l'adoption de ses amendements.
Les sorts des amendements du rapporteur examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
|
Article 2 |
|||
|
M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
COM-4 |
Extension du périmètre des appels à la vigilance de Tracfin aux identités fictives |
Adopté |
|
Article 3 |
|||
|
M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
COM-5 |
Création d'une mesure de vigilance LCB-FT complémentaire en cas de cession amiable de société commerciale |
Adopté |
|
Article 8 |
|||
|
M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
COM-6 |
Suppression de doublons |
Adopté |
|
Article 9 |
|||
|
M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
COM-7 |
Conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation de l'accès des greffiers des tribunaux de commerce aux données cadastrales |
Adopté |
La commission a également donné les avis suivants sur les autres amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
|
Article 9 |
|||
|
M. SÉNÉ |
COM-2 |
Intégration d'une chambre commerciale de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l'expérimentation sur l'accès aux données cadastrales |
Défavorable |
|
Article additionnel après Article 9 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
COM-1 |
Immatriculation des associations au RCS |
Défavorable |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 25(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie26(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte27(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial28(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mardi 28 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 877 (2024-2025) pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- Aux leviers d'action contre l'usage d'identités fictives ou de prête-noms à des fins de blanchiment ;
- À la sécurisation du processus de cession amiable des sociétés commerciales face au risque de blanchiment ;
- Au rôle des greffiers des tribunaux de commerce dans le dispositif de lutte contre le blanchiment.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mme Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne et auteur de la proposition de loi
M. Raphaël Daubet, sénateur du Lot et auteur de la proposition de loi
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Tracfin (Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins)
M. Clément Larrauri, adjoint au directeur
Mme Ève Mathien, adjointe à la conseillère juridique
Table ronde
Direction générale des finances publiques (DGFiP)
M. Stéphane Créange, chef du Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF)
Direction générale du Trésor (DGT)
M. Thibaut Herrero, chef du bureau Lutte contre la criminalité financière (SECFIN1) au Service des Affaires multilatérales et du Développement (SAMD)
M. Anselme Mialon, chef du bureau Services bancaires et moyens de paiement (BANCFIN4) au Service du financement de l'économie (SFE)
M. David Sabban, adjoint au chef du bureau BANCFIN4 au SFE
M. Sofien Abdallah, conseiller parlementaire et relations institutionnelles
Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
M. Paul Hedon, adjoint au chef de bureau SECFIN1 au SAMD
Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF)
M. Éric Belfayol, chef de la mission
Mme Christine Fournier, cheffe de projet Enjeux numériques, responsable de l'analyse des données, de la performance, de la synthèse et de l'appui.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil)
Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles
Institut national de la propriété industrielle (Inpi)
M. Pascal Faure, directeur général
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)
M. Victor Geneste, président
Direction des Affaires civiles et du sceau (DACS)
M. Martin Guesdon, chargé de la sous-direction du droit économique
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-877.html
* 1 Rapport n° 757 (2024-2025) de M. Raphaël Daubet et Mme Nathalie Goulet fait au nom de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, 18 juin 2025.
* 2 La Cnil a ainsi fait part au rapporteur de l'analyse suivante : « L'exposé des motifs précise que le fichier doit permettre d'éviter la réutilisation de ces identités dans de nouvelles structures frauduleuses. La rédaction de l'article 2 de la proposition de loi semble, par conséquent, trop large puisqu'elle vise un objectif imprécis de lutte contre “ les fraudes ” ».
* 3 Si ces éléments peuvent, le cas échéant, être prévus par voie réglementaire, la Cnil a néanmoins rappelé que leur nature dépendrait directement des modalités d'inscription au fichier, elles-mêmes trop imprécises en l'état.
* 4 La Cnil a ainsi fait part au rapporteur de l'analyse suivante : « la rédaction actuelle pourrait permettre un accès fondé sur la lutte contre tout type de fraude, alors que la finalité du fichier semble limitée au domaine de la délinquance économique et financière. Il serait donc souhaitable de préciser les missions concernées afin de les limiter au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit d'accorder aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale un accès permanent au fichier. Toutefois, la répartition des rôles entre les différents acteurs du dispositif n'apparaît pas clairement définie. Si le Conseil national des tribunaux de commerce est désigné comme responsable du traitement, les greffiers semblent appelés à alimenter le fichier. Les conditions concrètes dans lesquelles ils procèdent à cette alimentation - notamment la nature des informations collectées, leurs sources, ainsi que les modalités de vérification ou de transmission - ne sont pas précisées. Une clarification du rôle respectif du Conseil national et des greffiers, tant en matière d'alimentation que d'accès au contenu du fichier, apparaît dès lors nécessaire pour garantir la transparence et la conformité du dispositif aux principes de protection des données ».
* 5 Articles L. 561-5 et R. 561-10 du code monétaire et financier.
* 6 Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
* 7 Rapport n° 757 (2024-2025) de M. Raphaël Daubet et Mme Nathalie Goulet fait au nom de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, 18 juin 2025.
* 8 Article L. 141-12 du code de commerce. L'article L. 141-13 liste quant à lui les mentions obligatoires.
* 9 7° de l'article 635 du code général des impôts.
* 10 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 11 Amendement n° CL187.
* 12 CNGTC, Livre blanc, 15 propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité financière, p. 24.
* 13 Article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
* 14 Article R. 561-1 du code monétaire et financier.
* 15 Article L. 561-47-1 du code monétaire et financier.
* 16 Article L. 561-48 du code monétaire et financier.
* 17 Elle n'est néanmoins pas mentionnée aux articles L. 561-47-1 et L. 561-48 du CMF.
* 18 Ministères économiques et financiers, « Comment s'informer sur le cadastre ? », 24 janvier 2025.
* 19 Commission d'accès aux documents administratifs, « Fiscalité locale et cadastre ».
* 20 Conseil d'État, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 119734.
* 21 À l'adresse suivante : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do.
* 22 Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques.
* 23 Commission d'accès aux documents administratifs, « Fiscalité locale et cadastre ».
* 24 Rapport n° 757 (2024-2025) de M. Raphaël Daubet et Mme Nathalie Goulet fait au nom de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, 18 juin 2025.
* 25 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 26 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 27 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 28 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.