III. LA POSITION DE LA FRANCE : UN ATTENTISME INACCEPTABLE COMPTE TENU DE LA GRAVITÉ DES ENJEUX
La France à travers ses départements et territoires Outre-mer est présente dans tous les océans, ce qui devrait la pousser à jouer un rôle moteur dans l'instauration des systèmes d'alerte aux tsunamis. En réalité, une fois l'émotion liée à la catastrophe de Sumatra passée, la volonté politique s'est émoussée, laissant les services techniques assumer seuls et sans moyens les engagements pris par la France il y a à peine deux ans.
A. UNE FORTE VULNÉRABILITÉ AUX TSUNAMIS QUI DEVRAIT CONDUIRE À UN ENGAGEMENT IMPORTANT DE LA FRANCE
Les côtes françaises sont toutes concernées par l'aléa tsunami, la France a donc intérêt au développement d'un système d'alerte au niveau international.
1. Des enjeux de sécurité importants
a) Une exposition au risque particulièrement grande compte tenu de sa géographie
Les zones économiques exclusives (ZEE) françaises couvrent plus de 10 millions de km² dans l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. La France se situe ainsi au deuxième rang mondial après les États-Unis.
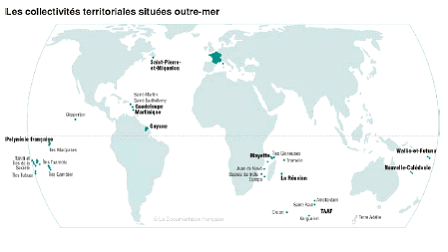
A contrario , cela signifie qu'elle est particulièrement exposée au risque de tsunami.
La France compte 5.800 km de côte en métropole. S'agissant de la côte française en Méditerranée, les événements suivants ont été répertoriés :
- Le 20 juillet 1564, un séisme a entraîné une inondation à Antibes et des dégâts à Nice ;
- le 4 février 1808, un flux / reflux fut observé à Marseille après un séisme ;
- le 9 décembre 1818, un séisme a entraîné de violentes vagues à Antibes ;
- le 23 février 1887, un séisme en mer Ligure a provoqué un retrait de la mer suivie de vagues qui sont montées jusqu'à 2 m d'altitude à Cannes et à Antibes, inondant les plages et causant des destructions matérielles ;
- le 16 octobre 1979, l'effondrement d'une partie de l'aéroport de Nice a entraîné des vagues de 3 m de haut sur Antibes ;
- le 21 mai 2003, le tsunami généré par le séisme de Boumerdès (Algérie), de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, a causé des dégâts dans certains ports français.
Ces deux derniers événements sont symptomatiques des événements qui pourraient affecter, à l'avenir, la côte d'Azur.
D'une part, un effondrement de terrain est susceptible d'engendrer un tsunami local, dont le délai de propagation serait très court. Dans le cas de l'aéroport de Nice, les travaux et l'instabilité de la zone se sont sans doute conjugués pour provoquer l'accident. De façon générale, en mer Ligure (de Fréjus à Menton pour la France), la côte est jugée instable et profonde, ce qui crée des conditions maximales de risque.
D'autre part, le contexte géodynamique de la côte méditerranéenne en fait une zone de danger. Un tremblement de terre provoquant un effondrement de terrain ou un séisme sous-marin pourrait générer un tsunami qui aggraverait l'événement. Un tel séisme pourrait se produire en mer Ligure, où il existe des failles actives. Il pourrait également avoir lieu en Algérie. Ainsi, le séisme de Boumerdès s'est produit à la zone frontière entre la plaque tectonique eurasienne et la plaque africaine, dans une région où la plaque africaine bouge vers le nord-ouest, contre la plaque eurasienne, à une vitesse de quelques millimètres par an. Le déplacement relatif de la plaque crée un environnement tectonique propice à des tremblements de terre de magnitudes élevées potentiellement générateurs de tsunamis de plusieurs mètres de haut, avec des délais d'alerte très courts (maximum une heure).
La France compte également plus de 12.000 km de côtes Outre-mer, dans tous les océans du globe. Le risque de tsunami existe particulièrement à La Réunion, dans le Pacifique et aux Antilles.
Environ 7 heures après le séisme du 26 décembre 2004 au large de Sumatra, le tsunami a atteint les côtes de La Réunion avec des vagues d'une hauteur maximale de 2,50 m, qui ont provoqué près de 500 000 euros de dégâts matériels.
Dans le Pacifique, le risque de tsunami est bien pris en compte en Polynésie française mais ne fait jusqu'à présent l'objet d'aucune surveillance à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie. Pourtant, plusieurs événements témoignent de la réalité de ce risque dans ces deux régions.
Tsunamis observés en Nouvelle Calédonie
|
DATE |
ORIGINE |
OBSERVATIONS |
|
28-03-1875 |
Séisme 8 Vanuatu |
Tsunami destructeur à Lifou |
|
4-10-1931 |
Séisme 7.9 Salomons |
Tsunami 1.5m à Hienghene, bateaux renversés |
|
19-7-1934 |
Séisme 7.8 Est Salomons |
Tsunami 1.3m à Hienghene, Touho |
|
21-7-1934 |
Séisme 7 Est Salomons |
Tsunami à Hienghene, Touho, Thio |
|
1951 |
Origine et date exactes inconnues |
Tsunami au nord d'Ouvéa |
|
1993 |
Séisme 6,3 Futuna |
Tsunami local qui n'a pas causé de dégât |
|
1 er avril 2007 |
Séisme 8,7 Salomons |
Tsunami à Hienghene, Poindimié et Touho |
Source : CEA, COI
Aux Antilles, l'histoire des tsunamis reste encore mal connue, mais l'on sait que le tremblement de terre de Lisbonne (1755) y causa des vagues de 3 à 6 m de haut. La sismicité de cette région est dominée par des ruptures du contact entre la plaque Nord-Atlantique et la plaque Caraïbe, la première plongeant sous la seconde de 2 cm/an. Cette région est également fortement volcanique.
La dernière décennie fut marquée par plusieurs événements :
* Un séisme a eu lieu le 21 novembre 2004 au large de la Guadeloupe, à une dizaine de kilomètres au sud des îles des Saintes. Sa magnitude 6,3 en a fait le plus gros séisme ayant touché l'archipel depuis 1897. Un « creux » s'est formé au fond de l'océan, induisant des mouvements d'eau qui ont généré un tsunami voyageant à une centaine de km/h. L'eau s'est retirée d'environ 80 m. Les mesures faites par des géologues quelques semaines après sur les côtes voisines ont montré, par les débris déposés, que la mer était montée de plusieurs mètres en certains endroits de la côte sud des Saintes. Les dégâts ne furent heureusement que matériels.
* Les effondrements successifs du dôme du volcan de l'île voisine de Montserrat ont entraîné des tsunamis sur les côtes de Guadeloupe en 2003 (d'une hauteur de 8 m à Montserrat et de 70 cm à la Guadeloupe) et en 2006 (avec des vagues atteignant 1 m à la Guadeloupe).
Les effondrements du volcan de Montserrat ont entraîné l'entrée en mer de 200 millions de m 3 de matériel volcanique depuis 1997. Or il a été montré que d'autres volcans des Antilles ont provoqué, dans le passé, des glissements beaucoup plus importants. Ainsi, la Montagne pelée (Martinique) a rejeté dans la mer plusieurs km 3 de roche il y a 100.000, 25.000 puis 9.000 ans. Une simulation a montré qu'un nouvel effondrement de ce volcan, à hauteur d'1 km 3 , pourrait entraîner une vague de 10 à 20 m de haut dans la région. Quant à la Soufrière de la Guadeloupe, elle s'est effondrée environ tous les 1000 ans depuis 8000 ans, et pour la dernière fois il y a 400 ans.
Enfin, il existe un volcan sous-marin actif près de la Grenade, dénommé le « kick'em Jenny », qui pourrait, lui aussi, avoir des effets ravageurs. Ce volcan est actuellement situé à 180 m sous la surface de la mer. Il devrait, à terme, conduire à l'apparition d'une nouvelle île.







