c) L'Atlantique Nord-Est et la Méditerranée : l'attentisme des Etats
Le groupe intergouvernemental de coordination pour la Méditerranée et l'Atlantique Nord-Est s'est déjà réuni 4 fois : à Rome en novembre 2005, à Nice en mai 2006, à Bonn en février 2007 et à Lisbonne fin novembre 2007. Pourtant, la mise en place d'un système d'alerte aux tsunamis dans cette zone apparaît laborieuse.
La couverture sismique des pays du pourtour Méditerranéen est loin d'être homogène aussi bien en ce qui concerne le nombre de stations sismiques que le type de sismomètre installé. En outre, de nombreux pays, en particulier les pays d'Afrique du Nord, refusent l'accès à leurs données. Or, la détection rapide d'un séisme et la détermination de manière fiable de son épicentre, de sa profondeur et de sa magnitude reposent sur un maillage dense de sismomètres dont les données sont accessibles par tous. Dans la mesure où les sources susceptibles de déclencher un tsunami à l'échelle du bassin méditerranéen sont situées sur les failles au large de l'Afrique du Nord, l'attitude fermée des pays de cette région constitue un obstacle majeur.
Par ailleurs, très peu de stations marégraphiques transmettent leurs données en temps réel, ce qui ne permet pas de les utiliser dans le cadre d'une alerte aux tsunamis et de vérifier si un tsunami a été induit. Pour les stations marégraphiques les plus modernes (ainsi que pour de nombreuses stations sismiques), la transmission des données ne se fait pas par satellite mais par internet, alors même qu'il s'agit d'un moyen de télécommunication vulnérable en cas de séisme.
Le groupe de travail sur les instruments de mesure du niveau de la mer a sélectionné une trentaine de marégraphes particulièrement stratégiques et exhorté les Etats chargés de la gestion et du traitement des données de ces marégraphes à les rendre opérationnels pour la détection d'un tsunami 43 ( * ) d'ici la fin de 2007. La réussite de cette action dépend cependant de la bonne volonté des Etats puisqu'aucun financement spécifique n'est prévu. Ce programme risque donc de prendre du retard compte tenu de la difficulté rencontrée par les organismes responsables des marégraphes pour obtenir des crédits pour l'amélioration de leurs instruments de mesure. Ainsi le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine) chargé d'améliorer les performances des marégraphes situés sur les côtes françaises a déjà fait savoir que faute de crédits, seules les données du marégraphe du Conquet seront transmises en temps réel en 2007.
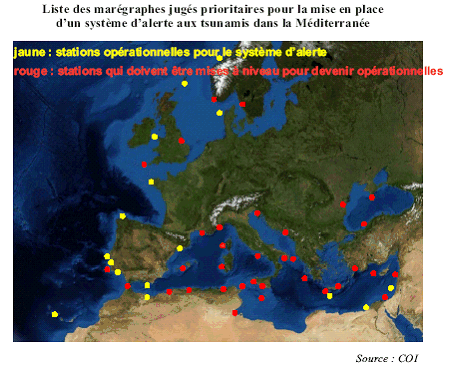
En outre, tout comme pour les données sismiques, la mise en place d'un système d'alerte aux tsunamis efficace se heurte au refus de nombreux pays d'Afrique du Nord de transmettre leurs données marégraphiques.
De même, l'installation de capteurs de pression au large est rendue difficile à la fois par le manque de crédits.
Au-delà de la détection, il semble qu'aucun Etat ne se soit engagé dans l'élaboration d'un plan d'alerte définissant les mesures à prendre par tous les acteurs chargés de la protection de la population. Aucune zone d'inondation n'a été définie, aucun plan d'évacuation n'est opérationnel. Les modalités de l'alerte n'ont pas été définies (sirènes, messages radio) et aucune action de sensibilisation et d'éducation de la population n'a été entreprise.
Votre rapporteur a constaté que l'Union européenne par le biais de la commission n'était pas impliquée dans la mise en place du système d'alerte aux tsunamis dans la zone Méditerranée/Atlantique Nord-Est. Cette absence est surprenante à plusieurs égards.
D'abord, ce projet est par nature européen : tous les pays européens sont concernés, les uns parce qu'ils bordent la Méditerranée, les autres parce qu'une proportion non négligeable de leur population se rend en villégiature sur les côtes des pays méditerranéens.
En outre, ce projet nécessite l'installation d'infrastructures (stations sismiques, marégraphes, tsunamimètres) utiles à tous les pays mais dont le financement incombe jusqu'à présent aux Etats nationaux. La prise en charge d'une partie de l'instrumentation à travers des programmes européens apparaît donc légitime et accélèrerait certainement la mise en place du dispositif d'alerte.
Enfin, ce projet ne deviendra opérationnel que si les pays d'Afrique du Nord acceptent de coopérer. L'Union européenne peut les y inciter dans le cadre de sa politique euro-méditerranéenne.
D'après votre rapporteur, l'élaboration d'une stratégie claire en matière d'alerte aux tsunamis au niveau de la zone Méditerranée/Atlantique du nord-est est brouillée par deux autres problématiques : la diversité des sources tsunamigènes et l'aspiration à une alerte multirisque.
Les systèmes d'alerte en train d'être instauré dans l'océan Indien, dans les Caraïbes et en Méditerranée/Atlantique Nord-Est ont vocation à gérer des tsunamis régionaux et des télétsunamis, c'est-à-dire des tsunamis dont la source est dans la majorité des cas sismique et située à une distance telle que le délai entre l'occurrence du séisme et l'arrivée du tsunami sur les côtes est compris entre 20 minutes et plusieurs heures. Pour les côtes touchées plus rapidement (notamment celles situées près de la source), le dispositif d'alerte tel qu'il est prévu actuellement n'est pas opérationnel car les délais sont trop courts et aucun Etat n'a pris position sur une automatisation de l'alerte par le biais de sirènes.
Or, l'étude des sources tsunamigènes en Méditerranée montre que le danger n'est pas simplement d'origine sismique, mais également lié aux instabilités gravitaires et aux volcans actifs. Le risque de tsunamis locaux n'est donc pas négligeable alors même qu'il ne peut pas être géré convenablement par le dispositif proposé. Certains pays sont donc en train de remettre en question le bien-fondé du système parce qu'il ne propose rien pour les tsunamis locaux.
Selon votre rapporteur, cette attitude n'est guère justifiée : compte tenu des difficultés déjà rencontrées pour l'instauration d'un système d'alerte aux tsunamis régionaux, il serait illusoire de vouloir le rendre à ce stade opérationnel pour les tsunamis locaux. En effet, ces derniers exigent une instrumentalisation très dense et une surveillance permanente des zones d'instabilité gravitaire et des volcans qui ne peuvent être prises en charge que par les Etats nationaux concernés. Il convient de rappeler que dans le dispositif pour le Pacifique, le PTWC sert également de centre d'alerte local pour Hawaï. Les Etats de la Méditerranée/Atlantique Nord particulièrement exposés aux tsunamis locaux seront donc amenés à développer un système d'alerte national, voire local. L'Italie a ainsi installé une surveillance permanente du Stromboli après le tsunami du 30 décembre 2002.
Par ailleurs, la zone géographique retenue (Méditerranée/Atlantique Nord-est) n'est pas exposée de manière uniforme aux aléas tsunamis. L'Europe du Nord est moins concernée par les tsunamis et doit plutôt lutter contre les ondes de tempête. Ces pays n'ont donc accepté de participer à la mise en place d'un système d'alerte aux tsunamis qu'à condition que l'alerte soit étendue à l'ensemble des risques d'origine marine.
Les défenseurs de cette approche multirisque estime que le financement des instruments de mesure du niveau de la mer devrait en être facilité puisqu'ils serviront à la détection de plusieurs risques. Pour autant, l'élargissement du système d'alerte à plusieurs risques peut également freiner sa mise en place. En effet, les connaissances scientifiques exigées ne sont pas les mêmes : la détection d'un tsunami s'appuie sur un réseau sismologique, les tempêtes sont du ressort des services météorologiques. De même, les plans de prévention sont distincts dans la mesure où les délais de réaction sont très variables. Alors que l'instauration d'un dispositif pour un seul risque s'avère relativement laborieuse, nécessitant l'organisation de multiples réunions pour dégager un consensus, le processus de décision risque d'être encore ralenti si d'autres aléas doivent être pris en compte.
***
Depuis le tsunami de Sumatra, la communauté internationale a pris conscience que le risque de tsunami n'était pas limité au Pacifique, mais concernait tous les océans. Chaque bassin a donc entrepris la mise en place d'un système d'alerte aux tsunamis.
Les résultats observés sont inégaux : les pays de l'océan Indien, encore très marqués par la catastrophe du 26 décembre 2004 et les trois autres tsunamis générés depuis 44 ( * ) , restent fortement impliqués. Aux Caraïbes et dans la zone de la Méditerranée/Atlantique Nord-est, une fois l'émotion passée, la plupart des Etats dont la France semblent désormais réticents à investir dans un système d'alerte pérenne compte tenu de la rareté de l'aléa.
* 43 Initialement, ces marégraphes doivent être capables d'envoyer des signaux toutes les minutes lorsqu'ils se trouvent à plus d'une heure (ou 100 km) d'une source tsunamigène, avec à terme un message toutes les 15 secondes.
* 44 Les trois tsunamis générés depuis celui du 26 décembre 2004 sont les tsunamis du 28 mars 2005, du 17 juillet 2006 et du 12 septembre 2007, qui ont fait des victimes à chaque fois. Le caractère « exceptionnel » du tsunami de Sumatra avancé par certains pour justifier l'absence de système d'alerte dans cette région a donc dû être relativisé.







