TITRE II
-
DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS
ET PRODUITS
DU CORPS HUMAIN
Article 5
(art. L. 1211-1, L. 1211-2 , L. 1211-4, L
1211-6, L. 1211-7, L. 1211-8, L. 1211-9 du code de la
santé publique)
Principes généraux du don et de
l'utilisation des éléments
et produits du corps
humain
Objet : Cet article vise à renforcer, en
précisant leur portée, les principes généraux
applicables au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain.
I - Le dispositif proposé
Le présent article vise à préciser les principes
généraux applicables au don et à l'utilisation des
éléments et parties du corps humain.
Pour cela, il modifie l'ensemble des articles L. 1211-1 à
L. 1211-9 du code de la santé publique, à l'exception des
articles L. 1211-3 et L. 1211-5.
Article L. 1211-1 du code de la santé publique
Le
1°
du présent article remplace les deux derniers
alinéas de l'article L. 1211-1 par un alinéa unique qui
affirme une position de principe : toutes les activités relatives
aux éléments et produits du corps humain, y compris en vue de
leur importation ou exportation, doivent poursuivre une finalité
médicale, scientifique ou être menées dans le cadre d'une
procédure judiciaire.
Les dispositions des deux alinéas remplacés ne sont toutefois pas
abrogées :
- celles du deuxième alinéa relatives à la
sécurité sanitaire sont renvoyées à
l'article L. 1211-6 du code de la santé publique,
lui-même amendé en ce sens ;
- celles du troisième alinéa définissant la
thérapie cellulaire sont reportées au titre IV du code de la
santé publique.
Article L. 1211-2 du code de la santé publique
Le
2°
du présent article complète
l'article L. 1211-2 par deux alinéas.
Le premier dispose que, sauf opposition de la personne concernée, il
sera possible de changer la finalité de l'utilisation des
éléments prévue au moment du prélèvement.
Le second précise la réglementation applicable aux
autopsies
médicales
qui ne figure pas aujourd'hui dans la loi. Ces
dernières doivent avoir pour but la recherche des causes du
décès. Elles sont soumises à la règle du
consentement présumé. Toutefois, un danger pour la santé
publique ou une nécessité impérieuse de suivi
épidémiologique ainsi que l'absence d'autres
procédés permettant d'établir avec certitude la cause du
décès pourront justifier la conduite de telles autopsies
malgré l'opposition du défunt.
Article L. 1211-4 du code de la santé publique
L'article L. 1211-4 pose le principe qu'aucun paiement ne peut être
alloué à celui qui se prête au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Seul peut intervenir,
« le cas échéant, le
remboursement des frais engagés »
selon les
modalités arrêtées par le décret
n° 2000-401 du 11 mai 2000.
Le
3°
du présent article assouplit cette règle en
prévoyant que
« les frais (...) sont intégralement
pris en charge »
. Le principe de gratuité ne doit pas en
effet conduire les donneurs à devoir faire l'avance de leurs frais.
Article L. 1211-6 du code de la santé publique
Le
4°
du présent article modifie
l'article L. 1211-6 :
- en inscrivant dans la loi le principe de non-utilisation des produits
issus du corps humain si, en l'état actuel des techniques, le risque
prévisible encouru par le receveur est très supérieur
à l'avantage escompté pour celui-ci. Il s'agit là du
principe de la « balance bénéfice-risque »
prôné par le Conseil d'Etat ;
- en réécrivant dans un second alinéa le principe de
soumission des prélèvements à des fins
thérapeutiques -et des activités ayant les mêmes fins-
à des règles de sécurité sanitaire comprenant
notamment des tests de dépistages.
Ces règles sont actuellement édictées par le décret
n° 97-928 du 9 octobre 1997.
Article L. 1211-7 du code de la santé publique
Le
5°
du présent article modifie l'article L. 1211-7
pour inclure les produits thérapeutiques annexes dans le champ de la
biovigilance. Cette activité, qui relève de l'AFSSAPS, concerne
les produits énumérés à l'article L. 5311-1 du
code de la santé publique.
Articles L. 1211-8 et L. 1211-9 du code de la santé
publique
Les
6° et 7°
du présent article procèdent
à un certain nombre de coordinations aux articles L. 1211-8 et L. 1211-9.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté sept amendements au présent
article.
Au premier alinéa du texte proposé par le
2°
pour
compléter l'article L. 1211-2, elle a, sur proposition de sa
commission spéciale, adopté un amendement rédactionnel
prévoyant que l'opposition à l'utilisation d'un
élément ou d'un produit du corps humain à une fin
différente de celle prévue initialement est exercée
conjointement par les deux titulaires de l'autorité parentale lorsque la
personne sur laquelle est opéré le prélèvement ou
la collecte est mineure. Elle a, en outre, adopté un amendement
proposé par le Gouvernement prévoyant qu'il soit
dérogé de droit à l'obligation d'information
préalable en cas d'impossibilité de retrouver la personne
concernée, ou en cas de décès de cette dernière.
Au second alinéa de ce texte, elle a adopté deux
amendements :
- le premier, à l'initiative de la commission spéciale, est
de nature rédactionnelle. Il remplace, pour les autopsies
médicales, le terme
«
réalisées
» par celui de
«
pratiquées
» ;
- le second, à l'initiative du Gouvernement, réserve la
possibilité d'autopsie, malgré l'opposition de la personne
décédée, au cas de «
nécessité
impérieuse pour la santé publique
» et non plus au
cas de «
danger pour la santé publique ou de
nécessité impérieuse de suivi
épidémiologique
». Cette nouvelle rédaction
réalise une synthèse des deux possibilités prévues
par la précédente rédaction. Le Gouvernement, par la voix
de M. Bernard Kouchner, en a précisé la portée
rédactionnelle en ces termes :
«
L'amendement vise à clarifier les intentions du
Gouvernement qui entend limiter l'exception au principe du consentement
présumé requis pour la pratique des autopsies médicales en
cas de danger immédiat pour la santé publique ou de
nécessité impérieuse de suivi
épidémiologique dans un souci de santé publique, qu'il
s'agisse, par exemple, de méningite ou d'encéphalopathie
spongiforme bovine. La rédaction proposée fait la synthèse
de ces deux critères.
« Cette exception vise à permettre la pratique des autopsies
afin de suivre, par exemple, l'épidémiologie de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob. Elle pourra aussi être utilisée
exceptionnellement en face d'un syndrome émergent que l'on ne comprend
pas et pour lequel ces investigations sont absolument nécessaires pour
protéger le reste de la population, notamment en présence de cas
groupés de décès dans un tableau clinique comparable et
non rattachable à une cause connue.
»
Cet amendement prévoit en outre qu'il revient au ministre de la
santé de préciser, par arrêté, les pathologies et
situations pouvant justifier de cette dérogation.
A l'initiative de la commission spéciale et du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a complété
l'article L. 1211-3 du code de la santé publique en
prévoyant que l'information en faveur du don d'éléments ou
de produits du corps humain serait menée en collaboration avec le
ministre chargé de l'éducation nationale
(2° bis nouveau
du présent article)
.
A l'initiative de la commission spéciale et de
M. Jean-François Mattei, l'Assemblée nationale a
adopté, à l'article L. 1211-6, un amendement
précisant que les prélèvements et collectes de produits du
corps humain à des fins thérapeutiques seraient soumis aux
règles de sécurité sanitaire en vigueur
(4° du
présent article)
.
Elle a enfin, à l'initiative de sa commission spéciale,
adopté un amendement prévoyant le principe de la reconnaissance
de la Nation aux personnes ayant fait don, à des fins médicales
ou scientifiques, d'éléments ou produits de leur corps
(5° bis nouveau du présent article)
.
III - La position de votre commission
L'encadrement juridique de l'utilisation des éléments et
produits du corps humain
L'article L. 1211-1 du code de la santé publique, dans sa
rédaction actuelle, prévoit que l'interdiction de céder ou
d'utiliser des éléments et produits du corps humain ne s'applique
qu'au prélèvement.
Le Conseil d'Etat
51(
*
)
avait
estimé que «
cette
limitation est contestable car elle
ne met pas les éléments et produits du corps humain totalement
à l'abri des pratiques commerciales
. Ainsi, leur importation
et leur utilisation pour des buts qui ne sont ni scientifiques et
médicaux ni judiciaires n'est pas interdite. Il semble donc souhaitable
d'introduire un principe général d'interdiction de l'utilisation
des éléments ou produits du corps humain (vivant ou mort)
à des fins autres que médicales, scientifiques ou judiciaires et
d'insérer ce principe au titre premier du
livre VI »
.
La réponse proposée par le texte répond de manière
satisfaisante au souhait formulé par la Haute Juridiction.
L'amélioration de l'information du public
Dans son rapport d'information en vue de la révision de cette loi,
l'Assemblée nationale relève le caractère
éminemment symbolique du prélèvement et de la greffe. A ce
titre, son rapporteur
52(
*
)
,
M. Alain Claeys note que
« évoqué comme
manifestation de cohésion sociale, le don d'organes fait
référence à la nécessité d'un gisement
d'organes où puiser pour sauver des malades. Cette
référence heurte la représentation que l'homme garde de
lui-même, de son corps comme siège de l'expérience
primordiale de la vie, comme totalité rebelle à une approche
analytique. Or, il est désormais confronté à une
médecine qui recourt de plus en plus à la science laquelle, par
définition, analyse, segmente et parcellise son champ d'investigation.
La prescription d'une greffe pour un malade revient, en dernier ressort,
à attendre la mort d'une personne inconnue. Mort violente, puisque le
prélèvement ne peut avoir lieu que sur une personne en
état de mort encéphalique, laquelle n'est pas encore très
connue du public et dont les fondements scientifiques, définis par
quelques savants, ne sont pas partagés par l'ensemble des
sociétés ».
Cette symbolique n'est pas sans éclairer le déficit en greffons
que connaît notre pays. Certes, depuis la loi Caillavet, le principe du
consentement présumé est consacré. Mais, depuis une simple
circulaire du 3 avril 1978, la famille intervient dans le processus de
prélèvement par le biais de son témoignage.
Or, la situation tragique dans laquelle intervient ce prélèvement
-la disparition d'un proche, dans neuf cas sur dix, de mort violente
53(
*
)
- explique la réticence des
proches à témoigner dans les limites que leur pose la
législation : le sujet décédé a-t-il
formulé son opposition au prélèvement d'organes ?
En conséquence, une moitié des personnes en état de mort
cérébrale ne fait pas l'objet de prélèvement et
dans un tiers des cas cette situation est due à une opposition, le plus
souvent des proches.
Devenir des sujets en état de mort encéphalique recensés en 2000
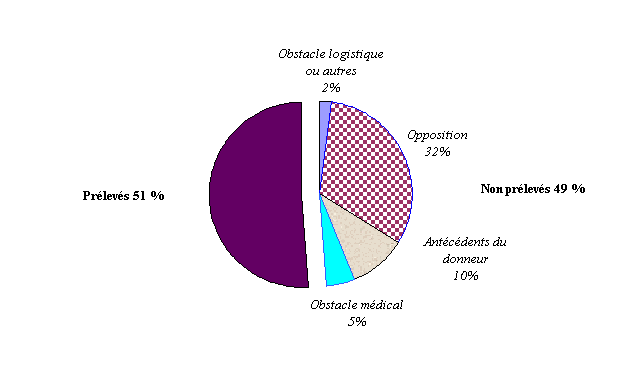 Source : Etablissement français des
greffes, Information presse du 30 janvier 2001.
Source : Etablissement français des
greffes, Information presse du 30 janvier 2001.
Alors même que le praticien serait en droit de prélever, il ne le
fera généralement pas contre l'assentiment de la famille. C'est
donc par une meilleure information qu'il convient de lever ces
réticences.
Le présent article prévoit la nécessité de
campagnes auprès des jeunes. Ces dernières pourront associer les
ministères de la santé et de l'éducation nationale.
Votre commission vous propose d'aller plus loin et de prévoir, par
un
amendement,
que tout médecin devra s'assurer auprès de ses
patients âgés de 16 à 25 ans qu'ils ont bien reçu
une telle information et, dans le cas contraire, la délivrer le plus
rapidement possible.
Cette mesure d'information, d'ordre éthique et sanitaire, permet en
outre de rendre la règle du prélèvement
présumé plus équitable. Ce ne sera en effet plus dans
l'ignorance de la loi que les personnes « subiront » cette
règle encore parfois perçue comme illégitime.
L'introduction du principe de la balance
« avantage-coût »
Plusieurs drames ont gravement affecté la crédibilité de
la santé publique dans notre pays notamment, la contamination des
produits sanguins par le virus du Sida et le développement de la maladie
de Creutzfeldt-Jacob chez des enfants traités avec de l'hormone de
croissance. Ces drames ont renforcé la nécessité de voir
des règles de sécurité sanitaire stricte régir
l'utilisation des produits et éléments du corps humain à
des fins thérapeutiques.
La loi de 1994 posait des principes importants, notamment le dépistage
et la vigilance, en renvoyant au décret leur mise en oeuvre. Ces
dispositions ont été renforcées par la loi du 28 mai 1996
qui confère une sorte de pouvoir « conservatoire »
au ministre de la santé à l'égard de la transformation,
cession ou utilisation de ces produits.
Néanmoins, vis-à-vis de ces produits, une difficulté se
posait, rappelée par MM. Claude Huriet et Alain Claeys
54(
*
)
:
« S'agissant des
prélèvements de tissus ou cellules post mortem,
il
(le législateur)
n'a pas cru devoir les interdire en dépit
des risques de contamination difficiles à prévenir
mais a
confié, là encore, au pouvoir réglementaire le soin de
fixer les situations médicales où ils pourraient être
autorisés ».
Le présent article va plus loin, puisqu'il propose d'écrire dans
la loi que ces produits ne peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques,
leur utilisation présente pour le receveur plus de risques que
d'avantages.
La paternité de ce concept de « balance
avantages/risques » revient sans nul doute au Conseil d'Etat. Ce
dernier avait, en effet, formulé des réserves quant à
l'articulation entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire
sur cet aspect de la sécurité sanitaire. Ces dispositions
devaient-elles continuer à figurer en intégralité dans la
loi, ou seuls leurs aspect éthiques ? A ce stade, le Conseil ne
tranchait pas mais formulait une proposition «
Si le choix est
fait de ne pas dissocier ces dispositions et de les maintenir dans la loi de
1994 révisée, il paraîtrait possible et souhaitable de
préciser, à cette étape du texte, la notion de
sécurité sanitaire en introduisant la notion de balance
avantages/risques.
La modification ici suggérée consiste
à expliciter cette notion de sécurité sanitaire et
à affirmer un principe qui doit s'imposer tant aux autorités
sanitaires, dans leur rôle de régulation et de
réglementation, qu'au praticien à qui il revient, dans chaque cas
particulier, d'apprécier le rapport avantages/risques
».
Le Conseil définissait ce dernier précisément :
« La balance avantages/risques conduit à renoncer
à un prélèvement si les avantages attendus pour la
personne concernée sont inférieurs aux risques
encourus
. Cependant, cette formulation négative consacre, en
sens inverse, la nécessité de la prise de risque.
La
décision consiste également, en effet, à prendre un risque
si celui-ci est acceptable
, c'est-à-dire s'il n'est pas hors de
proportion avec les bénéfices escomptés de l'intervention
envisagée. Un éventuel receveur ne saurait encourir une grave
perte de chance, celle de bénéficier d'un don d'organe, au nom
d'un risque infime pour sa santé.
La recherche de
sécurité ne doit donc pas être assimilée à
une exigence de risque zéro, qui n'existe pas dans la pratique, mais
procéder d'une évaluation portant sur l'acceptabilité du
risque
»
.
Ce type de raisonnement n'est pas étranger à la jurisprudence du
Conseil qui, pour apprécier la légalité de certains actes
administratifs, avait déjà construit une
« théorie du bilan ».
Votre rapporteur n'est pas opposé à cette introduction qui est en
effet utile. Elle se heurte cependant à des limites fortes que le
Conseil reconnaît lui-même. Il est en effet nécessaire que
« soient estimées la potentielle gravité du risque
et sa probabilité de se réaliser au regard du nombre et de la
nature des bénéfices thérapeutiques attendus de
l'opération envisagée ».
Ce sont donc les autorités sanitaires qui sont confrontées
à la nécessité d'évaluer un risque pour le patient,
et de lui proposer de le prendre au regard des bénéfices
escomptés de l'opération.
Il est nécessaire de s'interroger en conséquence sur le
régime de responsabilité des praticiens étant conduits
à évaluer ce risque. En cas de réalisation de ce dernier,
la personne qui aura consenti au traitement ne devrait pouvoir, si
l'autorité sanitaire n'a pas commis de faute manifeste dans
l'évaluation de ce risque, se retourner contre cette dernière. En
conséquence, c'est le régime de responsabilité
prévu au titre III de la loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des
malades qui devrait s'appliquer avec, le cas échéant,
indemnisation du patient par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM), qui trouve ici toute sa justification.
La reconnaissance de la Nation aux donneurs
Cette possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, est
controversée. Pour le rapporteur de la mission d'information de
l'Assemblée nationale, M. Alain Claeys, il est
évident
55(
*
)
que
« cette reconnaissance (...) devrait s'exprimer en faveur des
donneurs seuls car exprimer de la reconnaissance aux familles « de
ceux qui donnent » mettrait à bas tout l'édifice du
consentement présumé reposant sur l'intégrité du
donneur et le respect de son libre arbitre. Même si la
réalité des faits tend à le laisser croire, ce ne sont pas
les familles qui donnent, elles ne sont que porteuses, selon la loi, de la
parole du défunt »
.
Il s'agit donc de réserver cette reconnaissance aux donneurs vivants des
éléments et produits du corps humain.
Cette proposition présente deux difficultés : l'une pratique
et l'autre éthique.
La difficulté pratique a été formulée devant votre
commission par M. Claude Huriet. Tout en agréant cette proposition,
celui-ci s'interrogeait sur les modalités d'expression de ce
don
56(
*
)
.
« Il reste
à voir comment s'exprimera cette reconnaissance de la Nation pour ceux
qui font don généreusement d'une partie de leur corps, de leurs
tissus ou de leur sang ».
La difficulté éthique a été
précisée
57(
*
)
par
M. Didier Sicard, président du Comité national consultatif
d'étique, qui, devant votre commission, a estimé que
« la notion de reconnaissance de la Nation à celui qui
donnerait son corps ne me paraît pas forcément à
encourager. En effet, il s'agit ici du domaine du privé et de l'intime
et de donner un gage de reconnaissance de la Nation ne me paraît pas
nécessaire. Enfin, ce point de vue est marginal. Aucun autre pays ne me
semble avoir inscrit une telle disposition et cette spécificité
française peut, paradoxalement, sembler ambiguë
».
M. Didier Sicard réitérait ainsi le scepticisme
formulé par le Comité d'éthique, qu'il préside,
dans son avis sur l'avant-projet de révision des lois de
bioéthique.
Extrait de l'avis n° 67 du 18 janvier 2001
Article L. 1211-8
« La reconnaissance de la Nation est acquise aux personnes qui
font don à des fins thérapeutiques ou scientifiques
d'éléments ou produits de leur corps. »
Supprimer
Cette disposition relève d'une rhétorique
dépassée et mal accordée avec l'éthique
individuelle du don. Le CCNE rappelle que la valorisation excessive du don a,
dans un passé récent, été désignée
comme l'une des causes du dysfonctionnement du dispositif français de
don du sang. Au surplus, si cette disposition devait se traduire par des
manifestations concrètes de reconnaissance (diplôme,
décoration, médaille...),
elle serait contraire au
principe fondamental qui inspire la loi, et qui est celui de l'anonymat du
don
.
Votre commission demeure sceptique sur la proposition formulée par
l'Assemblée nationale et s'interroge sur sa mise en oeuvre pratique.
En l'état, tout en comprenant les motivations de cette initiative de
l'Assemblée nationale, elle observe que « la reconnaissance de
la Nation » est un acte d'une forte portée symbolique que l'on
ne peut décerner de manière indifférenciée. Donner
un élément du corps humain, un tissu ou du sang, est un geste
noble mais qui peut difficilement être comparé avec le don de sa
vie par un sapeur-pompier ou un militaire tué dans l'exercice de son
devoir. Aussi vous propose-t-elle, par
amendement,
de supprimer cet
ajout de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.







