3. Des résultats inégaux
a) L'océan Indien : une mobilisation internationale qui porte ses fruits
A la suite du tsunami de Sumatra, les pays de l'océan Indien touchés par cette catastrophe naturelle ont fait l'objet d'un élan de solidarité sans précédent. Ainsi, les dons versés par les Etats-Unis s'élèvent à 1,95 milliard d'euros, dont 714 millions d'euros en provenance du gouvernement et 1,2 milliard de dons privés. L'Allemagne a été le deuxième plus gros contributeur, avec 536 millions d'euros en provenance du gouvernement allemand et 553 millions d'euros de dons privés. Outre les sommes versées pour l'aide humanitaire et la reconstruction des zones sinistrées, de nombreux pays ont souhaité coopérer à la mise en place d'un système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien. Comme il a été indiqué précédemment, l'Allemagne a engagé 45 millions d'euros pour l'instauration d'un système d'alerte en Indonésie. De même, le Japon a installé 23 stations sismiques « large bande » dans ce pays.
En attendant que le système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien devienne opérationnel, les centres d'alerte de Hawaï (PTWC) et du Japon assurent l'intérim à travers la diffusion de messages d'information 39 ( * ) .
Le groupe intergouvernemental de coordination pour l'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien s'est déjà réuni à quatre reprises. Lors de la dernière session au Kenya en février-mars 2007, d'importants progrès ont été constatés.
Les visites d'évaluation des capacités des pays pour mettre en place un dispositif d'alerte effectuées entre juin et septembre 2005 grâce à des financements de pays donateurs ont été très efficaces. Elles ont, grâce à la présence d'experts envoyés par les institutions onusiennes (Unesco, l'OMM et la SICP), contribué à sensibiliser les Etats qui ont, par la suite, soutenu activement la mise en place du système d'alerte.
Par exemple, la plupart des pays sont engagés dans l'installation des instruments de mesure nécessaires à l'analyse de l'aléa et dans la transmission des données en temps réel. Ainsi, l'Inde est en train de moderniser son réseau de stations sismiques et prévoit l'installation de 50 marégraphes et de 12 capteurs de pression (tsunamimètres). En Indonésie, 67 des 160 stations sismiques prévues transmettent déjà leurs données en temps réel ; 25 tsunamimètres et 80 marégraphes devraient compléter le dispositif.
Certains pays ont également déjà pris des mesures pour alerter la population. En Malaisie, des sirènes devraient être installées dans les zones fortement peuplées. En Thaïlande, le centre national d'alerte aux catastrophes naturelles pourra interrompre les programmes de 14 stations de télévision et de nombreuses radios pour diffuser ses messages.
En outre, des sessions de formation ont été organisées à Dubaï sur l'évaluation des risques et à Perth sur l'élaboration des cartes d'inondation. Chaque groupe de travail a défini un programme d'action précis et les échanges d'informations entre les participants de chaque groupe sont nombreux. A cet égard, le soutien logistique apporté par l'Australie qui finance notamment le secrétariat du groupe est un atout non négligeable.
Enfin, un centre d'information aux tsunamis sur le modèle de celui existant déjà à Hawaï devrait être créé à Jakarta, financé par le Canada.
Pour autant, certaines lacunes persistent auxquelles les pays du GIC/SATOI devront remédier.
D'abord, un test mené par le centre d'alerte aux tsunamis à Hawaï en février 2007 a révélé certains dysfonctionnements dans la réception des messages d'alerte par les points focaux nationaux. Ainsi, tous les Etats n'ont pas confirmé avoir bien reçu le message d'alerte. En outre, ce test a montré l'inégalité des performances des trois outils de communication utilisés selon les Etats : alors que la transmission du message à l'aide du système mondial de télécommunications a nécessité entre 1 à 5 minutes, il a fallu entre 10 à 15 minutes par fax et entre 1 à 59 minutes par email pour que le message soit reçu.
Ensuite, l'évaluation correcte de l'aléa tsunami en cas de séisme dans la région se heurte à plusieurs difficultés : le nombre des instruments de mesure à terre comme en mer fournissant des données en temps réel reste insuffisant ; il n'existe pas de données bathymétriques et topographiques de haute résolution près des côtes ; aucune étude des paléotsunamis n'a été entreprise pour mieux comprendre les anciens événements.
Par ailleurs, l'intégration des réseaux nationaux dans un système régional d'alerte peine à se mettre en place. Les échanges des données sismiques et marégraphiques entre les Etats du GIC/SATOI restent encore très partiels tandis que l'architecture prévue à l'origine (à savoir un ou plusieurs centres régionaux qui diffuseraient les messages d'alerte à des centres nationaux) a été récusée. En effet, les Etats ne souhaitent pas être tributaires d'un centre particulier pour l'émission de l'alerte pour une zone géographique précise et privilégient plutôt la multiplication des sources d'informations. Le système d'alerte ne serait donc pas composé de « centres régionaux d'alerte aux tsunamis », mais de « fournisseurs régionaux d'avis de tsunami » 40 ( * ) avec lesquels chaque Etat passerait un accord pour recevoir les bulletins émis.
Enfin, d'importants progrès restent à accomplir dans la diffusion de l'alerte auprès de la population. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, peu d'Etats ont mis en place un plan de secours au niveau national et local définissant les responsabilités et les missions de tous les intervenants en cas d'alerte aux tsunamis. L'événement du 17 juillet 2006 qui a fait plus de 500 victimes en Indonésie a révélé les défaillances du dispositif d'alerte : le PTWC a bien transmis un bulletin d'information aux autorités indonésiennes, mais celles ci ont été incapables de protéger la population en diffusant rapidement une information précise des zones côtières menacées.
En dépit de ces insuffisances, le bilan des actions menées par le GIC/SATOI est plutôt positif. Il ne faut pas oublier que cette initiative a été créée il y a seulement deux ans et qu'il a fallu près de 40 ans au système d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique pour être véritablement efficace. L'instauration du système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien a profité d'une manne financière sans précédent de la part de nombreux pays donateurs. Elle a pu également s'appuyer dès avril 2005 sur les messages fournis par les centres du Pacifique et sur l'expérience accumulée par le GIC/Pacifique et profité des avancées technologiques récentes (tsunamimètres, modèles de simulation toujours plus performants, etc.). Toutefois, un certain nombre d'années sera nécessaire non seulement pour mettre en place un système d'alerte international et national efficace, mais aussi pour créer des relations de confiance entre les Etats et développer un dispositif régional basé sur la coopération et l'échange de données.
Il convient de remarquer que l'architecture des réseaux de surveillance dans l'océan Indien est beaucoup plus simple que dans les autres bassins comme en témoigne la carte ci-après.
Les différents types de tsunamis
susceptibles
de toucher les pays de l'océan Indien
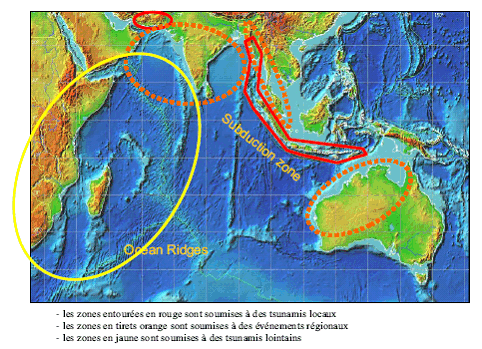
Source : CEA/DASE
En effet, contrairement aux autres régions où les Etats sont exposés au risque à la fois de tsunamis locaux, régionaux et parfois lointains, tous les pays de l'océan Indien à l'exception de la Birmanie et de l'Inde sont exposés à un seul type de tsunami :
- la Birmanie, les îles Andaman et Nicobar, le Timor, l'Iran et le Pakistan peuvent être touchés par des tsunamis locaux. Pour que le dispositif d'alerte soit efficace, ces pays doivent donc être équipés de réseaux denses de surveillance et de centres d'alerte très réactifs, avec des permanences 24h sur 24 7 jours sur 7 ;
- la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, Sri Lanka, l'Inde, l'Australie et Oman sont menacés par des tsunamis régionaux : les délais de réaction en cas d'alerte sont donc plus grands ;
- enfin, les 16 pays situés dans le cercle jaune sont exposés à des télétsunamis : leurs réseaux de surveillance peuvent donc être moins denses et une simple astreinte est suffisante dans les centres d'alerte.
En conséquence, les coûts globaux d'investissement et de fonctionnement sont, proportionnellement aux dimensions de l'océan Indien, 3 à 5 fois plus faibles que dans les autres bassins où les Etats doivent être équipés contre tous les types de tsunami.
En contrepartie, ce relatif cloisonnement des dispositifs d'alerte expliquerait les difficultés rencontrées pour l'intégration des réseaux nationaux dans un dispositif régional d'alerte.
* 39 Il ne s'agit pas de message d'alerte car les données à la disposition de ces deux centres ne sont pas suffisantes pour pouvoir émettre un bulletin d'alerte fiable. Actuellement, ces derniers fondent leur analyse sur les données transmises par 30 stations sismiques, 41 marégraphes et une bouée DART installée au large de la Thaïlande.
* 40 Regional Tsunami Watch Providers. Comme il a été indiqué précédemment la terminologie utilisée témoigne souvent des spécificités régionales. Dans le cas de l'océan Indien, elle vise à respecter les susceptibilités nationales en maintenant un équilibre entre les Etats membres du GIC.







