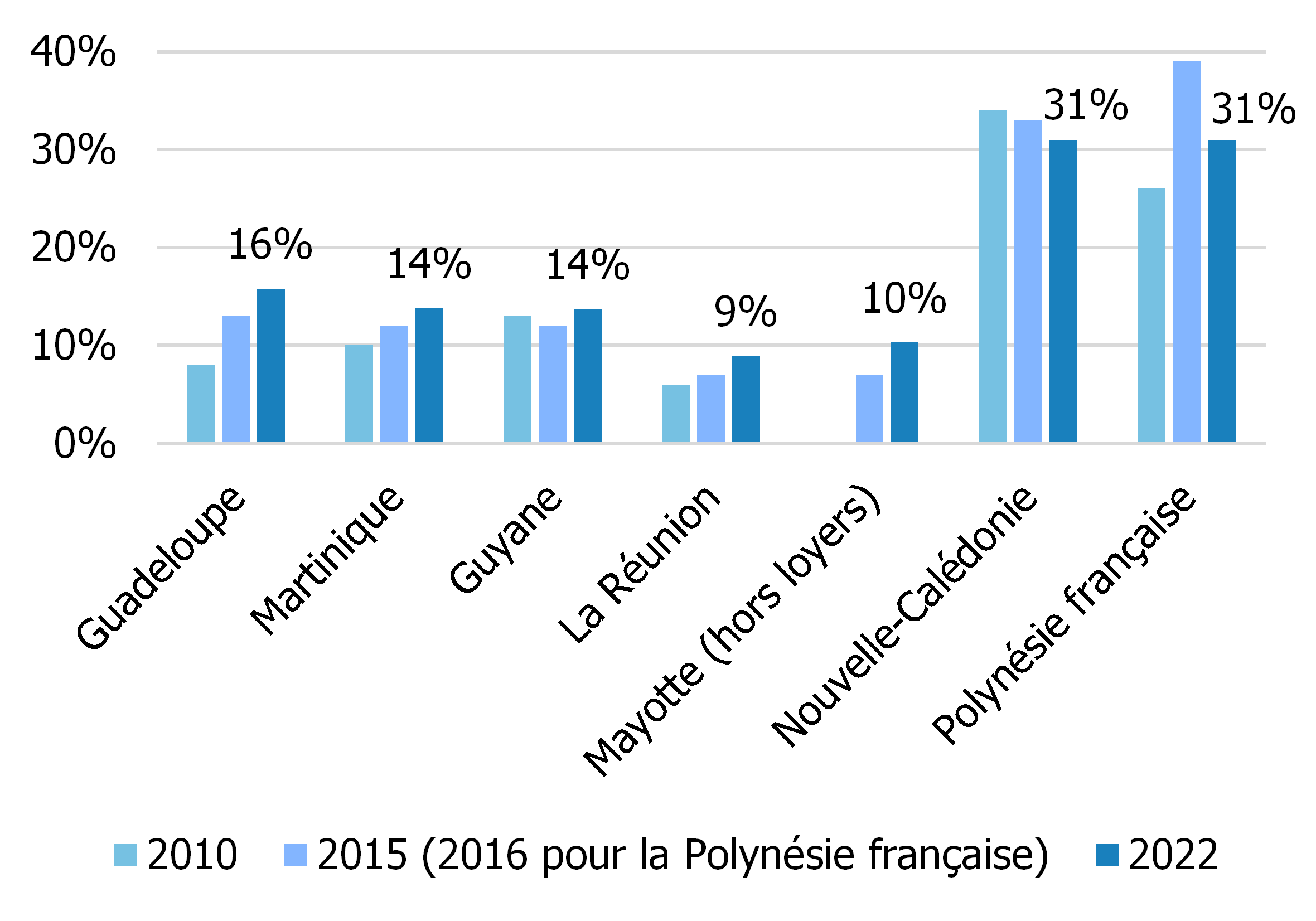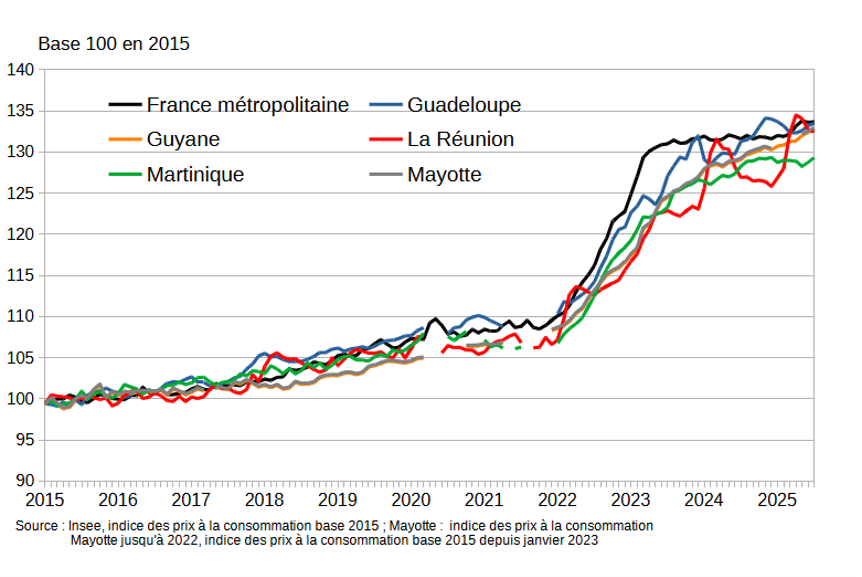EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT
ET
COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT
CHAPITRE IER
Baisser les prix par un renforcement
des dispositifs
de lutte contre la vie chère
Article 1er
Exclusion du prix du transport du calcul du seuil de
revente à perte (SRP)
Cet article vise à exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP) de manière à faire diminuer les prix à la vente des produits importés, l'éloignement géographique étant en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer.
En raison d'un impact réel incertain avec des effets contradictoires sur les prix ainsi que, surtout, du risque de renforcer les positions dominantes des gros distributeurs, de fragiliser le commerce de proximité et de pénaliser la production locale, le présent article n'est pas apparu pertinent. La commission a donc adopté deux amendements identiques de suppression dont l'un à l'initiative des rapporteurs.
La commission a donc supprimé l'article.
I. La situation actuelle - L'éloignement géographique est en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer et les entreprises sont toutes soumises à l'interdiction de vendre sous le seuil de revente à perte (SRP)
A. L'éloignement géographique est en partie à l'origine de la vie chère dans les outre-mer
Selon l'Insee0F0F0F1(*), les prix à la consommation sont plus élevés outre-mer qu'en France métropolitaine, par exemple de l'ordre de 9 % à La Réunion et de 16 % en Guadeloupe. Pour ce qui concerne les produits alimentaires, les écarts de prix vont de 30 % à 42 % par rapport à l'Hexagone. Ils sont plus faibles pour les services, qui restent cependant plus chers, notamment les services de communication. Pour tous les territoires ultramarins, ces écarts de prix augmentent année après année.
Ce différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche ».
Ces frais expriment à la fois le coût du transport maritime, mais aussi d'autres charges comme l'octroi de mer, des taxes diverses, ou encore le coût d'intermédiation lié au recours à différents prestataires pour l'import. Selon l'Autorité de la concurrence1F1F1F2(*), le détail de ces coûts fait en effet apparaître jusqu'à 40 postes comptables, comme le fret, l'empotage, le dépotage, la surcharge carburant, les assurances, la manutention portuaire, l'acconage2F2F2F3(*), l'embarquement, l'octroi de mer, les taxes de douanes, d'autres taxes, les coûts de palettes et d'emballages, les frais de pesage, ou encore le transport local, souvent routier.
Si ces frais d'approche s'élèvent en moyenne à 25 ou 30 % du coût d'achat des marchandises importées, ils peuvent fortement varier selon la marchandise considérée et le territoire concerné. Le prix du transport représenterait - à lui seul - entre 50 et 75 % de ces frais d'approche.
Ces surcoûts sont aggravés par la forte dépendance aux importations du marché de la distribution dans les outre-mer, notamment aux produits exportés depuis l'Hexagone, qui est une autre spécificité des économies ultramarines. Selon l'Institut d'émission d'outre-mer (Ieom) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom), le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie en effet entre 1 % et 10 % outre-mer contre environ 80 % dans l'Hexagone.
Dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs, la direction générale des outre-mer (DGOM) affirme que « les surcoûts liés aux frais d'approche, lesquels incluent notamment les coûts du transport, de stockage, de logistique, de conditionnement et de distribution des marchandises, pourraient expliquer, à eux seuls, environ deux tiers des écarts de prix avec l'Hexagone ».
B. Le principe d'interdiction de la revente à perte et ses aménagements
L'article L. 442-5 du code de commerce interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Les modalités de calcul du seuil de revente à perte (SRP), prévues par cet article, s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, sans distinction pour les territoires ultramarins.
Le calcul du SRP, outre le prix de vente, repose donc sur le prix d'achat effectif du produit. Ce dernier se définit aux termes de l'article précité comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ».
Actuellement, outre-mer, seule la composante transport des frais d'approche est donc prise en compte dans la détermination du SRP. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport. Le niveau élevé de ce dernier - plus encore pour les produits à faible valeur ajoutée que pour les produits plus onéreux3F3F3F4(*) - augmente significativement les SRP, qui sont donc souvent distincts de ceux constatés en métropole.
Cette spécificité ultramarine s'ajoute à l'absence de majoration de 10 % du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte. En effet, pour mémoire, ce cadre dérogatoire en matière de SRP a été mis en place dans le cadre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite Égalim 1, dans le but de procéder en métropole à l'expérimentation de la majoration de 10 % du SRP pour les seuls produits alimentaires (expérimentation prolongée par plusieurs lois depuis et donc en vigueur jusqu'en avril 2028 aux termes de la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire). Dans le cadre de la loi Égalim 1, il avait été à juste titre estimé qu'en raison du contexte de vie chère outre-mer, il n'était pas opportun d'y appliquer cette mesure de majoration, par nature inflationniste, surtout pour les produits revendus proches du SRP.
II. Le dispositif envisagé - Exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP) afin de le réduire et de faire baisser les prix
A. Lutter contre la vie chère en excluant le transport du SRP
La mesure entend contribuer à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer par la baisse du SRP applicable, en en déduisant les frais de transport. Elle serait applicable dans les collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. À cette fin, l'article L. 442-5 du code de commerce serait modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de son I.
Cette nouvelle règle de calcul permettrait aux distributeurs ultramarins de faire diminuer les prix à la vente en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, dont les coûts de transport représentent une part plus élevée proportionnellement à leur valeur. Les distributeurs seraient libres d'absorber les coûts de transports déduits ou de les répercuter sur d'autres produits, notamment des produits à forte valeur ajoutée.
B. Un impact réel précis difficile à mesurer selon le Gouvernement
Il n'est pas sûr que la mesure se traduise par une baisse effective des prix des denrées alimentaires outre-mer, surtout pour les produits qualitatifs, qui pourraient même augmenter. Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, qui le reconnaît donc elle-même, l'impact réel de la mesure reste « difficile à évaluer précisément ».
En effet, par définition, toute baisse du SRP a « pour seule conséquence certaine de permettre aux distributeurs ultramarins de réduire leurs prix de revente au détail tout en restant au-dessus du seuil de revente à perte ». Il convient de remarquer que dès lors que le prix du transport restera pris en charge par les distributeurs, ils devront nécessairement le répercuter sur leurs prix de revente au détail. Le Gouvernement fait donc valoir dans cette étude d'impact qu'en complément de la mesure prévue par l'article 5 du présent projet de loi sur la réduction des frais d'approche sur les produits de première nécessité, « il peut être raisonnablement envisagé que les distributeurs réaliseront des péréquations, en n'intégrant pas le prix du transport dans leurs prix de détail pour les produits de première nécessité, en particulier ceux pour lesquels le prix du transport est une composante importante du prix de détail ».
En revanche, ils devraient logiquement répercuter les frais de transport sur les prix de revente au détail de produits plus onéreux, pour lesquels la demande des consommateurs est moins sensible aux variations de prix et qui, en outre, seront comparativement plus faibles que sur les produits à moindre valeur ajoutée.
III. La position de la commission - Une mesure aux conséquences pour le moins contrastées qui plaident donc pour son abandon
A. Des effets contradictoires sur les prix
Si l'objectif du présent article est d'améliorer le pouvoir d'achat des Ultramarins, force est de constater que la mesure envisagée pourra avoir des effets contradictoires sur les prix à la vente en rayon : si les prix des produits les moins onéreux, et notamment des produits de première nécessité, dont les coûts de transport représentent une part plus élevée, pourraient bel et bien baisser, il n'en est pas de même pour les autres produits, que les distributeurs pourraient même envisager d'augmenter.
B. Le risque de renforcer les positions dominantes des gros distributeurs et de pénaliser la production locale
Mais la critique principale ds rapporteurs porte sur un second aspect, à savoir le risque de renforcement des positions dominantes des gros distributeurs : seuls les acteurs les plus importants seront en effet en mesure de tirer profit de la mesure en assurant une péréquation globale entre tous les produits qu'ils mettent en vente. Les petits commerces, déjà peu nombreux et fragilisés outre-mer, auront plus de mal à répercuter la mesure sur leurs prix de vente au détail. Plusieurs interlocuteurs, parmi lesquels la CPME, alertent sur la menace que le dispositif laisse planer sur le commerce de proximité, dont les difficultés outre-mer seront à l'évidence aggravées.
Au sein même des importateurs, de nouvelles inégalités, voire des distorsions de concurrence, pourraient apparaître, dans la mesure où tous ces acteurs économiques ne seront pas en mesure de répartir le coût des moindre recettes résultant de la baisse de certains prix en augmentant les prix d'autres produits. Les importateurs mono-produits auront, tout particulièrement, à faire face à cette problématique.
De manière corollaire à ces phénomènes, cette mesure pourrait avoir pour effet d'accroître la part des produits importés et de pénaliser la production locale, d'ores et déjà très insuffisante, puisque, comme il a été vu, le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie en effet entre 1 % et 10 % dans les territoires ultramarins contre environ 80 % dans l'Hexagone.
Le présent article, au nom de la lutte contre la vie chère, pourrait donc avoir pour effet paradoxal de donner plus de légitimité et donc de poids aux accusations portées contre les monopoles ou oligopoles de la distribution outre-mer. Les territoires ultramarins n'ont aucunement besoin d'accroître le sentiment de défiance envers ces acteurs économiques, déjà largement contestés, comme en témoignent les nombreux mouvements sociaux connus dans les dernières décennies au sein des différentes collectivités.
Lors de leur audition par les rapporteurs, les grands groupes de la distribution outre-mer ont eux-mêmes reconnu que l'exclusion du prix du transport du calcul du SRP pouvait être considéré comme « un cadeau » qui leur est fait et qu'il était possible qu'on le leur reproche. Ce cadeau empoisonné n'a pas donné l'impression de les satisfaire, ce que les rapporteurs comprennent aisément.
Pour l'ensemble des raisons évoquées ici, il est donc préférable de supprimer le présent article et de poursuivre la réflexion sur la réforme de l'aide au fret.
La commission a supprimé l'article.
Article 2
Réforme du bouclier qualité-prix (BQP)
Cet article vise à étendre le bouclier qualité-prix (BQP), dispositif de modération des prix de certains produits de consommation courante dans les collectivités ultramarines résultant d'un accord entre le représentant de l'État dans chacune d'elles et les organisations professionnelles du commerce de détail, en associant davantage d'acteurs institutionnels, économiques et associatifs à sa négociation, en ouvrant la possibilité d'y inclure des services et en instaurant un régime de sanctions administratives en cas de non-respect de ses stipulations.
Il explicite également un des objectifs du BQP, celui de réduire les écarts de prix avec la France hexagonale, impose la prise en compte d'impératifs de santé publique dans sa définition et permet sa modulation en faveur des magasins de petite taille.
La commission a adopté trois amendements, dont deux identiques pour rendre obligatoire la négociation annuelle d'un BQP portant sur les services, et un pour imposer que l'élaboration du BQP prenne en compte l'impératif de promotion de la production locale.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Le bouclier qualité-prix, principal outil de l'État pour lutter contre le phénomène de la vie chère au quotidien
A. Un mécanisme de négociation annuelle visant à geler le prix de produits de consommation courante
En réponse à l'échec de la réglementation des prix par l'État dans les collectivités ultramarines, autorisée par l'article 1er de la loi dite « Lodéom » du 27 mai 20094F4F4F5(*) mais jamais mise en oeuvre, plusieurs d'entre elles avaient par la suite engagé des initiatives locales pour obtenir, par la négociation, une modération du prix des produits de consommation courante. La loi dite « Lurel » du 20 novembre 20125F5F5F6(*) a institutionnalisé ce mécanisme et l'a généralisé à toutes les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna sous la forme du bouclier qualité-prix (BQP).
Figurant à l'article L. 410-5 du code de commerce, le BQP consiste en un « accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante ». Sur la base d'un avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), il est négocié annuellement par le préfet, dans chacune des collectivités précitées, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs - producteurs, grossistes ou importateurs, les entreprises de fret maritime et les transitaires, c'est-à-dire les intermédiaires chargés du bon acheminement des marchandises importées outre-mer. Son prix doit être affiché dans les commerces qui l'appliquent.
S'agissant d'un dispositif reposant sur la négociation, le code de commerce confie au préfet le soin, en l'absence d'accord dans un délai d'un mois après son engagement, d'arrêter le prix de la liste des produits constituant le BQP sur la base « des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».
Le contrôle du respect de l'obligation d'affichage du prix du BQP est confié aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en vertu des pouvoirs d'enquête et de communication dont ils disposent.
Un décret du 26 décembre 20126F6F6F7(*) est venu préciser les conditions de négociation ainsi que le contenu et les modalités d'application de ces accords de modération tarifaire. Il a été récemment modifié7F7F7F8(*) et prévoit désormais que la négociation doit porter sur six points : la composition et le prix de la liste des produits concernés ; les catégories de commerces participants ; les efforts de modération des prix réalisés par chacun des acteurs économiques ; la lisibilité de l'affichage du prix du BQP ; les conditions de présentation et d'identification des produits en faisant partie ; la part de produits issus de la production locale. Il énonce maintenant un objectif de « modération du différentiel des prix » par rapport à la France hexagonale (article 2).
Il autorise par ailleurs la majoration du prix du BQP, dans la limite de 5 %, pour les petits commerces si l'accord le prévoit (article 3).
Ce décret rappelle également que les acteurs économiques parties à cet accord restent libres de déterminer la marque commerciale des produits qu'ils proposent à la vente au titre du BQP. La liste qui le constitue ne comprend qu'une description générique des caractéristiques des produits concernés, relevant toutefois de plusieurs catégories : marques nationales, marques de distributeur, premiers prix et produits locaux. Il fixe également comme obligation aux distributeurs de transmettre chaque mois aux services de l'État la liste des articles soumis au BQP qu'ils proposent ainsi que leur prix.
Par ailleurs, à la fin de l'année 2022, dans le cadre de la démarche de « l'Oudinot du pouvoir d'achat », le Gouvernement avait, dans un contexte conjoncturel de retour de l'inflation, cherché à obtenir des engagements supplémentaires de la part des acteurs économiques ultramarins dans le cadre de « BQP+ » enrichis de nouveaux produits ou faisant intervenir de nouvelles enseignes, à droit constant et de manière variable selon les territoires.
B. Un outil imparfait et mis en oeuvre inégalement selon les collectivités ultramarines
Treize ans après son adoption, force est de constater que le BQP a atteint ses limites. Ainsi, entre 2010 et 2022, les écarts de prix entre les collectivités ultramarines et la France hexagonale, tels que mesurés par l'Insee dans ses enquêtes de comparaison spatiale, n'ont pas diminué et se sont parfois même accrus.
Évolution de l'écart de prix entre
les outre-mer
et la France hexagonale entre 2010 et 2022
(en %)
Source : Insee, Isee, ISPF, Iedom
S'agissant des produits alimentaires, coeur de cible du BQP, les écarts sont plus importants : 41,8 % en Guadeloupe, 40,2 % en Martinique, 39,4 % en Guyane, 36,7 % à La Réunion ou encore 30,2 % à Mayotte8F8F8F9(*). Leurs prix ont connu une évolution assez similaire à celle constatée en France hexagonale.
Évolution comparée de l'indice des
prix à la consommation
des produits alimentaires depuis
2015
Par rapport à 2019, ils ont progressé de 26 % en France hexagonale contre 23 % en Martinique, 25 % en Guadeloupe, 26 % à La Réunion et 28 % en Guyane et à Mayotte.
Qui plus est, les auditions réalisées par les rapporteurs ont mis en lumière la grande hétérogénéité des BQP, qui ne couvrent pas les mêmes produits selon les territoires et sont mal identifiés par les consommateurs, tandis que certains distributeurs mettraient en avant des produits plus onéreux mais bénéficiant d'offres promotionnelles. De même, le bon déroulement des négociations dépendrait beaucoup de l'impulsion donnée par les autorités préfectorales et de l'implication de la société civile.
Ainsi, en Guyane, la dernière actualisation du BQP remonterait à 2022, alors qu'une périodicité annuelle est exigée par la loi.
À l'inverse, un élargissement du BQP est d'ores et déjà intervenu dans d'autres collectivités. À La Réunion, le BQP traditionnel comprend 175 produits, essentiellement alimentaires, dont 40 % d'origine locale, et une déclinaison dédiée aux produits de bricolage a été adoptée, à l'initiative de l'OPMR. En Martinique, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole du 16 octobre 2024 de lutte contre la vie chère, le nouveau BQP, entré en vigueur le 16 septembre 2025, a été étendu de 134 à 180 produits dans les hypermarchés, intégrant notamment des fournitures scolaires et davantage de produits d'hygiène, et est désormais complété, comme à La Réunion, d'un BQP bricolage.
Toutefois, des demandes d'élargissement du BQP, formulées par plusieurs OPMR, n'ont pas pu être satisfaites à cadre juridique constant. En dehors de quelques initiatives isolées, les services courants, comme l'entretien automobile ou la téléphonie, qui relèvent de la première nécessité dans les territoires ultramarins, n'y sont pas inclus.
De manière plus générale, ainsi que l'a souligné l'Insee auprès des rapporteurs, le champ du BQP est loin de couvrir l'ensemble des dépenses des ménages, même si pour les plus modestes d'entre eux (premier quintile) les dépenses alimentaires représentent une part proportionnellement plus importante que pour la population générale : entre 20 et 23 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, 35 % à Mayotte contre 18 % dans l'Hexagone et environ 16 % pour la moyenne des ménages. La part des dépenses de transports (entre 18 et 20 %) est, par exemple, plus importante dans les outre-mer qu'en France hexagonale (16 %).
II. Le dispositif envisagé - Une consolidation du BQP comme outil territorial de lutte contre la vie chère
Le présent article 2 procède à la refonte du cadre juridique du BQP, inscrit à l'article L. 410-5 du code de commerce, sans toutefois modifier son champ d'application géographique : celui-ci reste concentré sur les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. La Polynésie française et Saint-Barthélemy, régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumises à ces dispositions, mais ont pu mettre en place des mécanismes similaires, portant d'ailleurs le même nom en Nouvelle-Calédonie9F9F9F10(*).
Le mécanisme même du BQP, c'est-à-dire une négociation annuelle, à l'initiative du préfet, pour parvenir à un accord de modération du prix global d'une liste de produits, auparavant de « consommation courante » et désormais de « grande consommation »10F10F10F11(*), est inchangé. Des modifications sont toutefois apportées aux parties à cette négociation, qui incluent désormais directement, outre les organisations professionnelles du commerce de détail alimentaire, les principales entreprises de ce secteur, au même titre que leurs fournisseurs et les entreprises de fret maritime et les transitaires. Toutes les entreprises du commerce de détail alimentaire et leurs fournisseurs qui en feront la demande pourront aussi participer à la négociation.
Pilotée exclusivement par l'État, cette négociation ne faisait pas intervenir les collectivités territoriales concernées par chaque BQP. L'association du président de la collectivité exerçant les compétences de la région11F11F11F12(*) (conseils régionaux de Guadeloupe et La Réunion ; collectivités de Guyane, la Martinique et Mayotte), au premier rang desquelles figure le développement économique, est maintenant prévue, tout comme une plus grande transparence vis-à-vis de la société civile avec la possibilité d'inviter les associations de consommateurs agréées à assister à ces négociations.
Le rôle de l'OPMR évolue également : cantonné jusqu'à présent à un simple avis préalable, il lui revient désormais d'assister le préfet dans la négociation. L'élaboration de la liste des produits composant le BQP doit par ailleurs tenir compte des impératifs de santé publique, et ce afin d'encourager une alimentation saine, dans un contexte où la prévalence des maladies chroniques liées à l'alimentation est plus forte dans les collectivités ultramarines que dans l'Hexagone et les inégalités sociales en matière de nutrition y sont plus marquées.
Il est également proposé d'élever au niveau législatif plusieurs dispositions qui figurent aujourd'hui dans le décret relatif au BQP (cf. supra) : l'objectif de réduction de l'écart de prix des produits qui en font partie avec la France hexagonale et la possibilité de majorer, dans une limite de 5 %, les prix négociés dans les petits commerces.
Plusieurs facultés nouvelles, à la main du préfet et des négociateurs du BQP, sont également ouvertes. En premier lieu, la différenciation des produits et du prix global de celui-ci en fonction de la surface commerciale est inscrite dans la loi, alors qu'elle est déjà pratiquée en Martinique et en Guadeloupe. En second lieu, et de manière plus novatrice, l'article institue la possibilité de négocier un BQP dédié aux services, selon les mêmes modalités que le BQP traditionnel, sans toutefois préciser lesquels ou en restreindre le champ.
Le reste de l'article précise les modalités pratiques de formalisation et d'application du BQP dans les commerces, afin d'améliorer la publicité et la transparence à son sujet, et institue un régime de sanction à destination de ceux qui ne respecteraient pas leurs engagements, qui faisait jusqu'à présent défaut.
L'accord portant sur le BQP est homologué par arrêté préfectoral, tandis que les entreprises ne l'ayant pas signé doivent rendre cette information publique. Elles peuvent y adhérer ultérieurement si elles le souhaitent.
Le non-respect du BQP est sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par les services de la DGCCRF. Le fait pour un opérateur économique de ne pas indiquer publiquement qu'il ne participe pas au BQP est quant à lui passible d'une amende de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Enfin, en cas d'échec de la négociation sur le BQP dans un délai d'un mois après son engagement, le préfet conserve le pouvoir, comme dans la situation actuelle, d'arrêter unilatéralement le BQP - son contenu comme son prix global - qui s'appliquerait alors à l'ensemble du secteur d'activité concerné et non aux seules organisations et entreprises signataires d'un accord.
III. La position de la commission - Étendre le BQP pour lutter plus efficacement contre la vie chère
A. Remédier aux insuffisances actuelles du BQP
Signe des limites de la politique de lutte contre la vie chère menée par les gouvernements successifs ces dernières années, les ministres des outre-mer, de l'économie et des finances, de l'agriculture et du commerce ont été contraints de procéder, par une circulaire du 10 juillet 202512F12F12F13(*), à la remobilisation des services de l'État, appelant à l'élaboration d'un « plan de bataille complet et structurel qui s'attaque, méthodiquement, à tous les facteurs expliquant la cherté de la vie ». Surtout, ils ont ordonné aux préfets de faire de la lutte contre la vie chère « une priorité absolue de [leur] action », sous-entendant ainsi qu'elle ne l'était pas jusqu'à présent, comme l'illustre l'absence de BQP en Guyane depuis 2022.
La commission estime que le présent projet de loi ne peut être considéré comme la traduction de ce « plan de bataille » annoncé, dans la mesure où il ne s'attaque pas aux causes structurelles du phénomène de la vie chère. Néanmoins, il importe de moderniser et étendre les outils existants, malgré leurs insuffisances.
C'est la raison pour laquelle elle est favorable à la réforme du BQP présentée à cet article, dans la mesure où celui-ci a bien, selon la DGCCRF, permis depuis 2012 de faire baisser les prix des produits de consommation courante ou, en période inflationniste, de les stabiliser.
Certaines des limites dont il souffre relèvent du législateur et sont traitées par cet article. Il en va ainsi principalement de l'extension du BQP aux services, de l'élargissement de sa négociation à de nouveaux acteurs, de l'association de la région et des associations de consommateurs à celle-ci ou encore de l'instauration de sanctions en cas de non-respect de l'accord.
D'autres toutefois dépendent des comportements des acteurs économiques et administratifs locaux. Ainsi, il a été rapporté à la commission que la mise en oeuvre du BQP serait, dans certains territoires, affectée par la disponibilité et la qualité des produits proposés par les distributeurs, qui restent libres de choisir les marques commerciales offertes dans leurs magasins.
De plus, un étiquetage parfois insuffisant, voire défaillant, ne permettrait pas aux consommateurs de bénéficier de ce dispositif à sa pleine mesure. Quant à la conduite des négociations conduisant à l'accord de modération des prix constitutif du BQP, elle varie selon les préfectures concernées, certaines ayant développé une culture de travail avec leur OPMR, qui ont pu contribuer à l'élargissement des produits offerts (cas du BQP bricolage à La Réunion), tandis que d'autres ne semblent pas être particulièrement investies ou considérer qu'une actualisation annuelle du BQP soit impérative (cas de la Guyane). Une sensibilisation accrue des consommateurs est nécessaire, tout comme l'application, en cas d'échec éventuel des négociations, des dispositions donnant au préfet le pouvoir de fixer lui-même le BQP.
B. Améliorer encore l'efficacité du BQP
Tout en saluant cette réforme du BQP, la commission a souhaité, à l'initiative de ses rapporteurs, l'approfondir, tout en conservant le caractère volontaire de la participation des entreprises au dispositif en cas d'accord.
Elle a ainsi rendu obligatoire la négociation annuelle d'un BQP « services », au même titre que celui portant sur des produits de grande consommation, en estimant que rien ne justifiait un traitement différencié de ces deux catégories au regard des contraintes de la vie quotidienne que subissent les Ultramarins et des écarts de prix constatés avec l'Hexagone (amendements identiques COM-92 et COM-19 rect. bis).
Enfin, elle a adopté un amendement ( COM-79) imposant que l'établissement de la liste des produits composant le BQP prenne en compte non seulement des impératifs de santé publique, comme l'article 2 le prévoit déjà, mais aussi de promotion des produits locaux. Alors que ce projet de loi ne comporte aucune disposition portant sur le développement des filières économiques locales, pourtant indispensable afin de diminuer la dépendance des collectivités ultramarines aux importations, il apparaît nécessaire d'utiliser le levier du BQP pour soutenir les producteurs locaux, sur le modèle par exemple du « panier péi » mis en place à La Réunion, et éviter qu'il ne vienne aggraver ce déséquilibre.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 3
Encadrement de la réglementation des prix des
produits
de première nécessité et pouvoir de saisine
des préfets
par les présidents des observatoires des prix, des
marges
et des revenus (OPMR) en cas de variations excessives des prix
Cet article vise à encadrer la réglementation des prix des produits de première nécessité et à permettre aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir les préfets en cas de variations excessives des prix, afin, le cas échéant, de réglementer les prix de vente de ces produits.
Si le renforcement du rôle des OPMR - à travers cette nouvelle compétence de leurs présidents - est bienvenu, ces derniers restent toutefois tributaires des moyens qui leur sont alloués et des informations recueillies. Par ailleurs, il est pertinent d'encadrer la réglementation des prix des produits de première nécessité.
La commission a adopté un amendement visant à élargir le pouvoir de saisine aux présidents des exécutifs locaux ainsi qu'un amendement rédactionnel pour améliorer la rigueur juridique de la modification de l'encadrement de la réglementation des prix outre-mer envisagée.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Le Gouvernement peut réglementer les prix de vente de certains produits outre-mer et les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) disposent de moyens limités
A. La possibilité de réglementer outre-mer les prix de vente de certains produits
Aux termes de l'article L. 410-4 du code de commerce, introduit par l'article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Pour mémoire, le même article 15 de la loi du 20 novembre 2012 précitée a créé l'article L. 410-5 du code de commerce, qui permet aux préfets, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) territorialement compétent, de négocier chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix d'une liste de produits de consommation courante13F13F13F14(*).
B. Le rôle des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR)
Dans chaque collectivité d'outre-mer de l'article 73 et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le code de commerce14F14F14F15(*) prévoit, à la suite de l'article 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, qu'un observatoire analyse « le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution »15F15F15F16(*). L'idée de la création de tels observatoires remonte aux années 1970 mais la création du premier observatoire n'a eu lieu qu'en 1996 par le ministre chargé de l'outre-mer dans le cadre du débat sur la sur-rémunération des fonctionnaires.
Les missions et le champ d'intervention des OPMR sont codifiés dans le code de commerce et dans le code de la consommation16F16F16F17(*). Outre l'analyse des prix, des marges et des revenus et la formulation d'avis évoquées, ils rendent un avis public dans le cadre du dispositif « bouclier qualité-prix » (BQP) en amont de l'ouverture des négociations, leurs présidents peuvent saisir l'Autorité de la concurrence (ADLC) et, s'agissant de sociétés ne procédant pas au dépôt de leurs comptes, demander au président du tribunal de commerce de les enjoindre de le faire sous astreinte.
Il existe un OPMR commun à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane, ainsi qu'un OPMR pour chacun des territoires suivants : La Réunion, Mayotte, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut remarquer que cet OPMR des Antilles et de la Guyane devrait prochainement se décliner dans chacun des territoires couverts, ce qui n'était pas encore le cas à l'heure de l'examen du présent rapport en octobre 2025, alors que ce mode d'organisation par territoire était appelé par les décrets n° 2025-720 et n° 2025-721 du 29 juillet 202517F17F17F18(*), codifiés aux articles D. 910-1 B, E et I du code de commerce. Désormais, seules les fonctions de président des observatoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourront être exercées par la même personne.
C. Une organisation spécifique des OPMR reposant sur des moyens très limités, dont dérivent peu d'initiatives
Les OPMR ont une gouvernance ad hoc à la fois politique (députés, sénateurs, représentants des COM), administrative (représentants des services de l'État), économique (syndicats d'employeurs et d'employés, conseil économique et social régional, chambres consulaires) mais aussi technique (personnalités qualifiées) et associative (associations de consommateurs). Ils sont surtout présidés par un magistrat de la chambre régionale des comptes18F18F18F19(*), ce qui est gage d'indépendance, malgré un rattachement fonctionnel des OPMR aux préfectures qui en assurent le secrétariat technique.
Les moyens des OPMR reposent donc en pratique largement sur le choix discrétionnaire des préfectures d'allouer des moyens aux présidents d'OPMR. Dans les faits, les OPMR disposent de très peu de moyens19F19F19F20(*), leurs présidents déplorent régulièrement la faible participation aux réunions ainsi que leur accès lacunaire aux données nécessaires pour exercer leurs missions, notamment concernant les prix et les marges20F20F20F21(*), et plus particulièrement les marges des acteurs de la grande distribution (fortement concentrés), y compris pour ce que l'on appelle les « marges arrière » c'est-à-dire les avantages ou services commerciaux (ristournes, placement en tête de gondole, etc.) que le distributeur vend à son fournisseur et qui sont payés par ce dernier, contribuant à renchérir le coût total du produit sans pour autant mettre le fournisseur à l'abri de tentatives de sur-facturations21F21F21F22(*).
À titre d'illustration, l'OPMR commun à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guyane, dispose d'un budget d'environ 50 000 euros selon son président, qui a précisé n'être pas associé au dialogue de gestion concernant ce budget et ne pas avoir toujours connaissance du montant attribué et de son utilisation. Cette somme résulte de la mise à disposition de moyens par le préfet de chaque territoire pour financer l'activité : « dans les faits, le préfet décide et gère le budget de l'OPMR ». La préfecture de Guadeloupe a ainsi mis un agent à disposition de l'OPMR pour assurer le secrétariat.
Les OPMR disposent d'ores et déjà d'un pouvoir de saisine de l'Autorité de la concurrence, or cette faculté n'a été utilisée qu'à deux reprises, en 2022, par le seul OPMR de La Réunion sur le fondement des articles L. 462-1 (saisine pour avis) et L. 462-5 (saisine contentieuse) du code de commerce.
En vue de contribuer à résoudre le problème d'absence de dépôt des comptes par les sociétés, les présidents des OPMR se sont vu offrir la possibilité de demander au président du tribunal de commerce d'adresser aux dirigeants de société ne procédant pas au dépôt des comptes une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. L'article 2 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a ainsi modifié l'article L. 611-2 du code de commerce afin de prévoir cette faculté. Malheureusement, cette dernière n'est pas utilisée, ce qui illustre une fois de plus la faiblesse des moyens dont disposent les OPMR, que ce soit pour analyser les prix, les revenus, les marges ou les comptes des entreprises.
II. Le dispositif envisagé - Permettre aux présidents des OPMR de saisir les préfets en cas de variations excessives des prix
A. Une nouvelle faculté offerte aux présidents des OPMR
Le présent article vise à permettre aux présidents des OPMR de pouvoir saisir les préfets de leurs territoires en cas de variations excessives des prix, et ce en vue de réglementer les prix de vente des produits vus au I du présent commentaire. En réponse, le préfet concerné fournira dans des conditions qui seront précisées par décret, une analyse de la situation. La notion de « variation excessive de prix » apparait déjà à l'article L. 410-2 du code de commerce et se rapproche d'une notion issue du droit des pratiques anticoncurrentielles : celle des « prix excessifs », pour lesquels le caractère excessif s'apprécie au regard soit des coûts, soit des prix pratiqués pour des produits ou services proches. Ainsi, comme l'a fait valoir la DGOM aux rapporteurs en se fondant sur les travaux de l'Autorité de la concurrence, une pratique de prix manifestement élevée peut être établie s'il existe une disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant (appréciée notamment via les coûts supportés et les capitaux engagés, ce qui revient à examiner les marges et la rentabilité), sans que cela ne soit justifié économiquement22F22F22F23(*).
B. Une précision apportée aux conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer
Le présent article apporte, de plus, une précision quant aux conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer : il s'agirait des seuls cas de « circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs ».
III. La position de la commission - Un dispositif pertinent qui restera à traduire dans les faits
A. Une compétence bienvenue pour les présidents des OPMR, qui restent toutefois tributaire des moyens qui leur sont alloués et des informations recueillies
Si le fait de permettre aux présidents des OPMR de pouvoir saisir les préfets en cas de variations excessives des prix constitue une avancée louable, ces mêmes présidents continueront de faire face à la problématique de leurs moyens très limités.
De manière générale, toute extension des missions des OPMR et de leurs présidents doit être reliée à la question de leurs moyens budgétaires et humains. C'est pourquoi une discussion en loi de finances sur les moyens de ces observatoires doit se tenir alors qu'ils peinent à exercer les missions qui leur sont confiées.
En lien avec les moyens alloués aux OPMR se pose la question des informations recueillies : l'OPMR des Antilles et de la Guyane a précisé dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs qu'il ne dispose pas d'outils de mesure des variations de prix. Ces variations sont en effet constatées par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), qui aujourd'hui ne les communiquent ni au président de l'OPMR ni à l'OPMR. Une transmission de ces informations sera indispensable pour que le présent article puisse avoir des effets réels sur les compétences des présidents des OPMR.
B. Ce nouveau pouvoir de saisine devrait être élargi aux présidents des exécutifs locaux
Dans la continuité de l'article 9 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer du droit des outre-mer23F23F23F24(*) déposé au Sénat le 28 novembre 2024 à l'initiative de votre rapporteur Micheline Jacques et de plusieurs de ses collègues, membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer, il convient d'étendre aux présidents des exécutifs locaux la faculté de saisir le représentant de l'État en cas de variation excessive des prix. Deux amendements identiques COM-29 rect et COM-82, ce dernier des rapporteurs, ont été adoptés à cette fin.
C. L'encadrement utile de la réglementation des prix outre-mer
Il peut être observé qu'en vue de pallier les handicaps structurels des économies ultramarines, le Gouvernement peut déroger au principe de libre fixation des prix dans des circonstances particulières, limitativement énumérées : les prix des marchés de gros24F24F24F25(*) , les prix des carburants et du gaz25F25F25F26(*), enfin, les prix des produits de dégagement26F26F26F27(*), analysés au commentaire de l'article 13 du présent rapport.
Le fait de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir la réglementation des prix outre-mer apparait pertinent aux yeux des rapporteurs. Toutefois le fait de mentionner les cas « de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs » n'est pas juridiquement optimal, c'est pourquoi il vaudrait mieux écrire de « circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs du fait de la situation économique locale ». Un amendement rédactionnel COM-81 a été adopté en ce sens.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
CHAPITRE II
Réduction des coûts d'acheminement et
logistiques
Article 4
Développer le e-commerce, soutenir
les territoires :
l'expérimentation du E-Hub ultramarin
Cet article vise à créer sous forme expérimentale un E-Hub logistique en Martinique pour y développer le commerce électronique, dans le but de faire baisser les prix pour les consommateurs et de favoriser les exportations des producteurs martiniquais.
La commission a adopté cet article modifié par trois amendements de ses rapporteurs visant à :
- préciser que les entreprises locales bénéficient en priorité du E-Hub, tant pour leurs activités à l'importation que pour celles à l'exportation ;
- prévoir que les entreprises qui utilisent le E-Hub doivent respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale définis par décret ;
- prévoir que deux ans après la promulgation de la loi, les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent demander à l'État la mise en place d'un E-Hub à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession.
I. La situation actuelle - Le commerce électronique est peu développé dans les territoires ultramarins, et singulièrement en Martinique
A. Le e-commerce est nettement moins développé dans les territoires ultramarins qu'en France métropolitaine
En 2024, le commerce en ligne (e-commerce) en France métropolitaine représentait environ 11 % du commerce de détail, avec un chiffre d'affaires de 175,3 milliards d'euros, en hausse de 9,6 % par rapport à 2023, et 2,6 milliards de transactions. 31 % des équipements électroniques grand public, 25 % des produits électroménagers et 23 % de l'habillement sont ainsi achetés en ligne. Si le premier site de e-commerce en France reste le site américain Amazon, plusieurs entreprises françaises telles que Le Bon Coin, E. Leclerc ou Carrefour disposent de positions très solides, tandis que les sites chinois Temu et Shein ont connu une croissance fulgurante au cours des deux dernières années.
Si la part du e-commerce tend aussi à augmenter dans les territoires ultramarins, celle-ci représente aujourd'hui moins de 5 % des flux de marchandises alors que 76,2 % de la population y utilise Internet quotidiennement.
Ce retard paraît avant tout s'expliquer par les spécificités des marchés locaux et par l'importance des coûts logistiques liés aux caractéristiques géographiques de ces territoires.
B. Un phénomène de carence de l'initiative privée en matière de e-commerce particulièrement marqué en Martinique
Le développement du e-commerce paraît singulièrement entravé en Martinique par des difficultés structurelles qui le rendent peu attractif pour les investisseurs, engendrant une forme de carence de l'initiative privée.
En premier lieu, le fait que le marché local soit relativement restreint et fragmenté limite les économies d'échelle indispensables pour rentabiliser les infrastructures coûteuses nécessaires au développement du e-commerce, qu'il s'agisse des plateformes, d'entrepôts ou des systèmes d'information.
En outre, la Martinique pâtit des coûts logistiques élevés liés à l'insularité et à la desserte du dernier kilomètre, des contraintes douanières et administratives qui alourdissent les procédures d'importation, ainsi que d'une visibilité insuffisante sur la demande locale en l'absence de données fiables (fréquence d'achat, panier moyen, saisonnalité).
Enfin, des facteurs tels qu'une confiance insuffisante dans la livraison à domicile et la concurrence des circuits informels contribuent à accroître le risque perçu par les opérateurs privés et à retarder leur engagement.
L'ensemble de ces freins au développement du e-commerce privent ainsi les Martiniquais de la possibilité d'avoir autant recours que les habitants de métropole à ce type d'achats et diminuent l'intensité concurrentielle en Martinique, ce qui est de nature à peser sur les prix et à contribuer dans une certaine mesure au phénomène de la vie chère.
II. Le dispositif envisagé - La création à titre expérimental pour cinq ans d'un E-Hub en Martinique
Le premier alinéa de l'article 4 du projet de loi dispose qu'il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat.
Son second alinéa prévoit qu'au terme de l'expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.
Lors de son audition par les rapporteurs, la direction générale des entreprises (DGE), qui porte ce projet, a beaucoup insisté sur le fait que l'opérateur qui sera chargé d'assurer ce service public de gestion logistique ne jouera pas le rôle d'une centrale d'achat et n'aura pas vocation à acquérir lui-même des produits.
Son rôle sera d'assurer la gestion complète des opérations logistiques, c'est-à-dire de proposer aux entreprises qui procéderont à l'achat ou à l'expédition de produits et qui auront recours à ses services :
- la gestion du stockage sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de stocks d'urgence, de stocks tampon, de stocks de régulation ou de stocks de long terme ;
- la préparation des commandes ;
- la gestion des retours ;
- la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels ;
- l'expédition vers l'Hexagone ou vers d'autres territoires.
Cette offre de service a pour objectif de permettre aux entreprises martiniquaises, et en particulier les TPE et les PME, de commander ou d'expédier des volumes importants de produits pour lesquels aucune gestion logistique n'était jusqu'ici disponible, ce qui permettrait de créer de nouveaux flux commerciaux.
Le choix d'avoir recours à une expérimentation vise à pouvoir mettre fin à ce service public de gestion logistique si celui-ci devait ne pas atteindre les objectifs qui lui sont assignés ou rencontrer des difficultés financières obérant sa viabilité. Si celle-ci est un succès, elle pourrait a contrario être pérennisée voire étendue à d'autres territoires ultramarins.
La durée de cinq ans est justifiée par la nécessité - compréhensible - d'amortir les investissements en logistique et en systèmes d'information nécessaires à la mise en place de ce E-Hub. Cette durée paraît également nécessaire pour produire des enseignements exploitables et permettre une évolution durable des comportements d'achats des entreprises et des consommateurs martiniquais.
Selon la DGE, le choix de la Martinique pour l'implantation du projet E-Hub repose sur plusieurs facteurs spécifiques. Tout d'abord, la Martinique s'est montrée volontaire et impliquée, avec en particulier un avis favorable de la collectivité territoriale de Martinique (CTM), ce qui a permis de recueillir des informations précises et d'engager un dialogue constructif avec les acteurs locaux du commerce en ligne.
Le choix de la Martinique a également été guidé par plusieurs critères :
- un bassin démographique favorable, permettant de tester l'initiative sur un marché représentatif et suffisamment significatif ;
- une appétence et un dynamisme des acteurs locaux, qui montrent une forte volonté de développer le commerce en ligne et l'innovation logistique.
- la lutte contre la double insularité du territoire. En effet, à la fois insulaire et archipélagique, la Martinique est caractérisée par une double insularité, ce qui constitue une exception au sein des départements français. Le E-Hub pourrait contribuer à y renforcer la cohésion économique interne, à fluidifier les circuits logistiques inter-îles et à améliorer l'accès des petites entreprises locales au commerce en ligne.
La DGE a reconnu que d'autres territoires ultramarins, et en particulier la Guadeloupe avaient fait part de leur intérêt pour ce type d'expérimentation, mais à ce stade, le projet reste une initiative pilote concentrée sur la Martinique. L'objectif est de tirer des enseignements exploitables avant d'envisager une extension à d'autres territoires.
Enfin, la DGE a précisé lors de son audition que le contrat qui serait conclu avec l'opérateur chargé du E-Hub serait un contrat de concession de service public, c'est-à-dire un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public (en l'occurrence l'État) confie la gestion d'un service public à un opérateur économique, ici privé.
Ce dispositif aura par conséquent pour effet de transférer l'ensemble des charges, coûts et risques liés à l'exploitation du service public au concessionnaire. Ainsi, la rémunération du concessionnaire dépendra des résultats de l'exploitation du service.
III. La position de la commission - Une expérimentation qui mérite d'être lancée, en précisant que les entreprises locales seront les utilisatrices prioritaires du E-Hub et que l'ensemble des entreprises utilisatrices devront respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale
A. Les bénéfices espérés du E-Hub dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Martinique
Interrogée sur ce point, la direction générale des entreprises (DGE) a indiqué aux rapporteurs que les grandes familles de produits qui pourraient faire l'objet d'une gestion logistique par le E-Hub n'ont pas encore été formellement classifiées.
Mais l'objectif est bien d'améliorer la disponibilité et la rapidité de livraison des produits les plus demandés par les Martiniquais sur les plateformes de commerce en ligne, en tenant compte des besoins et des priorités des entreprises et des consommateurs locaux. Il s'agirait ainsi des pièces détachées automobiles ou des produits électroménagers et électroniques.
Du point de vue économique, le E-Hub s'adresse en priorité aux commerçants de proximité qui souhaiteraient bénéficier d'un nouveau canal de distribution à des prix plus attractifs. Il leur permettra notamment de réduire leurs coûts logistiques en réalisant des achats groupés et de mutualiser l'espace de stockage afin de faire baisser les prix liés à l'importation (donc le prix final pour le consommateur).
Ce faisant, l'amélioration de l'offre en e-commerce devrait bénéficier à moyen terme à la demande locale (hausse de la consommation) et potentiellement renforcer l'activité du port en augmentant les volumes de fret maritime vers le E-Hub.
L'émergence d'une nouvelle alternative d'approvisionnement devrait également permettre, selon ses promoteurs, de renforcer la concurrence et de lutter contre des situations oligopolistiques susceptibles de bénéficier à de grands groupes de la distribution qui tendent à appliquer des tarifs élevés aux commerçants locaux devant s'approvisionner chez eux.
La mise en place de ce E-Hub devrait en outre représenter un atout pour les entreprises locales (transporteurs, logisticiens, start-ups numériques, e-commerçants...) qui devraient grâce à lui bénéficier de nouveaux débouchés facilitant leurs activités d'exportation de leurs marchandises à l'extérieur de la Martinique et d'une modernisation des procédés contribuant à la croissance de leurs chiffres d'affaires.
Enfin, la réhabilitation d'une friche contribuera à l'attractivité du territoire martiniquais et la montée en gamme de ses infrastructures logistiques.
|
Effets pour les acteurs locaux |
Effets pour les consommateurs |
Effets pour les territoires |
|
Augmentation du chiffre d'affaires des e-commerçants |
Baisse des prix finaux |
Création d'emplois locaux |
|
Réduction des coûts logistiques et amélioration de la chaîne opérationnelle |
Amélioration de la qualité de service et de l'exercice des certains droits (service après-vente, droit de rétractation) |
Attractivité territoriale |
|
Accès facilité à une logistique moderne |
Accès à une offre diversifiée |
Digitalisation des acteurs locaux |
Afin de conforter cette orientation du projet, la commission a adopté un amendement COM-87 des rapporteurs qui précise que les entreprises établies en Martinique bénéficient en priorité du E-Hub, tant pour leurs activités à l'importation que pour celles à l'exportation.
Interrogée sur le risque que les acteurs chinois ou américains du e-commerce ne soient les premiers bénéficiaires de la mise en place de ce E-Hub, la DGE a indiqué aux rapporteurs qu'elle avait bien identifié ce danger potentiel, mais qu'il n'était pas possible de limiter l'accès au E-Hub sur des critères d'origines des entreprises.
Toutefois, elle leur a garanti que l'utilisation du dispositif serait réglementée par un cahier des charges prévoyant des clauses, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui devraient décourager des acteurs moins disant d'un point de vue social ou environnemental de recourir à ce dispositif.
Désireux de s'assurer qu'il en sera bien ainsi, la commission a adopté un amendement COM-88 des rapporteurs qui prévoit que les entreprises qui utilisent le E-Hub doivent respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale définis par décret.
Enfin la commission a adopté un amendement COM-90 qui propose que les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna puissent demander à leur tour à l'État la mise en place d'un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession, deux ans après la promulgation de la présente loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.
Comme indiqué supra, la création d'un E-Hub logistique est susceptible d'intéresser d'autres collectivités territoriales ultramarines dont les caractéristiques économiques sont voisines de celles de la Martinique. La Guadeloupe, en particulier, a déjà fait part de son intérêt pour le dispositif.
Si le fait de mettre en place dans un premier temps une expérimentation dans une seule collectivité territoriale paraît raisonnable, il convient de prévoir dès à présent que d'autres collectivités pourront également bénéficier d'un E-Hub si elles en font la demande à l'État.
Ce délai de deux ans apparaît comme le délai minimal permettant d'avoir un premier retour d'expérience sur le fonctionnement du E-Hub martiniquais.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 5
Péréquation des frais d'approche
Cet article habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, un mécanisme de péréquation des frais d'approche visant à réduire ces derniers pour les produits de première nécessité.
Au vu de l'imprécision du mécanisme envisagé et des nombreuses questions juridiques que celui-ci soulève, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article, à charge pour le Gouvernement de présenter les contours envisagés de cette péréquation en séance publique.
La commission a supprimé cet article.
I. La situation actuelle - Les frais d'approche sont un des facteurs déterminants et bien identifiés du phénomène de la vie chère dans les outre-mer
L'insularité et l'éloignement des collectivités ultramarines, auxquels s'ajoutent une forte dépendance aux importations depuis l'Hexagone, qui fait obstacle à leur intégration à leur environnement économique régional, et une taille limitée des marchés domestiques contribuent de manière décisive aux écarts de prix constatés entre les outre-mer et l'Hexagone et qui sont constitutifs du phénomène de la vie chère. Ces écarts s'élevaient en 2022, selon l'Insee et pour les seuls produits alimentaires, à 41,8 % pour la Guadeloupe, 40,2 % pour la Martinique, 39,4 % pour la Guyane, 36,7 % pour La Réunion et 30,2 % pour Mayotte.
Une cause majeure de ces écarts est la chaîne de valeur qui se forme tout au long du processus d'importation des produits de consommation, qui peut comprendre jusqu'à 15 étapes et constitue les frais d'approche, que les distributeurs répercutent sur les consommateurs finaux. Ces surcoûts incluent notamment les coûts du transport, de stockage, de logistique, et de conditionnement et de distribution des marchandises.
En 2019, dans son avis concernant le fonctionnement de la concurrence en outre-mer27F27F27F28(*), l'Autorité de la concurrence estimait que ces frais d'approche, représentant jusqu'à 40 postes comptables pour certaines entreprises et en incluant l'octroi de mer, représentaient 16 % des coûts totaux des distributeurs et grossistes ultramarins. Qui plus est, elle soulignait que l'impact de ces frais était bien plus important sur le prix des produits à faible valeur ajoutée que sur celui des produits à plus forte valeur ajoutée, et ce à volume comparable, car le coût du transport maritime dépend du volume et non de la valeur des biens transportés.
Plus récemment, une étude de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique sur la formation des prix en Martinique28F28F28F29(*) a quant à elle estimé les frais d'approche, hors octroi de mer, à 7 % du prix de vente des produits de consommation courante. En y ajoutant la marge commerciale des intermédiaires et prestataires concernés ainsi que les frais d'approche portant sur les consommations intermédiaires des opérateurs économiques martiniquais eux-mêmes, elle conclut que les frais d'approche représentent en Martinique 15,7 % du prix de vente au consommateur, soit les deux tiers de l'écart de prix existant à la date de l'étude entre ce territoire et l'Hexagone pour les produits de consommation courante (23,5 %).
Cette étude émet également l'hypothèse qu'une péréquation des frais d'approche entre produits à faible et forte valeur ajoutée permettrait de réduire de 7 % le prix des produits de première nécessité.
Le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère conclu en Martinique le 16 octobre 2024 s'inspire de cette idée en indiquant, à son point 12, que l'État « contribuera à la mise en place d'un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d'approche [...] pour les 69 familles de produits citées au point 10 », c'est-à-dire les produits de grande consommation que la collectivité territoriale de Martinique a exemptés d'octroi de mer et sur lesquels l'État a appliqué une TVA à taux nul. Ce protocole prévoit dans ce cadre la mise à contribution des compagnies maritimes, en premier lieu la CMA-CGM, et marque l'engagement de l'État à accompagner ce mécanisme et à en identifier des « sources de financement » supplémentaires, le cas échéant par une participation financière directe.
II. Le dispositif envisagé - La création d'un mécanisme complexe et aux contours encore incertains pour faire diminuer les frais d'approche sur les produits de première nécessité
Dans ce contexte, le présent article 5 habilite le Gouvernement à instituer par ordonnance, conformément à l'article 38 de la Constitution, un mécanisme de « péréquation des frais d'approche ».
Cette habilitation définit le but poursuivi par ce dispositif et son champ d'application géographique : il s'agit de réduire les frais d'approche pesant sur les produits de première nécessité dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution - Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte - ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Son financement par un « prélèvement spécifique », dont ni le taux, ni l'assiette, ni les redevables ne sont précisés, est également mentionné.
Elle apporte également une définition des frais d'approche qui seraient pris en compte. Ils seraient constitués de « l'ensemble des frais de logistique et d'acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs » établis dans les collectivités ultramarines, excluant ainsi de son champ l'octroi de mer et toute autre taxe, contrairement à la définition des frais d'approche retenue par l'Autorité de la concurrence dans son avis de 2019.
Cet article fixe enfin la durée de l'habilitation conférée au Gouvernement pour adopter l'ordonnance instituant ce mécanisme de péréquation des frais d'approche à un an à compter de la publication de la loi. Un projet de loi de ratification devra quant à lui être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de cette date.
III. La position de la commission - Un dispositif inabouti qui mérite d'être précisé par le Gouvernement au moment de l'examen du projet de loi en séance publique
Le dispositif proposé au présent article, soulève, pour la commission, de profondes interrogations, sur le fond comme sur la forme. Si l'objectif poursuivi est évidemment louable, les frais d'approche constituant l'un des principaux facteurs de la vie chère en outre-mer, le flou qui persiste sur les modalités concrètes d'application du dispositif à la date d'examen du projet de loi appelle de sérieuses réserves.
Traduisant l'un des engagements pris dans le cadre du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère conclu le 16 octobre 2024 en Martinique, la péréquation des frais d'approche au profit des produits de première nécessité, qui verraient leur prix baisser, a vocation à être neutre économiquement : elle serait compensée par une hausse tarifaire sur les produits à plus forte valeur ajoutée.
La mise en oeuvre de ce principe semble toutefois se heurter à des obstacles juridiques importants. L'étude d'impact annexée au projet de loi souligne que sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne n'est pas garantie, au regard notamment de l'interdiction des aides d'État29F29F29F30(*), des droits de douane à l'importation entre États membres30F30F30F31(*) et des restrictions quantitatives à l'importation31F31F31F32(*) par celui-ci.
Pour parvenir à surmonter ces obstacles, le Gouvernement a confié au Conseil général de l'économie une mission dont l'objectif est de déterminer le mécanisme le mieux à même de satisfaire à ces exigences conventionnelles, tout en atteignant le but recherché. La commission regrette que ses conclusions ne soient pas connues à la date d'examen du projet de loi.
Le Conseil d'État avait lui-même souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur « les difficultés pratiques et juridiques que la mise en oeuvre d'un tel dispositif [de péréquation des frais d'approche] occasionnera nécessairement ». La création d'un prélèvement spécifique, autorisée par l'habilitation et envisagée par le Gouvernement, reste particulièrement vague, sans que les personnes qui y seraient assujetties ou son montant ne soient évoqués. De même, la commission estime qu'il conviendrait d'obtenir davantage de précisions sur l'étendue de la solidarité entre catégories de produits, qui sous-tend la péréquation, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
De manière plus générale, ainsi que l'a mis en avant auprès des rapporteurs M. Ivan Odonnat, président de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom) et directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer (Ieom), le présent article n'apporte pas une réponse structurelle aux vulnérabilités des économies ultramarines mais entretient leur dépendance aux importations, ne favorisant pas l'émergence de producteurs locaux.
Sur la forme enfin, la commission renouvelle sa réserve de principe vis-à-vis des habilitations à légiférer par ordonnance, qui constituent un dessaisissement par le Parlement de son pouvoir législatif. Si elles se justifient parfaitement dans certains domaines, comme l'amélioration de l'accessibilité du droit et la codification, elles ne sauraient constituer un moyen pour le Gouvernement de gagner du temps et le dispenser de soumettre à la représentation nationale un dispositif juridique complexe faute d'avoir réussi à l'élaborer.
Au vu de ces considérations, la commission a adopté un amendement ( COM-84) de suppression de cet article. Il appartiendra au Gouvernement d'apporter des précisions sur le mécanisme de péréquation des frais d'approche d'ici à l'examen du projet de loi en séance publique et de le soumettre par amendement au vote du Sénat.
La commission a supprimé cet article.
TITRE II
RENFORCER LA TRANSPARENCE
SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX
CONSENTIS
AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS
Article 6
Obligation
pour les distributeurs de transmission de données économiques aux
services de la concurrence, de la consommation
et de la répression
des fraudes
Cet article vise à obliger les acteurs de la grande distribution présents dans les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 m², à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.
Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les prix des produits vendus outre-mer sont à la fois élevés et opaques, et que la DGCCRF ne dispose pas de telles informations, n'ayant le pouvoir d'exiger la communication d'informations économiques et comptables uniquement dans le cadre de la recherche et de la constatation d'un manquement ou d'une infraction. Elle conduira à une plus grande efficacité des politiques de réglementation des prix en facilitant la connaissance des variations et des écarts de prix pour les produits de grande consommation. Elle facilitera également un paramétrage adapté des prix réglementés si une telle mesure devait être mise en place. En outre, elle ne représentera pas une nouvelle charge de travail pour les entreprises puisque des informations similaires sont d'ores et déjà transmises à l'Insee.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Des prix élevés et opaques alors que les données économiques sont transmises à l'Insee et protégées par le secret statistique
A. Des prix élevés et opaques outre-mer
Dans les outre-mer, la vie chère se caractérise par des prix élevés dans la vente au détail, en particulier dans l'alimentaire, mais aussi par un manque de transparence dans le mode de fixation de ces prix. De même, les marges des différents opérateurs économiques restent opaques. En face de cette opacité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tout comme l'Autorité de la concurrence, mobilisent des pouvoirs d'enquête afin d'identifier d'éventuelles situations de rente ou de marges excessives au niveau des entreprises. Elles ont en revanche des difficultés, en dépit de leurs pouvoirs, à suivre les évolutions de prix de détail des produits de grande consommation.
B. Un droit de communication de la DGCCRF qui ne peut s'exercer que dans la perspective de la recherche d'un manquement ou d'une infraction
En effet, dans le cadre de leur habilitation à constater et relever des infractions pénales et des manquements administratifs, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'ils soient affectés dans les collectivités ultramarines au sein des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) en Guyane. Ces agents peuvent ainsi exiger des entreprises contrôlées, en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés par l'article L. 450-3 du code de commerce, « la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ».
Leurs prérogatives sont en pratique limitées puisqu'elles ne peuvent s'exercer que dans le cadre de la recherche et de la constatation d'un manquement ou d'une infraction. Or un tel encadrement exclut tous les travaux à caractère général visant à améliorer la connaissance des marchés et l'accès à l'ensemble des données pertinentes concernant la formation des prix. Des travaux de ce type seraient pourtant très utiles à la préparation et à la mise en oeuvre de politiques publiques pertinentes dans les outre-mer, à l'instar - le cas échéant - de mesures de régulation tarifaire.
C. Des données économiques transmises à l'Insee et protégées par le secret statistique
En l'état actuel du droit, seule l'Insee est aujourd'hui en mesure d'obtenir régulièrement de la part des entreprises des données sur les prix et les quantités vendues des produits de grande consommation. La DGCCRF ne peut pas obtenir ou utiliser ces informations collectées par l'Insee, ou l'intermédiaire qu'elle a désigné, car elles sont couvertes par le secret statistique et, par conséquent, ne peuvent pas être transmises à un tiers32F32F32F33(*). Le secret statistique est même opposable à toute réquisition judiciaire ou émanant d'autorités administratives, y compris dans le cadre d'enquêtes.
De ce fait, les données économiques du secteur de la grande distribution en outre-mer sont connues des seuls services de l'Insee, mais à des fins exclusivement statistiques, et elles ne peuvent être en aucun cas communiquées aux autres administrations à des fins de contrôle ou de régulation.
II. Le dispositif envisagé - La création d'une nouvelle obligation pour les distributeurs de transmettre des données économiques aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
A. La transmission obligatoire de données économiques par les distributeurs
Le présent article vise à obliger les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins33F33F33F34(*), pour leurs magasins de plus de 400 m² à dominante alimentaire34F34F34F35(*), à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation. Les données seront donc concrètement traitées par la DGCCRF.
Il s'agit d'accroître la transparence des pratiques des acteurs économiques ultramarins, afin d'améliorer la connaissance des marchés et en particulier celle du secteur de la grande distribution. Ces informations permettront en effet d'enrichir la connaissance des marchés économiques dans les territoires ultramarins par une communication des prix au détail et des quantités vendues par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire de produits de grande consommation. Les conditions de transmission de ces informations seront précisées par décret en Conseil d'État.
Cette nouvelle disposition sera insérée à l'article L. 410-6 du code de commerce dont elle remplacera la disposition actuelle, laquelle n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
B. Une obligation assortie de sanctions en cas de non- respect
Le respect de l'obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une nouvelle amende administrative. Dans le but de garantir l'effectivité du dispositif et s'assurer que les grandes enseignes de la distribution transmettent les données attendues, un régime de sanction administrative en cas de non- respect de cette obligation est en effet proposé.
Il s'agira d'une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale. Le régime applicable aujourd'hui aux sanctions administratives pour les manquements en matière de concurrence et de consommation, prévu à l'article L. 470-2 du code de commerce, en termes de publicité, de recouvrement, de contradictoire et autres, sera également applicable à ce nouveau manquement.
III. La position de la commission - Une mesure de transparence utile
A. Une contribution nécessaire à la lutte contre l'opacité des prix
Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les prix des produits vendus outre-mer sont à la fois élevés et opaques. Elle apparaît nécessaire pour adapter la régulation aux spécificités de ces territoires qui sont notamment marqués par l'opacité des facteurs à l'origine de la cherté de la vie.
Comme il a été vu, les dispositions en vigueur sont insuffisantes puisque le droit de communication de la DGCCRF ne peut s'exercer que dans la perspective de la recherche d'un manquement ou d'une infraction. Cela exclut donc la transmission de données exhaustives, dans la durée, permettant le suivi général des prix de détail et des quantités vendues dans le but d'éclairer le régulateur et, le cas échéant, de mettre en oeuvre une régulation des prix.
Une telle transmission systématique des données n'est pas actuellement organisée, sauf dans le cas de leur agrégation pour les statistiques de l'Insee ou dans celui du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 2024, mais sur une base strictement volontaire pour ce dernier. Ce protocole prévoit en effet que la DGCCRF réalise des bilans des effets de l'accord.
Il est certain que de telles données sont essentielles pour élaborer et mettre en oeuvre les politiques publiques, en particulier celles de lutte contre la vie chère outre-mer. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi rappelle, à bon escient, que l'accès aux données économiques par produit, principalement issues des sorties de caisse, portant sur les prix, mais aussi les quantités vendues au niveau de chaque magasin, est ainsi indispensable pour détecter ou objectiver d'éventuelles situations anormales de marché comme des pénuries ou des variations anormales des prix, de caractériser les comportements de consommation à l'instar du poids des marques de distributeurs ou des marques premier-prix dans les paniers relativement à celui des marques nationales sensiblement plus chères et, enfin, agir efficacement sur la régulation, en particulier tarifaire, sur les marchés ultramarins.
En effet, le suivi précis et régulier des prix de détail et des quantités des produits de grande consommation vendus en grandes surfaces à dominante alimentaire permettrait, d'une part, de mieux comprendre les comportements de consommation outre-mer et, d'autre part, d'établir des diagnostics précis et fiables en matière d'écarts de prix vis-à-vis de l'Hexagone ou de variations importantes de prix. Ces données permettraient donc une régulation tarifaire plus pertinente pour l'application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code de commerce, lorsque celle-ci s'avère nécessaire.
Comme l'explique l'exposé des motifs du présent projet de loi, la mesure permettra, en outre, à l'administration de disposer des informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la réglementation des prix s'agissant du bouclier qualité-prix (BQP) qui consiste, pour mémoire, à fixer depuis 2012 les prix de certains produits au terme de négociations ou, en l'absence d'accord, à les faire arrêter par le préfet. Ainsi, ces informations permettront aux services de l'État, en particulier, de « préparer les négociations du bouclier qualité-prix dans chaque territoire, mais également d'assurer le suivi et le respect du résultat des négociations, et d'en assurer un bilan annuel qui pourra être présenté aux observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et rendu public ».
En résumé, la connaissance des comportements de consommation et des marchés de la distribution alimentaire dans les outre-mer contribuera à des politiques publiques plus efficaces, qu'il s'agisse des négociations du BQP et du contrôle des engagements pris ou des problématiques de régulation tarifaire. Ce suivi au long cours des données économiques portant sur les prix et les quantités vendues par les distributeurs à prédominance alimentaire en outre-mer apparaît bien nécessaire et proportionné à l'atteinte de l'objectif de transparence, toujours insuffisante dans les régions ultramarines.
Le non-respect de cette obligation de transmission sera, par ailleurs, utilement sanctionné par une amende administrative.
B. Une transmission de données sans surcharge administrative pour les entreprises, qui les communiquent déjà à l'Insee en s'abritant parfois derrière le secret des affaires
La transmission systématique des données concernées n'engendrera pas de charges administratives supplémentaires pour les entreprises, cette obligation existant en réalité déjà au bénéfice de l'Insee. L'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique prévoit en effet notamment que « les personnes morales dont un des établissements a une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire de plus de 400 m² transmettent par voie électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques les données nécessaires à la réalisation de l'enquête statistique pour l'indice des prix à la consommation et l'enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires dans les conditions décrites dans les articles suivants ».
La DGCCRF et ses services déconcentrés pourront toutefois se heurter au secret des affaires puisque, concernant les marges et les étapes de la formation des prix, l'Insee se voit lui-même parfois opposer le secret des affaires par les distributeurs. La nouvelle obligation étant avantageusement assortie de sanctions en cas de non- respect, vos rapporteurs espèrent que cet argument sera moins mobilisé par les grands groupes de la distribution outre-mer.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 6 bis (nouveau)
Faculté pour les observatoires des
prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir les agents de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
Cet article additionnel est issu de l'adoption en commission d'un amendement du sénateur Victorin Lurel et de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il vise à permettre aux observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de pouvoir saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette mesure permettra d'accroître la transparence des marchés économiques outre-mer.
La commission a adopté cet article additionnel.
I. Le dispositif introduit par la commission - Un nouveau droit de saisine
A. La mesure proposée
Lors de l'examen du projet de loi en commission, un amendement COM-31 du sénateur Victorin Lurel et de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été adopté en vue de permettre aux observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de pouvoir saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les missions et le champ d'intervention des OPMR sont codifiés dans le code de commerce et dans le code de la consommation35F35F35F36(*). Le fait de leur donner la faculté de saisir les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre de leurs activités leur permettra de mieux conduire leurs missions. Cet amendement propose à cette fin de compléter l'article L. 910 1 H du code de commerce d'un alinéa idoine. Les moyens des OPMR reposant en pratique largement sur le choix discrétionnaire des préfectures d'allouer des moyens à leurs présidents, cette nouvelle compétence devrait leur être utile.
B. Un dispositif déjà adopté par le Sénat cette année
Une telle disposition avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025.
II. La position de la commission - Une mesure pertinente
A. Le dispositif facilitera le travail des OPMR
La mesure proposée par le présent article va dans le bon sens et permettra de compléter les compétences des OPMR, qui, d'une part, reposent sur des moyens limités et qui, d'autre part, disposent d'ores et déjà d'un pouvoir de saisine de l'Autorité de la concurrence.
B. Une mesure conditionnée par les moyens des services de la DGCCRF
À l'image des commentaires des articles 3, 6 et 7 du présent rapport, toutes les mesures proposées par le projet de loi qui s'appuient sur la DGCCRF ou les OPMR sont conditionnées aux moyens alloués à ces derniers. Pour que ces mesures soient efficaces, il faudra que ses services établis outre-mer disposent des moyens budgétaires et humains adéquats, les effectifs demeurant insuffisants.
La commission a adopté cet article additionnel.
Article 6 ter (nouveau)
Faculté pour les
départements ultramarins
de saisir l'Autorité de la
concurrence
Introduit par un amendement de Victorin Lurel ( COM-32), cet article additionnel a pour objet de donner la faculté aux départements ultramarins de saisir l'Autorité de la concurrence de toute pratique anticoncurrentielle concernant leur territoire respectif, ce qui dotera en pratique les départements de Guadeloupe et de La Réunion de ce pouvoir de saisine.
La commission a adopté cet article additionnel.
I. La situation actuelle - Les régions ultramarines disposent de la capacité de saisir l'Autorité de la concurrence de toute pratique anticoncurrentielle concernant leur territoire respectif
Le IV de l'article L. 462-5 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence (ADLC) peut être saisie par les régions d'outre-mer, le département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique anticoncurrentielle concernant leur territoire respectif.
II. Le dispositif envisagé - Une extension aux départements ultramarins de la capacité de saisine de l'Autorité de la concurrence
Le présent article 6 quater élargit les possibilités de saisine de l'Autorité de la concurrence, définies à l'article L. 462-5 du code de commerce et rappelées supra, aux départements d'outre-mer - seules les régions étant prises en compte en l'état actuel du droit.
Parmi les collectivités concernées, seules la Martinique, la Guyane et Mayotte sont des collectivités territoriales uniques (CTU). Pour mémoire, une CTU est une collectivité territoriale à statut particulier au sein de laquelle une seule assemblée exerce sur son territoire les compétences dévolues à la région et au département.
III. La position de la commission - Une disposition qui bénéficiera aux départements de Guadeloupe et de La Réunion
Dans l'état actuel du droit, les départements de la Guadeloupe et de La Réunion ne pouvaient saisir l'Autorité de la concurrence, les régions Guadeloupe et La Réunion ayant seules ce pouvoir.
Cette faculté nouvelle qui leur sera donnée par l'article issu de l'amendement COM-32 de Victorin Lurel et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain adopté par la commission devrait permettre de détecter davantage de pratiques anticoncurrentielles dans ces deux territoires.
Cette disposition avait déjà été votée lors de l'examen de la proposition de loi de Victorin Lurel adoptée par le Sénat le 5 mars 2025.
La commission a adopté cet article additionnel.
Article 6 quater (nouveau)
Partage d'informations couvertes par le
secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de
l'État, les collectivités d'outre-mer
et les présidents
des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR)
Cet article additionnel est issu de l'adoption en commission d'un amendement COM-33 du sénateur Victorin Lurel et de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il vise à permettre un partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État, les collectivités d'outre-mer et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR). La mesure traduit la recommandation n° 5 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la vie chère visant à définir un cadre législatif autorisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État et les collectivités ultramarines.
La commission a adopté cet article additionnel.
I. Le dispositif introduit par la commission - Un partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires
A. Le constat dressé par la Délégation sénatoriale aux outre-mer
La recommandation n° 5 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la vie chère visait à « définir un cadre législatif autorisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État et la collectivité à compétence régionale ». Comme le rappelle ce rapport, « le code des douanes a formalisé un cadre très souple d'échanges d'information entre les services de l'État. L'article 59 duodecies du code des douanes permet ainsi aux Douanes, à la direction générale des finances publiques (DGFIP) et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de se communiquer les données collectées sur l'ensemble de leurs missions ». Malheureusement, les collectivités ultramarines restent exclues de ce partage d'informations, surtout pour les informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires.
En effet, comme le poursuit ce rapport « un angle mort demeure les relations et les échanges d'information avec la collectivité régionale. L'exemple le plus topique est la non-transmission de nombreuses données douanières au nom du secret des affaires, alors même que dans les Drom la région fixe les taux et exonérations de l'octroi de mer. C'est aussi elle qui a la charge du développement économique. L'état de la concurrence l'intéresse donc directement, de même que la compréhension de la formation des prix ». Jugeant indispensable de formaliser un cadre organisant le partage de renseignements, le rapport précisait en outre que le président de l'OPMR étant un magistrat financier, il pourrait être destinataire de ces renseignements « sous réserve naturellement qu'il soit tenu de ne pas diffuser les informations recueillies auprès des autres membres de l'observatoire ».
B. Le dispositif proposé
Lors de l'examen du projet de loi en commission, un amendement du sénateur Victorin Lurel et de ses collègues du groupe Socialistes, Écologistes et Républicains a été adopté en vue de créer ce cadre organisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État, les collectivités d'outre-mer et les présidents des OPMR.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourront donc désormais communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d'outre-mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin et au président de l'OPMR territorialement compétent, tout document de nature fiscale recueilli dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire respectif.
II. La position de la commission - la traduction d'une proposition sénatoriale
A. Le dispositif donnera plus d'informations aux collectivités d'outre-mer et aux présidents des OPMR
La mesure proposée par le présent article permettra d'accroître la transparence des marchés économiques outre-mer en donnant plus d'informations aux collectivités d'outre-mer et aux présidents des OPMR, qui, d'une part, restaient tous deux jusqu'ici en-dehors du partage d'informations mis en place entre les administrations et qui, d'autre part, ne pouvaient pas accéder à des informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires.
B. Une mesure à assortir de garde-fous plus importants
Les informations partagées ne le seront qu'entre les administrations et les présidents des collectivités d'outre-mer concernées et des OPMR. À cet égard, le caractère sensible des informations recueillies justifie ce niveau restreint de communication.
Cette transmission devra faire l'objet de gardes fous plus importants, à définir en séance en liaison avec le Gouvernement, le cadre actuel ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs présidents pourraient se voir communiquer ce type d'informations.
La commission a adopté cet article additionnel.
Article 7
Obligation pour les distributeurs de transmission
d'informations
sur les marges arrière aux services de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
Cet article vise à obliger les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 m², à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, des informations sur leurs marges arrière et autres avantages obtenus auprès des fournisseurs.
Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les marges arrière contribuent à augmenter de manière opaque les marges des distributeurs au détriment des fournisseurs mais aussi parfois des consommateurs puisqu'elles peuvent contribuer aux prix déjà élevés des produits vendus outre-mer.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Le problème d'opacité des « marges arrière » et le surcoût qu'elles engendrent
A. Comprendre les marges arrière
Comme il a été vu au commentaire de l'article 6, auquel les rapporteurs renvoient s'agissant de l'importance pour l'administration de disposer d'informations, l'objectif de transparence dans la grande distribution pour les prix des produits de grande consommation reste difficile à atteindre. Parmi les facteurs à l'origine de la fixation de ces prix, les marges demeurent l'un des éléments les plus opaques et, en leur sein, les marges arrière sont le volet plus obscur.
Les marges arrière représentent des avantages obtenus par les distributeurs auprès de leurs fournisseurs, les premiers exigeant de ces derniers qu'ils leur rétrocèdent une partie de leurs marges sous la forme d'un pourcentage des ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs grandes et moyennes surfaces en contrepartie d'une coopération commerciale renforcée, pouvant prendre des formes multiples, telles que des rémunérations ou remises différées, des placements dans les rayons comme des primes de gondole, mais aussi des primes de coopération commerciale ou des primes d'objectifs. Ces avantages sont d'autant plus faciles à obtenir que les distributeurs sont à l'égard des fournisseurs dans un rapport de force qui leur est favorable, parfois proches de situations de monopsone36F36F36F37(*).
B. Une pratique qui contribue à la cherté de la vie outre-mer
Ces pratiques font deux perdants, elles conduisent à transférer une part des marges des fournisseurs vers les distributeurs sans que les consommateurs n'en tirent le moindre bénéfice. Elles pourraient conduire à réduire les prix de vente si elles conduisaient à des remises sur facture, mais elles conduisent au contraire à exercer une pression à la hausse des marges de l'ensemble de la chaîne de valeur, grossistes-importateurs et distributeurs au premier plan, font monter les prix des produits de fond de rayon comme en témoignent les travaux des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR).
Le rapport des députés de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution37F37F37F38(*) indique avoir mis au jour à La Réunion, un véritable « système GBH », « consistant pour ce groupe à exiger 7 à 8 % de marges arrière des producteurs locaux pour que leurs produits soient distribués ». Lors de l'examen du projet de rapport de la commission d'enquête le 20 juillet 2023, le rapporteur Johnny Hajjar concluait sur le fait que « même si le travail d'investigation doit être poursuivi et complété, nous avons découvert des mécanismes extrêmement troublants et contraires à l'éthique économique. Nous avons notamment pu confirmer l'existence des marges arrière. Les grands groupes intégrés accumulent, à chaque étape, les marges tout en maintenant l'opacité du système, ce qui empêche de savoir où vont les bénéfices accumulés. En tout état de cause, les marges arrière exigées par certains distributeurs n'atterrissent jamais dans la poche du consommateur, car les prix ne baissent pas ».
Le manque de transparence des marges arrière constitue un problème récurrent. Si elles doivent bien en théorie être intégrées dans le seuil de vente à perte (SRP), la réalité est que les vérifications sont très complexes. De même, en application de l'article L. 442-1 du code de commerce, si constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'une convention, « de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention [...] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence », de telles pratiques sont difficile à prouver.
C. Une pratique opaque qui échappe aux contrôles de la DGCCRF
Les marges arrière accentuent l'opacité autour de la formation des prix de vente au détail, ce qui altère la confiance des consommateurs et des autres opérateurs économiques, surtout que le détail de la contractualisation commerciale effective n'est pas toujours vérifiable. Des pratiques en théorie proscrites, comme la vente forcée de services de mise en rayon, peuvent toujours subsister dans le secret le plus total. Et selon le droit en vigueur, les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF ne leur permettent pas de disposer d'une bonne connaissance des avantages que les distributeurs ultramarins obtiennent auprès de leurs fournisseurs.
En effet, comme l'explique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, d'une part, les investigations portent davantage sur le respect des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce (formalisation des négociations et des contrats, réalité de certaines contreparties consenties par les enseignes aux avantages financiers octroyés par leurs fournisseurs) et, d'autre part, les effectifs de la DGCCRF établis dans les Drom étant limités, les contrôles des conventions sont réalisés par sondage et ne portent pas nécessairement sur les enveloppes globales consenties au titre des marges arrière, en particulier les avantages financiers octroyés aux distributeurs par les fournisseurs mais ne figurant pas sur les factures de produits comme les rémunérations de services de coopération commerciale, de services distincts ou de ristournes conditionnelles. Ces avantages font ainsi l'objet de factures établies par les distributeurs, et ne constituent pas des réductions de prix au sens propre, même si leurs montants sont généralement contractualisés sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires prévisionnel.
II. Le dispositif envisagé - Obliger les distributeurs présents sur les territoires ultramarins à transmettre à la DGCCRF des informations sur leurs marges arrière
A. La création d'une nouvelle obligation pour les distributeurs
En vue de pouvoir faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu'il s'agisse des réductions de prix figurant sur les factures d'achat des marchandises ou des avantages facturés aux fournisseurs par les distributeurs, y compris les ristournes conditionnelles, le présent article vise à obliger les distributeurs présents sur les territoires ultramarins à transmettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des informations sur leurs marges arrière.
Il consiste plus précisément à rendre obligatoire, pour tout distributeur exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 400 m², la communication des montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou tout autre avantage financier obtenus auprès de ses fournisseurs dans le cadre de l'exécution de la convention conclue l'année précédente, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ces avantages financiers sont négociés et stipulés dans les conventions annuelles comme le prévoit l'article L. 441-3 du code de commerce. Ces montants seraient exprimés en valeur absolue, mais aussi en pourcentage du tarif de chaque fournisseur soumis à la négociation.
Le présent article crée à cette fin un nouvel article L. 441-4-1 dans le code de commerce. Cette disposition permettra de mieux objectiver la situation et les difficultés que pourraient rencontrer les opérateurs économiques, notamment les producteurs locaux, au regard de la pratique des marges arrière. De fait, la DGCCRF sera en charge du traitement, de l'agrégation et de l'analyse de ces données. Le contrôle opéré par cette dernière, qui impliquera aussi de vérifier la fiabilité des informations transmises, pourra s'accompagner de sanctions administratives.
B. Le contrôle par la DGCCRF pourra s'accompagner de sanctions
Afin que les distributeurs respectent cette nouvelle obligation de communication. Dans le but de garantir l'effectivité du dispositif et de s'assurer que les enseignes de la distribution transmettent les données attendues, le respect de l'obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une nouvelle amende administrative.
III. La position de la commission - Une mesure de transparence utile
A. Le pertinence de la lutte contre l'opacité des marges arrière
Cette mesure de transparence va dans le bon sens alors que les prix des produits vendus outre-mer sont à la fois élevés et opaques. Les marges arrière sont un des facteurs de cette opacité et le fait d'envisager une communication de ces informations par les distributeurs sur une base volontaire ne constituerait pas, comme l'explique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « une option réaliste vis-à-vis d'opérateurs dont certains ne déposent même pas leurs comptes sociaux malgré l'obligation que la loi leur impose déjà en ce sens ».
Les rapporteurs jugent nécessaire de renforcer la transparence au niveau des pratiques commerciales et des niveaux de marge des acteurs ultramarins, notamment des marges arrière. Cela permettra d'améliorer la connaissance de ces marchés tout particulièrement celui de la grande distribution à dominante alimentaire, dans lequel les écarts de prix avec l'Hexagone sont les plus élevés. Pour que la mesure soit efficace, il faudra que les services de la DGCCRF établis outre-mer disposent des moyens budgétaires et humains adéquats, les effectifs demeurant insuffisants.
B. Le dispositif adopté par le Sénat en mars 2025 à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale
Le Sénat a, pour mémoire, adopté un dispositif expérimental d'encadrement des marges arrière dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025. L'article 1er bis de la proposition de loi prévoit ainsi qu'à titre expérimental, « pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l'objet de contreparties commerciales ou financières à l'égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires hors taxes par ligne de produits ».
En l'attente de la poursuite de l'examen de cette proposition de loi au cours de la navette parlementaire, le présent article représente une avancée notable qui permettra au Gouvernement de faire le cas échéant de nouvelles propositions législatives sur la base du retour d'expérience de la DGCCRF.
C. Une mesure contraignante pour les gros distributeurs
Le non-respect de la mesure sera comme il a été vu sanctionné par une amende administrative en cas de manquement à cette nouvelle obligation d'information de la part des distributeurs, afin d'assurer l'efficacité de la disposition.
La mesure créant de plus une nouvelle obligation déclarative, elle représentera une charge, à la fois administrative et financière, pour les distributeurs ultramarins.
Ces deux éléments illustrent le fait que le présent article vise une mesure contraignante pour les gros distributeurs, qui pourrait être perçue négativement, toutefois elle permettra d'améliorer la connaissance par les pouvoirs publics de la réalité de la pratique des marges arrière, celles-ci étant comme vu précédemment difficiles à appréhender et, encore plus, à rattacher à des produits précis. Il participera donc au renforcement de la transparence sur les prix outre-mer, que les rapporteurs appellent de leurs voeux.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 8
Interdiction des conditions
générales de vente et conditions commerciales discriminatoires
des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination
finale les outre-mer et instauration d'une obligation d'information sur les
prix convenus
Cet article vise à interdire les conditions générales de vente (CGV) et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer et à instaurer une obligation d'information sur les prix convenus
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Les conditions générales de vente (CGV), les négociations commerciales et les pratiques restrictives de concurrence
A. Les conventions commerciales qui lient fournisseurs, grossistes et distributeurs sont basées sur les conditions générales de vente (CGV) des produits et prestations de service
Les articles L. 441-3 et L. 441-3-1 du code de commerce disposent respectivement que la formalisation de la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service d'une part, ou bien entre un fournisseur et un grossiste38F38F38F39(*), ou entre un grossiste et un distributeur ou un prestataire de service d'autre part donne lieu à une convention écrite.
Celle-ci est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Cette convention écrite mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale.
Elle fixe ainsi, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
- les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situations et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
- les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
- les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
- l'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
Lorsque la convention écrite négociée entre un fournisseur et un distributeur est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation, l'article L. 441-4 du code de commerce prévoit que cette convention mentionne aussi le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.
La convention fixe également le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention, le plan d'affaires de la relation commerciale.
Le fournisseur, dans sa relation avec le distributeur ou dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de service, doit communiquer ses conditions générales de vente (CGV) dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
S'agissant de produits de grande consommation, le fournisseur doit communiquer ses CGV au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.
L'article L. 441-1 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente (CGV) comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
Ces CGV peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services.
Dès lors que les CGV sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Les prix convenus à l'issue de cette dernière correspondent par conséquent au tarif prévu par les CGV, diminué des sommes liées à d'autres éléments concourant à la détermination du prix qui sont également prévus par les CGV (remises par exemple) ou négociés par les parties (rémunération de services rendus par le distributeur, ristournes conditionnelles liées à l'atteinte de volumes d'affaires, etc.). Selon la DGCCRF, le prix convenu s'élève alors généralement à un niveau compris entre 60 % et 100 % du tarif prévu par les CGV, selon la nature du produit et la taille du fournisseur.
Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des CGV est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, ce qui est bien sûr le cas des relations établies entre fournisseurs, grossistes et distributeurs.
S'agissant des grossistes, l'article L. 441-1-2 du même code prévoit que tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est également tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Là encore, ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services.
Tout manquement à cette obligation de communication est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
B. La sanction des pratiques restrictives de concurrence susceptibles de survenir dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat
Listant une série de pratiques commerciales déloyales, l'article L. 442-1 du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
- d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
- de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- d'imposer des pénalités logistiques ;
- de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
- de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir.
L'action contre ces pratiques restrictives de concurrence peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, l'une de ces pratiques.
Peuvent être ordonnés par la justice la cessation de ces pratiques, l'indemnisation du préjudice subi, la nullité des clauses ou contrats illicites ou bien encore le prononcé d'une amende civile.
II. Le dispositif envisagé - L'interdiction des pratiques commerciales discriminatoires relatives aux produits destinés aux outre-mer et la création d'une nouvelle pratique restrictive de concurrence dédiée
A. L'interdiction des conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer
Le I du présent article 8 vient compléter le II de l'article L. 441-1 du code de commerce, lequel dispose que les conditions générales de vente (CGV) peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services, pour prévoir que les CGV ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.
Cette nouvelle règle s'applique aux conventions commerciales prévues à l'article L. 441-3-1 qui lient un fournisseur et un grossiste, ou un grossiste et un distributeur ou un prestataire de service. Elle s'applique également aux conventions commerciales prévues à l'article L. 441-4 négociées entre un fournisseur et un distributeur et relatives aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.
Elle s'applique également, le cas échéant, aux conventions prévues à l'article L. 443-8.
Le II de l'article 8 du projet de loi vient quant à lui compléter le III de l'article L. 441-1-2 du code de commerce, lequel dispose que les conditions générales de vente établies par les grossistes peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services, pour prévoir, là encore, que les CGV ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.
Cette nouvelle règle s'applique aux conventions commerciales prévues à l'article L. 441-3-1 qui lient un fournisseur et un grossiste, ou un grossiste et un distributeur ou un prestataire de service.
B. La création d'une nouvelle pratique restrictive de concurrence, passible de sanction, susceptible de survenir dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat portant sur des produits destinés aux territoires ultramarins
Le III de l'article 8 insère un 4° bis à l'article L. 442-1 du code de commerce pour créer une nouvelle pratique restrictive de concurrence qui engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
Il s'agit du fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.
Comme pour les autres pratiques restrictives de concurrence déjà visées par l'article L. 442-1, l'action contre cette nouvelle pratique restrictive de concurrence peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, l'une de ces pratiques.
Là encore, peuvent être ordonnés par la justice la cessation de ces pratiques, l'indemnisation du préjudice subi, la nullité des clauses ou contrats illicites ou bien encore le prononcé d'une amende civile.
C. Une obligation de transmission des conventions commerciales prévoyant une différenciation entre la métropole et les territoires ultramarins à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Le IV de l'article 8 crée dans le code de commerce un article L. 441-4-2 qui instaure l'obligation pour tout fournisseur ou grossiste de communiquer, à sa demande, à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conditions générales de vente qui comportent des différenciations pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna ainsi que, le cas échéant, les motifs de ces différenciations.
Les conditions de transmission et de communication de ces informations à l'autorité administrative sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
La DGCCRF disposera par conséquent, lorsqu'elle le demandera, des tarifs selon la destination des produits et des prix convenus dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins avec l'explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant.
Cette obligation déclarative incombant aux fournisseurs devrait ainsi permettre à la DGCCRF de s'assurer du respect de l'interdiction de discrimination et de mieux documenter les spécificités des circuits d'approvisionnement dans les territoires ultramarins et leur impact sur la construction des tarifs et des prix convenus à l'issue des négociations commerciales.
Le IV de l'article 8 dispose que les manquements aux dispositions de ce nouvel article L. 441-4-2 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
D. Une application aux conditions générales de ventes et aux conventions commerciales conclues après l'entrée en vigueur de la loi
Le V de l'article 8 vient préciser que la nouvelle pratique restrictive de concurrence visée par cet article ne concernera que les conditions générales de ventes soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et les conclusions qu'ils ont conclues avec eux postérieurement à l'entrée en vigueur dudit article 8, lequel n'aura pas de portée rétroactive.
Les CGV et conventions commerciales conclues avant l'entrée en vigueur de l'article 8 ne pourront par conséquent pas faire l'objet d'une action devant la juridiction civile ou commerciale sur son fondement.
III. La position de la commission - Une mesure nécessaire pour garantir l'absence de toute mesure discriminatoire à l'encontre des consommateurs ultramarins et pour rétablir la confiance vis-à-vis des industriels
À l'occasion d'une étude menée en 2024 auprès de fournisseurs de la grande distribution négociant en direct leurs conventions commerciales avec les distributeurs ou grossistes implantés dans les Drom, la DGCCRF avait pu constater qu'il existe une grande diversité de cas et de modalités permettant aux industriels, lorsqu'ils savent que leurs produits seront vendus dans les territoires ultramarins, de tenir compte des spécificités de ces territoires dans leurs conditions générales de vente (CGV) et leurs tarifs.
Des CGV distinctes de celles de l'Hexagone et des tarifs plus élevés sont généralement appliqués pour tenir compte de la prise en charge du transport, du commissionnement de l'agent importateur, de la complexité industrielle induite par des dates limites de consommation (DLC) plus longues, de conditionnements différents, de frais logistiques, etc.
Il convient en outre de noter que certaines références sont spécifiquement destinées aux Drom pour répondre à des habitudes alimentaires locales ou aux contraintes de transport (plus de surgelés ou de boîte en aluminium par exemple), ce qui rend plus difficile la comparaison avec les produits destinés aux consommateurs hexagonaux.
Dans le contexte du phénomène de vie chère outre-mer, une défiance s'est exprimée envers les distributeurs et leurs fournisseurs, soupçonnés de prévoir des conditions générales de vente (CGV) et des tarifs délibérément moins favorables pour les produits destinés aux territoires ultramarins.
Lors de son audition, la DGCCRF a indiqué aux rapporteurs qu'elle n'avait pas connaissance de discriminations abusives avérées dans les CGV des industriels pour leurs clients implantés outre-mer.
Elle a en outre signalé que pour les références les plus consommées des marques nationales, les enseignes s'approvisionnent à hauteur de 35 % auprès des centrales hexagonales, qui, ensuite approvisionnent les entités implantées dans les Drom, en direct ou via une centrale d'achat régionale métropolitaine. Or, les négociations avec ces dernières, quand elles ne sont pas des centrales dédiées aux Drom, se font sans distinction relative à la destination des produits : les produits et CGV sont donc strictement identiques, la destination n'étant pas connue des fournisseurs lors des négociations ni à l'occasion des commandes reçues.
Bien consciente malgré tout que l'existence de potentielles pratiques discriminatoires du seul fait que des produits sont destinés aux territoires ultramarins ne pouvait être écartée et qu'en tout état de cause la confiance devait être rétablie vis-à-vis des industriels, la DGCCRF a fait valoir, à raison, qu'imposer systématiquement de plein droit les CGV métropolitaines aux produits à destination des Drom pourrait s'avérer problématique, les raisons objectives mentionnées supra pouvant amener les industriels à établir des conditions différenciées. L'interdiction de celle-ci serait même susceptible, dans certains cas, de conduire les industriels concernés à se détourner des marchés ultramarins.
Prévoir des dispositions ne permettant l'application envers un acheteur de produits destinés aux territoires ultramarins de conditions commerciales différenciées par rapport à un acheteur métropolitain (pour des produits totalement identiques) que sous réserve de l'existence de raisons objectives, telles que l'éloignement géographique lorsque le fournisseur se charge de l'acheminement des marchandises jusqu'au territoire ultramarin, apparaît en revanche comme une mesure intéressante et proportionnée.
Les conditions différentiées dans les conditions générales de vente (CGV) et dans les conventions commerciales resteront dès lors possibles mais devront désormais être dûment justifiées pour garantir l'absence de toute pratique discriminatoire au détriment des acheteurs ultramarins.
Prévoir en outre une obligation déclarative incombant aux fournisseurs et portant à la fois sur leurs tarifs comparés selon la destination des produits mais aussi sur les prix convenus en Hexagone et dans les Drom et l'explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant, permettra à la DGCCRF de s'assurer du respect de l'interdiction de discrimination et de mieux documenter les spécificités des circuits d'approvisionnement dans les Drom et leur impact sur la formation des tarifs et des prix convenus à l'issue des négociations commerciales
Il s'agira ainsi de lutter contre le sentiment partagé par de nombreux Ultramarins d'une opacité dans la négociation des prix, et notamment des « marges arrière », qui alimente l'incompréhension face à la formation des prix et le soupçon d'un renchérissement indu préjudiciable aux consommateurs.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 9
Nouveau régime de sanctions en cas de
non-dépôt des comptes
par les entreprises en outre-mer
L'obligation de dépôt des comptes n'est pas respectée outre-mer et la possibilité, introduite en 2012, pour les préfets d'exiger la transmission des comptes n'a pas été utilisée. Cet article vise donc à renforcer les sanctions en cas de défaut de dépôt des comptes par les entreprises en outre-mer avec la création d'un nouveau dispositif qui s'ajoutera aux autres régimes de sanctions existants. Il s'agit de permettre aux préfets et aux associations de consommateurs de pouvoir saisir le juge des référés afin qu'il prononce une injonction aux sociétés de déposer leurs comptes, avec une astreinte pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen HT par jour de retard.
Le Sénat a adopté un dispositif voisin dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025. La seule différence réside dans le fait que l'article 1er de cette proposition de loi prévoit une astreinte payée par les dirigeants défaillants alors que le présent article ne sanctionne que les personnes morales.
La commission a donc adopté un amendement COM-83 de ses rapporteurs pour permettre au juge de sanctionner la personne morale ou le dirigeant fautif, lui offrant la possibilité d'adapter la sanction en fonction du cas d'espèce.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Une obligation de dépôt des comptes non respectée en outre-mer et une possibilité non utilisée par les préfets d'exiger la transmission des comptes
A. L'obligation de dépôt des comptes
Aux termes des articles L. 232-21 à L. 232-26 du code de commerce, lors de la clôture de chaque exercice annuel, toute société commerciale doit obligatoirement déposer ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ces documents comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable. L'obligation de publicité des comptes résulte aussi du droit communautaire, aux termes de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, à laquelle a succédé la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Ce dépôt assure une certaine transparence financière et garantit l'information des tiers, qu'il s'agisse de l'administration fiscale, des partenaires commerciaux, des investisseurs, etc.
Lors de la clôture de chaque exercice annuel, une société commerciale doit ainsi concrètement déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce pour être annexés au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ce dernier est en effet tenu par le greffe sous l'autorité du président du tribunal. À réception par le greffe, les comptes annuels font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Sous certaines conditions, les entreprises peuvent demander la confidentialité totale ou partielle de leurs comptes, c'est notamment le cas des micro-entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises.
À cette exception près, les manquements à l'obligation de dépôt de comptes peuvent conduire à d'éventuelles sanctions pour les sociétés défaillantes. En effet, des sanctions de nature pénale ou civile peuvent être imposées en cas de non-respect de cette obligation. Il s'agit ainsi d'inciter les dirigeants à régulariser leur situation.
Le défaut de dépôt de ces comptes constitue tout d'abord une infraction pénale qui constitue une contravention de cinquième classe pouvant donc faire l'objet d'une sanction sous la forme d'une amende de 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive.
Par ailleurs, en matière civile, le président du tribunal de commerce peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresser une injonction au dirigeant de déposer les comptes dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte.
Cette astreinte vise la société elle-même par application des articles L. 232-23 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, ou les dirigeants en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce.
Si l'injonction n'est pas respectée, le président du tribunal de commerce peut choisir de liquider l'astreinte, qui est alors à la charge de l'entreprise, ou à celle, personnelle, du dirigeant de la société fautive. Les dirigeants pouvant en effet être tenus pour responsables à titre personnel du non-respect de l'obligation, l'astreinte sera alors mise à leur charge en cas de non-respect de l'injonction de dépôt des comptes.
Il faut souligner qu'aux termes de l'article R. 247-3 du code de commerce, l'amende fait assez rapidement l'objet d'une prescription puisque l'action publique pour non-dépôt des comptes se prescrit en effet par un délai d'un an à compter de la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés.
Plus généralement, comme à l'accoutumée, les décisions d'injonction ou de liquidation d'astreinte peuvent être contestées par des recours en réformation ou en cassation.
Par ailleurs, l'article R. 210-18 du code de commerce prévoit un mécanisme de mise en oeuvre forcée, via la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc.
En pratique, toutes ces dispositions sont peu appliquées, ce qui ne contribue pas à inciter les entreprises à respecter leur obligation de dépôt des comptes, ce qui est particulièrement le cas en outre-mer.
B. Une obligation non respectée en outre-mer conduisant à la possibilité pour les préfets d'exiger la transmission des comptes
En effet, les entreprises implantées en outre-mer respectent beaucoup moins que leurs homologues de l'Hexagone leurs obligations de dépôt et de publication des comptes, comme le souligne le rapport de Mme Bellay au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale39F39F39F40(*) sur la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer : à la Martinique, par exemple, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi rappelle que, pour la Guadeloupe, ces taux descendent même à 14 % au greffe du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui couvre également les sociétés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Un dispositif spécifique aux collectivités d'outre-mer a donc été mis en place en vue de permettre aux services de l'État de pouvoir contraindre les sociétés commerciales à leur communiquer leurs comptes.
C'est ainsi qu'en outre-mer, le droit existant, issu de l'article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, prévoit que ces entreprises, bénéficiant d'une aide publique en faveur de leur activité économique, sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l'État dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée.
L'article en vigueur précise qu'en cas de refus, le représentant de l'État peut demander au juge des référés d'enjoindre à l'entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte. Ces dispositions ont été introduites en 2012 pour inciter les entreprises à respecter en outre-mer leurs obligations de dépôt de leurs comptes. Malheureusement, elles n'ont pas conduit à des changements dans les pratiques, surtout que les préfets ne font pas usage de cette prérogative consistant à exiger de se voir transmettre les comptes.
II. Le dispositif envisagé - Permettre aux préfets et aux associations de consommateurs de pouvoir saisir le juge des référés afin d'enjoindre sous astreinte les sociétés de déposer leurs comptes
A. Un nouveau régime de sanctions en cas de non-dépôt des comptes par les entreprises en outre-mer
Le présent article vise à permettre aux préfets et aux associations de consommateurs (celles mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation, qui justifient d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs) de pouvoir saisir le juge des référés afin qu'il prononce une injonction aux sociétés de déposer leurs comptes, avec une astreinte pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen HT par jour de retard. Ce dispositif vise à renforcer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer. Par ailleurs, le montant de l'astreinte sera versé au Trésor public et non pas au demandeur.
Il est proposé, en outre, de renvoyer à un décret en Conseil d'État pour le régime de liquidation de l'astreinte, qui devrait être inspiré des dispositions de l'article R. 611-16 du code de commerce, le Gouvernement ayant à juste titre fait valoir que la loi ne peut renvoyer à un article réglementaire.
Il peut être observé que dans le même esprit que ce projet de dispositif de sanctions renforcées, l'article 8 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, dite loi Égalim 1, a créé l'article L. 123-5-2 du code de commerce disposant que le président du tribunal de commerce peut adresser à certaines sociétés40F40F40F41(*) une injonction de déposer leurs comptes à bref délai sous astreinte d'un montant qui ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France. Cette disposition qui crée un traitement différencié, y compris entre les entreprises de l'Hexagone, a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, dans laquelle il a rappelé que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit »41F41F41F42(*).
B. La possibilité d'assortir la sanction d'une mesure de type « name and shame »
L'étude d'impact annexée au présent projet de loi rappelle que le nouveau dispositif de sanction sera assorti d'une mesure de type « name and shame » permettant, sur demande de la partie demanderesse, de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion du contournement de la loi. Il reviendra au juge de décider, d'une part, de l'opportunité d'ordonner la publication de la décision lorsqu'une telle demande sera faite par le préfet et, d'autre part, de fixer les modalités de cette publicité (durée, support, etc.).
Cette disposition devrait contribuer à faire évoluer les comportements en matière économique outre-mer, et, à ce titre, elle contribuera à la transparence comptable des entreprises outre-mer, ce qui facilitera la connaissance des déterminants de la vie chère dans les territoires ultramarins.
III. La position de la commission - Ce nouveau régime de sanctions est pertinent mais il peut être enrichi des travaux récents du Sénat à ce sujet
A. Un dispositif pertinent
Les rapporteurs partagent l'objectif d'un renforcement de la transparence comptable des entreprises, qui est une exigence à la fois du droit communautaire et du droit national. Le nouveau régime de sanction civile destiné aux collectivités d'outre-mer en cas de manquement à l'obligation de dépôt de ses comptes par une société s'ajoutera aux autres régimes existants, dont celui de l'infraction pénale, sachant que cette procédure juridictionnelle, par nature longue et incertaine, si elle doit être conservée mais ne constitue pas le meilleur levier pour inciter les entreprises à déposer leurs comptes. C'est pourquoi il est pertinent d'ajouter aux procédures existantes le dispositif proposé par le présent article.
B. L'adoption d'un dispositif voisin par le Sénat en mars 2025 à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale
Le Sénat a adopté un dispositif voisin dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025. L'article 1er de la proposition de loi a ainsi été entièrement réécrit à la suite de l'adoption par la commission des affaires économiques d'un amendement sur l'initiative d'Évelyne Renaud-Garabedian, alors rapporteur, en prévoyant un nouveau régime de sanction civile destiné aux collectivités d'outre-mer donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'adresser une injonction aux dirigeants en cas de non-transmission des comptes avec une astreinte pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen HT par jour de retard. Dans ce dispositif, l'astreinte devait être payée par les dirigeants défaillants alors que le présent article ne sanctionne que les personnes morales.
Afin de reprendre l'esprit de la disposition adoptée par le Sénat, la commission a donc adopté un amendement COM-83 de ses rapporteurs pour permettre au juge de sanctionner la personne morale ou le dirigeant fautif, lui offrant la possibilité d'adapter la sanction en se basant sur le cas d'espèce auquel il doit faire face en pratique.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
TITRE III
RENFORCER LA CONCURRENCE
Article 10
Augmentation des moyens de
l'Autorité de la concurrence
Cet article vise à :
- ajouter deux membres au collège de l'Autorité de la concurrence, choisis en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer ;
- créer un service d'instruction spécifiquement dédié aux territoires ultramarins au sein des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ;
- apporter, à la demande de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, des ajustements aux dispositions du code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie et relevant de la compétence de l'État ;
- abaisser le seuil de concentration pour le commerce de détail dans les outre-mer.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Bien qu'elle traite beaucoup de droit de la concurrence dans les outre-mer, l'Autorité de la concurrence ne dispose ni de membres du collège ni de service d'instruction dédié
A. L'Autorité de la concurrence
1) Les attributions de l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège de dix-sept membres
Instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), l'Autorité de la concurrence (ADLC) est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée, en vertu des dispositions du I de l'article L. 461-1 du code de commerce, de veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
Le II du même article L. 461-1 prévoit que les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres au mandat irrévocable, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique après avis des commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le collège comprend également :
- six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation. Deux vice-présidents sont désignés parmi eux ;
- cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales. Deux vice-présidents sont désignés parmi eux.
Cette composition diversifiée du collège de l'Autorité de la concurrence vise à favoriser la diversité des points de vue et la richesse des échanges lors des délibérations.
Le président et les quatre vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps tandis que les douze autres membres sont non permanents. Le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. Le mandat des membres du collège n'est renouvelable qu'une seule fois.
Ces règles de composition, de nomination et de renouvellement des membres du collège de l'ADLC ne prévoient pas pour l'heure d'expertise de l'économie ou de la concurrence spécifique aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution.
2) Les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence
L'article L. 461-4 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence (ADLC) dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel. C'est également le rapporteur général qui fixe le nombre et la composition des services d'instruction. Selon le rapport annuel 2023 de l'Autorité, les services d'instruction représentaient, au 31 décembre 2023, 123,62 équivalents temps plein travaillés (ETPT).
Ces services d'instruction de l'ADLC procèdent aux investigations nécessaires à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations économiques. Ils sont organisés en six services « concurrence » dédiés aux pratiques anticoncurrentielles (activité dite « antitrust ») et à l'activité consultative, un service des investigations, un service en charge du contrôle des concentrations, un service économique et un service de l'économie numérique.
Il n'existe pas pour l'heure de service dédié aux outre-mer, ce qui n'a pas empêché l'ADLC de se montrer active dans les territoires ultramarins.
|
L'action de l'Autorité de la concurrence dans les outre-mer Au titre de sa compétence répressive, l'Autorité a adopté, depuis sa création en 2008, 46 décisions relatives aux outre-mer pour un total de 232 millions d'euros d'amendes, dont 177 millions d'euros prononcés à l'encontre d'auteurs de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante), près de 53 millions d'euros à raison d'infractions procédurales (non-respect d'engagements, obstruction, réalisation anticipée d'une opération de concentration) et 2,3 millions d'euros pour des accords exclusifs d'importation. Des investigations sont en cours s'agissant notamment du fonctionnement du port de Longoni à Mayotte, des travaux publics à Wallis-et-Futuna, de la distribution de câbles électriques dans l'ensemble des départements d'outre-mer et des déchets d'activité de soins à risque infectieux. En matière consultative, l'Autorité a rendu 17 avis relatifs à l'outre-mer depuis 2008, dont deux en 2009 et 2019 qui dressent un diagnostic général du fonctionnement de la concurrence dans les départements et régions d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte). À la suite de la signature en octobre 2024 du protocole de lutte contre la vie chère en Martinique, l'Autorité instruit actuellement, à la demande du Gouvernement, un avis sur les marges des importateurs-grossistes et des distributeurs sur les produits alimentaires de première nécessité dans ce département. Enfin, l'Autorité a rendu 85 décisions relatives à des opérations de contrôle des concentrations en outre-mer. Sur ces 85 décisions, 58 l'ont été sur le fondement des seuils de chiffres d'affaires spécifiques aux outre-mer et 22 décisions ont été assorties de conditions visant à remédier à des risques de concurrence identifiés par l'Autorité, majoritairement dans le secteur du commerce de détail. Source : Autorité de la concurrence |
B. Les dispositions du code de commerce applicables de Nouvelle-Calédonie et relevant de la compétence de l'État
Si les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie disposent chacune d'une compétence exclusive en matière de droit de la concurrence, l'État conserve sa compétence législative en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
Pour la Nouvelle-Calédonie, ces règles sont fixées par l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
L'article 5 de cette ordonnance prévoit notamment que les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées aux parties en cause et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'arrêt de la cour d'appel peut lui-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Or, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a alerté les services de l'État pour signaler que les règles prévues par l'ordonnance du 7 mai 2014 souffraient de lacunes par rapport au droit applicable en Polynésie française, notamment en matière de protection du secret des affaires, ces décisions relevant de la compétence du Conseil d'État42F42F42F43(*) en premier et dernier ressort, alors que les mêmes décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou par celui de l'autorité polynésienne de la concurrence relèvent du juge judiciaire.
Il en résulte selon l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie une complexité excessive qui amoindrit l'efficacité de la lutte contre la vie chère en Nouvelle-Calédonie.
C. Les seuils de notification à l'Autorité de la concurrence des opérations de concentration
Comme il a été indiqué supra, l'Autorité de la concurrence (ADLC) est chargée du contrôle des concentrations d'entreprises en France. En vertu de l'article L. 430-1 du code de commerce, une concentration d'entreprises s'entend comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises existantes, par la prise de contrôle totale ou partielle d'une entreprise par une autre ou encore par la création d'une entreprise commune par deux sociétés existantes.
Une opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence lorsque certains seuils sont dépassés. Ces seuils ont été fixés par le législateur afin que puissent être préalablement examinées par l'ADLC les opérations susceptibles de modifier la structure d'un marché ou d'un segment de marché et de soulever des problématiques concurrentielles.
L'article L. 430-2 du code de commerce prévoit ainsi trois types de seuils de notification ont été fixés :
- des seuils généraux43F43F43F44(*) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
. le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
. le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros.
- des seuils, plus bas, spécifiques aux magasins de commerce de détail44F44F44F45(*) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
. le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
. le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros.
Comme précisé dans les lignes directrices de l'ADLC en l'absence de définition légale, un magasin de détail s'entend comme un magasin qui effectue, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Le commerce de détail recouvre ainsi des domaines variés tels que la distribution à dominante alimentaire, les concessions et la location automobile, la vente au détail de carburants et de combustibles, la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie ou bien encore la vente au détail de produits électrodomestiques.
Sont également assimilés à du commerce de détail, bien que ne constituant pas de la vente de marchandises, un certain nombre de prestations de service à caractère artisanal : pressing, coiffure et esthétique, cordonnerie, photographie, entretient de véhicules et montage de pneus.
- des seuils, plus bas, spécifiques aux départements d'outre-mer45F45F45F46(*), à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy :
. le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
. le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail, sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale.
Selon les informations communiquées aux rapporteurs et comme indiqué ci-dessus, depuis 2008, l'Autorité de la concurrence a rendu 80 décisions de contrôle d'opérations de concentration en outre-mer, dont 53 ont été rendues sur le fondement des seuils de chiffres d'affaires spécifiques fixés par l'article L. 430-1 du code de commerce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que sont seulement notifiées à l'Autorité de la concurrence les opérations de concentration qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission européenne, chargée de la politique européenne de concurrence, définie par le règlement européen du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations d'entreprises46F46F46F47(*).
L'article 1er de ce règlement définit notamment les opérations de concentration qualifiées de « dimension communautaire » lorsqu'elles répondent aux critères suivants :
- le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros et le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans l'Union européenne par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros ;
- ou que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l'Union européenne à l'intérieur d'un seul et même État membre.
L'article 22 de ce même règlement prévoit la possibilité pour les autorités nationales chargées de la concurrence de renvoyer à la Commission européenne des opérations de concentration qui ne sont pas de dimension communautaire mais qui affectent le commerce au sein du marché intérieur ou menacent d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres.
Alors que la Commission européenne avait récemment élargi l'interprétation de cet article 22, en acceptant le renvoi par les autorités nationales d'opérations de concentration qui sont également « sous les seuils » fixés au niveau national - permettant notamment de mieux appréhender les acquisitions prédatrices ou consolidantes, en particulier dans l'économie numérique - le récent arrêt Illumina/Grail de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 septembre 2024 a mis un terme à cette interprétation extensive.
II. Le dispositif envisagé - Des ajustements portant sur le collège et les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence, sur le droit connexe au droit de la concurrence applicable en Nouvelle-Calédonie et sur le seuil de concentration pour le commerce de détail dans les outre-mer
A. L'Autorité de la concurrence
1) Une composition du collège modifiée pour accueillir deux membres supplémentaires choisis en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer
Le I du présent article 10 modifie l'article L. 461-1 du code de commerce relatif à la composition du collège de l'Autorité de la concurrence (ADLC).
Il prévoit ainsi le passage de dix-sept à dix-neuf du nombre de membres de ce collège.
Il insère un 4° dans la liste des membres du collège pour prévoir que ces deux membres supplémentaires doivent être deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer.
Le II de l'article 10 précise que le mandat des membres nommés pour la première fois en tant que personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer prend effet à compter du 18 septembre 2026. Il prévoit que le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans. Ces dates visent à prendre en compte la règle du renouvellement par moitié tous les deux ans et demi des membres du collège.
2) La création d'un service d'instruction dédié aux outre-mer
Ainsi qu'il a été rappelé supra, l'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général. Le III du présent article 10 prévoit que l'un de ces services d'instruction traite les sujets concernant les collectivités de l'article 73 de la Constitution, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna.
B. Les dispositions du code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie et relevant de la compétence de l'État
Le IV du présent article 10 insère un article 6-1 après l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
Cet article 6-1 réunit devant la juridiction judiciaire l'ensemble du contentieux relatif aux décisions de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie puisqu'il dispose que les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article Lp. 463-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
L'article 6-1 prévoit également que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
Un décret en Conseil d'État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026.
Le V de l'article 10 vient pour sa part insérer un nouvel article L. 462-9-1-1 dans le code de commerce, lequel prévoit que l'Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l'obligation de secret professionnel, communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu'elle détient ou qu'elle recueille, dans l'exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité.
C. L'abaissement du seuil de concentration pour le commerce de détail dans les outre-mer
Ainsi qu'il a été rappelé supra, le III de l'article L. 430-2 du code de commerce prévoit qu'une opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail, sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale.
Le VI du présent article 10 modifie le III de l'article L. 430-2 du code de commerce pour abaisser de 5 millions d'euros à 3 millions d'euros le seuil pour le commerce de détail du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement par au moins deux entreprises parties à la concentration entraînant une notification obligatoire à l'Autorité de la concurrence.
III. La position de la commission - Des mesures bienvenues mais qui, en ce qui concerne les ajustements apportés à l'organisation de l'Autorité de la concurrence, devraient avoir peu d'effets concrets en l'absence de moyens d'action supplémentaires
A. Sur la modification du collège de l'Autorité de la concurrence et la création d'un service d'instruction spécifique aux outre-mer
Lors de son audition par les rapporteurs, l'Autorité de la concurrence a fait valoir qu'elle partageait pleinement l'objectif du présent article 10 du projet de loi, à savoir renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence pour lui permettre d'améliorer sa capacité de réponse aux enjeux concurrentiels ultramarins, dans un contexte de lutte contre la vie chère.
À cet égard, elle considère que l'ajout de deux membres du collège choisis en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer peut être de nature à enrichir ses décisions et avis relatifs aux territoires ultramarins.
De même, elle ne voit pas de difficultés de principe à ce que soit créé un service d'instruction spécialement dédié aux outre-mer, même si elle considère, à l'instar du Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi, qu'une telle mesure ne relève pas du domaine législatif mais des prérogatives du rapporteur général de l'Autorité, que l'article L. 461-4 du code de commerce habilite à « décider en toute indépendance de l'emploi des ressources humaines et budgétaires au sein des services d'instruction sans que la loi puisse lui prescrire une organisation particulière de ses derniers »47F47F47F48(*).
Toutefois, elle considère que l'augmentation du nombre de membres du collège ou la création d'un service d'instruction dédié, s'ils adressent indiscutablement un signal politique important aux collectivités ultramarines, ne constituent pas en elles-mêmes une réponse suffisante aux enjeux de la régulation concurrentielle en outre-mer et aux besoins identifiés par l'Autorité compte tenu de son organisation particulière.
Lors de son audition, l'Autorité a rappelé que sa structure et son fonctionnement obéissent à une stricte séparation entre les activités d'instruction, menées par les services d'instruction, et l'activité de jugement, menée par le collège de l'Autorité. L'instruction des dossiers est ainsi menée en toute indépendance par les services d'instruction, placés sous la direction du rapporteur général. Ce n'est qu'au terme d'une enquête et d'une procédure contradictoire entre les parties et les services d'instruction que les affaires sont examinées par le collège de l'Autorité.
Or, les besoins de moyens humains supplémentaires identifiés par l'Autorité ne concernent pas véritablement la fonction de jugement exercée par le collège mais plutôt en réalité la fonction d'enquête et d'instruction qui incombe aux services d'instruction. La détection et l'instruction des affaires aboutissant à une décision du collège impliquent de fait un travail préparatoire considérable de recueil et d'analyse de preuves ainsi que la tenue de débats contradictoires s'étendant sur des périodes pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années.
Aussi l'Autorité estime-t-elle que seule l'augmentation des effectifs des services d'instruction permettrait de véritablement renforcer son action dans les outre-mer. Elle considère en outre que sans moyens supplémentaires, la création au sein des services d'instruction d'un service distinct pour les outre-mer n'aurait aucun effet sur ses capacités d'action réelles dans ces territoires.
Serait en outre nécessaire, selon elle, de prévoir également une augmentation des moyens de la DGCCRF en outre-mer, dans la mesure où l'Autorité s'appuie sur le maillage territorial de celle-ci. De fait, l'Autorité s'appuie sur les remontées d'indices et les rapports administratifs d'enquête des agents locaux de la DGCCRF et la majorité des saisines de l'Autorité sur des pratiques anticoncurrentielles en outre-mer proviennent directement ou indirectement (saisine d'office de l'Autorité après rapport administratif d'enquête de la DRCCRF) des services du ministre de l'économie.
Aussi les rapporteurs s'attacheront-ils à veiller, dans le cadre des débats auxquels donnera lieu le projet de loi de finances pour 2026, à ce que tant l'Autorité de la concurrence que la DGCCRF puissent disposer de moyens supplémentaires dédiés aux outre-mer, car il s'agit là du véritable levier susceptible de favoriser un accroissement du nombre d'enquêtes menées pour lutter contre les pratiques concurrentielles dans les territoires ultramarins.
B. Sur les dispositions du code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie et relevant de la compétence de l'État
Les mesures prévues aux IV et V du présent article 10 visent à combler des lacunes juridiques identifiées par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
En prévoyant que les recours contre les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée sont jugées par le juge judiciaire mais également en organisant la communication d'informations ou de documents de l'Autorité de la concurrence vers l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ces dispositions nouvelles permettront à cette dernière de mieux lutter contre les pratiques qui faussent la concurrence et contribuent au phénomène de la vie chère en Nouvelle-Calédonie.
C. Sur l'abaissement du seuil de concentration pour le commerce de détail dans les outre-mer
Lors de son audition, l'Autorité de la concurrence a indiqué aux rapporteurs que les seuils spécifiquement applicables aux outre-mer ont démontré leur utilité depuis leur introduction en 2008 en permettant à l'Autorité d'examiner de nombreuses opérations, notamment dans le secteur de la grande distribution où la cession d'un simple supermarché est susceptible d'entraîner des problèmes de concurrence au niveau local.
Dans ce contexte, l'ADLC leur a indiqué qu'elle n'est pas opposée sur le principe à un abaissement du seuil local ultramarin de 5 millions à 3 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail.
De fait, la grande majorité des décisions de l'Autorité imposant des engagements pour remédier à des difficultés de concurrence en outre-mer concernent le secteur du commerce de détail (17 décisions sur 22, soit 77, 2 %). Ces statistiques montrent que le commerce de détail demeure un secteur particulièrement sensible en outre-mer dans un contexte de crise de la vie chère.
La révision proposée des seuils prévus au III de l'article L. 430-2 du code de commerce sera ainsi de nature à renforcer la capacité de contrôle de l'Autorité s'agissant d'opérations de concentration portant sur des entreprises de taille modestes mais susceptibles de diminuer significativement la concurrence dans des zones de chalandise locales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat avait déjà voté cette mesure dans le cadre de l'examen de la proposition de loi du sénateur Victorin Lurel visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer adoptée par le Sénat le 5 mars 2025.
Si l'Autorité ne dispose pas d'élément lui permettant d'anticiper le nombre de notifications supplémentaires potentiellement concernées, les opérations comprises entre 3 et 5 millions n'ayant par définition fait l'objet d'aucune notification jusqu'à présent, elle estime cependant que la charge de travail supplémentaire devrait être proportionnée au regard des objectifs poursuivis.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 11
Habilitation du Gouvernement
à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code
de commerce les dispositions connexes au droit
de la concurrence relevant de
la compétence de l'État
en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Des règles connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'État et applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française réparties dans plusieurs textes législatifs
En vertu des lois organiques statutaires qui les régissent, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie disposent de compétences propres très étendues en matière de droit de la concurrence.
Les réglementations locales en matière de droit et de politique de la concurrence prises par les collectivités dans le cadre de l'exercice de leurs compétences propres s'articulent toutefois avec des règles qui sont connexes au droit de la concurrence, mais demeurent de la compétence de l'État.
En vertu, d'une part, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'État reste en effet compétent en matière de garantie des libertés publiques, de justice et d'organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse.
Les règles connexes au droit de la concurrence demeurant de la compétence de l'État et applicables dans chacun de ces deux territoires sont rassemblées respectivement dans :
- l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions ;
- l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.
II. Le dispositif envisagé - Une habilitation du Gouvernement à codifier à droit constant par ordonnance les règles connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'État et applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
L'article 11 du projet de loi prévoit, en vue d'améliorer l'accessibilité du droit, que le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l'exercice par l'État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le second alinéa de l'article précise qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de la publication de ladite ordonnance.
Le livre IX du code de commerce est consacré à l'outre-mer.
Il s'agit donc, sur le fondement de l'article 11 du projet de loi, d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter ce livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les règles connexes au droit de la concurrence demeurant de la compétence de l'État et applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française rassemblées respectivement dans :
- l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions ;
- l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.
Une fois leurs dispositions codifiées, ces deux ordonnances seront abrogées.
L'article 11 ne vise pas spécifiquement ces deux ordonnances afin de réserver la possibilité d'introduire également dans le livre IX du code de commerce d'éventuelles autres dispositions relevant du droit connexe au droit de la concurrence demeurant de la compétence de l'État applicable en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française qui ne se trouveraient pas dans ces deux ordonnances, mais dans d'autres textes législatifs.
III. La position de la commission - Une opération de codification qui permettra d'améliorer l'intelligibilité et l'accessibilité des règles connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'État et applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Le Conseil constitutionnel a consacré un objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Il a également indiqué à plusieurs reprises que la codification des normes contribuait à cet objectif. Celle-ci, en rassemblant des normes dispersées, en les rendant cohérentes et accessibles à travers un plan logique et en améliorant la qualité des textes, contribue à rendre le droit plus lisible, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique.
Dans la mesure où l'ordonnance que le Gouvernement souhaite adopter sur le fondement de l'article 11 vise uniquement, à droit constant, à codifier au livre IX du code de commerce relatif à l'outre-mer les règles connexes au droit de la concurrence demeurant de la compétence de l'État et applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ladite ordonnance paraît clairement de nature à contribuer utilement à l'intelligibilité et à l'accessibilité du droit au profit des Néo-Calédoniens et des Polynésiens.
Cette opération de codification facilitera en outre l'exercice des compétences des institutions locales en matière de droit et de politique de la concurrence.
Compte tenu de la complexité du travail juridique à effectuer - recensement des dispositions à codifier, indispensable coordination du projet d'ordonnance avec les réglementations locales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie -, une durée d'habilitation de dix-huit mois paraît proportionnée.
L'ensemble de ces éléments justifie donc que la commission propose au Sénat de faire exception à sa règle habituelle de refuser les habilitations à légiférer par ordonnance pour privilégier leur inscription directe dans la loi soumise à la délibération du Parlement, les ordonnances étant rarement plus rapides et moins transparentes.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 12
Extension des pouvoirs des commissions
départementales
d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser
la concurrence
Cet article vise à étendre la possibilité de saisine de l'Autorité de la concurrence par les CDAC des territoires ultramarins pour les entreprises détenant une part de marché de 25 % d'une zone de chalandise, au lieu de 50 % dans le droit en vigueur.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - En outre-mer, les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) peuvent saisir l'Autorité de la concurrence lorsqu'une opération peut conduire une entreprise à dépasser 50 % de part de marché d'une zone de chalandise
La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), présidée par le préfet, est une instance départementale chargée de se prononcer sur les autorisations d'exploitation commerciale. Elle examine les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface de vente après l'opération.
Dans charque département, la CDAC est instituée par un arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du code de commerce, lequel établit notamment la liste des six membres permanents de la CDAC composée de personnalités qualifiées et de représentants des élus au niveau départemental.
Participent également à la CDAC cinq membres non-permanents dont la désignation dépend de la zone de chalandise du projet.
Introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, l'article L. 752-6-1 du code de commerce dispose que, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) doivent tenir compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone de chalandise par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale.
Si la part de marché de cette entreprise, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise considérée au terme de l'opération, la CDAC peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence (ADLC).
Le second alinéa de l'article L. 752-6-1, introduit par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, précise que lorsqu'une CDAC saisit l'ADLC, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'Autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la CDAC peut valablement statuer.
Cette faculté de saisine de l'ADLC par la CDAC d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a été utilisée qu'une seule fois, par la CDAC de Saint-Barthélemy. Elle a donné lieu à l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-20 du 7 novembre 2013 relatif au projet d'agrandissement du principal magasin de distribution alimentaire de Saint-Barthélemy qui n'émettait aucune objection à l'opération en l'absence de risque sérieux pour la concurrence.
II. Le dispositif envisagé - L'extension de la possibilité de saisine de l'Autorité de la concurrence par les CDAC des territoires ultramarins pour les entreprises détenant une part de marché de 25 % d'une zone de chalandise
L'article 12 du projet de loi vient abaisser de 50 % de part de marché à 25 % de part de marché de la zone de chalandise après l'opération le seuil à partir duquel la CDAC d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin peut saisir l'Autorité de la concurrence (ADLC) pour obtenir une analyse concurrentielle d'un projet de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface de vente après l'opération.
Il suffira donc désormais que l'entreprise à l'origine d'un projet commercial soit susceptible de dépasser les 25 % de parts de marché dans la zone de chalandise concernée par l'opération - et non plus 50 % - pour que la CDAC, avant d'autoriser ou non cette opération, puisse solliciter l'avis de l'ADLC.
Cette évolution élargit donc substantiellement le champ des saisines de l'Autorité, bien qu'il s'agisse toujours d'une possibilité offerte aux CDAC et nullement d'une saisine automatique.
III. La position de la commission - Une mesure bienvenue et déjà adoptée par le Sénat, mais qui nécessitera d'être mise en oeuvre par les CDAC pour être pleinement utile
L'étroitesse des marchés des collectivités ultramarines est parfois telle que des opérations conduisant une entreprise à disposer d'une part de marché significative, bien qu'inférieure à 50 %, sont susceptibles d'engendrer une intensité concurrentielle insuffisante, au détriment des consommateurs ultramarins.
L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (l'ACNC), qui, en vertu du droit de la concurrence spécifique à ce territoire, est chargée de mener une analyse des opérations d'aménagement commercial avant leur réalisation, a ainsi identifié dans deux décisions de 2020 des problèmes de concurrence à l'occasion de l'installation d'hypermarchés entraînant une part de marché pour l'entreprise concernée située autour de 30 % de la zone de chalandise après l'opération.
Cette part de marché avait beau être très inférieure à 50 %, l'ACNC a estimé qu'elle ne pouvait autoriser l'opération prévue par ce nouvel entrant dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire sans engagements structurels de sa part destinés à garantir un niveau de concurrence suffisant.
D'autres décisions de l'ACNC ont également exigé des engagements destinés à protéger la concurrence de la part d'entreprises qui n'étaient pas susceptibles de dépasser les 50 % de parts de marché dans la zone de chalandise concernée après la mise en oeuvre de leur projet d'aménagement commercial pour autoriser ce dernier.
Ces exemples tendent à accréditer l'idée selon laquelle prévoir un seuil inférieur à 50 % de parts de marché à l'issue de l'opération permettrait aux CDAC des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin de solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence pour des projets dont l'analyse concurrentielle demeure aujourd'hui insuffisante, ce qui peut participer, dans une certaine mesure, au phénomène de la vie chère que subissent les habitants de ces territoires.
L'élargissement des possibilités de saisine, par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), de l'Autorité de la concurrence, au sujet d'entreprises sollicitant une autorisation d'exploitation commerciale et susceptibles de détenir une part de marché de 25 % d'une zone de chalandise au terme de l'opération, au lieu de 50 % aujourd'hui, n'a pas suscité d'opposition de la part des acteurs entendus par les rapporteurs, qu'il s'agisse de la direction générale des outre-mer (DGOM), de la DGCCRF ou encore de l'Autorité de la concurrence.
Une telle saisine, ne peut, de fait, que contribuer utilement à la lutte contre les abus de position dominante dans une zone de chalandise donnée et c'est la raison pour laquelle le Sénat avait déjà voté cette mesure dans le cadre de l'examen de la proposition de loi du sénateur Victorin Lurel visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer adoptée par le Sénat le 5 mars 2025.
Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, l'Autorité n'a été saisie qu'une seule fois par une CDAC, en 2013, au sujet d'un projet d'agrandissement du principal magasin de distribution alimentaire de Saint-Barthélemy.
Il n'est donc pas garanti que cette modification législative conduira à des évolutions significatives, même si la réduction de moitié du seuil pertinent pourrait augmenter le nombre de saisines.
La commission a adopté l'article sans modification.
TITRE IV
SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN
Article 13
Extension
aux produits substituables du régime des
produits identiques ou similaires
importés dont les prix de vente outre-mer
sont inférieurs
à ceux pratiqués dans l'Hexagone
Cet article vise à étendre aux produits substituables le régime des produits identiques ou similaires importés dont les prix de vente outre-mer sont inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone et pour lesquels le préfet peut rendre obligatoire la conclusion d'un accord entre, d'une part, les acteurs de l'importation et de la distribution et, d'autre part, ceux de la production et de la transformation locales. La mesure doit permettre un soutien aux produits locaux présentant des caractéristiques comparables aux produits importés et non seulement aux produits identiques.
Le Sénat a adopté un dispositif similaire dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Le dispositif introduit en 2017 vise à protéger la production locale
A. Une production locale nettement insuffisante
La vie chère peut être notamment combattue par la baisse des prix, à la faveur de la commercialisation de produits moins chers, soit à la suite d'opérations d'importation, soit à la suite d'une production locale compétitive. Le plus souvent, outre-mer, les biens produits localement sont quoi qu'il en soit très loin de pouvoir couvrir la demande.
L'étude d'impact annexée au présent projet de loi rappelle ainsi que la production locale demeure très insuffisamment développée dans les outre-mer. Selon l'Institut d'émission d'outre-mer (Ieom) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom), le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie ainsi, en effet, entre 1 % et 10 % en outre-mer contre environ 80 % dans l'Hexagone.
B. Le régime introduit par la loi Érom en 2017
L'article L. 420-5 du code de commerce prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. L'article 64 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, dite loi Érom, a introduit un dispositif particulier visant à protéger la production locale dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, où les prix de distribution de certains produits alimentaires, comme ceux dits « de dégagement », sont très inférieurs aux prix pratiqués en métropole. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits plus onéreux.
Cet article, codifié à l'alinéa 2 de l'article L. 420-5 du code de commerce, prévoit ainsi que si des produits identiques ou similaires importés dont les prix de vente outre-mer sont inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone, le préfet peut rendre obligatoire la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part.
Cet accord est rendu public par arrêté préfectoral mais, en l'absence d'accord dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le préfet peut prendre par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux enjeux de prix de vente aux consommateurs, de situation des producteurs locaux et d'intérêt des consommateurs. Il pourrait ainsi choisir de réglementer les prix ou de l'imiter l'importation de certains produits.
Ce régime s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et vise à assurer la viabilité de la production locale dans le contexte de l'augmentation de l'importation de denrées alimentaires à bas prix. Il poursuit donc notamment l'objectif d'encadrer la commercialisation des « produits de dégagement », à savoir des denrées en majorité alimentaires parfois peu consommés dans l'Hexagone et dès lors transportées puis vendues à bas coût vers les outre-mer. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi donne l'exemple du poulet congelé, produit de dégagement typique, importé à bas coût de l'Hexagone et revendu dans les outre-mer à moins de 2 euros le kilo au consommateur en moyenne.
L'article 18 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim 1, a, pour mémoire, apporté une précision rédactionnelle à l'article L. 420-5 du code de commerce.
Il convient, en outre, d'observer que cette disposition, qui repose donc sur l'article L. 420-5 du code de commerce, n'a - à ce jour - encore jamais été utilisée.
II. Le dispositif envisagé - L'extension aux produits substituables du régime applicable aux produits identiques ou similaires importés
A. Permettre aux préfets d'activer l'article L. 420-5 du code de commerce pour les produits substituables au lieu des seuls produits identiques ou similaires
Le présent article vise à un rééquilibrage entre production locale et importations à protéger davantage la production locale en ajoutant la notion de produits locaux substituables aux produits identiques ou similaires importés, leur permettant de pouvoir bénéficier de l'accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l'égide du préfet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce. Par l'ajout du terme substituable, seront ainsi considérés l'ensemble des produits locaux en concurrence avec les produits importés vendus à un prix manifestement inférieur à celui constaté dans l'Hexagone, ce qui renforcera la possibilité, pour le représentant de l'État dans le territoire ultramarin considéré, de garantir la viabilité de la production locale et, le cas échéant, de réglementer les prix ou les importations.
B. Un objectif de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale pouvant résulter de l'importation de denrées alimentaires en provenance de l'Hexagone
Le droit en vigueur, en se limitant aux seuls produits identiques ou similaires, ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des situations dans lesquelles des produits importés peuvent entrer en concurrence avec les produits locaux, en particulier dans les cas où ces produits seraient proches mais sans être strictement identiques ou similaires. L'exemple le plus connu étant celui de la concurrence directe entre des produits surgelés importés et des produits locaux frais, ce qui illustre la pertinence de remanier le deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce.
III. La position de la commission - Un dispositif pertinent mais qui ne permet pas de lutter contre la vie chère et qui a déjà été voté par le Sénat lors de l'examen d'une proposition de loi
A. Soutenir la production locale en vue de garantir une concurrence équitable est utile mais ne permet pas de lutter contre la vie chère
Sur le fond, le choix de protéger la production locale ultramarine par un dispositif d'encadrement des produits importés permet de garantir une concurrence plus équitable mais ne permet pas de lutter contre la vie chère.
En effet, de telles dispositions visent les produits dont les prix de vente dans les outre-mer sont manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone, et pour lesquels le préfet peut rendre obligatoire la conclusion d'un accord entre, d'une part, les acteurs de l'importation et de la distribution et, d'autre part, ceux de la production et de la transformation locales, or elles ne sont pas de nature à lutter contre la vie chère et à accroître la concurrence outre-mer.
S'il est bien pertinent de soutenir la production locale et de lutter contre la part croissante de certaines denrées alimentaires peu chères vendues dans les outre-mer, notamment celles qu'on appelle les « produits de dégagement », il ne faut pas perdre de vue qu'un tel dispositif n'aura pas pour effet de conduire à une baisse des prix pour les consommateurs.
B. L'adoption d'un dispositif similaire par le Sénat en mars 2025 à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale
Le Sénat a adopté un dispositif similaire dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par le sénateur Victorin Lurel le 10 décembre 2024 et adoptée par le Sénat le 5 mars 2025. L'article 2 de la proposition de loi a ainsi été enrichi d'une extension du régime des produits identiques ou similaires importés dont les prix de vente outre-mer sont inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone aux produits présentant des caractéristiques comparables, dans le but de soutenir les produits locaux.
Cette extension résultait de l'adoption d'un amendement du sénateur Teva Rohfritsch, vice-président de la délégation sénatoriale aux outre-mer, et de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, dont le rapporteur Frédéric Buval.
La commission des affaires économiques, par la voix d' Évelyne Renaud-Garabedian, alors rapporteur, s'était alors déclarée en séance publique défavorable à l'amendement car il contredisait l'objectif général de la proposition de loi, qui était précisément de lutter contre la vie chère.
Bien que le dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce n'ait jamais été mobilisé et que l'Autorité de la concurrence doute des effets juridiques de ce dispositif et de sa réforme48F48F48F49(*), il convient selon les rapporteurs de faire primer l'objectif de soutien aux produits locaux.
Si à court terme les produits importés peuvent être moins onéreux, il est indispensable de renforcer à moyen terme la compétitivité des produits locaux et d'accroître à long terme l'autonomie alimentaire des territoires ultramarins, le taux de couverture de la consommation locale par la production locale restant dans une fourchette de 1 % à 10 % outre-mer, contre environ 80 % dans l'Hexagone.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 14
Expérimentation d'un Small Business Act
ultramarin
Cet article vise, à titre expérimental, à imposer aux acheteurs publics ultramarins de réserver jusqu'à 20 % de leurs marchés inférieurs aux seuils des procédures formalisées aux microentreprises, petites et moyennes entreprises et artisans locaux, pour une durée de cinq ans.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La commande publique représente l'un des principaux moteurs d'un tissu économique ultramarin très éclaté
Le tissu économique dans les collectivités ultramarines est marqué par la prédominance des très petites entreprises (TPE), qui représentaient en 2022 97 % des 48 732 entreprises martiniquaises49F49F49F50(*), ou une proportion comparable à La Réunion en 202050F50F50F51(*), contre 82 % à l'échelle nationale. De plus, selon l'Insee, la diversité sectorielle y est plus restreinte, avec un nombre d'activités exercées, mesuré par les codes APE (activité principale exercée), plus faible que dans l'Hexagone (602 codes dans l'Hexagone, contre 408 à La Réunion, 370 en Guadeloupe, 347 en Martinique et 290 en Guyane)51F51F51F52(*). De même, la taille moyenne des petites et moyennes entreprises (PME) y est plus faible : de 1,34 à 1,41 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes annuel en moyenne, contre 1,53 million d'euros dans l'Hexagone.
Dans ce contexte, la commande publique y joue un rôle de soutien à l'activité économique encore plus marqué que dans l'Hexagone, et ce alors que les TPE et PME constituent 60 % des titulaires des marchés publics en France52F52F52F53(*). Elle représentait ainsi dans les collectivités ultramarines 6,3 milliards d'euros en 2023, montant en progression continue depuis 2019. Alors que, selon les données de l'Observatoire économique de la commande publique (OECP), qui reposent sur les seuls marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes (HT), la commande publique représente environ 6 % du PIB à l'échelle nationale, elle compte pour 14,4 % de celui de La Réunion ou encore 15,7 % de celui de la Guadeloupe53F53F53F54(*). À Mayotte, selon les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française, « 50 % de l'économie locale repose[rait] sur l'achat public sous toutes ses formes ».
Quand bien même le droit de la commande publique, qui est issu du droit européen et repose sur les principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures énoncés à l'article L. 3 du code de la commande publique, interdit aux acheteurs publics de favoriser les entreprises locales pour l'attribution de leurs marchés, des initiatives ont été engagées dans les collectivités ultramarines pour développer un dialogue entre les pouvoirs adjudicateurs et les acteurs économiques locaux.
C'est le cas de la « stratégie du bon achat » (SBA) à La Réunion, qui sous l'égide d'une association a, à partir de 2016, rassemblé des acheteurs, des organisations professionnelles et des entreprises autour de trois objectifs : l'anticipation, afin de mieux informer les entreprises sur les besoins prévisionnels des pouvoirs adjudicateurs ; l'adaptation, afin de mieux dimensionner les marchés aux capacités des entreprises ; l'ancrage territorial, afin de favoriser le développement de filières locales.
Son succès a conduit à la mise en place, à l'initiative de l'ancienne députée de La Réunion Ericka Bareigts, d'une première expérimentation entre 2017 et 2022 visant à réserver aux PME ultramarines jusqu'à un tiers des marchés passés dans les collectivités d'outre-mer, dans la limite de 15 % de la moyenne des marchés conclus dans le secteur économique concerné par chaque acheteur. Prévue à l'article 73 de la loi du 28 février 2017 dite « Érom »54F54F54F55(*), et parfois qualifiée de « Small Business Act » ultramarin par référence à la loi américaine réservant une part des marchés publics fédéraux aux petites entreprises, elle n'a toutefois pas rencontré le succès escompté, en raison des perturbations liées à la crise sanitaire mais aussi du risque juridique perçu par les acheteurs au regard du droit européen et qui a freiné son application.
II. Le dispositif envisagé - Une expérimentation encadrée pour soutenir l'activité économique locale
Le présent article 14 propose de relancer une expérimentation sur le modèle de celle de l'article 73 de la loi « Érom », tout en cherchant à la sécuriser juridiquement pour éviter les écueils rencontrés par cette dernière.
La durée - cinq ans - et le périmètre géographique d'application de l'expérimentation seraient identiques à ceux de 2017 : ils concerneraient les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte) ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion donc de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, où elle serait restreinte aux seuls marchés publics passés par l'État.
La principale différence par rapport à 2017 repose sur les marchés publics concernés ainsi que les entreprises bénéficiaires, dont la liste est enrichie.
Afin de se prémunir contre les règles de la directive du 26 février 2014 sur les marchés publics55F55F55F56(*), l'article propose de limiter l'expérimentation aux seuls marchés d'un montant inférieur aux seuils à partir desquels elle s'applique, c'est-à-dire les seuils des procédures formalisées56F56F56F57(*), soit 143 000 euros HT (État) ou 221 000 euros HT (autres pouvoirs adjudicateurs) pour les fournitures et les services et 5 538 000 euros HT pour les travaux.
Cette expérimentation porterait sur 20 % du montant total de ces marchés, qui pourraient être réservés aux microentreprises, aux PME et aux entreprises artisanales établies dans les collectivités ultramarines concernées. Deux différences sont donc à noter ici par rapport au dispositif de 2017 : la modification du champ des marchés concernés et du volume des marchés pouvant être réservés à ces acteurs économiques, dont le calcul est simplifié, et l'extension de l'expérimentation, au-delà des seules PME, aux microentreprises et aux artisans.
Enfin, comme il est d'usage pour une expérimentation, l'article prévoit que le Gouvernement devra réaliser son évaluation et remettre, trois mois avant son terme, un rapport au Parlement à ce sujet afin de lui permettre d'examiner l'opportunité de sa pérennisation et de son extension.
III. La position de la commission - Une mesure bienvenue pour favoriser le développement des petites entreprises ultramarines
La mobilisation de la commande publique en faveur des petites entreprises constitue une demande récurrente des acteurs économiques et des élus locaux, à qui est traditionnellement opposée la rigueur de la réglementation européenne en la matière, qui interdit toute restriction d'accès des opérateurs économiques aux marchés publics, et notamment toute discrimination basée sur l'origine ou la nationalité des candidats. Le Conseil d'État s'en fait l'écho dans son avis sur le projet de loi, recommandant ainsi de « ne pas retenir » cette mesure, qui se heurterait « à des obstacles d'ordre constitutionnel ou conventionnel ».
Pour autant, la commission a estimé qu'il était absolument indispensable de parvenir à mieux faire profiter de la commande publique le tissu économique ultramarin, constitué très majoritairement de TPE et PME, et que l'expérimentation proposée au présent article constituait une première réponse en ce sens, à cadre juridique européen constant.
Cet article tire les leçons de l'échec de l'expérimentation qui a eu lieu entre 2017 et 2022 en application de l'article 73 de la loi « Érom ». L'évaluation de sa mise en oeuvre à La Réunion par le Haut conseil de la commande publique (HCCP) de ce territoire57F57F57F58(*) avait fait apparaître que, sur 23 acheteurs réunionnais, 74 % d'entre eux connaissaient cette mesure mais seulement 4 %, soit un seul, y avaient eu recours. Ils invoquaient notamment l'imprécision des termes de cet article ou encore l'absence de mention explicite des TPE pour expliquer les réticences à participer à cette expérimentation. Pour autant, 78 % des acheteurs interrogés considéraient qu'il serait pertinent de la reconduire, avec quelques aménagements, notamment pour compenser la période de la crise sanitaire, durant laquelle l'activité économique a été très perturbée.
Cette mesure correspond également à une proposition formulée par la délégation sénatoriale aux outre-mer qui, dans la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer déposée par ses membres58F58F58F59(*), invitait à reconduire pour cinq ans l'expérimentation de la loi « Érom », sous réserve de quelques ajustements (article 12).
La commission considère qu'une évolution plus profonde du droit de la commande publique est nécessaire pour mettre en place un véritable Small Business Act à l'échelle européenne. La révision des directives sur la commande publique engagée par la Commission européenne pourrait être l'occasion de le mettre en oeuvre, comme l'a recommandé la commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française59F59F59F60(*). Toutefois, l'urgence liée à la situation économique des territoires ultramarins ne permet pas d'attendre encore plusieurs années que ce processus aboutisse.
Dès lors, l'expérimentation proposée au présent article recueille l'entier soutien de la commission. Le fait qu'elle soit limitée aux marchés publics qui ne sont pas soumis à la directive européenne et qu'elle soit facultative constitue à ses yeux des garde-fous suffisants, de nature à rassurer les acheteurs publics ultramarins sur ses modalités de mise en oeuvre.
Il leur appartient maintenant de s'en saisir, au profit des TPE, PME et artisans situés dans les collectivités d'outre-mer. La commission estime par ailleurs que si la mention des entreprises artisanales peut apparaître juridiquement superfétatoire, dans la mesure où elles relèvent, en fonction de leur effectif et de leur chiffre d'affaires, soit de la catégorie des TPE, soit de celle des PME, elle n'en reste pas moins bienvenue et constitue un signal en faveur de ce secteur essentiel des économies ultramarines.
La commission a adopté l'article sans modification.
Article 15
Expérimentation d'une obligation de sous-traitance au
profit
des petites entreprises dans le cadre des marchés publics
outre-mer
Cet article vise, à titre expérimental, à instaurer pour les titulaires de marchés publics d'un montant supérieur à 500 000 euros dans les collectivités ultramarines une obligation d'établir un plan de sous-traitance au profit des TPE et PME locales.
La commission a adopté deux amendements rédactionnels.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - La sous-traitance est une voie d'accès courante à la commande publique pour les petites entreprises
Dans le cadre de la commande publique, la sous-traitance est définie à l'article L. 2193-2 du code de la commande publique comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité60F60F60F61(*), et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur ». Elle permet ainsi d'en faciliter l'accès aux entreprises qui ne seraient pas en mesure de répondre seules aux marchés publics lancés par les pouvoirs adjudicateurs, en raison notamment de leur taille dans le cadre d'opérations complexes, et aux titulaires de ces marchés de faire appel à des compétences ou un savoir-faire particuliers non disponibles en interne pour assurer la bonne exécution des prestations qui leur ont été confiées.
Il s'agit d'une pratique économique courante et particulièrement répandue dans le secteur de la construction. Selon l'Insee, en 2021, une entreprise sur deux avait recours à la sous-traitance, et même 60 % des entreprises du secteur de la construction61F61F61F62(*). Cette même prévalence se retrouve dans les marchés publics : selon une étude de l'Observatoire économique de la commande publique (OECP) de 202062F62F62F63(*), les actes de sous-traitance représentent 26 % du nombre des marchés de travaux, contre 10 % de celui des marchés de services, et au moins 20 % des marchés d'un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes (HT) donnent lieu à de la sous-traitance.
Surtout, les PME sont les bénéficiaires de 76 % des actes de sous-traitance, représentant en valeur 66,5 % du total sous-traité, alors qu'elles ne représentent que 60 % des titulaires de marchés publics, ou seulement 27,2 % en valeur63F63F63F64(*).
Il convient également de rappeler que deux interdictions encadrent l'exercice de la sous-traitance dans les marchés publics : celle de la sous-traitance de l'intégralité des prestations d'un marché64F64F64F65(*) et celle pesant sur les marchés de fournitures ne comportant ni services, ni travaux de pose ou d'installation65F65F65F66(*).
Dès lors, au même titre qu'elle avait institué, à titre expérimental, un mécanisme de réservation d'une part des marchés publics ultramarins au profit des PME (cf. commentaire de l'article 14), la loi dite « Érom » du 28 février 2017 avait également, à son même article 73, rendu obligatoire la présentation d'un plan de sous-traitance dans les marchés d'un montant estimé supérieur à 500 000 euros HT, devant préciser les conditions de participation au marché des PME locales.
Un décret du 31 janvier 201866F66F66F67(*) était venu en préciser les modalités d'application et fixer le terme de cette expérimentation au 31 mars 2023. Ce plan de sous-traitance devait figurer dans l'offre des candidats aux marchés publics concernés et ceux-ci devaient le cas échéant justifier du fait qu'ils ne prévoyaient pas de faire appel à des PME locales en tant que sous-traitantes, notamment si aucune d'entre elles n'était en mesure de réaliser les prestations attendues.
II. Le dispositif envisagé - Le renouvellement d'une expérimentation favorable aux petites entreprises ultramarines
Le présent article 15 propose de reconduire, selon des modalités similaires, l'expérimentation qui s'est déroulée entre 2018 et 2023.
Dans le même périmètre géographique et pour la même durée - cinq ans - que l'expérimentation du Small Business Act ultramarin prévue à l'article 14, il impose aux candidats aux marchés publics d'un montant estimatif supérieur à 500 000 euros HT de produire un plan de sous-traitance au profit des microentreprises, PME et entreprises artisanales ultramarines.
Cette obligation ne s'appliquerait toutefois pas aux microentreprises, PME ou entreprises artisanales qui seraient elles-mêmes candidates à un tel marché. Qui plus est, en cas de carence du tissu économique des petites entreprises sur le territoire concerné, qu'il s'agisse d'une absence de structures ou d'une incapacité de leur part à exécuter les prestations du marché, il appartiendrait aux candidats de justifier de l'impossibilité de faire appel à la sous-traitance.
Cette expérimentation ne serait applicable, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, qu'aux seuls marchés publics passés par l'État.
Enfin, comme il est d'usage pour une expérimentation, l'article prévoit que le Gouvernement devra réaliser son évaluation et remettre, trois mois avant son terme, un rapport au Parlement à ce sujet afin de lui permettre d'examiner l'opportunité de sa pérennisation et de son extension.
III. La position de la commission - Soutenir les petites entreprises ultramarines grâce à la sous-traitance
La commission estime que le renouvellement de cette expérimentation, qui va de pair avec celle prévue à l'article 14 et qui vise à réserver une part des marchés publics ultramarins inférieurs aux seuils européens aux TPE, PME et entreprises artisanales, constitue une mesure attendue par les acteurs économiques locaux.
Ainsi, l'évaluation de l'article 73 de la loi dite « Érom » réalisée par le Haut conseil de la commande publique (HCCP) de La Réunion en 202267F67F67F68(*) a mis en lumière le fait que 87 % des acheteurs interrogés connaissaient cette mesure et que 74 % considéraient qu'elle leur permettait d'ancrer localement leurs achats. Selon le HCCP, cette obligation de sous-traitance « permet notamment de favoriser l'activité sur le territoire lorsque de grandes entreprises extérieures obtiennent les marchés publics locaux ; et donc de développer une réelle valeur ajoutée localement, en consolidant le tissu productif local ». 74 % des acheteurs interrogés étaient favorables à la reconduction de l'expérimentation.
La commission partage ce point de vue. En raison du caractère particulièrement atomisé du tissu économique ultramarin, constitué très majoritairement de TPE et PME à l'activité fragile, et dans un contexte où l'emploi informel reste une réalité dans ces territoires, il convient de tout mettre en oeuvre pour soutenir le secteur formel, en particulier dans le secteur de la construction, et mieux valoriser le savoir-faire de ces professionnels.
Elle est donc très favorable à la relance d'une expérimentation similaire à celle qui avait été conduite en application de la loi « Érom », mais invite cette fois le Gouvernement à en réaliser une évaluation à son terme dans toutes les collectivités concernées.
La commission a adopté deux amendements rédactionnels ( COM-85 et COM-89) à cet article.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 16
Application de la loi à Wallis-et-Futuna
Cet article vise à assurer les coordinations nécessaires pour l'application du présent projet de loi à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence puis l'article ainsi modifié.
Collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution, Wallis-et-Futuna est régie par le principe de spécialité législative, selon lequel une loi n'y est applicable que si elle le mentionne explicitement.
De ce fait, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État68F68F68F69(*), cette mention expresse répond à une technique de rédaction particulière dite des « compteurs Lifou », sous la forme, dans les codes, de tableaux pour chaque collectivité relevant du principe de spécialité indiquant, en deux colonnes, les dispositions étendues et la rédaction dans laquelle elles sont applicables.
Le présent article 16 procède donc, dans le code de commerce, à l'extension à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 du projet de loi, ainsi qu'à la mise à jour de certains compteurs pour tenir compte de modifications apportées par de précédents textes législatifs.
La commission a adopté un amendement ( COM-86) visant à corriger une erreur de référence.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
* 1 La dernière comparaison disponible se base sur des données de 2022. Cf. l'enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation entre territoires, qui permet de mesurer les écarts de prix entre la France métropolitaine et les cinq départements d'outre-mer (DOM) - Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte - ainsi qu'entre la Corse et le reste de la province et, qu'entre la région parisienne et la province (hors Corse). Précédemment à l'enquête de 2022, seules quatre enquêtes ont été réalisées en 1985, en 1992, en 2010 et en 2015. La prochaine devrait être conduite en 2027 ou 2028.
* 2 Cf. l'avis n° 19-A-12 de l'Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en outre-mer.
* 3 L'acconage correspond aux opérations de chargement ou de déchargement d'un navire au moyen d'acons, qui sont des embarcations de taille plus réduites à fond plat utilisées dans les ports.
* 4 L'Autorité de la concurrence donne l'exemple du transport de bouteilles d'eau et de champagne pour illustrer l'impact du prix du transport sur le prix de détail des produits à faible valeur ajoutée alors qu'il peut être beaucoup plus faible sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Une bouteille d'eau minérale importée coûte 1,03 euro (base 100 « prix champagne »). Elle est donc près de 100 fois moins chère qu'une bouteille de champagne à l'achat. L'importation de ces produits génère des frais supplémentaires, notamment d'approche comme le fret, l'octroi de mer ou encore le transport local. Ces frais sont certes comparables en valeur nominale entre les deux produits (les volumes étant comparables), ainsi qu'en base 100 « prix champagne », mais ils ont un impact nettement plus significatif sur le prix de revient de l'eau minérale. En effet, ce dernier fait plus que doubler avec la simple prise en compte du fret. En définitive, le prix de la bouteille d'eau minérale est multiplié par plus de 4 contre seulement 1,36 pour la bouteille de champagne.
* 5 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
* 6 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
* 7 Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce.
* 8 Décret n° 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce.
* 9 Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2022.
* 10 Article Lp. 411-2-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
* 11 Les produits de grande consommation sont définis à l'article L. 441-4 du code de commerce comme des produits « non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
* 12 Et du président de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.
* 13 Note circulaire portant instructions à l'intention des préfets pour le pilotage et l'animation des services et missions visant à lutter contre la vie chère dans les outre-mer, 10 juillet 2025, NOR : MOMO2519794C.
* 14 Cf supra article 2.
* 15 Cf. le Titre 1er A du code de commerce : « Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer », articles L. 910-1 A à L. 910-1 J.
* 16 L'article 75 de la loi précitée précise qu'un décret fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de ces OPMR. Le décret n'a été pris que sept ans plus tard. Cf. le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les membres de l'Observatoire de La Réunion sont rapidement nommés par le préfet et la séance d'installation a lieu le 13 juillet 2007. Un article a été écrit sur les conditions de création des OPMR en 2007 et les premiers mois de fonctionnement de celui de La Réunion, cf. Jean-Yves Rochoux, « La comparaison des prix à la Réunion : entre perception, statistiques et enjeux sociaux », disponible au lien suivant : https://www.opmr.re/wp-content/uploads/2024/04/PrixRunPrimeur.pdf
* 17 Cf. les articles L. 910-1 A et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L. 410-5 et L. 462-1 du même code et l'article L. 113-3 du code de la consommation.
* 18 Cf. le décret n° 2025-720 du 29 juillet 2025 relatif à l'avis sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale de l'observatoire des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna et le décret n° 2025-721 du 29 juillet 2025 relatif aux modalités d'exercice du mandat de président de l'observatoire des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et des îles Wallis et Futuna.
* 19 L'article L. 910-1 B du code de commerce précise que le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.
* 20 Selon les informations transmises par la DGOM, les neuf OPMR disposent d'un budget annuel consolidé s'élevant à 600 000 euros depuis 2019. Les dotations budgétaires allouées aux activités des OPMR avaient en effet sensiblement augmenté, passant de 279 350 euros en 2018 à 600 000 euros en 2019, afin d'amplifier leur activité en matière d'études.
* 21 L'OPMR des Antilles et de la Guyane a précisé dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs que « les données concernant les revenus et les marges sont inexistantes ».
* 22 Le sujet des marges arrière revient régulièrement dans les débats sur la vie chère outre-mer alors même que la comptabilisation des marges arrière dans le taux de marge des distributeurs est régulée au niveau national depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008. Elles sont, depuis, incluses dans la détermination du seuil de revente à perte (SRP). L'enjeu de leur transparence est traité au commentaire de l'article 7 du présent projet de loi, dont l'objet est précisément d'obliger les distributeurs à procéder à la transmission d'informations sur ces marges arrière aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
* 23 Cf. notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-26 du 22 décembre 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe
* 24 Cf. le texte de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer au lien suivant : https://www.senat.fr/leg/ppl24-172.html
* 25 Cf. l'article L. 410-3 du code de commerce.
* 26 Cf. les articles R. 671-1 à R. 671-31 du code de l'énergie et les arrêtés du 5 février 2014.
* 27 Cf. l'article L. 420-5 du code de commerce.
* 28 Autorité de la concurrence, avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en outre-mer.
* 29 La formation des prix en Martinique, étude réalisée par le cabinet DME pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Martinique, avril 2023.
* 30 Article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 31 Articles 28 et 30 du TFUE.
* 32 Article 34 du TFUE.
* 33 Cette règle a été instaurée par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
* 34 Il s'agit des collectivités de l'article 73 de la Constitution, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
* 35 Les commerces de détail d'une surface inférieure, qui auraient pu avoir des difficultés à agréger ces données, ne sont pas soumis à cette obligation ; les commerces de plus grande taille disposent déjà, quant à eux, de systèmes d'information permettant cette agrégation de données.
* 36 Cf. les articles L. 910-1 A et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L. 410-5 et L. 462-1 du même code et l'article L. 113-3 du code de la consommation.
* 37 Ces mêmes distributeurs peuvent être en monopole ou oligopole à l'égard des consommateurs.
* 38 Cf. le rapport n° 1549, déposé le jeudi 20 juillet 2023 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L16B1549.html.
* 39 L'article L.441-1-2 du code de commerce précise que « le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes ».
* 40 Déposé le 4 décembre 2024.
* 41 Il s'agit des sociétés commerciales transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail.
* 42 Cf. les 2018-771 DC, consid. n° 5 et s. Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-771 du 25 octobre 2018).
* 43 CE, 10 octobre 2014, Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, n° 367.807.
* 44 Article 25 de l'Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004.
* 45 Article 96 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
* 46 Ibid.
* 47 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations »).
* 48 Conseil d'État, avis sur un projet de loi de lutte contre la vie chère, séance du 23 juillet 2025, paragraphe 41.
* 49 Dans son avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019, l'Autorité de la concurrence a estimé non seulement que les notions de produits identiques ou similaires figurant dans le droit actuel n'ont pas de traduction exacte en droit de la concurrence mais surtout que les produits de dégagement ne peuvent être regardés comme substituables à la production locale, ce qui a conduit le Conseil d'État à affirmer, dans son avis sur le projet de loi, que l'évolution proposée par le présent article n'est « pas de nature à résoudre les difficultés relatives à la définition du champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce ».
* 50 Source : Iedom, rapport annuel économique 2024 sur la Martinique.
* 51 Source : Iedom, rapport annuel économique 2024 sur La Réunion.
* 52 Source : Maurice Bilioniere, Philippe Clarenc, Zinaïda Salibekyan-Rosain, Comparaison de la rentabilité financière des PME dromiennes et hexagonales, Insee, juillet 2025.
* 53 Source : Recensement économique de la commande publique, chiffres 2023.
* 54 Source : Dany Wattebled, Simon Uzenat, rapport au nom de la commission d'enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française, Sénat, n° 830 (2024-2025), 8 juillet 2025.
* 55 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
* 56 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
* 57 Appels d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif.
* 58 Enquête sur la reconduction du Small Business Act ultramarin, Haut conseil de la commande publique de La Réunion, octobre 2022.
* 59 Proposition de loi n° 172 (2024-2025).
* 60 Rapport n° 830 (2024-2025) précité, recommandation n° 20.
* 61 C'est-à-dire un contrat de sous-traitance.
* 62 Source : Insee Première n° 1985, 21 février 2024.
* 63 OECP, Étude sur la sous-traitance dans les marchés publics, juillet 2020.
* 64 Source : Recensement économique de la commande publique, chiffres 2023.
* 65 Énoncée à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
* 66 Qui figure à l'article L. 2193-1 du code de la commande publique.
* 67 Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
* 68 Cf. supra.
* 69 CE Ass., 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, n° 107.400.